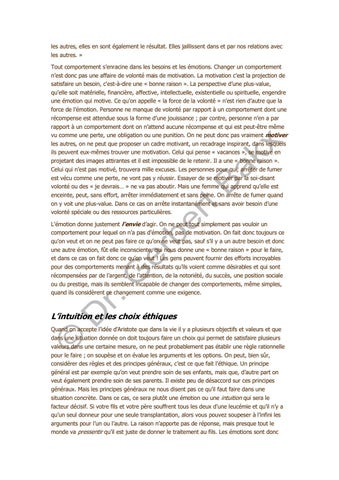les autres, elles en sont également le résultat. Elles jaillissent dans et par nos relations avec les autres. » Tout comportement s’enracine dans les besoins et les émotions. Changer un comportement n’est donc pas une affaire de volonté mais de motivation. La motivation c'est la projection de satisfaire un besoin, c'est-à-dire une « bonne raison ». La perspective d’une plus-value, qu’elle soit matérielle, financière, affective, intellectuelle, existentielle ou spirituelle, engendre une émotion qui motive. Ce qu’on appelle « la force de la volonté » n’est rien d’autre que la force de l’émotion. Personne ne manque de volonté par rapport à un comportement dont une récompense est attendue sous la forme d’une jouissance ; par contre, personne n’en a par rapport à un comportement dont on n’attend aucune récompense et qui est peut-être même vu comme une perte, une obligation ou une punition. On ne peut donc pas vraiment motiver les autres, on ne peut que proposer un cadre motivant, un recadrage inspirant, dans lesquels ils peuvent eux-mêmes trouver une motivation. Celui qui pense « vacances », se motive en projetant des images attirantes et il est impossible de le retenir. Il a une « bonne raison ». Celui qui n’est pas motivé, trouvera mille excuses. Les personnes pour qui, arrêter de fumer est vécu comme une perte, ne vont pas y réussir. Essayer de se motiver par la soi-disant volonté ou des « je devrais… » ne va pas aboutir. Mais une femme qui apprend qu’elle est enceinte, peut, sans effort, arrêter immédiatement et sans peine. On arrête de fumer quand on y voit une plus-value. Dans ce cas on arrête instantanément et sans avoir besoin d’une volonté spéciale ou des ressources particulières. L’émotion donne justement l’envie d’agir. On ne peut tout simplement pas vouloir un comportement pour lequel on n’a pas d’émotion, pas de motivation. On fait donc toujours ce qu’on veut et on ne peut pas faire ce qu’on ne veut pas, sauf s’il y a un autre besoin et donc une autre émotion, fût elle inconsciente, qui nous donne une « bonne raison » pour le faire, et dans ce cas on fait donc ce qu’on veut ! Les gens peuvent fournir des efforts incroyables pour des comportements menant à des résultats qu’ils voient comme désirables et qui sont récompensées par de l’argent, de l’attention, de la notoriété, du succès, une position sociale ou du prestige, mais ils semblent incapable de changer des comportements, même simples, quand ils considèrent ce changement comme une exigence.
L’intuition et les choix éthiques Quand on accepte l’idée d’Aristote que dans la vie il y a plusieurs objectifs et valeurs et que dans une situation donnée on doit toujours faire un choix qui permet de satisfaire plusieurs valeurs dans une certaine mesure, on ne peut probablement pas établir une règle rationnelle pour le faire ; on soupèse et on évalue les arguments et les options. On peut, bien sûr, considérer des règles et des principes généraux, c’est ce que fait l’éthique. Un principe général est par exemple qu’on veut prendre soin de ses enfants, mais que, d’autre part on veut également prendre soin de ses parents. Il existe peu de désaccord sur ces principes généraux. Mais les principes généraux ne nous disent pas ce qu’il faut faire dans une situation concrète. Dans ce cas, ce sera plutôt une émotion ou une intuition qui sera le facteur décisif. Si votre fils et votre père souffrent tous les deux d’une leucémie et qu’il n’y a qu’un seul donneur pour une seule transplantation, alors vous pouvez soupeser à l’infini les arguments pour l’un ou l’autre. La raison n’apporte pas de réponse, mais presque tout le monde va pressentir qu’il est juste de donner le traitement au fils. Les émotions sont donc