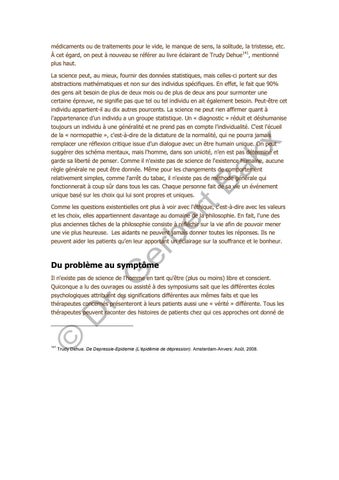médicaments ou de traitements pour le vide, le manque de sens, la solitude, la tristesse, etc. À cet égard, on peut à nouveau se référer au livre éclairant de Trudy Dehue141, mentionné plus haut. La science peut, au mieux, fournir des données statistiques, mais celles-ci portent sur des abstractions mathématiques et non sur des individus spécifiques. En effet, le fait que 90% des gens ait besoin de plus de deux mois ou de plus de deux ans pour surmonter une certaine épreuve, ne signifie pas que tel ou tel individu en ait également besoin. Peut-être cet individu appartient-il au dix autres pourcents. La science ne peut rien affirmer quant à l’appartenance d’un individu a un groupe statistique. Un « diagnostic » réduit et déshumanise toujours un individu à une généralité et ne prend pas en compte l’individualité. C'est l'écueil de la « normopathie », c'est-à-dire de la dictature de la normalité, qui ne pourra jamais remplacer une réflexion critique issue d’un dialogue avec un être humain unique. On peut suggérer des schéma mentaux, mais l'homme, dans son unicité, n’en est pas déterminé et garde sa liberté de penser. Comme il n'existe pas de science de l'existence humaine, aucune règle générale ne peut être donnée. Même pour les changements de comportement relativement simples, comme l'arrêt du tabac, il n'existe pas de méthode générale qui fonctionnerait à coup sûr dans tous les cas. Chaque personne fait de sa vie un événement unique basé sur les choix qui lui sont propres et uniques. Comme les questions existentielles ont plus à voir avec l'éthique, c'est-à-dire avec les valeurs et les choix, elles appartiennent davantage au domaine de la philosophie. En fait, l'une des plus anciennes tâches de la philosophie consiste à réfléchir sur la vie afin de pouvoir mener une vie plus heureuse. Les aidants ne peuvent jamais donner toutes les réponses. Ils ne peuvent aider les patients qu’en leur apportant un éclairage sur la souffrance et le bonheur.
Du problème au symptôme Il n'existe pas de science de l'homme en tant qu'être (plus ou moins) libre et conscient. Quiconque a lu des ouvrages ou assisté à des symposiums sait que les différentes écoles psychologiques attribuent des significations différentes aux mêmes faits et que les thérapeutes concernés présenteront à leurs patients aussi une « vérité » différente. Tous les thérapeutes peuvent raconter des histoires de patients chez qui ces approches ont donné de
141
Trudy Dehue. De Depressie-Epidemie (L’épidémie de dépression). Amsterdam-Anvers: Août, 2008.