



À 75 ans, on aura consacré 2 ans de nos vies à manger.
Et c’est là que les souvenirs se créent. Les soupers, les brunchs, les épluchettes, les potluck, les party d’huîtres, les réveillons, les poutines aux p’tites heures.
Le popcorn qui excite plus que le film. Le risotto plus trippant que la « date ».
Mais aussi, la tomate qui fait rouler l’économie. Le chou et le blé qui nous gardent en santé. Les producteurs qui font pousser le bonheur.
Bref, manger ne prend pas beaucoup de place dans nos vies.
table des contenus
Intro
Le succès : u ne recette de famille !
P réface : u n livre anniversaire pas comme les autres
Metro : 75 ans d’innovation
Les villes
Le Groupe Messier : de racines en boutures
Metro, une porte sur le monde
La famille Bellemare : u ne histoire de complicité
L’alimentation dans une nouvelle ère
Les produits phares : les tomates et cie
Les Productions Horticoles Demers : se renouveler dans la continuité
K im Lam : u n patrimoine culinaire inestimable
V irée gourmande dans les villes
Recette : tomates aux épices à steak, mayo aux herbes et croustillant de pain
Les champs
La famille Marquis : l’innovation depuis trois générations
Loounie : v ivre de sa passion
La famille Beaulieu : a imer son métier, c’est la clé !
Les Fermes Émile Gariépy : u n rêve transformé en citrouille
P ierre D’Amour : le routard de Drummondville
Metro dans les champs
P ierre James : le choix au repêchage
V irée gourmande dans les champs
Les produits phares : le maïs et cie
Recette : t atin aux pommes et cidre fermier, crème fouettée à l’érable et au mélilot
Le fleuve
La famille Ferland : 100 ans dans la peau d’un épicier
L’ouverture des marchés le dimanche
Pierre-Luc Arseneault : l e gars du Metro
Le Saint-Laurent dans notre assiette
Les produits phares : le crabe des neiges et cie
V irée gourmande sur et aux abords du fleuve
Recette : t artine au beurre d’algues et salade de crevettes nordiques
Les montagnes
La famille Bolduc : v ivre avec les gens qu’on aime
I sabelle Huot : u n phare dans le milieu de la nutrition
La famille Thibeault : d’épiciers à bâtisseurs
Pour l’amour du bio
V irée gourmande dans les montagnes
Les produits phares : l’agneau et cie
Recette : soupe à l’oignon en croûte, veau de Charlevoix braisé et Migneron
Les lacs et les rivières
A ndré Fortin : la main à la pâte et l’oreille tendue
Une petite bière dans le panier
Les produits phares : la truite et cie
La famille Boutin : bâtir pour demain
V irée gourmande sur les lacs et les rivières
Recette : fi let de doré rôti, vichyssoise de laitue et quinoa croustillant
Les forêts
La famille Plouffe : l’importance de l’équipe
K pour Katrine : parcours d’une gourmande créative
V incent Saumure : le patron tant aimé
Le terroir forestier, une mine d’or pour la cueillette
Le temps des sucres en épicerie
Retour vers nos racines
Les produits phares : les champignons et cie
V irée gourmande dans les forêts
Recette : ragoût de champignons sur un pancake de pommes de terre et salade d’herbes
La mer
Jean-Pierre Durette : à la conquête de Sainte-Anne-des-Monts
L'appel du large
Le goût des Îles
Virée gourmande à la mer
Les produits phares : les huîtres et cie
Recette : homard gratiné au cheddar vieilli, sauce crémeuse aux herbes salées et boutons de marguerite
Dans ce livre, vous trouverez 75 points identifiés, comme les 75 bougies pour souligner l’anniversaire de Metro. Ce sont 75 choses marquantes : un point d’histoire, un fruit important au Québec, des gens qui comptent pour Metro, un produit ou un lieu gourmand à découvrir, etc.
01 1986, une année marquante : Metro entre en Bourse
02 Le Groupe Messier et la recherche de l’excellence sur 70 ans
18 La culture de la bienveillance avec Pierre D'Amour
19 Metro sait cultiver les champs
20 Pierre James, le capitaine du Metro Plus de Victoriaville
21 La Ferme Les Petites Écores propose de grandes surprises
22 La Ferme Guy Rivest, une promenade dans les champs
23 Les Vergers Ivanhoë Faille : plus grand fournisseur de bleuets chez Metro
24 Pour tout savoir sur la canneberge, visitez son centre d’interprétation
25 La Ferme Genty : coup de cœur pour la vache Highland
26 Le Domaine Labranche, pour goûter les saveurs d’ici
27 C ’est à la Ferme aux Mille Cailloux que l’on retrouve les cerises griottes

28 Le maïs, fidèle acolyte de nos fins d’été
29 Un peu de cidre en plus? Une tatin aux pommes savoureuse
30 La famille Ferland ou la passion du métier d’épicier depuis plus de 100 ans
31 Pierre-Luc Arsenault, R imouski tatoué sur le cœur
32 Goûter les trésors du fleuve Saint-Laurent, une découverte à la fois
33 Le crabe des neiges, la vedette de notre estuaire chéri
La Ferme Guyon, une expérience gustative et éducative
Cultiver Montréal, pour une ville plus verte
Virées gourmandes avec les guides de Tours de la Table
Un mélange audacieux : tomates et épices à steak
La famille Marquis : de générations en innovations
Devenir l’égérie de l’alimentation végétale chez Metro
A imer son métier avec la famille Beaulieu
Le principal fournisseur de citrouilles de Metro, c’est lui!
10
11
12
13
14
15
16
17
03 Adonis et Metro? L’Orient rencontre l’Occident!
qui a misé sur la qualité
tend la main à
monde de saveurs!
de découvertes
04 Suivre son instinct avec les Bellemare 05 De nouvelles approches pour aider la planète 06 La tomate, trésor de nos serres urbaines 07 Les serres Demers : la ferme
08 Metro
un
09 Les marchés publics, mines
index
Retrouvez les 75 clés de notre culture gastronomique.
34 Cassis Monna & Filles, ou l’art de déguster notre terroir
35 La Ferme Maricole Purmer vous offre les richesses du Fleuve
36 Racines boulangerie fermière : goûter L'IsleVerte à chaque bouchée
37 Crevettes, beurre d’algues et salicorne? Osée, l’entrée!
38 La famille Bolduc, cultiver le bonheur à La Malbaie
39 I sabelle Huot et son amour du prêt-à-manger
40 La famille Thibeault, un entreprenariat hors du commun
41 Promouvoir la viande biologique, la mission des Girard-Mc Nicoll
42 Une promenade gourmande dans les Jardins de Cap-à-l’Aigle
43 La Ferme Ambrosia, un gîte enchanteur
44 La Fromagerie Bergeron, plaisir garanti!
45 Truffe Charlevoix : raffiné et de bon goût
46 La Ferme MarieNoëlle Beaulieu, pour le plaisir des enfants
47 L’agneau de Charlevoix, certifié IGP
48 Un classique : une soupe à l’oignon en croûte
49 André Fortin, notre ami du Lac
50 Éclosion des m icrobrasseries chez Metro
51 La truite, un joyau dans nos rivières
52 La Famille Boutin, LA famille du Lac-Saint-Jean
53 Une journée de pêche inoubliable avec Aventure Lac Saint-Jean
54 Une balade sur la Véloroute des Bleuets

55 Garnir son garde-manger en empruntant le Chemin du Terroir
56 À la Pourvoirie du Lac Matchi-Manitou, poissons à profusion
57 Si mple et délicieux : filet de doré rôti
58 La famille Plouffe : faire grandir l’équipe
59 De la bonne cuisine pour tous, c’est K pour Katrine
60 Vincent Saumure, u n boss pas ordinaire
61 Le champignon, chefd’œuvre de nos forêts
62 Le Chemin du Roy : une virée riche en découvertes
63 Une expérience écovégétalienne à La Cabane à Tuque
64 Connaître le secret des abeilles à la Miellerie de la Grande Ourse
65 Faire le plein de délicieuses pâtisseries à La Cabane sur le Roc
66 Un goût de bois : ragoût de champignons
67 Jean-Pierre Durette : coup de cœur pour Metro
68 Anthony Dubé : un partenaire en mer
69 Le goût des Îles ou la gastronomie qui va loin
70 Devenir pêcheur madelinot avec Interprétation de pêche en mer
71 La Distillerie des Marigots, le savoirfaire gaspésien
72 À la chasse aux petits fruits dans la Vallée de la Framboise
73 Couleur Chocolat, écomusée pour les papilles
74 L’huître du Québec, une saveur variée selon son coin de pays
75 Heureux mélange : homard gratiné et cheddar vieilli!

Le succès : une recette de famille !

Metro est l’épicier des Québécois depuis 75 ans, soit trois générations de marchands qui ont mis leur passion à contribution et continuent de le faire pour nourrir le bien-être, la curiosité et les goûts de 8 millions de Québécois.
Plus que jamais, nous sommes tournés vers l’avenir et avons à cœur le dynamisme de l’économie d’ici, le développement durable et la santé des générations futures. Nous avons profité de cet anniversaire pour renouveler nos plateformes de communication et lancer Manger c’est la vie, un hymne à notre vocation d’épicier et à notre mission de nourrir le Québec.
Aujourd’hui, Metro est fière d’être un chef de file de l’alimentation et de faire partie des marques favorites au Québec. La recette de notre succès est une histoire que nous écrivons ensemble, depuis 75 ans. Avec ce livre, nous souhaitons vous remercier de votre formidable travail, ainsi que celui de nos partenaires et producteurs, partout au Québec, pour qui manger, c’est vraiment la vie !
Eric La Flèche Président et chef de la direction
 Photos : Metro (portrait de M. La Flèche), Signé Gourmand (portrait de Mme Laurendeau), Maude Chauvin (portrait de M. Juneau)
Photos : Metro (portrait de M. La Flèche), Signé Gourmand (portrait de Mme Laurendeau), Maude Chauvin (portrait de M. Juneau)
Préface
Voici un livre anniversaire pas comme les autres.
On y raconte des aventures humaines, des histoires d’entreprises, on y découvre des produits délicieux ; on y parle du Québec et des personnes qui ont la nourriture en commun et qui participent à la construction d’une culture majeure : la culture de la gastronomie d’ici.
C’est un livre qui vient saluer le travail de Metro depuis 75 a ns. Plus qu’un distributeur alimentaire, Metro se veut un partenaire dans l’émancipation et dans l’épanouissement d’un Québec toujours plus gourmand, toujours plus curieux et épicurien. Sans relâche, Metro participe au bien manger et au mieux manger.
Depuis 75 a ns, Metro est un rouage important, qui continue de nourrir le Québec. Pour cela et pour tenter de décrire ce qu’est le Québec d’aujourd’hui et sa nourriture, le livre est découpé en sept territoires nourriciers – les villes, les champs, le fleuve, les montagnes, les lacs et les rivières, les forêts et la mer. Ces territoires, chacun à leur manière, participent à nourrir le Québec. On y retrouve des produits phares, des cultures uniques, mais aussi des portraits d’artisans et de marchands qui y travaillent et qui contribuent à faire grandir le terroir québécois.
Pour guides, nous avons choisi deux experts, curieux et enthousiastes, fins connaisseurs de l’art culinaire et fiers gourmands à 100 % !
H élène Laurendeau , nutritionniste et spécialiste des communications, connaît chaque recoin du Québec, chaque spécialité et chaque produit. Des recettes familiales traditionnelles aux explorations d’avant-garde, elle sait expliquer la merveilleuse chimie de la cuisine. Pour ce livre, elle nous ouvre la porte de tous les territoires et nous accompagne à la rencontre du meilleur.

Martin Juneau , chef renommé et restaurateur, homme d’affaires et de communication, il est l’entrepreneur culinaire aux mille projets. C’est avec enthousiasme et curiosité, et en tant que nouveau chef exécutif de Metro, qu’il a imaginé sept recettes pour ce livre. Sept recettes qui sont des points de référence des territoires choisis. Elles sont simples et raffinées, vous allez les adorer !

B onne lecture et bon voyage à travers le Québec qui se mange !
Joyeux anniversaire, Metro.

01
Metro : 75 ans d’innovation
Déjà soixante-quinze années se sont écoulées depuis que les magasins Lasalle Stores ltée ont vu le jour sous l’impulsion de Rolland Jeanneau, le 22 d écembre 1947, dans l’ancienne ville de Verdun. En s’associant à 18 a utres épiciers indépendants, l’entrepreneur natif de Sainte-Martine-de-Châteauguay souhaite offrir des produits abordables, et concurrencer les grandes chaînes comme Steinberg, Dominion, A & P ou encore Dionne et Union.
Alors que le concept de libreservice se répand dans les magasins d’alimentation du Québec, l’entreprise ajoute le terme « Groceteria » à son enseigne et devient Les Épiceries Lasalle Groceteria en 1952. Désormais, les clients ont un accès direct aux étals et à une plus grande diversité de produits. En 1954, à l’approche de Noël, l’entreprise achète une pleine page publicitaire dans La Presse pour y présenter des aubaines sur divers produits, dont la fa meuse dinde du Québec à 39 cents la livre. Ce coup publicitaire sans précédent lui permet de gagner en popularité auprès des Québécois.
S’associer pour avancer
En 1956, Les Épiciers Maisonneuve rejoignent Les Épiceries Lasalle Groceteria, et une division est créée : groupe des épiciers Metro. Metro, un nom inspiré du projet du maire Jean Drapeau que l’on connaît tous, le métro de Montréal.
La compagnie connaît ensuite une croissance fulgurante. Au
tournant des années 1970, elle noue un partenariat avec les Épiceries Richelieu pour fonder Bœuf Mérite, un acronyme composé de la première syllabe de Metro et de Richelieu, auxquelles les lettres « t e » o nt été ajoutées. Jardin Mérite voit le jour peu de temps après pour la distribution de fruits et de légumes frais, ainsi que de produits surgelés.
Cette alliance mènera Marchés d’Aliments Metro et Épiceries Richelieu à se regrouper en 1979 sous le nom de Metro-Richelieu ; u ne nouvelle entreprise comptant 520 m agasins et un chiffre d’affaires de 345 millions de dollars.
Devenir un leader, une acquisition à la fois L’année 1986 marquera également un tournant dans l’histoire de Metro alors qu’elle inscrit ses actions à la Bourse de Montréal. S’en suivront plusieurs acquisitions, dont celle de McMahon Distributeur pharmaceutique inc., propriétaire des pharmacies Brunet et Pêcheries atlantiques du Québec, puis de La Ferme Carnaval, qui possède alors 14 m agasins d’alimentation à escompte Super Carnaval, connus aujourd’hui sous le nom de Super C. En 1992, alors que l’entreprise traverse des moments plus difficiles, elle parvient à tirer son épingle du jeu et à augmenter sa présence dans la grande région de Montréal en obtenant les baux et les droits de 48 magasins d’alimentation appartenant à la famille Steinberg, alors en faillite.
Dans les années 2000, Metro Richelieu étend ses activités en Ontario avec l’acquisition de 41 s upermarchés Loeb, ainsi que de la chaîne d’épiceries The Great Atlantic & Pacific Company of Canada (A&P Canada). Ceci place l’entreprise au deuxième rang en termes de parts de marché au Québec et en Ontario, avec respectivement 35 % et 24 %.
Souhaitant se différencier de la concurrence et répondre aux nouveaux besoins de ses clients, Metro s’associe en 2011 au Marché Adonis, spécialisé dans les produits frais, méditerranéens et les plats préparés. La bannière noue ensuite un partenariat avec Boulangerie Première Moisson, un autre fleuron québécois.
Si Metro possède aujourd’hui un réseau de quelque 950 m agasins d’alimentation sous plusieurs bannières dont Metro, Metro Plus, Super C et Food Basics, l’entreprise détient également près de 650 pharm acies sous les bannières Jean Coutu, Brunet, Metro Pharmacy et Food Basics Pharmacy.
Alors qu’elle vient tout juste de souffler ses 75 bougies, Metro continue de se projeter dans l’avenir et d’innover au quotidien, sans pour autant oublier d’où elle vient. C’est avec ses souvenirs du temps d’avant qu’elle fonde toute la base des prochaines années ; off rir des produits abordables et de qualité aux gens d’ici, parce que manger, c’est la vie !
Photo : Metro
Elles grouillent d’activités et nous font vibrer au rythme de leurs festivités. Chaque ville veut nous séduire avec sa personnalité, ses couleurs et sa bouffe à l’honneur. Camions de rue ou terrasses de bistrot, cantines ou grands restos, des chefs de toutes origines confondues nous en mettent plein la vue ! Leurs prouesses culinaires font notre fierté et nous incitent à tout goûter. Même jusque sur les toits, où des ruches sont installées, des vignes, plantées et des serres, déployées. En plein centre-ville ! De véritables jardins d’agriculture urbaine où poussent des légumes et des fines herbes à l’année. Il existe aussi des fermes urbaines qui cultivent des champignons, d’autres qui visent l’innovation et la recherche universitaire. On en apprend, des affaires ! Dans les écoles de formation culinaire, des apprentis cuisiniers et pâtissiers côtoient nos futurs sommeliers. Les cuisines collectives, ces lieux rassembleurs et nourrissants pour les participants, accueillent pendant ce temps jeunes mamans, étudiants et nouveaux arrivants. Et tout ce joyeux monde se croise dans les nombreux marchés colorés, comme une grande courtepointe de la vie.





Photos : Hoi Do Photography –T ourisme Montr é al (caisses de légumes) et Les Fermes Lufa (salades en serre)




02 02
France Messier
Albert Messier
Vincent Messier
Simon-Pierre Dalpé-Messier
Le Groupe Messier : de racines en boutures
Au sein du milieu québécois de l’alimentation, le Groupe Messier pourrait se qualifier de petit empire. Lumière sur cette entreprise qui résiste aux changements de garde et aux fluctuations économiques en appliquant la logique suivante : Demain, il faudra bien manger! Aussi bien exceller!
Trois-cent-vingt-cinq. C’est le nombre de pieds carrés du premier magasin d’alimentation qu’a ouvert, en 1953, Jean-Claude Messier, à l’âge de 22 a ns, rue Bélanger à Montréal. « C ’était si petit que ma mère racontait que, alors qu’elle était enceinte de mon frère Gilles, le tiroir-caisse du magasin lui cognait sur le ventre à chaque transaction », explique France Messier, présidente du Groupe Messier. On pourrait presque dire que les quatre enfants de Thérèse et Jean-Claude Messier sont nés sur une tablette d’épicerie !
Moins de cinq ans plus tard, cette personnalité du monde de l’alimentation rejoignait la bannière Metro, et septuplait la superficie de son commerce. Le reste est une combinaison de passion et d’acquisitions, et il faut y ajouter la capacité de convaincre trois de ses enfants d’étudier en administration des affaires. Avant de prendre leur retraite, les frères Gilles et Denis avaient tour à tour présidé l’entreprise. Jusqu’à l’âge de 85 a ns, le fondateur du Groupe Messier se rendait encore au travail. Il est décédé pendant la pandémie.
Soixante-dix ans et trois générations plus tard, France Messier, la fille du fondateur, dirige le Groupe Messier depuis plus d’un an. Elle est appuyée par une solide équipe, dont ses trois fils, qui constituent la relève familiale : Simon-Pierre, 38 a ns, est directeur général, Albert, 35 a ns, voit aux opérations et Vincent, 33 a ns, supervise la sphère informatique. Le Groupe Messier réunit 1100 employés, âgés entre 14 et 70 ans, dans 10 magasins du Grand Montréal.
« Mon père a toujours été à la recherche de l’excellence, et exigeait du personnel le souci du détail. Il répétait aux employés que sans les clients, nous n’étions rien, et qu’il
fallait rester à l’écoute, décrit sa fille. Mes frères ont siégé à différents comités de Metro et ont été très actifs afin de faire grandir le Groupe Messier. J’y suis maintenant, et mes fils y seront bientôt. On s’est passé le relais depuis sept décennies, et les valeurs de mon père – rigueur, droiture et authenticité – ont façonné mon éthique de travail. »
À 63 a ns, la présidente observe qu’elle a parlé jusqu’à maintenant de « r acines » et qu’il est désormais question de « b outures ». La dirigeante a une conviction : « Je suis là pour mentorer, mais certainement pas pour développer. L’avenir appartient à mes fils. Les trentenaires ont des valeurs différentes et une manière d’agir propres à leur génération. »
De fait, Simon-Pierre Dalpé-Messier, l’actuel directeur général et futur président du Groupe Messier, quitte le bureau plus tôt que sa mère, ses oncles ou son grand-père. Il souhaite atteindre un équilibre. « Heureusement, je suis bien entouré par des collègues qui ont vraiment à cœur la compagnie. Dans ce contexte, il est essentiel d’accepter que les choses ne seront pas faites exactement comme je les aurais faites. Je dois plutôt m’assurer que ce qui doit être fait sera bien fait. Être à l’écoute est primordial : les employés ont souvent la solution, il suffit d’écouter ! »
E n 2022, l’équipe de direction a offert des promotions à de nombreux employés dans la trentaine et la quarantaine, ce qui a permis de rajeunir l’entreprise. Et, comme ses frères, Simon-Pierre Dalpé-Messier demeure un homme qui cherche à mettre les valeurs familiales au premier plan. Et comme les fils de France Messier ont cinq jeunes enfants – dont le plus vieux n’a que six ans – à eux trois, le Groupe Messier n’a pas dit son dernier mot...
Photos : Mar ï Photographe




03
Metro, une porte sur le monde
À l’image de la ville cosmopolite qui l’a vue naître, Metro s’est transformée au fil des ans pour faire sa place et proposer une offre alimentaire variée. Et si Montréal est aujourd’hui une véritable porte sur le monde, les épiceries ne sont certainement pas étrangères à ce phénomène.
Un renouveau culinaire
Au cours du 20 e s iècle, Montréal connaît d’importantes vagues d’immigration. Les premières décennies voient les communautés chinoise, italienne, juive de l’Europe de l’Est, polonaise, ukrainienne, britannique, irlandaise, polonaise ou portugaise ouvrir des restaurants et des épiceries dans la métropole pour perpétuer leur identité culinaire. Il suffit encore aujourd’hui de longer le boulevard Saint-Laurent pour voir se côtoyer mets asiatiques, spécialités juives, plats portugais, restaurants italiens et grecs.
Cette diversité culturelle va s’accentuer avec l’arrivée de populations vietnamienne, indienne, africaine et haïtienne et de leur savoir-faire alimentaire.
C’est toutefois à partir des années 1960 que le Québec connaît un renouveau culinaire. Portée par la Révolution tranquille de Jean Lesage, la province s’émancipe et se réapproprie son identité culturelle et gastronomique, s’ouvrant par le fait même sur le monde.
Mais l’évènement qui a ouvert les horizons culinaires des Québécois reste l’Expo 6 7. En l’espace de six mois, plus de 50 m illions de personnes ont ainsi découvert une offre alimentaire dont elles ne soupçonnaient pas l’existence. Les visiteurs ont pu se délecter, bien souvent pour la première fois, de spécialités provenant de 62 pays, incluant le Canada. Cette expérience gastronomique a marqué à jamais les Québécois en ce qui concerne leur alimentation.
Des habitudes alimentaires qui évoluent
Alors que les aliments naturels et biologiques et les produits fins connaissent un engouement, les produits exotiques et importés sont eux aussi en forte demande. Ce phénomène s’explique, d’une part, par l’adoption de nouvelles habitudes alimentaires par la population et, d’autre part, par la présence de communautés culturelles à travers le Québec.
Pour se différencier de la concurrence et s’ajuster à sa clientèle, Metro fait le pari en 2011 de développer le segment des aliments « e thniques » e n s’associant à Marché Adonis, fondé par les frères Elie et Jamil Cheaib et spécialisé dans les produits frais, méditerranéens et les plats préparés, ainsi qu’à Produits Phoenicia, qui importe et distribue ces produits.
S’il est possible de trouver tous les produits de base dans l’ensemble des épiceries de l’enseigne, chaque magasin a toutefois ses particularités afin de pouvoir répondre aux besoins spécifiques et aux habitudes alimentaires de sa clientèle. Par exemple, le Metro de Côte-des-Neiges est généralement plus fourni en marchandises asiatiques, moyen-orientales et casher, alors que celui du quartier Saint-Michel possède une grande variété de produits tels que des dattes et des figues fraîches.

04 04
Manon, Robert et Mylène Bellemare
La famille Bellemare : une histoire de complicité
Mylène Bellemare s’apprêtait à faire sa rentrée à l’université en enseignement du primaire. Elle était fébrile, mais cette fébrilité venait plutôt du sentiment profond de ne pas faire tout à fait le bon choix, de ne pas être vraiment à la bonne place. Sa chaise allait rester vacante à la faculté. Son instinct lui a dit qu’un bonheur bien plus grand l’attendait. Mylène aimait le travail en soi, et l’aspect familial, aussi. Elle était chef-caissière dès ses 19 a ns et appréciait autant le service à la clientèle que la gestion des équipes. Adolescente, elle accompagnait son père aux réunions de dirigeants. « Je pense que je ne m’étais jamais permis d’imaginer que Metro puisse devenir ma vraie carrière, note-t-elle. Ce travail avait d’abord constitué un jeu, puis un job d’étudiante. Il m’a fallu m’apprêter à quitter l’entreprise familiale pour comprendre que, en fait, je ne la quitterais jamais. »
Aujourd’hui, Mylène est VP aux opérations et sa sœur Manon, VP aux affaires immobilières. Pour Metro, c’est Mylène, assistée de Manon, qui prendra les rênes des mains de Robert, leur père. Mais rien ne presse. À les écouter raconter leur histoire, on sent toute la complicité et tout le respect qu’il y a dans la famille. La future présidente ne cesse de souligner tout ce que son père lui a appris. Lui ne tarit pas d’éloges sur le talent naturel de ses dirigeantes. « M anon fait preuve de beaucoup de rigueur, elle ne s’en laisse jamais imposer. Du côté de Mylène, j’admire son grand sens de la justice : tout ce qu’elle demande aux employés, elle le donne en retour. Elle gère sans conflit, c’est admirable », note l’homme de 73 ans.
Tout a commencé à Verdun en 1949 avec Roland et Claire, et leurs deux fils, Claude et Robert. Ce dernier a pris les rênes des mains de son père, et rebelote avec ses deux filles, épaulé par son épouse, Ginette.
Lorsque Roland est décédé à l’été 2016, le patriarche de 94 a ns a cédé à la famille un important parc immobilier et quatre magasins. Aujourd’hui, les Bellemare fêtent 65 a ns sous la bannière Metro, et suivant le leitmotive du fondateur, Robert et ses filles s’assurent de toujours posséder l’immeuble qui abrite le Metro qu’ils gèrent. Leurs magasins se trouvent à Saint-Hubert, à Verdun et deux fois à Brossard, où, avec la venue du REM, leur position est des plus stratégiques.
Parallèlement à la gestion des Marchés Bellemare, Robert a également mené quelques projets personnels, dont la gestion du Metro de Marieville dans les années 1990. Situé en pleine zone rouge pendant la crise du verglas, la famille avait alors reçu de l’armée canadienne l’ordre de demeurer opérationnelle. « Sans chauffage, notre personnel travaillait en habit de neige, se rappelle Robert. Sans électricité, nous sommes revenus à la méthode du bon vieux temps : marquer les achats dans un calepin car nous n’avions ni caisses ni guichets fonctionnels! Ça a duré 26 jours et 26 nuits! Toutes les routes étaient fermées. Heureusement, on pouvait compter sur le support du bureau chef pour le transport et l’approvisionnement. » Disons que chez les Bellemare, la pandémie ne constituait pas leur première gestion de crise! En près de huit décennies en affaires, les anecdotes se bousculent.
On dit souvent que l’histoire se répète. Ici, transmission des valeurs oblige, on dira plutôt que l’histoire se perpétue. Et si Roland, à son époque, avait été baptisé ministre des Finances , Robert aura sans doute été un formidable ministre au Développement et à l’Innovation . Il revient maintenant à Mylène de prendre sa place. On chuchote autour d’elle qu’elle fera à son tour, et sans contredit, une excellente ministre de l’Humanité
« J’ai commencé à travailler dans les fruits et légumes vers l’âge de 8 ans, raconte la jeune femme, qui en aura 40 en avril. Je pense que mon père faisait toujours attention pour que ma sœur et moi, on s’amuse en travaillant. Visiblement, sa tactique a fonctionné. »
Photo : Karine Lévesque
L’alimentation dans une nouvelle ère
Pollution, réchauffement climatique, gaspillage : notre manière de manger peut engendrer à long terme des conséquences sur l’environnement. Pour faire face à cet enjeu, des groupes de citoyens tout comme des dirigeants de grandes entreprises se mobilisent afin de contribuer à un écosystème durable. Entretien avec des visionnaires sur les principaux enjeux de l’alimentation de demain.
Des défis colossaux à venir
Au cours des prochaines années, de nombreux enjeux globaux pourraient entraîner des répercussions sur la manière dont nous mangeons, en raison de l’équilibre toujours plus précaire des chaînes d’approvisionnement alimentaire. C’est du moins l’intime conviction du PDG et cofondateur des Fermes AquaVerti, Georges Aczam, dont les produits bio cultivés en serre se retrouvent dans les rayons des succursales de Metro.
« Les températures changent partout dans le monde, ce qui cause de la sécheresse dans certains coins du globe ou, à l’inverse, l’excès de précipitations, indique-t-il. Les récoltes en sont donc durablement perturbées. » Selon le jeune PDG, ces enjeux, jumelés à des conflits interétatiques et à l’usage intensif des pesticides, devraient nous amener à repenser l’alimentation d’un point de vue local.
Un virage vers la culture en serre ?
L’autonomie alimentaire fait-elle partie de la solution ? Bien qu’elle soit plus difficile à atteindre en raison du caractère nordique de la province, Georges Aczam estime qu’il est toutefois possible de s’en approcher grâce à l’agriculture en serre : « Ce mode de culture fournit des fruits et légumes à longueur d’année, ce qui permet de s’affranchir — du moins en partie — de notre dépendance aux denrées d’importation », ajoute-t-il. Il applaudit d’ailleurs les efforts de Metro pour prioriser des partenariats avec des producteurs locaux pratiquant la culture en serre.
Innover avec l’agriculture urbaine
Un bâtiment au cœur de la ville n’est pas exactement l’image que l’on associe à une ferme. Pourtant, l’agriculture en milieu urbain pourrait bien être une solution privilégiée pour favoriser l’autonomie alimentaire dans une perspective durable. Voilà pourquoi des entrepreneurs innovants transfigurent l’industrie en adoptant l’agriculture verticale. Ce mode de culture n’exige qu’un nombre limité de pieds carrés, ce qui convient parfaitement à la région métropolitaine : « Notre
Sur la page de droite
Georges Aczam, PDG et cofondateur des Fermes AquaVerti, à Montréal, dans ses plus récentes installations de serres verticales. Ici, on cultive les plants dans l'eau, pas dans le sol, les uns par-dessus les autres.


05
Photos : Alexandre Turgeon
ferme est située en plein dans l’arrondissement Saint-Laurent. Puisque nous rénovons des entrepôts qui sont abandonnés ou vides, nous n’avons pas besoin de détruire un espace vert pour faire la production alimentaire », affirme le PDG des Fermes AquaVerti.

Le gaspillage alimentaire : un enjeu capital
L’avenir de l’alimentation passe sans contredit par la réduction du gaspillage, selon Guillaume Cantin, co-initiateur et directeur général de La Transformerie, un organisme qui contribue à l’atteinte de cet objectif. Une question plus difficile à résoudre qu’il n’y paraît. À notre dépendance aux mégastructures mondiales s’ajoute l’attitude souvent cavalière des gens face aux aliments. « C ’est un problème complexe et multifactoriel, explique-t-il. Il ne faut pas oublier que notre système est lié à l’abondance. La nourriture est vue comme une denrée de consommation courante, ce qui fait que l’on en gaspille beaucoup. »
C omment envisage-t-il l’avenir ?
Guillaume Cantin partage l’avis de Georges Aczam, qui prône l’instauration de structures locales, centrées sur des bannières privilégiant les circuits courts, comme Metro. Selon lui, cette décentralisation permet de modifier notre rapport à l’alimentation : « D’acheter sa nourriture à des artisans d’ici, de savoir d’où ça vient, ça nous incite à l’apprécier et à éviter de la gaspiller. »
06
Guillaume Cantin, co-initiateur et directeur général de La Transformerie à Montréal.
Photo : Maude Chauvin –Sélection du R eader’s Digest (novembre 2019). Périodiques Reader’s Digest Canada limitée (portrait de M. Cantin).
Produits phares
Il y aurait près de 15 000 variétés de tomates dans le monde… En ville, on retrouve maintenant une grande diversité de tomates quant au format, à la fermeté de la chair et à la couleur. Acide ou très sucrée, en bouchée cocktail ou en sauce ragù, la tomate est un incontournable. On en mangerait tous les jours, et du matin au soir! Et c’est aussi en ville, été comme hiver, que l’on retrouve le plus grand choix de laitues, mais aussi de fines herbes et de poivrons : des productions toujours fraîches, cultivées en serres, locales et diversifiées.

06



07
Se renouveler dans la continuité
Innover, moderniser, bâtir : telle est la devise de Jacques Demers, le PDG de Productions Horticoles Demers. Celui qui s’est engagé sur la voie de ses parents en reprenant les rênes de la ferme familiale visait toutefois plus loin. Comment? Révolutionner l’industrie, tout simplement.
Fort d’un solide bagage transmis par ses parents, Jacques Demers comprend mieux que quiconque les exigences rigoureuses de son métier. Les nombreuses contraintes, les horaires surchargés, la cadence atypique sont des notions familières à l’homme d’affaires, qui a passé d’innombrables heures à trimer sur la ferme familiale.
C’est en connaissance de cause que Jacques Demers restructure l’exploitation de l’entreprise lorsqu’il en prend la direction avec son frère Réjean, au début des années 1990. « L’intention n’était pas de recopier le modèle de nos parents. Je n’avais pas le goût de vivre ce mode de vie là, affirme-t-il. L’objectif, quand nous avons racheté la ferme, c’était de la transformer et de la faire croître. »
P lutôt que de s’éparpiller dans la culture d’espèces variées, Jacques Demers choisit de concentrer ses efforts sur une gamme de produits, dans le but d’en rehausser la qualité de manière significative. « On pourrait tenter d’être bons dans tout, mais on préfère être les meilleurs dans la production de quelques cultures. C’est de là qu’est partie l’idée de se concentrer sur les fruits et légumes de serre. »
Faire différemment donc, mais surtout faire mieux. L’homme d’affaires se retrousse les manches pour reconfigurer la ferme familiale, un défi titanesque qui s’échelonne sur plusieurs années. « N ous l’avons transformée graduellement, explique-t-il. À ce moment-là, nous avons
gardé les deux produits les plus importants : l a tomate et les fraises, précise-t-il. Auparavant, la saison des fraises ne durait que quatre semaines. En serre, on en produit 12 mois par année. »
Une complicité qui perdure
Si la relation avec Metro a traversé l’épreuve du temps, elle a su évoluer avec l’essor de l’entreprise. Partie de trois ou quatre succursales, Productions Horticoles Demers ravitaille désormais tout le réseau. Cette collaboration a d’ailleurs été cruciale pour la croissance de l’organisation. « C ’est un lien important qui a grandi au fil des années, en connaissance des besoins et des limites de part et d’autre », confie le PDG
En partenariat avec Metro, Jacques Demers est fier de contribuer à l’alimentation des gens d’ici. Ce rôle, qu'il prend au sérieux, le motive dans sa poursuite de l’excellence. « Fabriquer quelque chose pour nourrir la population, je trouve ça louable, confesse-t-il. J’approvisionne une partie des Québécoises et Québécois, je mets des aliments dans leur assiette tous les jours. De le faire, avec des produits de qualité, qui ont bon goût… J’aime cette idée-là, je trouve ça très valorisant. Ça me motive à aller plus loin. »
Photos : F abrice Gaëtan –Metro
Kim Lam : un patrimoine culinaire inestimable
Un goût d’exotisme, des parfums enivrants… D’aucuns ne sauraient résister aux mets savamment élaborés par Kim Lam. Il n’est donc guère étonnant que ses plats surgelés se soient frayé un chemin jusqu’aux rayons de Metro. Portrait d’une entrepreneure qui n’a pas froid aux yeux.
« J ’ai toujours eu le goût de cuisiner », lance d’entrée de jeu la femme d’affaires aux yeux pétillants et au sourire communicatif. Une passion transmise par son père, qu’il a lui-même héritée de ses parents d’origine chinoise. Bien que sa trajectoire ait été teintée par la tragédie lorsqu’il a fui le Viêtnam en 1978, son père a réussi non seulement à lui inculquer son amour de l’art culinaire, mais aussi à lui inspirer une force de caractère à toute épreuve.
Car il en faut du cran — v oire une solide dose de culot — p our se lancer en affaires, en ayant comme seule ressource un répertoire de recettes familiales. « Q uand j’ai commencé, je venais de divorcer, mentionne Kim Lam. Je n’avais pas d’argent et je n’avais même pas accès à un prêt ! » Elle flaire toutefois un filon lorsque ses voisins, attirés par des effluves alléchants, débordent d’enthousiasme à la vue de ses rouleaux impériaux.
« D es gens m’ont suggéré de vendre mes rouleaux impériaux au marché public de Granby, raconte Kim Lam. Au début, je n’étais équipée que d’un cooler et c’est tout ! » Il n’en fallait pas plus pour que s’opère la magie du bouche-à-oreille. Elle attribue d’ailleurs son succès à l’authenticité de ses plats et à la fraîcheur des ingrédients qui composent ses recettes. « J e fais de vrais mets, affirme-t-elle. Il n’y a aucun agent de remplissage, de conservation ou de glutamate monosodique. Dans les rouleaux impériaux, on goûte réellement la saveur de la viande. Je mets beaucoup de légumes de qualité, comme des champignons shiitakes. C’est savoureux ! »
Du marché public à la section des aliments surgelés de Metro, il n’y avait ensuite qu’un pas. Kim Lam l’a franchi lorsqu’elle s’est rendue à une succursale de Metro située à Bromont quelques années plus tard.
« Je m’y suis arrêtée avec ma carte de visite, confie-t-elle. J’ai parlé au gérant de la section des produits surgelés, Bertrand SaintOnge, qui m’a énuméré les conditions à remplir pour offrir mes produits. Il m’a dit : “ Tu viendras me voir quand ce sera fait.” Et j’ai suivi ses conseils à la lettre. »
S ’associer avec un partenaire tel que Metro marque d’ailleurs un moment charnière dans son parcours, en lui insufflant la confiance dont elle avait besoin pour faire démarrer son entreprise et la propulser.
« I ls ont vraiment cru en mon projet, ajoute la femme d’affaires. J’ai parfois ressenti le syndrome de l’imposteur, mais lorsque des collaborateurs comme Metro m’ont félicitée pour mes produits, j’ai réalisé l’ampleur de tout ce que j’avais accompli. »
Son entreprise, en expansion constante, a d’ailleurs inauguré, en avril 2022, une usine de transformation de 7 0 00 pieds carrés à Laval. Des succursales de Metro partout au Québec proposent désormais ses fameux rouleaux impériaux, ainsi que toute une gamme de mets soigneusement confectionnés, tels que le général Tao, les dumplings et les wontons, le bouillon et la sauce à rouleaux. L’entrepreneure aux yeux rieurs et à la bonne humeur contagieuse n’a toutefois pas l’intention de se cantonner aux frontières de la Belle Province. « La demande est très grande, dit-elle. D’ici quelques années, je compte également m’attaquer aux marchés du reste du Canada et des États-Unis. »
Photos : Metro (portrait de Mme Lam) et F abrice Gaëtan –Metro



08
Virée gourmande
Dans les villes, l’agriculture est différente, les marchés publics sont des coins de campagne, les petites boutiques gourmandes sont des aventures et les serres poussent sur les toits… Les villes charment toujours les épicuriens, car ce sont dans les villes que l’on veut retrouver la diversité et la qualité, que l’on veut tout manger !
09 Partir à la découverte des marchés publics de Jean-Talon, d’Atwater et de Maisonneuve ainsi que des marchés de quartier et des marchés solidaires est une belle manière de prendre le pouls de Montréal, de faire des rencontres mémorables avec des artisans, des producteurs et des maraîchers passionnés.

10 Comprenant le Marché fermier, le Centre jardin, la Ferme pédagogique et la Papillonnerie, la Ferme Guyon , située à Chambly, offre une expérience immersive en réunissant au même endroit une vaste gamme de produits issus de l’horticulture ornementale et maraîchère de la région ainsi que du terroir québécois.
11 Une des missions de Cultiver Montréal est de faire rayonner toutes les formes d’agricultures urbaines et périurbaines du Grand Montréal. Pour ce faire, on organise notamment des excursions festives et éducatives qui permettent d’aller à la rencontre, à vélo ou à pied, de projets d’agriculture, et on présente la Fête des semences et le Festival Cultiver Montréal, entre autres.
12 Les Tours de la Table souhaitent vous faire découvrir la cuisine d’ici et d’ailleurs en organisant des tours culinaires thématiques, à travers les entreprises nichées de la ville de Montréal. Embarquez dans l’aventure pour aller à la rencontre des chefs et entrepreneurs les plus talentueux de la métropole.
09
Photos : Alison Slattery –T ourisme Montr é al (homme avec les poireaux), La Ferme Guyon (serres à jardins) et Latrompette Studio (enfants dans les jardins)



12 10 11

13
Tomates aux épices à steak
mayo aux herbes et croustillant de pain
entrée POUR 4 personnes TEMPS DE PRÉPARATION 30 minutes TEMPS DE CUISSON 15 minutes
ingrédients
50 ml d’huile d’olive
250 ml d’herbes fraîches (persil italien, coriandre, ciboulette, aneth, cerfeuil, oignon vert, etc.) au choix, effeuillées
100 ml de mayonnaise du commerce (ou maison)
½ baguette, sans la croûte
2 g rosses tomates Cœur de bœuf de couleurs différentes (vertes ou jaunes et rouges ou orange)
Le jus d’un demi-citron
Sel, fleur de sel ou mélange d’épices à steak au choix
préparation
1 Préchauffer le four à 375 °F (190 °C).
2 Dans une casserole, verser 50 m l d’huile d’olive. Chauffer l’huile jusqu’à 160 ° F (70 °C) et y ajouter les herbes effeuillées. Cette température sera suffisante pour blanchir les herbes et la couleur verte de la chlorophylle sera fixée. Mettre ensuite le contenu de la casserole dans un petit robot culinaire et mélanger à haute vitesse afin d’obtenir la purée la plus lisse possible.
3 Déposer la purée d’herbes dans un tamis au-dessus d’un bol et laisser égoutter 15 minutes, sans presser.
4 Laisser refroidir, puis mélanger la purée d’herbes à la mayonnaise, finir par le jus de citron et assaisonner au goût. Réserver au frigo, idéalement dans une pipette, pour le dressage de l’assiette.
5 Tailler la mie de la baguette en petits cubes ou la mettre dans un petit robot culinaire bien sec afin de la réduire en poudre. Ensuite, déposer la mie dans une poêle avec un peu d’huile d’olive et faire dorer une dizaine de minutes au four, à 375 ° F (190 °C). Réserver à température ambiante lorsque bien croustillante et dorée.
6 Tailler les tomates en grosses tranches épaisses (2 cm). À l’aide d’un emporte-pièce rond, de la taille du tiers de la tomate environ, couper des cercles de chair dans chacune des tomates. Retirer le cercle de la tomate d’une couleur et l’insérer dans le trou d’une tomate d’une autre couleur.
7 Pour le dressage, disposer les tomates « recomposées », verser un généreux trait d’huile d’herbes fraîches, faire de gros ronds de mayonnaise aux herbes sur la tomate et dans l’assiette. Saupoudrer de mie de pain frite et de beaucoup d’épices à steak.
Quand on se promène sur une route qui sillonne au travers des champs, notre regard est invariablement attiré par ces grandes étendues prometteuses et un brin mystérieuses, avouonsle. Que fait-on pousser au juste ? Ah bon, c’est du sarrasin ? Et ça, avec les petites fleurs jaunes, du canola ? Ici, des pommes de terre cachées dont le beau panache vert se pavane au soleil ? Du cassis, que les anciens appelaient gadelle noire ? Et ces grands épis destinés au bétail, comment les distinguer du maïs que les humains aiment tant savourer à pleines dents ? Les connaissances de la nature et le savoir-faire des agriculteurs impressionnent les mangeurs néophytes. Tant de travail pour que nos aliments se rendent du champ à notre assiette ! Sans oublier les particularités des sols propices à leur culture. Les laitues fines et les bébés épinards sont friands de nos terres noires, les asperges préfèrent celles plus sablonneuses, alors que les vignes se contentent de ce qu’on leur offre. À tous ces beaux et bons végétaux, levons notre verre bien haut !
les champs les champs les champs les champs les champs les champs les champs les champs les champs

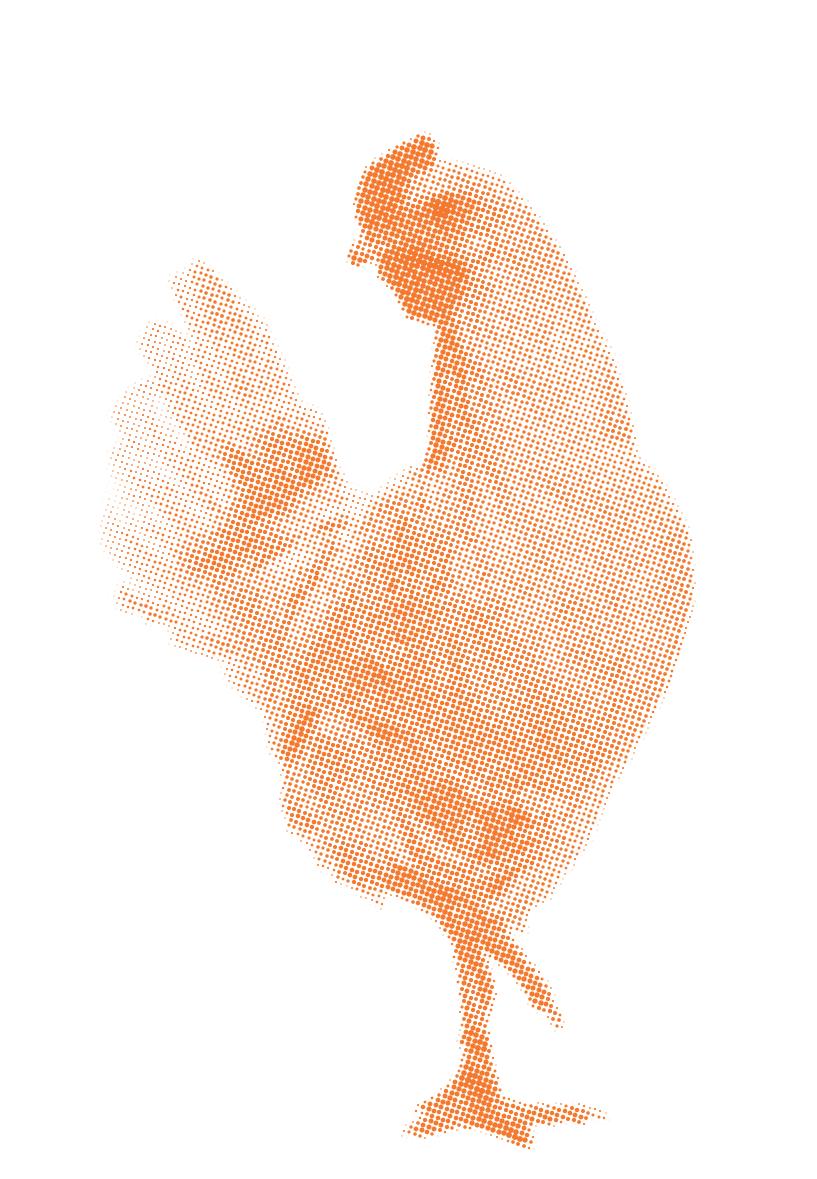
 Photo : Metro (portrait de M. Riendeau)
Photo : Metro (portrait de M. Riendeau)
 Sylvain Riendeau, Le Potager Riendeau inc., Saint-Rémi
Sylvain Riendeau, Le Potager Riendeau inc., Saint-Rémi


14 14
Kevin, Audrey, Jean-Paul et Jason Marquis
Jessica Fouani, Maryline Marquis et Melissa Fouani
La famille Marquis : l’innovation depuis trois générations
Dans l’Est du Grand Montréal, en trois générations, les descendants de Lucien et Rita Marquis ont été à la barre de 16 magasins Metro.
Tout destinait Maryline Marquis et son frère Jean-Paul à devenir épiciers. Avant-derniers d’une fratrie de sept enfants, tous devenus maîtres d’œuvre en alimentation, les petits Marquis ont littéralement grandi au magasin général de leurs parents, à La Trinité-des-Monts, dans le BasSaint-Laurent. Les trois plus vieux, Gaston, Gaétan et Solange, étaient déjà de jeunes adultes alors que les quatre derniers aidaient encore au magasin.
D’abord Louise, longtemps chefcaissière au défunt Dominion de Rimouski, est maintenant propriétaire d’un Metro. Elle est également la mère des frères Thibeault, dont l’histoire est racontée dans notre section des montagnes. Puis Linda, la benjamine, qui a mis en pot sa fameuse sauce à spaghetti, propulsant ainsi le règne de la Reine des Sauces sur plusieurs tablettes d’épicerie. Jusqu’à tout récemment, cette dernière fabriquait encore les plats cuisinés au Metro de Maryline et de Jean-Paul, à Repentigny.
Au déménagement du paternel, en 1973, le duo composé de Maryline et de Jean-Paul a poursuivi le travail dans un tout petit Metro du boulevard Gouin. Moins d’une décennie plus tard, les jeunes entrepreneurs achètent leur premier Metro sur Maurice-Duplessis, toujours à
Rivière-des-Prairies. Ils avaient 20 et 24 ans. C’est une quinzaine d’années plus tard que le duo migre vers Repentigny pour ouvrir un spectaculaire supermarché de 53 000 pieds carrés, boulevard Louvain.
En 2014, un second supermarché s’ajoute au portefeuille de la famille, cette fois sur la montée de Saint-Sulpice à L’Assomption. Ce dernier est exploité par la troisième génération, soit le fils aîné de Jean-Paul, Kevin, et la fille aînée de Maryline, Jessica. Pendant ce temps, à la maisonmère de Repentigny, la relève se prépare doucement avec Audrey et Jason, du côté de Jean-Paul, et Mélissa, du côté de Maryline.
« Ce sont certainement nos standards de qualité et notre sens de l’innovation qui ont fait notre marque », observe Jean-Paul Marquis. Celui qui a commencé à aider ses parents vers l’âge de 10 ans a passé plus d’une cinquantaine d’années de sa vie dans l’épicerie. Qu’est-ce qui a changé en cinq décennies ? « Demandez-moi plutôt ce qui n’a pas changé », rétorque le grand patron, qui déchargeait encore une livraison de pommes de terre au moment de réaliser cette entrevue, faute de personnel.
Ce type de difficulté n’a toutefois jamais empêché Jean-Paul et Maryline d’innover. À titre d’exemple, lorsqu’ils ont ouvert les portes de leur magasin de Repentigny, en 1997, leur Metro s’est retrouvé en vedette dans un
magazine d’architecture de Chicago, sous le titre The French Connection . Ils ont multiplié les offres originales, figurant parmi les premiers à offrir à leurs clients un comptoir à pizza « comme au resto », un comptoir à biscuits Félix & Norton, un comptoir à pain Première Moisson ou une brûlerie.
Encore aujourd’hui, le dernier-né de la famille a été pensé avec des comptoirs réfrigérés et surgelés alimentés par des systèmes de réfrigération totalement « verts », au CO2 , et un système d’éclairage au DEL. « De plus, nos clients ont accès à des produits distinctifs qui comblent les plus fins gourmets », note Maryline, soulignant une offre incroyable de fromages artisanaux et un bar à olives, un bistro, des sushis faits sur place, un expert torréfacteur de café, une chambre de vieillissement pour bœuf, un fumoir à poisson, une grande variété de gros fruits de mer, des chocolats fins, une boutique de cadeaux, une section sans gluten et une offre sans cesse enrichie de bières artisanales et de nombreux produits régionaux.
Avec l’étendue des variétés de produits, dans un monde où il y a tant de goûts différents à satisfaire, la famille se dit prête à relever les défis. Parce que la passion n’est pas une fleur qui se fane facilement.
Photos : Karine Lévesque
Loounie : vivre de sa passion
La créatrice de contenu à la personnalité lumineuse et charismatique est devenue, en quelques années seulement, l’une des principales égéries de l’alimentation végétale. Caroline Huard, alias Loounie, guide avec bienveillance ses abonnés vers la découverte d’une culture culinaire encore méconnue.
Sa formation d’ergothérapeute ne pourrait être plus éloignée de son milieu actuel. De son propre aveu, Caroline Huard fait figure d’ovni sur la scène culinaire effervescente. Elle s’y initie d’ailleurs par accident : après un séjour en Europe en 2011, elle prend la décision d’adopter la cuisine végétale, en développant des recettes presque en autodidacte. Elle finit par partager ses créations avec une communauté toujours enthousiaste envers ses plats savoureux et simplissimes.
Si son cheminement atypique crée chez elle un petit sentiment d’insécurité, il l’amène toutefois à imaginer des recettes d’une perspective unique. « J ’ai constaté que ça me plaçait dans une position intéressante pour conseiller les gens qui, eux non plus, n’ont pas fait d’études à l’ITHQ, indique-t-elle. Eux non plus ne sont ni nutritionnistes ni spécialistes. »
Metro et Loounie
Les abonnés de Loounie sont au rendez-vous. Ses mets végétaliens suscitent un véritable engouement, au point d’attirer rapidement l’un de ses premiers partenaires : la bannière Metro, qui lui propose de créer du contenu à la pièce. En 2019, elle finit par se jeter à l’eau en quittant son emploi d’ergothérapeute pour se consacrer à sa passion à temps plein. Son approche humaine, son ouverture et son absence totale de jugement ne sont probablement pas étrangères à son succès. « La plupart de mes abonnés sont des gens qui souhaitent réduire leur consommation de produits d’origine animale, affirme Caroline Huard. Je ne suis pas là pour les convertir, mais pour leur donner des outils dans leur transition, peu importe jusqu’où ils veulent se rendre. »
Toujours dans l’objectif de faciliter la vie à ses nombreux adeptes, Caroline Huard s’associe à Metro pour offrir son fameux Tofu magique en version prêt-à-manger. Il s’agit d’une alliance organique pour celle qui s’approvisionne quotidiennement à la succursale Metro de son quartier. « Il y a tout ce dont j’ai besoin, ajoute l’entrepreneure. Le vaste réseau de la chaîne de supermarchés favorise aussi l’accessibilité de ce mode d’alimentation, ce qui correspond à mes valeurs et à ma mission. C’est important pour moi que l’on puisse trouver aisément les ingrédients de mes recettes partout au Québec. »
À l’épicerie avec Loounie
À ceux et celles qui souhaitent enrichir leur répertoire de recettes végétaliennes, Caroline Huard suggère de commencer par dénicher des produits chouchous. « D ans mon cas, j’aime beaucoup les légumineuses de marque Irresistibles et Mieux-Être, confie-telle. Leur faible taux en sodium me permet de contrôler la quantité de sel. Je peux également utiliser le liquide de trempage comme agent liant dans la préparation de muffins ou de biscuits, par exemple. »
Parmi ses incontournables de l’alimentation végétalienne, Caroline Huard s’est entichée des marques Gusta et Aliments Racine, deux entreprises québécoises qui confectionnent des aliments sans protéines animales. « J ’adore avoir leurs produits sous la main, surtout lorsque le temps me manque pour cuisiner. » Elle confie que, lors des soirs de semaine où elle est pressée, elle aime également ramasser en magasin son propre Tofu magique, qu’elle achète d’ailleurs à plein prix. « M ine de rien, je suis vraiment fan de mon produit », dit-elle.

15
Photo : Bertrand Exertier

16
Stéphane et Dominic Beaulieu
La famille Beaulieu : aimer son métier, c’est la clé !
Propriétaire
Tous ceux qui connaissent Stéphane Beaulieu vous diront que c’est un self-made man – un autodidacte. Il est vrai que ce boucher de métier, qui a commencé dans une toute petite épicerie à Sainte-Julienne, n’avait pas d’autre ambition que celle de gagner sa vie honnêtement, mais le destin en a décidé autrement.
Aujourd’hui, Stéphane Beaulieu est propriétaire de quatre bannières Metro. À son magasin de Sainte-Julienne se sont ajoutées trois bannières, situées dans Rosemont et sur le très prisé Plateau-Mont-Royal, à Montréal. Il serait faux de prétendre que Stéphane Beaulieu a tout bâti seul. « J ’aurais pu me faire avoir bien souvent. Heureusement qu’il y avait France. Je te dis que, avec elle, tout le monde marchait droite ! » France, c’est France Perreault, qui a ajouté Beaulieu à son nom en 1974, alors que tous deux étaient encore dans la vingtaine. Enseignante de formation, comptable dans l’âme et dotée d’un jugement exemplaire, elle a fini par quitter son métier de formation pour venir guider son électron libre de mari. C’est elle qui prenait les décisions importantes, et Stéphane ne s’en cache pas.
En 1980, le couple saisit une belle occasion d’afficher la bannière Richelieu au-dessus de la porte de la boutique. Quatre ans plus tard, la bannière bleue faisait place au gros « M » rouge de Metro, et s’amorçait alors ce que Stéphane Beaulieu nomme parfois, en cours de conversation, « u n empire monté brique par brique » et parfois, aussi, « u n chemin parcouru sans s’en apercevoir ».
Stéphane et France ont eu deux fils, Dominic et Jean-Philippe. Si le cadet a préféré la construction, l’aîné a fait son HEC et est devenu actionnaire en 2011 du
magasin sur Laurier. En 2018, France se retire, et c’est le duo père-fils qui acquiert le Metro de l’avenue du Mont-Royal. En 2021, les deux entrepreneurs ajoutent à leur portefeuille un quatrième magasin, rue Jean-Talon.
« A ujourd’hui, le stress repose sur les épaules de Dominic, lance Stéphane, et il est mille fois meilleur que moi. Je suis un amateur ; lui, c’est un véritable administrateur ! Pour ma part, je fais maintenant du facing, je ramasse ce qui traîne, je remplace ceux qui manquent, et je me plais vraiment à aider les autres », avoue le fondateur.
Dans son mode de gestion, Dominic Beaulieu porte une grande attention à la promotion des artisans locaux. On n’a qu’à l’écouter parler des formidables microbrasseries de quartier, ou du Miel Bonneau, récolté sur le toit de l’Accueil Bonneau à Montréal. En gestion, il applique la science du gros bon sens et du non-dit, léguée par son papa. « L’instinct que tu développes à regarder le temps qu’il fait, pour savoir combien faire cuire de baguettes, et à quelle heure les sortir « chaudes », ça fait une immense différence, note Dominic. Pour le reste, oui, on fait face à une pénurie de main-d’œuvre, et le défi est de composer avec les réalités de tout un chacun. Il ne faut pas s’opposer à ce qui se passe ; i l faut plutôt gagner en souplesse. »
Pendant que le gestionnaire gère, France profite de sa retraite et Stéphane continue de faire la navette entre ses magasins. Il est de bonne heure sur le piton et, c’est connu, il s’attarde toujours dans les Centres Jardin de leurs magasins. « I l faut bien que quelqu’un arrose les fleurs », lance le showman . C’est d’ailleurs parce qu’il a toujours pris soin de ses fleurs qu’il est passé de petit à grand épicier.
affiliée de quatre magasins Metro, la famille Perreault-Beaulieu demeure fidèle à un adage qui lui sied : « Fais ce que tu aimes et aime ce que tu fais. »
Photo : Karine Lévesque
Un rêve transformé en citrouille
Du haut de ses 10 ans, Émile Gariépy fait pousser des citrouilles sur le terrain du voisin. Moins d’une décennie plus tard, il est maintenant le principal fournisseur de la cucurbitacée emblématique de Metro.
La génération de l’ambition
Bien qu’il soit difficile d’inciter les jeunes à faire le saut en agriculture, certains y vont de leur propre gré. C’est le cas d’Émile Gariépy, de Saint-Roch-de-l’Achigan. À 10 a ns, il aimait les jeux manuels et la mécanique des tracteurs, des intérêts à tout le moins normaux pour un jeune de cet âge. Mais, dans son cas, ces jeux d’enfant ont rapidement mené à un plan d’affaires réfléchi.
« M on grand-père était cultivateur de fraises, mais à petite échelle, raconte Émile Gariépy. Mon père, lui, a une entreprise d’automatisation. Il fabrique des robots. Mes connaissances en agriculture étaient limitées au début, mais je savais que la culture de citrouilles se faisait surtout à la main, sans trop de machinerie. »
Émile Gariépy a donc approché un voisin pour lui demander s’il pouvait louer son terrain et y planter ses premières citrouilles. « J e suis allé voir une épicerie dans mon village pour vendre mes récoltes, ajoute-t-il. Le marchand s’attendait à ce que je lui apporte une trentaine de citrouilles. Mais j’en ai récolté 800 la première année ! »
Dans la ligne de mire de Metro
L’hiver suivant, Émile Gariépy a loué un plus grand terrain. Pendant ce temps, dans le cadre de la Journée nationale de la culture entrepreneuriale, l’équipe de l’émission Dans l’œil du dragon l’a invité à présenter son entreprise. Cela a fait de lui le plus jeune participant de l’émission.
Bon nombre de médias ont raconté à leur tour son histoire hors du commun. Puis, lors d’un évènement de l’Association des producteurs maraîchers du Québec (APMQ), il a été invité comme jeune maraîcher. Tecla Masciarelli, chef acheteuse chez Metro, était dans la salle. Elle a saisi l’occasion de changer la vie du jeune entrepreneur.
« J e voulais faire affaire avec une épicerie d’ici, confie Émile Gariépy. Donc, lorsque Tecla m’a offert un contrat de cinq ans en exclusivité et d’acheter 100 % d e ma production, ç’a été tout un levier pour mon entreprise. » La première année, il leur vend 2 5 00 c itrouilles. À la fin du contrat, il en a récolté 65 0 00. Il était alors âgé de 16 ans.
D’année en année, Émile Gariépy a loué davantage de terrain, bâti un entrepôt pour le lavage et l’entreposage de ses citrouilles, puis il a commencé à cultiver la courge, le cantaloup, le melon d’eau et la carotte, tout en suivant une formation en gestion et technologies d’entreprise agricole au Cégep de Joliette. Aujourd’hui, il consacre tout son temps à faire grandir son entreprise.
« Metro a toujours été là pour m’appuyer, que ce soit pour croître ma production de citrouilles ou pour faire pousser de nouveaux légumes ou fruits », conclut-il. Âgé aujourd’hui de 19 a ns, Émile Gariépy souhaite toujours produire des fruits et légumes de qualité, en quantité suffisante pour fournir les supermarchés d’ici.



17 Photos : Les F ermes Émile Gariépy inc.

18
Pierre D'Amour
Pierre D'Amour : le routard de Drummondville
Au sein de ces grandes familles qui font briller Metro de génération en génération, Pierre D’Amour se distingue. Il compte bien 40 ans de métier dans le commerce de détail, mais a épousé la bannière il y a 6 ans seulement.
« Si j’avais su à quel point la bienveillance primait, c’est chez Metro que j’aurais commencé ma carrière, et j’y aurais passé ma vie » , lance l’épicier-propriétaire du boulevard Lemire, à Drummondville.
Tant pis si c’est passé de mode, mais ce grand amateur de moto voit « sa gang de Metro » comme une deuxième famille, après celle qu’il a fondée avec Line Labrecque et qui lui a donné trois fils, aujourd’hui trentenaires, Maxime, Simon et Antoine. Sa famille Metro, elle, donne plutôt dans la diversité. Chaque employé a le droit à sa différence, et l’inclusion prend tout son sens, sans égard au sexe, à l’origine, à la santé mentale ou à la religion. « C ’est convenu, mais ces différences font vraiment notre richesse », résume l’homme.
Pierre D’Amour vend de la nourriture, bien sûr, mais il cultive les bons rapports avec les gens. Il prône la transparence, et n’hésite pas à partager ses objectifs avec ses employés pour atteindre ses marges de profit. L’épicier-propriétaire est de l’école du team building et des programmes de reconnaissance. Il réunit son monde, expose les chiffres, bannit la culture du secret, aborde et règle les entraves au succès, mais insiste surtout pour dire que sa véritable motivation vient de l’écoute dont il fait preuve auprès des siens.
« I l faut s’intéresser aux autres, à leur famille et aux aspirations qui les animent. Une fois que tu es impliqué, le lien est créé, et tu ne peux pas te désinvestir. Cela ne s’invente pas ; si tu feins, tu perds. »
Quand il parle d’intérêt qu’il faut porter aux autres, le boss s’efface pour devenir un simple membre de sa communauté. Celui qui offre son auto à Stéphanie et Guillaume, deux employés dont la voiture a été accidentée la veille : « P renez la mienne ; e lle va dormir dans le stationnement toute la journée. » O u celui qui se rend dans la cour d’un autre pour lui enseigner comment changer lui-même ses freins : « Tu vas voir, Gérard, c’est facile et tu vas pouvoir le faire toi-même ensuite. »
Au-delà du partage de ses talents de mécano, si vous achetez un sandwich du comptoir du prêt-à-manger de « s on » Metro, sachez qu’il pourrait bien avoir été confectionné par le patron lui-même. « Les défis qu’impose le manque de personnel sont quotidiens. Il faut savoir faire équipe. À mes yeux, venir aider quand un besoin urgent se fait sentir, c’est non seulement naturel, mais c’est ça, le véritable leadership. »
Si Pierre D’Amour sait tendre l’oreille et prêter main-forte, c’est de son propre aveu parce qu’il a reçu ce genre d’attention de la haute direction. « En arrivant dans la grande famille de Metro, j’ai fait face à certains défis, et Metro m’a soutenu. En termes concrets, j’ai bénéficié d’écoute, d’outils, de budgets, de temps et de confiance. Avec un tel combo, impossible de ne pas faire de petits miracles ! Mais surtout, quand tu reçois un tel bagage de tes patrons, il devient plus facile d’en offrir autant à tes employés. Et cette chaîne basée sur l’entraide, l’écoute et la bienveillance, elle se retrouve dans l’expérience des clients qui viennent se procurer des aliments chez nous. »
P hoto : Metro




19
Metro dans les champs
L’histoire de Metro est pavée depuis ses débuts d’une relation étroite avec le monde agricole et agroalimentaire de nos régions.
Du champ de maïs, de poireaux ou de canneberges à la tablette d’un magasin, de la ferme d’élevage de bovins, de porcs ou de volailles au comptoir de viandes fraîches, de la traite des vaches ou de la fromagerie au réfrigérateur de produits laitiers, il n’y a qu’un pas de franchi allègrement en épicerie, jour après jour, semaine après semaine, pour proposer au consommateur le meilleur de ce qui est produit au Québec.
Et quel choix, quand on comptabilise près de 30 0 00 entreprises agricoles dans la province ! Avec celles qui transforment des aliments, elles sont le principal moteur économique de bien des régions. L’UPA calcule que « plus de 600 v illages prospèrent grâce au dynamisme des fermes de leur territoire »
Pour faire passer ces produits de « la ferme à la table », Metro a pris son rôle au sérieux. « I l y a 75 a ns que nous développons des partenariats avec des fournisseurs de produits frais, cultivateurs, éleveurs de volailles, de porcs, de bovins… », souligne Annie St-Onge, vice-présidente Mise en marché de produits périssables chez Metro. On n’a pas attendu la vague d’achats locaux des dernières années pour aller à leur rencontre, contribuer à les faire grandir en mettant en valeur leurs produits en magasin. Pour nous, c’est une priorité d’affaires. »
Les marchands Metro sont souvent à l’avant-garde des premières rencontres avec de petits producteurs et transformateurs, les premiers aussi à vendre leurs produits, mais « quand ils sentent un plus grand potentiel, ils nous les recommandent, et nous entrons en scène pour voir dans quelle mesure ces fournisseurs pourraient augmenter leurs productions afin d’élargir leur marché chez Metro ».
Deux programmes aident à faire mousser ces ventes. Metro a ainsi son Programme d’achat local pour soutenir entre autres les producteurs agricoles, « valoriser le patrimoine culinaire du Québec et encourager la consommation de produits québécois ».
Le Programme d’innovation de Metro vise, pour sa part, à faciliter l’entrée de produits innovants du Québec dans ses magasins, y compris ceux issus de l’agriculture. Produit nouveau, tendance alimentaire, ingrédients uniques, emballage qui se démarque, réponse à un nouveau besoin du marché, chaîne de production novatrice… toutes les innovations sont permises.
Metro est réellement « un ambassadeur pour l’agriculture québécoise », affirme Annie St-Onge, en soulignant le travail accompli afin de s’impliquer auprès de producteurs, les soutenir dans leur croissance et valoriser leurs produits en épicerie. Conseils de maraîchers, calendrier des arrivages, recettes de cuisine saisonnière agrémentent même son site Internet.
En amont, Metro accomplit un gros travail avec des regroupements de producteurs, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec (CTAQ) ou les tables agroalimentaires des régions. « O n aide, par exemple, certains secteurs à pénétrer le marché avec un service de conseil et d'accompagnement » , précise Annie St-Onge.
Metro travaille avec les tables agroalimentaires pour identifier des innovations, des produits qui sont proposés ensuite aux magasins locaux ou par l’intermédiaire du siège social. « N otre rôle est ensuite d’utiliser nos circulaires pour mettre ces nouveaux produits de l’avant », ajoute Jean-Michel Guillemette, directeur Mise en marché.
« C ’est dans notre ADN, dit-il, de pousser les produits d’ici. » L’une de ses fiertés ? L es produits Vivanda Boréal, de la région du Lac-Saint-Jean. « C e sont des galettes, de style burgers, aux gourganes, excellentes et uniques au Québec », explique-t-il.
Cet exemple illustre la relation formidable qu’entretient Metro avec les forces vives de notre agriculture et du secteur agroalimentaire : u ne relation de longue durée faite de confiance mutuelle, de soutien à l’innovation et au développement. Tous ces efforts pour, au final, servir le consommateur québécois par une offre sans cesse grandissante et de haute qualité en produits nature ou transformés issus de notre riche terroir.
Photos : T
Mont é r é gie
ourisme
(panier de légumes) et Guillaume Roy (gourgane)

20
Pierre James et sa conjointe, Vicky Thomas
Pierre James : le choix au repêchage
Pierre James fait partie de ces dirigeants qui doivent leur ascension à leur force de travail. Ses valeurs, son talent et ses manières de faire allaient le mener au firmament des étoiles de Metro. Histoire d’un repêchage à succès.
Pierre James s’en souvient comme si c’était hier. « C ’était à la veille de Noël. Un dirigeant de Metro m’avait approché et en moins d’une heure, après m’avoir posé les traditionnelles questions d’embauche, il avait bousculé mes certitudes… » E n ce 24 d écembre 1999, à quelques heures du grand bogue qui n’aurait finalement jamais lieu, Pierre James sentait qu’il jouait gros, même si au fond, il l’admet aujourd’hui, il avait bien peu à perdre.
Il était alors le bras droit d’un autre épicier, dans l’attente d’une offre de partenariat qui tardait à se présenter. Toute sa vie, Pierre James s’était dévoué au monde de l’alimentation, en fait depuis l’époque où, à 16 a ns, il était emballeur chez Steinberg, et il n’avait jamais ménagé son engagement auprès de la communauté. Il avait réglé des problèmes de gestion des stocks, concilié des différends, satisfait des clients, relevé des marges de profit, augmenté des ventes, amélioré des chiffres d’affaires, géré des comptes bancaires et, surtout, il avait appris le métier auprès des meilleurs experts de chacun des services des épiceries où il avait travaillé. Dans l’industrie, de Montréal à Québec en passant par l’Estrie, les compétences de Pierre James étaient reconnues, et son talent ne laissait personne indifférent.
Tout ce qu’il avait fait jusqu’à la fin de 1999, il l’avait accompli au profit d’autres propriétaires de bannières que lui-même ; i l avait travaillé pour le rêve d’un autre, comme son père l’avait fait. Et, petit-fils d’immigrant, Pierre James avait beau être porté par des valeurs de transparence, de respect d’autrui et de fierté du travail accompli, ses avoirs ne lui permettraient jamais l’accès à la propriété d’un magasin. Toutes missions
confondues, qu’elles eurent été confiées par Steinberg, Super C ou IGA, Pierre James avait été un fidèle soldat, mais ne serait jamais un vrai capitaine, croyait-il. Il avait 40 ans et était à la croisée des chemins.
Quelques jours après le passage à l’an 2000, Metro a de nouveau frappé à sa porte. « N ous étions chez Cora, cette fois avec un haut dirigeant. Je venais de lui expliquer que mes priorités étaient le service à la clientèle et le prêt aux affaires, et qu’entre les ventes et les profits, ma priorité était claire, puisque que sans ventes, les profits ne pourraient jamais exploser. Il m’a dit, en quittant la table : « C ’est bon. Prends le temps d’y penser… Je reviens dans cinq minutes ! Q uand je vais revenir, tu me donneras ta réponse… »
On ne saura jamais à quel point le v.-p. Jean Quenneville était sérieux. Mais Pierre James l’était. « Mon père avait été repêché par une ligue professionnelle américaine AAA, et ma grand-mère avait refusé de signer, de peur de perdre son fils de 18 a ns. C’est ainsi que mon père est devenu épicier. »
Sur la banquette du restaurant, Pierre James, père de trois filles, ne pouvait consulter qui que ce soit. Il a alors pensé aux enseignements de son propre père. « Mon fils, ne laisse jamais passer une opportunité. »
Aujourd’hui, à 63 a ns, le propriétaire franchisé du Metro Plus de Victoriaville se sent encore reconnaissant de cette main tendue de la part de Metro. Il est devenu capitaine. « C ’est une grande décision que j’ai prise en quelques minutes. Mais, quand on y pense, nos désirs ont souvent été mûrement réfléchis. Il faut simplement savoir dire oui, quand s’ouvre enfin une porte devant soi. »
Photo : Les Maximes
Virée gourmande
Au Québec, on dit que la zone agricole cultivée est évaluée à 6,3 millions d’hectares, soit 5 % de toute la superficie du territoire… Ce ne sont pas les plaines de l’Ouest, mais nous en avons des champs, à perte de vue ! Ici, sous le ciel, une explosion de couleurs et de formes : raisins, pommes, petits fruits, légumes, fleurs, etc. Nos produits naissent ici.

21 La Ferme Les Petites Écores de Pointe-Fortune vous invite à découvrir sa ferme par une visite de son domaine apicole, de son argouseraie, qui compte 1 500 plants, et de ses jardins biologiques. Elle offre également des soupers champêtres gastronomiques.


22 La Ferme Guy Rivest de Rawdon se distingue, entre autres, par ses activités d’autocueillette, mais aussi, en août, par sa magnifique zone de tournesols ainsi que par son immense labyrinthe de huit kilomètres répartis sur un champ de maïs de six hectares. Parsemé de jeux-questionnaires, le labyrinthe est ludique et éducatif.
23 En 1967, Gérard Faille a été le premier cultivateur de bleuets en corymbe dans la région. Depuis que son fils a repris l’entreprise de Covey Hill dans la belle municipalité de Franklin, les Vergers Ivanhoë Faille sont aujourd’hui le plus grand fournisseur de bleuets de Metro. Le domaine propose aussi une grande variété de pommes à cueillir, des aires de piquenique sur un site avec vue panoramique, des repas de cabane à sucre et des sentiers pour la marche, le ski de fond ainsi que la raquette.
24 Chaque automne, Saint-Louis-deBlandford célèbre la canneberge avec l’événement Canneberge en fête. Le Centre d’interprétation de la canneberge offre des visites guidées pour découvrir tout de la culture encore méconnue de ce petit fruit.
21 22 23
Photos : F erme Les Petites Écores (guide apiculteur), Ferme Guy Rivest (fillette dans un labyrinthe de maïs) et Audrey Martin (canneberges)

24
25 Les propriétaire de la Ferme Genty, Claude et Nathalie, ont eu un coup de cœur pour les bovins Highland. Ils y font l’élevage à Bécancour, depuis 2020, selon des pratiques écoresponsables. Pas étonnant que leur slogan soit : de caresses et d’herbes fraîches. Le couple propose des visites guidées sur réservation et, bien sûr, vend sur place : viande de bovin Highland, poulet de grain, œufs, et savons à base du gras de ses animaux.



26 L’histoire du Domaine Labranche est intimement liée à celle de la famille Desgroseillers, qui s’investit dans la région montérégienne depuis huit générations. Reconnue depuis le début du 20e siècle pour l’esprit convivial de ses repas lors de la saison des sucres, elle a ajouté à ses terres de Saint-Isidore un verger et un vignoble desquels sont issues des boissons alcoolisées (cidres, vins, mousseux). Celles-ci, dont le fameux vin d’Érable, ont remporté de nombreux prix et distinctions.
27 Le nom de la Ferme aux Mille Cailloux, entreprise de cinquième génération située à Franklin, est inspiré par sa terre particulièrement rocailleuse où poussent en abondance pommes, fraises, framboises, bleuets, et un petit fruit méconnu et rare en autocueillette : la cerise griotte.
25 26 27
Photos : F erme Genty SENC (vache Highland), Tourisme Mont é r é gie (Domaine Labranche) et Sébastien St-Jean (Ferme aux Mille Cailloux)
Produits phares
Les pommiers s’étendent à perte de vue dans nos champs. L’expression « aller aux pommes » fait partie du langage courant. Nous connaissons les sortes de pommes à choisir pour telle ou telle recette, et nous sommes fiers de nos cidres. L’art du vin a de moins en moins de secrets pour nous, et les vignes courent dans les champs. Et si la couleur dominante de l’automne est l’orange, c’est grâce à la citrouille, très présente dans notre territoire.
Mais le maïs reste notre produit phare : c’est celui qui annonce la fin de l’été, celui dont on recherche le grain parfait pour nos épluchettes de blé d’Inde. Détail important : sans lui, le pâté chinois n’existe plus.

28

29
Tatin aux pommes et cidre fermier
crème fouettée à l’érable et au mélilot
Dessert POUR 6 personnes TEMPS DE PRÉPARATION 20 minutes TEMPS DE CUISSON 45 minutes
ingrédients
8 à 10 pommes Lobo (ou autres pommes qui conservent leur forme et leur texture lors de la cuisson)
75 g de beurre demi-sel
200 g de sucre
341 ml de cidre fermier
1 feuille de pâte feuilletée (à dégeler d’avance et réserver au frigo, bien à plat)
250 ml de crème 35 % à fouetter
30 ml de sirop d’érable Quelques gouttes d’essence de mélilot (ou vanille)
préparation
1 Préchauffer le four à 400 °F (200 °C).
2 Peler les pommes, les vider et les tailler en gros morceaux (quarts ou sixièmes selon la grosseur de la pomme). Dans une très grande poêle, faire mousser le beurre et ajouter le sucre afin que celui-ci soit absorbé par le beurre. Baisser le feu à moyen et laisser le sucre devenir liquide en caramélisant.
3 À l’aide d’une cuillère en bois, remuer doucement afin de ne pas faire masser le sucre. Lorsque le sucre sera complètement liquide et de couleur caramel (environ 10 m inutes), ajouter les morceaux de pommes. Bien enrober les pommes et faire cuire de 10 à 15 minutes environ, jusqu’à ce que le jus qu’elles auront rendu sera complètement évaporé et que les pommes seront dans un caramel nappant. Retirer les pommes et les laisser refroidir sur une plaque. Laisser le caramel dans la poêle.
4 Faire chauffer le caramel de pommes dans la poêle et déglacer au cidre fermier, puis faire réduire à presque sec. Laisser tempérer légèrement.
5 Dans la poêle contenant le caramel, disposer les quartiers de pomme caramélisés en rosace, du rebord jusqu’au centre, dans la même poêle. Lorsque tout l’espace sera dressé avec les pommes, disposer le reste en serrant un peu, s’il y a lieu.
6 Tailler la pâte feuilletée afin qu’elle recouvre entièrement les pommes. Lorsque celle-ci est bien à plat, enfourner à 400 °F (200 °C) pendant une quinzaine de minutes. Une fois la pâte bien dorée, laisser tempérer une dizaine de minutes.
7 Pendant ce temps, verser la crème 35 % d ans un cul-de-poule moyen et la fouetter vivement afin de la faire monter. Lorsque la crème commence à épaissir et qu’elle a la texture du yogourt, ajouter le sirop d’érable et l’essence de mélilot. Continuer de fouetter jusqu’à ce qu’elle soit bien ferme.
8 Coller une assiette contre la pâte cuite et pencher la poêle afin d’enlever le plus de caramel du fond de celle-ci. Le récupérer dans un bol. Garder l’assiette collée afin de pouvoir la retourner d’un geste vif pour que les pommes du fond de la poêle se retrouvent sur le dessus de la pâte. Retirer la poêle et admirer la Tatin.
9 Servir la tarte chaude, avec une généreuse portion de crème fouettée au mélilot. Terminer par le caramel de cuisson en guise de garniture.
Beaucoup plus qu’un fleuve, le Saint-Laurent mérite qu’on écrive son nom au grand complet, sans abréviation. C’est l’un des plus grands au monde, après tout ! Aussi inspirant pour les poètes et chansonniers que nourricier pour les gourmands, le Saint-Laurent foisonne de trésors sur ses côtes et dans ses eaux. Pas moins de trois estuaires (fluvial, moyen et maritime) et un golfe sont nécessaires pour décrire ce fleuve qu’on nomme aussi respectueusement « la mer » à partir de l’endroit où son eau devient salée. Des petits et gros poissons – bar rayé, anguille américaine, poulamon, capelan, esturgeon. Des algues et des plantes – livèche, salicorne, airelles, genévrier. Des mollusques et des crustacés – mactres, buccin, pétoncle, crabe, oursin vert et petites crevettes roses nordiques hautement prisées ! Un fleuve unique pour y observer les baleines, faire une croisière, pagayer en kayak, découvrir ses îles. Et le bonheur pour certains au quotidien de pouvoir le longer en voiture, en vélo ou à pied pour s’en inspirer.






 Karyn Ferland
Antoine Ferland
Serge Ferland
Karyn Ferland
Antoine Ferland
Serge Ferland
30 30
Roland Ferland
La famille Ferland : 100 ans dans la peau d’un épicier
Depuis 1917, c’est le souci d’offrir un service irréprochable et des produits de qualité qui aura permis successivement à Oscar, à Roland, à Serge et, maintenant, à Karyn Ferland de se démarquer à Québec. Et une cinquième génération fait déjà son entrée sur la scène.
Lorsque Karyn Ferland s’empare d’une caisse afin de donner un coup de main, il se trouve toujours un client pour penser qu’il s’agit « d ’une p’tite nouvelle » qui attend encore son uniforme de Metro ! Ç a fait sourire la copropriétaire des succursales du boulevard Charest, dans le quartier Saint-Sauveur, et de la rue Marais, dans Duberger, qui aimait déjà être caissière à l’été de ses 16 ans.
Dans la vingtaine, Karyn Ferland n’était pas si certaine de vouloir poursuivre la tradition familiale. Quand Serge, le père de Karyn, a acquis la succursale de la rue du Marais, en 2008, elle avait 25 a ns, et allait bientôt accoucher d’Antoine. Elle y a travaillé en comptabilité. Puis est venue Olivia. C’est à l’aube de ses 30 a ns qu’elle a décidé de joindre les rangs de la direction. Et c’est là qu’elle a eu la piqûre et est devenue copropriétaire avec son père. Il lui a appris à se défendre contre les géants de ce monde en ayant toujours à cœur d’offrir un service irréprochable et des produits de qualité.
« M on père a toujours été un investisseur redoutable, raconte Karyn. Il m’a appris à foncer. » C ’est peut-être cette fibre entrepreneuriale, très présente chez l’homme d’affaires, qui intimidait sa fille et l’empêchait de se sentir à la hauteur, à ses débuts. Elle en a fait sa force ! « I l reste que mon père m’a aussi enseigné à être généreuse et attentionnée envers mon monde, se souvient-elle. Il demeure un homme d’affaires profondément humain, et j’ai évolué avec cet exemple en tête. »
De jeune caissière à femme d’affaires, Karyn Ferland a connu une courbe d’évolution assez spectaculaire. « La plupart des employés et des clients du quartier Saint-Sauveur m’ont vue naître, raconte celle qui siège aujourd’hui au Comité consultatif de Metro. Oui, c’était intimidant et confrontant de soudain devenir la patronne. Mais ils ont été formidables et m’ont généreusement permis de prendre ma place. »
L’aventure dure depuis 105 a ns chez les Ferland. D’ailleurs, fait peu banal, Roland, le grand-père de Karyn et arrière-grand-père d’Antoine, travaille encore. Il est âgé de 95 ans.
Ceux qui croient que Monsieur Roland ne fait que jaser avec les clients peuvent aller se rhabiller ! L’ancien propriétaire de trois succursales de Metro, désormais sur le payroll , travaille cinq jours par semaine. Au magasin, il se déplace toujours avec un panier d’épicerie. « C hez Metro,
personne ne sait que j’ai une canne, avoue l’homme, avec un sourire entendu ! Au travail, je ne ressens jamais la fatigue. Et quand je me couche le soir, je m’endors heureux de savoir que, le lendemain, je retournerai au magasin », note celui qui a passé quelque 80 années dans le monde de l’épicerie.
Au Metro Saint-Sauveur de Québec, où règne un esprit d’épicerie de quartier, Roland Ferland a pris l’initiative de créer une section de canettes. « Je déballe une quinzaine de caisses par semaine pour permettre aux clients de se procurer différentes variétés à l’unité. Il faut penser à ceux qui se déplacent en autobus », note le nonagénaire, qui livrait ses premières commandes à vélo et en traîneau, au début des années 1940.
« O ui, les choses changent, et mon grand-père en a vu beaucoup, observe Karyn. Mais une chose ne change jamais : les gens veulent bien manger. Nos départements sont exceptionnels et regorgent de produits locaux et haut de gamme. Mais au-delà d’une excellente gestion et des meilleurs produits, une grande part du mérite revient à nos employés, qui sont vraiment attentionnés, talentueux et dévoués. Sans eux, rien de tout cela ne serait vraiment possible. »
Photos : P ascal Huot



Photos : Les Maximes
L'ouverture des marchés le dimanche
De nos jours, on imaginerait mal ne pas pouvoir faire son marché le dimanche – ou le soir, après avoir, par exemple, amené les enfants à leur pratique sportive. Essentielles pour offrir l’accessibilité et la flexibilité attendues par la clientèle, les longues heures d’ouverture demandent aux propriétaires de supermarché de trouver l’équilibre entre bien des facteurs.
Michel Dépatie, patron du Metro Plus Dépatie de Laval et président de l’Association des détaillants en alimentation du Québec, est bien placé pour comprendre ces enjeux, dont on discute souvent dans son entourage professionnel. Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte pour le secteur de l’alimentation. Aujourd’hui, les défis liés à la main-d’œuvre jouent un rôle important, mais ils sont loin d’être les seuls dans un environnement fort compétitif : « F ermer durant une journée complète, c’est plus difficile, aujourd’hui, explique-t-il. On a beaucoup de produits frais, par exemple, et ça aurait de grandes répercussions sur nos opérations. »
Au-delà du jour du Seigneur
L’ouverture le dimanche – et en soirée –est fortement liée à l’évolution d’une société qui ne fonctionne plus selon le « 9 à 5 ». Jusqu’au milieu des années 1980, dans un contexte marqué par la chrétienté, le dimanche est un jour de repos où bureaux et commerces ont l’obligation légale de fermer leurs portes.
Une décision de la Cour suprême du Canada, en 1985, vient invalider cette obligation en tant que discriminatoire contre les non-chrétiens.
Alors que la société se libéralise et que le consumérisme se renforce, cet absolu va tomber et transformer le commerce de détail, en particulier dans le domaine de l’alimentation.
En 1990, le gouvernement du Québec adopte une loi limitant à cinq le nombre d’employés pouvant travailler dans un commerce le dimanche. La loi est ensuite assouplie en 1992, l’ouverture complète étant autorisée jusqu’à 17 h , pour ensuite limiter le nombre d’employés à quatre en soirée. « À c ause de la taille du commerce, c’était difficile de servir à quatre employés » , se remémore toutefois Michel Dépatie.
En 2006 et 2007, après de longues négociations entre syndicats et propriétaires, des changements prolongent les heures normales d’ouverture jusqu’à 20 h , puis renforcent les obligations liées aux jours fériés. L’ouverture des supermarchés en soirée, souvent jusqu’à 23 h , voire
minuit, est alors bien passée dans les mœurs, pour accommoder les heures de travail de plus en plus variables et les nouvelles obligations familiales.
Des questions d’équilibre
Les dernières années, en particulier à cause des épreuves liées à la COVID-19 et aux mesures sanitaires, ont toutefois fait surgir de nouvelles questions liées à cette offre de service. Comment satisfaire la clientèle tout en ménageant sa main-d’œuvre ? « Je pourrais ouvrir 24 heures, où je suis situé, mais personnellement, je crois qu’on avait trop augmenté les heures avant la pandémie, constate Michel Dépatie, en pensant particulièrement aux équipes qui offrent les services. Quand il y avait des heures d’ouverture plus normales, disons, jusque dans les années 1 970-80, il y avait beaucoup de gens qui faisaient carrière dans le commerce de détail. » L a conciliation travail-famille, pour les employés, fait partie d’une recherche d’équilibre pour des commerçants qui doivent répondre aux besoins des consommateurs et assurer la qualité de l’offre, dans un secteur dont le caractère essentiel est plus évident que jamais.

31
Pierre-Luc Arseneault
Pierre-Luc Arsenault : le gars du Metro
Pierre-Luc Arsenault s’avère le prototype du gars qui a forgé pour devenir forgeron. Il ne vient pas d’une famille d’épiciers, et il serait peut-être devenu ingénieur industriel, n’eût été l’influence de deux femmes qui allaient croiser son chemin : Francine Lévesque et Katia Laflamme. Marquantes à deux époques, et pour deux raisons fort différentes!
La première était à la tête du Metro Notre-Dame à Laval. Francine Lévesque avait pris le jeune homme, alors âgé de 22 a ns, sous son aile. Pierre-Luc Arsenault avait commencé comme emballeur, mais il démontrait du potentiel. « E lle a vu en moi ce que je savais à peine de moi-même » , observe le marchand, près de deux décennies plus tard.
Aguerri aux postes de gérants de service et mûr pour la direction de magasin, Pierre-Luc Arsenault commence les pèlerinages entre la rive nord et la rive sud de Montréal, au gré des besoins de la bannière. « J ’avais abandonné l’université après un an et je voyais déjà les possibilités de carrière chez Metro. J’étais prêt à m’installer n’importe où au Québec parce que je n’avais pas d’attaches. J’étais ouvert à l’idée de travailler dans la région du Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, d’où viennent mes parents. » C’est ainsi qu’à 27 a ns, il quitte Boisbriand et prend en main le Metro de Mont-Joli. Son passage, remarqué, y sera toutefois bref puisque les administrateurs de Metro lui offrent, au bout de six mois seulement, rien d’autre que Rimouski.
Immédiatement, Pierre-Luc Arsenault s’implique dans la communauté. Alors qu’il participe à une conférence de presse pour le hockey mineur, il croise le regard d’une jeune journaliste de la télé communautaire, qui est aujourd’hui une figure bien connue à TVA. C’est là qu’entre en jeu Katia Laflamme,
la seconde femme marquante dans la vie de l’épicier. Il s’enracinera avec elle dans ce que les natifs de la place appellent « la plus belle ville au monde ».
Douze ans plus tard, le papa de Pierre-Olivier, 8 a ns, et de Louis, 6 a ns, sourit en mesurant le chemin parcouru. « J e ne changerais rien à ma vie, note l’homme d’affaires, maintenant quarantenaire. J’applique des valeurs qui reflètent qui je suis tous les jours. J’ai une équipe de confiance; les employés et les clients se connaissent. Le matin, je fais ma tournée, je m’assure que mon monde se porte bien tout en ayant à l’œil la mise en marché. Ce n’est pas cliché de parler d’une grande famille : c’est ce qu’on est ! »
Parce que les produits locaux, autant que leurs artisans, lui sont chers, Pierre-Luc Arsenault siège également au conseil d’administration de l’association Les Saveurs du Bas-Saint-Laurent. Être épicier, à ses yeux, ne se limite pas à nourrir les gens mais à les accompagner au quotidien. « Je suis épicier sept jours sur sept, partout dans la communauté. À l’école, au magasin Sports Experts, à l’hôpital, au hockey ou au centre commercial, je demeure le gars du Metro, et Katia, la fille de TVA . Même à ma retraite, une chose ne changera pas : je serai toujours le gars du Metro ! »
P hoto : Metro
Le Saint-Laurent dans notre assiette
Porte d’entrée du continent, le fleuve Saint-Laurent représente l’une des plus formidables réserves d’eau douce au monde. Un bassin titanesque qui foisonne en espèces comestibles. Pourtant, la population du Québec ne consomme qu’une fraction de ses ressources. Explications et pistes de solutions avec l’océanographe et amoureux du fleuve Guillaume Werstink.
Un riche terroir maritime Algues, crustacés, poissons ou mollusques, le Saint-Laurent constitue un vaste garde-manger garni d’espèces comestibles. Or, plus de 80 % d es produits de la mer québécois sont exportés sur le marché international ou ailleurs au Canada, selon différents organismes. Au point où nous en sommes réduits à importer des fruits de mer provenant de la pêche étrangère. Cette situation en laisse plus d’un perplexe, d’autant plus que nous disposons de ces mêmes ressources dans notre cour.
« L e Saint-Laurent nous offre des produits de très grande qualité, lance d’emblée Guillaume Werstink, océanographe et cofondateur de Chasse-Marée, un organisme visant à promouvoir et à valoriser les ressources maritimes d’ici. Le problème, c’est que l’industrie s’est organisée en vue de l’exportation. C’est beaucoup plus facile pour un acteur industriel important de remplir un conteneur et de l’exporter que de ravitailler une multitude de points de chute locaux », ajoute-t-il.
Des espèces à apprivoiser
La méconnaissance de certaines espèces constitue également un obstacle à leur commercialisation : « Mon poissonnier m’a confié qu’il pourrait s’approvisionner en oursins, mactres de Stimpson ou bourgots, mais qu’il craint de les perdre puisque les gens ne savent pas quoi en faire, ajoute Guillaume Werstink. Je crois qu’on a perdu un savoir-faire quant à la préparation et à la manipulation de certains produits de la mer. »
G uillaume Werstink donne l’exemple d’autres régions du monde, où le patrimoine culinaire reste ancré d’une génération à l’autre. « P renez un marché à Barcelone : c’est rempli de poissons entiers et de coquillages. Les gens les achètent tels quels, rentrent chez eux et les apprêtent », indique-t-il.
Un homme qui récolte des algues en bordure du fleuve Saint-Laurent, une des richesses de notre estuaire qui tend à gagner en popularité auprès des Québécois. Guillaume Werstink, océanographe et chef de projet en pêche et en aquaculture de formation, et Emmanuel Sandt-Duguay, pêcheur aguerri, sur leur bateau. Ils sont les fondateurs de l'organisme Chasse-Marée, situé à Rimouski, qui vise à promouvoir la pêche responsable et à faire découvrir les ressources maritimes du Québec.
Sur la page de droite


32
Photos : CHOK Images (homme récoltant des algues) et Iften R edjah –Chasse-Marée (bateau de pêche)
Une solution collective
Cet enjeu aux dimensions complexes nécessite donc une réponse multifactorielle, selon l’expert. « Pour commencer, il faut rebâtir la culture de la consommation des produits de la mer, réapprendre à les apprêter et à les préparer, explique le scientifique. Si la demande augmente pour ces produits, les poissonniers n’hésiteront plus à les offrir à leur clientèle. »
Certains acteurs du milieu, lassés de voir ces ressources maritimes précieuses s’échapper aux mains d’étrangers, ont fondé Mange ton Saint-Laurent, un collectif qui réunit chercheurs, chefs, artistes, professionnels de la santé et entrepreneurs souhaitant faciliter l’accès aux ressources comestibles du fleuve. Faisant partie de ce mouvement, la chef Colombe St-Pierre milite depuis plusieurs années pour inciter les épiceries et poissonneries du Québec à offrir les produits du Saint-Laurent. Elle-même se fait un devoir (et un plaisir !) d’inscrire les trésors gourmands de la mer au menu de son restaurant Chez Saint-Pierre, installé au Bic, dans le Bas-Saint-Laurent, afin de les faire découvrir à ses clients. Flétan, oursin, thon, crabe des neiges, pétoncles, bourgots, algues, huîtres sont quelquesuns des produits de la mer succulents apprêtés à merveille par la chef.
D’après Guillaume Werstink, les grandes épiceries ont également un rôle à jouer pour faciliter l’accès aux produits maritimes, de la mer à l’assiette. Il salue d’ailleurs les initiatives de Metro pour les mettre de l’avant : « I l s’agit d’une bannière où l’on trouve les plus belles poissonneries, indique-t-il. Il faut non seulement offrir ces produits à la clientèle, mais aussi fournir davantage d’information sur leur origine et la méthode de pêche. C’est un élément de marketing très vendeur. »

 Des bourgots Des mactres
Des bourgots Des mactres
Produits phares
Sous le charme du SaintLaurent, nous sommes encore à l’orée de nos découvertes. Des algues comestibles ? Le fleuve regorge de ces trésors riches en minéraux, vitamines et antioxydants. Et qui ne connaît pas les crevettes de Matane ? Petite, rose et très savoureuse, la crevette de Matane est la princesse du fleuve Saint-Laurent depuis les années 1960. À son embouchure, le fleuve cache un autre délice, un emblème de notre gastronomie : le crabe des neiges. Depuis plus de 50 ans, le Canada fournit près de deux tiers de l’approvisionnement mondial en crabe des neiges. Aux premiers arrivages, dès avril, il est exquis.

33



34
Virée gourmande
Décor majestueux, voie commerciale, route des explorateurs, terrain de jeu de toute embarcation… Le fleuve Saint-Laurent est notre colonne vertébrale ! Long de 1197 km, il dessine le territoire avant de se jeter dans le golfe du Saint-Laurent. À ses côtés, on apprend la vie des cétacés, la vie des vents et des marées; on découvre les algues, les moules, les pétoncles, etc. Le terrain de jeu est immense.
34 Cinquième génération de liquoristes, Catherine et Anne mettent à l’honneur le cassis dans des produits alcoolisés, dont la réputée Crème de cassis, récipiendaire de nombreuses distinctions. Cassis Monna & Filles confectionne aussi des sirops, des confitures, du beurre, des gelées, des terrines, etc. Tous ces produits sont disponibles à son domaine de l’Île d’Orléans, qui comprend notamment une boutique, une cave à vin, un coin gourmand et une crèmerie.
35 La Ferme maricole Purmer, située dans l’archipel des Sept Îles, cultive la moule, le pétoncle et quelques variétés d’algues comestibles. Elle offre des excursions en mer à bord d’un bateau pneumatique qui sont l’occasion de découvrir les techniques fascinantes de l’élevage marin, ainsi que la location de yourtes ou de chalets sur l’île La Grosse Boule.

36 Croyant à la richesse gustative de leur territoire d’adoption à L’Isle-Verte, Ève et Fabien ont emménagé leur petit fournil Racines boulangerie fermière dans une maison charmante où ils pétrissent et cuisent des pains au levain, lentement fermentés, faits de blé, de seigle, d’épeautre et de sarrasin locaux et biologiques. Ce n’est pas tout, ils cultivent également légumes, fruits et fines herbes qui entrent dans la composition de leur menu.

35 36 Photos : EM
T
C ô
photographie culinaire (bouteille et cornet), Cassis Monna & Filles (bâtiment),
ourisme
te-Nord (hommes pêchant des moules) et Julie Houde-Audet (jeune pousse biologique)

37
Tartine au beurre d’algues
et salade de crevettes nordiques
entrée POUR 4 personnes TEMPS DE PRÉPARATION 20 minutes TEMPS DE CUISSON 8 minutes
ingrédients
400 g de crevettes nordiques décortiquées
60 ml de crème fraîche (ou yogourt gras)
¼ de botte de ciboulette
150 g de beurre demi-sel tempéré
3 feuilles de nori
4 tranches épaisses de pain brioché
50 g de salicorne
Sel, huile d’olive ou sauce pimentée au choix
préparation
1 Déposer les crevettes dans un grand bol, ajouter la crème fraîche et bien mélanger. Assaisonner au goût. Ciseler la ciboulette et l’ajouter au mélange de crevettes et de crème. Recouvrir et réserver au frigo.
2 Dans un petit robot culinaire, mettre le beurre et les feuilles de nori. Bien mélanger afin d’obtenir un beurre vert-gris foncé et homogène. Déposer le beurre dans un contenant recouvert d’un papier film et réserver à température ambiante.
3 Bien beurrer chaque côté des tranches de pain avec le beurre de nori et poêler sur feu moyen-doux jusqu’à ce qu’elles soient bien dorées.
4 Lorsque le pain est croustillant à l’extérieur et moelleux à l’intérieur, le déposer dans une assiette, puis répartir les crevettes sur chaque tranche.
5 Terminer par la salicorne simplement « effeuillée » sur le dessus. Pour la finition, verser un filet d’huile d’olive ou de la sauce pimentée au goût.
Un guide naturaliste de la Sépaq m’a appris récemment que l’orignal aime la forêt jeune et le caribou, la vieille forêt. Moi, je les aime toutes. Entre autres en automne pour y faire de belles randonnées. « Le gros gibier tolère les bipèdes avec un sac à dos ! », m’avait-il rassurée. Quel bonheur de s’oxygéner dans les sentiers en montagne, pomme, barre tendre et bouteille d’eau en poche, de humer l’odeur du bois, de surprendre une perdrix ou une gélinotte huppée, de ramasser les plus belles feuilles pour décorer sa table d’Action de grâce, tout en grimpant pour admirer les plus beaux panoramas ! Et que dire de l’excitation qui se pointe lorsque la montagne se couvre de son manteau blanc et qu’elle se métamorphose en grand terrain de jeu ? Ski alpin, planche à neige, ski Hok ou de randonnée et sorties en raquettes sont autant de plaisirs d’hiver qu’on aime entrecouper de pauses pour se réchauffer et refaire le plein d’énergie. La nordicité, ça creuse l’appétit. Par temps froid, la chaleur produite par la digestion des aliments protéinés est plus importante ; les épices fortes telles la cannelle, le piment ou le gingembre font aussi des merveilles pour remonter quasi instantanément le thermostat interne des plus frileux !
les montagnes les montagnes les montagnes les montagnes les montagnes les montagnes les montagnes les montagnes les montagnes

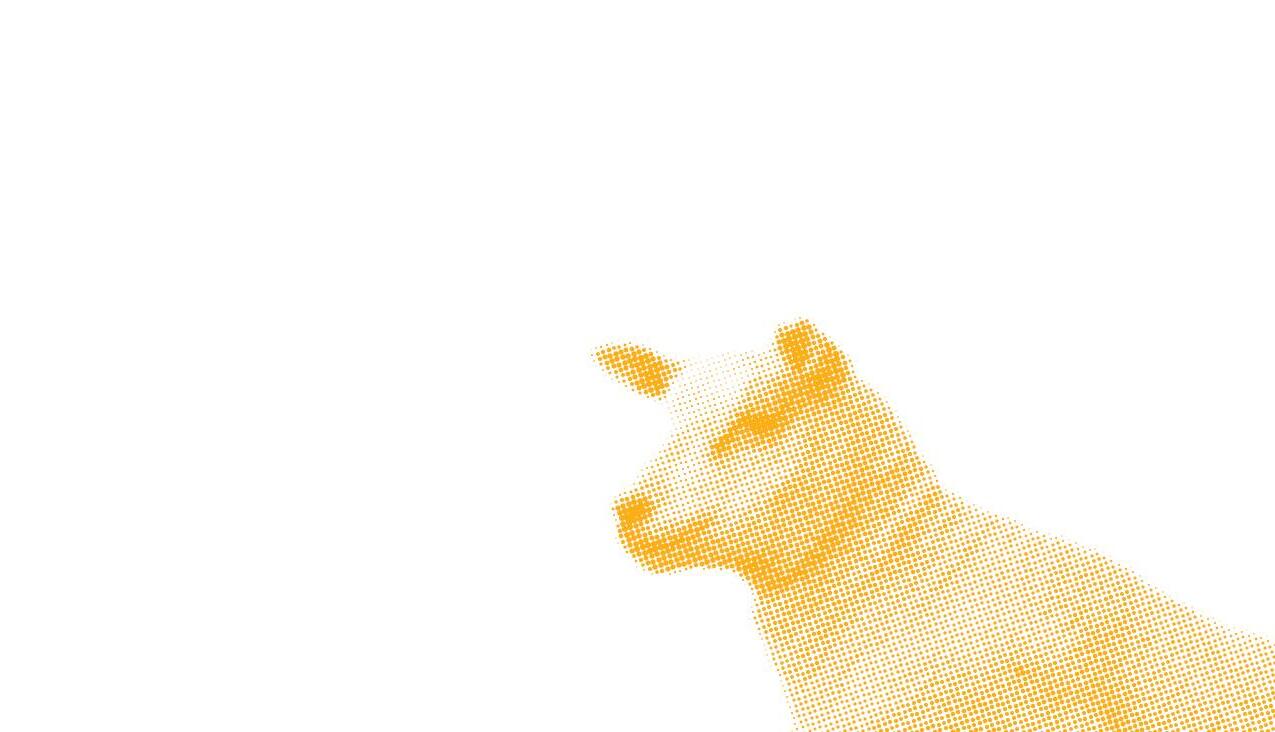
les montagnes les montagnes


T
é r é
Photo :
ourisme Mont
gie (champs et montagne)

38
France Bonenfant et Sylvain Bolduc
La famille Bolduc : vivre avec les gens qu’on aime
Avant d’entreprendre une vie à la tête d’une franchise à La Malbaie, Sylvain Bolduc passait beaucoup de temps à faire la navette entre la rive nord et la rive sud de Québec. La fatigue et l’usure dues aux heures passées au volant se faisaient sentir, mais l’homme, alors au début de la quarantaine, s’accrochait à sa passion : celle d’être épicier Metro.
Quand on lui a parlé d’une franchise à La Malbaie qui se cherchait un « c hef d’orchestre », Sylvain Bolduc s’est dit qu’il ne savait pas vraiment ce que signifiait « v ivre en région », surtout d’un point de vue humain. « J e dirais que La Malbaie a été généreuse envers moi et ma famille, se souvient-il. Elle m’a pris à bras-le-corps, et m’a appris beaucoup de choses sur la vie et sur moi-même. Je ne retournerais pas à ma vie d’avant. »
C’était il y a presque six ans. Avec celle qu’il appelle « ma blonde », France Bonenfant, il a tout bâti : une union qui dure depuis 30 ans, trois fils et un duo complice. Soulignons que sa conjointe est gérante de service. « Le moment que je préfère ? d it-il. Le samedi, à 5 h du matin, quand j’allume les premières lumières et que j’arpente les allées, avant l’arrivée des premiers employés. Je suis là pour leur souhaiter une bonne journée. » Ensuite, il se rend au backstore. Il est là, également, pour recevoir ses fournisseurs. « Il y a peu de chances qu’une carotte fanée traverse la ligne de mon magasin », lance-t-il, confiant.
On ne quitte pas la ville pour la région en criant ciseau. Avant de s’installer à Saint-Irénée, Sylvain Bolduc s’est montré prudent. « J ’ai commencé par observer comment on faisait les choses, dans la vie comme au magasin, raconte-t-il. Quand Metro faisait un chèque de 1000 $ p our une école, je ne le postais pas ; je m’y rendais. Je demandais à rencontrer les élèves. J’allais leur parler de l’importance de l’alimentation, de saisonnalité, des vitamines contenues dans les oranges d’hiver et dans les pommes d’automne. Et je me suis rendu compte combien « fa ire manger » me rendait heureux. »
La clientèle est hybride et, quand les touristes quittent, les gens de la place restent. Le patron a sa manière de se mettre à leur service. « Pas seulement pour les nourrir, mais aussi pour les écouter, explique-t-il. On parle de leur santé, de leurs activités, de la température. Mais surtout, si j’ai huit variétés de jus, mais pas de jus de pêche et qu’un client m’en demande, soyez assuré que je fais mon possible pour que mon fournisseur m’en trouve ! E t je rappelle mon client quand j’en reçois. Je suis sur le plancher, je connais mon magasin et j’aime mon monde ! »
On sent la même affection envers ses 85 employés. « O n ne me verra pas me pavaner en complet-cravate, confie-t-il. Je suis plutôt dans l’action. Si j’ai une réunion à faire avec ma gang de la viande pendant que les rôtis français sont en solde, je mets un sarrau et un tablier, et on jase… avec un couteau à la main ! » Non, il ne se prend pas pour un autre, mais il a été boucher, gérant de viande, gérant de service, gérant d’épicerie, superviseur dans les fruits et légumes, et directeur adjoint. On le verra rarement les mains dans les poches.
Comme la pomme ne tombe jamais bien loin de l’arbre, voilà que son fils aîné, Samuel, a quitté La Malbaie pour s’installer « en région ». À 23 a ns, il vit à Sept-Îles, où il fait sa vie et gère son entrepôt de chips Old Dutch. Mathis, son fils de 13 ans, aime emballer et Zachary, son fils de 11 ans, adore faire balancer les caisses. C’est bien jeune pour parler de relève 100 % locale, quoique…
Photo : MP Photographie
Isabelle Huot : un phare dans le milieu de la nutrition
Dotée d’un caractère fonceur et d’une détermination hors du commun, la docteure Isabelle Huot s’est taillé une place enviable dans l’industrie du prêt-à-manger. Ses rêves de jeunesse bouillonnants ont toutefois bien failli l’emmener dans une tout autre sphère.
Depuis près de 30 a ns, Isabelle Huot accompagne des milliers de Québécoises et de Québécois dans leur démarche pour améliorer leur alimentation. Le champ d’études qu’elle a choisi la prédestinait pourtant à exercer à l’autre bout du globe. « J ’avais envie d’être missionnaire et de partir dans des pays en voie de développement pour contribuer à éradiquer la malnutrition, affirme-t-elle. C’est pourquoi j’ai suivi une formation en nutrition. »
I sabelle Huot multiplie les chroniques dans les médias, tout en continuant parallèlement ses études supérieures et la pratique en clinique. Prolifique, elle publie aussi de nombreux ouvrages destinés à guider les gens en cuisine. Sa profonde empathie et son approche holistique de la nutrition lui permettent d’accéder à une certaine notoriété en l’espace de quelques années seulement.
Malgré l’acuité de ses conseils et sa proximité avec ses clients, Isabelle Huot finit par constater les limites de ses interventions. « Q uand j’ai lancé mes livres ( Kilo Cardio, tomes 1 , 2 et 3), les gens m’ont dit qu’ils les adoraient, mais qu’ils gagneraient bien du temps si j’étais dans leur cuisine, se souvient-elle. Je leur ai dit : “ Savez-vous quoi, je vais les faire, les repas ! ” »
Le virage vers le prêt-à-manger
Une prouesse qu’Isabelle Huot accomplit en dépit d’un horaire déjà chargé. Dès 2011, elle propose des repas prêts-à-manger dans sa boutique en ligne, avant d’approcher les
bannières d’épicerie. C’est alors que débute sa collaboration avec Metro. « Nous avons développé une belle relation, dit-elle. Je trouve que cette bannière valorise beaucoup les entrepreneurs québécois. Elle tient à avoir des produits locaux et elle sait nous mettre de l’avant. »
D evant l’engouement pour sa gamme de mets, Isabelle Huot se consacre désormais exclusivement à son entreprise en services de nutrition et d’aliments prêtsà-manger. « C ’est ce que j’aime le plus faire : d évelopper des produits innovants, les commercialiser, ajoute-t-elle. Les gens sont de plus en plus pressés, mais ne veulent pas faire de compromis sur la santé. Donc, il y a un intérêt pour des repas suffisamment protéinés, qui se réchauffent sans effort au four micro-ondes. »
U ne autre de ses missions est celle de s’assurer qu’une alimentation équilibrée reste accessible à tous. La docteure en nutrition exhorte néanmoins à faire preuve de simplicité dans la préparation des repas. « I l ne faut pas se compliquer la vie avec des recettes élaborées, indiquet-elle. Sinon, on risque de décrocher. On peut faire des mets simples, mais santé, comme une frittata, un bol-repas ou une salade composée. C’est plus facile qu’on ne le pense de bien manger ! »

39
Photo : Gracieuseté d’Isabelle Huot



 Frédéric Thibeault
Louise Marquis et Nelson Thibeault
Martin Thibeault
Frédéric Thibeault
Louise Marquis et Nelson Thibeault
Martin Thibeault
40 40
William Thibeault
La famille Thibeault : d'épiciers à bâtisseurs
Les Marquis-Thibeault sont ancrés dans l’histoire des Basses-Laurentides depuis plus de 40 a ns. La pérennité de leur succès repose sur un mantra qui ne se démode pas dans la famille : qualité, variété et service.
1973. Lucien Marquis, marchand général à Trinité-des-Monts, voit les deux aînés de ses sept enfants devenir de prospères marchands Metro à Sainte-Luce et à Québec. L’homme de 52 a ns cède alors au chant des sirènes et déménage ses pénates pour acquérir le Metro du boulevard Gouin à Montréal. Au diable le choc urbain ! L e guts de cet homme dont le fleuve lui coulait dans les veines, et qui a vécu jusqu’à 95 a ns, sera gage d’un succès qui donnera lieu à quatre g énérations de passionnés de l’alimentation.
Lucien Marquis se sera assuré d’avoir aidé chacun de ses sept enfants, filles comme garçons, à se placer les pieds dans l’alimentation avant de se retirer.
L’histoire se raconte de la bouche de Frédéric Thibeault. Frédéric et son frère Martin, « co nçu chez Metro », sont tous deux connus dans les Basses-Laurentides comme « les gars qui ont six Metro et pas mal de terrains ». Leur mère, Louise, digne fille de Lucien Marquis, était chef caissière chez Dominion quand elle a épousé un policier de Rimouski. Louise Marquis et Nelson Thibeault ont tout lâché pour acquérir leur premier supermarché à Saint-Jérôme.
« M a mère est une comptable et une boss redoutable ; m on père est un entrepreneur et un visionnaire extraordinaire. À deux, ils ont toutes les qualités », observe Frédéric. Aujourd’hui, Louise est toujours contrôleur financier ; Nelson préfère son rôle de conseiller. « Avec son besoin de créer, mon père aurait fait une bien malheureuse police (sic), s’exclame Frédéric. Après l’achat d’un magasin, il était capable de dire qu’il fallait le fermer tout de suite pour le rouvrir deux coins de rues plus loin, acheter le voisin et doubler le chiffre d’affaires. Ma mère a dû en avoir, des vertiges ! Mais chaque fois, elle refaisait les comptes, et l’histoire démontre qu’ils ont eu raison. »
La plus grande qualité du couple n’était pas tant d’avoir raison comme de donner raison. « I ls nous ont fait de la place », résume Frédéric. Pour illustrer, il confie une anecdote. « J ’étais stressé ; j’avais 22 a ns et j’allais congédier un monsieur qui avait deux fois et demie mon âge ! M ais je retiens une chose essentielle : n os parents nous ont permis de prendre des décisions et, par le fait même, nous ont appris à assumer nos erreurs et à prendre des responsabilités. C’est une clé majeure si on veut que la génération suivante prenne sa place. »
Outre ce pif pour faire rouler les affaires, les Marquis-Thibeault reconnaissent que leur succès repose sur une valeur parfois démodée : le service aux clients. « Q uand un client te dit que la salade était molle,
vaut mieux ne pas t’obstiner à lui faire croire qu’elle était ferme. Tu es condamné à t’améliorer, mais tu n’iras jamais plus loin que là où tes employés veulent bien te mener. » Heureusement, leurs employés, « du monde en or » , précise Frédéric, veulent aller loin !
F rédéric et Martin sont à la tête des Metro de Saint-Jérôme et de Saint-Antoine, mais aussi de Blainville, le premier succès qu’ils ont eux-mêmes piloté, également de Sainte-Sophie, où ils ont aussi bâti une pharmacie et un café, une autre manière de s’implanter au sein de la communauté. S’est ensuite ajouté le Metro de Prévost et, en avril 2 023, ce sera celui de Mirabel. Et William, l’aîné des cinq enfants de la quatrième génération, vient de passer l’été de ses 15 a ns à se passionner pour… des fruits et des légumes !
S ur les tablettes, les producteurs locaux sont à l’honneur : S erres Savoura, Microbrasserie et Charcuteries Shawbridge, fromages d’ici et produits maraîchers… La fibre locale fait vibrer les allées. Socialement, la famille est impliquée dans plusieurs fondations. « O n conserve un esprit coopératif parce qu’on sait qu’on est plus forts… unis ! »
Photos : Karma Photo
Pour l’amour du bio
La famille Girard-Mc Nicoll est l’une des pionnières dans le secteur des viandes et charcuteries biologiques et locales. Depuis plus de vingt ans, ses liens d’amitié avec les marchands et le personnel en magasin font partie de ses meilleures stratégies d’affaires.
Des précurseurs sur toute la ligne Dès l’enfance, Damien Girard baigne dans le milieu agricole. « M on père a toujours travaillé là-dedans, raconte Elsa Girard. À un moment donné, il a décidé de quitter les grandes entreprises agroalimentaires pour revenir à l’agriculture d’autrefois. »
À l ’aube des années 2 000, Damien Girard et sa conjointe, Natasha Mc Nicoll, se lancent dans l’élevage biologique de poulets. Parallèlement, la certification biologique voit le jour au Québec.
« M es parents allaient livrer euxmêmes leurs poulets dans les petites épiceries de la région pour essayer de se faire un nom, ajoute Elsa Girard. On se rappelle qu’en 2001, très peu de gens croyaient au bio. »
M algré tout, quelques marchands Metro vendent leurs produits. « Au début, je vendais 50 ou 100 p oulets par semaine, raconte Natasha Mc Nicoll. Ce n’était vraiment pas beaucoup ! »
Quelques années plus tard, la famille Girard-Mc Nicoll ajoute l’élevage de porcs à sa production, alors que la certification n’est même pas encore adaptée à ce secteur. « C ’est nous qui avons développé le cahier des charges avec Ecocert », s’exclame Elsa Girard.
L’amitié comme stratégie d’affaires En discutant avec les bouchers, la famille Girard-Mc Nicoll voit ses produits prendre de plus en plus de place en magasin. « I ls ne pensaient pas que ça allait vendre à l’époque, mais on y allait mollo, et il y avait très peu de retours », se souvient Natasha Mc Nicoll.
Petit à petit, le bio fait son nid. Mais il est encore trop tôt pour vendre du porc biologique frais. La différence de prix entre le porc bio et le porc conventionnel est trop importante. C’est ainsi qu’ils se sont concentrés sur la fabrication de charcuteries biologiques artisanales, un autre secteur méconnu à l’époque.
« Mon père est allé en Europe pendant quelques mois pour apprendre à faire de la charcuterie, précise Elsa Girard. En 2007, au Québec, la plupart des charcuteries fines étaient importées. On a donc bâti une usine de transformation, et mon père a développé nos premières recettes. Encore aujourd’hui, tous nos produits sont conçus par lui ! »
E ntre-temps, l’aînée de la famille, Alexandra, s’est jointe à l’entreprise familiale. Elle s’occupe des cultures pour nourrir les animaux, alors que leur fils, Félix, est gérant de ferme.
Pour chaque produit mis en marché, c’est par l’entremise du personnel en magasin qu’ils le font connaître aux consommateurs. « Depuis plus de 20 ans, je parle à nos clients (les marchands et le personnel en magasin) chaque semaine. On s’est vraiment liés d’amitié au fil du temps. Ils sont nos meilleurs alliés », conclut Natasha Mc Nicoll. Ensemble, ils contribuent à l’essor du bio et ils continuent de diversifier l’offre de viandes biologiques et locales de qualité.
« Mes parents allaient livrer eux-mêmes leurs poulets dans les petites épiceries de la région pour essayer de se faire un nom, ajoute Elsa Girard. On se rappelle qu’en 2001, très peu de gens croyaient au bio. »



41
Photos : Les viandes biologiques de Charlevoix (table de charcuteries et ciel de saucissons)
Virée gourmande
Les régions qui abritent les chaînes de montagnes sont d’une beauté époustouflante, en toute saison, et peut-être encore plus à l’automne lorsque les feuillus deviennent multicolores. Profitons de ces terrains accidentés pour voir et goûter tout ce que la nature a à offrir.
42 Les jardins de Cap-à-l’Aigle font rayonner ce village de Charlevoix qui fait partie de la courte liste des plus beaux villages du Québec. Répartis sur 19 hectares d’une terre ancestrale, les jardins s’étendent de la montagne au fleuve Saint-Laurent et comptent plus de 800 plants. Voilà un cadre enchanteur où casser la croûte et déguster des produits locaux tels qu’un fromage Migneron et un saucisson sec aux champignons sauvages des Viandes biologiques de Charlevoix.

43 La Ferme Ambrosia située à Saint-Hilarion, tenue par Alexis et Aleck, a deux missions : offrir aux visiteurs un gîte agrotouristique unique et élever des canards en liberté et nourris au pâturage. Cela donne aux produits une saveur réellement ancrée dans le terroir culinaire du Québec et de Charlevoix.
44 La Fromagerie Bergeron de Saint-Antoine-de-Tilly n’a plus besoin de présentation tant elle est connue. Elle se distingue grâce à sa spécialisation : la fabrication de fromages à pâte ferme de type gouda. L’offre comprend une douzaine de produits, fromage frais en grains et en bloc, ainsi que des mélanges pour fondue au fromage.

42 43
:
ë l
–
Photos
Rapha
Bilodeau
Tourisme Charlevoix (Jardins du Cap-à-l’Aigle), Ferme Ambrosia (deux hommes avec un canard) et Fromagerie Bergeron (planche de fromages)

44
45 Signe de raffinement et de classe, la truffe est déclinée, grâce à l’entreprise Truffe Charlevoix de La Malbaie, en une gamme de produits qui la mettent à l’honneur : tartinade d’érable, huile, sel, sauce BBQ, et plus encore.

46 Ici, dans la Ferme Marie-Noëlle Beaulieu de Baie-Saint-Paul, les animaux sont traités aux petits soins. L’été, des poules en liberté cohabitent avec des chèvres naines, des moutons miniatures et plein d’autres animaux. Les visites guidées de la fermette sont l’occasion pour petits et grands de voir de près ce qu’est la vie agricole.

45 46
Photo : F erme Marie-Noëlle Beaulieu (enfants avec des cochons)
Produits phares
Le Québec n’a plus rien à prouver côté fromages. Les vaches et les brebis rapportent de l’or, et notre savoir-faire est enviable, comme en témoignent les nombreux prix internationaux remportés et nos plateaux de fromages quotidiens. Idem pour le saucisson : marginal il y a encore quelques années, il se multiplie, se diversifie et a l’audace de se marier à des goûts très variés ! Dans Charlevoix, le produit phare reste cependant l’agneau , qui possède la certification IGP — identification géographique protégée. Il est élevé et nourri aux pieds des monts et des vallons… et dégusté dans tous les foyers et toutes les tables de la province.

47

48
Soupe à l’oignon en croûte
veau de Charlevoix braisé et Migneron
plat principal POUR 4 personnes TEMPS DE PRÉPARATION 30 minutes TEMPS DE CUISSON 2 h 15
ingrédients
100 g de beurre demi-sel
800 g d’épaule de veau (palette avec os)
341 ml de bière de Charlevoix
8 g ros oignons doux (style Vidalia)
10 ml de sirop d’érable
200 g de fromage Migneron
450 g de pâte feuilletée (dégeler d’avance et réserver au frigo, bien à plat)
Garniture aromatique au goût (carotte, oignon, céleri-branche, ail, thym, etc.)
Sel, poivre et huile d’olive
pour la dorure
1 œuf battu
1 cuillerée à soupe d’eau
préparation
1 Préchauffer le four à 300 °F (150 °C).
2 Dans une grande casserole allant au four, faire mousser à feu vif 25 g de beurre avec un peu d’huile d’olive. Assaisonner la palette de veau et la faire bien dorer des deux côtés dans la casserole. Réserver dans une assiette.
3 Dégraisser ensuite la casserole et déglacer celle-ci avec la bière. Faire réduire jusqu’à presque sec et ajouter la garniture aromatique. Remettre la viande dans la casserole. Mouiller ensuite avec de l’eau froide jusqu’à hauteur. Porter à ébullition, écumer et couvrir avant d’enfourner à 300 °F (150 °C). Laisser braiser au four pendant 2 heures.
4 Sortir la casserole prudemment et décanter délicatement la viande. Réserver celle-ci sur une plaque à pâtisserie. Défaire la viande en gros morceaux. Passer le jus de cuisson dans une passoire très fine et réserver.
5 Émincer les oignons doux. Dans une grande casserole, faire mousser le reste du beurre. Lorsqu’il est presque noisette, ajouter la moitié du sirop d’érable et les oignons. Laisser colorer à feu très vif, tout en remuant de temps à autre afin que le fond de casserole ne brûle pas. Frotter le fond lorsque les sucs des oignons s’y collent, et ainsi répartir la « caramélisation » parmi tous les oignons*. Répéter l’opération avec le reste du sirop d’érable et des oignons jusqu’à ce que les oignons soient complètement caramélisés, c’est-à-dire assez foncés.
6 Verser le jus de cuisson du veau à ce moment, puis porter le tout à ébullition. Ajouter les morceaux de veau braisés et assaisonner.
7 Verser ensuite la soupe à l’oignon et au veau dans 4 bols de modèle « soupe à l’oignon », en quantités égales. Tailler le Migneron en 4 t ranches et les disposer sur le dessus de la soupe.
8 À l’aide d’un gros emporte-pièce ou d’une assiette, tailler des cercles de pâte assez grands pour recouvrir toute la superficie du bol contenant la soupe à l’oignon. Recouvrir chaque bol de pâte et s’assurer de bien la faire adhérer au bol. Badigeonner de dorure. Enfourner à 400 ° F (200 °C) de 15 à 20 m inutes. Laisser tiédir de 3 à 4 m inutes et servir, bien brûlante, avec le fromage fondu sous la croûte croustillante.
*Note : Si le fond devient un peu trop foncé, le truc est de couvrir la casserole et retirer du feu : la condensation causée par la vapeur rendra le fond de la casserole humide et rendra le grattage plus facile.
La toponymie de nos nombreux lacs est aussi variée qu’insolite. À preuve, le lac J’en-Peux-Plus, le lac Pohénégamook, le lac aux Américains, le lac A, le lac B, le lac Do-Ré-Mi, le lac On-Dîne, qui ouvre l’appétit. Justement, je me souviens qu’enfants, on taquinait le poisson, en pyjama au bout du quai, en attendant de courir à l’appel de ma mère pour dévorer ses fameuses crêpes. Parfois, ô joie !, elle nous mettait un lunch dans un sac de papier brun, à manger sur l’eau, dans la chaloupe. Le piquenique était composé de sandwichs beurrés garnis de concombres, de limonade et d’un petit gâteau. Nos vacances d’été et l’aventure avec un petit a. Dans notre belle province, il existerait plus de 500 000 lacs et 4500 rivières, autant d’occasions pour petits et grands de profiter de ces précieuses réserves d’eau douce. Qui les a comptés ? Peut-être celui ou celle qui sait aussi tout sur les saumons. Des 8000 œufs de la nouvelle portée, 30 arriveront à se rendre à la mer et seulement 5 femelles remonteront la rivière pour y pondre leurs œufs. Et le cycle de la vie sauvage recommencera. Et les vacances d’été aussi pour les enfants.
les lacs et les rivières les lacs et les rivières les lacs et les rivières les lacs et les rivières


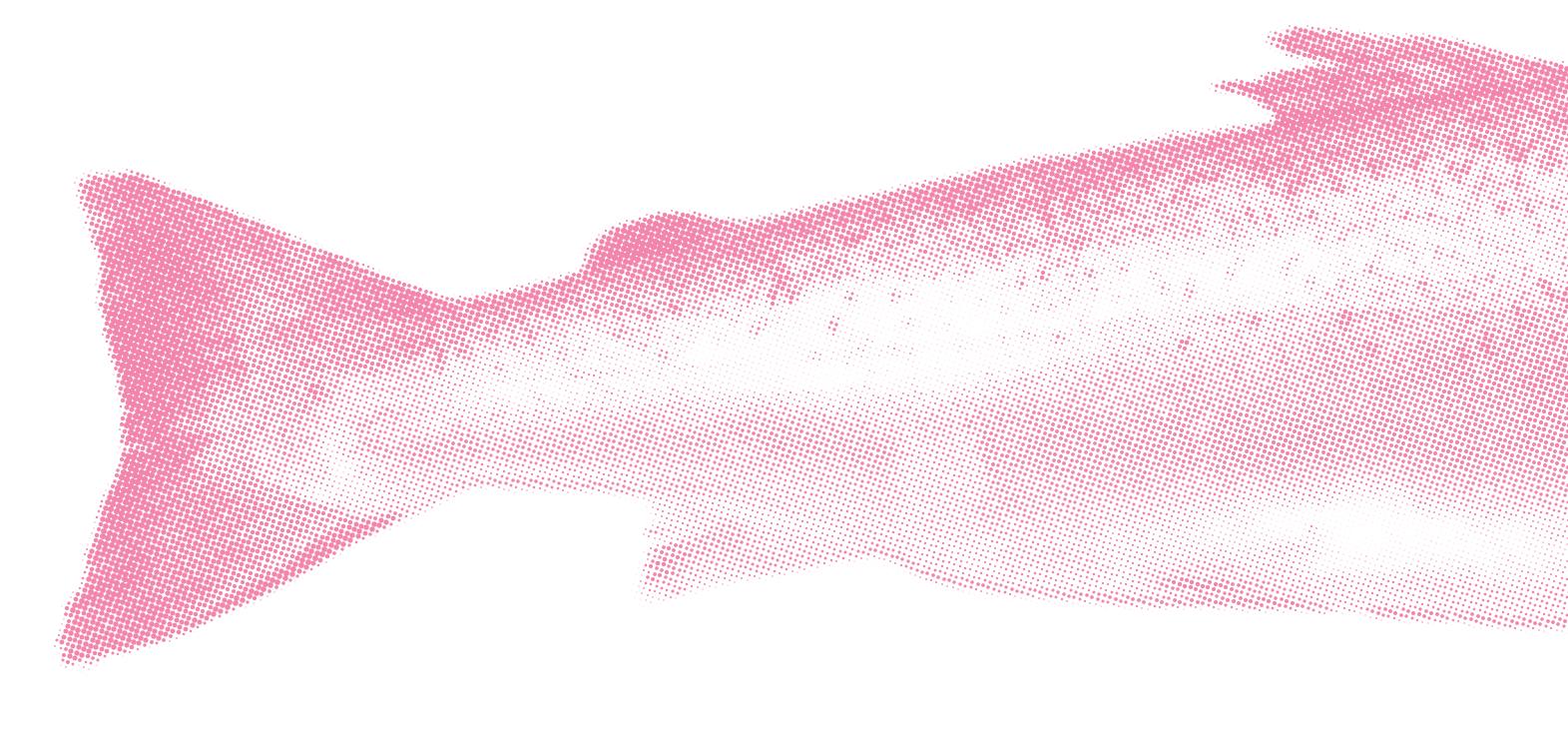

 Photo : T ourisme Saguenay—Lac-Saint-Jean (homme pêchant au coucher du soleil)
Photo : T ourisme Saguenay—Lac-Saint-Jean (homme pêchant au coucher du soleil)

49
André Fortin
André Fortin : la main à la pâte et l’oreille tendue
Les épiciers qui font la différence dans la vie des gens ont souvent une histoire qui prend racine dans l’enfance. Ils ont commencé tout petits à classer des bouteilles, sont devenus emballeurs, avaient une mère qui était caissière et adorait son métier, et bien avant l’âge de 15 ans, avaient déjà fait une incursion dans plus d’un service d’une épicerie.
Elle est là, la genèse de la carrière de l’épicier André Fortin. Ce père de famille, qui a élevé trois enfants, pourrait dire qu’il a tout fait au cours de sa carrière, y compris négocier à titre de délégué syndical et de représentant patronal. On le verra encore régulièrement aux caisses, au service des clients et à la rescousse de son équipe. « Je connais les enjeux, les défis et les joies de chaque poste au sein du magasin parce que je les ai occupés. » C’est une force incroyable dont André Fortin ne se vante jamais.
Quand on demande au proprio du « g ros Metro d’Alma » et du « petit Metro de Delisle » ce qui fait, justement, un bon marchand d’alimentation, il n’évoque pas ses 36 a nnées d’expérience. Ce qui fait d’André Fortin un excellent épicier tient moins de sa gestion des marges de profit que de sa manière de mener ses troupes. « Chez nous, les clients soulignent la belle ambiance de travail, note-t-il. Je sais que si je ne suis pas à l’écoute, et si je n’ai pas à cœur le bonheur de mes employés, on va quand même les vendre, les côtelettes de porc, mais ça va être tellement moins agréable pour tout le monde. »
C’est ainsi que les mots dialogue , relation , affection , respect et écoute se sont tour à tour glissés dans la conversation du Saguenéen. André Fortin n’a pas évoqué le nombre de mètres carrés de ses magasins ni la fraîcheur de ses aliments. Il a plutôt
parlé des humains qui l’entourent. Tant pis pour la côte de bœuf en solde ; i l s’est appliqué à dire à quel point il lui importait de se rendre accessible et ouvert aux autres. Par exemple, il a instauré un système d’horaire appris de ses mentors. Il l’a fait en pensant à la qualité de vie des familles et en fonction des besoins de chaque employé.
André Fortin, natif de Chicoutimi, n’hésite pas à reconnaître qu’il a été mentoré. Sans la famille Dubé, avec qui il a travaillé pendant 10 a ns, il serait peutêtre resté ce garçon trop timide, certes incapable de s’adresser à une assemblée de 800 p ersonnes, comme il sait le faire maintenant dans les nombreuses activités du Club Lions au sein duquel il est impliqué. « Si je pouvais parler au jeune André Fortin, je lui dirais qu’aider son prochain est une source d’accomplissement, que le bénévolat nourrit l’âme et qu’en travaillant pour gagner sa vie, il faut surtout cultiver l’amour de ce que l’on fait. C’est avec la persévérance que le sort d’une personne s’améliore. » Parlez-en à celui qui a commencé sa carrière en classant des bouteilles.
Photo : P aul Cimon
Une petite bière dans le panier
Au Québec, ajouter de la bière à son panier d’épicerie est un geste tout naturel – qui fait pourtant figure d’exception au Canada. Et cet accès facile à la bière se double d’une sélection diversifiée qui met en valeur les microbrasseries d’ici.
Les Québécois ne s’en doutent probablement pas, tellement la chose semble évidente, mais acheter de la bière à l’épicerie, comme on le fait depuis la fin de la prohibition, en 1921, est une sorte de privilège. Au Canada, seule Terre-Neuve donne la même possibilité à ses citoyens. L’Ontario l’offre également, mais depuis seulement quelques années et de façon beaucoup plus limitée. Ailleurs, les brasseries doivent obligatoirement passer par des chaînes de distribution centralisées ou par les monopoles provinciaux.
Pour les producteurs de bière, en particulier les microbrasseurs et les producteurs artisanaux, l’accès direct au marché de la vente au détail, en rejoignant directement les épiceries et les dépanneurs à l’échelle locale, régionale ou nationale, est un avantage important. « Aujourd’hui, c’est 90 % d e notre production qui est vendue dans les épiceries, » r ésume Gilles Dubé, président-directeur général des Brasseurs du Monde, à Saint-Hyacinthe, la microbrasserie qu’il a fondée en 2011.
Le Metro Riendeau, dans la ville dont est originaire l’entreprise, est d’ailleurs devenu un des tout premiers clients des Brasseurs du Monde, quand la distribution se faisait à l’échelle locale. Une aventure qui a pris beaucoup d’ampleur depuis : « E n 2011, c’était très embryonnaire, mais depuis, les consommateurs se sont tournés vers les microbrasseries, un phénomène qui a pris encore plus d’importance avec la faveur qu’ont reçue les produits locaux à cause de la pandémie de COVID-19. » Aujourd’hui, la présence d’une sélection importante et distinctive de bières locales est un incontournable pour bien des supermarchés.
La multiplication des bières
Cet élargissement des gammes de produits disponibles est issu d’une transformation profonde de la production et des goûts des Québécois en matière de bière, souligne Gilles Dubé. « La génération précédente avait une idée de la bière, dit-il. Pour elle, c’était quelque chose de facile et d’accessible. Avec les microbrasseries, il y a beaucoup plus de recherche de nouvelles saveurs. »
P our le fondateur des Brasseurs du Monde, donner de la place aux « a rtistes brasseurs » a été depuis toujours au cœur de la production. « O n a dû produire de 250 à 300 nouveaux produits en une dizaine d’années : bières spontanées, aux fruits, avec des levures maison, bière Nigori, faite avec du riz et des levures de saké, une gamme de bières pour la collection M de Metro, etc., se souvient-il. L’objectif, c’est la créativité. »
C ette créativité est bien mise en vitrine au pub Le Picoleur, ouvert en 2021, qui offre plus d’une centaine des produits des Brasseurs du Monde, y compris des bières vieillies en cave depuis plusieurs années. En raison de l’autorisation donnée en 2021 à la centaine de brasseurs artisans de distribuer leurs produits en épicerie, comme les quelque 220 détenteurs de permis industriels le font depuis des années, le marché québécois de la bière a connu une très grande expansion qui favorise les produits locaux. Pour Gilles Dubé, cette occasion en or vient désormais avec « la responsabilité de garder le niveau de qualité » Un ingrédient essentiel afin de préserver l’effervescence de l’industrie.
:
Photos
F
abrice Gaëtan
–
Metro (portrait de M. Dubé) et Les Maximes (étalages de bières)



50

Produits phares
Le doré, la truite et la ouananiche, ce saumon d’eau douce au nom si doux et à la chair si délicate, peuplent nos lacs et rivières. Mais pensons aussi à l’omble chevalier, qui aime les eaux froides et qui passe de l’eau douce à la mer : un poisson royal et magnifique, aussi beau à regarder que délicieux à manger… Et qui dit lac, dit Lac-Saint-Jean. Et qui dit Lac-Saint-Jean, dit bleuet , un autre produit phare traditionnel du Québec. Si simple, si singulier et si accommodant dans tous les plats sucrés ou salés, le bleuet de petite taille est au cœur d’une activité économique majeure dans la région du Saguenay.

51

52
Dany Boutin, Naomie Boutin, Carole Tremblay et Olivier Boutin
La famille Boutin : bâtir pour demain
Ces temps-ci, Dany Boutin met la touche finale aux rénovations de ses succursales de Dolbeau et de SaintFélicien. Retour sur le parcours marquant d’un battant dont la manière de faire pourrait servir d’exemple à tout aspirant au MBA.
Alors qu’il avait 7 ou 8 a ns, le petit Dany Boutin, originaire de Desbiens au Lac-Saint-Jean, fils de cuisinière et de soudeur, admirait secrètement son oncle épicier. « I l avait les clés du magasin. On pouvait entrer là avec lui, même quand c’était fermé », raconte l’homme de 60 a ns, un sourire dans la voix. Très tôt, l’idée d’être son propre patron allait prendre vie dans le cœur du garçon ; il s’est mis à rêver d’être propriétaire d’un dépanneur.
Dany Boutin avait 17 a ns quand son père a été victime d’un premier AVC. « Tout le monde insinuait qu’il était diminué. Moi, j’appréciais la douceur de sa nouvelle personnalité.
Alors qu’on était en route vers l’entrevue pour mon premier vrai job — aux entrepôts Metro —, à 250 k m de la maison, mon père n’a pas cessé de m’encourager. Au retour, il n’a pas cessé de me féliciter. C’est peut-être l’un des plus beaux moments que j’ai vécus avec lui. » S ept années plus tard, son père succombait à un dernier AVC.
Pendant que les cousins héritaient de la bannière de leur père, Dany, le petit dernier de sa fratrie, comptait sur sa détermination, son caractère droit et fier, ainsi que sur son sens du travail bien fait pour avancer dans les dédales d’un Super Carnaval. Un jour, en se portant à la défense d’un employé handicapé qui se faisait injustement engueuler pour le manque d’ardeur de son coup de balai, Dany s’est avancé vers le grand patron de passage sur « s on » quai de réception, et l’a sommé de partir. Ce leader naturel n’avait peur de rien.
« A ujourd’hui, je peux dire que ces traits de caractère ne remplacent pas des leviers financiers, mais ça vaut pourtant bien des millions ! »
P our la petite histoire, lors d’une restructuration, Metro a congédié le jeune Dany. Malgré la situation, ce dernier avait remercié ses employeurs pour l’expérience, au moment de quitter. « C e sont les relations qu’on établit avec les gens qui importent, elles sont la trace qu’on laisse derrière soi et qui sert d’assise à ce qu’on bâtit pour demain. » Pour preuve, la bannière allait le réembaucher quelques années plus tard.
Le reste est une histoire de chance et de courage. Au début des années 1990, Dany Boutin s’associe à son frère et l’un de ses cousins pour acquérir le Metro de Dolbeau. Le trio devient un duo, puis en 1997, à l’âge de 35 a ns, Dany devient, sur papier,
l’unique actionnaire. À cette époque, il est en couple avec Carole Tremblay. Ensemble, ils ont deux enfants : Naomie et Olivier.
En 2008, Dany et Carole acquièrent le Metro de Saint-Félicien, et le rêve de Dany se transforme en projet de famille. « Les enfants faisaient leurs devoirs au Metro, ils visitaient des magasins avec nous, et quand on rénovait, ils s’exprimaient sur le choix des matériaux ; i ls prenaient part aux conversations. Même s’ils n’étaient que des enfants, Carole et moi écoutions ce qu’ils avaient à dire. »
En 2 012, le couple éclate. Mais tout a été mis en place pour que le projet de famille se perpétue, et que Carole demeure partenaire. Les enfants, aujourd’hui âgés de 30 et 34 a ns, s’avèrent une solide relève. « I ls se font confiance mutuellement, et ils savent qu’ils ont besoin l’un de l’autre pour grandir. Je suis extrêmement fier d’eux », note le père.
Aujourd’hui, trois petits-fils s’ajoutent à l’histoire. Ils ont l’âge qu’avait leur grand-père quand il a commencé à rêver. Le dépanneur dont il avait rêvé plus jeune s’avère maintenant une entreprise de plusieurs millions. Dany ne cache pas sa reconnaissance envers Metro. « À c haque étape, la bannière a cru en moi, comme l’avait fait mon père. » Dany Boutin rêvait d’un trousseau de clés ; M etro lui a ouvert ses portes.
Photo : Gracieuseté de Dany Boutin
Photos T ourisme Saguenay—Lac-Saint-Jean (femme dans un bateau et cueillette de bleuets) et Tourisme Laurentides (provisions dans une voiture)



53 54 55
Virée gourmande
Le Québec possède 3 % des réserves d’eau douce renouvelables de la planète. On parle de plus de 4000 rivières et de plus de 500 000 lacs. C’est énorme. On pratique des activités nautiques, on flâne sur les berges et on pêche, été comme hiver. On aime y taquiner doré, brochet, perchaude, ouananiche…
53 Pour découvrir les trésors cachés du magnifique lac Saint-Jean, dans le respect des règles de développement durable, Aventure Lac Saint-Jean , une entreprise de Roberval, propose la pêche en bateau l’été et sur glace l’hiver. Au menu, doré, brochet, perchaude et ouananiche, et ce, en compagnie de guides expérimentés.

54 La Véloroute des Bleuets, une boucle de 256 kilomètres qui ceinture le lac SaintJean, traverse 15 municipalités ainsi que la communauté ́innue de Mashteuiatsh. Sur le chemin, on retrouve Bouchard Artisan Bio, une fermette et fromagerie artisanale, la Chocolaterie des Pères Trappistes de Mistassini et Les délices du Lac-Saint-Jean, où le bleuet est à l’honneur. Il est aussi possible de faire un circuit thématique des produits brassicoles de la région.
55 Le Chemin du Terroir est une route de 226 kilomètres qui met en vedette l’agrotourisme, la culture, et le patrimoine des Basses-Laurentides et d’Argenteuil. Cidrerie, vignoble, fromagerie, charcuterie, microbrasserie, tarterie… Le Chemin du Terroir est synonyme d’escapades romantiques, familiales, éducatives et, bien sûr, gourmandes.
56 Pêcher en famille l’omble de fontaine, le brochet, le doré ou encore le touladi, c’est possible à la Pourvoirie du Lac Matchi-Manitou, à Val-d’Or, qui offre des options d’hébergement pour tous les budgets et même la chance de voir des aurores boréales.
56

57
Filet de doré rôti
vichyssoise de laitue et quinoa croustillant
Plat principal POUR 4 personnes TEMPS DE PRÉPARATION 40 minutes TEMPS DE CUISSON 30 minutes
ingrédients
2 g ros oignons espagnols
30 g de beurre
2 gousses d’ail
11 sucrines (ou cœurs de laitue romaine)
200 ml de crème 35 %
200 g de quinoa
50 g de beurre demi-sel
4 fi lets de doré de lac d’environ 150 g (avec la peau, écaillés)
25 ml de vinaigre de cidre
25 ml de miel
25 ml de moutarde forte
75 ml d’huile d’olive pour vinaigrette
Sel, poivre noir et huile d’olive en quantité suffisante
préparation
1 Peler et émincer les oignons espagnols. Les faire suer dans le beurre et un peu d’huile d’olive, avec l’ail concassé grossièrement, à feu très doux afin qu’il n’y ait pas de coloration.
2 Pendant ce temps, émincer 8 sucrines. Ajouter celles-ci à l’oignon sué et les faire tomber à feu moyen et à couvert. Après environ 10 m inutes ou jusqu’à ce qu’elles soient tombées, ajouter la crème et retirer du feu.
3 Verser le contenu de la casserole dans un mélangeur. Mélanger prudemment à haute vitesse, afin d’obtenir une texture bien lisse. Passer ensuite le tout dans une passoire fine afin d’éliminer les éventuels grumeaux. La consistance devrait être bien « nappante ». Assaisonner, puis réserver au frigo, à couvert.
4 Bien rincer le quinoa à l’eau froide. Le mettre ensuite dans une casserole et remplir aux trois quarts d’eau froide. Porter l’eau à ébullition et baisser le feu. Laisser cuire à petit bouillon pendant une quinzaine de minutes, puis saler légèrement. Lorsque le quinoa est bien tendre, égoutter à l’aide d’une passoire, puis faire assécher sur une plaque recouverte de papier absorbant en le laissant tempérer.
5 Chauffer une friteuse à 350 ° F (180 °C) et faire frire le quinoa dans une passoire en métal, un petit peu à la fois, jusqu’à ce qu’il soit doré et croustillant. Saler et poivrer, puis réserver sur une plaque recouverte de papier absorbant.
6 Dans une poêle antiadhésive, déposer le beurre et le faire mousser à feu vif. Ajouter un trait d’huile d’olive et déposer les filets de doré assaisonnés, côté peau vers le bas. À l’aide d’une spatule, aplatir les filets, qui devraient se raidir au contact de la chaleur. Baisser le feu et laisser rôtir en arrosant doucement la chair du poisson du beurre de la poêle, pendant environ cinq minutes. Retourner ensuite et retirer la poêle du feu. La cuisson va se compléter dans la chaleur accumulée de la poêle.
7 Pendant ce temps, dans un cul-de-poule de bon format, verser le vinaigre, la moutarde, le miel et l’huile d’olive, puis fouetter légèrement afin d’obtenir une vinaigrette homogène. Tailler les 3 sucrines restantes en quartiers sur la longueur. Bien les enrober de la vinaigrette et assaisonner au goût.
8 Dans une assiette creuse, verser un fond de la vichyssoise de laitue, déposer la laitue enrobée de vinaigrette et terminer avec le filet de doré sur le dessus. Saupoudrer généreusement de quinoa croustillant pour la finition.
Savez-vous ce qu’est un forestible ? C’est un néologisme plutôt mignon pour désigner les produits de la forêt qui sont aussi de bons comestibles. Le terme regroupe les petits fruits, les légumes forestiers, les champignons, les noix, les herbes, les aromates, les thés et les tisanes. Quand on découvre toutes les merveilles qui poussent ici et qu’on peut consommer, on se sent comme des analphabètes de la forêt : carcajou, myrique baumier, agastache, gingembre sauvage, amélanches, que de jolis noms ! Les chefs s’y intéressent de plus en plus et leur accordent une place dans leurs menus, des épiceries les mettent sur les tablettes, et j’aurais aussi envie de les utiliser dans ma cuisine de tous les jours ou au retour d’une bonne cueillette dans les bois. Pour y arriver, il faut acquérir des connaissances, une expertise : par exemple, distinguer le sapin baumier de l’if du Canada, l’un comestible et l’autre toxique, ou savoir qu’il vaut mieux laisser certains champignons au sol. En apprenant sur les bienfaits de nos nombreux forestibles, on a encore plus envie de protéger cette belle nature généreuse.
les forêts les forêts les forêts les forêts les forêts les forêts les forêts
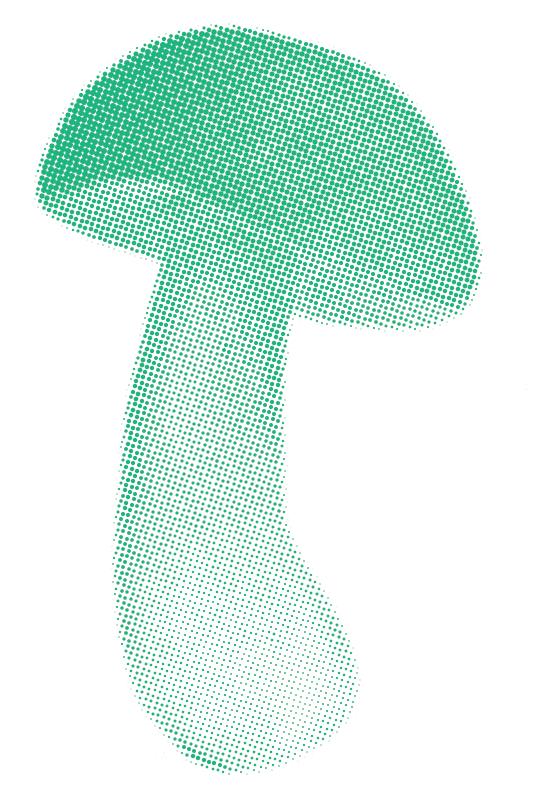




58
Jean-Christophe Plouffe
La famille Plouffe : l’importance de l’équipe
Si vous rencontrez Jean-Christophe Plouffe dans une allée de l’un de ses marchés Metro, demandez-lui de vider ses poches : il y a fort à parier qu’elles seront pleines de bouts d’étiquettes décollées des produits et de morceaux de papier écornés – souvent de vieilles listes d’épicerie –ramassés sur les planchers qu’il arpente à longueur de journée.
Jean-Christophe Plouffe sourit en évoquant cette manie. « C hez nous, on est de fiers compétiteurs, note l’homme. Je n’ai pas peur de me pencher pour ramasser quelque saleté. Il n’y a pas de secret p our arriver au succès : tous les détails et toutes les personnes sont importants dans une histoire de réussite. »
I l est comme ça, le directeur des opérations du Groupe Plouffe en Estrie : un gars d’équipe ! Farnham, Bedford, Bromont, Granby, Waterloo, Magog, Rock Forest et Fleurimont, Jean-Christophe Plouffe fait sans relâche la navette entre l’une et l’autre de ces localités. Il visite au moins deux épiceries par jour, est en contact étroit avec ses directeurs locaux et ne laisse jamais un Metro à lui-même pendant plus d’une semaine.
Troisième de sa génération, Jean-Christophe Plouffe est né alors qu’existait déjà cette chaîne d’affiliés. Par conséquent, il évite de s’attribuer le mérite d’avoir créé un tel château fort familial, si l’expression se prête au monde de l’alimentation. « M etro nous offre des outils pertinents, des campagnes de marketing éprouvées et un pouvoir d’achat accru. Nous avons les mêmes accès que ceux d’un magasin franchisé, mais aussi, une latitude non négligeable pour mettre de l’avant nos propres idées. On est inclus dans la grande famille Metro tout en conservant une grande flexibilité. C’est le meilleur de deux mondes. »
L’histoire d’un petit épicier
L’histoire commence à Farnham, au milieu des années 1950, là où Jean-Claude Plouffe, grand-père de Jean-Christophe,
tient sa première épicerie, qui devient un Metro en 1960. Ses deux fils, Daniel et Patrick, développent l’entreprise. Chacun a des enfants qui s’impliquent, ou non, dans le développement des affaires à différents moments de leur vie. À 30 a ns, Jean-Christophe est toutefois le seul de sa génération à faire partie de la haute direction.
Alors qu’il n’était pas plus haut qu’un comptoir-caisse, Jean-Christophe Plouffe jouait déjà les emballeurs dans le rayon du vrac. À l’époque, le travail ne l’attirait pas autant que l’idée de se remplir les poches… de bonbons. « Déjà, je savais que je voulais être gestionnaire », note-t-il. Ça tombe bien parce que, à 19 ans, il était nommé directeur adjoint, histoire de tester ses affinités avant ses études en gestion.
Aujourd’hui, ce passionné fait équipe avec Daniel Duranleau et Patrick Lavoie (encore Daniel et Patrick ! ), deux maîtres des opérations sans qui rien ne serait possible. Produits bio, sans gluten, végétaliens, keto ou régionaux, aucune tendance n’échappe à ce trio, pour qui l’implication locale et communautaire fait aussi partie d’un schème de valeurs parfaitement intégré. « B ien des gens disent que c’est difficile de travailler avec son père – D aniel Plouffe est toujours l’unique propriétaire – o u, à l’inverse, de transmettre les pouvoirs à l’autre génération. J’ai eu un modèle intéressant, et qui a su m’intéresser. J’aime ma bannière et je bénéficie de huit bonnes équipes dans huit magasins performants. J’aime ce métier, où il n’y a pas deux journées qui se ressemblent, et, surtout, je veux continuer à avancer et à saisir toutes les occasions. »
P hoto : Metro
K pour Katrine : parcours d’une gourmande créative
Des allergies de ses filles, Katrine Paradis a su tirer une énergie créative pour élaborer des recettes succulentes et originales. Qui aurait imaginé que de telles restrictions alimentaires puissent être le point de départ d’une entreprise florissante d’ici ?
K atrine Paradis jouit d’un vaste capital de sympathie autant chez les végétaliens ou les flexitariens que les intolérants au lactose ou au gluten. Son secret ? La volonté de ne rien sacrifier du plaisir gustatif en raison d’une allergie ou d’une sensibilité alimentaire. « J e suis tellement gourmande ! co nfie-t-elle. Lorsque j’ai cessé de manger du gluten à cause d’un problème d’inflammation, il n’était pas question que la bouffe soit plate. »
C ’est sa fidèle complice, Marie-Josée Morin, qui entrevoit l’immense potentiel de la créativité culinaire de son amie. « E lle a vu que je préparais des mets sans gluten et sans produits laitiers pour mes amis, mais que personne ne s’en rendait compte », explique Katrine Paradis. Pourquoi ne pas partager ses recettes inventives avec d’autres ?
Les créations alléchantes de Katrine Paradis font mouche presque instantanément. « D ès qu’on a lancé le site Internet, on a senti que l’on répondait à un besoin, ajoute Marie-Josée Morin. Nous avons
reçu de nombreux remerciements de la part de gens souffrant d’intolérances ou d’allergies qui désespéraient de trouver des recettes adaptées à leurs restrictions alimentaires. » S elon Katrine Paradis, ce succès s’explique en partie par le caractère inclusif de ses recettes : « O n voulait que ça soit festif et gourmand. Le but ? Rassembler tout le monde autour de la table, que les gens aient des allergies ou non. Même les plus sceptiques ! »
Des astuces pour végétaliser les desserts Pour ceux et celles qui souhaitent mettre la main à la pâte, Katrine Paradis leur conseille de se parer de créativité ainsi que d’un… moule Bundt : « C ’est l’allié des desserts végétaliens. Il permet à la chaleur de mieux se répartir et d’éviter qu’ils ne renfoncent. » Si vous désirez végétaliser vos recettes favorites, elle suggère de privilégier celles ne contenant pas plus que deux ou trois œufs. « I ls servent entre autres à faire monter la pâte, une fonction toujours difficile à imiter avec d’autres ingrédients », explique-t-elle.
Katrine Paradis émet toutefois une mise en garde contre la tentation de vouloir reproduire fidèlement le goût d’une recette traditionnelle en version végétalienne. « I l faut y aller dans l’optique de créer autre chose et de s’ouvrir à de nouvelles perspectives, dit-elle. C’est l’attitude que je prône. »
Armées d’un répertoire de recettes appétissantes et d’une cote de popularité grandissante, les entrepreneures ont sollicité Metro en vue d’établir un partenariat. Une collaboration fructueuse qui leur a non seulement offert une visibilité extraordinaire, mais aussi un soutien indéfectible. « C’est un associé qui nous donne des idées, qui est capable de nous guider et de nous conseiller, indique Marie-Josée Morin. Notre relation est très privilégiée. »

59 Photo : Ariel T arr
Margaux Verdier, Katrine Paradis et Marie-Josée Morin

60
Vincent Saumure
Vincent Saumure : le patron tant aimé
En juin dernier, le personnel du Metro de Mont-Laurier a réservé une surprise de taille à Vincent Saumure : la visite de l’équipe de PierreOlivier Zappa de TVA. Les employés ont ainsi scellé leur désir de nommer leur boss adoré « Patron de la semaine ». Arrêt sur image.
Vincent Saumure a cette énergie contagieuse qui fait qu’autour de lui on s’active dans la bonne humeur. Après 21 a ns chez Metro, dont 8 auprès de sa gang des Hautes-Laurentides, il ne s’en cache pas, c’est tout un défi de garder engagée une main-d’œuvre de qualité. L’arme la plus efficace que l’homme d’affaires ait trouvé est sans doute de nourrir le sentiment d’appartenance des employés. Ça fonctionne à un point tel que dans la missive envoyée par la gérante de boulangerie à l’équipe de l’émission À vos affaires, à LCN, la boulangère avait écrit : Les employés souhaitent souligner « l’implication » du patron dans « notre » magasin .
L’anecdote fait sourire Vincent Saumure. Oui, il est bien le proprio de « leur » franchise, mais au fond, il n’hésite pas à dire qu’il n’est rien sans ses 110 employés. « Fanny a eu raison d’écrire « notre » m agasin. Je ne pourrais pas souhaiter mieux ! »
Les efforts de Vincent Saumure pour alimenter l’esprit de collégialité sont tangibles. Chanteur, guitariste et bassiste à ses heures, ainsi que fervent amateur du répertoire des Cowboys Fringants, le propriétaire du Metro de Mont-Laurier n’hésite jamais à transformer le service des viandes en stage pour donner son show avec son chum Rémi. Et, c’est connu, Vincent Saumure est un joueur de tours. L’entrepreneur joue beaucoup de tours et se fait souvent rendre la monnaie de sa pièce. « I l nous transmet son énergie, et on sait qu’il nous fait confiance », dira l’un. « I l est proche des gens, on se sent valorisé, on sent qu’on fait partie de la solution », dira l’autre. Sans compter qu’il comble le personnel d’une multitude de petites attentions, ne serait-ce que des viennoiseries, un matin, des sorties ou des prix de présence lors d’activités.
Évidemment, on ne gagne pas le cœur d’une centaine d’employés avec des beignes ! Travailler dans des milieux tissés serrés implique des moments délicats. « Parfois, il faut se dire les vraies affaires, mais je n’oublie jamais que nous faisons tous partie d’une même communauté. Et puis, si c’est dur de gérer quand on est proche de ses employés, pensez-vous que c’est plus facile de gérer loin de son monde ? »
Q uand Vincent Saumure évoque sa communauté, ce ne sont pas que des mots. Un immanquable filet de tendresse s’échappe lorsqu’il parle de Tom, un employé chouchou – et modèle – aux défis particuliers, ou de cette collègue, arrivée jeune femme, reparti jeune homme, et qui a vécu sa transition avec la gang de Metro. L’homme d’affaires reçoit cette diversité comme un cadeau !
P our parfaire l’histoire, Vincent Saumure a rencontré sa Léa, Léa Santo, dans une allée de fruits et légumes alors qu’il était commis. « O n peut dire qu’elle a eu du flair ! On vient tous les deux de FermeNeuve. Ç’a sans doute aidé », lance l’homme, qui avoue mesurer sa chance. Ensemble, ils font tout, dont élever Bénédicte, 8 a ns, Adrien, 6 a ns et Joséphine, 4 a ns. « O ui, je l’avoue ; on parle de job à la job, et on parle de job à la maison. Mais ce n’est pas un fardeau ; on aime nos employés et on aime nos clients. Metro fait partie de notre vie et de celle de nos enfants. Pas question de cloisonner ça ! »
L’équipe a aussi développé une expertise de taille avec le plus gros centre jardin du réseau Metro. D’ailleurs, sous les chapiteaux, l’aînée trippe déjà sur les fleurs. Fier, M. Saumure ? On peut imaginer, mais il renvoie spontanément les honneurs à son entourage : « C ’est eux autres, les experts. » Une attitude qui en dit long.
Photo : Nicolas A ubry
Le terroir forestier, une mine d’or pour la cueillette
Chaga, chanterelle, pousse de sapin, racine de gingembre, céleri sauvage, poivre des dunes, fleur de mélilot, bouton de marguerite, chicoutai… La liste des champignons et plantes comestibles réunis sous le vocable de produits forestiers non ligneux (PFNL) s’allonge au rythme de l’engouement qu’ils suscitent dans la population. Aux cueilleurs toujours plus nombreux partout dans la province s’ajoutent les transformateurs, les chefs et les consommateurs.
Les temps ont bien changé depuis trente ans, époque où l’entreprise Gourmet Sauvage, dans les Laurentides, a vu le jour avec quatre produits : gousses d’asclépiades marinées, cœurs de quenouilles marinés, confiture de chicoutés et confiture d’amélanches. Son fondateur, Gérald Le Gal, fut un pionnier dans la mise en valeur des PFNL au Québec.
S’il y a aujourd’hui un véritable marché pour ce type de produits, ce n’était pas le cas à l’époque. « Aujourd’hui, on offre même une formation de cueilleur professionnel au Québec », souligne Ariane Paré-Le Ga l, copropriétaire de Gourmet Sauvage. Avec une centaine de produits offerts à la vente, deux guides d’identification ( Forêt et Cueillir la forêt ), des ateliers et une nouvelle formation en ligne (gourmetsauvage.ca/webinaires), Gourmet Sauvage a le vent dans les voiles, tout comme plusieurs autres entreprises en région, tels Gaspésie Sauvage, De baies et de sève, Trésors des Bois et Terroir Boréal sur la Côte-Nord, et Forêt Gourmande dans Charlevoix.
Les vagues d’achat local et de cueillette en forêt s’inscrivent « d ans une certaine urgence de mieux comprendre notre environnement, de se reconnecter au territoire et d’être plus autonome dans notre alimentation », estime Ariane Paré-Le Gal, qui appelle à une « cueillette responsable » Parmi les coups de cœur d’Ariane Paré-Le Gal, on retrouve l’ortie, aux nombreuses propriétés et très nourrissante, l’oseille, un condiment pour salades et poissons, les chénopodes, très nutritifs, avec un goût d’épinard, et le mélilot, sorte de vanille nordique qui parfume magnifiquement certaines pâtisseries, comme la crème brûlée. Tous les petits fruits nordiques (airelle, chicoutai, amélanche) mériteraient, selon elle, qu’on leur accorde plus de place dans notre alimentation. On les achète déjà facilement en confitures, et des chefs renommés les utilisent de plus en plus dans la confection de sauces au goût délicat pour les viandes et les poissons.
Sur la page de droite
a Asclépiade
b Gaillet
c Livèche
d Oxalide
e Patience crépue
f Petite oseille
g Pissenlit
h Plantain
Photo : X avier Girard Lachaîne

b c d e f g a h




Le temps des sucres en épicerie
Avant les années 1970, la situation était bien différente, et l’industrie du sirop d'érable était menacée de stagnation, voire de déclin. Grâce à une approche coopérative, des plans conjoints des producteurs acéricoles du Québec ont été élaborés par leur fédération et sont appliqués depuis 1989. Ils déterminent les conditions de production (notamment les normes de qualité) et de commercialisation (mise en marché collective, fixation des prix…) qui ont grandement aidé les quelque 13 5 00 a cériculteurs du Québec à prendre leur essor. Ces conditions ont permis de faire des produits de l’érable un élément distinctif de l’art culinaire québécois et d’offrir une solution de rechange au sucre raffiné et importé.
La chaîne Metro a contribué, à son niveau, à ce développement quantitatif et qualitatif des produits de l’érable au profit de consommateurs de plus en plus friands d’aliments naturels et locaux. « N ous avons toujours eu ces produits de l’érable dans nos magasins, souligne Jean-Michel Guillemette, directeur Mise en marché au siège social de la bannière Metro. Nous en avons de plus en plus et pas seulement durant la saison des sucres. »
L a diversification des produits s’est accompagnée, en effet, d’un allongement de la saison. « B ien sûr, nous avons un pic des ventes de février à Pâques, explique Jean-Michel Guillemette. Mais la demande du consommateur est maintenant toute l’année. Les produits de l’érable sont une des catégories en très grande croissance dans les ventes de Metro, et il y a toujours plus de produits transformés. » D es mini-cabanes à sucre, montées en magasin à la fin de l’hiver, on est passés dans les magasins aux
présentoirs permanents de produits de l’érable, tels que des condiments, des marinades et des vinaigrettes. En juillet, les marinades pour le barbecue, par exemple, ont la cote, et les produits surgelés — cornets en tête — sont vendus toute l’année.
« N otre rôle est de pousser ces produits dérivés développés par nos partenaires producteurs, d’en faire la promotion dans nos circulaires et de les mettre en valeur dans nos magasins » , précise Jean-Michel Guillemette. L’Érable au fil du temps est un bon exemple d’entreprise acéricole qui a le vent dans les voiles grâce, notamment, à un bon coup de pouce de Metro.
Partie d’une petite érablière en Montérégie, L’Érable au fil du temps a grossi au point de devenir un transformateur d’importance dont le meilleur vendeur chez Metro est son petit cornet au beurre d’érable et tire surgelé. « O n en a vendu un million en 2021, dont 80 % c hez Metro », calcule Philippe Thibault, directeur des ventes. L’histoire de ce partenariat a débuté il y a six ans au Metro Famille Plouffe de Bromont, où le producteur-transformateur avait présenté son fameux cornet. Vendu dans les huit Metro Famille Plouffe, puis dans les 10 de la Famille Messier, le cornet a fait son chemin pour devenir le top des ventes de L’Érable au fil du temps et un produit de choix chez Metro, à l’échelle de la province, depuis trois ans. Deux autres cornets, érable-canneberges et érable-bleuets, ont aussi fait leur apparition dans les congélateurs de Metro.
« M etro nous a fait confiance, a cru en la qualité de nos produits et notre capacité à fabriquer de bonnes quantités toute l’année », ajoute Philippe Thibault. Le partenariat lui a permis d’améliorer ce produit spécifique, sa qualité et sa présentation en barquette thermoformée, scellée sous vide, ce qui lui a valu d’être finaliste en innovation à l’emballage au gala de 2021 de la CTAQ. Le producteur a aussi innové en proposant à Metro des présentoirs en pignon d’érable pour mettre en valeur ses condiments. On les trouve désormais aussi dans des dizaines de magasins Metro du Québec.
Si le Québec est le champion de la production de sirop d’érable et d’une multitude de produits qui en sont dérivés, avec près des trois quarts du marché mondial, Metro a été et demeure un leader en matière de mise en valeur des produits de l’érable dans ses épiceries. Metro encourage bien des acériculteurs œuvrant dans différentes régions et exerce ainsi une influence certaine sur les goûts des consommateurs.
Retour vers nos racines
Depuis quelques années, sous l’impulsion de chefs comme Arnaud Marchand et Jean-Luc Boulay, la cuisine boréale est à la mode au Québec et semble devenir une vraie tendance de notre gastronomie. Elle suit le même mouvement que la cuisine autochtone « moderne » qui prend ses racines dans notre terroir nordique pour magnifier ses ressources comestibles, qu’elles soient plantes, champignons, fruits, bourgeons ou racines.
Témoigne de cet engouement la publication depuis une douzaine d’années de livres de recettes et d’initiation aux plantes sauvages comme Gourmand boréal , de Michèle Genest (2010), Saveurs boréales , d’Agro-Boréal (2012), Le garde-manger boréal , d’Arnaud Marchand et Jean-Luc Boulay (2017), Forêt, de Gourmet sauvage (2019), ou Cuisine sauvage, de Simon-Pierre S. Murdock (2021).
Petit à petit, ces livres et ces chefs nous font découvrir de beaux produits de la cueillette sauvage, en forêt boréale notamment, et montrent la voie pour réduire l’utilisation de certains aliments et épices venus d’ailleurs et les remplacer par des plantes et fruits sauvages d’ici.
Des saveurs boréales dans l’assiette Porte-étendard de la cuisine d’inspiration nordique, Arnaud Marchand, chef de Chez Boulay-Bistro boréal à Québec, restaurant qu’il a ouvert avec Jean-Luc Boulay, comme leur Comptoir boréal, estime que chaque chef peut avoir son interprétation de la cuisine boréale. Lui-même ne renie pas ses origines et propose depuis plusieurs années une cuisine française faisant la part belle aux ingrédients nordiques pour leurs saveurs et textures inédites. Ainsi en va-t-il de sa blanquette de veau du Québec aromatisée au myrique baumier plutôt qu’au clou de girofle ou de sablés à la fleur de mélilot plutôt qu’à la vanille.
Plusieurs épices boréales remplacent ainsi facilement le romarin, le basilic ou le poivre de Sichuan dans la cuisine du chef, mais, parmi ses préférées, il cite les racines de céleri sauvage, le poivre des dunes (chaton de l’aulne crispé) et les aiguilles de peuplier baumier.
La cuisine autochtone d’aujourd’hui
Les Premières Nations, qui ont été les pionnières en matière d’utilisation des ressources naturelles dans leur alimentation, sont une source d’inspiration pour tous ceux qui s’intéressent à la cuisine boréale, y compris évidemment des chefs d’origine autochtone comme Martin Brisson. Le chef propriétaire de La Galouïne à
De gauche à droite et de haut en bas
De la fleur de sumac pour accompagner le poisson, du thé du Labrador pour goûter à l'une des richesses de nos forêts québécoises, la fleur de mélilot pour remplacer la vanille dans vos recettes sucrées et de la myrique baumier plutôt que des clous de girofle pour aromatiser vos plats principaux.
Photos V alérie Lacroix




Tadoussac, et de la boutique Terroir Boréal, est convaincu que la cuisine autochtone témoigne du savoir-faire de leurs ancêtres cueilleurs et chasseurs, mais doit s’adapter à la cuisine contemporaine. Sa boutique regorge de produits concoctés avec les richesses de la forêt boréale (poudres de petits fruits nordiques, thé du Labrador aromatisé, confits et tartinades aux bleuets et airelles sauvages, épices et aromates, champignons séchés…). Sans compter des prêts-à-emporter issus de la carte du restaurant, dont une trilogie de saumon fumé maison ou la cuisse de canard confite aux herbes boréales.

D’origine malécite, Maxime Lizotte rappelle pour sa part que, dans les temps anciens, la cuisine autochtone en était une de subsistance. À la tête d’un service de chef privé et d’une boutique (produits Wigwam), celui qu’on a vu à MA.tv, dans l’émission Le Cuisinier locavore , s’identifie plutôt comme « u n créateur culinaire aux valeurs ancrées dans ses racines autochtones ». Il utilise les produits de la terre ou de la mer les plus locaux possible et de façon responsable « p arce qu’ils sont précieux ». Et adore remplacer les ingrédients importés par des ingrédients d’ici, issus si possible de plantes sauvages.
Fini le romarin, vive les aiguilles de conifères ! F inies les herbes de Provence, vive la comptonie voyageuse ! L es baies de genièvre nordique assaisonnent son gravlax ou sa choucroute, tandis que les graines de carotte sauvage, les fleurs de mélilot et les bourgeons de peuplier baumier parfument ses desserts préférés. En ce qui concerne les sauces, le raisin sauvage est selon lui à découvrir pour le gibier, et le sumac, pour le poisson.
D’autres ne jurent que par les sauces à base de baies indigènes, les hamburgers à la moutarde boréale et au ketchup de baies sauvages, le homard cuit au gin de bleuets, la crème de champignons à la poudre de cèdre ou le tartare de bœuf aux jeunes pousses de conifères… Et on est loin d’avoir fait le tour de tous les trésors de la forêt ou du littoral boréal !
 Le chef Maxime Lizotte et son plat de courge rôtie
Photos Gracieuseté de Maxime Lizotte
Le chef Maxime Lizotte et son plat de courge rôtie
Photos Gracieuseté de Maxime Lizotte
Produits phares
La forêt boréale regorge de produits uniques, des boutons de marguerite qui viennent parsemer nos plats d’une acidité croquante, au thé du Labrador que les autochtones utilisaient pour ses vertus thérapeutiques, en passant par le sapin baumier, bien présent sous nos latitudes, gourmandise des orignaux, et dont l’odeur rappelle Noël. Mais ce sont les champignons qui, depuis quelques années, tiennent la vedette au Québec. On apprend à les trouver et à les cuisiner. Chanterelles, pleurotes, bolets, cèpes, morilles et truffes. Truffes ? Eh oui, on trouve de tout dans nos forêts !

61

62
63 64 65
Virée gourmande
Près de la moitié de notre territoire est couvert par l’un des plus vastes réservoirs forestiers du monde. Les forêts du Québec regorgent de vie animale et fourmillent de végétaux à nul autre pareils. Notre ressource la plus prisée ? Le sirop d’érable !
62 Le Chemin du Roy est une route touristique de 280 km entre les villes de Repentigny et de Québec qui traverse notamment la Mauricie. On y trouve plusieurs endroits incontournables, comme la fromagerie L’Ancêtre à Sainte-Annede-la-Pérade, la chocolaterie Véniel Fines Gourmandises à Trois-Rivières, et le vignoble Domaine Gélinas à Saint-Sévère. Voilà de quoi bien remplir les sacoches de vélo.
63 Bien qu’on y récolte l’eau d’érable de façon ancestrale, c’est-à-dire à la chaudière et à bras, le reste de La Cabane à Tuque à Mont-Tremblant propose plutôt une expérience différente et écovégétalienne. Les plats sont cuisinés à partir d’ingrédients locaux et biologiques, puis ils sont servis dans une maison isolée en béton de chanvre, avec plancher chauffant en terre crue.



64 À Saint-Marc-de-Figuery se trouve la Miellerie de la Grande Ourse, une miellerie tout à fait unique où il est possible de faire un safari pour découvrir le monde apicole avec un guide passionné. À la boutique, on se procure, entre autres, miel et chandelles à la cire d’abeille et, à la buvette, on s’assoit pour déguster les hydromels en fût ou un des nombreux cocktails élaborés à partir d’alcools artisanaux.
65 L’ancienne cheffe pâtissière du restaurant Au Pied de Cochon, Gabrielle Rivard, a fondé La Cabane sur le Roc , sa propre pâtisserie acéricole où le sirop d’érable est à l’honneur dans des confections aussi belles que décadentes.
De juin à octobre, le kiosque estival de Saint-Joseph-du-Lac propose ses desserts à emporter ainsi que des crèmes glacées et sorbets à manger sur place. La boutique virtuelle prend ensuite le relais.
Photos Étienne Boisvert (deux femmes dans un verger), V almedia (gens à une table), Miellerie de la Grande Ourse (guide apiculteur) et gracieuseté de La Cabane sur le roc (kiosque de pâtisserie s)

66
Ragoût de champignons
sur un pancake de pommes de terre et salade d’herbes
ingrédients
4 g rosses pommes de terre Yukon Gold
3 œufs entiers
75 g fa rine tout usage
1 kg de champignons mélangés (champignons de Paris, champignons shiitakes, pleurotes érigés, 1 paquet de pleurotes gris ou blancs)
50 g de beurre demi-sel
Herbes fraîches au choix (persil italien, coriandre, ciboulette, aneth, cerfeuil, oignon vert, etc.)
Sel, poivre noir et huile d’olive
préparation
1 Préchauffer le four à 375 °F (190 °C).
2 Déposer les pommes de terre dans une casserole. Remplir d’eau froide et salée. Porter à ébullition et laisser cuire à feu moyen jusqu’à ce que les pommes de terre soient cuites. Pour le savoir, planter un couteau dans une pomme de terre : s’il n’y a aucune résistance, c’est qu’elle est prête.
3 Sortir les pommes de terre de l’eau et les faire tempérer sur une plaque. Avant qu’elles ne soient complètement refroidies, les peler avec un couteau d’office.
4 Passer les pommes de terre au presse-purée ou à travers une passoire fine. Les mettre ensuite dans un grand bol.
5 Séparer les blancs des jaunes des œufs (délicatement afin de garder les jaunes entiers), conserver les jaunes et fouetter les blancs en neige dans un cul-de-poule. Calculer de façon approximative le volume des pommes de terre et celui des blancs montés, et ne garder que la même quantité de blancs montés (il devrait y avoir un peu plus de blancs que de pommes de terre). Ajouter les blancs d’œufs en pliant afin de ne pas les faire tomber. Une fois bien incorporés, ajouter la farine, mélanger et bien assaisonner. Réserver la préparation à pancakes de pommes de terre au frigo, à couvert.
6 Tailler les champignons de Paris en quarts et les autres champignons en tranches d’un peu moins de 1 cm d’épaisseur.
7 Dans une très grande poêle, faire mousser 25 g de beurre, avec un généreux trait d’huile d’olive, à feu vif. Lorsque le beurre commence à devenir noisette, ajouter les champignons. Laisser cuire une minute sans remuer afin que l’eau des champignons ne sorte pas, et ainsi faire bouillir la poêlée. Sauter les champignons pendant 2 m inutes, saler et finir la cuisson au four, à 375 °F (190 °C), pendant une dizaine de minutes.
8 Pendant ce temps, dans une poêle antiadhésive, faire mousser le reste du beurre avec un trait d’huile d’olive. À l’aide d’une grande cuillère, déposer environ une demi-tasse de la préparation à pancakes et l’aplatir un peu. Répéter l’opération afin d’avoir 4 gros pancakes. Enfourner à 375 ° F (190 °C ) une dizaine de minutes et, à l’aide d’une spatule, retourner les pancakes aux trois quarts de la cuisson.
9 Pendant la cuisson des pancakes, concasser les herbes fraîches et réserver. Assaisonner au goût.
10 Lorsque les pancakes sont cuits et bien dorés, les déposer dans une assiette creuse. Déposer les champignons dessus. Et terminer par le jaune d’œuf cru sur le dessus, au milieu des champignons, les herbes fraîches, un filet d’huile d’olive et un tour de moulin de poivre noir.
entrée POUR 4 personnes TEMPS DE PRÉPARATION 30 minutes TEMPS DE CUISSON 30 minutes
Les gens de la mer vivent depuis longtemps au rythme des marées, des départs des chalutiers avant l’aube, des levers de filets au large, des pesées au port de pêche, des découpes et transformations à l’usine de tous ces poissons, mollusques et crustacés de grande qualité.
J’aime côtoyer ces hommes et ces femmes, vaillants et travaillants, qui ont à cœur ce que la mer nous donne ; j’aime écouter leurs histoires.
J’ai été fascinée d’entendre parler, entre les filets, d’une pouponnière de homards ! Situé en bord de mer gaspésienne, un centre de recherche en biologie marine compense une partie de ce qu’on prélève des fonds marins en l’ensemençant avec des bébés homards qui grandiront en laboratoire, avant d’être relâchés plus grands et plus forts pour affronter les dangers qui les guettent en mer. À l’écloserie, le taux de survie obtenu est 200 fois plus élevé que dans la nature. Une merveilleuse façon d’aider à assurer la pérennité de ce crustacé qu’on aime tant. Et ainsi, les pêcheurs et les capitaines pourront encore nous raconter longtemps leurs aventures sur l’eau.
la mer la mer la mer la mer la mer



é
p ê
Photo : Interpr
tation
che en mer (bateau)

67
Jean-Pierre Durette
Jean-Pierre Durette : à la conquête de Saint-Anne-des-Monts
Au bout de 29 ans dans le métier, Jean-Pierre Durette voulait tout abandonner. « Je ne me sentais pas compétent. »
C’est là qu’un directeur des opérations de Metro a suggéré à l’épicier d’oublier les chiffres et de mettre l’accent sur ses forces : sa personnalité joueuse, chaleureuse, et son approche humaine.
Cinq ans plus tard, l’épicier n’a pas peur de le dire : jamais il ne s’est senti aussi respecté que par la bannière Metro. « C’est plus qu’un employeur. C’est un coup de cœur. »
Jean-Pierre Durette était confortablement installé au Metro de Mont-Joli quand l’appel est venu. Lui qui avait si souvent dit oui à ses employeurs qui désiraient changer de secteur, lui qui avait si souvent demandé à sa conjointe, aux origines gaspésiennes, de le suivre un peu partout, avait soudain la chance de vivre à Rimouski et de travailler à 20 minutes de chez lui.
Quand Jean-Pierre Durette a appris, au bout du fil, que son Metro allait devenir un Super C, il n’a pas hésité. N’écoutant que son courage – et son épouse qui, à cette nouvelle demande de déménagement, a dit non –, Jean-Pierre Durette s’est loué un appartement en Gaspésie, et a accepté d’aller remonter l’esprit de famille de la gang du Metro de Sainte-Anne-des-Monts. « M on cœur était chez Metro. Je me suis donc expatrié. »
Malgré les défis qui attendaient le nouveau boss à son arrivée, Jean-Pierre Durette a retroussé ses manches sans broncher. Sa sensibilité et son écoute lui ont permis de mettre en place des changements positifs pour donner un second souffle à son équipe. Une fois les voies de la communication bien rétablies, il a pu revêtir le costume qui lui sied le mieux : ce lui d’un travailleur fier de servir les clients. Il a donné l’exemple. Et, sans magie mais avec énormément d’ardeur, il a vu les ventes se stabiliser, puis augmenter. « Q uand on n’est pas fier, on ne veut pas appartenir au groupe. Et sans sentiment d’appartenance, rien n’est possible », souligne l’humble leader.
En haute période estivale, lorsque le tourisme bat son plein, le magasin atteint
presque son chiffre d’affaires. « A lors j’ai besoin de mon monde. Par contre, l’automne, il y a beaucoup d’employés qui vont à la chasse, alors je les laisse partir. » Mais là où le cœur du dirigeant vibre le plus fort, c’est lorsqu’il entend un employé lui dire, sans qu’il n’ait rien demandé : « Si tu as besoin, je peux être là demain. » « Dans ce temps-là, je sais que le cœur y est. Et le cœur, ça peut faire face au manque d’employés, aux grosses journées, aux grands défis, aux pires tempêtes », note le rassembleur.
Outre ce grand cri de ralliement qu’il a lancé à ses troupes, l’homme a pris soin de prioriser l’approvisionnement local. Il s’est impliqué dans les affaires communautaires. Il a choisi une gestion transparente, s’affairant par exemple à démystifier les visites des directeurs des opérations auprès des employés. Depuis, ces visiteurs sont non seulement les bienvenus, mais l’équipe les met désormais au défi de trouver les failles ! « Ma gang est fière », affirme celui qui a amené tous les services de l’épicerie à un niveau supérieur.
Les excellents résultats, ce ne sont pas le patron qui les exprime, mais plutôt les clients, les vrais juges de ce qui mérite d’être appelé une victoire. En six mois, leur niveau de satisfaction est passé de 56 % à 76 %. Finalement, cette manière qu’a eu Metro de traiter son franchisé se répercute sur sa façon à lui de traiter son monde. « Je suis persuadé que les clients le sentent. » Les trajets de JeanPierre Durette sur la route, pour retourner à la maison, lui donnent aussi l’occasion de réfléchir, et d’affirmer que non, cette ascension est loin d’être terminée.
Photo : Jérôme Landry
L’appel du large
À l’époque où ses petits camarades consacrent leur temps libre aux jeux vidéo, le jeune Anthony Dubé préfère sillonner les côtes de la Gaspésie avec son grand-père, en quête de produits de la mer. Des années plus tard, après un détour dans le milieu de la construction, il est rattrapé par son destin.
L’immensité d’une mer écumante, l’odeur du poisson fraîchement capturé : l es souvenirs de pêche ont meublé en grande partie l’enfance du capitaine Anthony Dubé. Dès l’âge le plus tendre, il comprend les exigences d’un métier aussi exaltant qu’impitoyable. « J ’ai commencé très jeune, vers neuf ou dix ans. Sitôt que l’école était finie, j’allais à la pêche au homard et au hareng avec mon grand-père. » Un accident fatal survenu en bateau coûte la vie à son aïeul, ce qui n’empêche pas le jeune pêcheur de marcher sur ses pas. Son oncle prend le relais, lui montre les ficelles du métier, le guide dans son apprentissage.
Après ses études, Anthony Dubé quitte la Gaspésie pour rouler sa bosse dans le domaine de la construction. Qu’il s’agisse du parfum salin du large ou de la beauté époustouflante d’un territoire péninsulaire, l’appel de sa région natale reste plus fort que la carrière qu’il a embrassée, aussi lucrative soit-elle. Il reprend donc les commandes d’une embarcation pour revenir à ses premières amours, avec l’aide d’un ami de longue date. Six ans plus tard, une chance inouïe le met sur la trajectoire d’un capitaine à la veille de prendre sa retraite. « Je lui ai acheté son permis, ce qui est très difficile à obtenir de nos jours en raison de la surenchère », explique-t-il.
Enfin, en 2022 le pêcheur continue d’exercer le métier qui le passionne, cette fois-ci à titre de capitaine de son propre bateau. À l’heure où l’aube n’est encore qu’une promesse à l’horizon, Anthony Dubé met le cap vers le large pour y capturer le homard. Fébrilité et excitation semblent le gagner à l’évocation d’une saison aussi courte qu’intense.
« P uisque la pêche ne dure que 68 jours, on n’a pas droit à l’erreur, ajoute le capitaine. Et tant que le permis n’est pas payé, la marge de profit est mince. »
L a bonne fortune sourit à nouveau à Anthony Dubé lorsqu’il est approché par Metro, toujours à l’affût de nouveaux partenariats avec des producteurs locaux. « Je suis très fier de collaborer avec Metro, affirme-t-il. Je sais que je contribue à nourrir des gens d’ici, et ça, ça me rend très heureux ! »
Sur la page de droite
Le capitaine-propriétaire Anthony Dubé, fier Gaspésien, lors de sa première sortie de pêche en mer avec son équipe, au printemps 2022. Ces images ont été captées lors du tournage de la campagne Les premiers en été, produite en collaboration avec Metro et l’agence Cossette.
P hotos : Cossette


68

69
Photo : Isaac LeBlanc
Le goût des Îles
Originaire des Îles-de-laMadeleine, Hugo Lefrançois a passé plus de deux décennies sur le continent à travailler dans les restaurants d’hôtels, plus particulièrement en Estrie. Chaque été, il rentrait aux Îles pour voir sa famille. À tous les coups, il en revenait inspiré et se faisait un devoir de mettre des produits de chez lui à ses menus.
Hugo à Mémé Jo
Enfant, Hugo à Carmel à Jo à Samuel à Dominic à Charles (la façon de nommer les gens aux Îles pour savoir de qui ils sont les descendants) passe beaucoup de temps avec sa grand-mère, Mémé Jo. C’est elle qui lui apprend à cuisiner. Elle l’emmène partout, et toutes les grands-mères du village apprécient l’amour d’Hugo pour la cuisine. Ce sentiment est au cœur de ses plats, encore aujourd’hui.
De retour pour de bon dans son archipel natal, il rejoint sa cousine, Cathy Chevarie, au Château Madelinot pour réinventer le menu du Resto Bistro Accents, le restaurant du plus grand hôtel des Îlesde-la-Madeleine. L’idée est de partir d’ingrédients phares des Îles et de les cuisiner au goût du jour, comme les gnocchis au homard, le mignon de loup-marin (phoque) et la poutine au fromage Pied-De-Vent.
Un tel menu ouvre aussitôt l’appétit des touristes, tout comme celui des Madelinots. Depuis lors, le Resto Bistro Accents est passé d’une salle à manger peu occupée à une salle comble. À cela s’ajoutent les passagers de 90 autobus de voyage organisé transportant chacun 50 v isiteurs, que le restaurant accueille dans la salle de réception pendant l’été. Pour nourrir tout ce beau monde, il faut beaucoup de nourriture !
Double défi
En région éloignée, il faut s’armer de patience et effectuer ses achats des semaines à l’avance. Heureusement, Hugo Lefrançois connaît très bien ses fournisseurs, comme la Fromagerie du Pied-De-Vent, Les Jardins du
havre vert et la Boucherie Côte à Côte. « Parfois, ça peut me prendre trois semaines avant de recevoir un produit de base, comme des pommes de terre grelots, confie-t-il. Dans ce temps-là, je vais à l’épicerie du coin, chez J.H. Boudreau. C’est mon dépanneur ! » Aux Îles, il est judicieux d’avoir diverses solutions de rechange derrière le tablier.
Comme si cela n’était pas déjà assez compliqué, Hugo Lefrançois tient à offrir le plus de produits locaux possible à la carte du Resto Bistro Accents. « E n saison, j’ai accès aux petits fruits des Îles, comme les airelles et les pommes des prés (canneberges sauvages), 80 % d e mes légumes viennent d’ici et 100 % des verdures sont produites localement, ajoute-t-il. Mais en hiver, je n’ai pas le choix de m’approvisionner à l’extérieur des Îles. Et même si les produits de la mer, comme les poissons, les fruits de mer et la viande de phoque, sont facilement accessibles, ça me prend toujours un plat ou deux pour convenir aux clients qui n’en mangent pas. »
Visiblement, Hugo Lefrançois maîtrise aussi bien la débrouillardise que les classiques culinaires des Îles, comme le poten-pot, un généreux pâté aux fruits de mer, les rillettes de phoque et le fard de homard, une tartinade à base d’œufs, de foie et de chair de homard. Compte tenu de la réputation des Madelinots d’être sympathiques et serviables, tout porte à croire qu’il est bien entouré pour nourrir généreusement ses nombreux convives.


70
Virée gourmande
Nous sommes aussi un pays de bord de mer… Les régions bordées par les eaux salées de l’estuaire et du golfe du Saint-Laurent offrent un panorama époustouflant et inspirant. Les créations des chefs portent la signature du vent salin et de la vie maritime, et les producteurs nous invitent à essayer toujours de nouveaux produits. Un paysage à goûter et à sentir !

70 Pêcheur de métier, Maxime Poirier partage sa passion en permettant aux visiteurs de vivre une vraie excursion guidée et structurée à la manière des pêcheurs madelinots. Parmi les forfaits de sorties offerts par Interprétation de pêche en mer, cette entreprise des Îles-de-la-Madeleine, on trouve la pêche au homard commerciale, l’interprétation de la pêche au homard et de la pêche récréative au maquereau.
71 Située à flanc de falaise à Caplan, dans la baie des Chaleurs, La Distillerie des Marigots trouve l’inspiration pour la création de ses spiritueux dans les arômes, les parfums et le savoir-faire agricole gaspésien. Dotée de grandes fenêtres, la bâtisse, qui compte aussi une boutique et un espace de dégustation, permet d’observer le processus de production et d’admirer la mer. Des visites guidées sont offertes sur réservation.
72 Après avoir hérité des terres familiales à ValBrillant, Jean-Paul Lebel et sa conjointe décident d’y cultiver des framboises en vue de l’autocueillette. Aujourd’hui, le site Vallée de la Framboise compte 23 acres de framboisiers, 7 de fraisiers, et 3 de bleuetières. On y cultive aussi camérisiers, cassissiers, groseilliers, gadelliers, cerisiers, rhubarbe, etc. L’entreprise confectionne également des produits alcoolisés, des tartinades, des gelées, des beurres, des tartes et des pâtes de fruits.

73 De retour dans sa région natale de Sainte-Anne-des-Monts, Carl Pelletier a ouvert sa chocolaterie, Couleur Chocolat , avec un écomusée. Ses fines bouchées, tartinades, caramels, guimauves, tablettes et barres de chocolat sont inspirés de nombreux aromates de la péninsule. Résultat? Des accords aussi étonnants que délicieux, qui donnent la mesure de la splendeur du terroir gaspésien.

71 72 73 Photos Interpr é tation p ê che en mer (homme
avec
un
homard
et touristes
sur
un bateau),
Distillerie
des Marigots (bâtiment) et Couleur chocolat (touristes avec un chocolatier)

Produits phares
Le bord de mer à l’Est du pays ne serait pas ce qu’il est sans une chaudrée de palourdes réconfortante, ou sans palourdes frites croquées sur le pouce en Gaspésie, sans saumon, encore et toujours, et sans homard, sous toutes ses formes, surtout en guédille en plein été… De notre mer du nord, on devient de plus en plus amoureux des huîtres. On les découvre, on les cultive, on les choisit avec attention et on les déguste en tout temps ! Les huîtres naissent dans les vagues, gardent le goût de la mer, et chaque variété a la saveur de son coin de pays. Bonnes pour la santé, elles sont les reines de la fête !

74

75
Homard gratiné au cheddar vieilli
sauce crémeuse aux herbes salées et boutons de marguerite
entrée POUR 4 personnes TEMPS DE PRÉPARATION 1 heure TEMPS DE CUISSON 20 minutes
ingrédients
4 homards vivants d’environ
1 ½ lb (700 g) chacun, idéalement femelles*
60 ml de whisky single malt St. Pierre (par la distillerie O’Dwyer, idéalement)
25 ml de beurre demi-sel
25 ml de farine tout usage
250 ml de lait entier
100 g de cheddar vieilli L’Épave (un autre cheddar vieilli fera l’affaire) râpé
10 ml de moutarde forte
10 ml d’herbes salées du Bas-du-Fleuve
50 ml de boutons de marguerite hachés
Cerfeuil (optionnel), sel, piment fort (optionnel)
préparation
1 Remplir une très grande casserole d’eau salée, porter à ébullition, puis y plonger les homards vivants. Faire cuire environ 7 m inutes et les laisser refroidir sur une plaque.
2 Couper ensuite les homards en deux, sur le long, prudemment. Retirer la chair de la queue et la réserver. Casser les pinces et retirer la chair. Enlever les viscères du homard, bien laver la carapace, puis la laisser sécher.
3 Dans une petite casserole, verser le whisky et le faire brûler en étant très vigilant. Retirer l’alcool flambé et le conserver dans un petit contenant.
4 Dans la même casserole, faire mousser le beurre. Ajouter ensuite la farine et la laisser cuire en remuant avec une cuillère en bois, en la faisant dorer. Ajouter le lait et porter à ébullition.
5 Laisser cuire à feu doux en remuant constamment avec la cuillère, pendant une dizaine de minutes, afin d’éliminer le goût de la farine. Retirer du feu. Ajouter le corail des homards, s’il y a lieu, et mélanger à l’aide d’un mélangeur à main : la sauce deviendra rose grâce au corail cuit. Ajouter ensuite le fromage râpé et remuer afin de le faire fondre. Ajouter l’alcool flambé, la moutarde, les herbes salées et les boutons de marguerite.
6 Concasser au couteau la chair du homard en gros morceaux et les mettre dans la casserole avec la sauce. Assaisonner au besoin. Bien mélanger, puis remettre le tout de façon égale dans les carapaces de homards comme dans le cas du homard thermidor, le classique qui a inspiré ce plat.
7 Servir immédiatement. Optionnel : passer les homards sous le gril (broil) pendant une minute et finaliser l’assiette avec du cerfeuil émincé.
*Note : Pourquoi idéalement des femelles? À cause des œufs (le corail) qui se trouvent dans la chair de la queue. Ils sont verts, mais deviennent d’un rose très joli à la cuisson. Conserver ceux-ci pour la cuisson de la sauce blanche.
L’équipe metro
en collaboration avec
Communications Qolab inc.
Directeur général : Sébastien Viau
Éditrice en chef : Juliette Ruer
Directeur artistique : Louis-Philippe Verrier
Concepteur graphique : Alexandre Fauteux
Rédactrice en chef : Myriam Huzel
Chargée de contenu : Ca roline Abel
Réviseurs : Anne-Marie Bernier, Louis Villemur et Simon Tucker
Rédacteurs : Anne Pélouas, Catherine Lefebvre, Gassendie Jocelyn, Josée Larivée, Julie Bosman, Philippine de Tinguy et Rémy Charest
Textes d'introduction des régions : Hélène Laurendeau
Élaboration des recettes : Martin Juneau
Photographe des recettes : Maude Chauvin
Styliste culinaire : Nataly Simard
Accessoiriste culinaire : Sylvain Riel
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, 2023.
ISBN 978-2-9821553-0-5
Impression Numerix inc. 4050, rue Jean-Marchand, local 100, Québec (Québec) G2C 1Y6
Imprimé au Québec © metro














 Photos : Metro (portrait de M. La Flèche), Signé Gourmand (portrait de Mme Laurendeau), Maude Chauvin (portrait de M. Juneau)
Photos : Metro (portrait de M. La Flèche), Signé Gourmand (portrait de Mme Laurendeau), Maude Chauvin (portrait de M. Juneau)

































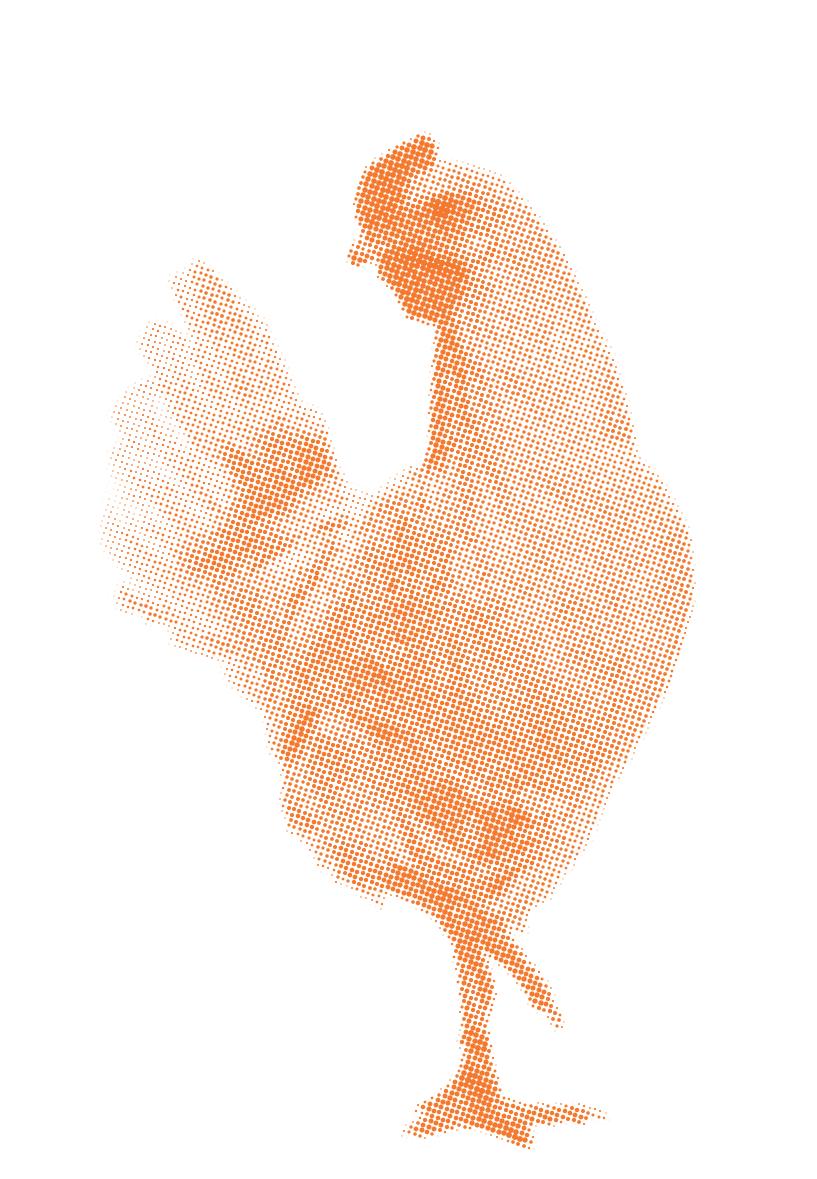
 Photo : Metro (portrait de M. Riendeau)
Photo : Metro (portrait de M. Riendeau)
 Sylvain Riendeau, Le Potager Riendeau inc., Saint-Rémi
Sylvain Riendeau, Le Potager Riendeau inc., Saint-Rémi




























 Karyn Ferland
Antoine Ferland
Serge Ferland
Karyn Ferland
Antoine Ferland
Serge Ferland







 Des bourgots Des mactres
Des bourgots Des mactres








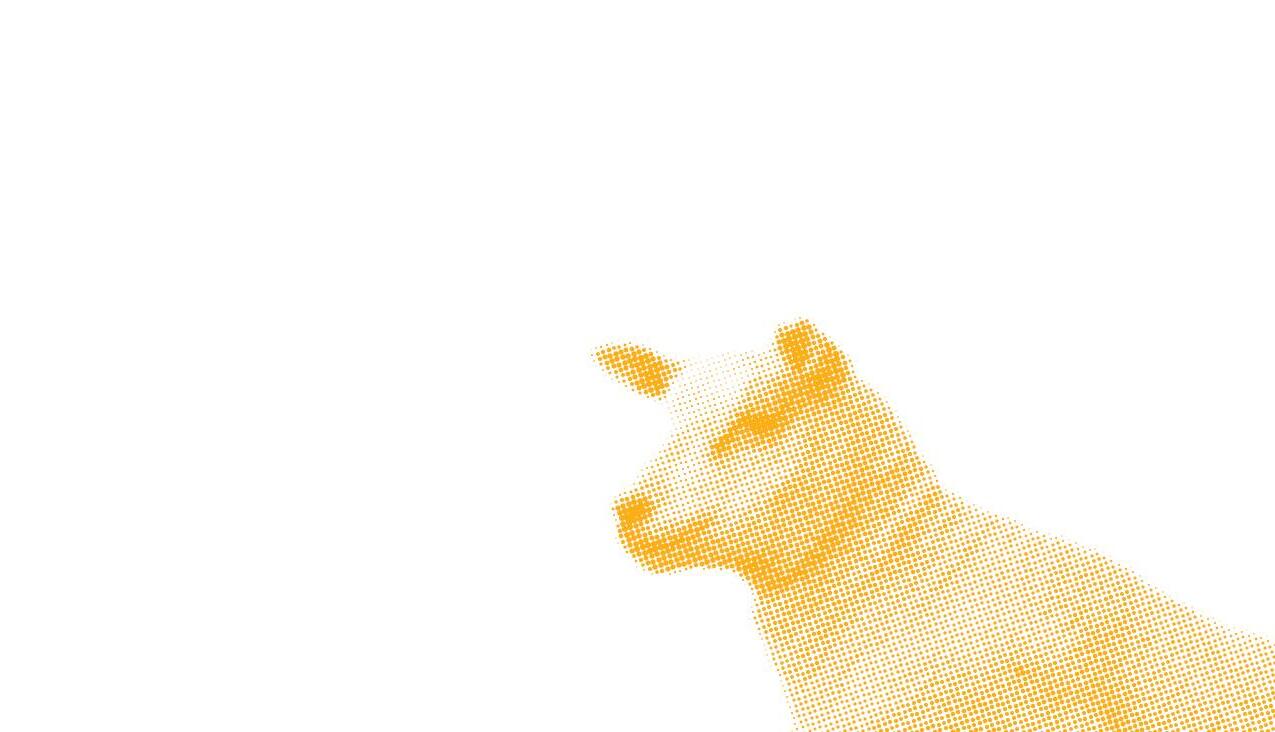







 Frédéric Thibeault
Louise Marquis et Nelson Thibeault
Martin Thibeault
Frédéric Thibeault
Louise Marquis et Nelson Thibeault
Martin Thibeault












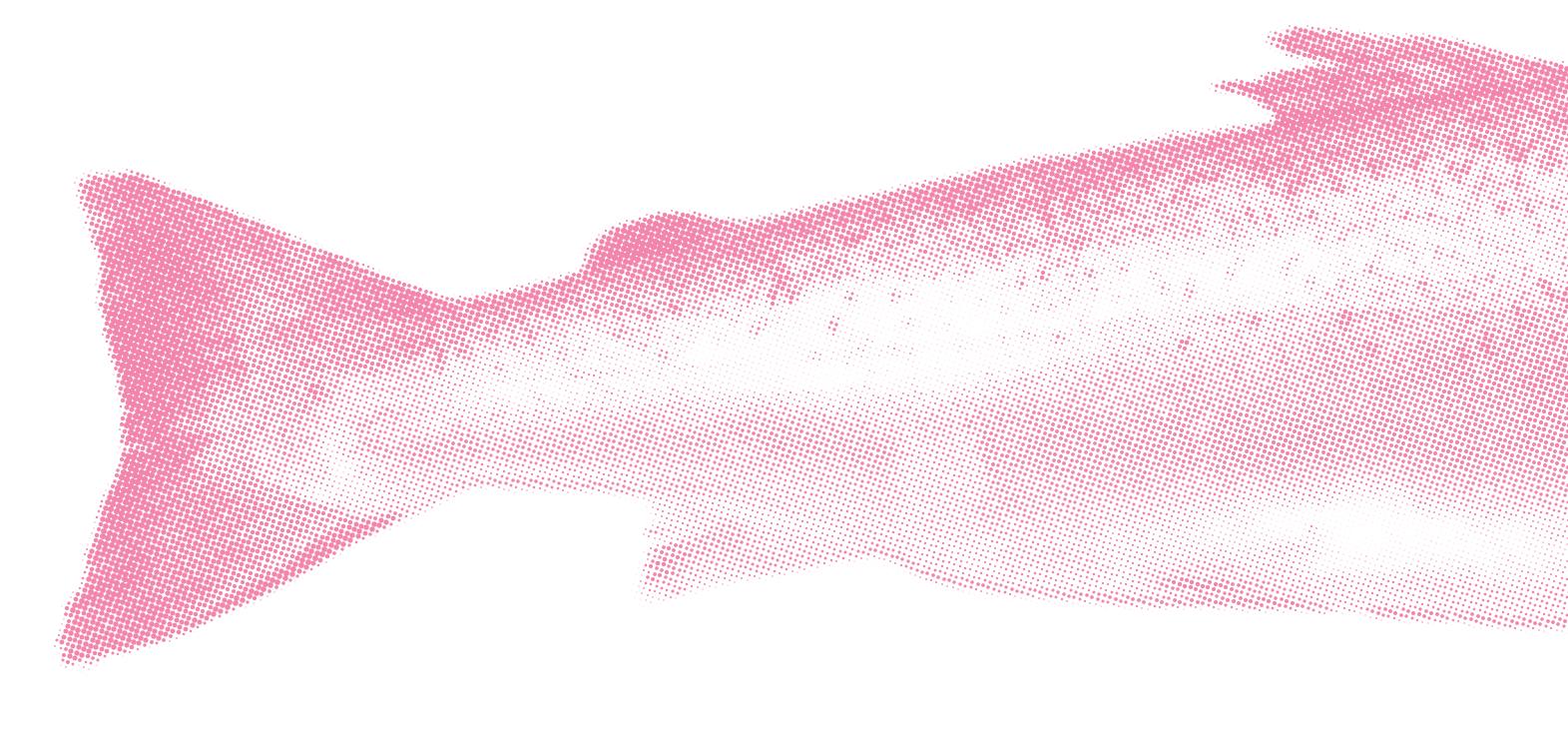

 Photo : T ourisme Saguenay—Lac-Saint-Jean (homme pêchant au coucher du soleil)
Photo : T ourisme Saguenay—Lac-Saint-Jean (homme pêchant au coucher du soleil)












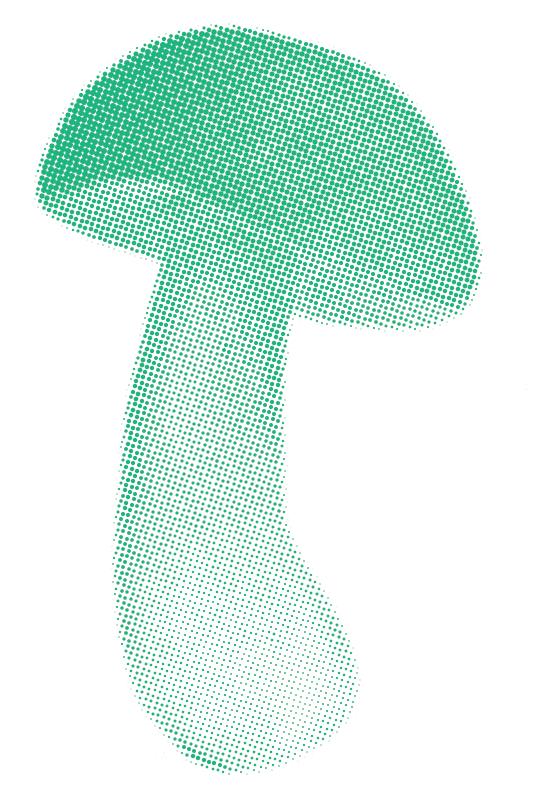
















 Le chef Maxime Lizotte et son plat de courge rôtie
Photos Gracieuseté de Maxime Lizotte
Le chef Maxime Lizotte et son plat de courge rôtie
Photos Gracieuseté de Maxime Lizotte

























