S.V.P. n’achetez qu’au camelot portant un e carte d’identification.
sur le prix de vente va directement au camelot.


S.V.P. n’achetez qu’au camelot portant un e carte d’identification.
sur le prix de vente va directement au camelot.


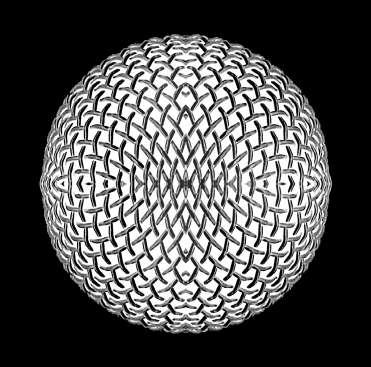
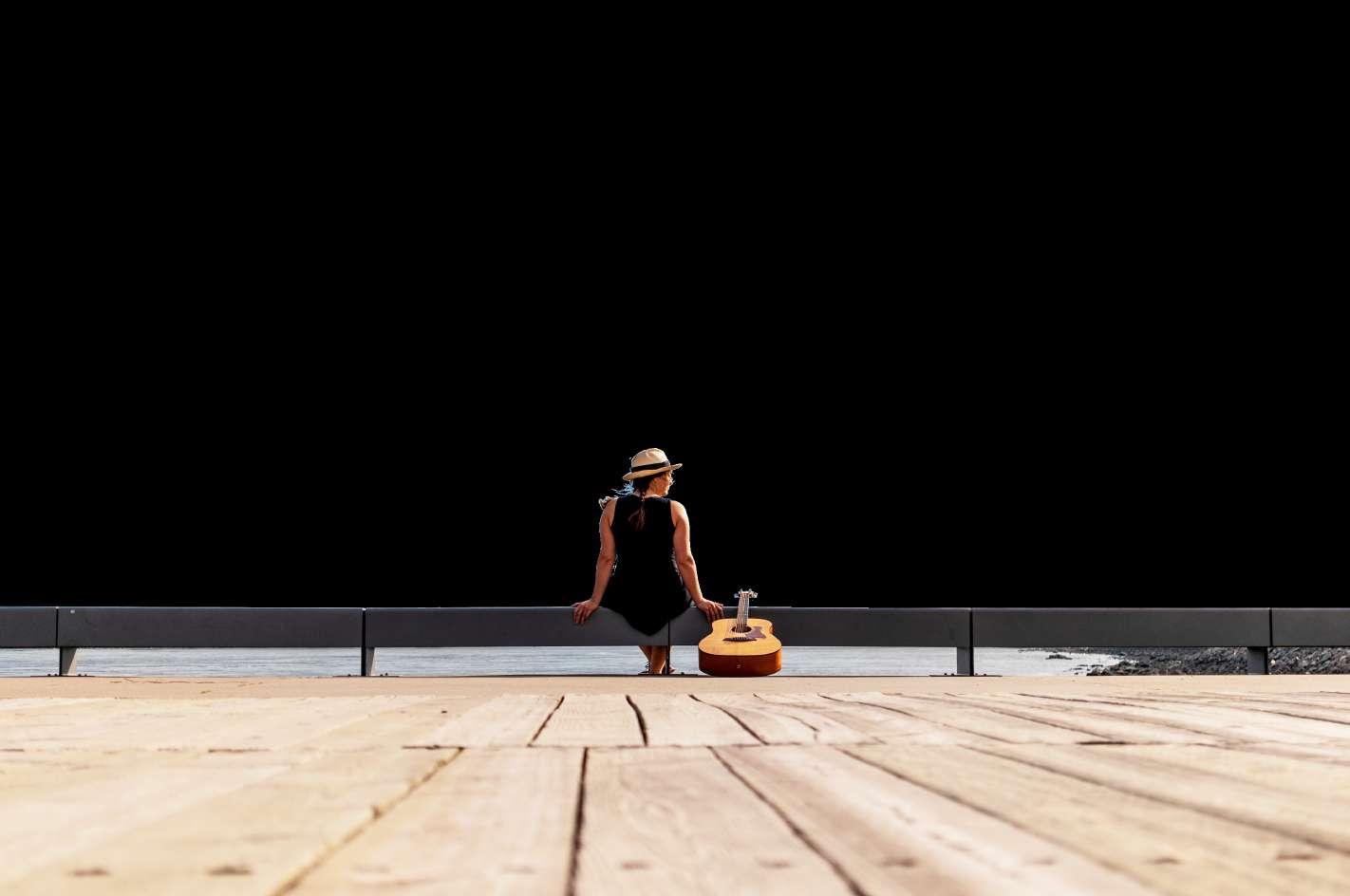






L’Archipel d’Entraide, organisme à but non lucratif, vient en aide à des personnes qui, à un moment donné de leur existence, sont exclues du marché du travail ou vivent en marge de la société. Ces laissés pour compte cumulent différentes problématiques : santé mentale, itinérance, toxicomanie, pauvreté, etc. Dans la foulée des moyens mis en place pour améliorer le sort des plus défavorisés, l’Archipel d’Entraide lance, en 1995, le magazine de rue La Quête. Par définition, un journal de rue est destiné à la vente - sur la rue !- par des personnes en difficulté, notamment des sans-abri. La Quête permet ainsi aux camelots de reprendre confiance en leurs capacités, de réaliser qu’à titre de travailleurs autonomes ils peuvent assumer des responsabilités, améliorer leur quotidien, socialiser, bref, reprendre un certain pouvoir sur leur vie.
L’Archipel d’Entraide, composée d’une équipe d’intervenants expérimentés, offre également des services d’accompagnement communautaire et d’hébergement de dépannage et de soutien dans la recherche d’un logement par le biais de son service Accroche-Toit.
Depuis sa création, La Quête a redonné l’espoir à quelques centaines de camelots.
SUIVEZ-NOUS SUR facebook.com/laquete.magazinederue et issuu.com/laquete/docs
PAGE COUVERTURE
Photo de Victor Lhoest
Conception graphique : Mélanie Imbeault
ÉDITEUR
Archipel d’Entraide
ÉDITEUR PARRAIN Claude Cossette
RÉDACTRICE EN CHEF Francine Chatigny
DIRECTRICE DE L’INFORMATION Valérie Gaudreau
SECRÉTAIRE DE RÉDACTION Isabelle Noël
CHRONIQUEUR.E.S
Martine Corrivault, Claude Cossette, Philippe Bouchard et Marc Émile Vigneault
JOURNALISTES
Jean-Louis Bordeleau, Christine DeslongchampsPelletier, Philippe Fortin, Nicolas Fournier-Boivert, Pier-Olivier Nadeau et Victor Lhoest
AUTEUR.E.S
Envie de faire connaître votre opinion, de partager vos poésies, de témoigner de votre vécu ? Nos pages vous sont grandes ouvertes. Envoyez-nous vos textes par courriel, par la poste ou même, venez nous les dicter directement à nos bureaux.
Faites-nous parvenir votre texte (500 mots maximum) avant le 1er du mois pour parution dans l’édition suivante. La thématique de novembre : Rémunération
Les camelots font 2 $ de profit sur chaque exemplaire vendu. Autonomes, ils travaillent selon leur propre horaire et dans leur quartier.
Pour plus d’informations, communiquez avec Francine Chatigny au 418 649-9145 poste 31
Nous vous encourageons fortement à acheter La Quête directement à un camelot. Toutefois, si aucun d’eux ne dessert votre quartier, vous pouvez vous abonner et ainsi nous aider à maintenir la publication de l’unique magazine de rue de Québec.



Abonnement régulier 65 $ Abonnement de soutien 80 $ Abonnement institutionnel 90 $ Téléphone :
La Quête est appuyée financièrement par :
Stratégie des partenariats de lutte contre l’itinérance (SPLI)
Financé par le gouvernement du Canada
Sébastien Beaulieu, Julie Bellemare, Bertrand Cyr, Gaétan Duval, François Gagnon, Armand Labbé, Mariette Mailhot, Judy Miller, et Christiane Voyer
AUTEUR DU JEU
Jacques Carl Morin
RÉVISEUR Benoit Arsenault
INFOGRAPHISTE
Mélanie Imbeault
IMPRIMEUR Imprimerie STAMPA inc. (418) 681-0284

COPYLEFT
La Quête, Québec, Canada, 2014
Ce document est mis à votre disposition sous un droit d’auteur Creative Commons « PaternitéPas d’Utilisation commerciale - Pas de Modification 2.5 – Canada » qui, si ce n’est pas commercial, permet de l’utiliser et de le diffuser tout en protégeant l’intégralité de l’original et en mentionnant le nom des auteurs.
190, rue St-Joseph Est Québec (Québec) G1K 3A7
Téléphone : 649-9145 Télécopieur : 649-7770 Courriel : laquetejournal@yahoo.ca

Pour notre page couverture, on a retenu une photo de la manifestation — forme visible de l’engagement citoyen — qui se tenait à Mexico, le 18 mai dernier, pour souligner la journée de lutte nationale contre les disparitions et les féminicides. Notre journaliste Victor Lhoest était présent auprès des Mexicaines descendues dans la rue pour revendiquer que les agresseurs présumés soient traduits en justice. Dans Pas une de plus, Victor fait écho à leur combat.
L’indignation véritable est souvent le levier de l’engagement comme le souligne Claude Cossette dans sa chronique. Pour la concrétiser, certains prennent la rue, d’autres la plume. Dans son Manifeste d’un intervenant frustré, notre sociologue en résidence offre une réflexion sur les systèmes d’oppression dont sont victimes les citoyens avec qui il travaille.
En ce mois d’élection, on ne peut passer sous silence, l’engagement politique qu’embrassent les élus. Philippe Fortin s’est penché sur les relations provinciales municipales qui sont en métamorphose depuis quelques années. Il semblerait que la conjoncture soit favorable aux élus municipaux.
En endossant l’uniforme, la Colonelle MarieChristine Harvey savait quels besoins elle voulait assouvir, mais elle ne réalisait pas à quel point cette carrière la passionnerait. Philippe Fortin s’entretient avec cette militaire qui a gravi les échelons jusqu’au poste de commandante d’une brigade mécanisée.
Les couples ouverts et les polyamoureux sont-ils moins engagés dans leur relation que les couples monogames ? Christine Deslongchamps-Pelletier a posé la question aux principaux concernés.
Le projet Point de vue lancé par Marc Émile Vigneault est un véritable succès. Chaque mois, il réunit un florilège de poèmes qu’il offre à La Quête. Toutefois, peu de candidats se sont présentés pour signer Espoir au Cube, la chronique qui met en valeur les personnes qui arrivent à se construire ou à se reconstruire une vie heureuse. Si ça vous parle, écrivez à mev@sympatico.ca.
Dans sa chronique Espoir au Cube, Marc Émile Vigneault témoigne de l’engagement envers soimême comme un outil de mieux-être. Une réflexion dont on peut tous tirer avantage.
Bon an, mal an, une bonne quinzaine d’étudiants en journalisme à l’Université Laval collabore à La Quête. Certains d’entre eux passent à la vitesse de l’éclair, d’autres étirent leur participation sur un, deux, voire trois ans. Puis, ces apprentis prennent leur envol. Que deviennent-ils par la suite ? Un peu par curiosité et beaucoup pour inspirer nos futures recrues, nous en avons retrouvé quelques-uns et quelques-unes qui ont accepté de nous faire connaître leur parcours post-Quête. Jean-Louis Bordeleau, maintenant journaliste au quotidien Le Devoir, ouvre le bal de cette série qui se poursuivra au cours des prochains mois. On a aussi demandé à ces ex, de nous concocter un reportage sur la thématique du mois. Jean-Louis a décidé de nous faire connaître Patrick R. Bourgeois, un ardent défenseur de la rainette faux-grillon.
Bonne lecture, FRANCINE CHATIGNYDe février 2010 à juillet 2022, Hélène Huot a signé 122 chroniques, tout aussi intéressantes les unes que les autres, de La langue dans sa poche. Citations, jeux-questionnaires, parties de Scrabble, mots pour rire, nouvelles entrées dans les dictionnaires, origine des noms de rue, et j’en passe, autant de moyens qu’elle a utilisés pour démontrer la richesse et la précision de notre vocabulaire, les nuances de sens d’un même mot et autres subtilités langagières. Son travail assidu a fourni à qui la suivait d’innombrables occasions de s’émerveiller de la beauté de la langue de Molière. Son engagement bénévole à la production du magazine de rue prend fin avec ce numéro-ci. Nous tenons à lui exprimer toute notre gratitude et de sincères remerciements pour son altruisme et sa solidarité. Au revoir Hélène !
Le mot engagement évoque des actions bien connues comme celles de s’enrôler dans l’armée ou de choisir une/un partenaire amoureux pour le long terme.
L’engagement dont je parlerai ici, c’est la décision prise par une personne de participer à la vie citoyenne, de l’animer, de la régénérer. Gros programme !
Il y a soixante-dix ans, l’Internet n’existait pas ; pour découvrir les enjeux du grand monde, les jeunes dont j’étais devaient digérer les textes austères de journaux et de revues d’idées. Le communisme constituait alors le principal sujet d’inquiétude.
Aujourd’hui encore, il existe des situations qui suscitent le débat, qui soulèvent l’indignation, et qui amènent certains à « s’engager ». Les limites imposées à la liberté ou les injustices sociales sont les sujets qui déclenchent le plus souvent cet engagement.
Le dictionnaire Le Petit Robert définit ainsi l’engagement : « Acte ou attitude (d’un intellectuel, d’un artiste) qui s’engage ». C’est restrictif. Oui, c’est vrai, plusieurs professeurs et artistes de la scène présentent l’exemple de personnes engagées pour une cause. Mais les citoyens ordinaires le font aussi au sein de cercles, de regroupements, de mouvements. Notamment, les partis politiques ou les groupes religieux engendrent leur lot de militants.
Il existe par ailleurs des personnes qui défendent l’idée qu’il faut agir par soi-même, directement sans nécessairement passer par les intermédiaires que sont les associations, partis, syndicats et autres groupes d’influence. On appelle ces personnes des activistes. Des électrons libres, ironisent certains.

Des chroniqueurs prétendent que les citoyens d’aujourd’hui, les jeunes en particulier selon certains, sont moins engagés. Ceux-ci ne croiraient plus à leur pouvoir d’influence, se désolidariseraient, renonçant à agir sur leur milieu.
Beaucoup de personnes sont indignées, touchées aux larmes par les bulletins de nouvelles qui rapportent une horreur sociale, l’action de voleurs en cravate ou une guerre au bout du monde. Sans toutefois passer à l’action. C’est en ce sens que le philosophe Luc Ferry, en critique, estime que l’indignation « s’inscrit
dans une politique de l’émotion plutôt que dans une politique de justice ».
C’est que l’indignation véritable ne se satisfait pas de larmes, mais se nourrit du besoin d’agir : d’abord afin d’approfondir sa compréhension de la problématique, de se fonder une solide opinion ; ensuite pour inventorier les organismes qui œuvrent sur les enjeux ciblés et éventuellement se joindre à l’un d’eux comme militant.
Beaucoup de contemporains le font pour défendre leur idée sur la répartition des richesses ou contre la pauvreté, la protection de l’environnement ou contre la surconsommation, l’égalité citoyenne ou contre le sexisme, le racisme. Ainsi de suite.
Plusieurs jeunes font mentir le point de vue qui veut que les jeunes ne s’indignent plus : certains se retroussent les manches, prennent la parole, font des gestes d’éclat, mettent sur pied un projet novateur, retrouvent la puissance des manifestations pacifiques. Ainsi, la grève étudiante de 2012, dite Printemps érable, est devenue la plus imposante de l’histoire. Ainsi encore, en 2019 à Montréal, 500 000 personnes ont rejoint une marche à la suite de la jeune Greta Thunberg, réclamant une efficace stratégie de lutte contre la crise climatique.
S’engager, c’est s’appuyer sur son indignation pour faire quelque chose en vue de changer une situation. Ce qui veut dire, prendre position en signant des pétitions, participer à des campagnes de financement, rejoindre des manifestations, sensibiliser son entourage aux situations d’injustices qui prévalent dans notre monde.
Et, le cas échéant, reprendre le flambeau, sollicitant la direction d’une association, d’une entreprise, voire d’un gouvernement. Ou même (pourquoi pas ?) fonder un nouveau groupe de pression ou une nouvelle coopérative.
En un mot, s’engager, ce n’est pas seulement s’indigner, c’est agir. Comme il est prôné sur une mini pancarte de manifestant conservée dans son bureau par la députée-poète Catherine Dorion sur laquelle il est simplement écrit : « Fais quelque chose ».
Le 24 janvier 2019, la page Facebook du magazine de rue La Quête publie la photo d’une contravention. Celle-ci a été donnée généreusement par la police de la Ville de Québec. Description de l’infraction : « avoir flâné, vagabondé ou dormi dans une rue ou dans un endroit public sans motif raisonnable ». Coût de la contravention : 223 $, soit trois nuits dans un motel.
La semaine précédant cette publication, les journaux québécois racontent la « bombe météo » avec laquelle les Québécois-e-s doivent composer. Les grands titres des journaux relatent la « paralysie du Québec » : fermeture des routes, des écoles, « orage » en plein hiver, froid intense… Le 18 janvier 2019, dans Le Journal de Québec, Elisa Cloutier signait un article intitulé « Les refuges pour itinérants débordent à Québec ».
Le travail social engage les intervenants et les intervenantes face à la population qu’iels accompagnent. Ces populations sont regroupées selon des caractéristiques particulières, souvent décidées par la mission de l’organisme : jeunes, personnes âgées, adolescents et adolescentes, personnes psychiatrisées, personnes en situation d’itinérance, personnes judiciarisées, etc. Ces caractéristiques désignent le « problème » que la personne vit et l’angle selon lequel les interventions seront conduites.
Cette problématisation des vies individuelles, des manières d’être, de se comporter dans l’espace public, dans les relations interpersonnelles, de réfléchir le monde, s’ancre dans une conception normalisante de l’individu moderne. Cet individu est perçu par l’État comme étant autonome, responsable de son devenir, de ses faits et de ses gestes.
Le matin de la découverte de la contravention, l’équipe de l’Archipel d’Entraide était scandalisée. Nous étions déjà au courant des phénomènes de judiciarisation et de profilage social vécu par les personnes marginalisées. Il n’en demeure pas moins que c’est toujours confrontant de voir le traitement que d’autres groupes sociaux réservent aux personnes que nous accompagnons. Comment se fait-il qu’un individu pénalise un autre individu des dysfonctionnements d’un système social ?
La relation d’accompagnement ancre ses acteurs et ses actrices à l’intérieur d’une éthique du care, c’est-à-dire une éthique relationnelle qui se construit au sein même des relations. Son opposé, la morale universaliste, incarnée par le droit et le travail policier, me semble mal s’imbriquer avec le travail des intervenants sociaux et des intervenantes sociales.
La Loi propose de s’adresser à tous les citoyens et toutes les citoyennes. Or, iels ne sont pas pourvu-e-s des mêmes ressources économiques, matérielles, sociales, culturelles ou cognitives. Pourquoi est-ce que la Ville de Québec continue à donner des contraventions à des individus qui n’ont pas de logement ? Pourquoi pénaliser les difficultés d’un individu à se loger et à se sentir confortable en logement ? Est-ce réellement la meilleure manière de faire ?
Depuis le début de mon parcours d’intervenant social, il y a six ans, j’en suis venu à développer un sentiment de révolte envers le système d’oppression qui régit les vies des personnes désaffiliées. Si ce n’est pas la police qui exclut ces personnes de l’espace public, ce sont les commerçants et les commerçantes qui se plaignent, ce sont les
résidents et les résidentes qui font des pétitions contre les utilisateurs et utilisatrices des organismes communautaires, ce sont les politiciens et les politiciennes qui détournent leur regard du monde social pour s’occuper du monde économique.
Le système d’oppression, nous l’incarnons tous et toutes, à des échelles différentes. Il prend la forme de préjugés : « il n’a qu’à arrêter de consommer, ça ira mieux dans sa vie » ou de stéréotypes : « du monde de même, ça ne veut pas s’aider ». C’est le fait de traiter différemment une personne en fonction de certaines de ces caractéristiques sociales, telles que son habillement, son hygiène personnelle, son statut socioéconomique, ses origines ethniques, ses capacités physiques et intellectuelles, etc.
Le sentiment de révolte témoigne d’un engagement émotionnel vécu par les intervenantes sociales et les intervenants sociaux face aux personnes qu’iels accompagnent. Au sein de cet espace relationnel, de nombreuses émotions sont véhiculées, allant de l’impuissance, à la tristesse, en passant par le dégoût ou la colère.
Dégoûté de la manière dont la société traite ces citoyens victimes. En colère face aux manques de ressources et aux injustices structurant le travail d’accompagnement et les vies appauvries. Les intervenantes sociales et les intervenants sociaux sont souvent les derniers remparts avant la désaffiliation complète d’un citoyen ou d’une citoyenne. Néanmoins, je crois qu’un engagement citoyen face à ces réalités permettrait l’atteinte d’une société plus juste et l’abolition des systèmes d’oppression.
Jean-Louis Bordeleau écrit quotidiennement pour Le Devoir, pour les actualités liées à la santé, l’immigration et parfois la politique. Sa trajectoire vers le journalisme de grands périodiques a débuté à l’écriture de La Quête. Il raconte ce qu’il est devenu. Mes premiers pas dans l’écriture journalistique ont débuté dans ce mensuel, La Quête, en 2014. Universitaire en quête de pratique, j’y ai trouvé l’espace qu’il me fallait pour soigner une plume chancelante. La circulation de ce magazine papier — très précieux de nos jours —, sa mission sociale, tout comme l’esprit bigarré de ses auteurs me sont apparus comme tout désignés pour le jeune journaliste que j’étais.
Et il l’est encore aujourd’hui. J’y suis justement revenu le temps d’une édition, comme on dit « Bonjour » à des amis que l’on devrait appeler plus souvent. Après des études en journalisme à l’Université Laval, donc, et un voyage de par le monde pour ouvrir mes horizons, j’ai décidé d’explorer le Grand-Est. Le diplôme en communication estampillé de rouge et d’or que j’avais en poche m’a ouvert la porte de Radio-Canada… à Sept-Îles, sur la Côte-Nord. Pas besoin de vous dessiner combien c’est loin. C’est loin, mais c’est beau ! L’aventure semblait belle. Elle le fut. Elle a duré 3 ans.
Les hivers étant ce qu’ils sont « par enbas », j’ai ensuite choisi de quitter ce territoire adoré pour mon territoire natal : Montréal. L’éloignement et une certaine crise sanitaire ont précipité les choses. Réinstallé dans la métropole, je me suis tourné naturellement vers mon journal préféré, Le Devoir. Deux raisons m’y ont poussé, surtout. D’un, je considère qu’il s’agit du seul journal indépendant depuis toujours dans la presse québécoise, une valeur cardinale en journalisme. De deux, c’est simplement le journal avec lequel j’ai appris à lire.
Je remercie ici le journal qui m’a appris à écrire.
L’environnementaliste Patrick R. Bourgeois est parfois connu pour ses photos et ses vidéos inédites des fonds marins du SaintLaurent. Mais s’il fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, c’est parce qu’il se bat pour sauver de l’extinction la rainette faux-grillon, une toute petite grenouille montréalaise. Une lutte astucieuse se cache derrière ce combat d’écologiste presque microscopique au sein du grand saccage planétaire. Portrait.
L’été, on joint Patrick R. Bourgeois sur la Côte-Nord. Il y passe la belle saison à plonger dans le fleuve afin de photographier la vie marine, au fond de l’eau, au large.
Le reste de l’année, il œuvre plutôt dans la grande région de Montréal. C’est là que se joue son combat de l’heure. Il y affronte vents et marées pour ne pas que disparaisse à tout jamais la rainette faux-grillon. Ce batracien ne survit plus que dans quelques parcs de Longueuil et « au rythme où vont les choses, il n’en reste pas pour des années et des années », estime-t-il.
Les campagnes pour protéger les bélugas ont déjà fait mouche, à la faveur de la beauté et de la grâce du mammifère. Mais pourquoi
prendre la défense d’un si petit animal, pas forcément attachant, et inconnu de tous de surcroît ?
« C’est tout le temps plus facile de souhaiter la préservation d’une espèce qui ne te concerne pas. C’est facile de dire que tu veux sauver les éléphants. Ça ne te concerne pas. Le Saint-Laurent, c’est encore trop loin », résume Patrick R. Bourgeois.
C’est ainsi qu’il a décidé il y a quelques années de prendre à bras le corps la sauvegarde de cette grenouille « grosse comme le bout de ton doigt » qui vit dans les marécages. Car le véritable champ de bataille, c’est la préservation des zones humides, l’habitat naturel de la rainette. Ces « grands filtres qui nettoient l’eau et épongent les zones inondables » sont asséchés à 90 % en Montérégie.

« Ça ne sert à rien de sauver un animal si tu ne sauves pas son habitat.
On a souvent fait cette erreur-là dans le monde contemporain », relève-t-il. De la même façon, la défense du béluga implique la défense du golfe du Saint-Laurent au complet.
« La rainette faux-grillon, c’est une espèce dynamite », expose Patrick Bourgeois. « C’est un animal poli-
tique qui vit dans la cour du monde. Ça touche de la plus petite réalité du quotidien jusqu’au grand promoteur immobilier. […] Tu fais plus de bruit avec la rainette faux-grillon. »
Dans cette bataille à la David contre Goliath, le photographe s’octroie une vacance à chaque début d’été après la saison de reproduction de l’animal menacé. « C’est tellement déprimant », ditil. « Il n’y a jamais rien qui va bien dans ce dossier-là. Jamais. Tu es toujours en train d’éteindre un feu. Quand tu arrives à l’éteindre, un autre est décollé. Je ne pourrais pas juste faire ça, c’est bien trop déprimant ».

S’il passe l’été à Baie-Comeau, sa ville natale, c’est qu’il y a là une « impression d’intactitude » si chère à l’âme des amoureux de la nature.
Cette transhumance lui permet aussi de s’adonner à la photo sous-marine. Une autre façon de s’engager pour l’environnement.
« Les gens découvrent les animaux sous un jour meilleur, pour qu’ils finissent par les aimer et ultimement les protéger. »
Ses plongées dans les profondeurs du Saint-Laurent l’amènent
à constater des réalités « terrifiantes », en premier lieu la disparition du phytoplancton, ces cellules végétales qui font vivre les océans. « L’Amazonie et les autres grandes forêts, c’est une bouffée d’air sur deux que tu respires. L’autre, c’est le phytoplancton », explique-t-il.
L’évolution du décor marin de ses photos constitue selon lui une preuve de l’urgence de la situation. « Au début, j’étais très proche de mes sujets. La colonne d’eau était toute petite, alors je n’avais pas trop de plancton entre moi et mon sujet. J’étais proche, et ça me faisait des images claires. Depuis quelques années, je peux faire des photos en grand-angle et je vois les vagues à 80 pieds en haut. Ça veut dire qu’il n’y a plus de phytoplancton dans l’eau. Ça n’arrivait jamais. Pour la photographe, c’est mieux, car j’ai de l’eau claire. Mais c’est pas mal juste bon pour ça. »
Le Québec rural et sauvage a modelé l'environnementaliste tout naturellement, dit-il. « On est à peu près les derniers à encore avoir des écosystèmes sauvages sur la planète. On a une très grande responsabilité. Dans le monde où l’on
est, on n’a juste pas le droit de laisser faire ça. C’est quasi-criminel de penser que moi, je vais être mort de toute manière quand ça va vraiment péter. »
Cette défense de ce coin d’Amérique du Nord a commencé en politique, relate l’ancien « militant indépendantiste actif ». Jadis compagnon du très engagé Pierre Falardeau, Patrick R. Bourgeois raconte que cet engagement politique apportait « beaucoup de risques, beaucoup de conséquences et très peu de revenus ».
Au final, dans sa deuxième vie d’environnementaliste, le but n’a pas tant changé : « Je suis parti défendre le Québec d’une autre façon, davantage dans son territoire ».
Il indique par ailleurs que le maniement de l’appareil photo et cette conservation de la faune par l’image, il l’a appris « sur le tas », « à force de milliers d’heures dans les buissons et sous l’eau ».
Pour ceux que la défense de l’environnement intéresse, il conseille de « commencer par protéger autour de soi ». Ensuite, le combat doit forcément devenir politique, à ses yeux.
« Il faut surveiller le politique. On est rendu dans un contexte où les gestes individuels ce n’est plus assez. Ça nous prend du monde en haut qui commence à marcher dans le bon sens. Il faut les talonner pour qu’ils marchent dans le même sens. »
Au Mexique, des femmes se battent parce que d’autres meurent. Plus de 3000 femmes ont été assassinées en 2021. Alors que le président Andres Manuel Lopez Obrador est accusé d’attentisme, des manifestantes demandent justice pour celles disparues.

Nous sommes à Mexico, au Zócalo, la place principale de la capitale mexicaine. Les militantes s’y sont donné rendez-vous en tenue noire pour manifester ce 18 mai, jour de lutte nationale contre les disparitions et les féminicides. Il est 17 h passé de quelques minutes. Certaines militantes s’impatientent. La manifestation devait commencer à l’heure pile. « C’est la ponctualité mexicaine », ironise Isabel Sanchez, militante féministe au grand chapeau, venue avec deux amies.
En quelques minutes, une cinquantaine de femmes remplissent
le trottoir. Le cortège — chauffé à blanc par les discours des meneuses du mouvement et les chants du public — démarre pour un tour de la place centrale. Elles endossent un macabre devoir d’alerte auprès des dirigeants du pays.
Parmi elles, Mélanie Gomez, étudiante de 22 ans, tient une pancarte où figurent trois visages. Ce sont ceux de ses amies. « Une a été séquestrée et les deux autres assassinées », dit-elle à La Quête « Une enquête est en cours. On espère que la justice fera son travail ». L’histoire est glaçante. Selon l’Institut de statistiques mexicain INEGI, 6 Mexicaines sur 10 ont été victimes de violences de genre au cours de leur vie. Pour les cas de féminicides, leur nombre a flambé depuis 2020.
Les féminicides sont un fléau national au Mexique. L’ONG Amnesty International a recensé 3 723 as-
sassinats de femmes au Mexique en 2020, soit une moyenne de dix chaque jour. Mais les autorités ne reconnaissent que 940 meurtres comme féminicides, un chiffre néanmoins en hausse de 136 % en cinq ans.
Comme au Québec où vingt-six féminicides ont été comptés en 2021, le phénomène s’est aggravé avec la pandémie. Les féminicides touchent la population de manière inégale : la pauvreté et le faible niveau scolaire sont des facteurs de vulnérabilités. Les violences sont le plus souvent commises par des proches des victimes, et il est difficile de fuir lorsque l’argent manque.
Afin de médiatiser la cause au-delà des frontières mexicaines, Isabel Sanchez, rencontrée pendant la manifestation, a accepté de s’entretenir avec La Quête.
En tant que psychologue féministe à l’organisme Renacer (renaître), elle intervient auprès de victimes de violences liées au genre. « On propose un soutien psychologique et un accompagnement dans les démarches judiciaires pour les femmes victimes de violence afin de faire valoir leurs droits devant la justice, et ainsi obtenir une entière réparation. C’est une étape très complexe pour les victimes », constate-t-elle après quatorze ans dans ce domaine.
Dans 90 % des cas de violence faite aux femmes, les agresseurs présumés ne sont jamais jugés, selon l’INEGI. Pour enrayer la mécanique, l’ancienne ambassadrice pour la prévention de la violence au ministère de la Justice de l’État de Mexico estime qu’il est nécessaire de rendre la justice accessible.
La solution mexicaine aux féminicides tient en quatre mots : prévenir, combattre, punir et éradiquer les violences envers les femmes. Ce sont les mots d’ordre de la politique définie par le gouvernement en 2021. Derrière ces promesses, les moyens mis sur la table pour les programmes qui s’occupent des victimes de violence ont été réduits, ou trop peu augmentés


— inférieur au taux d’inflation. « Comment on peut avoir les moyens d’agir sans ressources », regrette Isabel Sanchez.
Le président mexicain de gauche Andrés Manuel López Obrador (AMLO) élu depuis 2018 portait pourtant les espoirs du changement propre à chaque alternance. Jamais un gouvernement mexicain n’avait comporté autant de femmes, sept sur dix-neuf.
Son image a quelque peu changé. En 2020, derrière le mot clé « #UnDiaSinNosotras » (« un jour sans nous »), une grève nationale a mobilisé plus de 20 000 Mexicaines selon les chiffres officiels, pour dénoncer l’inaction du gou-
vernement face à une vague record de féminicides. La veille, la secrétaire de la fonction publique, Irma Eréndira Sandoval, affirmait encore qu’AMLO était le « président le plus féministe » du Mexique contemporain.
Une phrase qui fait sourire amèrement Isabel Sanchez. « Les hommes ne peuvent pas être féministes », lance-t-elle. Après une respiration, elle tempère. « Ils sont des alliés, ils ne peuvent pas vivre la même chose qu’une femme victime de violence subit parce qu’elle est femme. Mais ils peuvent partager notre lutte ». La moitié de la population tend la main pour que l’autre la rejoigne.
Une étude canadienne parue dans The Journal of Sex Research révèle que 4 % des répondants ont rapporté être dans une relation non monogame consensuelle, et que 12 % des participants ont déclaré que ce type de relation serait leur configuration amoureuse idéale. Bien que les relations ouvertes semblent moins contraignantes que la norme monogame, les couples ouverts et les polyamoureux respectent, eux aussi, des engagements.
à l’égard de sa copine. Notons que cet exemple est un cas spécifique, et que certaines unions s’autorisent des expériences chacun de leur côté. Il faut comprendre qu’à l’intérieur même de ses relations, plusieurs règles s’appliquent. Chaque couple décidera des termes de leur entente selon leurs principes et leurs valeurs.

Le polyamour est une éthique des relations amoureuses dans laquelle les partenaires sont en relation amoureuse avec plus d’une personne. Ce choix de vie nécessite le consentement de tous les partenaires. Il inclut aussi bien l’homosexualité que l’hétérosexualité.
s’engage pas avec n’importe qui. « Il faut faire attention au phénomène d’énergie des relations nouvelles, soutient Ophélie. La nouveauté est souvent excitante, mais cela s’estompe généralement après plusieurs mois. De plus, les relations que l’on vit peuvent rester floues, on n’est pas obligé de mettre une étiquette sur la relation qu’on entretient avec l’autre ». Ophélie dénote plusieurs bienfaits à cette éthique amoureuse : une augmentation de la confiance en soi, moins de jalousie et du progrès sur sa dépendance affective.
Le couple ouvert est une entente d’union entre deux partenaires qui s’autorisent des relations sexuelles avec d’autres personnes. Vincent est en couple ouvert depuis 8 ans. Son couple, expliquet-il, a des rapports sexuels divers tels que de l’échangisme ou encore des relations à plusieurs. Sa copine et lui se sont engagés à vivre ces aventures ensemble. Si l’un ou l’autre fait une expérience seule, cela est perçu comme de l’infidélité. Le couple a d’ailleurs un compte sur Jalf, une plateforme qui sert exclusivement à réaliser ses fantasmes. Mélanie échange avec d’autres femmes et d’autres couples. Dans leur relation, c’est Mélanie qui choisit les partenaires potentiels.
La raison première qui motive ce type de relation est la satisfaction sexuelle. De plus, Vincent mentionne qu’après de telles expériences, il partage plus de tendresse
La base de cette relation repose sur des ententes variées, des principes et des limites qui sont propres à chaque partenaire. Des concessions sont nécessaires, mais la personne centrale dans ce type de relation est soi-même, et le but est de s’épanouir. Cependant, la personne engagée dans le polyamour doit répondre au besoin qu’il dit combler chez son partenaire. Les polyamoureux affirment qu’une seule personne ne peut pas combler tout ce dont l’autre a besoin, ainsi chaque partenaire apporte ce qu’il a à offrir.
Selon les pluriamoureux, comme chez plusieurs couples monogames, lorsqu’une entente est brisée, cela relève de la tromperie, de la trahison. C’est ce qui qualifie l’infidélité dans ce type de relation. Selon Ophélie, polyamoureuse, des ajustements se font au fur et à mesure. Par exemple, les heures auxquelles l’autre revient à la maison : choses que l’autre est tout à fait libre de faire, mais qui peuvent générer de l’inquiétude, à savoir si l’autre est en sécurité. Bien que le polyamoureux soit ouvert, il ne
Malgré ce que l’on pourrait croire, les polyamoureux vivent, eux aussi de la jalousie. La solution, s’en parler. Ophélie dénote que les projets à long terme peuvent être source de conflits. Effectivement, certaines règles d’une relation peuvent entrer en conflit avec celles d’une autre relation. La bienveillance et le respect aident aux relations multiples. Les polyamoureux vont même jusqu’à ressentir de la compersion, soit un sentiment de bonheur lorsque l’on voit son partenaire s’épanouir avec une autre personne.
« Ce n’est pas parce qu’on commence à aimer quelqu’un que l’on aime plus l’autre. Mon amour pour la première personne ne change pas », affirme Sarah-Jane, la copine d’Ophélie.
Tant que l’éthique est respectée, les polyamoureux et les couples ouverts sont certainement engagés. Sarah-Jane insiste : « il y a la vulnérabilité, l’amour, le respect. Tu te dois d’être engagé dans ce type de relations ».
CHRISTINE DESLONGCHAMPS-PELLETIERLes élections provinciales donneront le ton quant aux relations à prévoir entre les municipalités et le nouveau gouvernement élu. Avec de gros projets sur la table pour la capitale, les débats politiques et les engagements ne manquent pas. Mais la dynamique entre les deux paliers de gouvernement est en transformation. Afin d’en cerner certains impacts, La Quête a rencontré Philippe Dubois, professeur adjoint à l’école nationale d’administration publique (ENAP). Difficile d’aborder le sujet des relations entre le palier municipal et provincial sans comparer avec le passé. La Ville de Québec a eu un maire charismatique pendant de nombreuses années et son départ vient avec des changements. Bruno Marchand a eu à faire face à l’héritage de son prédécesseur. Assez rapidement, il est devenu clair que le nouveau maire souhaitait garder une position forte face au gouvernement provincial. « M. Marchand s’inscrit dans la continuité, à savoir qu’il pense comme son prédécesseur et comme les élus plus jeunes du palier municipal », explique M. Dubois. Il continue en spécifiant qu’ils « se voient comme le palier de proximité, comme les spécialistes de leur milieu et que c’est eux qui devraient être les promoteurs et les leaders des projets locaux. »
La CAQ se voit aussi en promoteur des projets locaux, dans une vision dite régionale. « C’est une vision un peu plus classique de la relation du Québec envers ses municipalités et c’est ça qui a donné lieu aux accrochages que l’on a vus dans les médias », soutient le professeur.
M. Dubois souligne que la relation entre le municipal et le provincial est en pleine redéfinition. « La reconnaissance du gouvernement de proximité c’est récent. Le rôle des municipalités et comment elles se voient changent. » Il note que les

intérêts politiques des électeurs évoluent aussi. « Nous ne sommes plus dans une logique souverainiste avec les bleus contre les rouges, ce sont les tiers partis qui ont pris le devant de la scène. » Il précise à ce sujet que la CAQ « est le premier gouvernement depuis 1976 qui n’est pas formé par l’un des deux partis traditionnels. » Tandis que dans les conseils de ville « les élus sont plus jeunes et plus professionnalisés. Tout ce bouillonnement-là crée une redéfinition des relations et des pratiques ».
Quel type de relation est à prévoir devant cette nouvelle dynamique politique au Québec ? « Je pense que ça va bien se passer », assure M. Dubois ajoutant que « personne n’a intérêt à se chicaner, surtout pas en début de mandat. Des chicanes, ça peut être long et tout ce qui traîne en politique a tendance à salir les gens qui sont impliqués. » Malgré les accrochages récents, avance-t-il, « la CAQ a fait preuve de bonne foi et les mairies aussi. On est capable de trouver des solutions à des projets qui semblent perdus d’avance. C’est encourageant. » Selon le professeur de l’ENAP, les attentes des électeurs évoluent également et les élus doivent le comprendre. « L’appétit n’est pas pour la confrontation. Si les électeurs sont moins intéressés à la confrontation fédérale-provinciale, ce n’est pas pour la remplacer par une confrontation municipale-provinciale. Les gens s’attendent à ce que les choses fonctionnent. »
Le professeur soutient que « la scène municipale est mobilisée et de plus en plus intéressée par son propre sort. Il y a une conjoncture favorable aux élus municipaux et ils ont soif d’en profiter. » Pour le maire Marchand, le défi sera de conserver le rôle que la Ville de Québec a joué sous le maire Labeaume. « La mairie de Québec devra s’assurer de conserver un lien privilégié »
avec le nouveau gouvernement. Un rôle que M. Marchand réussit à remplir jusqu’à maintenant, selon M. Dubois. « Il a réussi à s’imposer, à imposer son style et à rallier les gens. Ça traduit selon moi un sens politique assez développé. »
Reste à savoir dans quelle mesure les deux paliers pourront collaborer de façon constructive pour le bienfait des citoyens. La vision régionale du premier ministre sortant amenait certaines frictions, mais le positionnement favorable des élus municipaux donne de l’envergure à leur prise de position. Cette redéfinition des relations et des engagements politiques du palier provincial face aux municipalités se précisera après les élections.
PHILIPPE FORTINElle est la première femme à commander une brigade mécanisée au Canada. Elle s’est enrôlée il y a 26 ans afin de tester ses limites. Son engagement militaire lui en aura donné l’occasion à plus d’une reprise. La Quête s’est entretenue avec la Colonelle Marie-Christine Harvey, la commandante du 5e Groupe brigade mécanisée du Canada (GBMC), à Valcartier.
Le commandement d’une brigade mécanisée représente une étape marquante dans le cheminement professionnel d’un officier supérieur. Au pays, il n’y en a que trois, une à Valcartier, une à Petawawa en Ontario et l’autre à Edmonton. Commander ce type d’organisation, c’est d’être à la tête d’environ 5000 personnes. Une brigade regroupe différentes unités, appelées régiment ou encore bataillon. Celles-ci offrent une variété de spécialisations professionnelles militaires qui fournissent aux brigades la capacité de mener des opérations au Canada ou encore à l’étranger.

Originaire de la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean, Marie-Christine Harvey cherchait l’aventure. Elle joint la Réserve comme soldat d’infanterie alors qu’elle n’était pas encore majeure. Ses parents ont d’ailleurs dû autoriser son enrôlement. Elle est familière avec l’environnement militaire depuis son enfance, car son père avait fait carrière dans l’aviation. De nature un peu hyperactive, confie-t-elle, elle s’est sentie appelée par le service sous les drapeaux.
Elle raconte qu’elle avait « le désir et le besoin d’assouvir un sentiment d’accomplissement et de comprendre mes
limites, autant physiques que psychologiques. »
Une fois en uniforme, avec un peu plus d’expérience, Mme Harvey explique qu’elle a alors réalisé l’ampleur de sa passion. « J’ai réalisé que j’avais joint quelque chose de beaucoup plus grand que moi. Tout ce que j’avais envie d’accomplir, je l’accomplissais. J’étais stimulée. » La vie militaire offre une panoplie de raisons d’apprécier son
travail. Mais la commande identifie en premier lieu les membres qui y servent pour lesquels elle a toujours eu un profond respect. « Ce qui me passionne le plus dans mon métier, ce sont les gens. Et ce qui me passionne de nos gens, c’est quand ils sont authentiques et qu’ils sont eux-mêmes. »
Il est difficile de passer à travers toutes ces années en service sans faire face à son lot de défis. Mme Harvey n’y échappe pas. Elle est la mère de deux adolescents, de 13 et 16 ans. Pendant son commandement de la base de Valcartier, sa famille demeure à Gatineau. Sur les cinq dernières années, elle en a vécu trois à travailler à l’extérieur.
« J’avais le besoin d’assouvir un sentiment d’accomplissement et de comprendre mes limites, autant physiques que psychologiques. »
~ Colonelle Harvey
« Le quotidien, je ne le passe pas avec eux », souligne la militaire. Pour elle, il est donc question de trouver l’équilibre fragile entre la famille et l’engagement militaire.

« Mes enfants acceptent que je vive ma passion, mais il y a des impacts, c’est certain. »

En cherchant à comprendre si les raisons pour lesquelles elle continue de servir changent avec les années, Mme Harvey soutient les remises en question
dant sont d’une durée prédéterminée de deux ans. Une fois passé le niveau d’une brigade, les officiers sont généralement employés dans des positions de leadership qui les éloignent des soldats et du terrain.

Elle devra ainsi quitter les troupes qu’elle affectionne tant, non sans un pincement au cœur. Colonelle Harvey demeure humble
dante encourage les nouveaux venus à « vivre pleinement chaque moment sans chercher à trop calculer la suite. » Elle fait confiance en cette institution qui lui a tant offert depuis bientôt trois décennies.
« C’est un privilège de leader des gens aussi compétents que ceux du 5e GBMC. »
~ Colonelle Harvey
En ce qui concerne la prochaine étape, Colonelle Harvey fait face à une période d’incertitude. Elle est reconnaissante d’avoir pu comman-
les forces armées canadiennes (FAC), les positions de comman-



prévues surviennent durant une carrière militaire et la comman-

Depuis le 25 juin, la population peut trouver sur son chemin les étonnantes œuvres des Passages Insolites d’EXMURO arts publics ainsi qu’un musée du Bad Art. En tout, 18 artistes locaux, nationaux et internationaux ont mis la main à la pâte pour produire un parcours d’art public de 16 œuvres. En plus des artistes et des employés qui ont travaillé sur le projet, quatre bénévoles ont retroussé leurs manches pour proposer une expérience unique dans le secteur du VieuxPort de Québec qui se déroule jusqu’au 10 octobre.
Pour Laurence Duchesne, chargée de la médiation et du développement des publics, les Passages Insolites sans les bénévoles seraient impossible. « Si ça n’était pas d’eux, ça serait l’équipe de bureau qui aurait peint [le musée]. Donc non, je ne pense pas que ça aurait été possible », affirme-t-elle.
Les bénévoles jouent plusieurs rôles clés pour l’évènement. Ils font « le montage des œuvres […] et de la salle d’exposition, ils collent les affiches publicitaires dans les endroits publics et, à l’inauguration des Passages Insolites, ils sont sur le terrain et distribuent des cartes et offrent de l’information aux gens », indique Mme Duchesne.
Elle ajoute qu’EXMURO aime faire appel aux bénévoles, ce qui constitue souvent leur première expérience pour les étudiants en arts. « On sait qu’en art, tu dois avoir des expériences, tu dois avoir des contacts. C’est un milieu particulier pour ça et on a une belle sensibilité à cette réalité. On est très content d’offrir aux étudiants une première expérience en art. »
Parmi les trois bénévoles interviewés qui participent à l’élaboration de la 9e édition, tous étudient
de Benoît Maubrey, ARENA, est constituée de plusieurs haut-parleurs fonctionnels. Le public peut les utiliser pour diffuser de la musique ou se faire un karaoké.

en art. Cette expérience leur permet de combler leur recherche de connaissances dans ce milieu. Audrey, l’une des bénévoles, résume bien les raisons pour lesquelles elle s’implique. « Par curiosité, pour apprendre et pour l’aspect social. »
Faire le montage des œuvres comble entièrement les attentes des trois bénévoles. Cependant, ne pas pouvoir faire leur propre production leur manque, selon Sandrine. « J’aime beaucoup ça produire. Ce n’est pas ça qu’on fait ici. C’est deux choses complètement différentes, être artiste et être technicien, mais je veux voir les deux côtés de la médaille », admet-elle.
Audrey Croteau cumule plusieurs expériences variées en bénévolat. Un point commun à ces engagements : l’aspect humain. « C’est l’aspect humain, moi, qui m’intéresse peu importe la cause. On rencontre tellement de personnes différentes, de vies différentes et ils ont tous des choses différentes à prendre ces gens-là. Je trouve ça le fun d’apprendre un peu de chacune de ces personnes que je rencontre à travers ces expériences. »
Ce n’est pas la première année que des bénévoles donnent cœur
et âme pour réaliser Passages Insolites. Après avoir été bénévole l’an dernier, Triska Sicuranzo Gagné commence sa maîtrise en art à l’Université Laval et travaille avec diverses entreprises dans son domaine d’étude. Elle croit que son bénévolat à travers plusieurs organisations en art, dont EXMURO, l’a aidé à être où elle est aujourd’hui. « Ça te fait un bon nom dans le réseau et ça m’a donné un contrat de médiation. Tu es considérée comme une personne de confiance ». La jeune artiste affirme également que l’expérience, l’aspect social et tous les aspects du bénévolat sont positifs.
En plus de toutes les connaissances acquises, Mme Gagné a également utilisé sa formation de guide, acquise lors de l’évènement Passages Insolites, pour conquérir son conjoint actuel. « À ma première date, je l’ai amené faire le tour des œuvres des Passages Insolites », confie-t-elle en riant.
PIER-OLIVIER NADEAUOù étaient les foules, fin juillet, quand le Pape est passé par chez nous, pour rencontrer les peuples autochtones ? Journalistes et commentateurs, commerçants et services de sécurité croyaient voir accourir des milliers de personnes pour le voir. Mais ceux qu’on attendait sont restés chez eux.
L’amie Valentine explique ce peu d’enthousiasme par le fait qu’on n’aime pas les excuses : elles ne corrigent pas les fautes. De plus, les gens descendent dans les rues pour saluer l’audace triomphante ou l’arrogance des vainqueurs et des stars. Ici, l’événement se résumait aux inconvénients causés par les mesures de sécurité autour du quatrième voyage d’un pontife en Canada. De nos jours, la foule préfère les défilés de fierté aux marches du grand pardon.
Comment discuter devant ce point de vue ? Alors, je ramène à Valentine le vieil argument des risques encourus à juger des événements d’hier avec les yeux d’aujourd’hui. Ce que de nos jours l’on condamne a pu, dans le passé, relever de la norme ; ce qui était alors rejeté est, de nos jours, accepté ou toléré. L’éducation et l’information ont contribué à bien des changements dans les sociétés. C’est l’évolution.
Et Valentine riposte : « Et pour cela, les gens ont dû découvrir que les représentants de l’autorité peuvent commettre des erreurs et que la recherche de la vérité signifie qu’on ne se limite pas à une seule source. Même si désormais, les sociétés semblent régresser en ne se fiant qu’au seul canal des réseaux sociaux constamment présents et consultés comme si là se trouvait la source de toute vérité. »
Comme je ne suis abonnée à rien de tout ça, j’avance que tous les âges ont connu leurs prophètes du vrai et du faux et que seuls leurs moyens de rejoindre les gens évoluent continuellement. Croyant créer une diversion, je lui offre le premier roman d’une écrivaine que je viens de lire, « parce qu’elle porte le même nom que ma grand-mère », mais la tentative échoue quand je mentionne que la romancière réussit à évoquer la théorie de l’eugénisme.
À travers une enquête policière située en 1910 à Murray Bay, Céline Beaudet glisse un personnage sensible à cette idée qui fermentait à l’époque dans certaines sociétés convaincues de leur supériorité culturelle et raciale. Cette année-là, lors du Congrès eucharistique de Montréal, un des orateurs
invités, Mgr F. Bourne, archevêque catholique de Westminster, en Angleterre, avait suggéré aux Canadiens francophones d’abandonner leur langue pour se joindre la grande communauté catholique anglophone.
Ce qui avait naturellement soulevé l’ire d’un certain Henri Bourassa dans Le Devoir, le journal qu’il avait fondé. Chez les peuples héritiers de la Reine Victoria, plusieurs croyaient à la supériorité de leur culture et tentaient de l’imposer sur une base universelle, ce qui expliquait, sans les justifier, les diverses politiques d’assimilation mises en place dans toutes leurs colonies, incluant au Canada.
«
Ça passe toujours par les élites ces histoires-là et c’est ce qu’on reproche aux organisations religieuses qui, traditionnellement chez nous, formaient les leaders tant politiques qu’économiques », commente Valentine en ajoutant qu’avec « les pensionnats pour les enfants autochtones, nos gouvernements ont bafoué l’idée de respect de la culture des autres mais dans ce temps-là, même la notion de culture comme on prétend la connaître aujourd’hui n’existait pas. »
Je me souviens (!) des discours contre l’assimilation des minorités francophones entendus à l’école dans lesquels on nous incitait à nous engager à défendre partout l’usage de la langue française. Les autres minorités ? Personne n’en parlait sauf si elles étaient catholiques et parlaient notre langue. Et la liberté de choisir, dans tout ça ? Avec des enfants encore à l’âge de l’obéissance, on n’insistait pas plus là-dessus que sur les conséquences de toute idée d’engagement. Les temps ont-ils vraiment changé ?
À cause des excès nazis, le vieux monde a été jugé et souvent condamné pour avoir oublié que la pratique du respect des différences constitue l’essence d’une vie saine en société. Mais posons la question de la morale de l’histoire : fait-on mieux, aujourd’hui ?

Engagement : ce mot se rattache à de nombreuses façons d’agir et de faire, mais c’est avant tout de se trouver une orientation très précise sur ce que la personne veut accomplir, car souvent dans cet engagement la personne qui s’y plaît va s’y consacrer corps et âme. Accomplissant ainsi par le fait même l’union du corps (travail matériel) et de l’esprit (travail spirituel et créatif) pour obtenir un parfait équilibre dans l’espace-temps.
Peu importe dans ce que l’être humain s’engage, le but ultime est qu’il soit heureux dans son choix qu’il accomplira. Son engagement peut être spirituel, militaire, civil ou autre, mais son principal but est de s’accomplir lui-même. S’il est heureux dans son accomplissement, ce bonheur rejaillira sur ceux qui l’entourent.
Dans l’engagement sérieux, l’âge et le temps comptent très peu, car ce qui prime, c’est le résultat. En exemple, Michel-Ange a travaillé sur les tableaux de la chapelle Sixtine jusqu’à un âge très avancé. Il en est de même pour Léonard de Vinci dont l’esprit était toujours alerte pour ses créations. La liste serait assez longue de tout ceux qui ont accompli de grandes œuvres artistiques et littéraires. Tout ce beau monde dans un engagement sans pareil est passé à l’histoire. Ils sont des exemples marquants de la civilisation.

d’un contrat — d’embauche, d’assurance, etc.
Il y a aussi l’engagement personnel ou social. C’est un engagement qui est exécuté volontairement sans que personne nous pousse à le faire. Il est souvent caritatif, pour aider le monde dans lequel on vit. Et c’est ce que je fais présentement en écrivant cet article et vous de votre côté vous y participez en achetant cette revue que vous lisez présentement.
« L’engagement est sans limites et il entretient la vie. »
BouchardL’engagement est sans limites et il entretient la vie. Pour bien des gens qui s’engagent sérieusement, le temps n’existe pas (ou très peu.) Ce qui compte est l’accomplissement d’une réalisation à laquelle leur esprit donne un but à atteindre, et qu’ils ne peuvent laisser tomber.
Mais l’engagement n’est pas seulement artistique, il y a aussi d’autres engagements qui n’ont rien à voir avec les arts. En exemple, si on s’engage à acheter une maison, on s’engage aussi à payer une hypothèque pendant un certain nombre d’années, et signer des ententes qu’on doit honorer. C’est ce qu’on appelle un engagement hypothécaire. Sont compris dans tout ça des paiements pour l’auto, l’électricité ou le gaz, les cartes de crédit pour acheter tout ça, donc des engagements à payer. Et plus notre civilisation avance, plus il y a de cartes de crédit.
Chaque changement de mode de vie entraîne différentes formes d’engagement. Par exemple le mariage, l’achat d’une auto, l’arrivée d’un enfant, la signature
Les obligations qu’on se donne parfois sont des obligations personnelles, il faut tout simplement se discipliner pour atteindre le but qu’on se fixe. Concernant mes articles dans cette revue, les premiers datent de 2007, et je me dois de maintenir le cap pour cet engagement personnel.
Avec cœur et courage, PHILIPPE
BOUCHARDLa première image qui me vient en tête c’est celle de l’engagement envers moi-même. Comment puis-je m’engager envers les autres si je ne le suis pas avec moi-même ?
C’est facile de partager, d’offrir mon écoute, mon amitié, mon aide au besoin, mais, qu’en est-il lorsque vient le temps de respecter mes limites, de prendre une pause, de dire non au bénéfice de mon bienêtre personnel ? Suis-je capable d’être engagé envers moi-même ?
J’ai appris par expérience que si je ne suis pas à l’écoute de mes propres besoins je n’arriverai pas à m’engager envers autrui. J’ai attendu de frapper un mur en essayant de me rendre indispensable, irremplaçable, pour constater que, aussitôt parti, aussitôt remplacer. Et hop ! le monde a continué de tourner sans moi. Cette période de ma vie a été un point décisif pour réellement m’engager envers moi-même.

« La liberté n’est pas l’absence d’engagement, mais la capacité de choisir. »
Paulo Coelho« J’ai attendu de frapper un mur en essayant de me rendre indispensable, irremplaçable, pour constater que, aussitôt parti, aussitôt remplacer. »
réalisé que pour atteindre le sommet, il faut plus qu’une idée, il faut une préparation de tous les jours et surtout qu’il faut être bien entouré. Je me croyais invincible. Je n’avais pas pensé à prendre soin de la machine. J’avais oublié de m’engager envers moimême. Suite à cet accident de parcours, je suis devenu lucide. J’ai réalisé que je n’étais plus une valeur sûre pour mon employeur, j’ai dû faire une croix sur mon désir de travailler au développement de la pratique professionnelle dans mon milieu de travail, mais rien ne m’empêchait de devenir le professionnel de ma propre vie. J’ai accepté un autre type d’emploi dans l’organisation et je m’y suis adapté.
J’ai commencé par être à l’écoute de mes propres besoins. J’ai appris à ne plus surcharger mon agenda. J’ai appris à dire non sans traîner de sentiment de culpabilité. J’ai acquis une certaine assurance en mes capacités et j’ai appris à respecter mes limites. Ensuite, j’ai choisi de m’engager envers mon conjoint, ma famille, mes amis et amies et j’ai choisi les domaines sociaux qui m’inspiraient pour m’engager envers ma communauté.
Maintenant, je participe à la programmation et aux activités de la Ruche d’Art de Sherpa, j’écris pour le magazine de rue de Québec La Quête, je m’implique comme bénévole et je suis chargé de projet pour le projet Point de vue à PECH/Sherpa. Tout ça dans le plaisir, car je me suis choisi et je me suis engagé envers moi-même avant d’ouvrir vers l’extérieur pour accueillir les opportunités qui se présentent à moi.
Ça n’a pas toujours été ainsi. Au début de ma carrière d’éducateur, j’étais carriériste, je visais toujours plus haut. J’avais une vision avec des œillères qui me guidaient dans une direction, mais qui m’empêchaient de voir ce que je provoquais autour de moi. Je cherchais à me surpasser et j’ai eu une carrière montante jusqu’au jour où j’ai frappé mon Waterloo comme Napoléon le conquérant. J’ai
J’ai changé mes habitudes de vie, les comportements nuisibles à ma santé tant physique que mentale. J’ai réduit mes facteurs de stress. J’ai laissé derrière moi des relations toxiques, je me suis créé un réseau qui correspond à la personne que je suis. Je me suis centré sur mes compétences artistiques et j’ai fait progresser mes talents.
Aujourd’hui, je suis fier de la personne que je suis devenu. Maintenant, je peux partager mes talents et en faire profiter les autres. Je me sens à ma place dans le milieu communautaire et j’y participe à la mesure de mes capacités. Je me sens apprécié par les personnes qui évoluent dans mon environnement et privilégié d’être devenu significatif pour certaines d’entre elles.
S’engager envers soi-même, ce n’est pas qu’une décision, c’est un engagement de tous les jours. Il est facile de retomber dans mes vieilles habitudes. Je dois rester vigilant et constamment me souvenir du pourquoi je me suis engagé envers moi-même avant d’essayer d’être disponible et à l’écoute de l’autre. S’engager envers soi-même c’est aussi choisir la liberté en faisant germer l’espoir chez l’autre.
Simplement, MARC ÉMILE VIGNEAULTPAR JACQUES CARL MORIN CE JEU CONSISTE À REMPLIR LES RANGÉES HORIZONTALES AINSI QUE LES COLONNES 1 ET 20 À L’AIDE DES DÉFINITIONS, INDICES OU LETTRES MÉLANGÉES OU DÉJÀ INSCRITES. CHAQUE CASE GRISE REPRÉSENTE UNE LETTRE QUI EST À LA FOIS LA DERNIÈRE LETTRE D’UN MOT ET LA PREMIÈRE LETTRE DU SUIVANT...
Verticalement :
1- Smog.
20- Commerce des fourrures. Horizontalement :
1- Enveloppe de saucisse. Façonner une pièce avec une machine-outil (SNIERU). Petites rues. Nouvelle exclusive.
2- Ouvrir de nouveau. Métal radioactif. Mets composé d’un mélange de légumes.
3- Bien rangés. Période de formation. Article de journal émanant de la direction.
4- Pressant, impérieux. Tambour d’Afrique. Sert à la préparation du tapioca (CAMINO). Méchant.
5- Renseigné. Individus sous la dépendance absolue d’un maître. Employé.
6- Frivolité. Bois noir et dur. Petit café (TATIMESEN). Ongles pointus de certains animaux. Signal d’arrêt.
7- Petit reptile. Ambassadeurs, émissaires. Île italienne.
8- Indolent, apathique (HOREMAP). Voleur, fripouille. Rêve effrayant.

9- Région d’Espagne renommée pour ses vins (AJOIR). Difficile à comprendre (CABSSON). Torture. Mèche de cheveux.
10- Décision gouvernementale. Remuer pour mélanger (RULOLITE). Rousse..
Un romancier, ça raconte des histoires qu’il invente ou imagine à partir de la réalité qu’il reconstruit. Et parfois, entre la page écrite et le lecteur, se glisse un souvenir, porté par un mot ou une image qui a déverrouillé la mémoire.
Ainsi, le roman Le vol de l’ange de l’auteur Daniel Poliquin m’a ramené dans un bout de phrase, un souvenir d’enfance, une odeur de vieux tabac dans un grand vestibule meublé d’énormes fougères. Impression restée du jour où, désobéissant à mon père, j’avais tenté de le suivre dans cette espèce de château où il allait entrer. « Tu m’attends ici, c’est une maison pour les vieux. » Mais, curiosité aidant, j’avais poussé la lourde porte derrière laquelle il avait disparu et découvert cette odeur, celle de l’hospice, l’institution où la charité publique hébergeait les personnes âgées démunies et les sans famille. Bien loin des CHSLD et résidences d’aujourd’hui.
Daniel Poliquin est un écrivain franco-ontarien qui observe et entend : son métier d’interprète-traducteur l’exige. Au fil des ans, il a signé une douzaine de romans et d’essais. Paru en 2014, Le vol de l’ange vient d’un séjour en Acadie où il a appris qu’entre 1875 et 1925, certaines paroisses organisaient des ventes aux enchères pour « placer » vieillards désargentés et orphelins abandonnés. S’ils trouvaient preneurs, ils échappaient à l’orphelinat ou l’hospice, alors considérés comme des « lieux peu recommandables » ; la suite de leur vie dépendait de ceux qui les achetaient. Ce qu’évoque le titre du livre : un saut dans le vide.
Le romancier raconte l’histoire de l’un d’eux, enfant abandonné, mis en vente dans un encan, qui, devenu vieux, va se retrouver à son point de départ. Après la trahison de sa mère, il a décidé de ne jamais plus en parler. Recueilli par une famille qui devra le remettre en vente, il survit en défiant le destin et grâce à son intelligence pratique : homme curieux, il apprend vite et se débrouille avec humour et ironie, même avec les femmes.
Mais il croit qu’il ne faut pas chercher le bonheur : « C’est fatigant, on a toujours peur de le perdre et ça ne dure pas. » Il observe que « les gens ont l’impression d’être bons quand ils vous enseignent quelque chose ; ils se sentent grandis et vous grandissez avec eux. Il ne faut jamais laisser passer l’occasion de faire l’élève… »
Mais au bout de sa route, la malchance le ramène là d’où il est parti, avec d’autres humains remis en vente pour la dernière des enchères paroissiales. La boucle est bouclée. L’auteur ne révélera son nom, Fidèle-à-Salomé, qu’à la toute fin du roman.
Daniel Poliquin a signé un essai biographique sur René Lévesque et traduit Kerouac et Richler, mais s’intéresse aux gens anonymes observés dans les rues, même à Ottawa où il a travaillé. Ainsi, le dénommé Calvin qui courtise la carillonneuse du Parlement et se prétend le concierge d’un immeuble dont il est propriétaire. Dans un roman paru en 1994, L’écureuil noir, le romancier le fait narrateur de sa propre vie où sa pénible relation avec son père est devenue prétexte à pervertir la réalité pour ne pas décevoir. Calvin, comme l’écureuil dans son arbre, observe sans jamais assumer sa responsabilité.

Dans le plus récent de ses romans, paru en 2017, Cherche rouquine, coupe garçonne, à partir d’un drame bien réel, l’Affaire Coffin, Daniel Poliquin imagine les conséquences des choix de certains des protagonistes de la tragédie survenue en 1953 en Gaspésie. Accusé du triple meurtre de trois chasseurs américains, Coffin a été pendu, mais un doute a toujours subsisté autour des événements. Il devait bien avoir un entourage et le romancier l’imagine.
Il invente donc une femme avec un bébé adopté par le prêtre présent lors de l’exécution du meurtrier ; ensuite, il interroge les faits autour de la culpabilité de Coffin dont il change le nom. Jonglant avec les dates, le romancier multiplie hypothèses et incidents pour dérouter le lecteur tout en restant fidèle aux lieux des événements réels. Libre à chacun d’adhérer à la thèse insinuée par le roman et la mystérieuse rouquine. Parce qu’après tout, titiller imagination et souvenirs n’est-ce pas le rôle du romancier ?

Engagement pour avoir Engagement pour être Engagement de sa vie Engagement de la vie Engagement de moi Engagement des autres Dans ce monde du je, pourquoi être engagé ?
Engagement d’un peuple pour protéger son pays, d’un dictateur dont tous les pays ont peur, d’une menace pour eux quand tant de gens meurent, juste pour protéger les leurs. Voilà les vraies valeurs humaines… d’un peuple fier.

Aucune inspiration en vue
Je ne rigole pas Je veux écrire Les mots sont morts de rire +++
Je me lance, plonge en apnée Ma respiration est coupée Mon inspiration, saccagée Mon texte hachuré. +++
C’est plate à mort Un texte à moitié mort Un texte décharné Pourquoi insister ? +++

J’insiste N’ai pas de piste Tel un funambule Sur le fil de sa bulle
Par chance, les rimes Existent dans les crimes Je tue l’écriture C’est pas dans ma nature +++
Il n’y a pas de plaisir À parler pour parler À écouter sans désir À écrire pour le papier +++
Un dernier effort Mon ultime ressort +++
Je clos ce texte séraphin Mené pas à pas D’un souffle, que je n’avais pas !
MARIETTE MAILHOTVous, les musiciens

Quand ils seront vieux Qu’auront-ils de mieux Que de vivre heureux ? Ils auront vécu Le meilleur, le pire Ils auront connu Des joies, des soupirs
Il aura fallu Plus que des ouï-dire Pour croire au bonheur D’un amour sans heurts

Loin du coup de foudre Qui sonne et qui soude Restera fidèle
La douceur de l’aile De leurs souvenirs
Les jours à venir Pourront se surprendre De les voir si tendres
En fuyant les modes Leur culte et leurs codes Ils auront gardé La simplicité Qui noie l’illusion Ce puits noir sans fond

Quand ils seront vieux Encore amoureux Après tant d’années Sans avoir triché… Sans avoir fait semblant De dormir en amants
Ils auront laissé À tous les guindés À tous les mondains Leurs gris lendemains.
Le fla-fla L’apparat L’étalage Ce mirage La parure Cette armure…

Ils auront laissé Leurs jours de parade Le verbe et les tirades De personnages huppés
Quand ils seront vieux Qu’auront-ils de mieux Que la vie à deux ?
Quand ils seront vieux… Combien de matins Avant ce demain ?
Il n’est pas si loin…
Les fabuleries sont pleines de mensonges, mais elles sont nos propres fabulations.

On aime se laisser aller à fabuler… comme dans un beau conte. Pleines de pièges, de combats Et pleines de moments d’exaltation et de conflits. Elles font partie de la vie, Comme les grandes périodes de désespoirs.
Leurs parcours sont incohérents et imprévisibles Parfois, même, on préfère la sécurité Et le confort, Puis étape par étape On enfile l’histoire D’un beau conte pour enfants qu’on a inventé
Idéaliste, tout ça dans notre petite tête C’est nécessaire Pour se sortir de ses illusions Afin de devenir un adulte
Une chose est certaine et concrète C’est qu’un instant En plein cœur du conte On peut ressentir un sentiment de fierté Dont on n’a jamais eu l’autorisation. De vivre en soi

Et tout d’un coup, on se permet de se libérer de nos fabulations et de se donner le droit d’être une femme libre Qui est fière de l’être.
On arrête d’avoir peur que le ciel nous tombe sur la tête.

Quel chemin emprunte la pensée ? Répondre à cette question demande un effort d’attention, car les mots sont fuyants comme les veines de mon bras Les mots parcourent tout mon être pour aboutir finalement à la main La main étant le prolongement de la pensée il en résulte quelque chose à la fois unique et multiple C’est le propre du langage poétique

La poésie est un carrefour où l’on s’arrête à tout instant
FRANÇOIS GAGNONDans la nuit s’illuminent tel un bouquet de fleurs les étoiles. Elles lèvent leurs diaphanes voiles Sur la vie amoureuse des cœurs De tous les fiancés et de leurs réciproques bonheurs. Les jeunes et romantiques couples s’endorment sur de confortables nuages ouatés. Du paisible et doux Morphée. Ils pensent à leurs idylles passionnées. Qui les feront planées sur la plus belle des voies lactées. Ils meubleront d’espoir dans leurs nocturnes rêves Que jamais leurs amours ne s’achèvent.GAÉTAN DUVAL Crédit photo : Depositphotos Crédit photo : Pixabay


Service d’information et de référence qui vous dirige vers les ressources des régions de la Capitale-Nationale, de la Chaudière-Appalaches
Tél. : 2-1-1
Aide sociale
ADDS
Association pour la défense des droits sociaux 301, rue Carillon, Québec Tél. : 418 525-4983
Aide aux femmes
Centre d’aide aux victimes d’actes criminels (CAVAC) Formé pour vous épauler ! 418 648-2190 ou le 1 888-881-7192
Centre femmes aux trois A Pour la réorganisation sociale 270, 5e Rue, Québec Tél. : 418 529-2066 www.cf3a.ca
Centre femmes d’aujourd’hui Améliorer les conditions de vie des femmes 1008, rue Mainguy, Québec Tél. : 418 651-4280 c. f.a@oricom.ca www.centrefemmedaujourdhui.org
Regroupement des femmes sans emploi 418 622-2620 www.rosedunord.org
Support familial Flocons d’espoir Écoute et aide pour les femmes enceintes 340, rue de Montmartre, sous-sol, porte 4 Tél. : 418 683-8799 ou 418 558-2939 flocons.espoir@videotron.ca
Alphabeille Vanier 235, rue Beaucage, Québec Tél. : 418 527-8267 info@alphabeille.com www.alphabeille.com
Atout-lire 266, rue Saint-Vallier Ouest, Québec Tél. : 418 524-9353 alpha@atoutlire.ca www.atoutlire.ca
Le Cœur à lire 177, 71e Rue Est, Québec Tél. : 418 841-1042 info@lecoeuralire.com www.lecoeuralire.com
Lis-moi tout Limoilou 3005, 4e Avenue, Québec Tél. : 418 647-0159 lismoitout@qc.aira.com
La Marée des mots 3365, chemin Royal, 3e étage, Québec Tél. : 418 667-1985 lamareedesmots@oricom.ca membre.oricom.ca/lamareedesmots
Relais d’Espérance
Aider toute personne isolée et en mal de vivre 1001, 4e Avenue, Québec Tél. : 418 522-3301
Rendez-vous Centre-ville Centre de jour 525, rue Saint-François Est, Québec Tél. : 418 529-2222
Détresse psychologique
Centre de crise de Québec Tél. : 418 688-4240 ecrivez-nous@centredecrise.com www.centredecrise.com
Centre de prévention du suicide 1310,1 re Avenue, Québec Tél. : 418 683-4588 (ligne de crise) www.cpsquebec.ca
Tel-Aide Québec Tél. : 418 686-2433 www.telaide.qc.ca
Tel-Jeunes Tél. : 1 800 263-2266 www.teljeunes.com
Maison de Lauberivière
Pour hommes et femmes démunis ou itinérants 485, rue du Pont, Québec Tél : 418 694-9316 accueil.hommes@lauberiviere.org www.lauberiviere.org
Maison Revivre
Hébergement pour hommes 261, rue Saint-Vallier Ouest, Québec Tél. : 418 523-4343 maison.revivre@gmail.com maisonrevivre.weebly.com
SQUAT Basse-Ville
Hébergement temporaire pour les 12 à 17 ans 97, rue Notre-Dame-des-Anges, Québec Tél. : 418 521-4483 coordo@squatbv.com www.squatbv.com
Gîte Jeunesse
Hébergement temporaire garçons 12 à 17 ans
Résidence de Beauport 2706, av. Pierre Roy, Québec Tél. : 418 666-3225
Résidence de Sainte-Foy 3364, rue Rochambau, Québec Tél. : 418 652-9990
YWCA
Hébergement et programme de prévention de l’itinérance et de réinsertion sociale pour femmes Tél. : 418 683-2155 info@ywcaquebec.qc.ca www.ywcaquebec.qc.ca
Réinsertion sociale
Carrefour d’animation et de participation à un monde ouvert (CAPMO) 435, rue du Roi, Québec Tél. : 418 525-6187 poste 221 carrefour@capmo.org www.campo.org
Fraternité de l’Épi
Aide aux personnes vivant de l’exclusion par la création d’un lien d’appartenance 575, rue Saint-François Est, Québec Tél. : 418 523-1731
Maison Dauphine
Pour les jeunes de 12 à 24 ans 31, rue D’Auteuil, Québec Tél. : 418 694-9616 courrier@maisondauphine.org www.maisondauphine.org
Insertion professionnelle
À l’aube de l’emploi (Lauberivière) Formation en entretien ménager commercial/buanderie 485, rue du Pont, Québec 418 694-9316 poste 248 alaubedelemploi@lauberiviere.org
Recyclage Vanier
Emploi et formation (manutentionnaire, aidecamionneur, préposé à l’entretien) 1095, rue Vincent-Massey, Québec tél.. : 418 527-8050 poste 234 www.recyclagevanier.com
La Maison de Marthe 75, boul. Charest Est, CP 55004 Tél. : 418 523-1798 info@maisondemarthe.com www.maisondemarthe.com
P.I.P.Q.
Projet intervention prostitution Québec 535, av. Des Oblats, Québec Tél. : 418 641.0168 pipq@qc.aira.com www.pipq.org
Soupe populaire
Café rencontre Centre-Ville 796, rue Saint-Joseph Est, Québec (Déjeuner et dîner) Tél. : 418 640-0915
Maison de Lauberivière (Souper) 485, rue du Pont, Québec Tél. : 418 694-9316
Soupe populaire Maison Mère Mallet (Dîner) 945, rue des Sœurs-de-la-Charité Tél. : 418 692-1762
Santé mentale
Centre Social de la Croix Blanche 960, rue Dessane, Québec Tél. : 418 683-3677
centresocialdelacroixblanche.org info@centresocialdelacroixblanche.org
La Boussole Aide aux proches d’une personne atteinte de maladie mentale 302, 3e Avenue, Québec Tél. : 418 523-1502
laboussole@bellnet.ca www.laboussole.ca
Centre Communautaire l’Amitié Milieu de vie 59, rue Notre-Dame-des-Anges, Québec Tél. : 418 522-5719
info@centrecommunautairelamitie.com www.centrecommunautairelamitie.com
Centre d’Entraide Émotions
3360, de La Pérade, suite 200, Québec Tél. : 418 682-6070
emotions@qc.aira.com www.entraide-emotions.org
La Maison l’Éclaircie Troubles alimentaires 2860, rue Montreuil, Québec Tél. : 418 650-1076
info@maisoneclaircie.qc.ca www.maisoneclaircie.qc.ca
Le Pavois 2380, avenue du Mont-Thabor, Québec Tél. : 418 627-9779 Téléc. : 418 627-2157
Le Verger 943, av. Chanoine-Scott, Québec Tél. : 418-657-2227 www.leverger.ca
Ocean Intervention en milieu Tél. : 418 522-3352 Intervention téléphonique Tél. : 418 522-3283
Parents-Espoir 363, de la Couronne, bureau 410, Québec Tél. : 418-522-7167
Service d’Entraide l’Espoir 125, rue Racine, Québec Tél. : 418 842-9344 seei@videotron.ca www.service-dentraide-espoir.org Relais La Chaumine 850, 3e Avenue, Québec Tél. : 418 529-4064 chaumine@bellnet.ca relaislachaumine.org
Toxicomanie
Al-Anon et Alateen Alcoolisme Tél. : 418 990-2666 www.al-anon-alateen-quebec-est.ca Amicale Alfa de Québec 75, rue des Épinettes, Québec Tél. : 418 647-1673 alphadequebecinc@videotron.ca
Point de Repères 225, rue Dorchester, Québec Tél. : 418 648-8042 www.pointdereperes.com
VIH-Sida
MIELS-Québec Information et entraide dans la lutte contre le VIH-sida 625, avenue Chouinard, Québec Tél. : 418 649-1720
Ligne Sida aide : 418 649-0788 miels@miels.org www.miels.org
Le lundi 25 juillet, j’écoutais à la radio FM93, l’émission d’Élisabeth Crête et son invité Christian Pagé, journaliste aussi connu sous le nom de L’Enquêteur du paranormal. Lors de cette tribune téléphonique, ils ont abordé la question des signes que perçoivent certaines personnes après le décès d’êtres chers. Ce phénomène tabou a fasciné et fascine encore des gens de tous horizons. Le bouddhisme, la spiritualité autochtone, les religions polythéistes et monothéistes, la science quantique enseignent tous que notre âme continue à vivre et à évoluer après avoir quitté notre corps terrestre.
Les lignes téléphoniques étaient remplies, car les témoignages affluaient de plusieurs endroits du Québec et tout se passait dans une ouverture d’esprit, de cœur et de grand respect. Nous pouvions entendre les personnes qui étaient contentes de partager leur expérience sans être étiquetées par des gens bizarres ou hallucinés.
Les témoignages qui ont été partagés lors de cette émission étaient touchants et sincères. Ils m’ont fait penser aux signes que j’ai reçus personnellement. Par exemple, quand ma mère est décédée, à l’âge de 87 ans, j’ai rêvé qu’elle venait vers moi avec un beau sourire, habillée d’une robe blanche brillante, en tendant ses bras, pour me dire « je t’aime ». J’ai voulu aller vers elle pour que nous puissions nous enlacer, mais il y avait comme un obstacle invisible qui nous empêchait de le faire. Le matin, à mon réveil, j’entends la sonnerie de mon téléphone et c’est ma sœur qui m’annonce que notre maman est décédée dans son sommeil pendant la nuit. Mon père décédé centenaire m’a aussi donné des signes. Un merveilleux signe que j’ai reçu récemment. Le premier juillet était la journée de son anniversaire et je lui avais rendu un hommage sur Facebook afin que les membres de ma famille et mes amis(es) puissent le lire. Le lendemain, dans ma méditation du matin, je lui ai demandé de me donner un signe s’il était content. Ensuite, je me suis rendue chez mon coiffeur. Comme je suis arrivée un peu à l’avance, j’ai décidé de m’installer pas très loin de là, où se trouvaient quatre tables à pique-nique espacées. Il y avait un beau soleil, une petite brise, de l’ombre. J’étais seule à cet endroit. Je m’assois à une des tables et tout à coup, je vois une pierre ronde sur laquelle est peint à l’acrylique rouge un beau dessin composé de deux cœurs entourés d’une pluie de petits cœurs. J’ai senti que c’était un bon signe que mon père me donnait, en me démontrant que c’est l’Amour qui est essentiel, qui nous garde unis tous, tous ensemble.
Tous les beaux signes que nos êtres aimés nous envoient nous remplissent de gratitude et d’espérance que nous allons nous revoir. Ils nous font aussi comprendre que nos proches décédés veillent sur nous, nous protègent et savent que notre passage sur terre est rempli d’épreuves.

Bonjour Monsieur, Madame-Tout-le-Monde.

Je m’adresse à la population en général et je parle aux gens ordinaires.
Avez-vous déjà pensé qu’il n’y a pas que les prisonniers qui ne choisissent pas où ils vivent et ce qu’ils mangent ? Qui ne sont pas libre de leurs actions ? Ça n’arrive pas qu’à eux. Ça arrive aussi aux gens hospitalisés de force à Robert-Giffard, aux jeunes qui vivent en Centre Jeunesse ou en centre de réadaptation interne comme le Gouvernail. Ça arrive aussi aux personnes obligées de vivre dans des RAC (résidence à assistance continue), aux malades dans les hôpitaux ou aux personnes âgées qui vivent en résidence et en CHSLD.
Ne pas avoir sa liberté, être enfermé, ça fait monter toutes sortes d’émotions : de la colère, de la jalousie, de la tristesse. Comment on fait pour vivre ça ? Discuter avec les gens autour de nous peut aider. Collaborer avec nos intervenants et intervenants, infirmiers et infirmières, gardiens et gardiennes de prison, éducateurs et éducatrices, au lieu de les envoyer promener et d’être en mode révolte peut être facilitant. Et si c’est possible de sortir de l’institution, ben, avoir de bons comportements peut faire « avancer » notre dossier. Et si c’est possible, demander de l’aide pour gérer nos comportements et éviter les débordements, c’est le mieux à faire.
On peut avoir un petit pouvoir personnel sur la situation qu’on vit… Et ce qui fait une grande différence c’est de toujours garder espoir que ça va finir par aller mieux. Ce que je souhaite à tous !




15,7 millions. C’est notre retour à la communauté en 2022. C’est la somme qui permettra à près de 215 organismes de Québec et Chaudière-Appalaches de consolider leur mission essentielle. C’est le succès d’un mouvement collectif. C’est un pas de plus dans la lutte aux inégalités sociales. C’est la preuve qu’ensemble, unis, on ne laisse personne derrière.








Centraide. Aide. 215 organismes.
