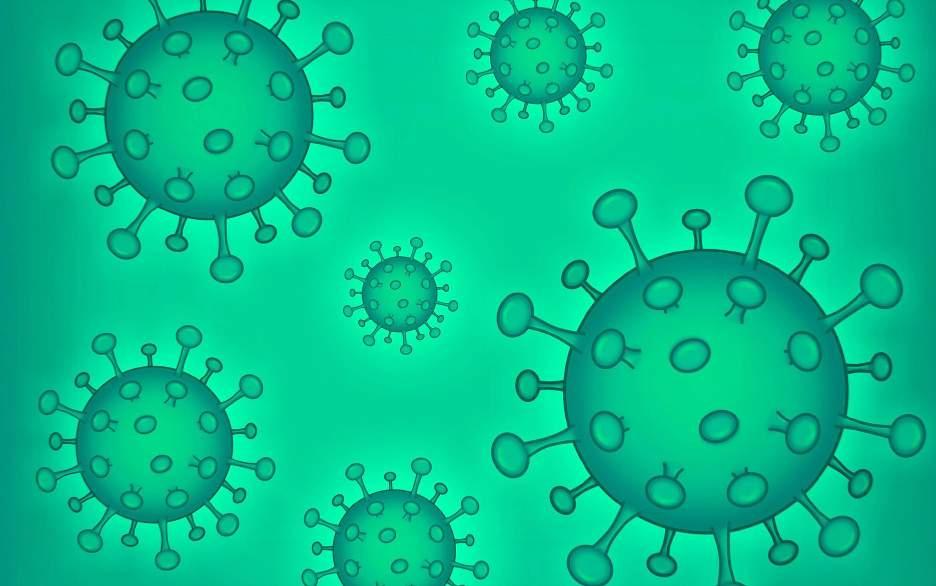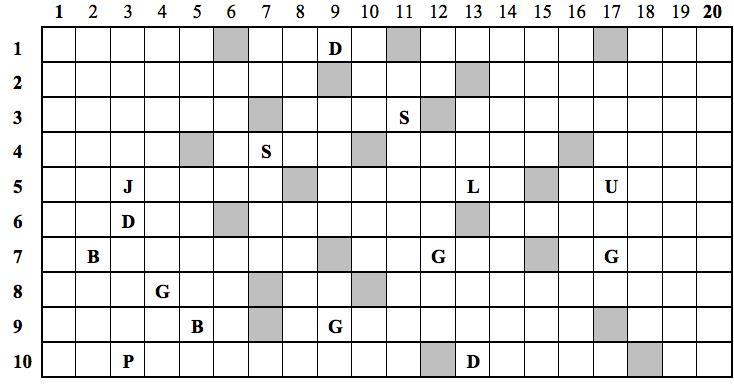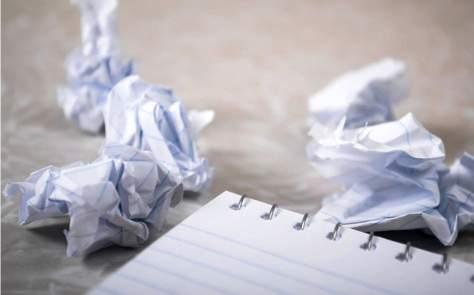Que les temps changent ! On dirait qu’hier encore la CAQ faisait couler de l’encre à profusion avec sa réforme de l’immigration et sa baisse des seuils d’immigrants, son nouveau Programme d’expérience québécoise (PEQ) et son fameux test des valeurs. Le contexte était aux antipodes de notre réalité postpandémique : en février 2020, le Québec enregistrait son plus bas taux de chômage depuis 1976 avec 4,5 % ! Six mois et une pandémie mondiale plus tard, l’échiquier de l’emploi québécois est déboussolé. Quel impact cela a-t-il eu sur les immigrants et les réfugiés ? Selon les données de Statistiques Canada, le taux de chômage a reculé de 1,2 point de pourcentage pour s’établir à 9,5 % en juillet, une baisse qui s’ajoute à celles observées au cours des deux mois précédents. Le taux de chômage se rapproche lentement de celui qu’on observait en février 2020, mais prendra assurément un certain temps à retrouver sa cadence, surtout dans des domaines comme l’aviation, les arts et spectacles, le tourisme, pour ne nommer que ceux-là. Pour nous aider à naviguer dans ces eaux agitées de l’immigration et de l’emploi, nous sommes allés à la rencontre de M. Jean-Paul Gélinas, directeur chez Service d’orientation et d’intégration des immigrants au travail (S.O.I.T), un OBNL qui se spécialise dans le recrutement et l’intégration des personnes immigrantes au marché du travail de la ville de Québec. Comment se porte la demande de main-d’œuvre à Québec?
« C’est une situation temporaire au niveau économique pour la plupart des secteurs. Pour les services, avec la distanciation sociale, c’est effectivement plus compliqué. Par contre, beaucoup de ces domaines étaient en situation de pénurie de main-d’œuvre avant la COVID-19 : restauration, hôtellerie, etc. Les entreprises manquaient de travailleurs et allaient en chercher à l’étranger.
08
Mais, en somme, ça dépend beaucoup des secteurs d’activités. Le secteur manufacturier, par exemple, a déjà commencé à recruter de la main d’œuvre. On y a récemment placé des immigrants pour des emplois permanents. Certains emplois qui étaient en carence pendant la pandémie le sont restés, on l’a vu quand le gouvernement a demandé aux Québécois d’aller travailler dans les champs : peu de Québécois ont répondu à l’appel. » Concrètement, quels ont été les impacts de la pandémie sur les immigrants ?
« La pandémie a créé des effets très pervers. Les plus grandes victimes ont été les travailleurs étrangers temporaires. Il y en a beaucoup qui venaient à Québec pour un emploi de deux ans et qui souhaitaient par la suite devenir résidents via le PEQ. Le ralentissement économique a fait en sorte que ces personnes ont été mises à pied. Du jour au lendemain, elles se retrouvaient sans emploi, sans PCU, sans filet social, et elles ne pouvaient pas retourner dans leur pays puisque les aéroports étaient fermés. Il y a aussi eu des problématiques avec les permis pour les étudiants étrangers. Les cours n’étant plus en présentiels, beaucoup ont dû retourner dans leur pays. Finalement, beaucoup de réfugiés suivaient des classes de francisation. Ces classes ayant été annulées, ils devaient les suivre en ligne, à la maison. Malheureusement, ce n’est pas tous les réfugiés qui avaient accès aux technologies nécessaires, alors vous comprenez le problème. » Et pour la suite ?
« Les différents problèmes qu’on observait avant la COVID-19 seront encore présents après. Environ 60 à 70 % des immigrants se concentrent à Montréal. Cela crée deux situations : une difficulté à arrimer la demande avec les compétences des immigrants dans la métropole et une carence de main d’œuvre aux demandes spécifiques en emplois des régions. LA QUÊTE
M. Jean-Paul Gélinas, directeur chez S.O.I.T
Crédit photo : Sébastien Agostini-Cayer
IMPACT DE LA PANDÉMIE SUR L'IMMIGRATION
Les immigrants qui s’installent à Québec ont une grande scolarité. Conséquemment, beaucoup de ceux-ci ont maintenu un statu quo en termes d’emploi : ils sont maintenant en télétravail à l’instar de beaucoup de Québécois, avec un retour intermittent au bureau dans les prochains mois. » Au final, il est difficile d’extrapoler avec confiance sur les conséquences qu’aura la pandémie sur le recul de la pénurie de main-d’œuvre et l’immigration. Comme l’a mentionné M. Gélinas, il faudra attendre plusieurs mois pour se faire une idée globale. Chose certaine, le dossier sera pertinent à suivre puisque beaucoup d’emplois dans la ville de Québec et les environs sont tributaires de l’intégration des immigrants, autant pour des emplois spécialisés que temporaires. Par exemple, tous les étés, les champs québécois accueillent une main-d’œuvre étrangère, des immigrants temporaires, qui viennent expressément pour labourer, planter et récolter. Cette année, la COVID-19 ayant forcé une fermeture partielle des frontières à cette main-d’œuvre précieuse, beaucoup d’agriculteurs ont dû embaucher localement. Bien qu’armée de bon vouloir et de détermination, cette main-d’œuvre locale amène inévitablement un coût d’inefficacité dans tout le processus, se reflétant sur le prix des aliments… parlez-en aux asperges ! SÉBASTIEN AGOSTINI-CAYER
OCTOBRE 2020