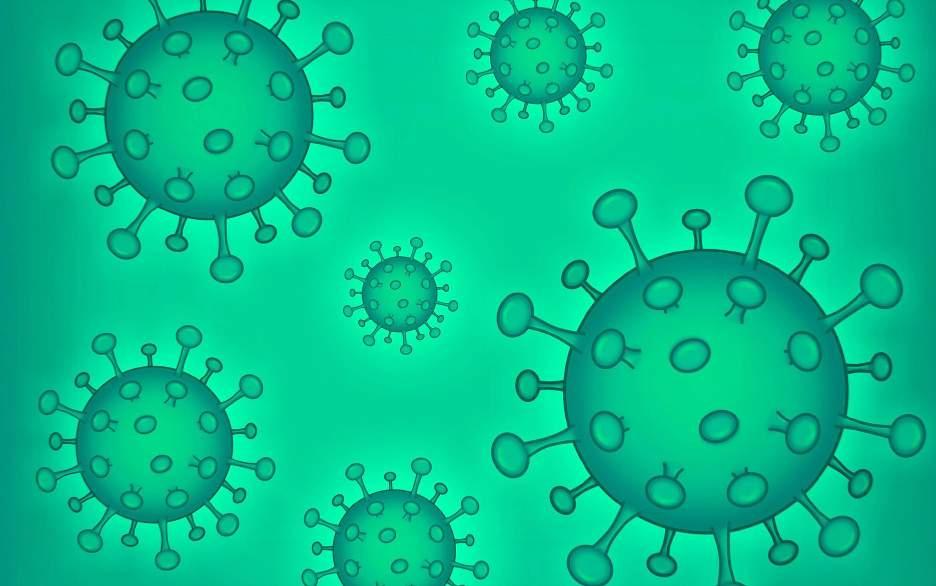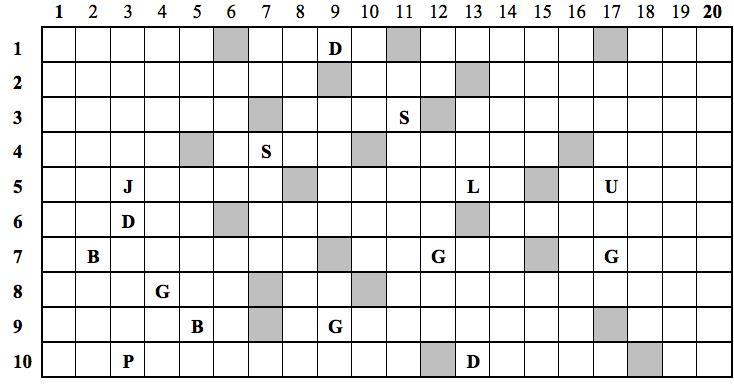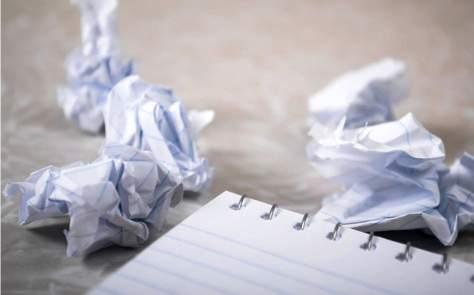PÉNURIE DE CONFIANCE Anti-masques, critiques de la science et des mesures de confinement, hauts cris contre la violation des libertés : la pandémie du coronavirus a exacerbé le discours individuel au détriment du collectif et de la protection des plus vulnérables. Comme si on vivait une sorte de « pénurie de bienveillance ». « Bienveillance? Je dirais plutôt pénurie de confiance », lance d’entrée de jeu le professeur à la Faculté de droit de l’Université Laval, LouisPhilippe Lampron. Spécialiste de la liberté d’expression et des droits individuels, il observe de près les phénomènes sociaux. Et la crise des derniers mois interpelle le juriste et le chercheur, mais aussi le citoyen en lui. Il ne cache pas son inquiétude face à la montée d’une minorité de plus en plus « décomplexée ».
Ceux qui croient que le coronavirus a été crée en laboratoire dans le cadre d’une vaste machination, ceux qui ont banalisé le nombre de morts de la COVID-19, insuffisant à leurs yeux pour justifier des mesures qui font mal à l’économie, ceux qui ne croient plus en rien et « font leurs recherches » basées sur des études scientifiques douteuses. On les entend de plus en plus. Car même si la polarisation ne date pas d’hier et que des discours de méfiance ont été observés lors de plusieurs débats passés, LouisPhilippe Lampron note une accélération depuis l’arrivée de Donald Trump à la présidence des ÉtatsUnis en 2016. « Cette pénurie, cette crise de confiance est alimentée par des attaques répétées envers les institutions », estime M. Lampron. Élus, médias, médecins, scientifiques, organisations mondiales, tout y passe.
Crédit photo : Louis-Philippe Lampron
« Quand un président dit que les médias et la politique sont là pour nous manipuler, on entre dans un cycle parano. Or, la démocratie repose sur la confiance et là, on a un président qui vient la fragiliser, la briser », illustre le chercheur.
Louis-Philippe Lampron, professeur à la faculté de droit de l'Université Laval
OCTOBRE 2020
Et le terreau devient alors fertile pour toute sorte de théories du complot et un règne de l’opinion où, à terme, plus aucun débat ne devient possible, chacun étant campé sur sa position au nom du « droit » de penser contre les scientifiques, par exemple. LA QUÊTE
« Ce que ça vient dire aux gens, c’est que leur opinion compte autant que celle des pseudo-experts qui, de toute façon, sont là pour nous manipuler », déplore M. Lampron. Une réalité amplifiée par les réseaux sociaux et les fameux algorithmes qui ne cessent de renvoyer des publications de gens qui pensent la même chose, créant ainsi une sorte de communauté en vase clos qui conforte les « antitout » dans leurs convictions. « Tout autre point de vue est alors décrédibilisé et les faits n’ont plus d’importance. » Espoir d’un dialogue possible
Mais si Louis-Philippe Lampron ne cache pas un certain découragement devant la montée de ces idées minoritaires et la crise de confiance qu’elles contribuent à alimenter, il martèle lors de l’entrevue à La Quête que tout n’est pas irréversible. Car ce discours demeure justement celui d’une minorité. « Je suis volontairement optimiste », lance-t-il en soulignant que la grande majorité des gens, au Québec comme ailleurs, respectent les mesures et croient encore en la science. « La minorité a une voix amplifiée, mais il ne faut pas tomber dans l’alarmisme », dit-il. Des pistes de solutions? Des rubriques de vérifications des faits, qui se multiplient dans les médias sont une bonne chose. « Il faut lutter contre la désinformation », dit-il. Le professeur de droit estime aussi que les réseaux sociaux ont en quelque sorte « montré leurs limites ». « Il faut trouver un nouveau modèle, pour éviter de créer des bulles. » Et ainsi, espère-t-il, l’espoir de rétablir le débat. VALÉRIE GAUDREAU
07