
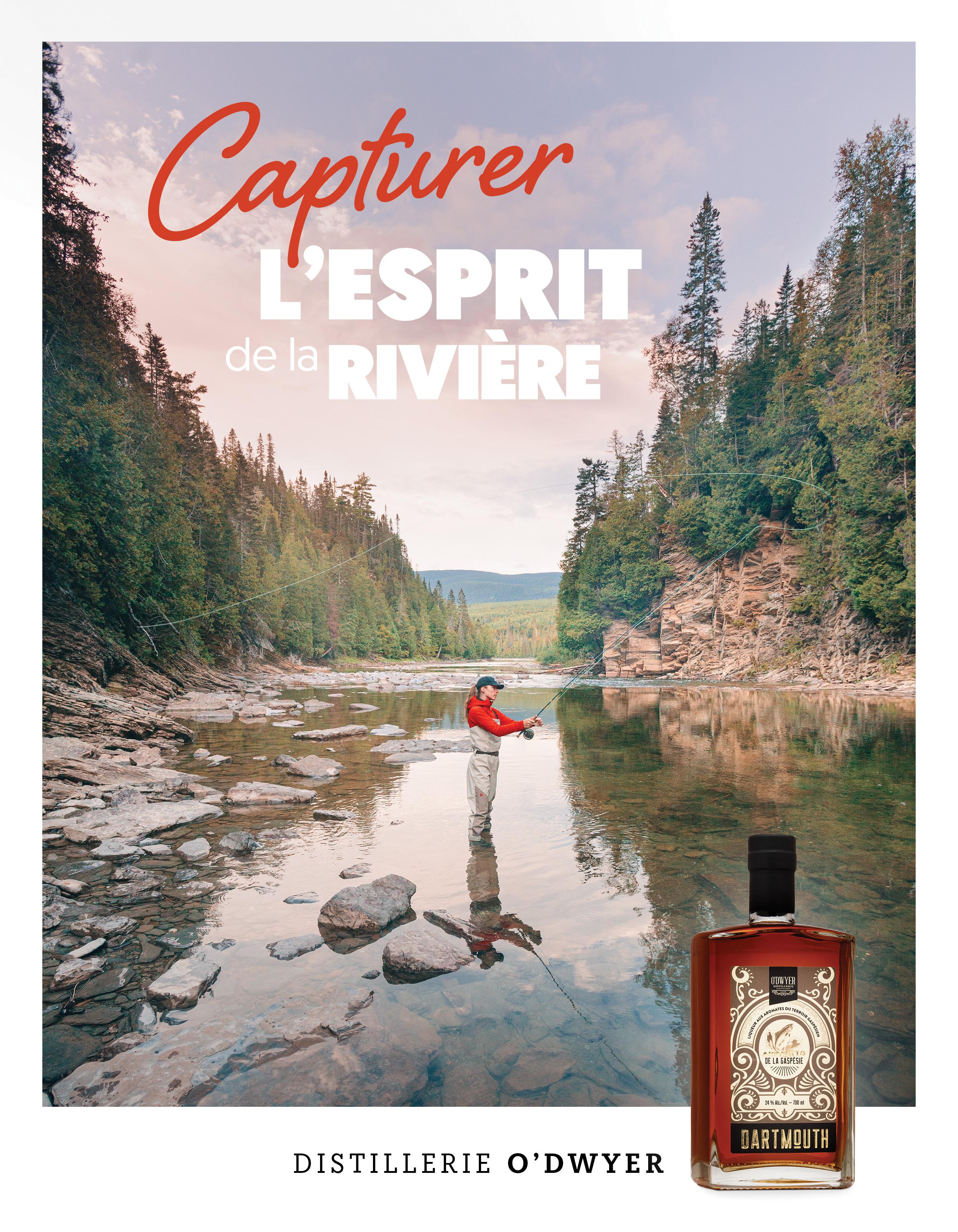


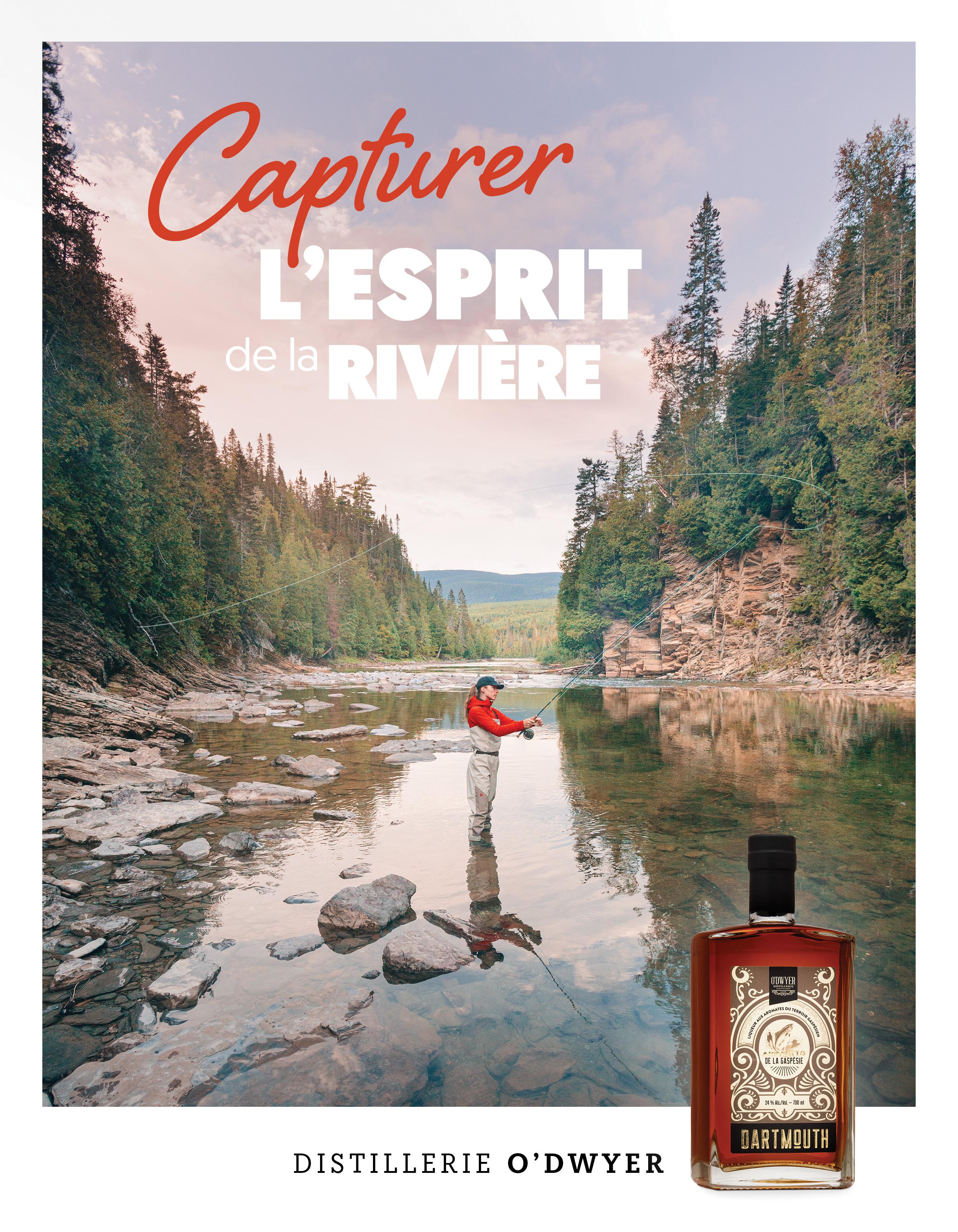
4 CHER MAGAZINE GASPÉSIE, C’EST À TON TOUR DE TE LAISSER PARLER D’AMOUR
Collectif
8 TERRAIN DE PRÉDILECTION POUR L’ÉTUDE DES PLANTES INDIGÈNES
Alexander Reford
10 MIGUASHA : UN ROI, UN PRINCE… ET DE TRÈS BELLES PLANTES
Paul Lemieux et Olivier Matton
11 L’EXPLORATION DES CHIC-CHOCS EN 1928
André St-Arnaud
15 DANS L’ŒIL D’UNE NATURALISTE
UNE FORÊT VIEILLE DE PLUS DE 650 ANS

Denis Michaud et Marie-Josée Lemaire-Caplette
Rachel Thibault
16 TRAITS BOTANIQUES REMARQUABLES DE FORILLON
Maxime St-Amour
19 DES PLANTES DU SUD AU NORD
Jean-Philippe Chartrand
22 LE FOIN SALÉ : UNE HERBE À TOUT FAIRE
Camillia Buenestado Pilon
25 MARCELLE GAUVREAU, INCONTOURNABLE DE L’ALGOLOGIE
André St-Arnaud
28 Photoreportage
ANNA LOIS DAWSON HARRINGTON, AQUARELLISTE
31 DISTILLER LA GRANDEUR
ELSIE REFORD : EXOTIQUE ET NATURALISÉE
Alexander Reford
Nos évènements
MITTERRAND EN GASPÉSIE

Robert Tremblay
Couverture
Épilobes (Epilobium angustifolium) sur l’île Bonaventure, parc national de l’Île-Bonaventure-et-du-Rocher-Percé.
Jean-Philippe Chartrand
Éditeur
Frédéric Jacques
32 LE JARDIN POTAGER, UN PATRIMOINE NATUREL

André Babin et Laurie Beaudoin
35 LE POTAGER DE MA GRAND-MÈRE AU PETIT ÉCRAN
Allen Synnott et Marie-Josée Lemaire-Caplette
41 Nos archives
LE TRAITEMENT DES ARCHIVES, UNE ACTION IMPORTANTE ET PRÉCIEUSE
Marie-Pierre Huard
43 Nos objets DES OUTILS À LA TONNE : LA FABRICATION DES TONNEAUX
Vicky Boulay
45 Nos personnages
FRANK NARCISSE JEROME : UN DES MILITAIRES LES PLUS DÉCORÉS… ET OUBLIÉS
Tom Eden
47 Nos Gaspésiennes
LA MAJOR (RETRAITÉE) PAULETTE BROUSSEAU
Jacques Bouchard
Avril – Juillet 2023
N° 206, volume 60, numéro 1
Éditeur : Musée de la Gaspésie
Fondé en 1963, le Magazine Gaspésie est publié trois fois par an par le Musée de la Gaspésie. Le Magazine vise la diffusion de connaissances relatives à l’histoire, au patrimoine culturel et à l’identité des Gaspésiennes et des Gaspésiens. Il est membre de la Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP).

Comité de rédaction
Marie-Pierre Huard, Gabrielle Leduc, Marie-Josée Lemaire-Caplette, Paul Lemieux, Élaine Réhel et Jean-Philippe Thibault
Abonnements et ventes
Eileen Fortin-Lansloot
418 368-1534 poste 104 boutique@museedelagaspesie.ca
Rédactrice en chef
Marie-Josée Lemaire-Caplette
418 368-1534 poste 106 magazine@museedelagaspesie.ca
Coordination et publicités
Gabrielle Leduc
418 368-1534 poste 102 coordo.direction@museedelagaspesie.ca
Recherche iconographique
Marie-Pierre Huard
418 368-1534 poste 103 archives@museedelagaspesie.ca
Rédaction et collaboration
André Babin, Laurie Beaudoin, Jacques Bouchard, Vicky Boulay, Camillia Buenestado Pilon, Jean-Philippe Chartrand, Tom Eden, Marie-Pierre Huard, Frédéric Jacques, Paul Lemieux, Olivier Matton, Denis Michaud, Alexander Reford, Maxime St-Amour, André St-Arnaud, Allen Synnott, Rachel Thibault et Robert Tremblay
Conception graphique et infographie
Maïlys Ory | Graphiste
Révision linguistique
Robert Henry
Distribution en kiosque
Jean-François Dupuis
Impression
Deschamps Impression
Plateforme numérique magazinegaspesie.ca
Dépôt légal
Bibliothèque et Archives Canada, ISSN 1207-5280 (imprimé)
ISSN 2561-410X (numérique)
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ISBN 978-2-924362-30-3 (imprimé)
ISBN 978-2-924362-31-0 (pdf)
Copyright Magazine Gaspésie
Reproduction interdite sans autorisation
Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada.
Toute personne intéressée à faire paraître des textes conformes à la politique du Magazine Gaspésie est invitée à les soumettre à la rédactrice en chef. Celle-ci soumet ensuite une proposition d’articles au comité de rédaction.
Le Magazine Gaspésie n’est pas un média écrit d’opinion, mais encourage le pluralisme des discours pour autant qu’ils reposent sur des fondements. Les autrices et auteurs ont la responsabilité de leurs textes. Seuls les textes où cela est spécifiquement mentionné relèvent de l’éditeur.
Les textes sont écrits de manière inclusive afin de refléter son objet et son approche. Le vocabulaire épicène est utilisé autant que possible. Les textes appliquent la règle de féminisation par dédoublement et les graphies tronquées à l’aide de points médians. L’accord de proximité est utilisé à des fins de lisibilité.
Droits d’auteur et droits de reproduction
Toutes les demandes de reproduction doivent être acheminées à : Copibec (reproduction papier) : 514 288-1664 | 1 800 717-2022 | licences@copibec.qc.ca
Abonnement
1 an (3 nos) : Canada, 30 $ ; É.-U., 56 $ ; Outre-mer, 79 $ (taxes et frais de poste inclus)
Vente en kiosques
Prix à l’exemplaire : 10,50 $ (taxes en sus) - Liste des kiosques sur le site Web
Magazine Gaspésie
80, boulevard de Gaspé, Gaspé (Québec) G4X 1A9 418 368-1534 poste 106
magazine@museedelagaspesie.ca magazinegaspesie.ca
LeMagazineGaspésieesttout en couleurs grâceaux caisses Desjardins delaGaspésie.
Planche de la Marguerite blanche, une espèce longtemps considérée comme une mauvaise herbe, entre 1909 et 1929.

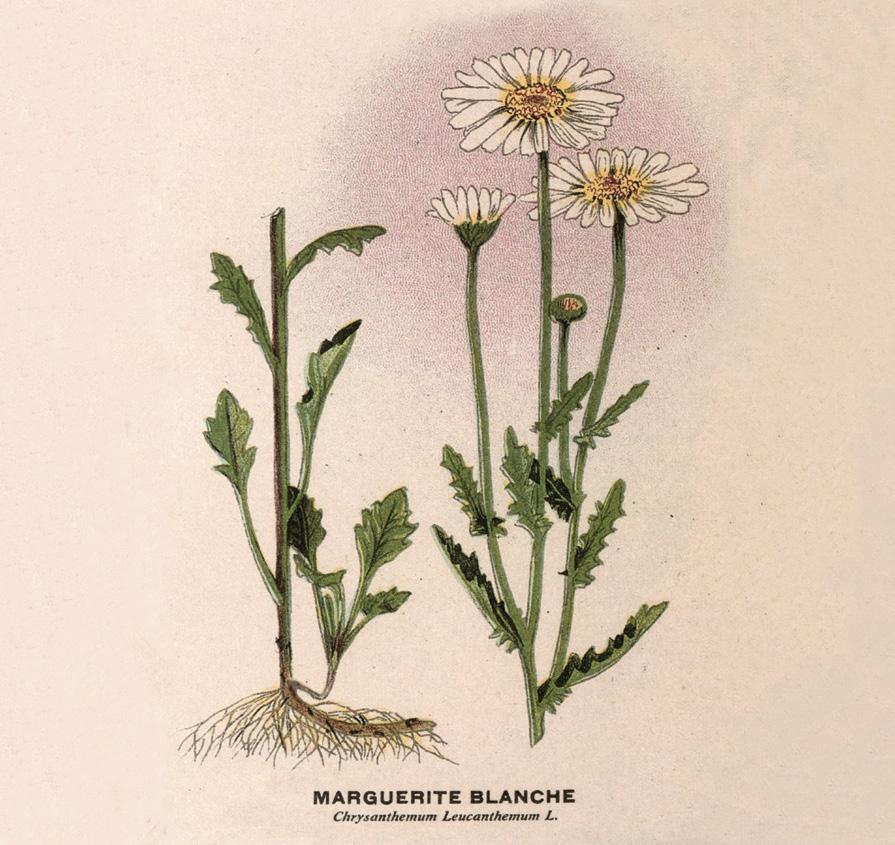
Illustration tirée de : Mauvaises herbes – Farm Weeds, affiche, ministère de l’Agriculture, entre 1909 et 1929; ANQ, AFF B 00003474 CON.
Avec ses forêts majestueuses et ses sous-bois, ses rivières cristallines et ses rivages, ses montagnes grandioses et ses hauts sommets, sa mer imposante et ses grèves, la Gaspésie est un espace propice à une végétation variée, tant terrestre qu’aquatique, allant de l’Érable à sucre au lichen, en passant par les algues. Ce n’est pas pour rien que depuis presque deux siècles, les scientifiques s’intéressent à cette nature féconde.
Les plantes et les végétaux sont bien vivants : ils migrent, prolifèrent, disparaissent… De nombreuses espèces sont présentes sur le territoire depuis des centaines, voire des milliers d’années. Leur histoire est aussi la nôtre, forgeant les paysages, créant de l’emploi, nourrissant la population, soignant ses maux, fournissant les matériaux pour la fabrication d’objets… La botanique est une science descriptive et expérimentale. On identifie et classe les spécimens, mais on étudie également ses usages. Il reste encore beaucoup à faire pour comprendre, conserver et mettre en valeur cette flore, et ce, tant sur les plans botanique, historique, gastronomique que patrimonial.
Le présent numéro n’est qu’une petite brèche dans ce monde
Oui, en vérité, il n’est pas exagéré de dire que celui qui n’a jamais regardé la grande Nature ne connaît rien; que celui qui n’a jamais dirigé une loupe ou un microscope dans le cœur d’une fleur n’a jamais vécu.
Frère Marie-Victorin, auteur de Flore laurentienne et fondateur du Jardin botanique de Montréal
LISEZ L’ARTICLE LES EXPLORATION DE MARIE-VICTORIN EN HAUTE-GASPÉSIE, PARU EN 2009
végétal qui nous entoure, des premières explorations à l’algologie, des plantes arctiques-alpines aux forêts anciennes, des champignons sauvages aux jardins potagers, sans oublier les jardins privés dont un des plus nordiques en Amérique du Nord se trouve ici avec les fabuleux Jardins de Métis.
Il y a un bon moment déjà que nous
réfléchissons à appliquer l’écriture inclusive aux textes des numéros. Bien que cela représente quelques défis et une adaptation de part et d’autre, il est temps d’amorcer le processus. Sans doute imparfaite, cette manière de rédiger les textes se veut une approche évolutive.
L’année 2023 marque les 60 ans du Magazine Gaspésie, une des plus vieilles revues d’histoire au Québec. C’est avec enthousiasme que nous amorçons cette année de festivités pour ce joyau du patrimoine régional. Nous partageons notre fierté avec toute l’équipe d’artisans·es passée et présente. Bon anniversaire Magazine Gaspésie, et surtout, nous te souhaitons une vie longue et riche d’histoires!
Rédactrice en chef du Magazine Gaspésie, Musée de la Gaspésie
Champ de Marguerites blanches, une espèce très répandue en Gaspésie, 1930. Musée de la Gaspésie. Collection Chantal Soucy. P247/2/5Le premier numéro de la Revue d’histoire de la Gaspésie est publié le 22 février 1963 par la Société historique de la Gaspésie fondée quelques mois plus tôt. Au fil de ses 60 ans, les Gaspésiennes et les Gaspésiens d’origine, d’adoption et de cœur ont créé un lien fort, voire même un lien d’amour avec le Magazine Gaspésie. La petite et grande histoire de la péninsule intéresse et séduit de génération en génération. Le souhait initial est ainsi exaucé : « […] nous lançons notre Revue d’histoire afin d’établir un contact, un trait d’union entre tous les Gaspésiens. »1. Afin de souligner ce 60e anniversaire, nous vous laissons donc la parole.
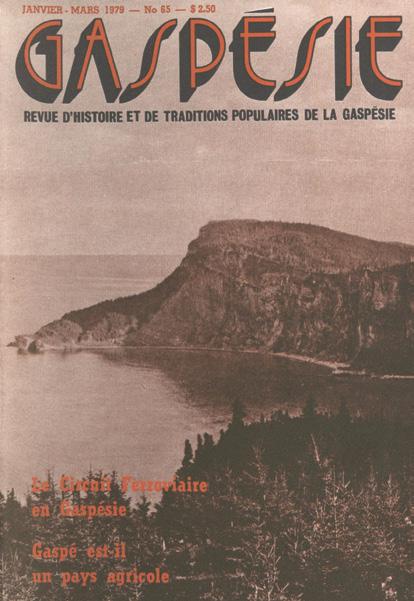
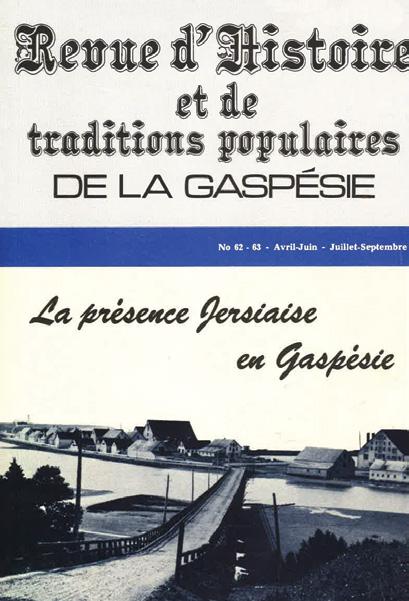
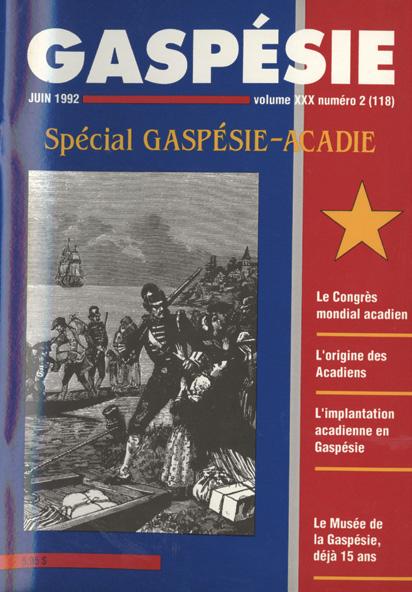
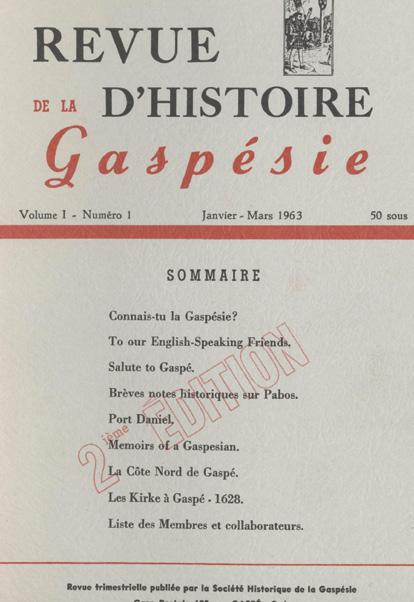
Je suis née en 1923 à Carleton-sur-Mer. Le Magazine m’a plu dès le début parce que j’aime l’histoire passée, présente et à venir. Les découvertes très bien documentées sur les premières Gaspésiennes et les premiers Gaspésiens, leur vie pénible, leur environnement en sol nouveau, etc. J’étais et je suis fascinée par ces pages de « mon histoire ». Tous les sujets sont traités avec intelligence et profondeur. Merci! C’est par la revue que j’ai connu la Gaspésie au complet, toujours de belles découvertes pour étoffer les thèmes variés, bien situés dans l’espace et le temps.

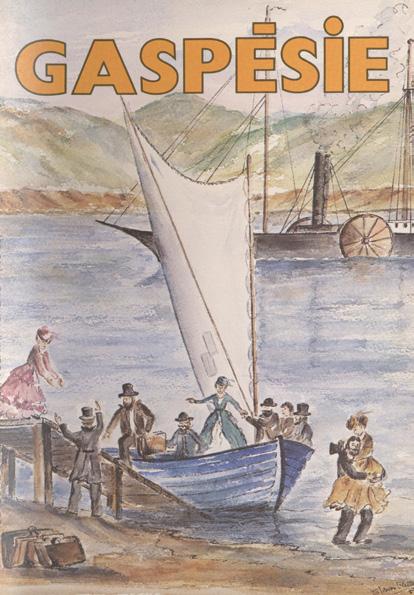
J’ai eu le privilège de passer trois ans à l’École normale des Ursulines à Gaspé. Avec ses chroniques, le Magazine Gaspésie nous a situées dans l’histoire.
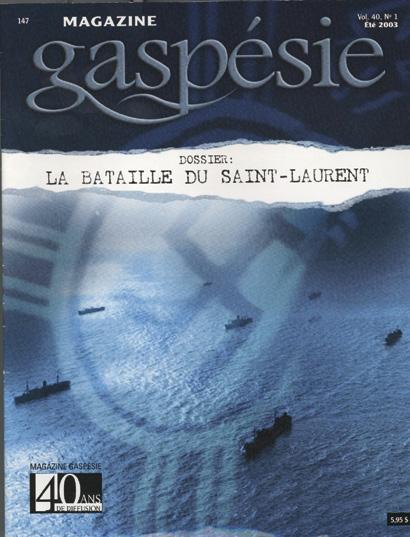
Dans les années 1960, mon mari, moi et nos deux garçons avons fait le tour de la Gaspésie en camping, assistés de références judicieuses du Magazine à partir duquel un itinéraire intéressant pour la famille s’est organisé. Le Magazine Gaspésie a étoffé nos vacances, merci!
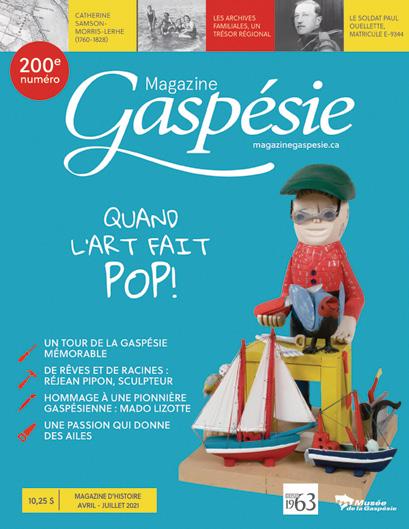
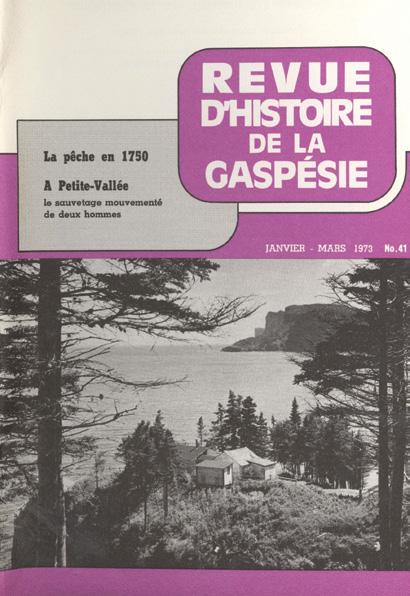
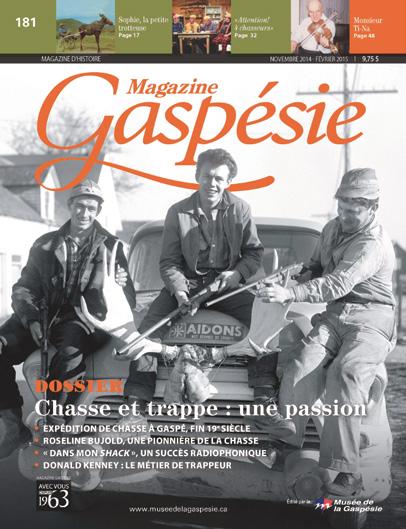
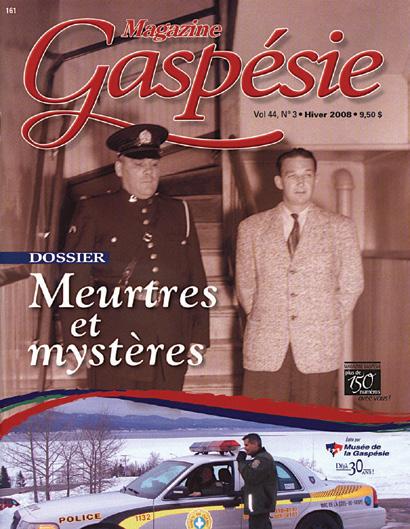
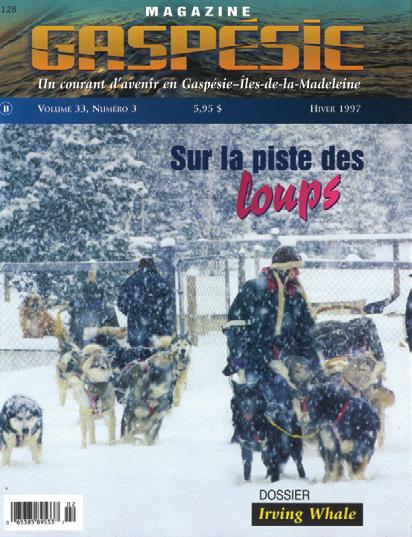
Nous sommes fiers d’avoir participé au numéro Toucher du bois. « Omer Poirier : une décennie à bûcher et draver du bois. » retrace une étape importante de sa vie passée en forêt. Un bel hommage et surtout un héritage pour la famille! Omer, avec son talent de conteur, son humour et sa grande mémoire ont fait de cette expérience un moment d’échanges très agréable et mémorable. Il est fier d’avoir partagé son vécu. Il s’est remémoré des instants qu’il qualifie d’incroyables, mais de vrais! Et en toute modestie, il ajoute que malheureusement beaucoup de ses collègues ne sont plus là pour valider et bonifier ses propos.
1963. J’ai 13 ans et j’étudie au Séminaire de Gaspé. Un jour, mon prof d’histoire, l’abbé Michel LeMoignan, demande aux élèves demeurant à Gaspé de rester après la classe. Et là survient la grande demande : vendre des abonnements à une revue d’histoire qui est en train de naître en Gaspésie. Mon secteur, la côte du San, où je cognerai aux portes avec mon discours de vente malhabile. Sans trop de succès d’ailleurs, si je me souviens bien.
Soixante ans plus tard, le Magazine Gaspésie fait toujours partie de ma vie. J’en possède une collection complète (enfin presque…), ai signé une bonne quinzaine de textes dans ses pages et siège au comité de rédaction en tant qu’historien. Bon 60e au Magazine!
Omer, Suzette et Yves Poirier Résidents de Saint-Siméon
Par un matin d’été 1971, alors que je suis en visite à Grande-Rivière chez mes grands-parents maternels, bien assis dans la vieille berceuse, mon regard est attiré par une revue que je décide de feuilleter. J’ai souvenance que mon grand-père m’a dit : « Cette revue, c’est un petit cadeau que Michel [LeMoignan, un ami de la famille] nous a offert il y a quelques années. ». Il s’agissait d’un exemplaire du tout premier numéro de la Revue d’histoire de la Gaspésie.
Paul Lemieux Originairede Gaspé et résident de Carleton-sur-Mer
Bon anniversaire, Magazine Gaspésie! Cette publication est pour moi un outil de référence fort utile qui me permet d’approfondir certains sujets, d’en apprendre plus sur plusieurs artistes de la région (par exemple) et de découvrir avec beaucoup d’intérêt ces femmes et ces hommes qui ont contribué à façonner la Gaspésie, celle d’hier et celle d’aujourd’hui.
À travers les nombreux numéros du périodique et grâce à la qualité des textes de ses contributrices et contributeurs, je suis sans cesse étonnée par la richesse de la petite et de la grande histoire de la Gaspésie. Longue vie au Magazine Gaspésie!
Marie-Claude Tremblay
Chroniqueuse culturelle, Radio-Canada Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Une quinzaine d’années plus tard, alors en visite chez une cousine à Percé, confortablement assis dans un fauteuil, ma main droite fouille dans son porte-journaux et sort quatre numéros du Magazine que je lui emprunte. Puis, au début des années 2000, au Musée de la Gaspésie, j’achète plusieurs numéros et je m’abonne au Magazine Gaspésie! Dans les jours qui suivent, le hasard fait si bien les choses, je rencontre Jeannine LeMoignan, la sœur de Michel, qui accepte de me donner une trentaine des premiers numéros de la revue, du butin rare… Puis récemment, une de mes institutrices d’enfance que je visite toujours me remet plusieurs numéros pour enrichir ma collection.
Enfin, au fil des évènements, j’ose écrire quelques historiettes qui y seront publiées et à l’occasion, je me paie le plaisir d’offrir des abonnements en cadeau à des proches!
Jacques Desbois Résident de Cap-ChatUn jour, je passe à la boutique du Musée de la Gaspésie, car je souhaite offrir un abonnementcadeau pour Noël. J’en profite pour chercher parmi les anciens numéros afin de trouver ceux qui manquent à ma collection.
Alors que je feuillette un vieux numéro, je trouve une enveloppe… adressée à ma grand-mère! Je l’ouvre et y trouve une lettre que ma tante a écrite à sa mère. Imaginez la chance insigne que la lettre se retrouve entre mes mains!
Quoiqu’invraisemblable, cette histoire est bien vraie!
Je suis une fervente et fidèle abonnée du Magazine Gaspésie depuis son tout premier numéro en 1963. Son arrivée dans ma boîte aux lettres est chaque fois reçue avec émotion, comme une vieille amie qui vient raviver et enrichir mes souvenirs de Gaspésienne.
Depuis 60 ans, le Magazine Gaspésie, sous ses différentes formes, a su me démontrer la richesse de mes racines. Il a nourri ces dernières, alimentant ainsi mon indéfectible amour pour le pays de mes origines, pays qui est pour moi à la fois père et mer.
Merci aux bâtisseuses et bâtisseurs de la première heure, maintenant disparus, et à celles et ceux qui ont si vaillamment su reprendre la barre sous tous les vents.
Charlotte LeclercOriginaire de Carleton-sur-Mer
D’où vient mon intérêt pour l’histoire? De descendance acadienne, ma mère Marguerite Leblanc avait une mémoire fabuleuse. Elle avait une facilité à défricher la parenté et à raconter des histoires. Avec seulement une 3e année, elle écrivait presque sans fautes et, pendant qu’elle surveillait sa fournée de pain, elle lisait assidûment la Revue d’histoire de la Gaspésie.
Ensuite, elle prenait plaisir à relater de façon imagée ce qu’elle venait d’y lire et terminait son récit en puisant dans son bagage reçu par transmission orale. Fasciné par la passion de cette mère pour le passé, j’eus dès mon adolescence (années 1960) la piqûre de l’histoire. Ceci dicta l’orientation de ma carrière d’historien, et est un beau clin d’œil au poste de rédacteur en chef du Magazine que j’occuperai plus tard, de 2004 à 2018.
Jean-Marie FalluOriginaire de Carleton-sur-Mer et résident de Douglastown
Depuis la création du Magazine, des copies se sont accumulées d’année en année. Un constat devient évident, un mécanisme doit se mettre en place pour distribuer ces trésors. Le Musée de la Gaspésie décide alors de mettre sur pied un comité de relance. La première réunion a lieu en 2006, nous sommes cinq membres au démarrage et le Magazine compte 300 abonnements. Nous nous fixons un audacieux objectif d’aller chercher 2 000 abonnements!
Notre stratégie se précise : impliquer des collaboratrices et collaborateurs partout en Gaspésie et même au Québec. Les contacts se multiplient, les appels se font, des lancements personnalisés se créent sur le territoire… L’esprit de camaraderie est vraiment présent, beaucoup de plaisir et de rires dans ce groupe, on se lance même des défis, qui vendra le plus de magazines? En 2011, c’est avec beaucoup d’émotions que le comité dévoile le chiffre symbolique de 2 000 abonnements atteints.
Avec le recul, je constate l’importance du travail bénévole dans une communauté et l’impact significatif qu’il a eu pour l’essor de la revue. Encore en 2023, plusieurs bénévoles sont présents pour veiller au maintien du Magazine Je suis fière d’y avoir consacré plusieurs années avec mes collègues. Bon 60e! Longue vie au Magazine!
Eileen Adams Résidente de GaspéAu début de l’année scolaire 2018-2019, le Magazine Gaspésie a contacté l’école Antoine-Roy à Rivière-au-Renard afin de solliciter la participation des élèves pour son numéro Fabuleuses légendes. Ils sont alors à la recherche d’illustrations pour accompagner les textes. Ironiquement, nous n’offrions pas de cours d’arts plastiques, mais nous trouvions l’occasion trop belle pour la laisser passer. Au fil des discussions, une simple demande d’illustrations est transformée en un projet d’envergure touchant tous les élèves du 2e cycle.
Ainsi est né, dans notre école, le projet Fabuleuses légendes : La légende (inconnue) du cap Bon-Ami. En collaboration avec le Magazine, Annick Paradis et moi organisons un concours d’écriture parmi les élèves du cours de français de secondaire 3 où les légendes sont étudiées. Le texte gagnant est ensuite publié dans le numéro 194, puis adapté en chanson par Mathieu Joncas et les élèves de secondaire 4. Celle-ci est enregistrée au studio de la Vieille Usine de L’Anse-à-Beaufils et les élèves de secondaire 5 prennent en charge le tournage du vidéoclip avec l’aide de Nathalie Daraîche. Finalement, les élèves du cours de communication en secondaire 5 organisent le lancement du numéro du Magazine à l’école Antoine-Roy. Pour cette soirée, plusieurs membres de la communauté sont présents et nous avons l’honneur de nous faire raconter la légende par Jean-Raymond Châles.
Pour couronner le tout, ce projet a remporté un prix reconnaissance Essor dans la catégorie Passeur culturel, remis par le ministère de l’Éducation et celui de la Culture et des Communications.
Philippe Meunier
Enseignant de français à l’école C.-E.-Pouliot

L’inventaire des plantes, oiseaux et animaux de la Gaspésie est l’un des premiers mandats rattachés à la Commission géologique du pays. Lors de la création du nouveau Parlement uni du Haut et du Bas-Canada, la Commission est chargée de fournir « une description complète et scientifique des roches, des sols et des minéraux du pays »1. Lors de sa fondation en 1842, William Edmond Logan (1798-1875) est nommé pour diriger la recherche. La première région qu’il explore est la Gaspésie.
Alexander RefordLes journaux des expéditions de Logan de 1843 et 1844 révèlent l’endurance de ce géologue pionnier alors qu’il escalade le littoral, les falaises et les pentes abruptes, aidé par un jeune M. Stevens de Bathurst, au Nouveau-Brunswick, et un guide des Premières Nations, John Basque, qui les suit en canoë. Ce n’est qu’au cap Bon Ami qu’il trouve une maison accolée d’un « premier petit jardin avec les premières fleurs que j’ai vues dans cette partie du monde, en plus d’une abondance de choux et de pommes de terre ». Il rapporte la décevante nouvelle à son mécène gouvernemental selon laquelle la région n’a pas de charbon, mais est riche en fossiles.
À ses débuts, la géologie est un domaine d’étude et ses premiers praticiens sont des naturalistes fascinés par le monde naturel. Ils enregistrent la faune et la flore de la région par intérêt personnel et professionnel. Leurs conclusions sont

présentées dans des rapports gouvernementaux et devant la Société d’histoire naturelle de Montréal. La publication On the Natural History of the Lower St. Lawrence and the Distribution of Mollusca of Eastern Canada (1859) de Robert Bell (18411917) est le fruit de son expédition pour la Commission géologique en 1857 et 1858. Fade inventaire de mammifères, de poissons, de mollusques et de la flore, l’ouvrage offre néanmoins une liste de référence des espèces de l’est du Québec observées avant que la colonisation ne s’installe. Les premiers excursionnistes en Gaspésie font parfois des remarques sur les plantes cultivées. Dans Canadian Scenery District of Gaspé de 1866, Thomas Pye commente la fertilité du sol et le succès des agriculteurs du bassin gaspésien dans la culture de légumes racines et de céréales. « Mais… l’agriculture n’est pas systématique et très en retard pour l’époque, toute l’énergie
des gens étant consacrée à l’ingrédient de base de l’industrie - la pêche. »

Des scientifiques de partout en Gaspésie
Les observations de Logan sur la flore alpine des Chic-Chocs amènent d’autres géologues et botanistes à suivre ses pas. Parmi eux,
William Edmond Logan, My tent, 1843. Les journaux de Logan contiennent des notes, mais également des croquis tels que celui-ci. Illustration tirée de : Bernard James Harrington, Life of Sir William E. Logan... first director of the Geological Survey of Canada, Montréal, Dawson Bros., 1883, p. 152.
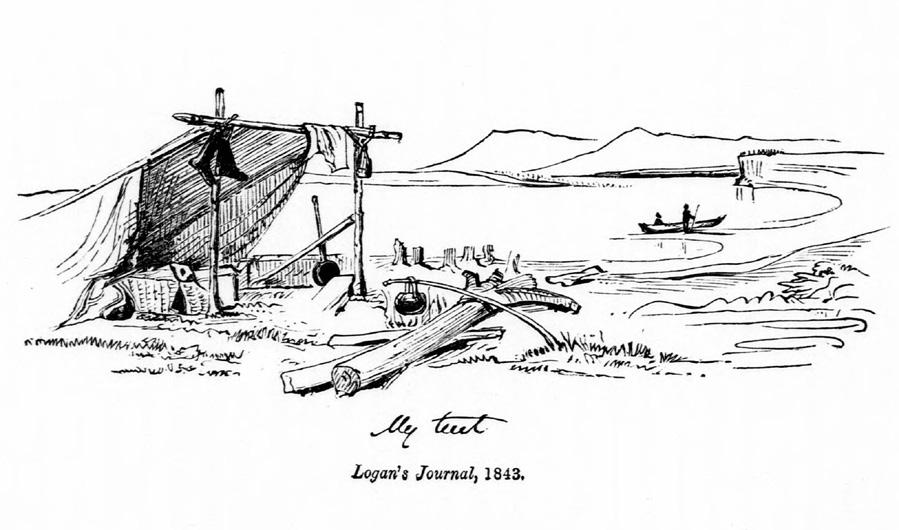
John Alpheus Allen (1863-1916), étudiant à l’Université Yale, s’aventure vers le nord en 1881 dans le cadre d’une fête botanique et inventorie 59 plantes sur le mont Albert et dans les environs de Sainte-Annedes-Monts et de Matane. L’année suivante, John Macoun (1831-1920) de la Commission géologique du Canada recueille aussi un grand nombre d’échantillons de la flore arctique sur le mont Albert pour l’Herbier national du Canada; il est devenu à moitié délirant lors de la prospection de plantes à cause des piqûres de mouches noires.
En 1876, John William Dawson apporte un nouveau dynamisme à l’observation scientifique dans la région en se faisant construire une résidence à Métis-sur-Mer. Il y passe l’été chaque année jusqu’à sa mort en 1899. Dawson est géologue et son travail de paléobotaniste lui vaut des éloges et une mention dans la publication historique de Darwin en 1860, L’Origine des espèces. C’est à Métis, pendant ses vacances, qu’il écrit certains de ses articles scientifiques (dont plusieurs s’opposent à la théorie de la sélection naturelle de Darwin). Il observe le rivage lors d’excursions quotidiennes avec son marteau de roche et son sac de collecte. Ses spécimens sont déposés au Musée Redpath de l’Université McGill où il est directeur. L’intérêt de Dawson pour les plantes fossiles laisse croire que la flore vivante n’est pas d’une importance primordiale. Il offre sa curiosité scientifique aux membres de sa famille qui partagent sa passion pour le monde naturel. Son fils George Mercer Dawson deviendra un géologue réputé alors
que sa fille, Anna Lois, illustre ses articles.
L’étude de la botanique dans les institutions universitaires favorise les expéditions végétales à travers le monde. Des endroits isolés comme la Gaspésie intéressent particulièrement pour la recherche de populations non perturbées de plantes indigènes. Le botaniste de Harvard Merritt Lyndon Fernald (1873-1950) fait de la Gaspésie l’un de ses domaines de recherche à partir de 1904 avec une série d’expéditions pour identifier de nouvelles espèces. La flore alpine unique est au cœur de sa théorie (maintenant rejetée) selon laquelle les 300 plantes endémiques de la région du golfe du Saint-Laurent non trouvées le long des hautes terres des Appalaches sont le résultat du fait que la région a échappé à la dernière phase de glaciation. Le frère Marie-Victorin s’est appuyé sur le travail de Fernald pour son livre Flore laurentienne (1935) et pour éclairer sa propre herborisation dans la région où il fait plusieurs séjours. Il entretient d’ailleurs une correspondance régulière avec Fernald qu’il considère comme son « botanical father ».

L’intérêt pour les plantes s’étend au-delà des botanistes. Les résidents·es d’été ou des environs sont parfois des scientifiques ou des
amatrices et amateurs passionnés. Dawson attribue à une « Miss Carey » l’identification des espèces le long du Saint-Laurent alors qu’Eugénie Lalonde Ranger (1878-1969) récolte de nombreux spécimens lors de ses étés à Percé. Pour sa part, le prêtre André-Albert Dechamplain (19001986) est un naturaliste aguerri féru de botanique qui enseigne plusieurs matières en lien avec les sciences naturelles au Séminaire de Rimouski. Il se promène en Gaspésie pour étudier les plantes et récolter des spécimens. Entre autres, il aurait accompagné le frère Marie-Victorin lors de ses relevés au mont Albert. Il existe sans doute des albums d’aquarelles et d’herbiers réunis par les visiteuses et visiteurs de la région aux 19e et 20e siècles. Une fois trouvés et inventoriés, ils deviendront des compléments importants à l’enregistrement de la flore de la région.
Pour en savoir plus, lisez l’article « Sur les traces du botaniste Merritt Lyndon Fernald » dans le numéro Séjour nature (n° 195), paru en 2019.
Remerciements aux Archives nationales du Québec qui ont mis gracieusement à disposition leur photographie.
Note 1. Dictionnaire biographique du Canada, « sir William Edmond Logan »
Frère Marie-Victorin lors d’un de ses séjours en Gaspésie, années 1930. Archives Université de Montréal. E01185FP009715
Premier contact
Depuis nombre d’années, une plante fossile magnifique, Archaeopteris halliana, trône à l’entrée de l’exposition permanente du musée d’histoire naturelle du parc. Pour le public de tout âge, il s’agit d’un premier contact avec l’univers fossile que préserve ce petit parc d’une superficie de 0,8 kilomètre2. Ce spécimen étonne, voire surprend, par sa qualité de fossilisation, chaque détail de sa structure végétale ayant été conservée lors du lent processus de conservation.

La découverte des premières plantes fossiles de Miguasha remonte au 19e siècle et les descriptions scientifiques initiales portent la signature du célèbre paléobotaniste John William Dawson, une sommité de l’Université McGill. Au fil des ans et des fouilles, six espèces de plantes fossiles vont enrichir ce trésor gaspésien, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1999.
Un environnement tropical
Au Dévonien, il y a 380 millions d’années, un fleuve, prenant ses sources dans les jeunes Appalaches à proximité, s’ouvre sur un large estuaire avant de se jeter dans la mer. Cet
Connus de par le vaste monde, les fossiles du parc national de Miguasha ont fait la réputation de cette falaise gaspésienne. Parmi eux, certains poissons ont acquis leurs lettres de noblesse, tels le prince Eusthenopteron foordi ainsi qu’Elpistostege watsoni qui, depuis la découverte d’un premier spécimen complet à l’été 2010, porte avec fierté le titre de roi de Miguasha. Mais à côté de ces géants de la paléontologie, se trouvent aussi des plantes fossiles, moins connues, mais toutes aussi exceptionnelles.
environnement se trouve sous un chaud soleil tropical, puisqu’au cours de cette période géologique, la plaque continentale de l’Amérique du Nord se situe sous l’équateur.
Sur les berges de cet estuaire, les plantes de l’espèce Archaeopteris halliana croissent et peuvent atteindre jusqu’à sept mètres de hauteur. Son tronc, formé de lignine et de cellulose, affiche une structure semblable à celle des conifères actuels. Sa partie supérieure présente un assemblage de branches sur lesquelles s’étalent des frondes s’apparentant à celles des fougères. Dispersées par le vent et l’eau, les spores produites par certaines frondes favorisent de nouvelles pousses de la plante. Considérée comme l’un des premiers arbres ayant poussé sur Terre, cette plante, avec une répartition mondiale, forme l’essentiel des premières forêts dévoniennes. Archaeopteris fait partie d’un groupe qui donnera naissance aux gymnospermes actuelles, dont font partie les conifères.
Une fossilisation de tissus mous
Il y a 380 millions d’années, certains de ces arbres se sont retrouvés dans
les eaux de l’estuaire, dans le fond duquel ils vont être enfouis rapidement dans les sédiments et se fossiliser avec le temps. Contrairement aux poissons dont les parties minéralisées (os, arêtes, épines) vont se fossiliser, la plante présente uniquement des tissus mous, mais un élément de la plante demeure, soit le carbone qui en se fossilisant devient charbon.
Clin d’œil sur les ginkgos
Au plan floristique, au parc, il faut aussi mentionner la présence de deux Ginkgo biloba bien vivants. Ces arbres originaires d’Asie peuvent vivre des milliers d’années et font partie d’un groupe apparu au Permien, il y a 270 millions d’années. Surnommé « l’arbre aux quarante écus », le ginkgo affiche un feuillage automnal doré qui tombe de façon soudaine. Ces deux arbres grandissent près du musée d’histoire naturelle. Pour être mis en terre au parc, ils ont dû recevoir l’approbation des autorités gouvernementales québécoises, étant donné qu’ils ne font pas partie de la flore indigène du territoire.
Une flore d’hier et d’aujourd’hui à découvrir au parc national de Miguasha.
Le domaine d’exploration botanique du frère Marie-Victorin (1885-1944) est surtout la province de Québec, mais il s’étend parfois à l’Ontario et aux Maritimes, et même à l’Afrique et aux Antilles. À partir de 1930, une longue série d’explorations est faite avec ses collaborateurs dont deux fructueuses saisons (1930 et 1931) dans la baie des Chaleurs auxquelles s’ajoute une autre courte saison (1936) en Gaspésie, possiblement du côté nord. En 1928, un jeune savant, Jacques Rousseau (1905-1970), va réaliser dans les Chic-Chocs, provenant d’un mot mi’gmaque qui signifie « barrière impénétrable », un voyage d’exploration scientifique dont le récit fait penser à un roman d’aventures.
 André St-Arnaud Directeur, Cercles des Jeunes Naturalistes
André St-Arnaud Directeur, Cercles des Jeunes Naturalistes
Les explorations de Jacques Rousseau sont nombreuses et importantes, et s’étendent sur plusieurs années. Au premier rang se trouvent ses travaux sur la région de l’estuaire du Saint-Laurent dans les années 1920 et 1930. Viennent ensuite ses trois voyages dans les Chic-Chocs (1928, 1931, 1939) et une campagne dans la vallée de la Matapédia (1929).
Sans doute qu’une excursion en Gaspésie entreprise par des amatrices et amateurs pour contempler les beautés de la nature et de ses richesses dans ce coin de pays n’offre rien d’extraordinaire, mais une exploration scientifique au cours de laquelle la voyageuse ou le voyageur est forcé de pénétrer dans des endroits reculés dont les scientifiques seuls ont le courage de sonder les mystères, présente un intérêt passionnant. Tel est le voyage entrepris, au mois de juin 1928, par le botaniste Jacques Rousseau, assistant du frère Marie-Victorin au Laboratoire de botanique de l’Université de Montréal. Il n’est âgé
que de 22 ans, mais il a pour lui son énergie, son talent, le témoignage de son célèbre maître et plusieurs travaux intéressants.
L’exploration racontée ici, entreprise par Jacques Rousseau, est une contribution au travail du frère Marie-Victorin sur la flore du Québec , avec l’aide du Conseil national de recherches. Les matériaux recueillis s’ajoutent à ceux que le frère a déjà herborisés en 1923. Ils feront l’objet de publications ultérieures qui formeront une étude d’ensemble sur la région de la Gaspésie. Le travail n’est qu’amorcé, d’immenses étendues de prairies alpines dans les Chic-Chocs n’ont pas encore été visitées. Léopold Fortier (1901-1984), ingénieur-chimiste, étudiant en botanique systématique, se joint à l’exploration, à titre bénévole.
Dans les solitudes
Jacques Rousseau part de Montréal vers la mi-juin pour poursuivre une exploration botanique longtemps
rêvée et collectionner des échantillons de la flore gaspésienne dont on parle depuis quelques années. Au cours de son voyage qui dure plus de deux mois, le jeune botaniste se rend au Bic, à Saint-Valérien et sur la côte nord de la Gaspésie. Mais le but principal de cette randonnée est la visite du massif central des ChicChocs. « Depuis plusieurs années, écrit-il dans son journal de voyage, nous avions projeté d’aller sur la « Table ». Enfin, notre projet sera réalisé. »
Le massif central des Chic-Chocs qu’on a surnommé « La Table », à cause de la forme généralement aplatie des sommets, n’a reçu qu’une dizaine de visites depuis 1850. À part le garde-forestier de Grande-Vallée, Jean-Baptiste Chicoine (1885-1975), il n’y a que des géologues, des botanistes et quelques chasseurs aventureux qui y ont pénétré.
C’est cette région sauvage que Jacques Rousseau explore durant 15 jours pour en rapporter quantité d’échantillons qui seront étudiés au cours de l’automne et de l’hiver, et
parmi lesquels on s’attend de faire des découvertes intéressantes. Il est très probable qu’en classifiant ses plantes au Laboratoire de l’Université, on s’apercevra que plusieurs d’entre elles ne sont pas encore connues. Mais ces résultats n’ont pas été obtenus sans peine et il faut suivre notre explorateur dans ses randonnées aventureuses pour constater que l’émotion d’un botaniste en face d’une fleur, préparée par tant de travaux et de fatigue, ne saurait être exagérée.
C’est à Mont-Louis que commence la phase la plus intéressante du voyage de Jacques Rousseau, le 7 août. Son compagnon, Léopold Fortier, est venu l’y rejoindre, à l’hôtel, la veille au soir.
Dès le matin du 7, nos hardis voyageurs partent en automobile, mais, au bout de 11 km, ils doivent continuer à pied. C’est à ce moment que la misère fait son apparition. Léopold Fortier doit porter une charge de 80 livres et Jacques Rousseau de 65 à 70 livres, à part la carabine 303 indispensable. En effet, on ne passe pas 15 jours à marcher sans prendre de nourriture… et, ne consommerait-on que du bacon (nos voyageurs en mangent trois fois par jour), il faut tout de même le porter! Et puis, le matériel d’étude : carton, cartable, préparations diverses pour conserver les insectes et… les hommes contre les piqûres des gladiateurs de l’air… les maringouins, etc., tout cela finit par faire du poids.
Enfin, à midi, nos voyageurs atteignent le dépôt de la Seigneurie de « La Madeleine ». Ils ont la bonne fortune d’y trouver trois compagnons de route, robustes défricheurs, qui vont débarrasser la « trail » (sentiers piétonniers) entre la Fourche du Nord et le lac de La Madeleine, c’est-à-dire, une distance de 32 km.
Le départ n’est pas encourageant, car nos voyageurs ont devant eux une pente raide de 3 km de longueur. De plus, l’ascension se fait sous un soleil ardent et pas une goutte d’eau à boire! Qu’importe; c’est pour la
science, et nos voyageurs oublient leur fatigue pour cueillir au passage de la Clintonie boréale…
Après la pente raide, c’est le sommet uniforme du plateau et nos explorateurs marchent toujours. Enfin, ils arrivent au camp du lac à 19 h 45. Ils y rencontrent le gardeforestier Tom Henley qui met son téléphone à leur disposition.
Télégramme original Jacques Rousseau se met aussitôt en communication avec le télégraphiste de Mont-Louis et lui demande d’adresser au frère Marie-Victorin le message suivant : « Venez Mont-Louis, Hôtel, Auclair, Téléphone Tabletop. » Le frère reçoit le télégramme ainsi : « Venez Mont-Louis, Hôtel, eau claire, téléphone, table »… Il croit donc que c’est le seul hôtel de la côte où l’on peut trouver de l’eau potable, une bonne table et, en plus, le téléphone, aussi il décide de venir s’y installer
La soirée se passe agréablement au camp du lac. À 5 h du matin, nos voyageurs sont debout. Ils ont le plaisir d’apercevoir, dans la clarté du matin, le but de leur voyage, « La Table » et le mont Auclair (1 105 mètres d’élévation) qui en est un élément. Vers 8 h, le 8 août, ils font la traversée du lac Mont-Louis avec Tom Henley qui les conduit dans un canot brisé qui prend beaucoup l’eau; puis, la marche recommence, à travers les obstacles semés sur la route difficile. Les marcheurs passent par la chaîne des Sept Lacs et arrivent au camp de la Fourche du Nord, où Jean-Baptiste Chicoine vient les rencontrer. Ils ont fait 19 km depuis le lac Mont-Louis et devront parcourir encore 8 km avant d’atteindre Tabletop. Ce massif est renommé en 1965 monts McGerrigle, en l’honneur du géologue du même nom. Après une nuit au camp de la Fourche du Nord, ils partent, à midi, à cause de la pluie, et, au prix d’une série de nouvelles fatigues et
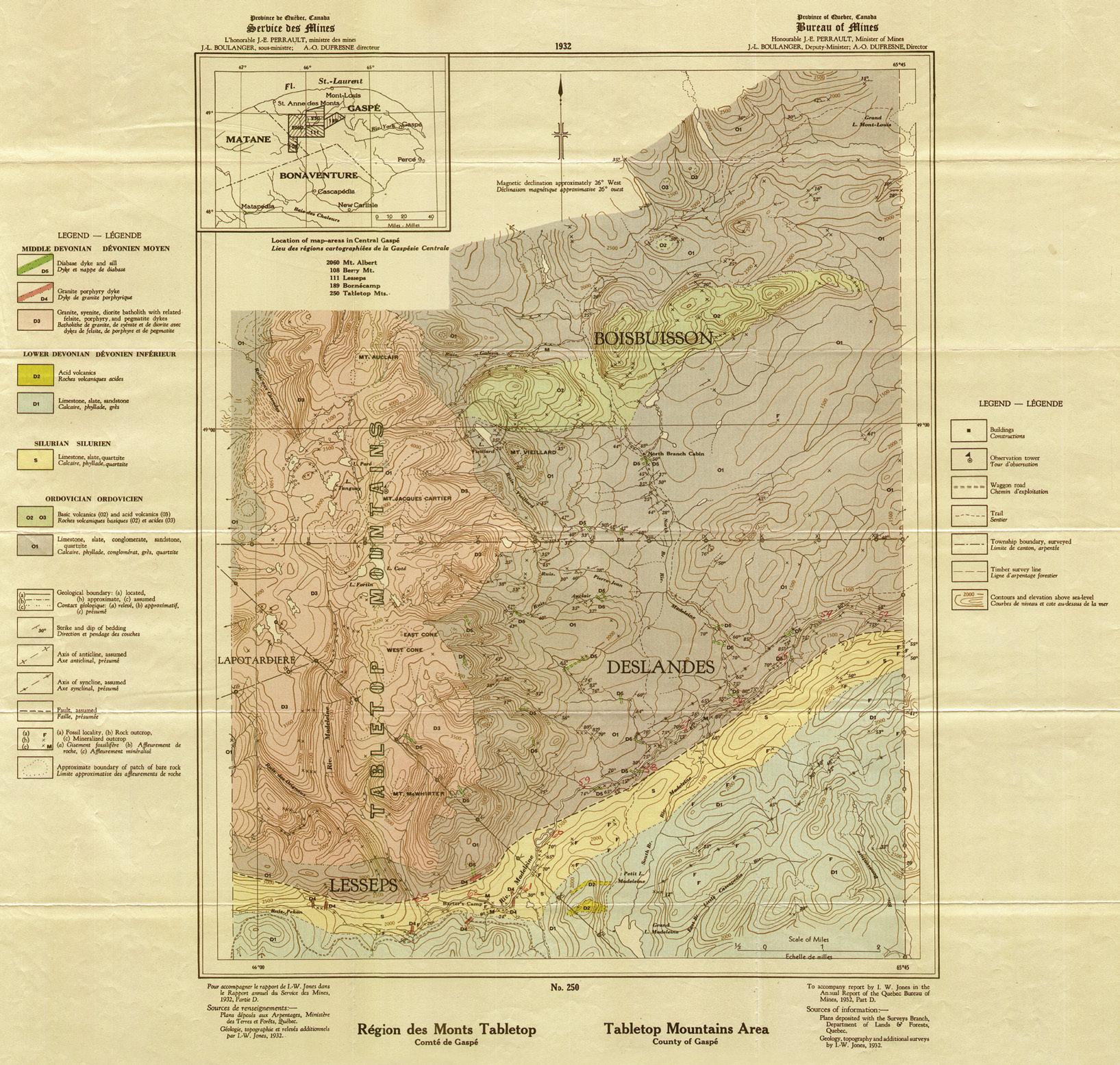
de chutes répétées au milieu des broussailles de la route, ils arrivent au camp de Chicoine, à 3 000 pieds (915 mètres) d’altitude.
Le lendemain, 10 août, les chercheurs de plantes reprennent leur randonnée, à 6 h 30 du matin, dans l’atmosphère suffocante d’une brume épaisse. Ils marchent, marchent toujours. Ils pourront tomber de fatigue, souffrir de la soif, de la chaleur; peu importe, ils ont pour eux une force plus grande que tous les obstacles : ils ont atteint leur but. À 8 h, ils sont à Tabletop, au plus haut point.
Le sommet! Que de fois nos botanistes ont rêvé de l’atteindre! Que de fois ils l’ont entrevu en imagination, dans le silence de l’étude, à la lecture des récits enthousiastes des explorateurs, leurs maîtres. Et voilà que leur rêve est devenu une réalité, ils ont fait leur première conquête, ils ont ouvert le chemin de la victoire. Il faut lire la page de journal où Jacques Rousseau signale cette glorieuse phase de son voyage : « Dieu soit loué! Voilà un projet bien ancien de réalité. Ce rêve commencé avec ma vie de botaniste trouve enfin sa réalisation. C’est un coin bien intéressant de notre pays que ce plateau géant. Sur le sommet, tente d’un garde-feu. Il y a un téléphone, une tour de 6 pieds [près de 2 mètres] de hauteur où se trouve la carte du district. Vers le sud-est, une source alimentée par un petit glacier de 100 pieds [30 mètres] de long par environ 30 [9 mètres] de large. Il est encore bon pour durer une partie des mois d’août, car son épaisseur est assez considérable. Sur le sommet le plus élevé, nous ne retrouvons pas l’un des cairns élevés par Fernald [Merritt Lyndon Fernald (1873-1950), botaniste américain] au cours de ses explorations. Peut-être a-t-il été employé ultérieurement à la construction de la petite tour?

Le géologue Coleman [Arthur Philemon Coleman (1852-1939), géologue canadien] l’avait retrouvé en 1917, mais le temps ou les hommes ne l’ont pas épargné. Eh bien, soit; nous en construirons un autre, témoin de
notre humble contribution à l’œuvre si bien commencée. ».
Au cours de leurs explorations sur la surface du mont, nos voyageurs parviennent à localiser un glacier qu’ils apercevaient depuis longtemps. En gravissant la cime du Vieillard (mont ainsi nommé à cause de sa forme arrondie comme le dos d’un vieillard), ils constatent que ce glacier est jusqu’alors inconnu. Aucune carte n’en signale la présence.
Ce glacier, situé au nord-ouest du Vieillard, repose au fond d’un cirque très vaste. À son extrémité inférieure, une moraine forme un barrage qui a permis à un petit lac de se former, alimenté par un ruisseau qui passe sous le glacier où il s’est creusé un chemin dans une chambre souterraine d’une profondeur de 15 pieds (4,5 mètres) et où l’on peut pénétrer. Le ruisseau coule dans un canyon dont les parois sont de 10 à 15 pieds (3 à 4,5 mètres) de
hauteur. Le cirque laisse pousser sur ses côtés des plantes de toutes sortes, dont Jacques Rousseau fera une riche collection.
Que dans ces régions sauvages dont la description seule inspire une sorte de terreur, on trouve des orignaux et des caribous, c’est tout à fait naturel : mais que l’on y rencontre des insectes, voilà qui semble étrange. Cependant, Jacques Rousseau rapporte dans son journal avoir trouvé un papillon au sommet du mont Jacques-Cartier. Il a vu aussi une multitude de souris, campagnols et musaraignes dont il a conservé quelques spécimens. Contrairement à l’opinion de Coleman, nos naturalistes rencontrent plusieurs crapauds d’Amérique sur la route de MontLouis à Tabletop.
On sait déjà que la végétation des Chic-Chocs est très différente de celle du reste du Québec; on en
trouve deux exemples frappants en parcourant le journal de Jacques Rousseau. Le jeune botaniste signale la présence de framboises (nommées Ronce pubescente) dont chaque grain est gros comme une cerise. Ces fruits sont excellents, mais leur goût est quelque peu différent de celui des framboises auquel on est habitué.
Fait qui peut paraître extraordinaire, il rapporte aussi des saules dans son herbier. Ces arbres nains ont environ un pouce de hauteur et ne portent que deux ou trois petites feuilles. Leurs racines sont beaucoup plus longues que l’arbre lui-même qui pousse dans les fentes de roche. Ces arbres nains ont toutes les caractéristiques du saule, d’où l’appellation Saule herbacé par les botanistes.
Il ne faut pas s’imaginer que le voyage de nos explorateurs, si intéressant qu’il soit, s’est accompli sans aucune difficulté. En effet, il faut se rappeler que les valeureux chercheurs ont dû parcourir 54 km dans les bois et sur les pics dénudés, de Mont-Louis à Tabletop. Au retour, Rousseau fait remarquer dans son journal que ses bottes n’offrent plus guère une grande protection à ses pieds endoloris, dont les extrémités passaient à travers. Pour comble de malheur, le jeune botaniste a brisé ses lunettes qu’il a dû réparer tant bien que mal pour continuer son expédition. Les chutes sensationnelles dans les broussailles ne se comptent pas, mais nos voyageurs s’amusent de ces contretemps qui ne les ont pas empêchés d’atteindre leur but.
En arrivant à Tabletop, le but de leur voyage, nos jeunes explorateurs, au comble de la joie, veulent commémorer cet évènement de leur vie. Ils élèvent un cairn en pierre de forme pyramidale, de 6 pieds (1,8 mètre) de base. Les quatre faces du cairn sont orientées d’après les points cardinaux. Jacques Rousseau rédige une inscription qu’il enferme dans une
Tabletop, 10 août 1928.
Exploration botanique sous les auspices du Lab. de botanique de l’Université de Montréal et du National Council of Research, conduite par Léopold Fortier et Jacques Rousseau.
Partis de Mt-Louis 7 août, avons couché Lac Mt-Louis; 8 août, avons couché Fourche du Nord; 9 août, arrivons au camp du garde-feu sur le flanc de Tabletop vers 3 000 pieds [915 mètres] d’altitude. M. Baptiste Chicoine, GrandeVallée, et son fils Hilaire, âgé de 14 ans, garde-feux. 10 août, avons gravi Botanist Dome où se trouve tente du garde-feu. Dans nos loisirs occasionnés par brume épaisse, avons bâti ce cairn à 50 pieds [15 mètres] à l’est de la tente. Orienté selon les points cardinaux. Le travail de construction demandé 10 heures d’ouvrage en tout. Demeurerons ici jusqu’au 21 probablement.
Léopold Fortier
Ingénieur Chimiste
Montréal
B.Chicoine
Garde-feu
Jacques Rousseau Lab. Bot. Univ. Montréal
Hilaire Chicoine Ass. Garde-feu
bouteille et dépose à l’intérieur du cairn.
Le retour des explorateurs s’accomplit sans incident marquant. Après tant de fatigue, d’efforts et de privations, ils sont heureux de revenir vers la civilisation. Chargés de matériaux dont la classification exigera des études patientes et ardues, les courageux voyageurs sont contents d’avoir réalisé le projet qu’ils cares-
saient depuis plusieurs années. Leur travail pourra être méconnu des profanes, le cairn, souvenir de leur expédition pourra périr, mais nos hardis explorateurs garderont la satisfaction d’avoir fait œuvre utile.
Pour en savoir plus : Le fonds JacquesRousseau, dont son journal, est conservé à l’Université Laval, P174/B-31, P/174/B-32.

J’observe. Depuis la tendre enfance, j’observe, dans les herbes hautes derrière la maison, les bourdons allant d’une inflorescence à une autre, que plus tard j’identifierai : la bardane, l’achillée, l’anaphale, la tanaisie, la chicorée et autres de la famille des composées qui envahissent les champs et les bordures de chemin.

Enfant, naviguant avec les voisins·es de notre chalet sur le barachois lagunaire de SaintOmer, nous glissons sur cette lugubre mini-forêt de zostères, découverte à marée basse et cachant les méchants crabes. De retour sur les rives bordées d’élymes et d’ammophiles ou blés de mer, je goûte la salicorne et la Sabline faux-péplus qui assaisonneront plus tard mes salades et mes hamburgers.
À l’âge adulte, ce penchant s’est affirmé. Je fouille les différents milieux de vie pour récolter les cent plantes de l’herbier nécessaire à ma deuxième année de biologie à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR). La Mitrelle nue est mon coup de cœur. Délicate, verdâtre, la fleur dentelée comme un flocon de neige m’est apparue dans une clairière de forêt de conifères, sur une souche envahie de mousses, à la lumière oblique d’une fin de journée, dans son éclatante beauté.
Entre-temps, les parcs nationaux me font de l’œil et me permettent de trouver ma voie. Je parcours ces espaces privilégiés. Je suis payée pour faire ce que j’aime faire le
plus au monde : faire découvrir aux personnes qui le veulent bien les merveilles qui nous entourent. Quel immense bonheur! Parlons des hauts sommets des Chic-Chocs et des monts McGerrigle où se réfugie une flore arctique-alpine : Bouleau nain, Saule arctique entre lesquels s’installent, en forme de coussinets, l’Armérie du Labrador, la Silène acaule et la Diapensie de Laponie. Et dans l’ascension des flancs de ces montagnes, nous croisons une succession altitudinale de forêts correspondant à la même succession en latitude qui est observable par le hublot d’un avion en voyage vers le Grand Nord québécois.
Comme chaque écosystème a sa forêt, la mer qui entoure la péninsule a les siennes. Les grandes algues brunes échouées sur la plage, les laminaires appelées goémons par nos grands-pères, bien accrochées sur les roches du fond forment une forêt très dense et se dressent sous la zone des marées, comme un brise-lames protégeant les habitants·es du littoral des vagues fortes venues du large. La forêt plus petite
des fucus ou varech, tout aussi touffue, garde à l’abri toute une faune contre la sécheresse occasionnée par le soleil plombant à marée basse et contre les prédateurs marins à marée haute.
Mais si dans toutes ces expériences, l’humain n’était pas présent, mon travail de naturaliste ne serait pas complet. À Percé, je n’aurais pas été pleinement satisfaite si je n’avais pas réussi à répondre de façon diplomate à une dame qui s’exclame « Quoi? L’eau est salée? ». Sur l’île Bonaventure, en balade avec trois couples, à quatre pattes, je dégage délicatement les racines en forme de corail de la Corallorhiza maculata, pour leur faire découvrir le bien-fondé de son appellation. J’ai su donner pleinement, que ce soit à ce directeur d’un musée d’histoire naturelle de Boston qui voulait les noms latins des plantes, aux amoureux du réseau national des parcs québécois et à ce couple si touchant qui écoutait, les yeux grands ouverts et qui m’a dit « Quoi, c’est vivant? ». J’ai eu l’impression d’ouvrir, pour ces derniers, une grande fenêtre sur le monde…
L’étude des plantes du parc national Forillon nous révèle bien des choses. Elle nous rappelle de grandes migrations, elle nous invite à remonter loin dans le temps, elle nous enseigne aussi à reconnaître que le changement fait partie de l’histoire de notre planète.

Maxime St-Amour Biologiste, chef de l’interprétation naturelle, historique et culturelle, parc national Forillon de 1970 à 1998, et résident de Cap-des-Rosiers
Bien au-delà de l’identification des plantes, qui demeure la base de la botanique, les études scientifiques sur leur présence ici ou leur absence, leur arrivée, leur occupation respective de certaines zones du territoire selon l’habitat qui leur convient ou leur persévérance à se maintenir dans certains de ces habitats depuis des siècles, nous racontent des histoires captivantes. L’interprétation de la botanique du parc doit se faire de façon déductive, c’est-à-dire basée sur des faits étudiés et reconnus. Autrement, l’interprétation se ferait de façon intuitive, voir même émotive ou imaginaire, ce qui ne serait ni sérieux ni valable.
La plus ancienne plante de Forillon se trouve dans les grès qui bordent la côte sud de la péninsule, depuis Petit-Gaspé vers Penouille et Saint-Majorique. Les fossiles de cette
plante éteinte dateraient de quelque 375 millions d’années à une période où le nouveau continent émergeait de la mer en se butant contre le coin nord-ouest du continent africain, situé alors un peu au nord de l’équateur.
Comme en témoignent les strates entrecroisées de cette formation rocheuse de sable, cette plante primitive vivait en bordure de continent, possiblement en eau saumâtre dans un contexte d’eau courante, du moins à l’occasion. C’était il y a environ 175 millions d’années avant l’ouverture de l’océan Atlantique. Psilophyton princeps, la plus ancienne plante de Forillon, était donc une plante tropicale.
rare
D’autres plantes établies à Forillon sont arrivées ici depuis longtemps, soit à la fin de la dernière glaciation, il y a quelque 10 000 ans. Quand la
calotte glaciaire continentale s’est mise à reculer lors de sa fonte, le sol québécois raboté et chamboulé par le glacier est vite colonisé par des plantes adaptées à ce type de milieu ouvert et froid en bordure du glacier. Ainsi, des plantes de l’Arctique s’y implantent.
Aussi, des espèces vivant dans le rude contexte alpin des montagnes Rocheuses et de la Cordillère canadienne (à l’ouest des Rocheuses) auraient migré d’ouest en est jusqu’ici à cette même période, colonisant ainsi l’étroit corridor fraîchement libéré par la fonte du glacier continental.
Il faut savoir que ces plantes, tant arctiques qu’alpines, « poussent dans des milieux ouverts et dénudés, où elles n’ont pas à concurrencer d’autres plantes… elles exigent de vivre seules et passablement parsemées… là où les arbres ne poussent pas et où l’été et la période de croissance sont courts. »1. Elles
Présente en Alaska au niveau de la mer, dans les montagnes
Rocheuses jusque dans l’Utah et pouvant parvenir à 3 300 mètres (10 800 pieds) d’altitude, la Drave incertaine, avec ses petites fleurs jaunes, n’a été trouvée dans tout l’est du continent qu’à Forillon.
doivent de plus pousser sur de la roche calcaire.
Les hautes falaises de Forillon correspondent parfaitement aux conditions énumérées. Leur orientation face aux vents froids, la froideur de la mer à leur pied, les courtes périodes d’ensoleillement qui y prévalent contribuent à la rigueur nécessaire des conditions de croissance qu’exigent ces plantes. Ces parois rocheuses ont été complètement lessivées par les hauts niveaux marins postglaciaires. Puis, par la suite, ce milieu s’est maintenu dénudé par l’érosion constante des falaises, surtout par l’action du
gel-dégel. C’est un habitat à la fois austère et dangereux.
Une anecdote à ce sujet : en 1971, j’ai accompagné le Dr Pierre Morissette, botaniste de l’Université Laval, chargé de faire l’inventaire des plantes arctiques-alpines de Forillon. Alors qu’on explorait un talus dans les falaises, un petit éclat de pierre en chute libre a frappé sa botte neuve en cuir épais et l’a coupée jusqu’à la chaussette. Un milieu dangereux? Oui, certes, et ce, par tous les temps. Pour trouver une fleur, avait-il défié la mort?
Ces plantes arctiques-alpines sont considérées comme les plantes rares de Forillon. Pourquoi? D’abord, parce qu’elles poussent ici de façon disjointe de leur milieu d’origine lointain. Puis, elles ne comptent qu’une trentaine d’espèces. Et enfin, certaines sont présentes en moins d’une dizaine de plants. Leur présence ici est l’une des cinq caractéristiques fondamentales à la base du choix de Forillon comme premier territoire québécois pour devenir un parc national fédéral en 1970.

Un autre habitat nordique, une taïga forestière
Au centre de la flèche de sable de Penouille persiste une taïga forestière. La taïga est cette zone juste au sud de la toundra du Grand Nord québécois. Elle est caractérisée par la présence de conifères (Épinettes noires) clairsemés croissant sur un sol sablonneux et recouvert de riches tapis de lichens et autres plantes basses. La taïga marque la transition entre la toundra ouverte au nord sans forêt et la forêt boréale aux arbres poussant serrés au sud.
« ll arrive souvent qu’on retrouve au sud des habitats typiques des régions plus nordiques. Mais normalement, cela se produit en gagnant de l’altitude. Or, Penouille est sis au niveau de la mer. De plus, il y fait souvent plus chaud qu’à bien d’autres endroits dans le parc. »2 Cet habitat situé dans la baie de Gaspé est donc une intrigue écologique.
Hypothétiquement, la combinaison de certaines conditions comme la présence de sable, la pauvreté du sol
et les facteurs climatiques créerait des conditions de croissance qui rappelleraient la sévérité de celles de la taïga. D’ailleurs, on remarque aussi que des Épinettes noires sur Penouille se reproduisent par marcottage, soit des arbres naissant à partir de branches basses d’où croissent des racines. Comme au Nouveau-Québec, il s’agit d’une adaptation aux milieux difficiles.
Tout un cortège de plantes intéressantes, adaptées à ce contexte sablonneux, s’y trouve réuni : éricacées, lycopodes, champignons, etc. Ces plantes sont souvent associées symbiotiquement, c’est-à-dire qu’elles ont besoin les unes des autres pour exister. Ce ne sont pas des plantes rares, sauf la Hudsonie tomenteuse, mais certaines de leurs associations particulières le sont.
Penouille présente donc une écologie unique du Québec continental. Son caractère de nordicité devrait être reconnu comme primordial et le parc national Forillon pourrait considérer intervenir de façon sélective pour prévenir que des espèces envahissantes introduites comme le Caragana (Caraganier de Sibérie) et le Pin blanc, un conifère plutôt typique du sud, ne viennent pas saper le caractère nordique singulier de Penouille. On voit déjà que ce pin et d’autres « envahisseurs » s’installent et que ce sera sûrement au détriment de l’Épinette noire qui donne à Penouille toute son importance patrimoniale naturelle.

Après les plantes du nord, des espèces du sud
La température moyenne plus chaude qu’aujourd’hui, il y a environ
7 000 à 5 000 ans, a favorisé une migration de plantes du sud vers le nord. C’est ainsi que des chênaies et des érablières se sont installées ici et, avec elles, certaines plantes de sousbois typiques des régions plus au sud.

Les plantes venues du sud ont envahi et délogé les plantes arctiques-

alpines partout, sauf là où les conditions extrêmes ont perduré.
L’habitat forestier de Forillon est typiquement boréal. On pourrait élaborer sur ses multiples facettes en décrivant ses différents peuplements
forestiers. Toutefois, cette description risquerait d’être trop technique et spécialisée.
Ainsi, je vais plutôt souligner que j’ai déjà trouvé, en 1972, dans cette forêt boréale un Thuya occidental (communément appelé « cèdre ») qui mesurait près de 18 pieds (5,5 mètres) de circonférence. Une carotte prélevée par des spécialistes de l’UNESCO une vingtaine d’années plus tard a révélé que cet arbre existait déjà à l’arrivée de Jacques Cartier en 1534. Il serait, en fait, à Forillon, un monument botanique vieux de 500 ans.
Une simple fleur peut émouvoir
Pour terminer, une autre anecdote : en 1976, Forillon accueille un groupe international de botanistes en congrès. Lors du souper de clôture de l’évènement, le botaniste porteparole conclut son exposé, dont chaque phrase est traduite pour les convives parlant une douzaine de langues différentes, en disant que ce qu’il a trouvé de plus extraordinaire en ce qui concerne les plantes en Gaspésie, ce sont : « les magnifiques prairies de Taraxacum ». En entendant le nom latin du pissenlit, dont l’utilisation est commune dans la communauté scientifique, tous, se sont levés à l’unisson et ont applaudi chaudement cette fleur souvent mal aimée au Québec qui pare en abondance nos champs au mois de juin.
Notes
La Gaspésie regorge de cette diversité d’écosystèmes dont sont friands les botanistes, les naturalistes ou simplement les fervents es de la nature. Ces écosystèmes engendrent une impressionnante variété de plantes dont un infime échantillon est présenté ici en photos.
Jean-Philippe Chartrand Biologiste, directeur au développement du créneau d’excellence récréotouristique ACCORD pour la Gaspésie, et résident de Port-Daniel
Le Sabot de la Vierge (Cypripède acaule, Cypripedium acaule) est une orchidée à la fleur très distinctive qui est présente dans divers types d’habitats : milieux secs ou humides, éclairés ou ombragés. Ce spécimen a été choisi pour la photo parmi une cinquantaine de ses congénères près d’un des sommets du mont Vallièresde-Saint-Réal dans les Chic-Chocs.

L’Iris à pétales aigus (Iris setosa) rappelle l’emblème floristique du Québec, l’Iris versicolore (ou Iris du Canada). Le premier est associé aux milieux maritimes. Celui-ci a été photographié au parc Colborne à Port-Daniel-Gascons à quelques mètres de l’eau

Le Trille rouge (ou Trille dressé, Trillium erectum) est présent dans les forêts mixtes et de bois franc. Ainsi, il est peu commun dans le haut pays gaspésien. Le spécimen a été photographié dans le bassin versant de la rivière Restigouche où érablières et peuplements de trembles matures ne sont pas rares.

La Marguerite blanche (Leucanthemum vulgare) est une fleur très commune qui profite des milieux ouverts. Elle se répand dans les champs et les bûchés. Ces spécimens ont été photographiés sur un lot agricole de Cap-d’Espoir et contribuent à présenter une scène des plus typiques de la vie rurale.

La Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea) est une plante carnivore étroitement associée aux tourbières. Les feuilles en forme de tubes piègent les insectes. Ceux-ci seront « digérés » pour fournir des nutriments à la plante et compenser ainsi la pauvreté du sol. La Gaspésie a peu de lacs en comparaison à d’autres régions du Québec, mais elle a pourtant été aperçue dans les terres près de la Pointe-Saint-Pierre.

La Linnée boréale (Linnaea borealis) porte ses fleurs en clochette toujours en paires. Petites et près du sol, ces floraisons passent souvent inaperçues pour les randonneuses et randonneurs. Pourtant l’espèce est commune dans l’ensemble des forêts boréales autour du globe, dont celles de la Gaspésie, y compris à l’île Bonaventure.

Le Lychnis alpin (Silene suecica) fait partie des plantes arctiquesalpines. Pour s’assurer d’être butiné fréquemment par les rares insectes sur les sommets, la tige et les feuilles, tout comme les fleurs, sont d’un vif violet. Il est commun en Norvège et en Suède, mais présent aussi dans les Alpes, les Pyrénées et les montagnes de l’Amérique du Nord. Elles sont bien visibles le long du sentier du mont Albert, sur le plateau et dans la Cuve du Diable.

Le Silène acaule (Silene acaulis) est très intimement associé aux habitats de montagnes. Sa forme en coussin compact permet de retenir l’humidité et une certaine chaleur provenant du sol. Cet avantage est déterminant pour la survie de l’espèce bien adaptée au climat des Alpes, des Pyrénées, des Rocheuses… et des Chic-Chocs!
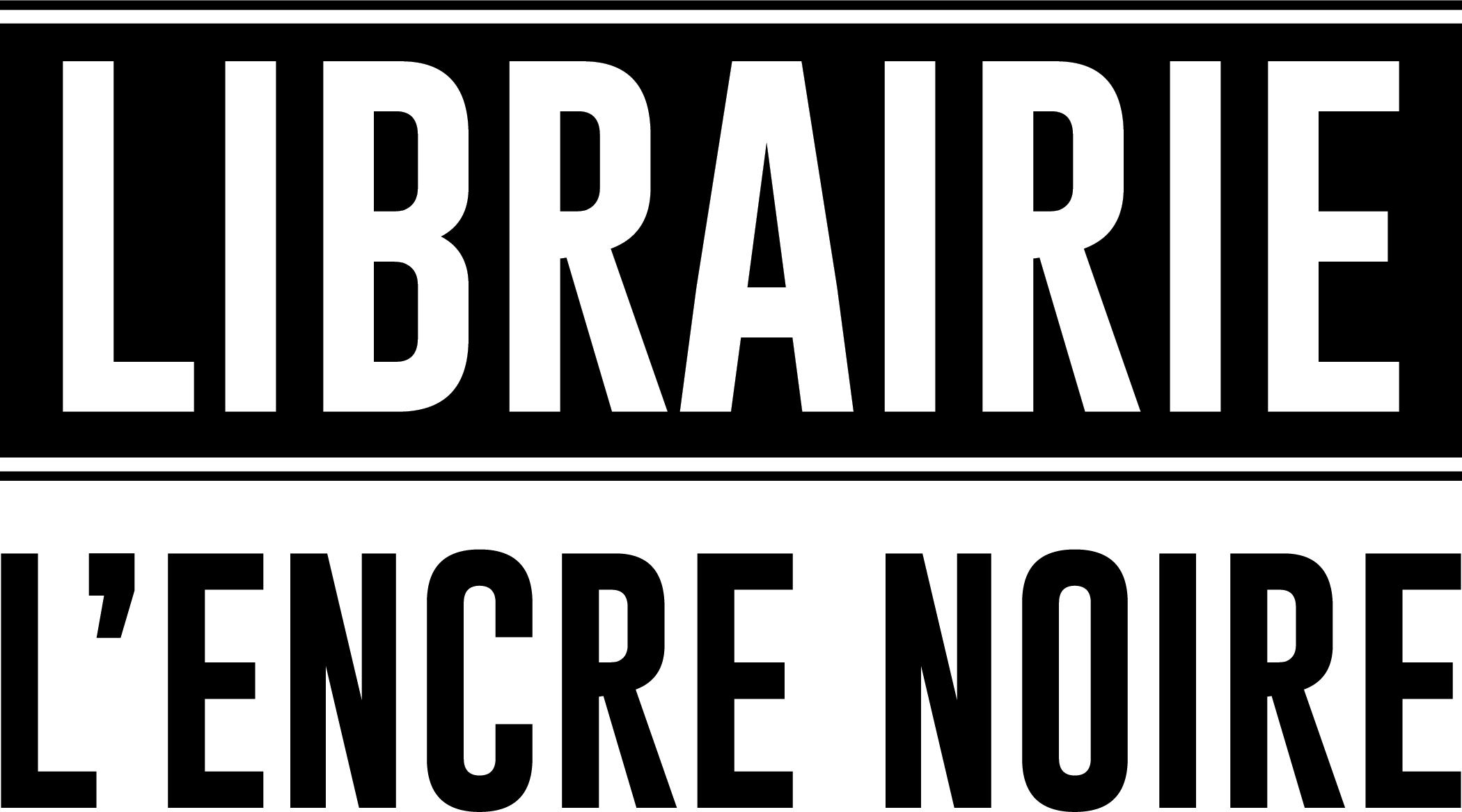

Le Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia) est une plante commune de la forêt boréale assez coriace pour coloniser les flancs de montagnes et les sommets peu élevés. Ses petites feuilles cirées et sa fleur aux pétales soudés résistent au froid, à la chaleur, à la sécheresse et aux forts vents. Tout ce qu’il faut pour survivre à la limite forestière des monts Xalibu, Richardson ou du pic du Brûlé.

Ce site est exceptionnel pour plusieurs raisons. D’abord, il n’a subi aucun ravage important, que ce soit par un incendie ou une épidémie d’insectes, ce qui est plutôt rare. De plus, ce secteur n’a jamais été « bûché ». En Gaspésie, on dénombre très peu d’endroits où les arbres n’ont pas été abattus au moins une fois par le passé. Cette forêt a ainsi pu traverser le temps, comptant des arbres matures de plus de 600 ans. Certains d’entre eux ont un diamètre allant jusqu’à 130 cm (50 pouces) et peuvent atteindre jusqu’à 28 mètres (92 pieds) de hauteur. On y trouve aussi une bonne quantité de bois morts, ce qui crée de belles percées et permet à de jeunes arbres de se frayer un chemin et à la forêt de se régénérer. Étant l’expression de la longue maturation des arbres, cette dynamique est sans doute plus vieille encore que les arbres les plus âgés qui s’y trouvent. Enfin, la cédrière est située dans la vallée de la rivière du Grand Pabos, là où le sol est recouvert de dépôts riches en nutriments à la suite d’inondations passées, ce qui favorise la croissance des arbres et des végétaux
En plus des cèdres, cette forêt ancienne est composée de Sapins baumiers, de Frênes noirs et de Bouleaux jaunes. Les sous-bois ont
Près de la rivière du Grand Pabos, au nord de Chandler, se trouve un écosystème forestier exceptionnel de la péninsule : une cédrière d’au moins 650 ans, ce qui en fait l’une des plus anciennes du Québec. La forêt est majoritairement composée de Thuyas occidentaux, que nous appelons cèdres au Canada. Cette forêt ancienne couvrant 24 hectares est une aire protégée par le ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec selon la Loi sur la conservation du patrimoine naturel.
aussi une végétation assez riche, dont une petite fougère calcicole, Cystopteris bulbifera, qui est peu commune au Québec.

La forêt ancienne de la Rivière-duGrand-Pabos est une aire protégée. Toutefois, l’espace qui l’entoure ne l’est pas. À proximité, la zone d’exploitation contrôlée (ZEC) des Anses comporte aussi de spectaculaires thuyas et d’imposants érables et merisiers, sans compter nombre de cours d’eau ainsi que la flore qui comprend des espèces menacées ou vulnérables, ou susceptible de l’être, dont le Calypso bulbeux, le Cypripède royal et la Dentaire à deux feuilles (Cardamine diphylla), une petite fleur protégée contre la récolte abusive n’ayant pas été identifiée par des experts.
En 2020, en apprenant que ce secteur devait subir des coupes forestières, le comité citoyen Solidarité Gaspésie s’est mobilisé grâce à la vigilance du directeur de la ZEC, Douglas Murphy, et à mon intervention. Ces démarches, appuyées par une entente avec le Conseil régional de l'Environnement GaspésieÎles-de-la-Madeleine (CREGIM) et la Société pour la nature et les parcs
(SNAP), ont permis de reporter la coupe, puis d’instaurer un moratoire. Elles ont aussi donné lieu, entre autres, à un important rapport sur la validation des écosystèmes forestiers exceptionnels présents sur le territoire, dirigé par l’ingénieur forestier Normand Villeneuve du ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Des démarches sont toujours en cours, mais la mobilisation citoyenne semble donner espoir qu’une partie de la ZEC sera désormais conservée.
Selon le registre des aires protégées au Québec, il existe en Gaspésie onze forêts anciennes, cinq forêts rares et huit forêts refuges, mais plusieurs autres sites méritent d’être conservés. Les écosystèmes sont complexes et plus vastes que des aires restreintes.

Transport de la Zostère marine à L’Isle-Verte où elle est surnommée « mousse de mer », entre 1920 et 1933.
 Maison
Maison
Louis-Bertrand
Le foin salé est une graminée humide qui vit dans l’eau près des rives du fleuve et du golfe du Saint-Laurent ainsi que de celles de la baie des Chaleurs. Fauché par les Mi'gmaqs depuis des centaines d’années, ce foin pousse au ras des marais salés, à l’embouchure de rivières et dans les barachois. On l’utilise pour nourrir le bétail, isoler, calfeutrer, rembourrer. Coup d’œil sur cette herbe à tout faire.
Le foin vert ou salé connaît diverses désignations populaires, dont herbe à outardes ou à bernaches puisqu’il sert de nourriture à ces oiseaux aquatiques et à quelques mollusques. En fait, son vrai nom est Zostera marina (Zostère marine). En Gaspésie, elle forme le plus souvent des herbiers insérés à l’intérieur de nos barachois. Contrairement à ce que l’on peut penser en la voyant, il ne s’agit pas d’une algue, mais bien d’une plante vasculaire indigène au Canada.
Les herbiers de zostère participent à la stabilisation des écosystèmes marins et offrent un habitat à de nombreuses espèces d’animaux et de poissons. Historiquement, ce foin est bien connu des Gaspésiennes et des Gaspésiens, qui le transforment et l’utilisent de plusieurs manières.
Séché, il est offert comme nourriture pour le bétail et sert aussi à rembourrer des meubles. Enfin, quelques sources mentionnent qu’on l’utilise pour effectuer le calfeutrage et l’isolation des maisons, une fois pressé.
Le foin salé est aussi recensé dans d’autres endroits au Québec et au Canada, comme chez les Acadiennes et les Acadiens de la NouvelleÉcosse. Ce foin « permettait de s’assurer que le bétail ne mourrait pas de faim en attendant la récolte des premiers foins cultivés »1. Il est ramassé à l’aide d’aboiteaux, des espèces de digues mises en place dans les marais. Selon les recherches de l’historien Michel Goudreau, des digues auraient été posées dans la rivière Ristigouche par les Acadiens.
À la suite de la Bataille de la Ristigouche, de nombreux Acadiens ayant transité par La Petite-Rochelle s’installeront à Bonaventure (1760), puis à Tracadièche (1767) (aujourd’hui Carleton-sur-Mer) sans titre de propriété.

De leur côté, les Mi’gmaqs revendiquent les terres de la rivière Cascapédia à la rivière Ristigouche ainsi que des droits exclusifs de pêche et de chasse sur la rivière Ristigouche.
Pour nourrir leur bétail, les Acadiens de la Baie viendront faucher le foin dans les prairies humides à l’embouchure de la Petite rivière du Loup en échange d’une redevance perçue par les Mi'gmaqs. Ainsi, l’équilibre des relations est fragile : les Mi’gmaqs laissent aux Acadiens le droit de s’approvisionner en foin, tant qu’ils sont payés et que les Acadiens ne revendiquent pas cette portion du territoire. Toutefois, la guerre d’Indépendance américaine augmente la précarité des Acadiens, qui sont irrités que les Mi’gmaqs ne leur laissent pas mettre de trappes dans la forêt ou pêcher le saumon et qu’ils aient augmenté leurs redevances pour la récolte du foin salé. De leur côté, les Mi'gmaqs rétorquent que l’exploitation intensive du foin nuit à la ressource, que les Acadiens font fuir le gibier et qu’ils ne paient pas leur dû.
Les tensions montent d’un cran à l’arrivée des Loyalistes dans la baie des Chaleurs en 1784. Un besoin de délimitation des terres se fait sentir. Pour résoudre le conflit entre Mi'gmaqs et Acadiens, le lieutenantgouverneur de la Gaspésie Nicholas Cox se rend dans la Baie, officialise l’entente pour le fauchage du foin entre les deux peuples et rassure les Mi'gmaqs : ceux-ci ne perdront pas leurs droits territoriaux. Mais cette entente n’est que provisoire et deux ans plus tard, Lord Dorchester, gouverneur de la province de Québec, met sur pied une Commission sur les terres gaspésiennes. Au terme de celle-ci, en 1786, les terres revendiquées par les Mi'gmaqs sont remises dans les mains de la Couronne britannique, qui souligne que les Mi’gmaqs doivent faire de la place pour « ses autres enfants, les Anglais et les Acadiens, qu’ils doivent considérer comme des frères ». Les Mi’gmaqs consentent à céder leurs droits aux Britanniques sur les territoires de Nouvelle et Miguasha en échange de droits exclusifs de pêche.
Malgré cela, l’entente ne sera pas respectée, car les autorités britanniques continuent d’octroyer des terres aux Loyalistes. Parmi eux, le juge Isaac Mann voit sa demande d’obtention de terres acceptée à Pointe-à-la-Croix (incluant les prairies de foin salé), ce à quoi s’opposent les Acadiens, ceux-ci ayant une entente avec les Mi'gmaqs pour le fauchage du foin. Malgré deux pétitions, les autorités statuent en faveur d’Isaac Mann, et jugent que les Acadiens doivent désormais lui louer des droits d’exploitation.
Au tournant du 19e siècle, la situation ne s’améliore pas; elle se dégrade même au profit d’une guerre à trois pour les ressources. À la lutte pour le foin se rajoutent les problèmes de surpêche et d’arpentage. Edward Isaac Mann, héritier des terres de son père Isaac, empêche les Acadiens et les Mi’gmaqs d’avoir accès aux prairies salées, évoquant une « concession de la Couronne » et le risque d’aller en prison si celle-ci est contestée. Il interdit également aux Mi'gmaqs et aux Acadiens d’accéder aux îles de la rivière Ristigouche. Il y fauche le foin, qui est abondant, et le vend aux marchands de la rive sud de la baie des Chaleurs, au grand dam des Acadiens et des Mi'gmaqs. Une année, le manque de foin les obligera à sacrifier 200 bêtes faute de fourrage.
Les revendications des Acadiens, Mi’gmaqs et Loyalistes conduisent à la création de la Commission des terres de la Gaspésie en 1820. Les Mann font l’objet de tirs groupés
de la part des Acadiens et des Mi'gmaqs, qui revendiquent les terres et l’observance de l’accord de 1784 pour la coupe du foin. En 1824, elles sont toutefois reconnues au fils d’Edward Isaac, Thomas Mann, avant qu’une partie ne passe entre les mains de Robert Christie un peu plus tard dans l’année. Malheureusement, la ressource se tarit graduellement bien que des commerçants continuent de faucher le foin pour une production très limitée.

L’historien Jean Provencher nomme plusieurs usages historiques de cette herbe. « L’herbe à bernaches sert

d’isolant pour les maisons et de litière pour les bêtes. On l’utilise aussi pour rembourrer les colliers de chevaux, les sièges de voiture, les matelas, les paillasses et même les sommiers disposés sous les matelas de laine. On répète dans la région que dormir sur de la zostère guérit du rhumatisme. »2


Outre l’alimentation des bêtes à cornes, le foin salé est aussi utilisé à des fins de rembourrage et de calfeutrage. On isole même des maisons avec cette herbe. En 1800, l’une des plus anciennes maisons de Saint-Omer, celle de John Grant, est calfeutrée de Zostère marine.
Le foin salé, à l’instar du foin des champs, est entreposé dans des dépendances. Sur le terrain de la beurrerie de Saint-Omer, il existe à l’époque une grange à foin salé, que l’on presse et envoie en Europe
pour calfeutrer les maisons. À Maria, M. Loubert possède une grange à foin salé attenante à la coopérative.
Un commerce de foin salé est aussi recensé dans la baie de Cascapédia pour des fins de rembourrage. Sur le banc Laviolette à Saint-Omer, on récolte cette herbe qu’on sèche et presse, avant d’en bourrer les sièges et de calfeutrer les maisons. Une présence historique de l’exportation du foin salé est aussi retracée à Paspébiac vers la fin du 19e siècle.
Enfin, on récolte aussi cette « mousse de mer » à L’Isle-Verte, au Bas-Saint-Laurent. Celle-ci est à la fois fauchée pour alimenter le bétail et pour la vente à des entreprises comme Ford qui l’utilisent pour rembourrer les sièges des automobiles.
Une ressource abondante? Même si une exploitation historique de la ressource est relatée, l’avenir commercial de la ressource n’est pas pour autant assuré. En 1932, « la zostère aurait même commencé à disparaître le long de la côte de l’Atlantique »3 en raison d’un champignon.






En 2002, une dizaine de zosteraies (herbiers de zostère) jonchent le secteur de la MRC Avignon, notamment : dans le marais côtier de Pointe-à-la-Batterie; dans l’estuaire de la rivière Verte et dans celui du ruisseau Kilmore à Maria; dans les barachois de Saint-Omer, de Miguasha, de la rivière Nouvelle et de Carleton-sur-Mer; dans l’herbacée riveraine de l’anse des McKenzie à Escuminac, et de celles de Pointe Verte et Pointe Kilmore à Maria; et dans la baie de Cascapédia. Cette herbe se rencontre aussi sur de nombreuses battures du SaintLaurent, dont plusieurs en Gaspésie.


Aujourd’hui, le foin salé existe toujours, mais les zosteraies se font plus rares. Seulement huit herbiers québécois font l’objet d’un suivi annuel.




Remerciements à la Cole Harbour Rural Heritage Society et à la Maison LouisBertrand qui ont mis gracieusement à disposition leurs photographies.
Notes

1. Le village historique acadien de la Nouvelle-Écosse, « Barges à foin salé ».
2. Jean Provencher, Les quatre saisons, « Dossier sur la mousse de mer »
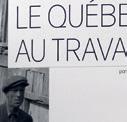
3. Ibid





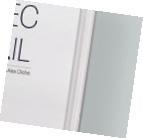








Scientifique, pédagogue et chroniqueuse, la Rimouskoise Marcelle Gauvreau (1907-1968) consacre son activité à la récolte et à l’étude des algues marines. De 1933 à 1937, « Elle parcourait les rives du Saint-Laurent tantôt en bateau avec les garde-côtes ou les pêcheurs, tantôt pieds nus sur les grèves et les rochers, elle chassait les algues marines. Puis revenue à la ville, seule le soir dans la vieille université, elle examinait le résultat de ses pêches pendant que les rats démolissaient murs et plafonds. »1 .
 André St-Arnaud Directeur général, Cercles des Jeunes Naturalistes
André St-Arnaud Directeur général, Cercles des Jeunes Naturalistes
Marcelle Gauvreau porte alors surtout son attention sur la distribution de ces végétaux dans la région gaspésienne. Elle étudie aussi la région de Charlevoix-Saguenay avec Claire Morin (1905-1994) et fait une saison aux Îles-de-la-Madeleine avec Georgette Simard (1911-2001).
Une première étude collective
En 1934, le botaniste Joseph-Émile
Jacques donne une conférence à l’Association canadienne-française pour l’avancement des sciences (Acfas) sur
quelques algues d’eau douce de la Gaspésie. Le biologiste et botaniste Jules Brunel (1905-1986), qui a pris part aux premières campagnes de l’Institut Botanique entre 1920 et 1924, se livre ensuite à des travaux d’algologie d’eau douce dans la région de Montréal, travaux où il a comme collaboratrice Cécile Lanouette (19141994). En 1938, il fait un séjour au parc national des Laurentides alors que pour la saison suivante, on le trouve sur la Côte-Nord, depuis Mingan jusqu’à Blanc-Sablon, faisant d’importantes récoltes d’algues.

Le professeur William Randolph Taylor (1895-1990), de l’Université de Chicago, auteur de Marine Algae of the North-eastern coast of North America paru en 1937, a bien voulu déterminer les spécimens recueillis lors de la première exploration, et
réviser les autres spécimens récoltés et identifiés par Marcelle Gauvreau les années suivantes. Des notes originales sont présentées sur le sujet lors de quatre congrès de l’Acfas dans les années 1930.
Après cinq étés de recherche active
sur le terrain et une année complète à la rédaction, un premier travail sur les algues marines québécoises est présenté par Marcelle Gauvreau, en 1939, à la Faculté des sciences de l’Université de Montréal, pour l’obtention d’une maîtrise. Ce mémoire fait d’elle la première femme à obtenir une maîtrise en science et lui vaut le prix de l’Acfas.
Pour ce premier travail, Marcelle Gauvreau doit ses remerciements au frère Marie-Victorin (1885-1944), à Jules Brunel, à Jacques Rousseau (1905-1970), botaniste au Jardin botanique de Montréal, ainsi qu’à Rudolph Martin Anderson (18761961), zoologiste, et à Alf Erling Porsild (1901-1977), botaniste, qui lui ont permis de consulter l’Herbier national du Canada et de retenir, pour les étudier, de nombreux spécimens.

En 1940, le travail dactylographié, relié, ayant pour titre : Les Algues marines du Québec, est déposé à la bibliothèque de l’Institut botanique de l’Université de Montréal. Une dizaine d’années passent, durant laquelle le professeur Elzéar Campagna (1898-1987), de l’École Supérieure d’Agriculture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, récolte des algues marines en Gaspésie (1938 à 1950), entre autres à Baie-des-Sables, Sainte-Flavie, Sainte-Félicité, Matane, Cap-Chat, Les Méchins, Marsoui, Gros-Morne, Rivière-Madeleine, Mont-Louis, Rivière-au-Renard, L’Anse-au-Griffon, Grande-Rivière, Cap-d’Espoir et Chandler. Ces herborisations apportent un complément intéressant aux recherches déjà effectuées par Marcelle Gauvreau.
En juillet 1950, un groupe d’une quarantaine d’étudiants·es, constitué en majeure partie de personnes vouées à l’enseignement des sciences naturelles, se rend à la Station de biologie de GrandeRivière, en Gaspésie, pour y suivre des cours de biologie marine organisée par les Cercles des Jeunes Naturalistes, en collaboration avec le ministère de la Jeunesse et du Bien-Être social et le personnel
attaché à la Station de biologie. Elzéar Campagna y donne les cours d’algologie et organise de nombreuses excursions.
Soulevé par le dynamisme de leur professeur, le groupe réclame la publication de l’ouvrage-manuscrit qui sert à identifier leurs récoltes : Les algues marines du Québec. À cette fin et sur la recommandation de Jacques Rousseau et de Jules Labarre (1904-2001), professeur à la faculté
VOYEZ DIVERS CROQUIS D’ALGUES RÉALISÉS PAR EUGÉNIE LALONDE RANGER
de pharmacie de l’Université de Montréal, l’Office provincial des recherches scientifiques du Québec et le Département des pêcheries accordent un octroi de 1 400 $ pour une publication l’année suivante. Ainsi, Marcelle Gauvreau s’est remise à l’œuvre pour réorganiser la flore algologique du Québec, étudier de nouveau ses récoltes et celles qui lui ont été soumises par Campagna et par différents collectionneurs et collectionneuses, en noter les diverses localités et, de plus, agrandir le cadre de distribution en consultant les publications les plus importantes parues depuis 1940. Le travail est ainsi considérablement augmenté.
Tous les spécimens d’herbier sont vus, notés et étudiés par Marcelle Gauvreau. Pour Grande-Rivière et les localités environnantes, Elzéar Campagna et les frères Sylvio (Albert Legault, 1919-2011), Samuel (Samuel Brisson, 1918-1982) et Claude (Marcel Côté, 1916-2004) des frères des Écoles chrétiennes à Mont-Saint-Louis et Montréal possèdent toutes les espèces représentatives de la région gaspésienne. Des duplicatas de tous les spécimens récoltés sont demeurés à l’Université du Michigan. Les autres sont offerts à l’Herbier Marie-Victorin au Jardin botanique de Montréal.
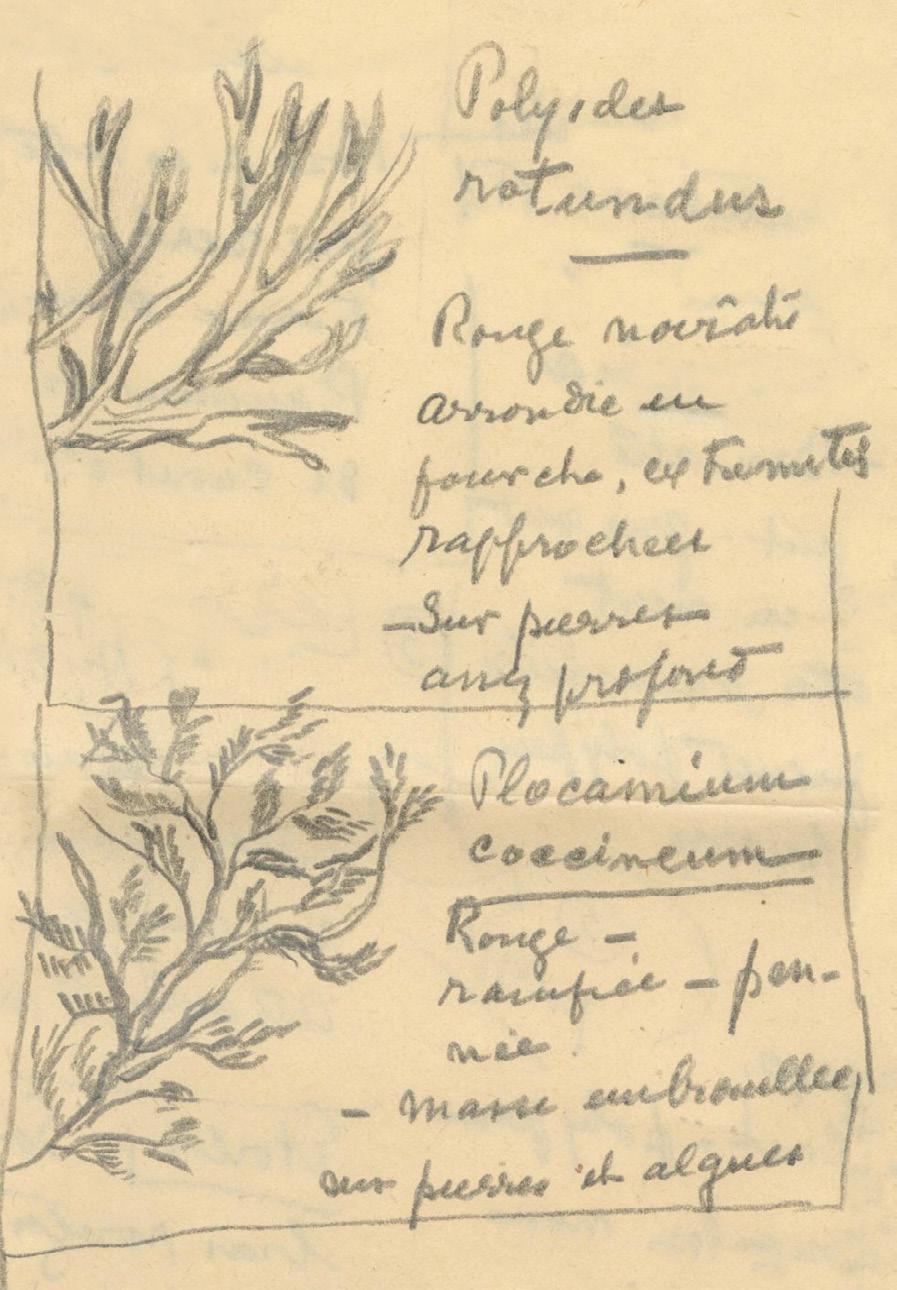
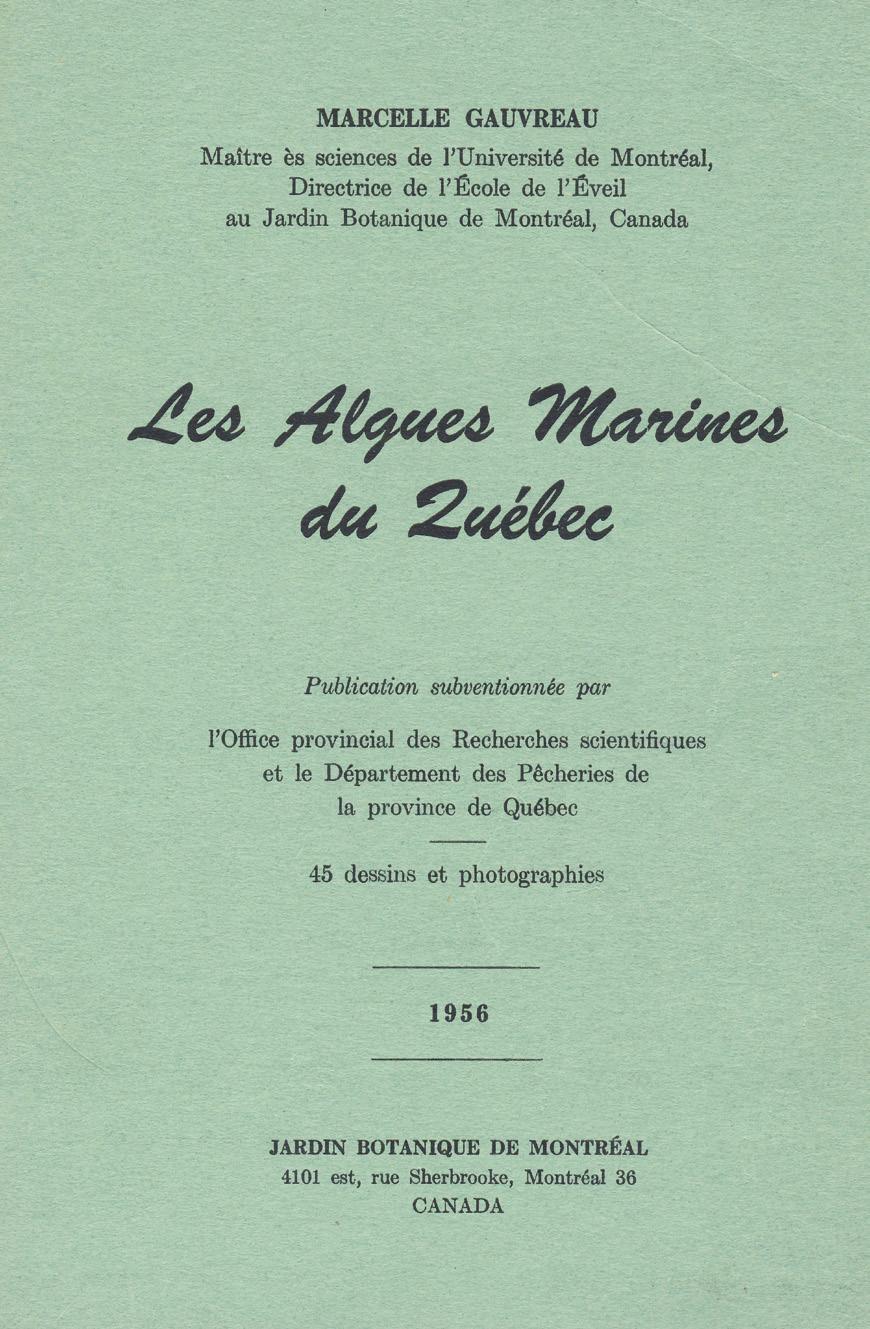
Puis, enfin, vient la publication en 1956 du premier livre sur les algues, sous les auspices du Jardin botanique de Montréal. Malheureusement, pour des raisons d’ordre financier, il est impossible de publier intégralement le texte de Marcelle Gauvreau ni de reproduire toutes ses

illustrations. Le Jardin botanique doit généraliser la distribution géographique et omettre les longues listes de spécimens qu’elle a étudiés. S’il y perd sur certains points, l’ouvrage y gagne peut-être sur d’autres. Ce livre est appelé à être la base de toutes les études futures.
Remerciements aux Archives de l'UQAM qui ont mis gracieusement à disposition leur photographie.
Note
1. Le Grand Québec, « Promotion de la femme » Extrait d'un croquis d’algues et d’herbes marines provenant d’un herbier constitué par Eugénie Lalonde Ranger, vers 1950. Musée de la Gaspésie. Don d’Eugénie Lalonde Ranger Couverture de la publication Les algues marines du Québec, Jardin botanique de Montréal, 1956. Collection André St-ArnaudNée en 1851, Anna Lois Dawson est la fille aînée du réputé géologue et paléobotaniste John William Dawson (1820-1899) qui est professeur et recteur de l’Université McGill. Anna apprend le dessin lors de ses études. Le dessin et l’aquarelle font partie des arts enseignés aux femmes dans le cadre de leur éducation pour devenir de « bonnes et heureuses épouses ». Talentueuse, elle remporte un premier prix juste avant d’être diplômée à l’Establishment for the Education of Young Ladies à Montréal en 1867. Elle poursuit sa formation artistique en 1873 à Toronto alors que sa famille y séjourne.
William Dawson est un auteur prolifique, signant plus de 300 articles scientifiques au cours de sa longue carrière à McGill. Plusieurs d’entre eux sont illustrés par des dessins d’Anna, portant l’abréviation « ALD »
pour « Anna Lois Dawson ». Combien de plus sont le fruit de son travail sans que le crédit lui soit accordé? Ses œuvres sont tout de même exposées à quelques occasions, incluant au Royal Canadian Academy of the Arts à Montréal en 1882 où deux de ses aquarelles sont présentées. Son travail suscite l’éloge du critique d’art du Daily Witness et de la Gazette
Un corpus impressionnant
La très grande partie de son travail est réalisé à Métis-sur-Mer où sa famille possède une résidence d’été. Une fois mariée à Bernard James Harrington, professeur de chimie à l’Université McGill, Anna continue d’y passer ses étés avec ses neuf enfants puisque le couple est propriétaire de la maison voisine de celle des Dawson. Elle y produit de nombreux croquis et aquarelles, principalement
liés à la nature. Son travail comprend également des scènes du lac George, du Bas-Saint-Laurent et de Montréal. Peu reconnue et même peu mentionnée de son vivant, Anna Lois Dawson Harrington décède en 1917 et laisse un corpus important d’œuvres, dont environ 200 aquarelles qui sont aujourd’hui conservées au Musée McCord Stewart.
L’exposition Anna Lois Dawson Harrington (1851-1917) sera présentée aux Jardins de Métis en 2024.

Remerciements à Alexander Reford, directeur des Jardins de Métis, et à Hélène Samson, commissaire de l’exposition, pour leur précieuse collaboration.
Remerciements au Musée McCord Stewart qui ont mis gracieusement à disposition les œuvres de leurs collections.
1. Anna Lois Dawson Harrington, Todies, Little Metis, aquarelle sur papier, 17,9 x 24,3 cm, 1899. Don de Mrs. Donald Byers, Musée McCord Stewart, M982.579.70

2. ALD (pour Anna Lois Dawson), Calamites, Ferns, & C., lithographie, 51,1 x 35,6 cm, vers 1872. Ces croquis de plantes fossiles et de fougères illustrent un ouvrage sur la géologie de J. W. Dawson.
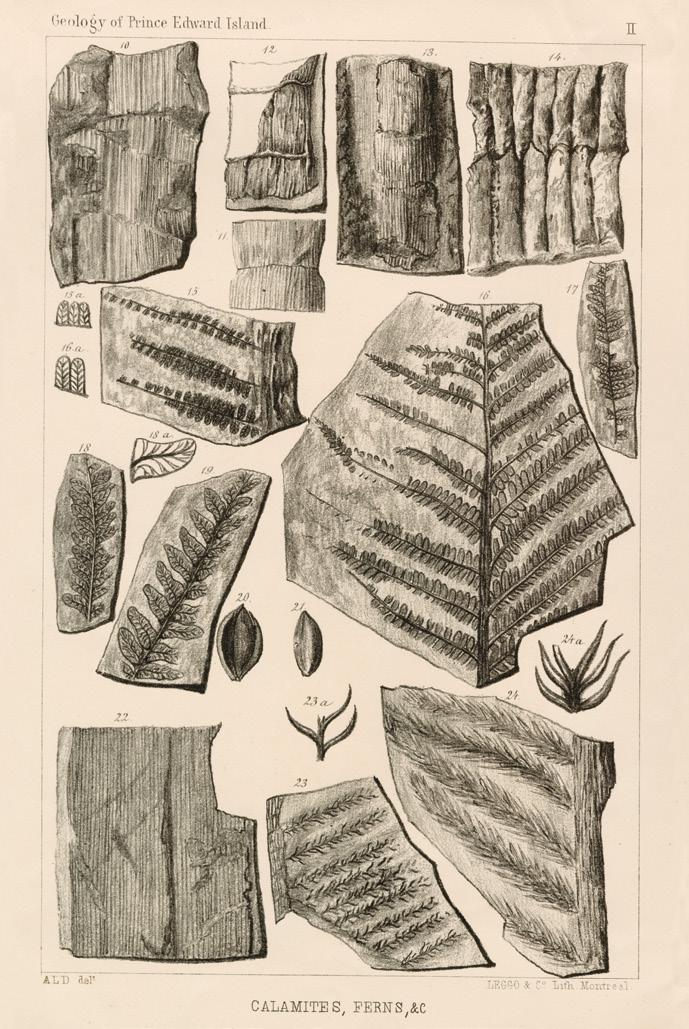


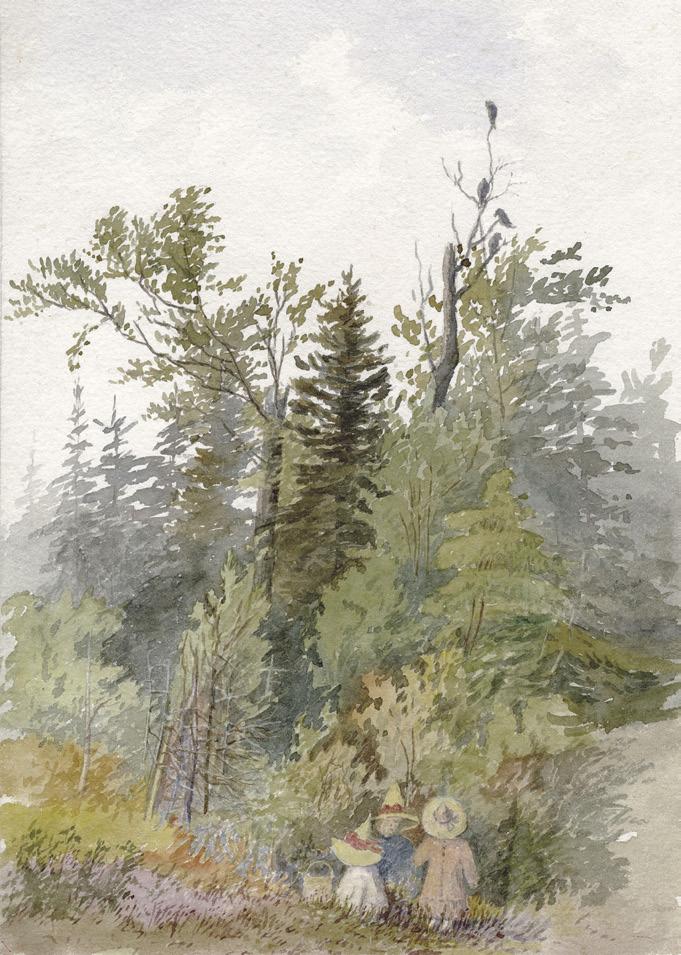
Don de Mrs. Donald Byers, Musée McCord Stewart, M982.586.1.2
3. Anna Lois Dawson Harrington, Vegetation of the Devonian period, vers 1870. Cette œuvre non signée illustre la flore présente durant la période dévonienne dans une publication de J. W. Dawson.
Illustration tirée de : John William Dawson, Geological history of plants, New York, D. Appelton and company, 1888, p. 49.
4. Anna Lois Dawson Harrington, Ladies’ Slippers, Metis, aquarelle sur papier, 26,8 x 20,1 cm, 1883. Il s’agit de Cypripèdes royaux. Don de Mrs. Donald N. Byers, Musée McCord Stewart, M982.579.93
5. Anna Lois Dawson Harrington, Little Metis, aquarelle sur papier, 24,2 x 17,1 cm, 1883. Cette aquarelle représente trois de ses enfants récoltant des plantes dans le bois près de leur résidence à Métis-sur-Mer.
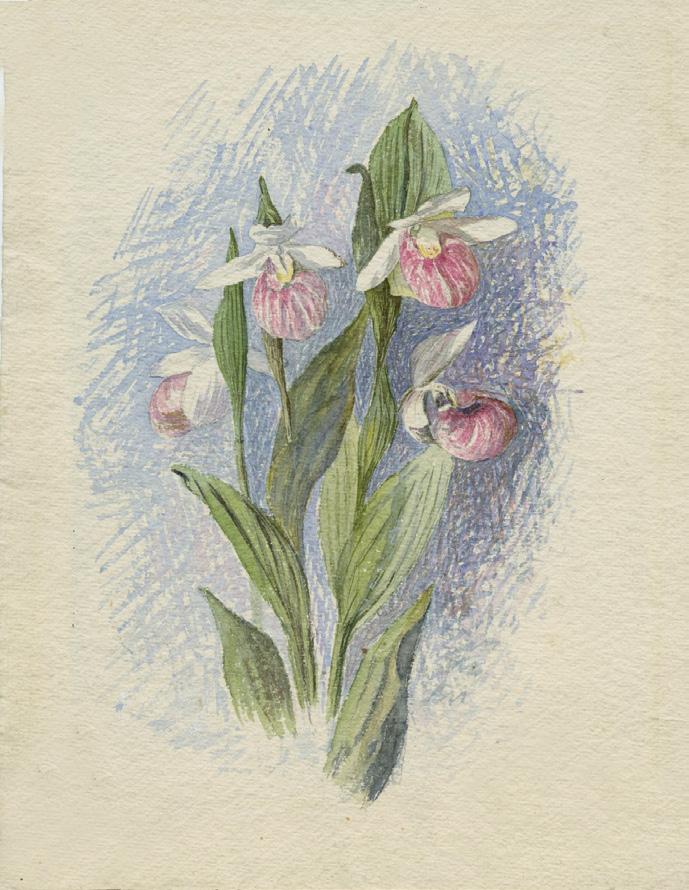
Don de Mrs. Donald N. Byers, Musée McCord Stewart, M982.579.12
6. William Notman, Miss Anna Lois Dawson, Montréal, négatif sur verre inversé, 17,8 x 12,7 cm, 1871.
Musée McCord Stewart, I-61215

Habitat Honguedo inc. est une entreprise de gestion immobilière fondée en 1975. Le nom de la compagnie, inspiré de la langue des Autochtones, signifie « lieu de rassemblement ».
L’entreprise est créée par quatre anciens professeurs du Cégep de la Gaspésie et des Îles : messieurs Jean Lamy, Roger Denis, Joseph Le Moignan et Jean-Paul Roussy. Ces associés, déjà en affaire en 1974 par l’acquisition de l’hôtel Baker, souhaitent développer davantage le domaine de l’immobilier à Gaspé.

En 1975, Habitat Honguedo inc. fait l’achat d’une subdivision d’un terrain et des bâtiments qui appartiennent à l’hôtel Baker ltée. Les bâtiments sont déménagés rue Baker et convertis en logements. C’est ce qui permet, en 1976, de disposer d’un grand terrain pour la construction de la première phase de l’immeuble de bureaux Pierre-Fortin. Là encore, l’histoire est une source d’inspiration pour les actionnaires qui, en donnant au lieu le nom de Pierre Fortin, veulent rendre hommage à un personnage plus grand que nature.
Pendant les premières années, les associés accomplissent, en même temps, leurs tâches professorales et l’administration de la compagnie. En 1988 toutefois, vu l’ampleur du travail et quelques difficultés administratives et financières, Jean-Paul Roussy quitte son emploi au Cégep pour devenir directeur général, à temps plein, de l’entreprise.
Dès son entrée en fonction, le nouveau d.g. établit un plan de redressement financier. En 1989, pour répondre à la demande, on procède à un agrandissement de l’édifice à bureaux de 12 000 pieds2 , portant l’offre totale d’espaces locatifs à 23 365 pieds2
Près de 40 ans plus tard, en 2015, Habitat Honguedo inc. a besoin d’un nouvel élan pour son développement. C’est à ce moment que monsieur François Roussy entre en scène en tant que directeur général. Deux ans plus tard, les associés décident de
Pierre Fortin a été, entre autres, médecin volontaire à Grosse-Île lors de l'épidémie de typhus en 1847 et en 1848, commandant d'un escadron de cavalerie lors des émeutes à Montréal en 1849, magistrat chargé de l'application des lois sur les pêcheries pour le Bas-du-Fleuve et les côtes du golfe du Saint-Laurent de 1852 à 1867, commandant des goélettes La Canadienne et Napoléon III ainsi que député élu sans opposition, deux mandats de suite, pour le parti conservateur dans Gaspé à l'Assemblée législative et à la Chambre des communes en 1867 et en 1872.

passer le flambeau et lui vendent leurs actions. Il devient alors président-directeur général et vient assurer la relève d’Habitat Honguedo inc.
Encore aujourd’hui, l’entreprise demeure à l’écoute de sa clientèle et des besoins du marché. C’est pourquoi elle continue d’offrir une variété de services tels que la location d’espaces de bureaux avec salles de repos et de réunion ainsi que 26 appartements locatifs, de différentes grandeurs. De plus, l’acquisition de nouveaux terrains, au cours des dernières années, permettra le développement des affaires pour assurer l’avenir de cette entreprise qui célèbrera un demi-siècle d’activité en 2025!
Les champignons et la flore sauvages font bonne figure au sein du terroir botanique gaspésien; ce dernier est un véritable laboratoire à ciel ouvert pour la distillerie. Effectivement, on peut penser au Puddingstone nécessitant des lactaires d’érable afin de donner un goût sucré à la crème ou encore au lichen et aux feuilles de framboisiers qui donnent les caractéristiques uniques à l’amaretto Dartmouth.
Au départ, l’idée du gin aux champignons est née dans la tête du jeune co-propriétaire Michael Briand. Alors qu’il s’affairait dans la cour arrière de sa maison, située à l’époque à Douglastown, il s’est demandé comment valoriser cette
À Gaspé, le gin Radoune est sans doute un des produits de consommation courants le plus facilement associé aux champignons. La distillerie O’Dwyer, qui le produit depuis 2016, a relevé le défi de mettre la richesse mycologique de la Gaspésie en bouteille.
 Frédéric Jacques Co-fondateur, distillerie O’Dwyer
Frédéric Jacques Co-fondateur, distillerie O’Dwyer
manne qui poussait librement au mois de septembre, « comme des champignons! ». C’est lorsque j’ai commenté une de ses publications sur les réseaux sociaux que Michael a découvert mon existence. Étant donné mon expérience en recherche dans le domaine de la chimie organique, le projet m’a rapidement séduit. Je travaillais depuis plusieurs années sur un gin aux algues, donc je maîtrisais déjà bien l’art de la distillation et ainsi, nous partions sur une base solide.
Afin de s’assurer d’obtenir un produit de qualité, nous avons contacté Gaspésie Sauvage, qui récolte des produits sauvages dans leurs milieux naturels, pour qu’ils nous fournissent en champignons locaux. Pour différentes raisons organoleptiques, notre choix s’est arrêté sur l’armillaire de miel, la chanterelle en tube et évidemment, la chanterelle commune. Après des mois de dur labeur, ensemble, nous avons créé la Radoune, dont le nom est une dé-


formation de « Au-Ras-des-Dunes » représentant la rivière Morris lovée au creux de la vallée située entre Rivière-au-Renard et Gaspé. Premier gin à base de champignons, ce spiritueux reconnu fait rayonner la flore de chez nous partout au Québec et même en Europe.
La famine liée à la pomme de terre en Irlande entre 1845 et 1849 a tué des millions de personnes et a reçu le nom de « grande noirceur ». La cause de la famine est un champignon nommé « blight » (ou mildiou) qui a infecté la pomme de terre. Cela a forcé des milliers d’Irlandais à trouver refuge ailleurs et certains ont trouvé leur foyer en Gaspésie.
En hommage à cette partie de l’histoire, nous avons appelé la distillerie O’Dwyer : « O » signifiant « descendant de » et « Dwyer » signifiant « noirceur » en gaélique. C’est aussi la raison pour laquelle nous mettons des champignons dans la majorité de nos produits.

Le jardin potager fait partie de notre paysage. Son histoire est millénaire et continue de nourrir la flore et la mémoire mondiale. Dans sa définition du patrimoine naturel, l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) inclut d’ailleurs le concept de jardin. Près de nous, le jardin potager de Mme Rose à Bonaventure est cultivé depuis plus de 130 ans et constitue un patrimoine acadien qui mérite que nous nous y attardions.
André BabinPropriétaire de la maison et du jardin de Mme Rose à Bonaventure
Laurie BeaudoinD’abord, voyons rapidement la définition des mots « jardin » et « potager ». Le jardin est un lieu où on cultive de façon ordonnée des plantes domestiquées. Le potager est, quant à lui,
un jardin ou une partie de jardin où se pratique la culture de plantes comestibles. En règle générale, tout jardin possède un potager, même les plus célèbres comme les jardins de Versailles.
Le jardin de Mme Rose Lors de l’exposition Maisons mémoire : La maison de Mme Rose présentée en 2021 au Musée acadien du Québec à Bonaventure, nous avons désiré souligner l’importance
de ce patrimoine. Le projet Maisons mémoire s’oriente d’abord sur le patrimoine bâti. Son but est de transmettre l’histoire d’une maison par des objets et des souvenirs afin de faire connaître et estimer la richesse et la diversité du patrimoine bâti acadien au Québec, mais aussi sensibiliser les publics à sa conservation.
En collectant les récits de mémoire pour l’exposition, il est devenu clair que l’histoire de la maison de Mme Rose est indissociablement liée à celle de son jardin. La culture du potager par cinq générations est un incroyable exemple de pratique alimentaire par des familles acadiennes de notre territoire.
Comment nos fruits et légumes favoris sont-ils arrivés dans nos jardins?
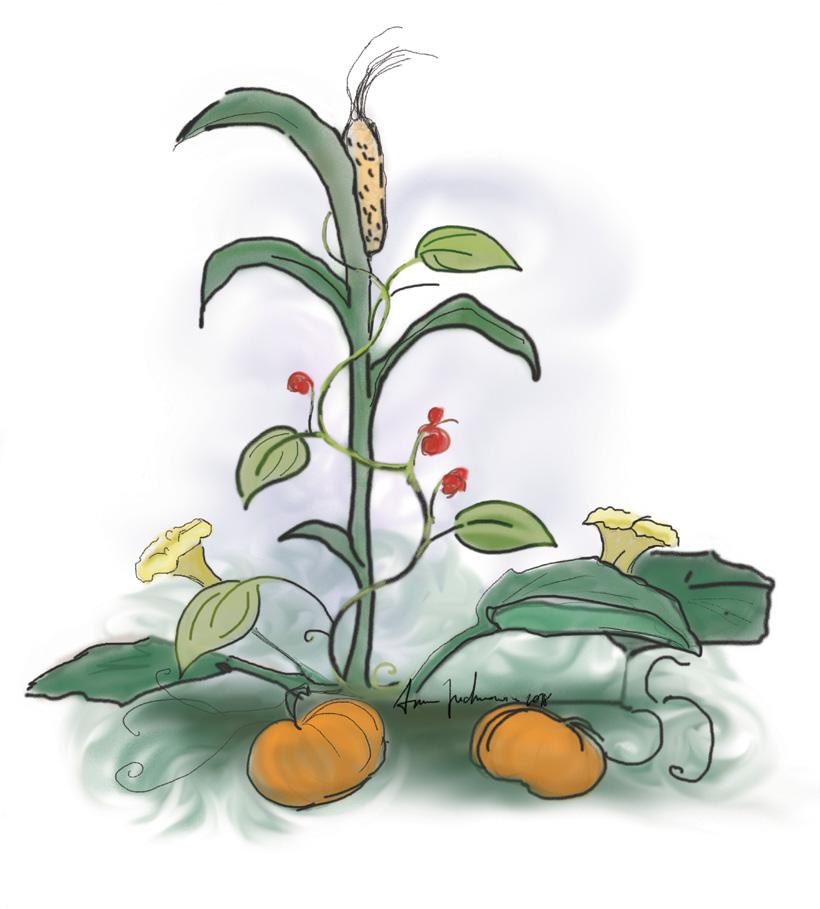
Le jardin potager est une forme agricole domestique qui joue un rôle majeur dans l’acclimatation et le développement de différentes espèces végétales. En effet, le potager est un lieu où nous testons et adaptons les plantes destinées à la consommation. C’est aussi la forme d’agriculture la plus répandue.
Pensons à l’incroyable ingéniosité de la technique ancestrale de culture des trois sœurs (maïs, courge et haricot) développée par les Mayas et
étendue à une bonne part de l’Amérique du Nord, notamment chez les Iroquoiens du Saint-Laurent; ou encore aux spécialités italiennes que nous devons à la « tomatl », nom aztèque donné au fruit originaire d’Amérique centrale. Si à une certaine époque la tomate a provoqué méfiance et dégoût, elle est depuis la fin du 19e siècle un symbole de la cuisine italienne et cette révolution, nous la devons d’abord à sa culture potagère.
Dès leur arrivée en Amérique, les colons français s’intéressent aux ressources locales. Les racines de la cuisine acadienne se trouvent d’ailleurs dans la relation entre les Acadiens, les Mi’gmaqs, la flore et leur territoire maritime d’accueil.
Si l’utilisation des espèces indigènes comme la courge et le haricot est d’abord timide dans le potager des Acadiennes et des Acadiens, l’impact demeure durable. La culture culinaire acadienne, avec son fricot à base de pomme de terre, ses fayots et sa salade de passe-pierre (nom acadien donné à la salicorne, aussi appelée plantain maritime), témoigne de cette relation entre les peuples et leur territoire. De bien des façons, l’alimentation est utilisée afin de communiquer une appartenance identitaire à l’Acadie et permet symboliquement de rattacher le passé au présent.
En 1979, lorsqu’il achète la maison de Rose Bujold avec sa conjointe Diane Arsenault, André Babin s’intéresse immédiatement au jardin. Cette aventure débute à leur retour en région gaspésienne au moment où ils cherchent à acheter une première propriété. Ils parlent alors avec les gens de leur entourage puisque les propriétés sont rares sur le marché immobilier de l’époque, tout comme celui d’aujourd’hui.

C’est la mère d’André, Thérèse Poirier, qui leur rapporte en premier une potentielle mise en vente. Elle
leur dit : « j’ai joué aux cartes avec des amies hier soir et l’une d’elles, Rose Bujold, pense bientôt vendre sa maison ». Il n’en faut pas plus pour organiser une rencontre chez elle, au 216 route Henry à Bonaventure, à quelques jours de Noël 1978. Le coup de cœur est instantané. Un avant-midi à boire du thé, manger des galettes et discuter, et elle accepte de leur vendre la maison à une condition, celle d’y vivre encore un an. La vente est conclue.
Qui est Mme Rose Bujold?
Née en 1920 dans le secteur de Cullen’s Brook à Bonaventure, elle épouse vers 1940 Stanislas Poirier (1903-1971) et emménage dans la maison familiale de son époux. Construite vers 1890, la maison se situe à quelques centaines de mètres de la maison de son enfance. Après ses noces, elle habite avec son mari, les parents, une tante et les frères et sœurs de ce dernier. Mme Rose rapporte qu’il y a un temps où 18 personnes vivaient dans la maison. Le couple n’aura qu’un seul enfant, une fille, Alida Poirier (1942-2008).
Rose, comme bien des femmes de son époque, est de toutes les besognes. Elle s’occupe à la ferme,
au poulailler, à la porcherie, au jardin potager et aux ruches. De plus, Rose voit au bon fonctionnement du couvoir coopératif de Bonaventure dont Stanislas est le gérant. Plusieurs habitants·es du secteur se souviennent également d’elle comme sage-femme et habilleuse pour les mariages. Après la fermeture du couvoir, ils achètent le magasin général situé au coin des routes Henry et Saint-Georges. Celui-ci est en service jusqu’au décès de Stanislas, en 1971, après quoi Mme Rose prend sa retraite. Au moment d’écrire ces lignes, Mme Rose, à 102 ans, et habite le Centre d’hébergement de soins de longue durée (CHSLD) de Maria.
Cultiver un jardin centenaire
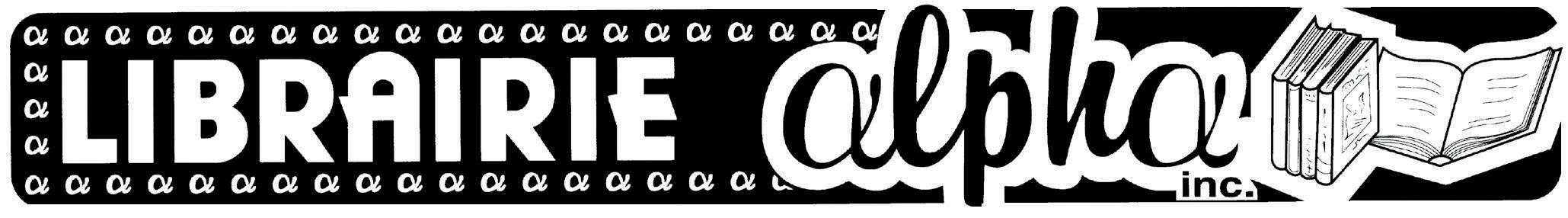
Lorsqu’il acquiert la maison presque centenaire de Mme Rose, André prend conscience du grand jardin avec ses plantes vivaces qui ont traversé plusieurs générations et de l’histoire de la propriété qui s’étend au-delà de ses murs. À leur prise de possession, le jardin est cultivé depuis plus de 80 ans au même endroit, sans interruption. André et Diane décident de poursuivre la conservation de ce patrimoine d’exception.

« Nous avons grandi avec l’influence de plusieurs personnes et de leurs jardins. De mon côté, ce fut celui de ma grand-mère Alma avec ses rangées de légumes et de fleurs, du champ de patate de mon grand-père Alexis et finalement dans le jardin de ma mère. Pour Diane, celui de ses parents producteurs maraîchers. Le jardin que nous a légué Mme Rose
nous a aussi influencés à reprendre le flambeau. Nous formions une belle équipe pour prendre soin de ce coin de pays avec une belle terre fertile » raconte André Babin.
Pour André, ses racines familiales et acadiennes ont influencé sa pratique de jardinage. La continuité de ce patrimoine lui procure une alimentation saine, de proximité et de fraîcheur, mais aussi un grand divertissement. « Du temps de mon enfance, nous attendions le vendeur de semences qui passait de village en village. Pour mes grands-parents, l’important était d’avoir beaucoup de pomme de terre, de légumes frais et de légumes de conserve sans oublier les petits fruits sauvages pour les confitures. Aujourd’hui, nos jardins accueillent de nombreuses variétés grâce aux catalogues et à Internet. Les techniques aussi sont différentes. J’ai plaisir de voir et de participer à cette évolution. »


Le téléroman L’ombre de l’épervier connaît un vif succès lors de sa diffusion en 1998 et en 2000, particulièrement en Gaspésie puisque l’histoire s’y déroule. Les tournages extérieurs sont filmés au parc national Forillon. De nombreuses personnes du coin y collaborent de diverses manières. On pense bien sûr aux figurants·es, mais plus surprenant, l’un d’eux se voit confier la tâche de créer des jardins potagers fidèles à ceux des familles gaspésiennes dans les années 1920, époque où se déroule l’intrigue.
Horticulteur et résident de L’Anse-au-Griffon
Rédigé par Marie-Josée Lemaire-Caplette Rédactrice en chef
Pour Allen Synnott, l’aventure commence à l’automne 1996 alors qu’il est envisagé de tourner les scènes du téléroman sur son terrain et sur celui de son voisin à L’Anse-au-Griffon. C’est à ce moment-là qu’il rencontre l’équipe de tournage et qu’il parcourt avec eux l’espace. Le projet tombe finalement à l’eau puisque le secteur de Grande-Grave sera
choisi comme lieu. Toutefois, ce n’est que le début de l’aventure pour M. Synnott! Le 23 juin 1997, Allen reçoit un coup de fil du responsable des décors extérieurs qui a remarqué l’imposant potager de M. Synnott sur son terrain lors de sa visite. La demande est simple de prime abord : concevoir deux potagers d’antan avec des récoltes « à terme ».
Avant de lui accorder officiellement le contrat, le responsable lui demande un croquis du grand potager qui fera environ 30 pieds (9 mètres) de large par 40 pieds (12 mètres) de long. Tout de suite, Allen pense à sa grand-mère Rosanne Sylvestre (1905-1996) qui était une excellente jardinière et une cuisinière hors pair. Ayant eu 19 enfants, elle pouvait compter
sur le potager qui fournissait les légumes pour que toute la famille ait le ventre bien plein. Cette dernière étant récemment décédée, il demande à sa mère Cécile Côté de dessiner le croquis. Cette dernière a hérité du pouce vert, mais surtout des connaissances de sa mère en matière de jardinage. Le croquis est immédiatement accepté, mais la demande se complexifie à l’annonce de l’échéance : tout doit être en place pour le 8 août, ce qui laisse environ un mois et demi!
De la semence au potager Allen Synnott possède les Serres Synnott de 1989 à 2017. Il détient un diplôme de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec en horticulture ornementale, en plus d’avoir suivi diverses formations comme producteur de serres. Mais pour lui, le plus important est le savoir des Anciens. Allen possède donc l’expertise pour réaliser ces


potagers, le défi est le temps.
Ne disant jamais non, Allen Synnott se met en mode débrouillardise. Nous sommes à la fin juin, tout a été vendu et les serres sont vides. Qu’à cela ne tienne, on repart des semis et on fait pousser les légumes en serres pour accélérer leur croissance. Carottes, tomates, rutabagas, pommes de terre, fèves, etc., sont ainsi plantés. On fait preuve d’ingéniosité, par exemple, les choux poussent dans des pots d’un gallon afin d’arriver à maturité.

Après un délai d’une petite semaine supplémentaire, le grand jour arrive et la plantation en terre a lieu le 16 août 1997. Ça demande une grosse journée de travail de transplanter tous les légumes en rangs bien droits. L’entretien et l’arrosage seront assurés par l’équipe de tournage. Celle-ci en profite aussi pour piger dans le potager et se régaler des légumes. À la fin du projet, il en reste toutefois beaucoup et c’est l’organisme Blanche-Goulet qui se voit remettre la récolte.


Conseiller en tous genres
L’équipe de tournage n’hésite pas à consulter Allen Synnott lorsqu’elle se bute à des obstacles en tous genres. Allen se souvient entre autres que le gazon, alors bien jaune, doit devenir vert pour « avant hier ». Il se retrouve donc à peindre le gazon avec un produit spécial sans danger pour la nature, en plus d’étendre du sulfate de fer qui fait verdir l’herbe.
Les scènes intérieures sont tournées à Montréal; on y voit des arbres matures par les fenêtres. Lors du tournage extérieur, on remarque
qu’il n’y a aucun arbre devant les maisons. On demande alors à M. Synnott rien de moins que d’en planter! Allen part ainsi en tracteur sur sa terre à bois et déracine des bouleaux qu’il met en pot. Le lendemain matin, ils sont tous morts. Il recommence avec d’autres essences, sans succès. Puis, il a une idée! Il va chez ses parents qui possèdent des pruniers importés par Blanche Bernard, une voisine, de la baie des Chaleurs. Les pruniers résistent et Allen fournit donc 15 de ces arbres en pot. Un seul sera finalement utilisé.
Ces anecdotes illustrent les défis occasionnés par le tournage et l’ingéniosité des gens en coulisses pour les relever. Toujours aussi passionné, Allen Synnott se remémore ses moments avec plaisir, mais c’est surtout le souvenir du savoir transmis par sa grand-mère et sa mère qui le rend fier et lui met le sourire aux lèvres.
Elsie Reford (1872-1967) est surtout reconnue pour avoir façonné un domaine horticole aux portes de la Gaspésie; ses jardins auront 100 ans en 2026. À la suite de leur ouverture au public le 24 juin 1962, les Jardins de Métis sont devenus avec le temps un des fleurons de la région et un de ses attraits les plus fréquentés. C’est le premier investissement majeur du gouvernement Lesage pour créer des pôles d’attraction sur la route touristique de la Gaspésie.

Au moment de son ouverture en 1962, on vante le Domaine Reford (le site porte le nom de Jardins de Métis seulement depuis 1978) et sa collection de « plantes ornementales ». Aujourd’hui, les spécialistes en horticulture divisent les plantes entre plantes exotiques et plantes indigènes. Et le plus souvent, on ajoute deux autres catégories, soit les plantes naturalisées et les plantes envahissantes. Les plantes naturalisées sont des plantes exotiques qui se reproduisent naturellement dans leur nouvel environnement, comme le Rosa rugosa ou la Marguerite blanche.

Les plantes exotiques envahissantes modifient l’écosystème naturel, comme l’Érable de Norvège, la Berce de Caucase ou le Phragmite, et font partie de celles contre lesquelles on lutte pour les enlever ou les contrôler.
La valorisation des plantes indigènes du Québec prend de l’ampleur après qu’Elsie a quitté la scène. Les guides Fleurbec commencent à se promener dans les mains des randonneuses et randonneurs, et des botanistes à partir de 1975, en initiant plusieurs à la reconnaissance des plantes indigènes autour de nous. Où se situe donc Elsie
Reford dans la culture et la mise en valeur des plantes indigènes de la vallée du Saint-Laurent? Autodidacte, elle commence son jardin à l’été 1926. L’histoire familiale raconte qu’Elsie, alors atteinte d’une appendicite, doit laisser de côté pour l’été sa vraie passion, la pêche au saumon. Le jardinage est conseillé par son médecin; une activité plus sereine pour une femme « fragile » en récupération de chirurgie. Elle a alors passé le cap des 54 ans.

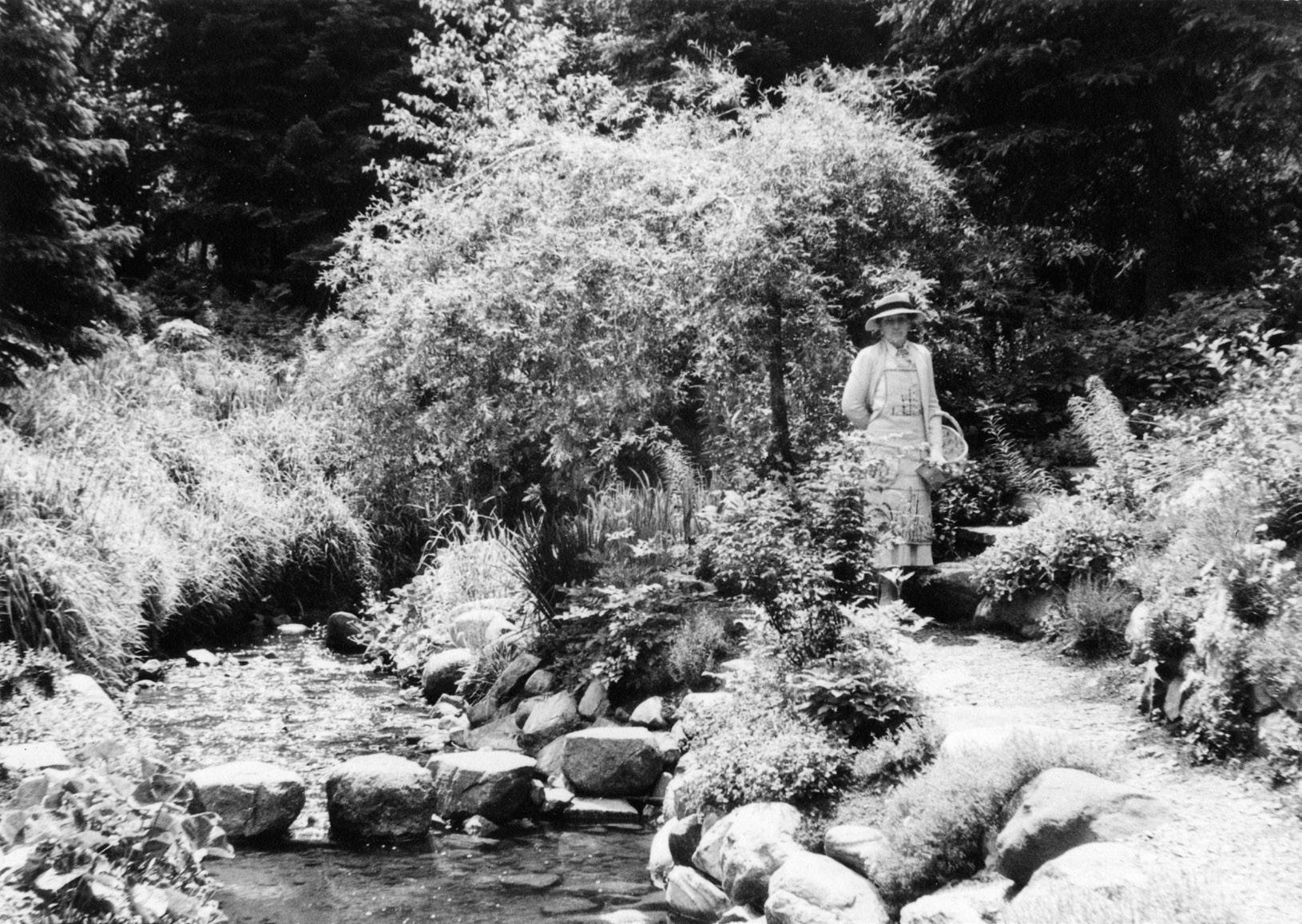
32 ans de passion
Elsie Reford commence son travail de jardinière. Elle arrête seulement à la fin de l’été 1958, à l’âge de 86 ans. Tous les jours, ou presque, de mai à octobre, pendant 32 ans, ses carnets de notes témoignent de son amour pour le jardinage et de son intérêt pour les plantes et leur rendement à Grand-Métis. Elle réussit à implanter et à cultiver sur son domaine des dizaines d’espèces exotiques, la plus remarquée étant le pavot bleu provenant de l’Himalaya. Bien avant l’apparition des cartes de zones de rusticité des plantes d’Agriculture Canada, son jardin est un champ d’essai. « Trial and error » (essaierreur) est son guide. Son portefeuille et sa patience l’aident à implanter des espèces rares (et coûteuses) pour voir leur capacité à résister au climat du bord du fleuve
Saint-Laurent. Subissant un échec une année, on change telle plante de place (de même que de sol et de fertilisant) l’année suivante. Elle cumule les échecs, mais ses réussites sont nombreuses.
Dès la fin des années 1930, elle commence à partager ses succès avec les plantes dans des articles qu’elle écrit pour des revues spécialisées publiées au Royaume-Uni et aux États-Unis, notamment ceux de la Société royale d’horticulture de
Londres et de la North American Lily Society.
Le défi des plantes exotiques
Elles aussi jugées « fragiles », les plantes exotiques sont devenues pour elle un défi horticole sans pareil. Et malgré la qualité de ses jardiniers, elle vante surtout le climat comme l’allié naturel le plus aidant, car la neige hâtive l’hiver ainsi que la fraîcheur et l’humidité l’été offrent aux plantes exotiques les conditions idéales pour favoriser leur acclimatation dans un écosystème fort différent de leur habitat naturel. On calcule environ 3 500 espèces, variétés et cultivars dans sa collection, une collection qui a peu d’équivalent au Canada dans les années 1930, à l’exception du Jardin botanique de Montréal, des Jardins Burlington en Ontario et des jardins de Jennie Butchart à Brentwood Bay, près de Victoria en Colombie-Britannique. Même si le vocabulaire distingue la plante exotique de l’indigène, pour le jardinier ce clivage n’est pas important. Elsie Reford est plutôt motivée par le désir de pouvoir offrir une floraison sur une saison entière. Le jardin est une pièce de théâtre, il y a des vedettes horticoles et plusieurs acteurs dans un second rôle. On
parle de plus en plus de « scénographie horticole », reconnaissant que le jardin et ses plantes sont un ensemble et que la jardinière ou le jardinier est à la fois auteur, chorégraphe, metteur en scène et technicien. Les plantes indigènes et exotiques sont utilisées pour leur force et leur beauté, de même que les plantes annuelles sont incorporées pour ajouter couleurs de floraison ou de feuillage, hauteur ou parfum. L’aménagement de son jardin est aussi inspiré des principes et exemples du « wild gardening » ou jardinage sauvage, un mouvement né en Angleterre à la fin du 19e siècle, sous l’influence du jardinier et écrivain irlandais William Robinson, auteur du livre The Wild Garden (1870). Ce mouvement favorise l’intégration des plantes indigènes et exotiques.
Les plantes indigènes sont importantes aux yeux d’Elsie Reford. Au début, elles jouent un rôle secondaire. Avec le temps, elle apprend que certaines plantes d’ici sont essentielles. Par exemple, bien avant que les recherches des dernières décennies établissent le rôle et la relation entre les arbres et les mycorhizes dans la croissance des racines des plantes, elle lutte pour préserver les arbres. Les épinettes, mélèzes, cèdres, bouleaux, peupliers et sorbiers ne sont pas coupés, mais plutôt préservés pour offrir une protection aux plates-bandes et espèces qui poussent à leurs pieds. Leur forme et leur écran vert offrent aussi une arrière-scène fort importante pour mettre en vedette les espèces pleines de couleurs. Des arbres exotiques, notamment des pommiers, pommetiers, marronniers, noyers et aubépines sont ajoutés pour bonifier la forêt de feuillus.
Un vaste terrain de jeux
Dotée d’un domaine de près de 1 000 acres avec des boisés, des champs, des cours d’eau et les rives de la rivière Mitis sur plus de quatre kilomètres, Elsie Reford ne
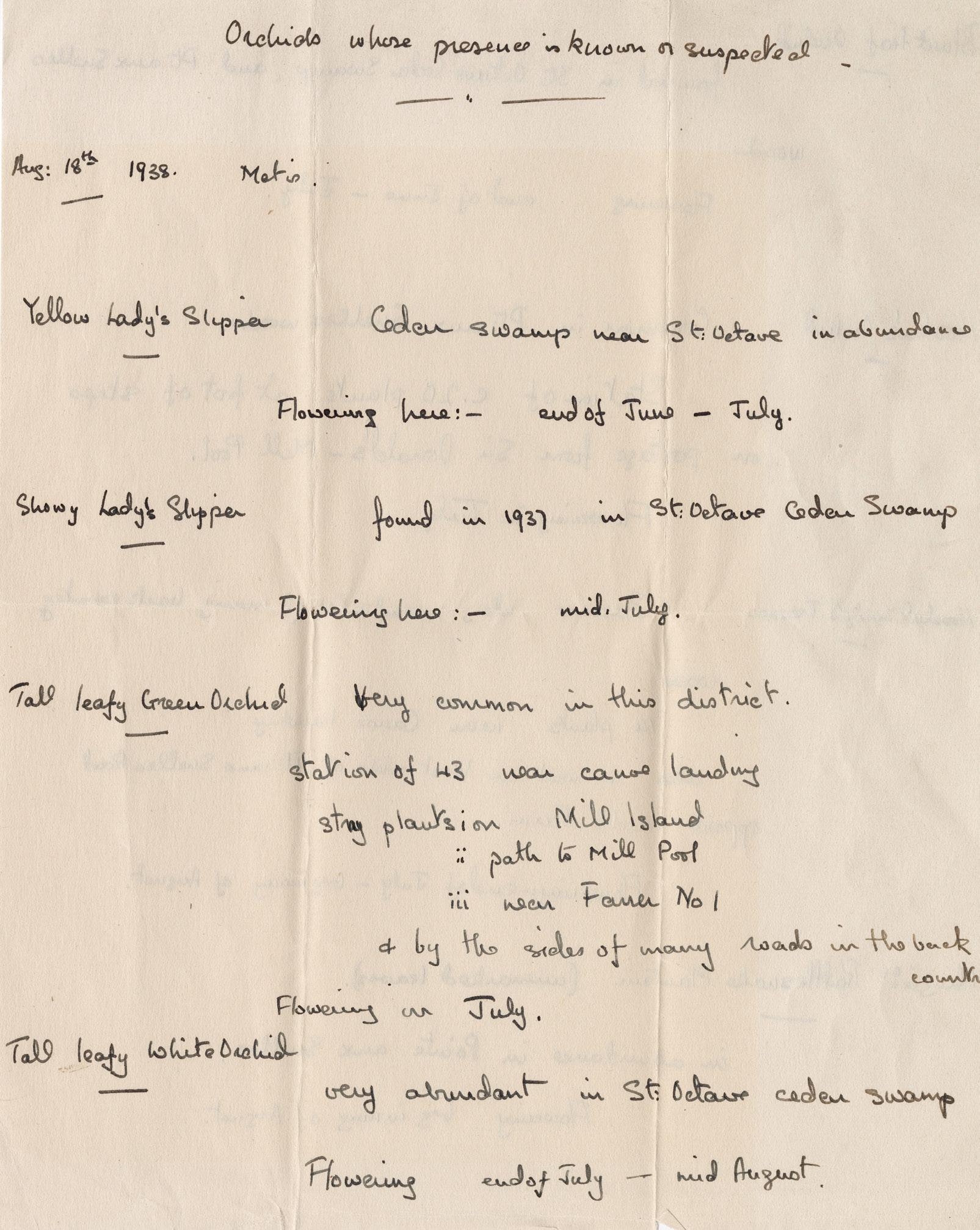
manque pas d’endroits pour prélever des plants dans leur milieu naturel. Mais ses explorations en « touring car » (voiturette de tourisme) pour montrer les beautés de la région avec ses invités·es sont transformées en explorations botaniques. Elle fait souvent la cueillette en milieu naturel (ce qui est fortement déconseillé et même contraire à la loi aujourd’hui). Souvent, son carnet indique que ses yeux d’horticultrice sont toujours en alerte. Et que sa pelle, sa truelle et son seau ne sont jamais loin. On a donc des talles de cypripèdes (Cypripedium parviflorum) et des colonies de fougères qui sont le fruit de ses explorations
botaniques il y a plus de 80 ans. Son intérêt pour les orchidées indigènes, qu’elle a même légué à son petitfils Robert, qui explore avec elle les fossés et les boisés, a fait de lui un orchidophile et un ornithologue averti.
Son amour des lys engendre une de ses grandes déceptions comme collectionneuse, car le Lis du Canada (Lilum canadense), la seule espèce indigène du lys, ne lui offre que des échecs. Le lys pousse et fleurit pour elle, mais ne survit pas aux hivers. On a réussi à l’implanter ces dernières années, mais le criocère du lys, un insecte envahissant du Japon, nous offre des défis
qu’Elsie Reford n’a pas eu à relever. De domaine privé à jardin populaire
Le frère Marie-Victorin connaît bien la Gaspésie. Est-ce que l’auteur de la bible des plantes indigènes du Québec, Flore laurentienne, est une inspiration pour Elsie Reford? Leur
correspondance est muette sur le sujet, mais on croit que MarieVictorin fait partie des « experts botaniques » cités dans son carnet, qui se sont arrêtés pour voir son domaine à Grand-Métis et qui l’ont quitté fort impressionnés. On sait que son bras droit, Henry Teuscher, architecte-paysagiste et
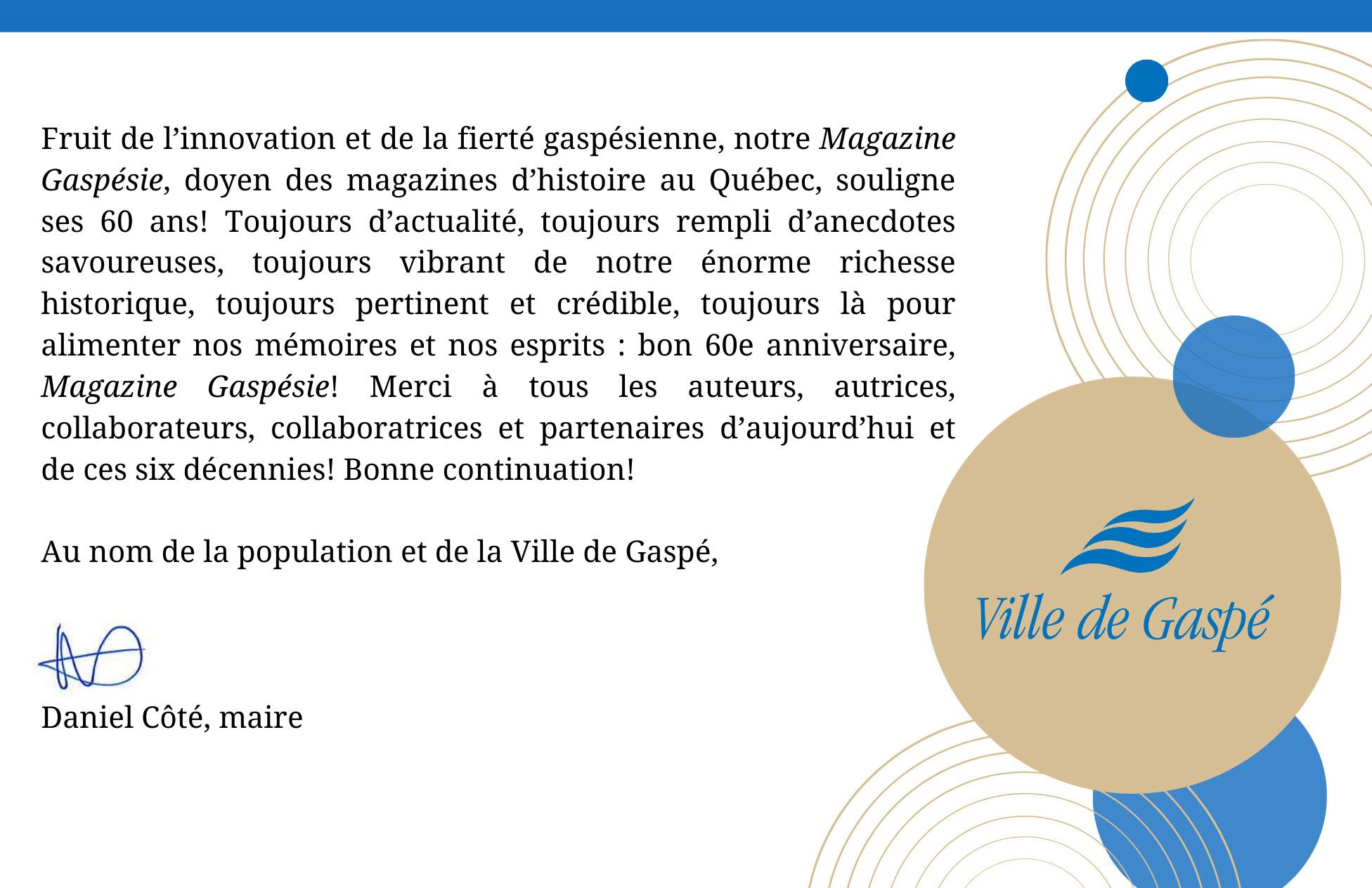
concepteur du Jardin botanique de Montréal, s’y est arrêté plus d’une fois. Après une première visite en 1940, Teuscher et Elsie Reford s’échangent des plantes. Teuscher fait la promotion de l’œuvre d’Elsie dans ses conférences à Montréal et à New York. C’est grâce à son enthousiasme et à sa réputation que les jardins d’Elsie Reford ont été sauvegardés, ayant convaincu le gouvernement qu’un domaine privé aux portes de la Gaspésie pouvait devenir un jardin public et populaire.
Aujourd’hui, on reconnaît l’avantgardisme dans l’approche d’Elsie Reford. Son jardin est témoin d’une époque, mais aussi d’une approche écologique moderne. Elle était une femme exotique, mais qui s’est naturalisée. Son jardin demeure un heureux mélange de plantes de diverses régions du monde, dont bon nombre de la région qu’elle a transformées avec son jardin.
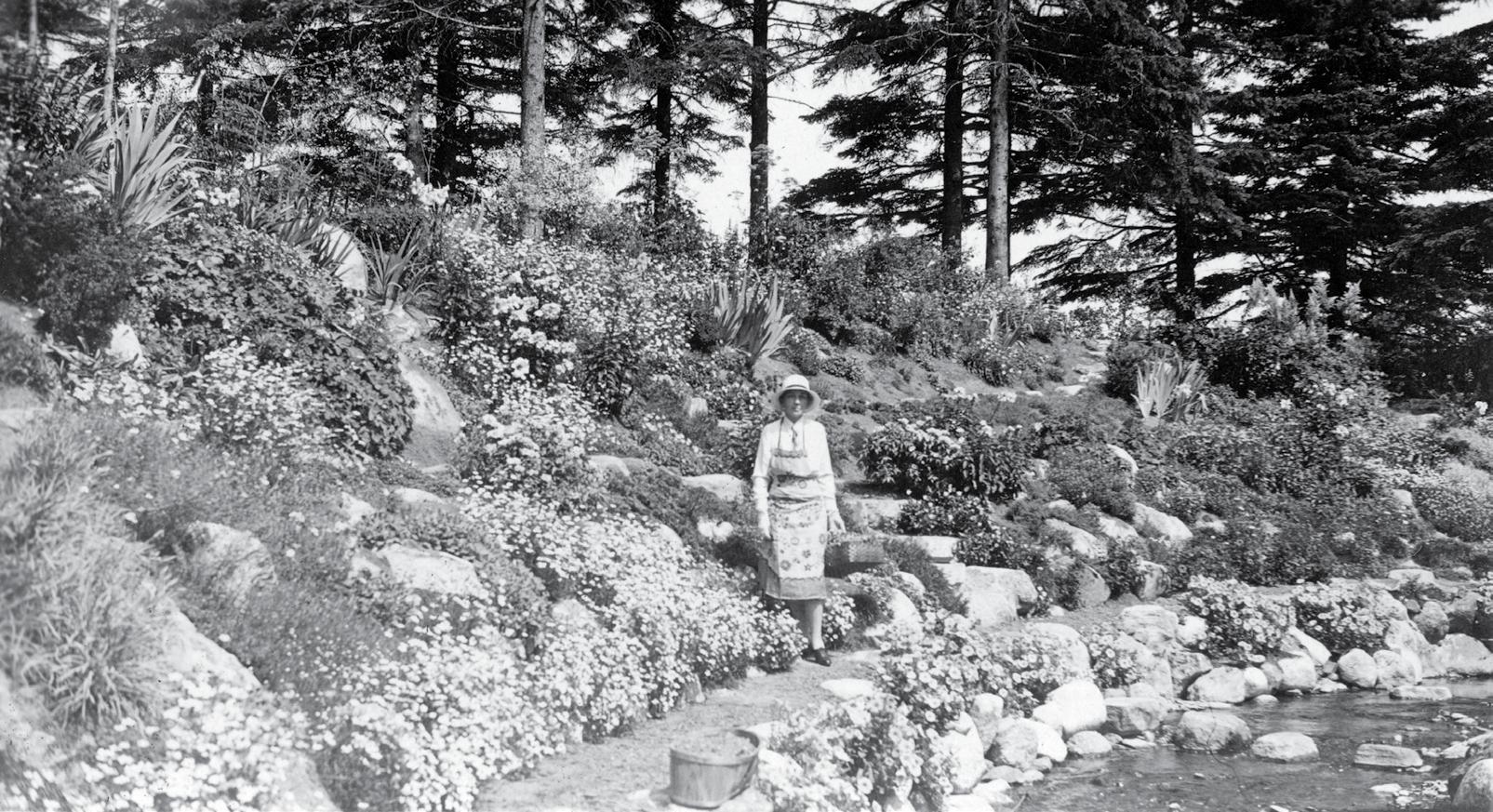 Elsie Reford dans le jardin du ruisseau, vers 1930.
Elsie Reford dans le jardin du ruisseau, vers 1930.
Il est toujours pertinent de parler du traitement des documents offerts par les donatrices et donateurs puisque c’est une étape très importante dans un centre d’archives. Plus particulièrement, il est intéressant de se pencher sur ce que révèle le traitement. Prenons en exemple deux petits fonds d’archives de deux dames importantes pour l’histoire et le patrimoine de la Gaspésie : Eugénie Lalonde Ranger et Carmen Roy.
Le traitement des archives est une étape cruciale permettant une bonne conservation et menant vers une mise en valeur adéquate. Contrairement à la croyance populaire, les documents ne font pas que dormir sur une tablette! Le Centre d’archives souhaite permettre une consultation simple et efficace d’un fonds ou d’une collection d’archives conservés entre ses murs. En premier lieu, il faut prendre en compte l’entièreté des documents donnés. Par la suite, l’archiviste, une ressource à contrat ou un·e bénévole ayant reçu une formation de l’archiviste divise ces documents selon des thématiques précises que nous nommons série. Il se peut que les thématiques puissent être aussi subdivisées.
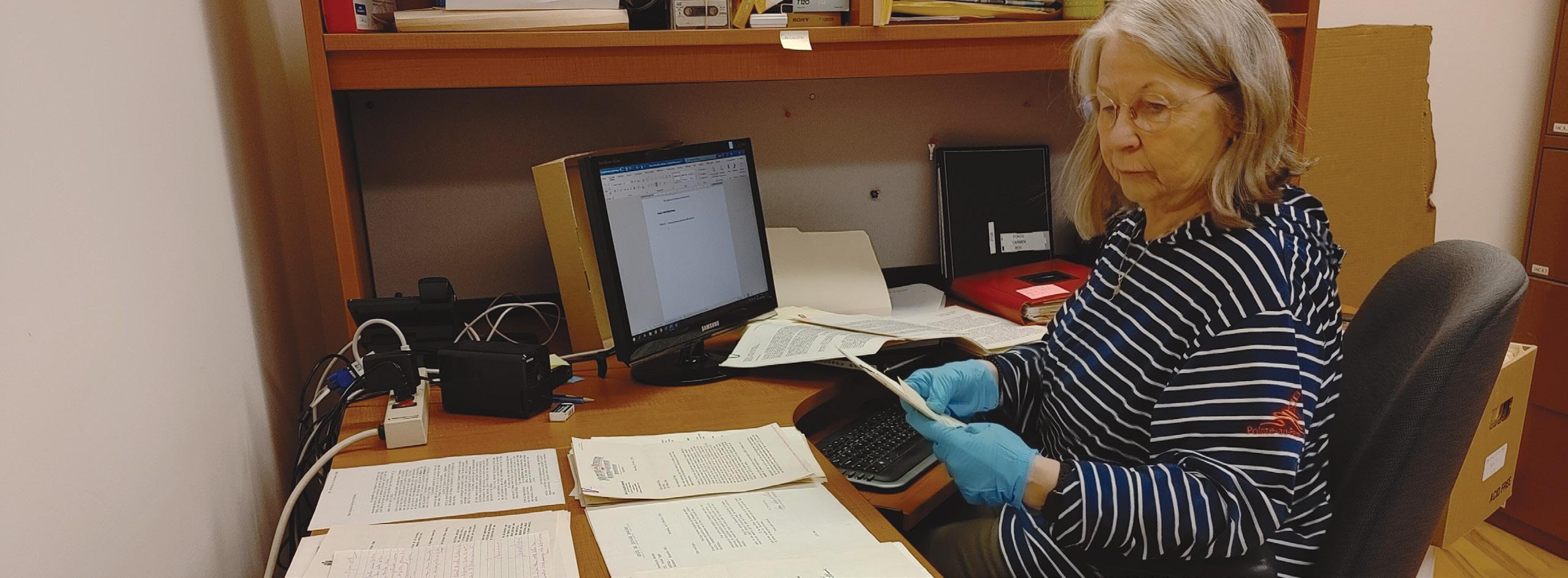
La personne responsable du traitement doit, entre autres, enlever les broches, car elles rouillent, sortir les photographies des albums et s’assurer que les cartes demeurent à
plat. Lorsque cette étape est terminée et que les documents sont mis dans des chemises sans acide, c’est la description qui débute. Elle mène à la composition d’un document nommé « instrument de recherche » ou « description des dossiers ». Dès lors, toutes les personnes qui se présentent au Centre d’archives peuvent consulter ce document et ainsi être en mesure de connaître le contenu des fonds et des collections d’archives. Il n’y a pas de consultation sans traitement! Idéalement, les documents sont ensuite numérisés. Cela favorise la diffusion, car le public ne pouvant se rendre au Centre d’archives a ainsi l’occasion de les consulter. C’est une longue étape qui demande beaucoup de ressources. Depuis quelque temps, le Musée de la Gaspésie se donne les moyens d’y arriver peu à peu.
Allons-y maintenant avec deux exemples concrets de traitement de fonds d’archives, récemment
effectués par Élaine Réhel, bénévole au Centre d’archives.
Fonds Eugénie
Lalonde Ranger
Eugénie Lalonde Ranger naît à Vaudreuil le 6 juillet 1878. Elle mène une carrière journalistique en écrivant entre autres pour La Patrie. S’intéressant énormément à la biologie et à la géologie, elle passe ses vacances d’été à Percé, et ce, pendant plus de 48 ans! Elle profite de l’endroit pour parfaire ses recherches sur ses deux sujets de prédilection et crée son musée de Percé.
Pionnière dans la région, elle lègue ses archives à la toute jeune Société historique de la Gaspésie en 1964. Elle y adhère l’année précédente et collabore plusieurs fois à la Revue d’histoire et de traditions populaires de la Gaspésie (l’ancêtre du présent Magazine Gaspésie).
Le traitement nous permet de comprendre l’implication de
Marie-Pierre Huard Archiviste, Musée de la GaspésieMme Lalonde-Ranger dans le milieu culturel et géologique de la péninsule. La correspondance décrite nous renseigne sur les relations qu’elle a avec Michel LeMoignan, Claude Allard, Mireille Éthier, en plus d’évoquer Paul Dansereau. Le traitement nous permet aussi de classer convenablement tous les documents en lien avec la création de son musée de Percé, tous les articles qu’elle écrit sous différents pseudonymes ainsi que ses cahiers de notes dont un sur les sciences occultes!
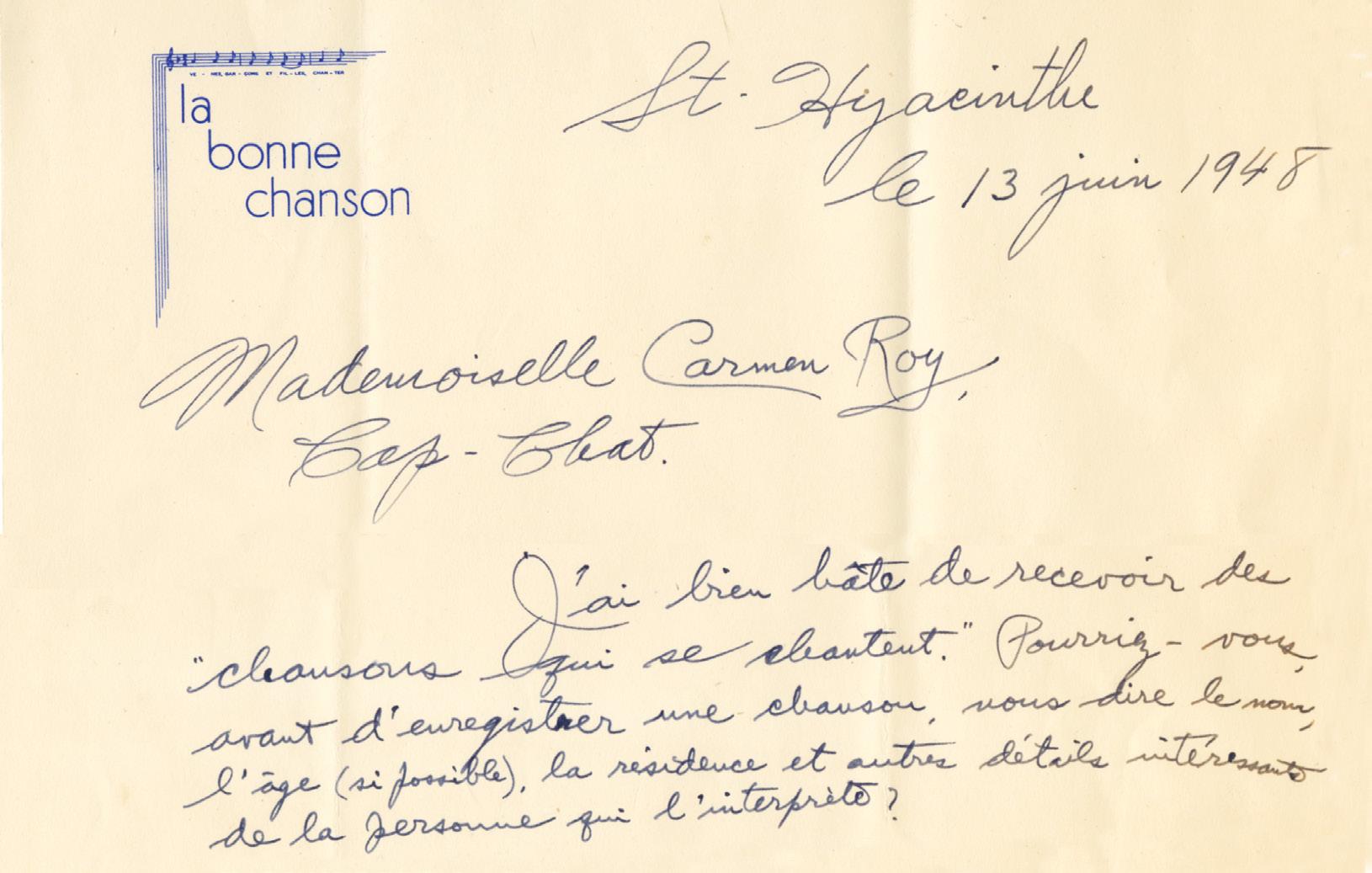

Fonds Carmen Roy Carmen Roy naît à Bonaventure le jour de Noël 1919. Elle grandit à Cap-Chat. C’est Marius Barbeau qui l’initie au monde folklorique alors qu’elle fait ses études à l’Université Laval, et ce, dès 1947. Pendant les quatre années qui suivront, Carmen Roy entreprend un grand projet d’enquête orale en Gaspésie

qui la mène vers l’écriture de sa thèse Littérature orale en Gaspésie. Dès le début des années 1950, elle travaille au Musée national du Canada (aujourd’hui le Musée canadien de l’histoire). C’est elle qui sera à la direction du Centre canadien d’études sur la culture traditionnelle lors de sa création au musée en 1970.
Les premiers documents du fonds Carmen Roy sont arrivés au Musée de la Gaspésie l’année de son décès en 2006. D’autres sont donnés en 2013 et en 2022. Le traitement effectué par notre bénévole nous permet de connaître la grande diversité des documents, et ce, même si elle dispose de deux autres fonds d’archives conservés dans deux autres institutions différentes. Le très grand nombre de photographies personnelles nous permet de voir cette grande dame de
l’ethnologie et du folklore différemment. La correspondance, maintenant bien classée, nous informe sur les relations professionnelles qu’elle entretenait et les sujets qui l’animaient. En effet, nous apprenons qu’elle avait un projet très précis de créer un musée d’histoire et de traditions populaires à Percé dès 1954. Grâce aux enregistrements sonores décrits, le public peut écouter une conversation entre elle et l’artiste Suzanne Guité en 1980.
Vous venez de lire deux petits exemples parmi tant d’autres évoquant l’importance du traitement des fonds d’archives. Sans cette étape, le Musée n’est pas en mesure de bien conserver et connaître le contenu des boîtes qu’il a le privilège de sauvegarder. Et dans ce cas, il demeure impossible d’aller vers une diffusion optimale!
Portraits de quatre jeunes femmes; Carmen Roy est la deuxième en partant de la gauche, 1938. Musée de la Gaspésie. P106 Fonds Carmen Roy. Extraits d’une lettre envoyée à Carmen Roy par Charles-Émile Gadbois, créateur du recueil La Bonne chanson. Il indique ses instructions concernant la collecte de données que Carmen Roy s’apprête à effectuer, 1948.
Autrefois, la fabrication des tonneaux représente l’un des savoir-faire les plus importants au sein des communautés de pêcheurs en Gaspésie. Ils sont employés autant pour l’entreposage des denrées que pour le transport de celles-ci, et surtout pour l’exportation de la morue séchée salée. Plusieurs des outils nécessaires à la confection des tonneaux sont communs à la menuiserie, comme les compas, les vilebrequins, les rabots, les haches et les scies. Ainsi, cette chronique ne dresse pas un inventaire exhaustif de tous les outils utilisés ou de toutes les étapes nécessaires à leur fabrication, mais elle se penche plutôt sur quelques pièces parmi les plus intéressantes conservées dans les réserves du Musée de la Gaspésie en lien avec la tonnellerie.
Vicky Boulay Conservatrice, Musée de la GaspésieLe façonnage des douves (douelles)
Une étape importante est le façonnage des douves ou des douelles, c’est-à-dire des pièces de bois qui
forment le corps des tonneaux. Le principal outil employé à cette étape est la plane. En tonnellerie, elle est utilisée pour exécuter les opérations de parage et de vidage. Le parage
consiste à arrondir l’extérieur de la douve afin de lui donner une courbe suivant la circonférence du tonneau alors que le vidage est l’opération par laquelle la surface intérieure
d’une douve est façonnée afin de la rendre concave.
Contrairement à la plane qui est un outil commun en menuiserie, le jabloir est un outil exclusif à la fabrication des tonneaux. Il a pour fonction est de créer le jable, c’est-à-dire la rainure qui est pratiquée à l’extrémité des douelles d’un tonneau pour y fixer le fond.
La tille de l’île Jersey Une tille est une petite hache en forme d’herminette, dont le fer est perpendiculaire au manche et le tranchant recourbé vers celui-ci. Très courte, elle est manipulée d’une seule main et est adaptée à diverses tâches, notamment pour niveler l’extrémité d’un tonneau. L’intérêt de cet objet est lié à son propriétaire, John Sorsoleil. Entre 1830 et 1835, il quitte l’île Jersey avec sa famille et plusieurs autres pour s’installer à Jersey Cove, un petit hameau situé entre L’Anseau-Griffon et Cap-des-Rosiers dont, le nom rappelle le lieu d’origine de ses habitants·es. Dans cette traversée, il aurait amené avec lui quelques biens, dont cette tille. En 1870, John Sorsoleil, sa famille et ses camarades jersiais ont quitté Jersey Cove. C’est son arrière-petit-fils, Carl O. Nelson, qui a remis cette pièce au Musée de la Gaspésie. Elle constitue une des seules traces matérielles du passage de ces insulaires en Gaspésie.
Joseph Adélard Briard, menuisier
De Joseph Adélard Briard (1909-1994)
de Cap-aux-Os, le Musée conserve deux outils en lien avec la tonnellerie :




une rouanne ainsi qu’une scie à chantourner. Une rouanne est un outil à main permettant d’inscrire sa marque sur les tonneaux. Le tonnelier, le fabricant ou, par exemple, l’agent des accises peuvent appliquer une telle inscription. La scie à chantourner est utilisée quant à elle pour scier en rond les fonds des tonneaux d’après le tracé fait au compas. M. Briard est menuisier et a occupé plusieurs fonctions au cours de sa vie. Il a notamment travaillé au phare de Pointe-à-la-Renommée et a participé à la construction des bâtiments du site de Fort-Péninsule durant la Deuxième Guerre mondiale.

Il ne reste que très peu de détentrices et détenteurs en Gaspésie
de ce savoir-faire qui autrefois comptait parmi les habiletés techniques les plus répandues. L’économie de la région étant alors tournée vers l’exportation de ses ressources, les gens qui fabriquent des tonneaux étaient nombreux sur la péninsule. Aujourd’hui, il est possible de visiter l’un des bâtiments du Site historique national de Paspébiac (SHNP) entièrement dédié à l’interprétation et la mise en valeur de ce métier.
Remerciements à Jeannot Bourdages, conservateur du SHNP ainsi qu’à Hubert Briard pour les précieuses informations.
1. Tille ou asse de rabattage de John Sorsoleil, vers 1850. Musée de la Gaspésie 2. Rouanne et scie à chantourner de Joseph Adélard Briard, vers 1950. Musée de la Gaspésie 3. Plane de Joseph Roy de Val-d’Espoir, vers 1930. Musée de la Gaspésie. Don de Denis RoyEn 1915, les Fusiliers du St-Laurent (189e bataillon), sous le commandement du lieutenantcolonel Philippe-Auguste Piuze, entreprennent une campagne de recrutement en Gaspésie. Bien que la grande majorité des soldats enrôlés par le 189e sont, selon la terminologie de l’époque, des Canadiens français, un bon nombre d’anglophones et d’Autochtones se sont joints à eux.
Parmi les nouvelles recrues, on retrouve Frank Narcisse Jerome de Gesgapegiag. Né le 17 juillet 1885, son baptême est célébré à l’église Sainte-Brigitte de Maria. Âgé de 29 ans, Jerome s’enrôle le 6 juin 1916 à New Carlisle. Nul ne peut se douter ce jour-là que Frank Narcisse Jerome va devenir un des soldats les plus décorés de toute l’histoire militaire canadienne.
Peu de temps après l’arrivée du 189e bataillon en Angleterre à l’au-
Il est difficile de chiffrer le nombre exact de soldats autochtones qui se sont enrôlés au sein de la Force expéditionnaire canadienne lors de la Première Guerre mondiale à travers le pays. Dans certaines communautés isolées, il y a peu d’intérêt des jeunes hommes à se joindre aux rangs de l’armée, tandis que dans d’autres, les recruteurs sont très peu enclins à accepter les gens issus de ces communautés. Par contre, en Gaspésie, au sein des deux communautés mi’gmaques les plus populeuses, Listuguj et Gesgapegiag, le taux d’enrôlement durant la période 1914-1918 est sensiblement équivalent à celui de la population non autochtone de la région.
 Tom Eden
Tom Eden
tomne de 1916, l’état-major de la Force expéditionnaire canadienne décide d’utiliser ses membres pour renforcer d’autres unités déjà présentes au front. Le rêve de mener un bataillon composé d’hommes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie au champ de bataille se termine ainsi pour le lieutenant-colonel Piuze. Pour Frank Narcisse Jerome, cette tournure d’évènement signifie un transfert au 14e bataillon, le Royal Montreal Regiment.
À la fin novembre 1916, quelques jours après la fin de la Bataille de la Somme, un des chapitres les plus sanglants de la Première Guerre mondiale, Frank Narcisse Jerome arrive au front. Le premier grand rendez-vous de Jerome face à l’ennemi se produit le 9 avril 1917 lors d’une bataille devenue mythique à la crête de Vimy. C’est ici, près de la ville française d’Arras, que pour la première fois de la guerre, toutes les forces canadiennes vont combattre ensemble. Après des mois de
préparation minutieuse, sur un front de sept kilomètres, les Canadiens, sous le commandement du général britannique sir Julian Byng, réussissent à soutirer ce promontoire stratégique des mains des Allemands.
Une bravoure récompensée À la suite de son baptême de feu à Vimy, Frank Narcisse Jerome va suivre une formation sur une arme avec laquelle il va rapidement devenir un expert : la mitrailleuse Lewis. Outil indispensable pour les unités d’infanterie canadienne lors de la Première Guerre mondiale, la mitrailleuse Lewis a une capacité de tir de 550 cartouches de calibre .303 par minute.
L’été et l’automne 1917 vont être particulièrement éprouvants pour les troupes canadiennes. Tour à tour, elles engagent des combats sanglants contre les Allemands à la côte 70, en France, et à Passchendaele, en Belgique. À la suite de
ceci, Frank Narcisse Jerome et le 14e bataillon se retrouvent près d’Arras à la fin novembre 1917. C’est ici que Jerome se voit décerner sa première Médaille militaire pour bravoure.
La Médaille militaire est décernée aux soldats du Commonwealth en reconnaissance d’un ou de plusieurs actes de bravoure. La citation pour la première Médaille militaire que reçoit Frank Narcisse Jerome se lit comme suit : « Pour sa bravoure et son dévouement au devoir… En tant que membre d’un équipage de mitrailleuse Lewis. Sévèrement ébranlé à deux reprises par des explosions d’obus, cet homme continue son service, aide à repousser deux raids ennemis, puis forme volontairement une patrouille pour obtenir des identifications. Son sang-froid sous le feu était une brillante incitation à tous les grades. ».
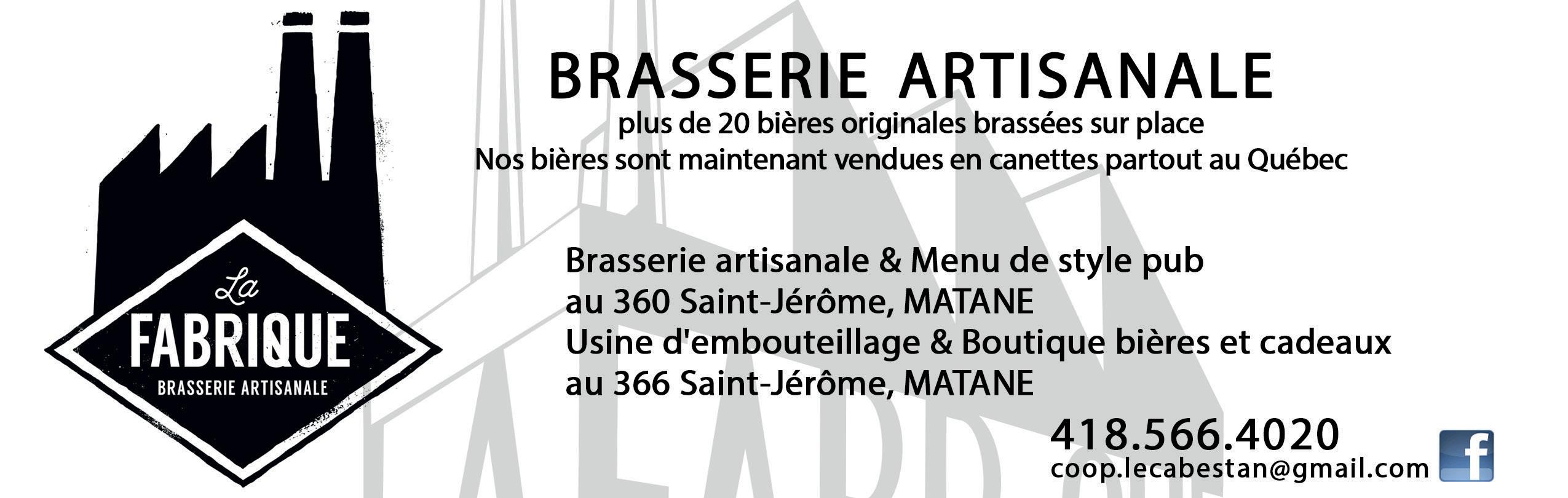
Une reconnaissance toute relative
C’est en 1918 que les Canadiens s’imposent comme des soldats capables de frapper rapidement et de foncer à travers les lignes allemandes avec brio. Avec ses camarades du 14e bataillon, Frank Narcisse Jerome prend de l’assurance et devient un leader respecté pour sa bravoure et sa compétence. Il est décoré de la Médaille militaire à deux autres reprises au cours de cette année et gravit les échelons, se voyant bientôt promu sergent.
En tout, seulement 38 Canadiens se sont vu décerner la Médaille militaire à trois reprises. En fait, le sergent Jerome se retrouve ex aequo avec le caporal Francis Pegahmagabow comme le soldat autochtone le plus décoré de l’histoire militaire canadienne. Bien que Pegahmagabow ait connu une certaine notoriété

dans l’après-guerre, devenant chef de sa communauté, Wausauksing, en Ontario, il en est tout autre pour Frank Narcisse Jerome. Il est retourné à Gesgapegiag après la guerre et a vécu dans un anonymat relatif. En 1926, il épouse Rose Anna Vézina à l’église de Saint-Jules-de-Cascapédia. Jerome décède le 21 juin 1934, quelques semaines avant son 49e anniversaire. Il repose dans le « vieux cimetière » à Gesgapegiag, au coin de la rue Main et du Chemin Eagle, alors qu’une pierre tombale est aussi présente dans le nouveau cimetière derrière l’église Kateri Tekakwhita. Espérons que la mémoire collective permettra de préserver son nom à travers l’histoire.
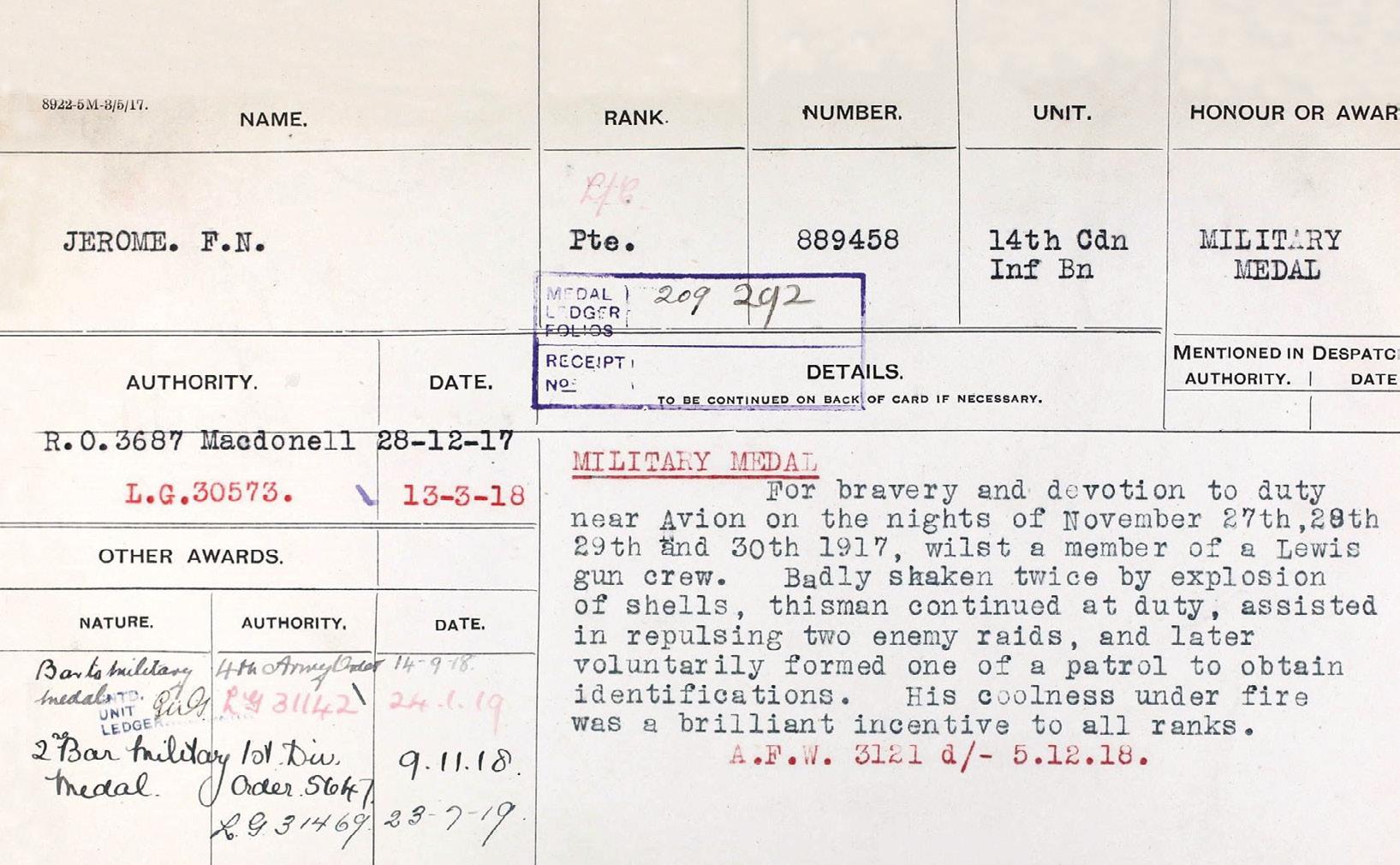 Il n’existe malheureusement aucune photographie de Frank Narcisse Jerome.
Citation de la première Médaille militaire remise à Frank Narcisse Jerome pour bravoure, 1918. Bibliothèque et archives Canada
Médailles militaires décernées à Frank Narcisse Jerome en 1918-1919.
Il n’existe malheureusement aucune photographie de Frank Narcisse Jerome.
Citation de la première Médaille militaire remise à Frank Narcisse Jerome pour bravoure, 1918. Bibliothèque et archives Canada
Médailles militaires décernées à Frank Narcisse Jerome en 1918-1919.
Paulette Brousseau est native de Petite-Vallée. En 1975, elle joint les Forces armées canadiennes. L’excellence de son dossier scolaire lui permet de choisir l’un des métiers les plus exigeants alors disponible. Pour elle, pas question de métiers traditionnellement destinés surtout aux dames. Il y a tout lieu de croire qu’elle serait la toute première femme à devenir électrotechnicienne en instrumentation d’avion au sein de l’Aviation royale canadienne.
Jacques BouchardCapitaine (retraité), conjoint de Paulette Brousseau et résident de Petite-Vallée
Paulette réussit d’abord, avec brio, l’exigeant cours de recrue à la base militaire de SaintJean-d’Iberville après un entraînement intensif de quelque trois mois. Ce succès lui permet de poursuivre sa formation, mais cette fois en électronique. Quelque temps plus tard, soit en juillet 1976, elle se retrouve à l’école d’électronique de l’aviation (CFSAOE) à la base de Borden, en Ontario, où elle se perfectionne dans son domaine, tout en maîtrisant de mieux en mieux la langue de
Shakespeare. Elle est alors initiée aux rudiments de son nouveau métier à l’aide d’aéronefs destinés à la chasse anti-sous-marine. En 1976, Paulette est mutée à la base de Bagotville, au Saguenay. Les avions de chasse les plus perfectionnés de l’Aviation royale canadienne ainsi que les hélicoptères de recherche et sauvetage deviennent son nouveau terrain de jeu.
En 1980, Paulette est mutée à la base militaire du commandement aérien de Portage-la-Prairie, située
au Manitoba. Son expertise est alors mise à profit afin de maintenir en excellent état de vol les aéronefs servant à la formation des aspirants-pilotes. Trois ans plus tard, elle est de retour à Bagotville, mais cette fois ce sont les avions de chasse ultramodernes Hornet F18 qui font l’objet d’un entretien méticuleux grâce aux connaissances de techniciens comme Paulette, laquelle continue à travailler dans un environnement où la gent féminine se fait rarissime. Au cours de sa carrière, elle

obtiendra les différentes qualifications de son métier sur 14 différents types d’avions, du CF-101 Voodoo au CF-18 Hornet incluant le CT-114 Tutor (Snowbird), et du CH-136 Kiowa au CH-118 Iroquois (recherche et sauvetage). En 1983, elle suit une formation, Digital Computer Principles à Kingston en Ontario, qui consiste à construire un ordinateur, alors que ceux-ci font leur apparition. Cette formation lui permettra plus tard de se joindre à l’équipe de techniciens des F-18 comme analyste informatique (EPLTS).
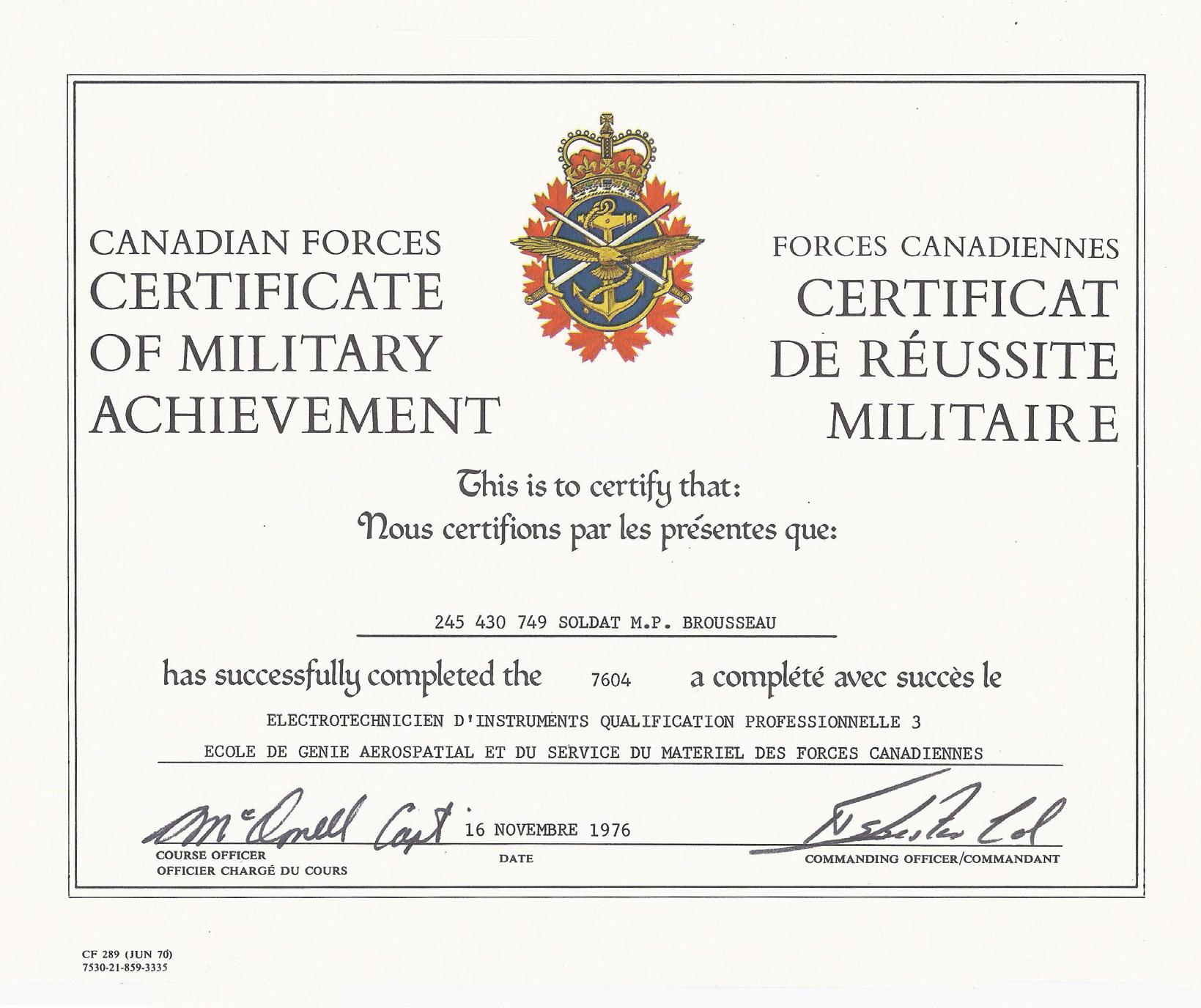
En 1990, elle quitte le domaine de l’aviation pour collaborer à l’étude notariale de son conjoint. Ses vastes connaissances acquises au cours de sa carrière militaire lui sont d’un grand secours afin d’apprivoiser les équipements informatisés que le notariat utilise. Sportive émérite, Paulette détient une ceinture noire, 2e dan, décernée par Judo Canada.
Une femme major : une rareté
Quelques années plus tard, le naturel revient au galop. Paulette retourne au centre de recrutement afin de devenir officier instructeur du mouvement des cadets. Son leadership exceptionnel est mis à profit et ses supérieurs l’invitent à poursuivre sa formation sur la voie
accélérée. En l’espace de seulement quelques mois, elle est promue capitaine et devient commandant d’une unité. Son travail acharné, ses capacités hors du commun et son expérience antérieure du monde militaire lui valent d’être promue au grade de major. Paulette devient ainsi la toute première femme à atteindre cet important grade au sein de sa qualification dans l’Est du Québec.
Son attitude positive, son dossier édifiant, sa diplomatie, sa connaissance élaborée de la culture militaire et la maîtrise des connaissances variées de son domaine d’expertise lui valent d’être invitée à devenir Aide de Camp honoraire auprès du cabinet du lieutenant-gouverneur du Québec. C’est auprès de cette institution que Paulette continue à développer constamment ses talents dans l’art du protocole.

Au cours de son illustre carrière militaire, Paulette reçoit les distinctions suivantes, notamment : la décoration canadienne avec agrafe, la médaille du 50e anniversaire du Jubilé de la Reine Élisabeth II et celle du 60e anniversaire du Jubilé
de la Souveraine, la médaille du Souverain pour le bénévolat, la mention élogieuse du ministre des Anciens combattants, la médaille d’or du lieutenant-gouverneur du Québec remise par l’honorable Pierre Duchesne et la médaille pour services exceptionnels du lieutenant-gouverneur du Québec décerné par l’honorable Michel Doyon. Paulette obtient également une lettre de félicitations du premier ministre du Canada Stephen Harper et une du premier ministre du Québec Jean Charest, l’épinglette du 150e anniversaire du Canada et l’épinglette du Jubilé de platine de Sa Majesté la reine Elisabeth II. Enfin, en 2004, elle reçoit le Prix du Duc d’Édimbourg à titre de leader, Défi Jeunesse Canada. Au-delà de ces reconnaissances, Paulette Brousseau a surtout su tracer sa propre voie grâce à ses compétences et sa détermination.
Note
À travers mes souvenirs, mon histoire gaspésienne gravite autour de la visite officielle du président de la République française François Mitterrand, le mardi 26 mai 1987, à Gaspé, Fort-Prével et Percé.
 Robert Tremblay
Robert Tremblay
Responsable de la visite protocolaire de Mitterrand en Gaspésie
Ce qu’il faut savoir, c’est que Mitterrand doit venir au Canada pour une visite officielle, mais qu’un arrêt au Québec ne coïncide pas avec le volet canadien. Sachant cela, le délégué général du Québec à Paris Jean-Louis Roy négocie alors de son côté avec l’Élysée, afin de mieux protéger et promouvoir les intérêts du Québec. Or, dans le journal Le Soleil du 24 mai 1987, la Presse canadienne rapporte les propos de Roy, en mentionnant que la partie québécoise du voyage a été négociée par Québec de bout en bout, en toute indépendance. Il rajoute aussi qu’il n’y a pas eu de rencontre tripartite et que l’ambassadeur à Paris Lucien
Bouchard et lui-même, ont toujours été reçus séparément à l’Élysée.
Jean-Louis Roy souligne qu’il n’y a pas eu d’accrochage et que l’ambassade canadienne a fait son travail avec l’Élysée, nous de même, mais nous ne nous sommes jamais réunis à trois, spécifie Roy.
Dès la fin de février 1987, les contacts et les rencontres avec les gens du ministère des Relations internationales et du Consulat général de France à Québec sont à l’agenda. La tâche est énorme et tout doit se concrétiser dans la perspective de la réussite certaine d’une
telle visite officielle, et ce, selon les exigences du Protocole conjointement avec l’Élysée. Pour ce faire, le côté sécurité est principalement chapeauté par la Sûreté du Québec et la Gendarmerie royale du Canada. De plus, quatre gardes du corps de la sécurité rapprochée de Mitterrand viennent s’installer à Gaspé dès avril 1987, afin de fignoler le tout dans les plus grands détails, comme ils sont habitués de le faire dans le cadre des visites officielles du président français.
Mais, à la demande de nos amis de l’Hexagone, une installation sine qua non spéciale est requise. Il est alors primordial d’établir un lien direct et constant entre Gaspé
Couverture du programme Visite officielle au Québec du président de la République française et de Mme François Mitterrand, 1987. Musée de la Gaspésie. P321 Fonds Robert Tremblay.
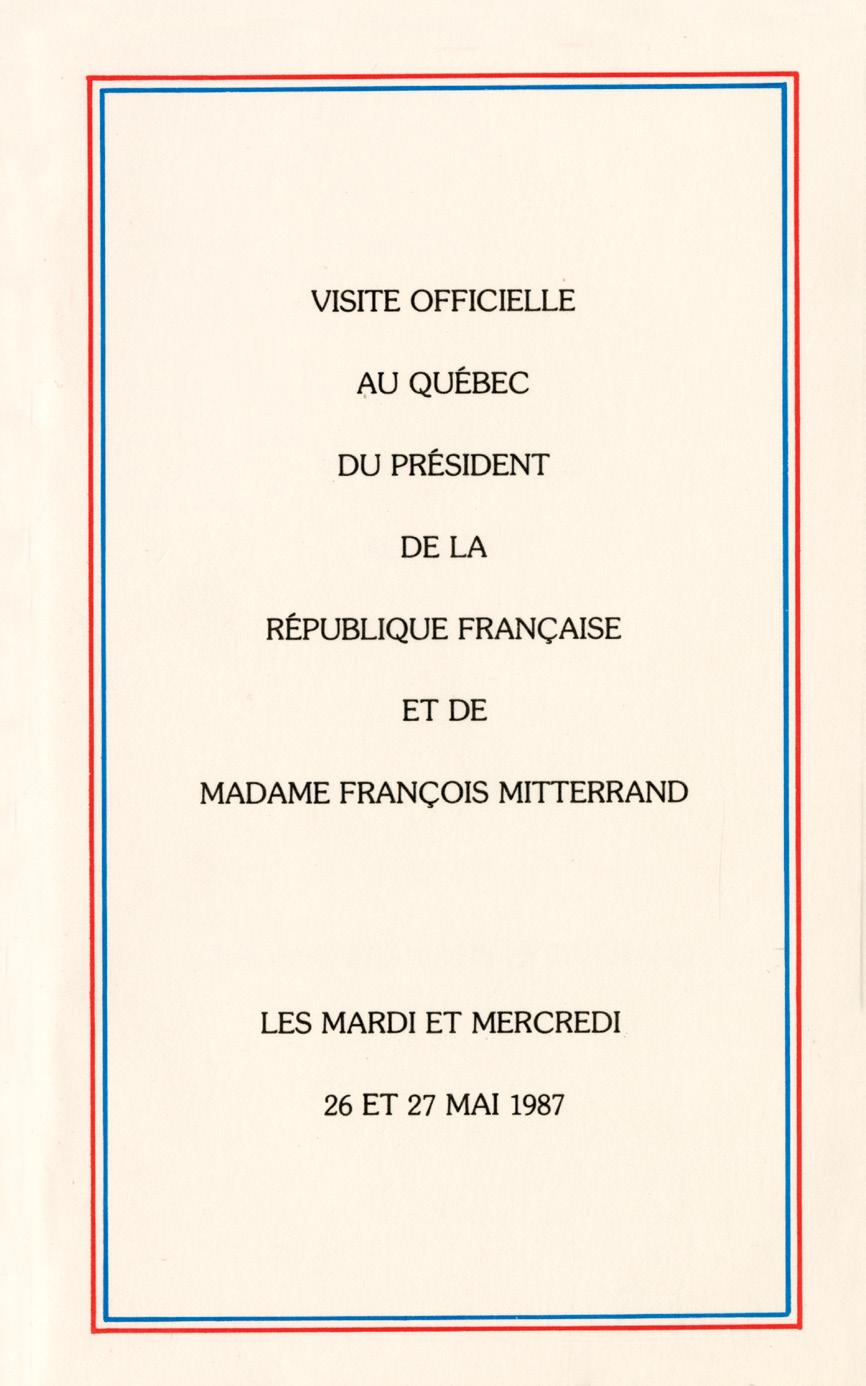
et le palais de l’Élysée à Paris. Ainsi, je me rappelle que l’équipe de Québec-Téléphone installe une antenne « provisoire » sur le territoire gaspésien. Or, à partir de leurs installations centrales de la rue Adams à Gaspé, une antenne parabolique de lien micro-ondes rejoint le réseau hertzien de Capdes-Rosiers, afin d’établir un circuit prioritaire transatlantique à haut niveau de sécurité, dédié à l’usage unique de l’Élysée. Comme me le fait remarquer Gaby Johnson, directeur d’exploitation de Québec-Téléphone à Gaspé, les communications par satellites en 1987 n’existent pas encore et on doit traverser l’océan par câble sous-marin.
Or, au matin du 23 mai 1987, nous prenons livraison des voitures utilisées dans le cortège de certains dignitaires. Déjà, la voiture toute spéciale présidentielle est entreposée dans un endroit secret et bien gardé.
Soulignons ici que durant la nuit du 25 au 26 mai 1987 précédant la
venue de Mitterrand, un maîtrechien de la Sûreté du Québec s’assure que le couvercle en acier de chaque trou d’homme soit soudé, et ce, sur l’entièreté du parcours présidentiel, tout en vérifiant l’absence d’explosifs et tous autres objets suspects.
Un protocole réglé au quart de tour Mon travail consiste à recevoir et à m’occuper du protocole concernant les dignitaires de la France, du Québec et les différents représentants régionaux de la Gaspésie. Les journalistes internationaux, nationaux et régionaux sont aussi invités au déjeuner historique offert par le ministre des Relations internationales du Québec, Gil Rémillard. Ainsi, le déroulement officiel de la journée du 26 mai 1987 débute avec l’arrivée de Mitterrand à l’aéroport de Gaspé à 11 h. Nous voyons de plus en plus de gardes du corps de la sécurité rapprochée sur tout le terrain d’opération. Soulignons aussi la présence d’une vedette maritime de la Sûreté du Québec surveillant les abords du Musée de la Gaspésie.
Premier arrêt : Gaspé À l’étape de la préparation entourant la visite de la cathédrale de Gaspé, nous apprenons, de la part de l’Élysée, qu’il n’est absolument pas
question que Mitterrand entre dans une église, car il n’apprécie guère s’y montrer, malgré son mysticisme connu. Or, nous leur mentionnons que nous désirons seulement et simplement lui présenter le tableau de Charles-de-Foucray qui orne un mur situé juste à l’entrée latérale et qu’il n’a pas à se déplacer davantage dans ce lieu. D’autant plus, précisons-nous, que l’œuvre a été donnée par le gouvernement français et installée dans la cathédrale en 1984; elle illustre l’arrivée de Jacques Cartier à Gaspé en 1534. C’est à notre avis, un beau parallèle à faire avec la visite officielle du président de la République française, leur disonsnous. C’est ainsi que nos arguments réussissent à lui faire franchir quelques pas dans la cathédrale, et ce, sans aucune déception de part et d’autre, car après avoir franchi la porte, il n’a qu’à se retourner et lever les yeux sur la toile. L’Élysée constate alors le tout petit chemin à parcourir et la simplicité de notre « tour de force ».
Par la suite, Mitterrand et le premier ministre Robert Bourassa déposent chacun une gerbe de fleurs au pied de la croix de Jacques Cartier avant de se rendre au Musée de la Gaspésie pour une visite. C’est là que le président français prononce son discours inoubliable et historique devant plus de mille personnes et 120 journalistes de tous les pays.
Une foule impressionnante est réunie pour le discours du président de la République française François Mitterrand sur le site du Musée de la Gaspésie, 1987. Musée de la Gaspésie. Fonds Musée de la Gaspésie. P1/7/3

Déjeuner officiel à Percé
Arrivés à Percé en provenance de Gaspé, deux hélicoptères se posent à 13 h sur le domaine du restaurant
Le Gargantua. Les dignitaires sont conduits en voiture jusqu’au quai, afin que le président de la République s’adonne à des poignées de main avec les pêcheurs. Il fait aussi un arrêt à La Maison du Pêcheur, un restaurant très connu. Le chef et propriétaire Georges Mamelonet le reçoit en lui faisant une brève présentation des produits marins qu’il utilise pour s’en faire une réputation déjà enviée de tous. Rappelons que Mamelonet est issu de l’École de la Marine nationale française à Marseille et il s’entretient maintenant avec le compatriote invité.
De retour avec les voitures officielles, le président de la République française et son épouse Danielle Gouze (alors toujours nommée comme madame François Mitterrand), le premier ministre du Québec Robert Bourassa et Andrée Simard, René Lévesque et Corinne Côté-Lévesque, et le ministre des Finances du Québec Gérard-D. Levesque et Denyse Lefort sont conduits au restaurant Le Gargantua. À 13 h 30, débute le déjeuner privé offert par le premier ministre du Québec. Pierre et

Ginette Péresse, d’origine bretonne, accueillent leurs prestigieux invités·es. En bons Gaspésien et Gaspésienne d’adoption depuis 1959, ils concoctent homards, crabes, pétoncles et bigorneaux; fromages et vins de choix accompagnent le copieux banquet.
Déjeuner protocolaire et médiatique à Fort-Prével
À la suite de la visite au Musée de la Gaspésie, j’accueille de mon côté les délégations française et québécoise ainsi que de nombreux journalistes à l’Auberge du Fort-Prével pour un déjeuner offert par le ministre des Relations internationales du Québec, Gil Rémillard. À 13 h, sur le parvis extérieur à l’entrée principale de l’établissement hôtelier, je reçois un à un les hauts dignitaires à leur sortie des limousines et des autocars, en
leur souhaitant personnellement la bienvenue et je les invite à se rendre dans la salle de réception officielle. Plusieurs personnes du Protocole sont déjà assignées pour les accompagner.
Avec tout le décorum, le ministre Gil Rémillard porte un toast à la fin du déjeuner. Par la suite, j’accompagne les plus hauts dignitaires et nous nous rendons sur le grand balcon franc nord surplombant le terrain gazonné du complexe hôtelier, car les nombreux journalistes sont conviés à une séance de photos que je qualifie d’impressionnante.
La réception officielle se termine à 14 h 45 pour les invités·es de l’Auberge du Fort-Prével qui se dirigent maintenant vers l’aéroport de Gaspé.
Du côté du Gargantua, la suite de Mitterrand quitte Percé à 15 h 05 à bord des deux hélicoptères affrétés. De son côté, Didier Mulet, garde du corps de la sécurité rapprochée du Président, me confie plus tard que René Lévesque lui demande gentiment s’il peut retourner à l’aéroport dans la camionnette conduite par ce sympathique gendarme français. Évidemment, même surpris, il accepte volontiers de raccompagner son unique et illustre passager, car son épouse Corinne préfère le retour dans l’hélicoptère attitré. Sans doute veut-il admirer davantage à son aise le trajet restant par la route, avant de quitter possiblement avec nostalgie, sa natale Gaspésie.
La journée s’achève donc à l’aéroport de Gaspé. Tous les dignitaires sont là. La température est idéale et les astres sont ainsi alignés.
Tant de siècles après, les lys du roi François 1er portés par Jacques Cartier de Saint-Malo signifient pour les habitants du Québec et particulièrement ceux de la Gaspésie la signification d’un début, la signification de temps nouveaux, des terres nouvelles pour des temps nouveaux. De fait, [c’est] à partir de là que s’édifiera la lente élaboration d’un peuple.
Extrait du discours de François Mitterrand, président de la République française, à Gaspé, 26 mai 1987.
de l’escalier le menant au Dash 8, il revient à nouveau sur le tarmac et nous partageons une solide poignée de main et un bref échange de cordialité.
Comme prévu, le 26 mai 1987 à 15 h 30, le président de la République française et madame François Mitterrand montent à bord de l’avion présidentiel et quittent Gaspé à destination de Québec.

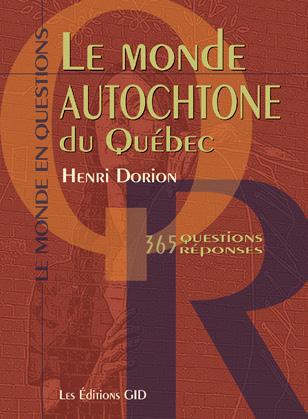

Pour en savoir plus : Un recueil étoffé rédigé et assemblé par Robert Tremblay est disponible pour consultation au Centre d’archives du Musée de la Gaspésie. Il comprend des souvenirs, des documents officiels, les menus, une revue de presse, etc.
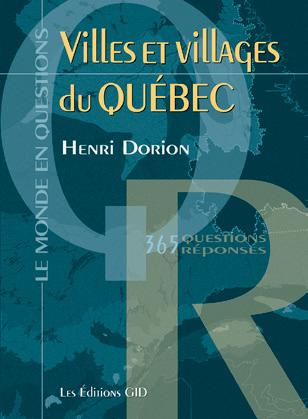
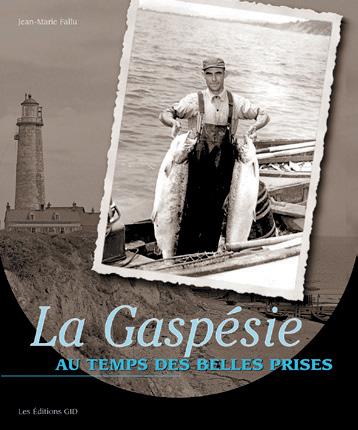
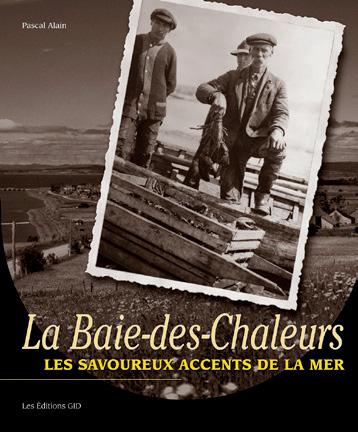
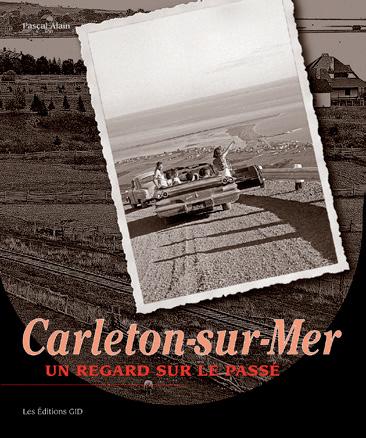
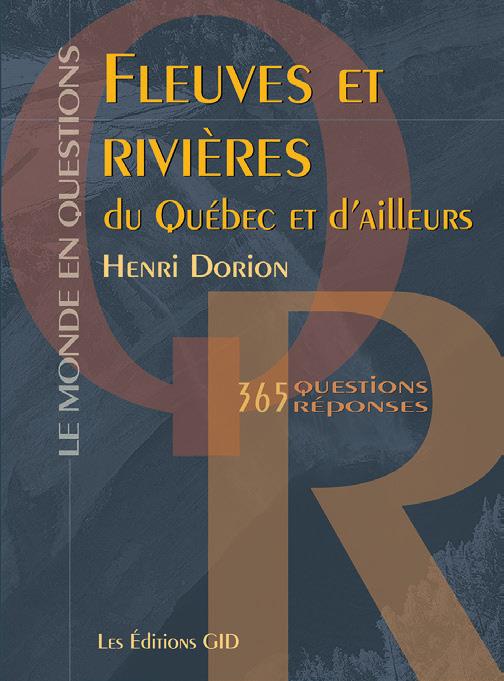
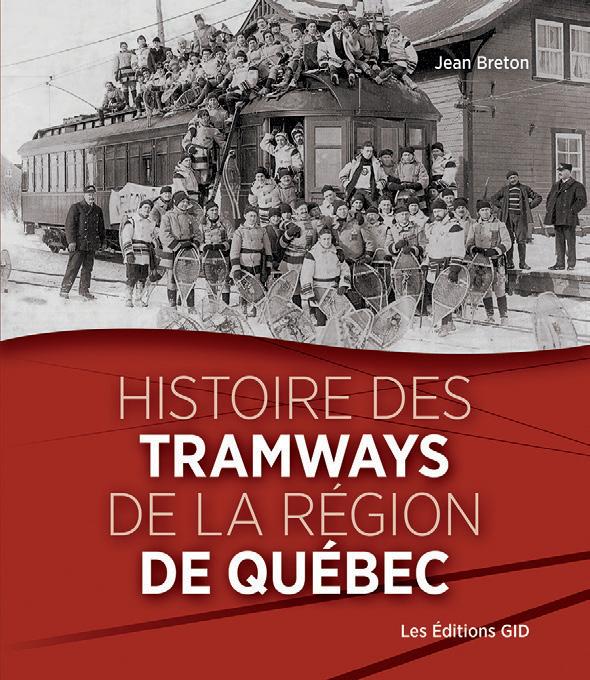
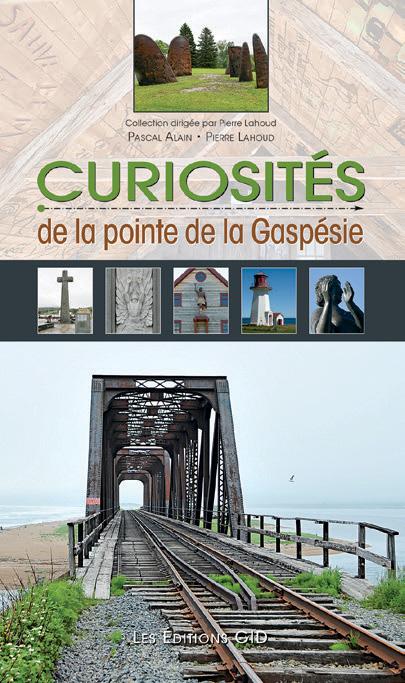
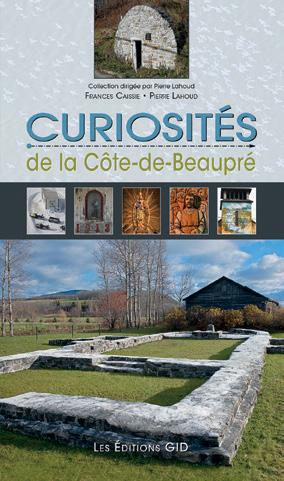

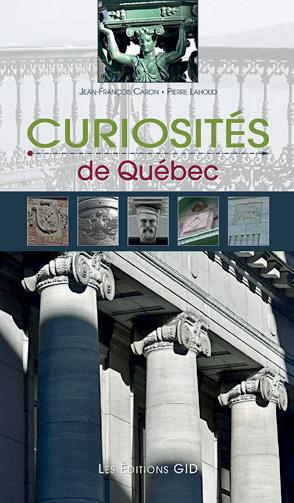
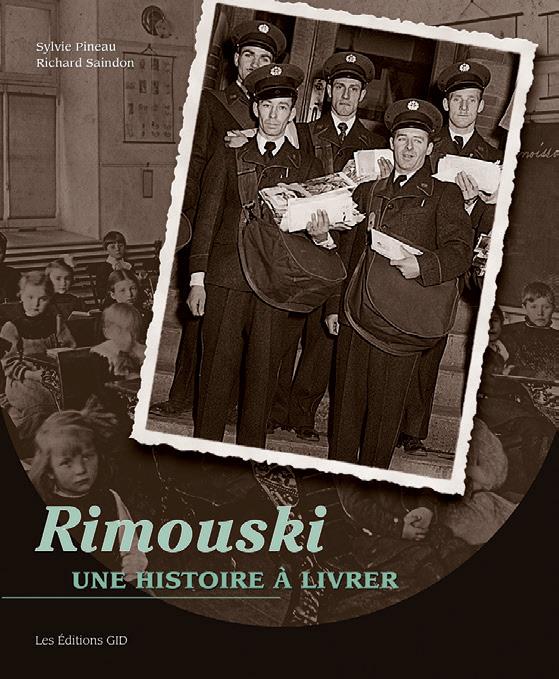
Toutefois, en attendant le départ, je vois le premier ministre Robert Bourassa s’entretenir avec Mitterrand juste à côté de son Dash 8. Je prends alors congé de
mon interlocuteur français pour me rendre auprès du Président et lui faire les salutations d’usage protocolaires, mais comme il a déjà un pied posé sur la première marche
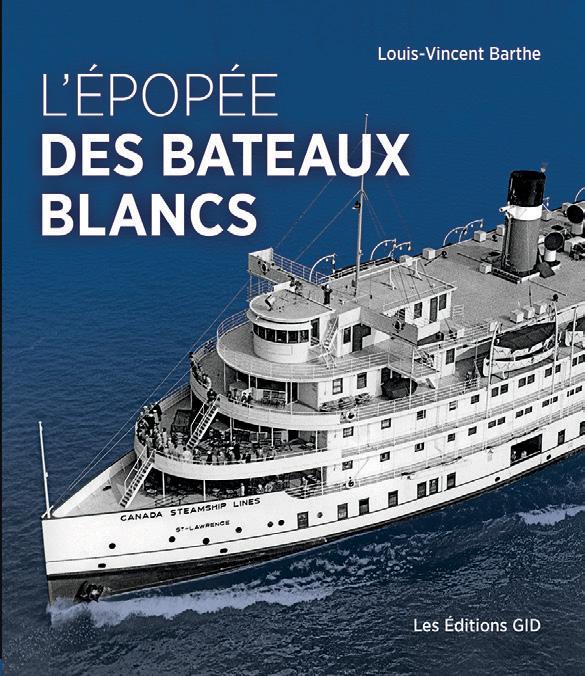

-p.51-52 : Les légendes des deux photos de croix de Saint-Jean-de-Brébeuf ont été inversées.

Les pastilles Web à la fin de certains articles vous invitent à consulter un extra en exclusivité sur notre site Web : magazinegaspesie.ca
Faites-nous part de vos commentaires et suggestions sur le Magazine Gaspésie : magazine@museedelagaspesie.ca 418 368-1534 poste 106 [NOS







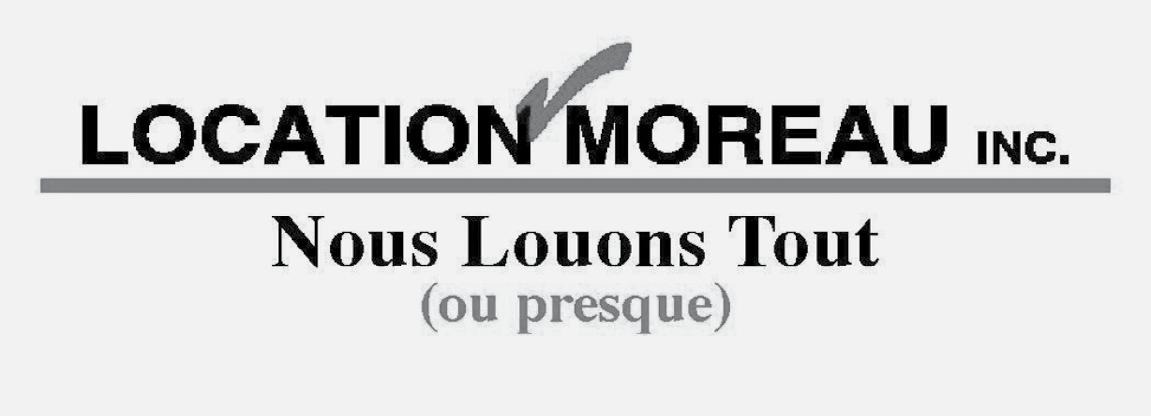
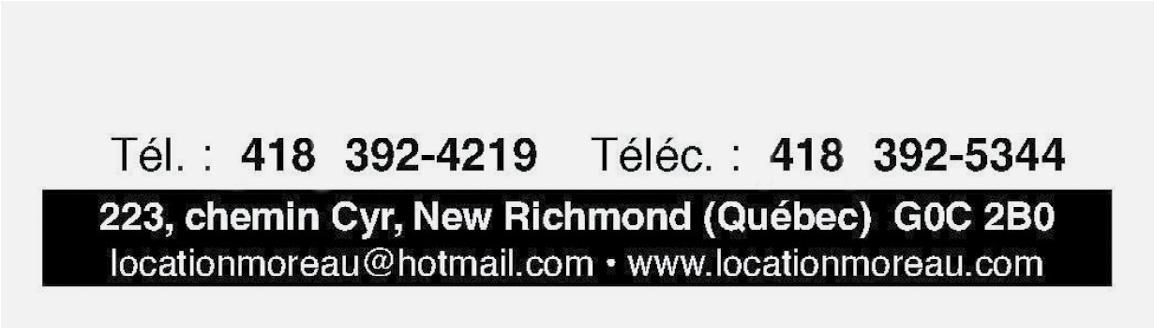

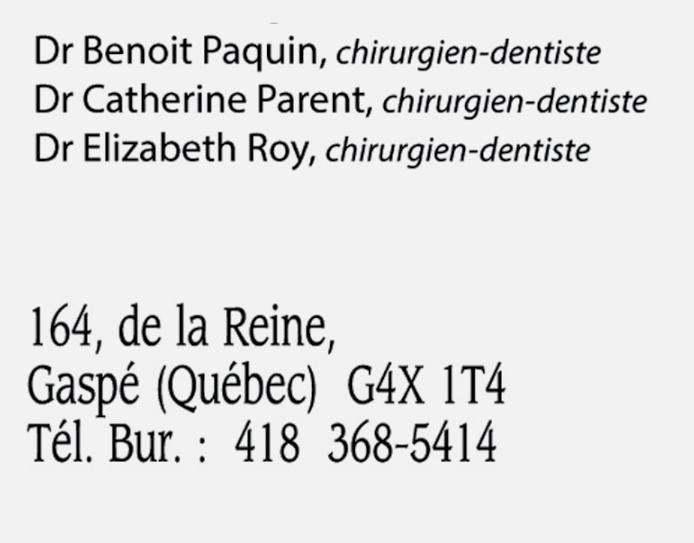


À NE PASMANQUER SURNOSONDESDULUNDI AU VENDREDI





Lemonde selonJack
De6h à 9h

Avec Jacques Henry et RichardO’Leary
LePunch
De13hà15h
Avec Dave Ferguson
Entretiens




De9hà 12h
Encompagniede CarolineFarley

Ilétaitune fois
dansl’Est

De15h à18h

Avec Yannik Bergeron
LesHitsdumidi
De12hà 13h
Pourunmidi toutenmusique!
DestinationCountry

De18h à 19h
Uneheure 100%Country!

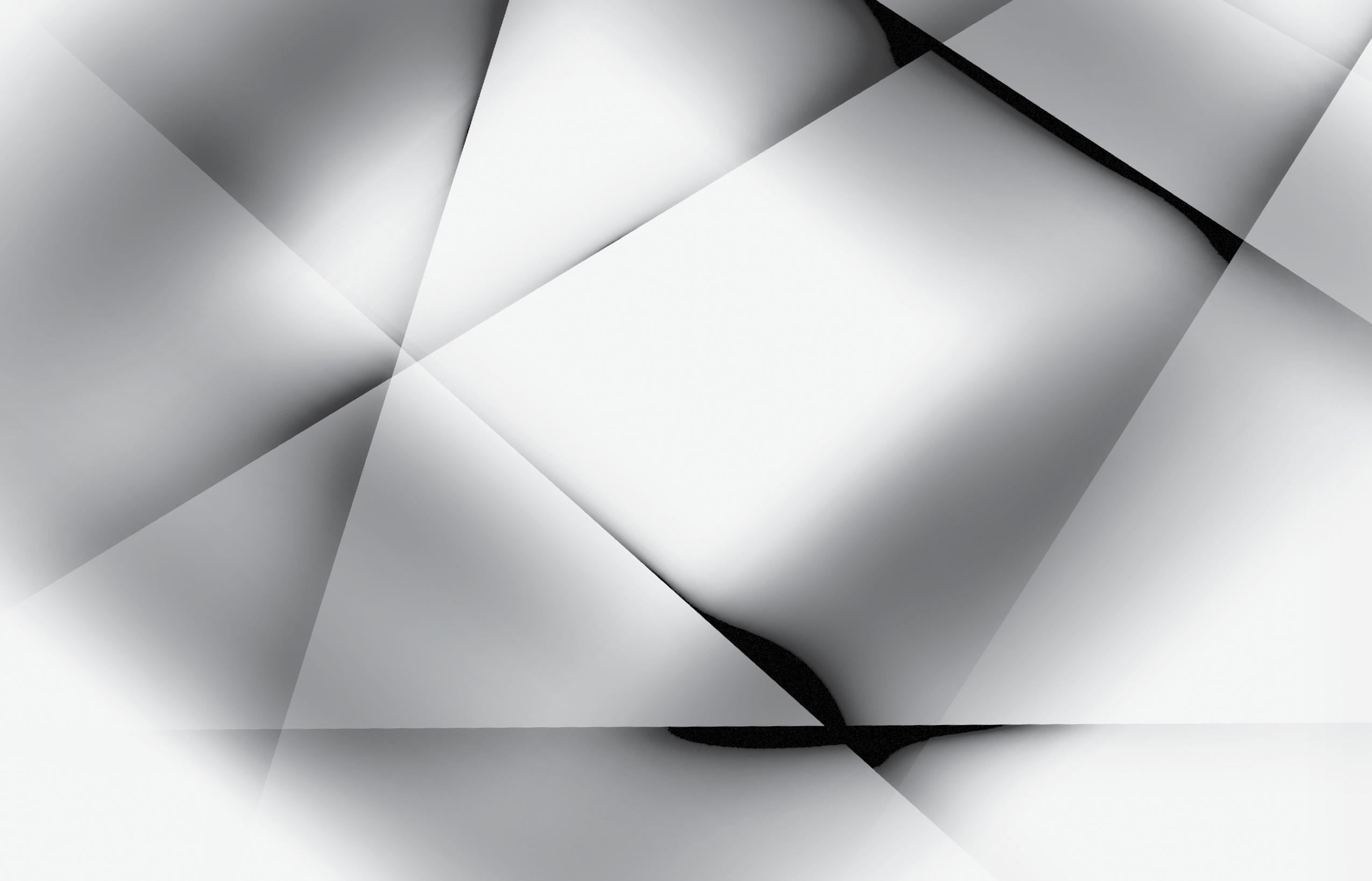


Venezrencontrer une équiped’experts quivous guidera dans l’accomplissement devos petitsetgrands projets!


151, boul. deGaspé,Gaspé Tél. : 418368-2234 info@kega.co

