





PAYS DE L’INTÉRIEUR, INTÉRIEUR DU PAYS : PELLEGRIN
Jean-Claude Clavet

OUVRIR ET FERMER
SAINT-FIDÈLE-DE-RISTIGOUCHE
Camillia Buenestado Pilon
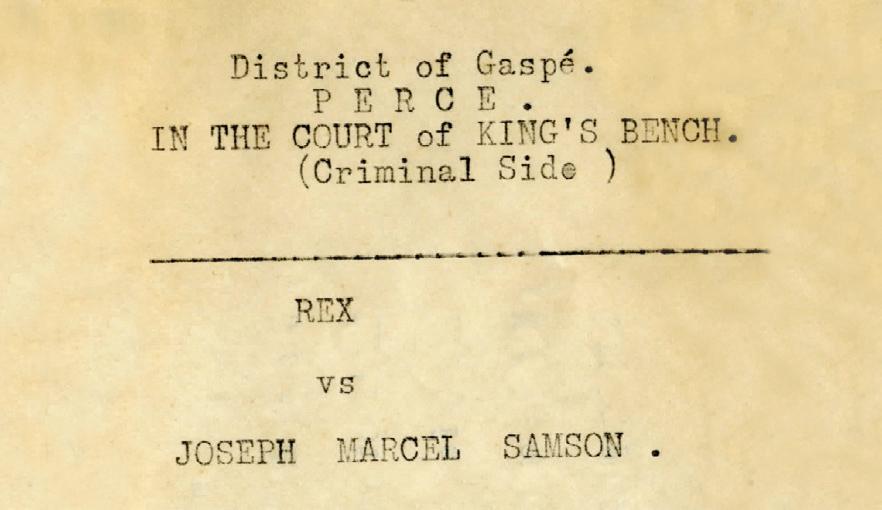
ANQ Gaspé
Nos curiosités judiciaires
Aurélie Le Maître
Adrien Pelletier
À SAINT-EDMOND
SUIVEZ LE MAGAZINE SUR FACEBOOK!
Anne-Marie Huard et Marie-Josée Lemaire-Caplette
Gilda Grenier
UN VILLAGE QUI A FIÈRE ALLURE!
Céline Pelletier et Réjean Pelletier
SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE : UNE COMMUNAUTÉ SUR LES SOMMETS
Jean-Louis LeBlanc
Photoreportage CE QU’IL RESTE DE NOUS… LA SUITE
ORIGINES DES OPÉRATIONS DIGNITÉ : L’EXIL DES FAMILLES ET LES FERMETURES DE VILLAGES DE L’EST-DU-QUÉBEC
Martin Gagnon
AMÉNAGER AU LIEU DE DÉMÉNAGER
Marie-Josée Lemaire-Caplette et Sylvie Beaulieu
41 Nos archives
LA GASPÉSIE AU TEMPS DES MISSIONS –JEAN-BAPTISTE-ANTOINE RACONTE
Marie-Pierre Huard
43 Nos objets
1924-2024 : SE SOUVENIR DES URSULINES
Vicky Boulay
45 Nos familles
LA FAMILLE AUBERT DE L’ÎLE BONAVENTURE ET PERCÉ
Élaine Réhel
EMPOISONNEMENT INTENTIONNEL OU ACCIDENTEL?
André Ruest et Guillaume Marsan
Photo : Donat C. Noiseux ANQ Québec. Office du film du Québec. E6,S7,SS1,D2,P1118 50
Couverture
Équipe d’entretien des chemins, rang VII à Saint-Bernard-desLacs, 1941. Une niveleuse est attachée au tracteur à chenilles.
Éditeur
47 Nos personnages MON ONCLE, SOLDAT LOUIS-GEORGES LABBÉ (1919-1995)
Armand Labbé

La Société du chemin de fer de la Gaspésie est très fière des travaux réalisés au cours de la saison estivale 2024 et tient à remercier tout particulièrement ses employés pour leur engagement soutenu et leur professionnalisme à toute épreuve. Sans eux, rien n’est possible!
Un grand merci aux citoyens qui sont demeurés vigilants aux abords de la voie ferrée, leur collaboration est précieuse.
Décembre 2024 – Mars 2025 N° 211, volume 61, numéro 3
Éditeur : Musée de la Gaspésie
Fondé en 1963, le Magazine Gaspésie est publié trois fois par an par le Musée de la Gaspésie. Le Magazine vise la diffusion de connaissances relatives à l’histoire, au patrimoine culturel et à l’identité des Gaspésiennes et des Gaspésiens. Il est membre de la Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP).
Comité de rédaction
Marie-Pierre Huard, Gabrielle Leduc, Marie-Josée Lemaire-Caplette, Paul Lemieux, Élaine Réhel et Jean-Philippe Thibault
Abonnements et ventes 418 368-1534 poste 104 boutique@museedelagaspesie.ca
Rédactrice en chef
Marie-Josée Lemaire-Caplette 418 368-1534 poste 106 magazine@museedelagaspesie.ca
Coordination et publicités
Gabrielle Leduc
418 368-1534 poste 102 coordo.direction@museedelagaspesie.ca
Recherche iconographique
Marie-Pierre Huard
418 368-1534 poste 103 archives@museedelagaspesie.ca
Rédaction et collaboration
Sylvie Beaulieu, Vicky Boulay, Camillia Buenestado Pilon, Jean-Claude Clavet, Martin Gagnon, Gilda Grenier, Anne-Marie Huard, Marie-Pierre Huard, Armand Labbé, Jean-Louis LeBlanc, Aurélie Le Maître, Guillaume Marsan, Adrien Pelletier, Céline Pelletier, Réjean Pelletier, Élaine Réhel et André Ruest
Conception graphique et infographie
Maïlys Ory
Révision linguistique
Maria Luisa Romano
Distribution en kiosque
Jean-François Dupuis
Impression Numérix
Plateforme numérique magazinegaspesie.ca
Dépôt légal
Bibliothèque et Archives Canada, ISSN 1207-5280 (imprimé) ISSN 2561-410X (numérique)
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ISBN 978-2-924362-40-2 (imprimé) ISBN 978-2-924362-41-9 (pdf)
Copyright Magazine Gaspésie
Reproduction interdite sans autorisation
Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada.
Toute personne intéressée à faire paraître des textes conformes à la politique du Magazine Gaspésie est invitée à les soumettre à la rédactrice en chef. Celle-ci soumet ensuite une proposition d’articles au comité de rédaction.
Le Magazine Gaspésie n’est pas un média écrit d’opinion, mais encourage le pluralisme des discours pour autant qu’ils reposent sur des fondements. Les autrices et auteurs ont la responsabilité de leurs textes. Seuls les textes où cela est spécifiquement mentionné relèvent de l’éditeur.
Les textes sont écrits de manière inclusive afin de refléter son objet et son approche. Le vocabulaire épicène est utilisé autant que possible. Les textes appliquent la règle de féminisation par dédoublement et les graphies tronquées à l’aide de points médians. L’accord de proximité est utilisé à des fins de lisibilité.
Droits d’auteur et droits de reproduction
Toutes les demandes de reproduction doivent être acheminées à : Copibec (reproduction papier) : 514 288-1664 | 1 800 717-2022 | licences@copibec.qc.ca
Abonnement
1 an (3 nos) : Canada, 30 $ ; Hors Canada, 82 $ (taxes et frais de poste inclus)
Vente en kiosques
Prix à l’exemplaire : 10,50 $ (taxes en sus) - Liste des kiosques sur le site Web
Magazine Gaspésie
80, boulevard de Gaspé, Gaspé (Québec) G4X 1A9 418 368-1534 poste 106 magazine@museedelagaspesie.ca magazinegaspesie.ca

Ce numéro sur les villages disparus fait suite au précédent paru à l’été. Ainsi se poursuit l’histoire des localités désormais rayées de la carte et de leurs communautés. Teintés de nostalgie, les récits des anciens résidents·es et de leur descendance sont joyeux, emplis de rires et de fêtes où l’entraide et le courage sont à l’honneur. Pourtant, leurs parcours ne manquent pas d’adversité, d’épreuves et de sueurs. Bien que chaque village possède une histoire unique, les uns font écho aux autres et tous partagent plusieurs points communs : la présence de l’église, l’importance de l’éducation, la préoccupation des récoltes, le dur travail forestier, la menace d’incendies, la solidarité du voisinage, sans compter l’amour que les habitants·es portent à leur village, lieu qu’ils ont vu naître, grandir, puis s’éteindre. Cette minisérie de deux numéros souhaite, bien humblement, dresser un portrait de ce pan d’histoire méconnu et peu documenté en offrant une voix aux personnes qui ont connu ces villages disparus afin qu’elles les fassent revivre. L’histoire de ces familles pionnières est au centre de l’histoire de la trentaine de localités gaspésiennes fermées par le gouvernement. Il importe d’en garder une trace pérenne et d’avoir conscience du rôle que ces évènements ont joué dans l’avenir de la ruralité au Québec. En plus des délocalisations et des drames humains, c’est le maintien des régions et la fierté d’y vivre et d’y appartenir qui ont été remis en cause il y a un demisiècle. Encore aujourd’hui, la vigilance est de mise alors que plusieurs services sont menacés. Souvenonsnous que c’est un mouvement populaire qui a permis de freiner la fermeture d’une centaine d’autres villages de la péninsule.
Je vais te raconter un pays.
Ce pays est le mien et ce pays va mourir…
C’était pourtant un si beau pays!
À le voir perché comme ça sur sa montagne, avec sa tête dans les nuages, on l’aurait cru immortel.
Mon pays était entouré d’une forêt merveilleuse… et dans cette forêt pleine de richesse habitaient tous ensemble des perdrix, des lièvres, des chevreuils et la liberté!
Il n’y avait pas, dans mon pays, des gens savants, ni de grands théâtres, ni de grands musiciens.
Mais on pouvait au printemps entendre la chanson des sources et la nature savait mieux que personne, en toute saison, présenter ses spectacles…
Abbé Delvida Leblanc
Extrait d’un poème en mémoire de Saint-Louis-de-Gonzague, 1974
Je réitère l’expression de toute ma gratitude aux anciens résidents·es et à leur descendance qui nous ont accordé leur confiance, ont partagé leur vécu et ont ouvert leurs albums de famille avec le Magazine Gaspésie. Sans vous, ce pan d’histoire n’aurait pas pu être raconté.
Du contenu qui se prolonge sur le Web
Un petit rappel que les pastilles à la fin des articles indiquent que des éléments en extra sont disponibles en libre accès pour toutes et tous sur notre site Web : magazinegaspesie.ca/ tour-de-la-gaspesie/en-extra/ Entrevues, reportages, documents d’archives et diaporamas photos vous y attendent!
Parlant de cadeaux, Noël approche à grands pas! Offrez l’histoire en cadeau à vos proches avec un abonnement, un présent 100 % gaspésien qui dure toute l’année. Vous pouvez le faire sur notre site Web ou par téléphone au 418 368-1534, poste 104.
À votre demande, nous avons créer une carte avec les villages disparus pour les situer, en plus de celle disponible sur notre site Web.
Rappelons qu’il est difficile de dresser une liste des lieux fermés et d’arrêter leurs années de fondation et de fermeture, qui se contredisent selon les sources. Nous avons tout de même tenté l’exercice; il s’agit d’une base qui n’attend que d’être bonifiée.
Page suivante : Carte modifiée de la région touristique de la Gaspésie, après 1946. Les villages qui sont aujourd’hui fermés y sont indiqués par des numéros, se référer à la légende.
Musée de la Gaspésie. Collection centre d’archives de la Gaspésie. P57/15/29
REPÉREZ LES LOCALITÉS FERMÉES SUR UNE CARTE ET CONSULTEZ LES DONNÉES DÉTAILLÉES
Marie-Josée Lemaire-Caplette Rédactrice en chef du Magazine Gaspésie, Musée de la Gaspésie

Saint-Nil – 1934-1974
Saint-Thomas-de-Cherbourg – 1934-1970
Rang IV – Les Méchins (Romieu) –1936-entre 1970 et 1974
Saint-Paulin-Dalibaire – 1937-1971
Saint-Octave-de-l’Avenir – 1932-1971
Saint-Joseph-des-Monts – 1877-1959
Saint-Bernard-des-Lacs – 1932-1963
Sacré-Cœur-Deslandes (ou L’Enfant-Jésus-de-Tourelle) – 1937-1973
Lac-au-Diable (ou Lefrançois) – 1933-1937
Grande-Vallée-des-Monts – 1938-1971
Saint-Thomas-de-Cloridorme – 1937-1960
Grande-Grave – 1798-1970
Île Bonaventure – Fin 18e-1971
Rangs III et VI – Val-d’Espoir – Années 1930-1973
Saint-Gabriel-de-Gaspé – 1935-1970
Saint-Charles-Garnier-de-Pabos – 1935-1971
Saint-Edmond-de-Pabos – 1931-1971
Sainte-Bernadette-de-Pellegrin – 1935-1971
Rangs VIII et XV (Garin) – Saint-Elzéar –Années 1930-1975
Rangs V, VI et VII – Saint-Siméon-de-Bonaventure –Début 20e-1979
Robidoux – 1924-1971
Secteur Biron (Saint-Louis-de-Gonzague) – 1932-1974
Saint-Jean-de-Brébeuf – 1930-1971 « Flat » de Restigouche (Listuguj) –Vers 1885-1931 et 1981
Saint-Conrad – 1935-1973
Saint-Fidèle-de-Ristigouche – 1937-1974
Saint-Étienne-de-Ristigouche – 1935-1974
Milnikek – 1870-années 1970-1980
Rangs – Routhierville – Fin 19e-années 1970-1980
Fermetures causées par le projet pilote du BAEQ et de l’OPDQ
Fermetures dues aux migrations « volontaires » (populations poussées à l’exil)
Autres fermetures
Fermetures pour la création de parcs nationaux

Arrivée de France pour un premier voyage au Québec en 2013, on me parle de villes dont les histoires sont liées à celle de l’économie du bois. Et c’est en effectuant des recherches sur ce sujet que j’en découvre un autre : l’histoire de villages fermés dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie à la suite d’un plan d’aménagement dans les années 1970. Trois ans plus tard, je pars explorer ceux du côté nord de la péninsule et réussis à en atteindre quatre avec mon véhicule de location.
Aurélie Le Maître Artiste plasticienne
Ce que la carte ne montre pas
Au premier abord, il ne reste rien, si ce n’est des chemins qui traversent l’immensité des montagnes bleues. Ici, les villages ont été rasés et les lots ont dû être reboisés par les enfants même de celles et ceux qui les avaient défrichés. Alors que la forêt reprend ses droits, j’y trouve les traces d’une activité passée telle une maison résistante, des seuils envahis par les herbes. Les temps se croisent et certains des indices se mêlent à un nouveau chapitre : d’anciens arbres fruitiers côtoient les pins gris replantés et les bouleaux sauvages; des sépultures sont réarrangées pour faciliter l’entretien des cimetières préservés et de nouvelles
sont ajoutées clandestinement à leurs côtés; des fondations de bâtiments accueillent les roulottes de chasseurs. Aussi, quelques activités subsistent, je trouve un relais, un hôtel, des lots rachetés, loués, « squattés », devenus terrains de chasse et marqués d’un panneau, des camions transportant les grumes (billes de bois) en soulevant la poussière du schiste sur leur passage.
Ici, c’est Saint-Nil, Saint-PaulinDalibaire, Saint-Thomas-de-Cherbourg et Saint-Octave-de-l’Avenir, rayés de la carte, parmi d’autres.
Puis, je rencontre des témoins, j’écoute leurs récits, je m’en imprègne. Ils m’expliquent qu’un lot est un terrain d’un acre par un mille, que les familles se sont installées les
unes après les autres le long d’un rang et que, parfois, il est inversé. Que les rangs sont numérotés de la côte jusqu’à l’intérieur des terres et qu’il faut ouvrir ces routes pour aller s’établir. Ils me racontent les installations, le bois, les pères, les mères, la chasse, la pêche, les moulins, les veillées, la rudesse des hivers, le déchirement, la lutte, et autant de souvenirs émus. Ils me montrent les photographies et tous les documents gardés précieusement. Quand un village ferme par décision administrative, cela crée un sentiment de perte, de déracinement, dont il est difficile de guérir. Les anciens habitants·es ressentent souvent une forme de nostalgie pour ce qui a été perdu : un mode
de vie, une communauté, des paysages familiers. Et la générosité avec laquelle ils l’ont partagée m’a touchée et donné l’envie de travailler autour de ce sujet.
Mesurer les racines
Dans ma pratique artistique, je m’intéresse au paysage et à ses transformations. À travers des photographies et installations, je raconte mon expérience dans des lieux, en écho aux vécus de celles et ceux que je rencontre. Ayant grandi dans un milieu agricole et vivant aujourd’hui dans une ancienne région minière de la France, les questions du sol et de son occupation traversent mon travail. Depuis 2016, je me rends sur l’emplacement des quatre villages choisis. Cinquante ans après leur fermeture, je cherche à connaître et questionner ce qu’ils ont été et ce qu’ils deviennent. Étrangère à ces espaces, à ce temps, je tente de cerner les lieux et d’en mesurer les racines.
Seule, puis guidée par d’anciens habitants·es, j’effectue sur le territoire mes recherches et expérimente autour des images et de la mémoire. En parcourant les chemins, photographiant les traces restantes et fouillant les archives, j’ai constitué un corpus visuel que je rassemble actuellement dans un livre d’artiste, trace sensible de ma rencontre avec ce territoire.
Ces rencontres m’amènent à me questionner sur ce qui fait un village. Est-ce le lieu, ses limites, ses habitations ou la mémoire, l’attachement, les racines? Peut-on envisager que ces derniers constituent le village, peu importe où celui-ci se trouve? J’ai été surprise par l’intensité des souvenirs conservés de la vie communautaire. Ces souvenirs deviennent des repères identitaires importants et des liens forts avec leur village d’origine sont maintenus. Beaucoup continuent d’y retourner, certains·es ont pu racheter un lot, d’autres remontent avec leur roulotte pour la chasse, d’autres encore parcourent le village en voiture en espérant y rencontrer quelqu’un. Ensemble, ils se réunissent lors de fêtes pour garder vivante la mémoire du lieu ou se mobilisent pour payer l’entretien du cimetière, etc. Sur les groupes Facebook des villages, les membres partagent des photos anciennes, des anecdotes, qui font vivre la localité. Cela aide à conserver la mémoire collective et à faire revivre le village virtuellement. Ainsi même fermé, il continue de vivre à travers celles et ceux qui y ont des racines.
Je ferme les yeux et je les vois
Comment traduire en images l’attachement, souvent profond, parfois invisible, à ces lieux? Pour la série Je
Je ferme les yeux et je les vois, Saint-Paulin-Dalibaire, 2023.
© Aurélie Le Maître


Sans titre, cabane de fortune à Saint-Thomas-deCherbourg, 2023.
© Aurélie Le Maître
ferme les yeux et je les vois, expression empruntée à un ancien habitant, j’ai collecté des photographies des villages et je suis retournée avec des personnes retrouver les endroits depuis lesquels elles avaient été prises pour représenter le paysage d’aujourd’hui. Puis, j’ai découpé dans les photos contemporaines les silhouettes des bâtiments tels qu’ils étaient à l’époque. Au-delà de l’image et à travers ses lacunes, le public est invité à s’interroger sur ces absences, ce qu’il en est advenu.
En rassemblant des fragments d’une histoire collective, je souhaite mettre en lumière cette situation et le livre est le dispositif de restitution que j’ai choisi pour ce sujet. Le choix de ce support m’est apparu évident au fur et à mesure de l’avancée du projet. D’une part pour la question de la mémoire, de la transmission. Les personnes qui ont témoigné étaient pour la plupart adolescentes à l’époque où cela est arrivé. Leurs enfants en revanche s’intéresseraient peu à cette histoire, parce qu’ils ne viennent pas du bois, parce qu’ils n’ont connu que la chasse de fin de semaine, parce qu’ils se sont éloignés géographiquement. D’autre part, je veux, au vu de l’écart géographique entre le terrain et mon atelier, réaliser un objet pérenne et transportable. Il témoignera des traces de ces hameaux qui subsistent tant sur le territoire que dans le cœur et la mémoire des gens.
Remerciements aux guides chaleureux qui m’ont partagé leurs visions des lieux, leurs souvenirs.

Dans les années 1929-1930, la Gaspésie est durement touchée par le chômage et à Cap-Chat, comme dans plusieurs autres paroisses, la crise met plusieurs familles dans une situation voisine de la misère. Devant les besoins urgents, Mgr Octave Caron, alors curé de Cap-Chat, aidé du député libéral de Gaspé-Nord, Thomas Côté, et quelques autres volontaires tels l’inspecteur de la colonisation, Euclide Gosselin, préparent de nombreuses requêtes pour divers ministères à la recherche d’une solution possible. Après délibérations, on trouve qu’il n’y a qu’un seul moyen efficace : fonder dans la forêt vierge de nouvelles paroisses. Un bon matin, la nouvelle se répand… On ouvre un village dans l’arrière-pays de Cap-Chat : Saint-Octave-de-l’Avenir.
Adrien Pelletier
Ancien résident de Saint-Octave-de-l’Avenir
Le recrutement est facile et c’est le premier départ à l’été 1932. Des résidents de Cap-Chat foncent hardiment dans un boisé à une douzaine de milles [près de 20 km], après avoir suivi un petit chemin jusqu’au rang VI et, finalement, un chemin de chasse. Pendant plusieurs jours, on recommence la même escalade qui mène toujours un peu plus loin. Partout, des arbres tombent de chaque côté du petit sentier. Ils bâtissent un abri, descendant chez eux le samedi et
remontant le lundi suivant. Heureusement, au-dessus de tout cela et pour nourrir leur espérance, il y a un coin de ciel bleu qui tranche avec le vert de la forêt et la grisaille des âmes.
Le premier travail est ébauché et on est prêt à déterminer le nombre de lots à distribuer. Mgr Octave Caron, qui est le promoteur de cette entreprise et qui est monté lui-même en faisant le piqué du chemin et en marquant l’emplacement des lots, mérite grandement que nous
lui rendions hommage. Les défricheuses et défricheurs ont besoin d’un père spirituel comme lui pour entreprendre un projet d’une telle envergure. Notre paroisse a l’honneur de prendre son nom, auquel il ajoute lui-même « de l’Avenir » pour la postérité sans doute.
S’établir
Les pionniers travaillent avec acharnement; ils bâtissent les camps en bois rond pour qu’au plus vite, femmes et enfants puissent venir les

rejoindre. Le premier hiver est extrêmement long, la neige est abondante et le printemps interminable. Les premiers arrivants·es bûchent avec peine quelques cordes de bouleaux vendues 5 $ (équivalant à 112 $ aujourd’hui 1 ) qu’ils doivent livrer par-dessus le marché au moulin de Roy & Frères à Cap-Chat. Heureusement, le ministre de la Colonisation offre à chaque famille une allocation qui varie selon le nombre d’enfants.
Au moins une fois par mois, Mgr Caron vient entendre les confessions, distribuer la Sainte Communion et célébrer la messe. La première se déroule en janvier 1933 dans le camp de Pit (Philadelphe) Gagné, qu’on appelle « le roi de la colonie » comme il possède le camp le plus grand.
Au printemps, toutes et tous mettent l’épaule à la roue : il faut défricher, sarper, enlever les souches pour faire un jardin, faire de l’abattis et brûler afin de semer un peu de grain. Ce mode traditionnel consiste à mettre le feu aux branches et autres matières ainsi qu’à une partie de la forêt pour la mettre en culture. C’est là qu’on assiste à des scènes lamentables. Le vent fait se rallumer des feux mal éteints, ce qui engendre des conflagrations. Des camps sont dévorés avec leur contenu et voilà encore une fois de pauvres gens obligés de repartir à zéro.
À l’été, la terre vierge rend ses premiers produits et les récoltes sont excellentes. On construit une chapelle qui servira aussi d’école. Les enfants ont besoin de s’instruire. Jusque-là, Eveline Fournier leur enseigne dans un camp, c’est surtout pour le catéchisme.
Se développer
Le premier magasin est celui de Lionel « Ti-Nel » Bérubé en 1933. Par la suite, plusieurs suivent. La même année, Freddy Parent construit le premier moulin. En 1934, ouverture
du rang VIII et on remarque un important contingent de Padoue et de Price. Une deuxième scierie s’installe et Saint-Octave obtient son premier bureau de poste chez Edgar Chrétien. Nous avons le courrier deux fois par semaine : le mardi et le vendredi, ce qui est d’ailleurs suffisant. Quelques années plus tard, nous obtenons la distribution du courrier tous les jours. Le premier postillon est Lionel Bérubé.
En 1935, la vie bat son plein, mais il manque un prêtre résident; ce sera l’abbé Auguste Rivard. Il fait naître un espoir sans borne et se dépense sans compter. Qui ne se souvient pas de ces gestes miraculeux, et le mot n’est pas trop fort! Alors que certains feux de forêt se déclenchent et que la désolation se lit sur tous les visages, notre bon curé arrive sur place, le vent tourne ou la pluie se met à tomber. Et l’espoir reprend de plus belle. En 1935, Mgr Ross, évêque de Gaspé, vient bénir la chapelle. Enfin la cloche sonne! Dorénavant, les habitants·es entendront son appel au rendez-vous.
En 1936, d’autres rangs s’ouvrent : les rangs doubles Romieu, Faribault et Courcellette. À la suite de requêtes répétées de la communauté, conjointement avec le curé, le ministère de la Santé juge nécessaire de doter la paroisse d’une
mariages ont lieu en même temps à Saint-Octave, vers 1953-1954.


garde-malade, tant désirée des mères qui attendent la cigogne. Un bon midi arrive Jeanne-d’Arc Emond, montée à cheval et accompagnée de son père. À l’époque, le bois n’a rien de rassurant. Il faut avoir les nerfs solides pour s’aventurer en pleine forêt au secours immédiat d’une personne blessée ou malade. La traîne à chien suit la piste étroite qui prend les apparences d’un ravin profond ou d’une montée infranchissable. Je ne me rappelle pas que Mlle Emond n’ait jamais failli à la tâche.
Quelques nouveaux venus·es viennent remplacer les démissionnaires. En 1938, un nombre assez imposant vient encore s’ajouter en provenance de Cap-Chat, SainteAnne-des-Monts, Saint-Octave-deMétis, Padoue, Val-Brillant, SaintMoïse, Sayabec, Gros-Morne, etc. C’est le début de la construction de l’église actuelle. Le curé parcourt lui-même les rangs et organise des corvées. Chacun fournit largement bois, temps et argent. Le 23 septembre 1939, Mgr Ross bénit notre église. C’est la grande fête paroissiale alors que le village compte environ 900 âmes.
Puis, le cercle des Fermières est formé : c’est là que les doigts de fée accomplissent des travaux d’une beauté remarquable. N’oublions pas la commission scolaire et la
coopérative, sans compter la caisse populaire. Ouverture aussi du premier restaurant appartenant à Gérard Leclerc du grand magasin général. La paroisse bouillonne d’activités; les moulins sont nombreux, deux forgerons ne manquent pas de travail, les magasins font de bons chiffres d’affaires, les ouvriers et menuisiers sont employés régulièrement, de belles maisons s’alignent toutes bien faites, les chemins sont réparés ou construits. Enfin, c’est une paroisse qui affiche sa raison d’être : la prospérité et la foi en l’avenir.
Il faut dire qu’à partir des années 1940, les familles bénéficient de plusieurs avantages. Par exemple, elles reçoivent 15 $ l’acre pour le défrichement et un autre 15 $ pour le premier labour, une subvention de 300 $ pour la construction d’une maison et 75 $ pour la construction d’une grange-étable. On est au sommet de la population en 1941 avec 150 familles et 1 100 âmes environ. Cette année-là, il y a 38 baptêmes.
Dès l’année suivante, un incendie détruit le premier moulin à bardeaux et un autre ferme. Déjà, certains sont obligés d’aller travailler sur la Côte-Nord pour gagner leur pain. Puis, grand feu de forêt
dans le rang Faribault que personne n’oubliera jamais. Une centaine de personnes restent sans abri et partent pour ailleurs. Le déclin de Saint-Octave vient de commencer avec la fermeture du rang. À l’été 1943, le curé Rivard quitte à son tour pour une paroisse plus ancienne, et quatre curés lui succèderont.
Malgré le déclin, en ces années 1948-1949, Gérard Leclerc commence à projeter des longs métrages au sous-sol de l’église; le premier film présenté est Le Comte de Monte-Cristo. On a enfin le téléphone en 1950. Toutefois, les boisés s’épuisent et l’exode commence. Paradoxalement, 1951 est l’année où il y a le plus de mariages, pas moins de 13! C’est aussi la construction tant désirée du couvent qui sera dirigé par les Sœurs de Saint-Paul de Chartres. Le premier chantier du Syndicat forestier, fondé en 1945, ouvre sur le bord des Chic-Chocs en 1953. Le bois reste sur place, car il n’y a pas de chemin. Les rangs se vident parce que les gens cherchent à se rapprocher de l’église. On espère des solutions. Puis un jour, il y a comme une lueur d’espoir : la mine d’uranium. Le monde l’appelle « la mine à Ti-Pierre » parce que c’est lui, Pierre Ouellet, qui travaille le
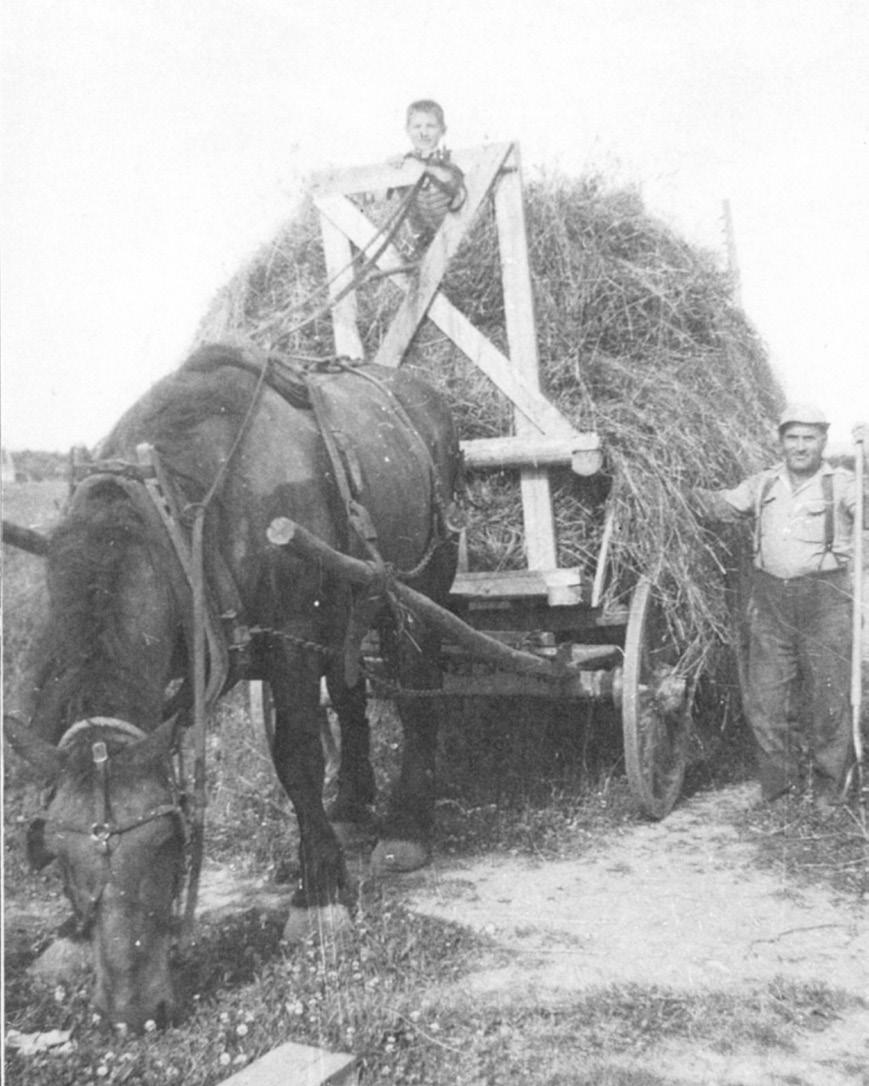

plus fort pour que ça marche. Un jour, une foreuse arrive pour creuser. Finalement, il y a de l’uranium, mais trop peu pour que ce soit rentable. La foreuse repart… En 1955, la route devint enfin carrossable jusqu’au sommet des Chic-Chocs.
Le moulin fonctionne encore à plein rendement, la coopérative et les magasins Leclerc, Roy, Cyr et Dumont font un bon chiffre d’affaires. Le Syndicat forestier fonctionne, le sciage du bois se fait sur place au moulin. Malheureusement, en août, il est détruit par un incendie, ce qui porte alors un dur coup au syndicat, appelé par la suite à disparaître. Et comme un dernier clou dans le cercueil, un grave incendie détruit le rang VII et une partie du rang VIII. Le feu se propage jusqu’à Saint-Bernard-des-Lacs. La paroisse est vouée à la fermeture.

De 109 familles en 1961, on passe en cinq ans à 67 familles pour 510 âmes.
L’année 1961 est marquée par une nouvelle loi fédérale, celle sur l’aménagement rural et le développement agricole (ARDA) visant le développement régional. Toutefois, deux ans plus tard, se déroule la première assemblée pour la fermeture des villages. La paroisse est dans des conditions critiques; toutes et tous s’acharnent à essayer de survivre. Le Bureau d’aménagement de l’Est du Québec (BAEQ) publie alors son étude et recommande la fin d’une dizaine de villages, dont Saint-Octave.
L’inquiétude et l’insécurité se lisent sur les visages de ces pauvres artisans·es qui ont passé leurs plus belles années sur la terre, afin de se créer un fructueux avenir. Ils voient le labeur de 40 ans s’anéantir devant eux. Les classes disparaissent pour de bon, les lots sont déserts, les maisons sont hantées par le silence,
le silence du néant. Un comité citoyen est formé et se rend à Québec. Le premier ministre Robert Bourassa (1933-1996) vient même nous rendre visite à Saint-Octave. Puis, le 25 septembre 1970, nous votons en faveur de la fermeture; il n’y a plus d’avenir. Il reste 32 familles pour 225 âmes qui doivent quitter en 1971.
Mais tout de même, efforçons-nous de laisser percer une note plus optimiste, car Saint-Octave-de-l’Avenir a été bercé par des instants heureux. Pensons à la joie d’avoir du pain sur la table, de se retrouver le dimanche à la grande messe, et que dire des belles veillées du temps des Fêtes! Saint-Octave a vu 191 mariages et près de 1 000 naissances. Celles et ceux qui en sont à leur dernier repos sont là comme des témoins d’un peuple acharné qui se souvient. C’est le souvenir d’une époque.
Je dédie ce texte aux anciennes et anciens, à leurs enfants et petitsenfants ainsi qu’à toutes les personnes intéressées de savoir ce qu’a été la vie communautaire de cette belle petite paroisse.
Pour en savoir plus : Georges Guy, Daniel DeShaime et Réjean Bernier, St-Octave-de-l’Avenir 1932-1971…, Cap-Chat, DeShaime & Associés éditeur, 2009, 283 p.
Remerciements à Simone Gagnon, Rita Tremblay, Georges Guy Chrétien et tous les autres qui ont inspiré les faits et anecdotes mentionnés.
Note
1. Les équivalences sont basées sur l'outil de calcul de l'inflation de la Banque du Canada.
ON SUIT VOTRE HISTOIRE DE PRÈS POUR VOUS ACCOMPAGNER
À TRAVERS LE TEMPS, LES SAISONS, LA VIE.
STYLE MÉRITE
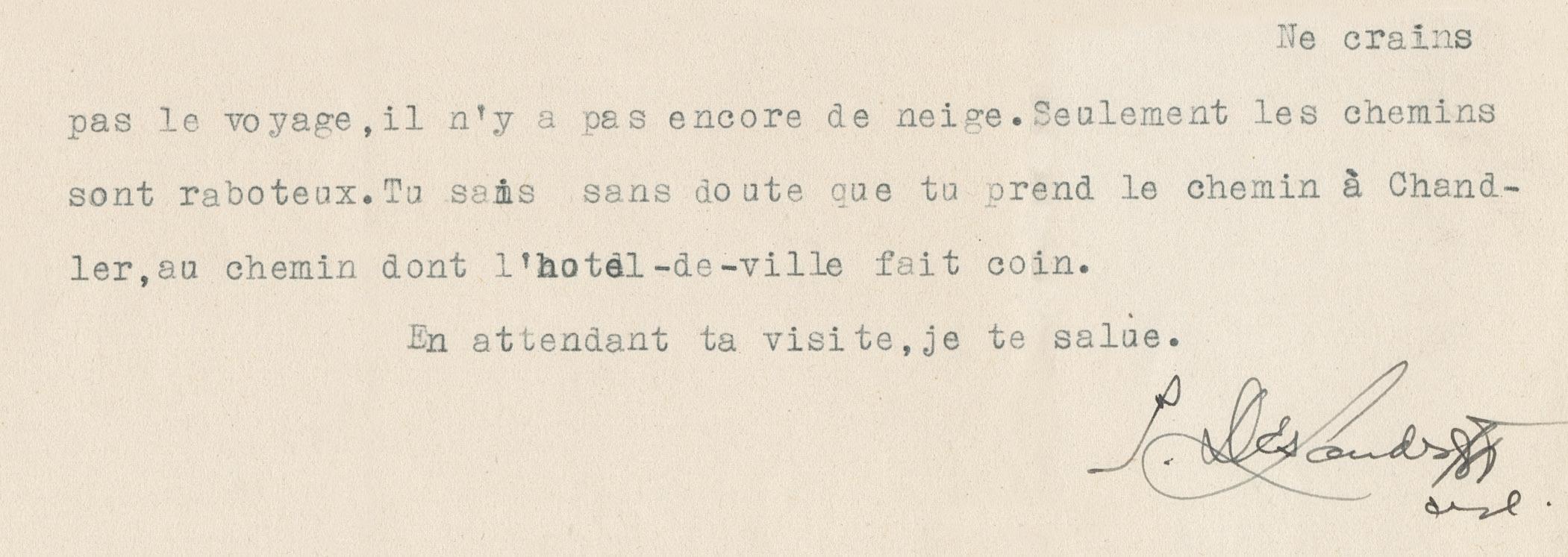
Lettre envoyée à l’abbé Gérard Guité par Ildège Des Landes, curé de Sainte-Bernadette-de-Pellegrin, 1945. Musée de la Gaspésie. Fonds Gérard Guité. P53/30/362/41
De mon enfance, sourd cette image qui représente, à ce moment-là, l’aventure. Une poussière dense volette derrière l’auto paternelle alors que toute la famille roule vers Pellegrin. De la côte, depuis Chandler, une vingtaine de milles (35 km) à patienter : « Quand est-ce qu’on arrive? » scande la marmaille. Nonobstant les cailloux qui valsent sous la carcasse métallique de l’auto et qui assourdissent les paroles, curieux, j’interroge : « D’où vient ce nom, Pellegrin? ». Les épaules se haussent en réponse exclamative. Nous sommes au mitan des années 1960 et personne ne manifeste appréhensions et émotion liées à une fermeture éventuelle de cet arrière-pays. Il est toujours noble de protéger l’enfance contre les blessures.
Jean-Claude Clavet
Neveu de Donat Clavet, ancien résident de Sainte-Bernadette-de-Pellegrin
La violente nouvelle de la fermeture arrive à mes oreilles, me dit ma mémoire, en même temps que l’expropriation de Forillon, au tournant de 1970. Un désarroi partagé plane alors dans les maisons de la côte qui l’évoquent de manière presque incantatoire, comme si le répéter apprend à s’y soumettre. En rides inquiètes sur les visages, se sculpte la tristesse de la parenté de Pellegrin qui vient nous visiter pour tenter d’évacuer ses peines, par la parole, par la solidarité, par l’amitié. Nous écoutons les uns les autres, puis des rides migrent aussi sur nos visages. Plus d’un demi-siècle plus tard, je veux mieux comprendre parce que je sais que « le passé, le présent et le futur ne sont pas désunis, mais unis »1
Origine toponymique
Comment ne pas connaître une fascination devant des noms de villages si singuliers? Ainsi en est-il de Sainte-Bernadette-de-Pellegrin. Va aisément pour la première partie qui correspond à un hagionyme, un nom de sainte, ce qui s’explique par l’histoire québécoise. Cet arrière-pays naît en 1935 alors que l’Église appuie le gouvernement de Louis-Alexandre Taschereau (18671952) dans sa volonté d’endiguer le chômage et la pauvreté. Depuis 1929, la Grande Dépression frappe durement et ne semble pas vouloir s’étioler; de fait, elle court jusqu’en 1939. Se conçoit un plan de colonisation, de 1934 à 1937, reposant sur l’octroi de terres aux chômeurs qui doivent s’appliquer à les défricher, les
cultiver et les habiter. Ce plan, sous l’égide d’Irénée Vautrin (1888-1974), reçoit l’approbation ecclésiale parce qu’il valorise une vie pastorale selon laquelle l’appropriation du territoire, par les Canadiennes françaises et Canadiens français qui se vouent à l’agriculture, est primordiale. De cette manière se consolide la fibre catholique et s’assure une pérennité démographique grâce à une natalité fort importante. Le plan, qui reçoit l’appellation Vautrin, constitue
Où se trouvent mes prémisses, mes racines dans l’histoire? 2

un moment central de l’extension du peuplement québécois. Qu’un ministère, dit de la Colonisation, naisse pour ce faire exprime sans équivoque la valeur de l’exercice mis en œuvre. Dès lors, si le plan Vautrin porte fruit, l’urbanisation, se soldant pour plusieurs par le chômage, et les migrations massives, aussi bien vers l’Ouest canadien que vers les ÉtatsUnis, se voient amorties.
À l’hagionyme se joint un patronyme : Pellegrin. À quelle hypothèse se référer pour en dévoiler la source? J’écris source et… je souris. Pourquoi? Parce que le patronyme du village renvoie à Gabriel Pellegrin (1713-1788) qui est mandaté aux relevés hydrographiques dans le golfe du Saint-Laurent de 1734 à 1740. Or, la rivière Petit-Pabos baigne l’arrière-pays de Pellegrin. Cet hydronyme, appliqué à partir de 1928, suggère le nom de l’hydrographe du 18e siècle.
1935-1971
Ces années campent respectivement la naissance et la fermeture de Sainte-Bernadette-de-Pellegrin. Que dire de ces 144 saisons. Vaut mieux exprimer des saisons que des années parce que les temps vernal, estival, automnal et hiémal montrent différentes physionomies. Les gens de l’arrière-pays œuvrent,
à l’évidence, sans répit pour conquérir ce nouveau territoire où ils veulent habiter. Leurs conquêtes d’une identité villageoise demeurent tributaires de la signature des saisons. Les exigences printanières, les travaux estivaux, les labeurs automnaux et les peines hivernales ne quémandent pas de la même façon. Il appert qu’il faille une volonté exemplaire pour s’établir, vivre et progresser dans un arrière-pays. Pour saisir toute la précarité vécue, suffit de penser que l’habitant·e de l’arrière-pays ne réussit à gagner qu’entre 200 et 300 $ annuellement. Cette terre, qui amène l’habitant·e dans le pays de l’intérieur, ne se montre pas beaucoup fertile, de sorte que le travail forestier concentre l’activité économique. Avec des revenus si minces, comment l’habitant·e peut-il espérer se procurer des semences pour nourrir la terre? Les autorités gouvernementales le savent et les distribuent gratuitement. Malgré les conditions difficiles, entre son ouverture en 1935, et son erre d’aller deux ans plus tard en 1937, Pellegrin connaît, en quelque sorte, une explosion démographique, passant de 60 à 445 personnes. Pellegrin illustre un phénomène démographique gaspésien : « de 1931 à 1941, c’est le meilleur moment de l’occupation du
territoire. La population du Québec va croître de 14 %, alors qu’en Gaspésie elle augmente de 22 % »3. Par quelles évocations significatives est-il permis de scénariser les 144 saisons? Pellegrin se construit progressivement en tant que communauté en mettant en œuvre une pluralité de modes qui assurent aux habitants·es une vie paroissiale dynamique. Autour des activités forestières, qui consistent en travaux de bûcheron, de sciage et de transport, croissent une église, des écoles, des magasins, des services infirmiers qui expriment une volonté déterminée de se sentir bien, là où on réside. Hommes, femmes, enfants répètent, par leurs gestes au quotidien, leur appartenance à cet arrière-pays et à nul autre. Avant que l’automobile impose sa poussière sur la route de Pellegrin, les résidents·es se donnent des moyens de transport adaptés aux conditions saisonnières : bœuf, cheval, traîneau à chiens, « snowmobile » (autoneige).

Edouard-Hospice Legendre, extrait du Plan du relevé de la rivière Petit Pabos, 1873. Saint-Edmondde-Pabos sera situé au nord de Pabos et SainteBernadette-de-Pellegrin au nord de Saint-Edmond. ANQ Québec. Fonds Ministère des Terres et Forêts. E21,S555,SS1,SSS18,P82B
Feue Anita Normandeau
Clavet Épouse de Donat Clavet, anciens résidents·es de Sainte-Bernadette-de-Pellegrin
À la Fête-Dieu, nous décorons nos maisons à l’extérieur et la procession passe devant. Tout le monde va à la messe, même les enfants et les bébés, le curé dit que ce n’est pas grave s’ils pleurent.
Le curé nous surveille, car nous nous réunissons dans une maison pour écouter de la musique et danser. Josephat Bolduc, marié avec Isoline Cyr, joue de la mandoline. Vers 23 h 30, il faut que tout s’arrête et que nous rentrions chacun·e chez soi.
Le curé est tellement sévère. Il ne faut pas empêcher la famille, il faut être enceinte chaque année. Le curé est venu chez nous et il m’a demandé combien j’avais d’enfants? J’ai répondu que j’avais seulement Georgette, et il m’a dit : « La prochaine fois que tu viendras à la confesse, tu ne pourras pas communier. ».
Il y a même une femme qui s’est confessée d’avoir empêché la famille et le dimanche, elle est allée communier et le curé lui a dit de sortir.
Extrait et photo tirés de : Gilda Grenier, La vie de nos Aïeuls. Ste-Bernadette-de-Pellegrin 1935-1971. St-Edmond-de-Pabos 1931-1971, 2023, p. 44.
Une vie communautaire intense demande que les personnes habitant le territoire puissent communiquer, échanger des biens, répondre à leurs besoins, consulter, se rendre à l’école, assister aux offices religieux, participer à des loisirs. Elle gravite autour de symboles spécifiques qui renvoient à sa foncière identité. Ainsi, elle estampille sa présence et soude son appartenance, se caractérisant par un socle canadien-français catholique; des nécessités spirituelles l’obligent. Elle se donne un lieu de culte, elle arbore des croix de chemin, elle aménage un cimetière pour honorer ses morts·es. D’ailleurs, des Pellegrinois·es, même après la fermeture de leur arrière-pays, en assurent l’entretien. Manifestation forte de la foi, la croix de chemin signe un enracinement précis sur le territoire : ou elle fixe les limites paroissiales ou elle commémore un moment significatif ou elle remercie pour l’aide reçue ou elle protège des catastrophes saisonnières.

Lise-Anne Poirier
Ancienne résidente de Saint-Jean-de-Brébeuf
Il est considéré comme un scandale que les femmes enceintes fréquentent les célébrations de l’église et, comme elles sont enceintes chaque année, il est rare qu’une femme soit présente à l’église. Quand le curé invite les paroissiens à une réunion, il va sans dire qu’aucune femme ne sera présente et il en est de même pour les visites au presbytère. Les femmes n’existent pas quand il s’agit de jouer un rôle quelconque dans les activités de l’église, sauf bien entendu pour le repassage des surplis et soutanes!
Je me souviens que papa emmène les enfants de sept ans et plus avec lui à l’église et qu’il raconte à maman ce que le curé a dit dans son sermon. Il doit aussi demander une « dispense » au curé parce que maman ne peut pas aller faire ses Pâques. En effet, il est péché mortel de ne pas aller se confesser et communier au moins une fois par année dans le temps du carême qui précède de 40 jours la fête de Pâques.
Quand la fermeture s’envisaget-elle? Paradoxalement, et curieusement, c’est en 1948 alors que Pellegrin connaît sa plus forte démographie. L’économie urbaine nécessite de la main-d’œuvre, laquelle se trouve en partie dans l’arrière-pays, dont la naissance est promue pourtant plus de dix ans plus tôt. Les sommes octroyées à

Pellegrin fondent, ce qui inévitablement se traduit par un apport démographique à la baisse. Le grand rêve projeté d’un arrière-pays gaspésien prospère s’érode progressivement de sorte que, avec l’entrée dans les années 1960, il connaît son chant du cygne. L’an 1971 marque la fin de Sainte-Bernadette-de-Pellegrin. Selon cette hypothèse retracée par l’historien Jean-Marie Thibeault, la fermeture s’effectue graduellement, d’abord sous le gouvernement de l’Union nationale de Maurice Duplessis (1890-1959), puis durant la Révolution tranquille pendant les années 1960, pour se voir définitivement consumée au début de la décennie 1970.
Symbolique de l’arbre
Au fronton des rencontres importantes des êtres humains trône cette nécessité de s’élever pour partager ensemble un sens qui les dépasse.
Nycthémère sur nycthémère, ils enfantent un chez-nous par-devers paysage, lieu, communauté, labeur, travail décuplé, souci, peine, joie, minime ou puissante, célébration, amitié, famille, présence des morts·es… Une identité naît, croît, s’enchâsse dans le respect des entours et d’autrui. Voilà pourquoi la symbolique de l’arbre se révèle si juste pour exprimer l’humain. Il s’enracine. Et d’autant s’avère profond son développement racinaire, d’autant il s’élève en ramure altière. Les racines arborescentes en embrassent d’autres souterraines avec lesquelles elles communiquent. L’arborescence vit tout aussi bien dans les arcanes terriens que dans la matrice ouranienne. Les humains et les arbres se touchent haut. La terre et la voûte sont maternelles.
Comment ne pas évoquer cet aphorisme du roi chantant Félix Leclerc (1914-1988) : « Quand il tombe,
l’arbre fait deux trous. Celui dans le ciel est le plus grand. »4. Dialoguant avec Leclerc, je lui ferais valoir que la chute d’un arbre crée trois trous, celui dans l’âme est indélébile. Toute privation, pour des intérêts maquillés sous des palabres, questionne notre humanité. L’antonyme d’enracinement est déracinement.
Je dédie ce texte à la famille ClavetNormandeau.
Remerciement aux Archives nationales du Québec qui ont mis gracieusement à disposition leur photographie et archive.
Notes
1. Walt Whitman, Lepoèteaméricain, Paris, Mille et une nuits, 1855, réédition 2001, p. 20.
2. Carl Gustav Jung, Mavie :Souvenirs,rêvesetpensées, Paris, Gallimard, 1961, réédition 1973, p. 321.
3. Noémie Bernier et Jean-Marie Thibeault, « Fermeture en trois temps », Àbâbord, no 65, été 2016.
4. Félix Leclerc, Le calepin d’un flâneur, 1961, dans Félix Leclerc, tome III, Montréal, Henri Rivard Éditeur, 1997, p. 172.

Camion de livraison de J. A. Laflamme qui possède des magasins à Pellegrin, 1952.
Photo tirée de : Gilda et Ginette Grenier, La vie de nos Aïeuls. Pellegrin 1935-1971; St-Edmond 1931-1971, 2023, p. 92.


Son diplôme de 9e année est bien la seule chose à laquelle Anne-Marie Huard peut s’accrocher alors qu’elle quitte ses proches et Saint-François-de-Pabos à peine âgée de 15 ans. Ça prend 17 ans pour enseigner, c’est une condition formelle alors les commissaires trafiquent son âge et inscrivent 17 ans. « Je sais bien que j’ai 15 ans, mais les autres pensent que j’ai 17 ans! Ça prenait 17 ans alors j’ai gardé 17 ans pendant trois ans. » se rappelle-t-elle. Cette expérience à Saint-Edmond est restée gravée dans sa mémoire; 70 ans plus tard, elle raconte ses souvenirs. À son ouverture en 1931, SaintEdmond ne possède pas d’école. La classe se tient dans l’église alors que deux autres « écoles » sont tenues dans des résidences privées. Le gouvernement accorde un octroi alors que le bois et la main-d’œuvre sont fournis gratuitement par les habitants·es. L’école est ainsi bâtie planche par planche après les « heures d’ouvrage ». J’aurais pu rester dans l’école parce que la bâtisse est faite pour accueillir une
On dit souvent que l’enseignement est une vocation. C’est d’autant plus vrai quand ce métier est exercé dans ce qui est communément appelé les « écoles de rang ». Une classe comprenant divers niveaux, un local souvent mal chauffé, des élèves avec une attention plus ou moins dispersée et un maigre salaire. Quand les villages sont plus éloignés, l’enseignante demeure sur place et doit, en plus, quitter sa famille et son lieu natal. C’est ainsi qu’en 1953, Saint-Edmond-dePabos, situé à 9,5 milles (15 km) derrière Chandler, voit arriver
Anne-Marie-Huard qui dirigera la classe durant trois années.
Récit d’Anne-Marie Huard
Enseignante à Saint-Edmond-de-Pabos de 1953 à 1956
Rédigé par Marie-Josée Lemaire-Caplette Rédactrice en chef
personne. Il y a une cuisine avec une cuisinière et une chambre en haut, ce qu’on appelle une école à un étage et demi. Je trouve ça « cute », mais je ne serais pas restée là toute seule parce que les maisons sont éloignées.
Au début, je reste avec une de mes cousines, Claudette qui enseigne, elle, dans une des trois premières écoles. Cette pension est tenue par Ovila Jean et son épouse, et ils nous gardent jusqu’à Noël. Puis, après les Fêtes, leur garçon qui est à Montréal s’en revient chez eux, donc la dame nous dit qu’on doit partir. Ce sont des gens très, très pieux. Il n’y a pas d’affaire à ce que des jeunes filles pas mariées restent avec un garçon même si tout ce qu’on fait, c’est jaser. On aurait été sur le même étage à part de ça. Ma cousine ne revient pas après les Fêtes alors je me cherche une autre pension. Finalement, c’est Laurette Gionet qui me garde pour me dépanner le reste de l’année. Avec M. Gauthier, c’est un couple qui n’a pas d’enfant.
Ah, je suis bien là! Mais je pense à chez nous tout le temps. Il n’y a pas de téléphone; le téléphone, ce n’est pas partout encore.
Avant de partir pour l’été, je m’assure que j’ai un toit en septembre. Ce sera chez M. et Mme Gaudreau et je vais y être pour le reste de mes


École à Saint-Edmond-de-Pabos, années 1930.
Photo tirée de : Gilda et Ginette Grenier, La vie de nos Aïeuls. Pellegrin 1935-1971; St-Edmond 1931-1971, 2023, p. 46.
trois ans. La pension est entre chez M. Gauthier et l’école alors je me rapproche d’un demi-mille certain. On se promène à pied tout le temps, beau temps, mauvais temps. Des fois, M. Gionet, la parenté de ceux qui tiennent le petit restaurant, vient reconduire ses enfants. Il a une grosse famille, sept enfants, je pense. Et puis, s’il y a une petite place, il m’embarque.
Dans ma nouvelle pension, la femme, Mme Moreau que je l’appelle, est une veuve qui s’est remariée avec M. Gaudreau de Grande-Rivière. C’est une personne âgée, mais en forme. Ils ont chacun des grands enfants qui sont à Montréal. Il y a donc de la place dans la maison. Du bon monde! Quand il n’y a pas d’ouvrage dans leur coin, les gens vont vers les colonies comme le gouvernement donne des terres. Les Gaudreau se sont donc établis à Saint-Edmond. Les gens viennent de Chandler et des environs, mais pas vraiment de la ville. Il y en a d’autres qui partent et vont à Gaspé ou continuent jusqu’à Montréal, mais ce n’est pas tout le monde qui a les moyens, surtout pas dans ce temps-là.
À la fin de l’année, jusqu’en septembre, je retourne à la maison à Saint-François. Je commence aussi mon cours à Mont-Joli auprès des Sœurs du Saint-Rosaire, formation que je fais l’été et que je termine après mon passage à Saint-Edmond. Du village, je me rends à Chandler. Un des personnages qu’on connaît à Pellegrin, Ernest Grenier, a un petit autobus et un « snow » (« snowmobile », une autoneige) pour l’hiver.
Il fait la tournée des gens, on attend au chemin quand on connaît ses heures. Pellegrin est plus gros, mais est encore plus loin dans les terres derrière Saint-Edmond. Là, il y a beaucoup, beaucoup de gens. Il y a une belle grosse école et plusieurs professeures. Le monde va à Chandler pour faire leur épicerie. Dans les villages, il n’y en a pas, il y a des « petits magasins » qu’on appelle, où on peut se réunir pour prendre une liqueur, pour jaser. Nous autres, avec la famille Cyr, ma famille amie, on fait des mots croisés.
Quand on est arrivées avec ma cousine à Saint-Edmond, il y avait un mariage. Tout de suite, les Cyr nous ont invitées. Dans les grands champs, il y avait une plateforme faite de planches pour danser. Des jeunes venaient nous voir, nous saluer, puis nous donner la main. Eux autres, les Cyr, c’est une grosse famille, plus que 11 enfants, je crois. Les plus vieux sont partis et le bébé a mon âge : 15 ans. Mais on se rappelle que pour eux, j’ai 17 ans! La famille Cyr me reçoit souvent. Ce sont des personnes cultivées; il y a un piano dans leur maison. Quand j’y vais, Mme Cyr dit : « Bernard, ta maîtresse est là! ».
Vivre dans ces « nouveaux villages »
À Saint-Edmond, il y a peu de services ou de magasins, mais il y a de grands champs. Les gens se nourrissent de l’agriculture. Le monde ne crève pas de faim, c’est ça l’important. La plupart ont aussi des animaux. Ils sèment les patates, le navet ainsi que de l’avoine et du foin pour nourrir les animaux. Ce sont de grandes familles, il y a de la marmaille!
Pour les maisons, c’est sûr que ce n’est pas comme à Chandler! Par exemple, il manque les toilettes dans la maison, ce sont encore les « bécosses » dehors. À l’école, elles sont à l’intérieur et à l’extérieur. Quand on entre, il y a un petit portique. D’un côté, il y a deux toilettes : une pour garçons et une pour filles. Puis de l’autre côté, c’est la porte de la classe qui est chauffée
au bois. C’est le bedeau qui s’organise pour acheter le bois. Il est assez âgé, mais ça fait longtemps qu’il est là. Il s’occupe aussi de l’église. On a une petite église et le curé vient une fois par mois ou par deux mois. On est dans la petite chorale. Je n’ai jamais autant ri de ma vie! Je suis ricaneuse, alors il y en a qui font des blagues pour me faire rire.
Le métier d’enseignante À l’école, j’ai 15 à 20 élèves de 7 à 15 ans, comme moi! J’enseigne à tout le monde en même temps, mais je me fais aider par les grands·es. Il y en a qui apprennent plus vite que les autres. Certains·es sont aussi plus vieux comme Bernard Cyr, de ma famille amie. Je pense que ça fait trois ans qu’il n’y a pas eu d’enseignante avant que j’arrive. Celles et ceux qui sont intéressés pouvaient continuer à lire chez eux et à faire des activités dans les livres. Comme Bernard, plusieurs doivent recommencer leur année. Auparavant, il a eu cinq professeures, car elles ne restaient pas longtemps.
Chez moi, à Saint-François-dePabos, j’avais connu l’enseignement pour deux « degrés », pas plus que ça. Le nombre de niveaux dépend du nombre d’élèves aussi parce qu’à l’école, il y a de la place pour tant d’enfants. Pendant que je m’occupe des plus jeunes, les plus âgés·es

s’occupent. Si c’est 10 ou 15 minutes, il faut qu’ils m’attendent pour des explications pendant que j’en donne à d’autres, et les autres continuent. Celles et ceux qui ont fini, je vais les trouver pour partir leur affaire. Puis, si on n’a pas fini, bien, il y en a qui restent après l’école, à 4 heures.
J’enseigne le catéchisme, on s’en doute! À tous les niveaux et c’est tout le monde qui en profite. Quand il y a une messe, tout le village est là donc les familles savent leurs prières pas mal. L’hiver, le curé de Pellegrin vient faire sa visite à l’école quand il vient pour la messe parce que l’église est à côté de l’école et que c’est chauffé. Il y rencontre des paroissiennes et paroissiens pour des baptêmes par exemple. Il fait même des baptêmes à l’école. À ma connaissance, il y a un baptême auquel les enfants assistent. Ils posent des questions et le curé aime ça. Quand le printemps s’en vient, la profession de foi s’en vient aussi. J’ai un programme avec le catéchisme qu’on commence avec les neiges. C’est pour les plus vieilles et vieux, ils prennent les 10 ans, car ils savent qu’il y en a qui n’iront pas plus tard à l’école. Puis, le curé fait une messe spéciale en juin. Il y a un certain nombre de questions qu’il prend n’importe où dans le catéchisme. Il met des notes là-dessus, et les enfants doivent obtenir la note de passage pour avoir leur profession de foi.
Pour le français, il y a des cahiers. Je prépare des choses et je les fais chanter. Je ne peux pas faire de copie. Si je copie quelque chose, c’est à la main donc je fais trois, quatre copies. J’ai aussi mon journal et ma préparation. Pour les préparations, j’ai deux cousines qui enseignent. Elles écrivent toutes les affaires dans leur cahier. Une d’elles, Aline, habite en face alors quand je retourne chez nous, je regarde tout le temps ses cahiers pour voir comment elle fait. Je suis curieuse… et j’aime ça.
La première année, la paye annuelle est aux alentours de 600 $ (correspondant à environ 6 855 $ de nos jours) et je dois payer la pension 20-25 $ par mois (entre 228 et 286 $

Assistance à une messe à Saint-Edmond-de-Pabos, années 1950.
Collection Anne-Marie Huard
aujourd'hui). La première année, j’ai ma paye fin septembre et la dernière, c’est pour ma fête le 31 mai. Papa fait du bois pour me donner mon 25 $ par mois et moi, je rembourse papa. La première année, j’ai donc son argent à la fin du mois de mai. Je suis descendue pour ma fête. Celui qui vient me porter ma paye me dit d’envoyer les jeunes chez eux. « Un congé, commence à faire beau, puis tout ça! » Puis, il ajoute : « Savourez votre paye! » parce que c’est quand même une bonne paye. Maman vient magasiner à l’automne avec moi pour avoir un petit peu de linge. C’est le temps pour magasiner des bas, des « bobettes »… Ce ne sont pas des « bobettes » comme aujourd’hui, c’est chaud, faut que ce soit chaud!
La période des neiges
L’hiver, ce sont les traîneaux, les skis. Il y a aussi des marcheuses et marcheurs. Moi, je n’ai jamais autant marché que là. Tous les soirs, je finis ma préparation à l’école et je m’en vais à la maison souper. Je m’habille chaudement et je descends chez les Cyr. Ça me prend quasiment une demi-heure, mais je marche vite par exemple. Mais la côte! Il y a une grosse côte qui descend pour aller chez les Cyr. Quand je pars, je dois la remonter! Je me rappelle qu’ils m’ont fait des skis. Des fois, je marche avec la neige jusqu’à la fourche. Ces jours-là, je ne suis pas obligée d’aller à l’école, mais je peux aller chez mes amis·es.
Une expérience mémorable
Dans mon village à Saint-Françoisde-Pabos, il y a une petite école toute neuve où j’applique en 1956.
J’obtiens le poste du haut de mes « vrais » 17 ans! Quand je pars de Saint-Edmond, c’est Thérèse, qui travaille dans un gros magasin à Chandler, qui me remplace. Je continue par la suite à visiter les Cyr, c’est une grande amitié qui se poursuit. Un moment donné, ils ferment les colonies et ils doivent partir de là en 1971. Pellegrin, qui est si bien organisé, est aussi touché.
Chaque année, un inspecteur vient à l’école après les neiges. Il vérifie tous mes travaux. Je suis chanceuse parce que j’ai ma cousine Aline à qui je demande bien des renseignements. À sa venue, l’inspecteur regarde mon journal et mon cahier de préparation. Ensuite, il pose des questions à chacun·e des élèves; je veux mourir! L’inspecteur conclut : « Je pense que vous pouvez quand même aller loin. ». J’enseignerai 35 ans et tout commence à l’âge de 15 ans à Saint-Edmondde-Pabos.
Je dédie ce texte à ma famille amie, les Cyr, qui m’a chaleureusement accueillie à Saint-Edmond et qui a contribué à faire de mon séjour un moment de joie et de rires.
Remerciements à Marie-Pierre Huard, archiviste au Musée de la Gaspésie et nièce d’Anne-Marie, pour la réalisation de l’entrevue et pour sa collaboration.
Première église et son presbytère à Sainte-Bernadette-de-Pellegrin, 1941.
Photo : Eugène Gagné
ANQ Québec. Office du film du Québec. E6,S7,SS1,D2,P2634

Dans les années 1930, le gouvernement croit que les gens se tireraient mieux d’affaire sur des terres ouvertes à la colonisation. Alors plusieurs personnes quittent le littoral vers les terres intérieures au potentiel forestier élevé et agricole quelconque, devenant une solution pour elles. C’est ainsi que sont nés Saint-Edmond-de-Pabos en 1931 et, plus tard, Sainte-Bernadette-de-Pellegrin en 1935.
Gilda Grenier
Ancienne résidente de Sainte-Bernadette-de-Pellegrin
ÀPellegrin et à Saint-Edmond, d’une année à l’autre, le dépeuplement s’accentue. Les années 1970 approchent et on parle de plus en plus d’expropriation. Le coût d’entretien pour ces villages devient très onéreux pour le gouvernement; on estime à 100 000 $ par an le coût pour les services d’entretien et autres. On met donc le projet à exécution en fermant ces villages définitivement. Pellegrin et Saint-Edmond sont complètement abandonnés en 1971.
1971 : expropriations définitives
Aurélie Lantin et Léopold Gauthier partent les derniers de Saint-Edmond. Ils quittent leur maison pleine de souvenirs, c’est comme abandonner
le fruit de leur labeur, de leur travail, de leurs peines et de leurs misères. La vie quotidienne est plus moderne et comporte davantage de commodités. Cependant, je suis convaincue qu’aucun·e de nous n’oubliera ce grand déracinement.
Pour sa part, Ernest Grenier est le dernier à céder son terrain à Pellegrin. Au début de la colonisation, M. Grenier explique que le gouvernement dit aux défricheuses et défricheurs : « Nous vous donnons une terre et si vous la défrichez pour qu’elle soit propre à l’agriculture, nous nous engageons à vous donner une autre terre adjacente à celle que vous possédez présentement et nous vous enverrons une lettre patente pour vous céder les terres qui seront à vous. ». Ernest a
ainsi défriché un deuxième terrain adjacent à celui qu’il possède déjà. En faisant ça, il a reçu sa lettre patente lui confirmant qu’il est propriétaire de deux terrains. À la fermeture en 1971, M. Grenier refuse de vendre, donc les autorités décident de lui laisser ses terrains pour encore une dizaine d’années. Quelques années plus tard, il est allé chez le notaire pour céder sa propriété et quelques larmes ont coulé sur son visage meurtri. Après tant de travail et d’efforts pour tous ces cultivateurs, ces bûcherons, ces commerçants, ces travailleurs journaliers et sans oublier nos mères de famille, après tout ça, un minime montant d’argent est donné. On a perdu nos amis·es, nos voisins·es, nos oncles, nos tantes et parfois nos
grands-parents qui sont déménagés loin de nous. C’est un deuxième deuil coup sur coup.
Après l’expropriation, Joseph Collin, âgé de 81 ans, qui est déménagé à Chandler, prend un taxi pour aller à sa maison abandonnée à Pellegrin. Il s’est procuré un petit bidon d’essence. Rendu devant sa propriété, il sort du taxi, va verser l’essence tout autour de sa maison et il y met le feu. Il revient ensuite s’asseoir dans l’auto, et le chauffeur de taxi et lui pleurent de voir un tel souvenir se consumer devant leurs yeux. Je connais cette triste histoire, car le chauffeur de taxi est mon ex-beau-père, Romuald Grenier, un homme avec un cœur très sensible. Il nous racontait ça plusieurs années après et il ne pouvait s’empêcher de pleurer.
Préserver ce qui reste
Lorsque Pellegrin et Saint-Edmond sont fermés, l’archevêché reçoit de l’argent des paroisses pour voir à l’entretien des cimetières et financer celles et ceux qui désirent déménager leurs morts·es. Rien n’a été fait de leur part et on n’a jamais vu ledit argent. Malgré tout, les cimetières ont toujours été entretenus bénévolement par d’anciens paroissiens et paroissiennes et les personnes qui voulaient déménager leurs morts·es, l’ont fait à leurs frais. Grâce à la générosité des gens de Pellegrin et de Saint-Edmond, de l’argent est amassé pour défrayer le
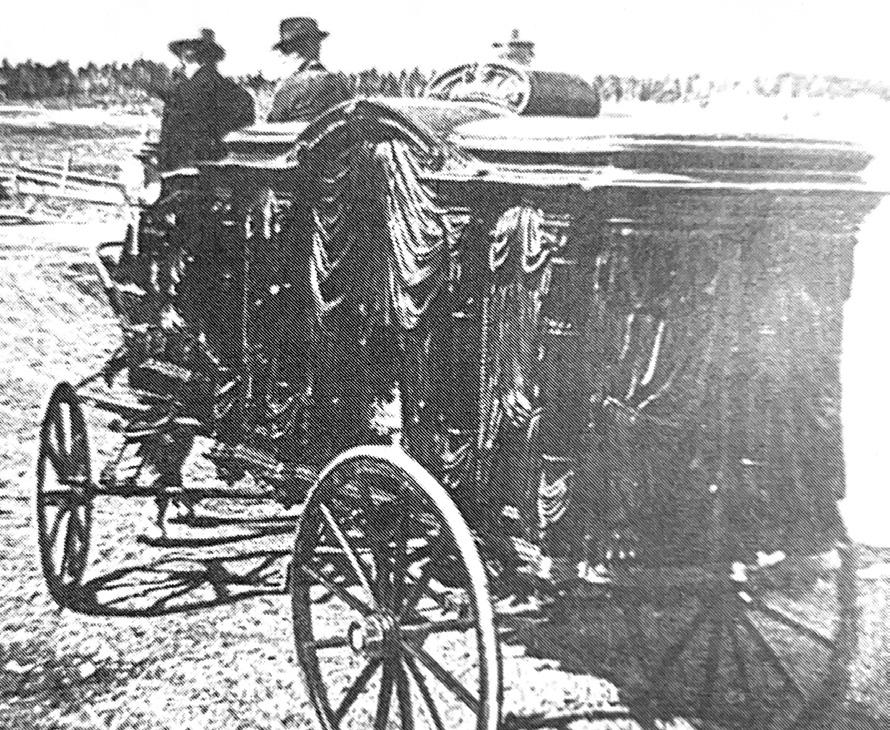
coût d’achat d’équipements nécessaires à l’entretien. Nous avons été déracinés, mais nos morts·es, eux, sont restés. Et jamais nous ne les abandonnerons, car « un mort qu’on abandonne est mort deux fois » comme le dit l’autrice Marie LeFranc (1879-1964).
Plusieurs villes et villages rougiraient de jalousie en voyant ces deux cimetières si bien entretenus même après 50 ans de fermeture. Il ne faut pas oublier que ce sont les deux seules choses qui restent dans ces lieux. Même si le gouvernement a fermé nos villages, les plus jeunes et les plus âgés·es ont conservé des souvenirs inoubliables de bonheur et de joie qui demeurent encore aujourd’hui avec force dans le cœur de celles et ceux qui y ont vécu. Nos racines resteront à jamais gravées en chacun·e de nous pour ces villages tant aimés.
Une vie bien remplie Il ne faut jamais oublier que pendant plus de 35 ans, ceux et celles qui sont arrivés dans ces petits villages ont travaillé très dur. Ils doivent défricher leur terrain, couper les arbres, arracher les souches avec des bœufs ou des chevaux, se faire un jardin pour récolter des légumes, créer des champs cultivables pour le foin, le blé, l’avoine pour nourrir les poules, porcs, vaches, etc. Tout en cultivant leur terre, les hommes vont au chantier pour les coupes de bois. Le printemps est aussi le temps de la drave sur les rivières. Ce plan d’eau est le seul moyen de transport pour le bois puisque le chemin de fer est laissé à l’abandon. Ce travail peut durer 3 à 4 semaines de 5 h du matin à 7 ou 8 h le soir. C’est très dangereux : lorsqu’il y a de gros embâcles, ils se servent de dynamites pour dégager un passage. Pendant ce temps, les femmes restent à la maison. Les mères exercent aussi des responsabilités importantes. Elles veillent aux bons soins de la famille. Elles cuisinent, jardinent, entretiennent la maison, cousent… Elles sont même des infirmières de fortune pour soigner la famille. Elles s’occupent aussi des animaux : traire les vaches, les nourrir,
Ce train sert principalement au transport du bois entre l’usine de pâte et papier à Chandler et les camps forestiers. Le chemin de fer passe sur le territoire qui deviendra Saint-Edmond-de-Pabos. Lorsque la route sera ouverte pour accéder au futur village, elle suivra le chemin de fer laissé à l’abandon.

l’inscription
leur donner à boire. Elles sont des épouses et des mères formidables. C’est pour toutes ces raisons que des retrouvailles ont eu lieu aux dix ans environ pour retrouver notre grande famille qui est désormais dispersée à travers le Québec et aussi en Ontario. Pour donner suite à des retrouvailles qui n’auront jamais lieu vu l’âge avancé des habitants·es, un livre-souvenir est publié. Ainsi notre histoire restera toujours vivante.
Merci aux grands défricheurs et défricheuses. C’est avec leur courage qu’ils ont fait de ces deux villages un lieu que nous avons tant aimé.
Pour en savoir plus : Gilda et Ginette Grenier, La vie de nos Aïeuls. Pellegrin 1935-1971; St-Edmond 1931-1971, 2023, 213 p.
Remerciement aux Archives nationales du Québec qui ont mis gracieusement à disposition leur photographie.
Il ne fait aucun doute que le premier Huard à fouler la terre gaspésienne est Pierre Huard. Toutefois, les informations autour de ses origines et de son arrivée demeurent nébuleuses. Vraisemblablement d’origine basque, Pierre arrive à Pabok (Pabos) vers 1730, le plus important poste de pêche gaspésien sous le Régime français. Il y épouse Catherine Capela (Caplan), fille de Guillaume Capela (Capelan) et d’une mère mi’gmaque. Les premiers registres de Pabos ouvrent en 1751, il n’y a donc pas de trace de leur union ni des baptêmes de leurs cinq enfants. La première mention de leur famille date de 1752 lors du mariage de leur fille Anne. Pierre Huard signe alors d’une croix, preuve qu’il ne sait pas écrire. Il n’est donc pas possible de confirmer s’il épelle son nom Huard ou Huart. Pour sa part, le registre de 1753 indique que leur fils aîné François est âgé de 24 ans. Il est ainsi possible de déduire que les enfants du couple Huard-Capela sont nés entre 1729 et 1738 environ.



Camille Huard, né à Saint-Françoisde-Pabos, est le premier gaspésien à participer aux Jeux olympiques. Il concourt à l’épreuve de la boxe aux Jeux de 1976 à Montréal. Musée de la Gaspésie. Fonds Musée de la Gaspésie. P1/16/1
-Anne, née en 1730, marie Pierre Langlois en 1752
-François, né en 1732, marie Geneviève Duguay en 1753
-Jacques, né en 1733, marie Anne Duguay en 1765
-Gabriel, né en 1736, marie Geneviève Delepeau en 1760
-Pierre, né en 1738, marie Madeleine Denis en 1765
De Pabos à Gaspé
En 1758, les soldats britanniques commandés par James Wolfe débarquent en Gaspésie et ravagent tout sur leur passage, pour ensuite prendre Québec l’année suivante. Plusieurs sources placent la famille de Pierre Huard à Pabos, mais il n’est pas impossible qu’elle soit alors dans le secteur de Port-Daniel. Quoi qu’il en soit, les Huard s’accrochent comme bien d’autres familles. Au fil des décennies, ils essaimeront de la Baie-des-Chaleurs jusqu’à Gaspé, notamment dans les secteurs de Pabos et de Paspébiac.
Les différentes crises économiques internationales qui se succèdent entre 1873 et 1929 incitent bon nombre de gens à défricher de nouvelles terres, plus loin des côtes. Dans cette foulée, les enfants des grandes familles du coin s’installent à Saint-François-de-Pabos qui ouvre en 1929. Né à Paspébiac, Siméon Huard, arrière-arrièrepetit-fils de Pierre, est du nombre. Premier Huard du village, Siméon exerce cent métiers : pêcheur, défricheur, agriculteur, chasseur, bûcheron, draveur, en plus de travailler sur des chantiers à l’extérieur de la région. Saint-François compte une grande lignée de Huard. Aujourd’hui, les Huard descendant de Pierre sont toujours bien présents en Gaspésie, formant une des grandes familles de la péninsule.
Recherche : Jean-Marie Thibeault
Rédaction : Marie-Josée Lemaire-Caplette
Direction : Julie Fournier-Lévesque

Saint-Bernard-des-Lacs, vers 1950. Le rang IX est le cœur du village avec l’église et le bureau de poste.
Photo : George A. Driscoll
ANQ Québec. Fonds George A. Driscoll. P630,S8,D10649

Avant même qu’un chemin soit ouvert entre Sainte-Anne-des-Monts et le parc de la Gaspésie, une colonie voit le jour et prend le nom de Saint-Bernard-des-Lacs. De braves gens, dont les Pelletier, vont s’y établir. Le transport de provisions et de marchandises se fait alors à dos d’homme ou en traîne attelée de chiens. Dix ans plus tard, on compte trois bureaux de poste, cinq écoles, une coopérative, un moulin à scie, une caisse populaire, une église, un dispensaire, des magasins généraux, des salles de loisirs, etc. Il n’y a pas à dire : la paroisse a fière allure!
Feue Céline Pelletier
Ancienne résidente de Saint-Bernard-des-Lacs
En collaboration avec Réjean Pelletier
Fils de Céline Pelletier et Fernand A. Pelletier, et ancien résident de Saint-Bernard-des-Lacs
En 1932, témoin du plus creux de la crise des années 1930, Alexis Pelletier et son fils de 14 ans, Fernand, qui deviendra plus tard mon époux, commencent le défrichement de leur lot de colonisation, le lot 14 du rang IX. Avec, entre autres, les Bélanger, les Truchon et les Vallée, ils s’entraident et construisent ensemble un camp après l’autre. Après deux ans de travail acharné et avoir parcouru
12 milles (19 km) à pied, aller seulement, chargés comme des mules toutes les semaines, les Pelletier déménagent dans un premier camp de 20 par 20 pieds (6 mètres) pour 10 personnes. D’autres familles suivent comme les Collin ou mes parents, Gustave Pelletier et Eugénie Chénard, qui sont arrivés alors que j’avais 5 ans. Quand on a commencé la colonie, mon père touchait 3 $ par semaine (correspondant à environ
97 $ aujourd’hui) des secours directs (aide financière gouvernementale), mais il n’avait pas le droit d’acheter du beurre et du tabac par exemple.
Le grand ennemi : le feu Et l’on fait du bois pour vivre et on défriche tant bien que mal, mais il faut se méfier des feux. Déjà à l’été 1935, les flammes détruisent le moulin à scie du rang V, de sorte que les résidents·es des autres rangs

doivent se sauver en catastrophe. Tous les ans, on subit des assauts de destruction. En 1938, c’est l’école et en 1946, le feu rase 11 maisons dans le rang XI. Commence alors l’exode de ceux et celles qui n’ont pas le courage de reconstruire : de 120 familles, on passe à 100 familles. Entre-temps, l’église brûle en 1957, frappée par la foudre. On rebâtit sans savoir que le ministère a l’intention de fermer la place. Fernand est le marguillier en charge; il participe donc à la reconstruction et reçoit 1 $/heure (équivalant aujourd’hui à un peu moins de 11 $).
Mais la paroisse progresse malgré tout. Plusieurs familles ont des vaches et de beaux lopins de terre. Fernand A. Pelletier, après avoir cultivé la terre quelques années, s’engage dans l’armée pour voir du pays. Après un an, il reçoit son congé et suit des cours pour devenir forgeron. Il opère même sa propre forge dans le village, en plus d’exploiter ses habiletés en menuiserie, mécanique et plomberie. Plus tard, il sera aussi chauffeur et charretier. Fait amusant, le troisième voisin des Pelletier est Achille Tanguay. Fernand chantera dans le chœur avec sa fille Thérèse, mieux connue plus tard comme maman Dion! Ma vocation est celle de « maîtresse d’école » et ma classe atteint parfois
les 45 enfants. Avec ma 10e année, je m’y consacre jusqu’à mon mariage en 1948, puis je serai maîtresse de poste. Ma mère a aussi tenu le bureau de poste, en plus du magasin familial. En 1957, on possède quatre vaches, des taureaux, des cochons, des poules, des dindes et des canards, et on cultive des patates, en plus du jardinage.
Tout part en fumée
À l’été 1959, le feu, parti de SaintOctave-de-l’Avenir, traverse SaintJoseph-des-Monts, puis Cap-Seize, pour finalement s’arrêter à SaintBernard. Il brûle trois colonies sur plusieurs milles carré, ne laissant que cendres et arbres calcinés. On a sauvé la maison et la grange, mais

on n’aura plus d’animaux comme l’incendie a détruit tout le foin et la végétation.
Ceux et celles qui n’ont pas de terre se désintéressent rapidement de sorte qu’il ne reste environ que 20 familles sur les rangs VII et IX. On n’en sait peu encore sur ce qui se passe, alors commencent les demandes pour obtenir de l’aide, mais la volonté de colonisation n’y est plus. Je commence à l’hiver 1960 à faire des recherches pour trouver une autre terre dans un milieu accessible à l’agriculture. Le ministère nous recommande à un agronome, et s’entament les démarches. De 1960 à 1963, on nous envoie de Bic à Kamouraska voir des terres, jusqu’à Dosquet dans Lotbinière, toujours à nos frais. On devait nous rembourser les dépenses par l’entremise de l’agronome et nous accorder un prêt fédéral de 15 000 $ pour l’achat d’un lot. On était convaincus d’être capables de rembourser avec le cheptel et le bois qu’il y avait sur la terre, mais on nous oppose une fin de non-recevoir. Pourtant, on a fait nos preuves vu que nous avons défriché 40 acres à la charrue. De plus, on nous refuse toujours la patente de notre lot malgré qu’on a rempli les obligations ministérielles. Ils savent depuis au moins cinq ans que la paroisse sera fermée…
Comme tant d’autres, on part de Saint-Bernard parce qu’on est placés au pied du mur. On a deux enfants au secondaire en pension à Sacré-Cœur-Deslandes et trois au primaire qu’on doit voyager à

nos frais à l’école de Cap-Seize. Toutes les autres familles sont dans le même cas. Tant bien que mal, on envoie nos enfants à l’école jusqu’aux neiges. On nous avise que les chemins ne seront pas ouverts durant l’hiver, en plus des services coupés. Il nous reste à trouver un logement et déménager dans un endroit plus propice pour l’instruction des enfants. Fernand fait déplacer la petite maison qui se trouve sur nos terres à Sainte-Annedes-Monts et travaille au moulin de Tourelle. Pour avoir l’électricité, il faudrait encore payer, déjà le déménagement a coûté cher. On prend finalement la direction de Montréal, à 10 dans un 5 ½, habitant dans un sous-sol pendant 20 ans. La maison, restée sur place, est pillée.

Ours abattu par Adélard Bélanger lors d’une partie de chasse. On y voit Gustave Pelletier, la famille Gendron et Jogues Pelletier.
Collection famille Pelletier
À la retraite de Fernand, on retourne dans notre région pour vivre avec un de nos fils à Cap-Chat. Et ainsi se termine la saga de Saint-Bernard-de-Lacs en 1963, non sans le nettoyage par le « brûlage » volontaire de ce qui reste des résidences et bâtisses de sorte que tout retourne à la Couronne. Il nous oblige toujours en 1967 à satisfaire aux exigences du ministère, comme payer les taxes. Pourtant, plus de 40 ans après notre départ, on ne sait toujours pas si la terre nous appartient ou si elle a été rétrocédée… À une seule exception près, aucun des défricheurs et défricheuses de Saint-Bernard ne verra sa terre patentée, malgré le respect des requêtes gouvernementales. Je fais encore des démarches en 2007 à l’instigation de l’abbé Provost, curé de Saint-Bernard à l’époque, qui nous dit que les résidents·es des autres villages ont été dédommagés avant de fermer les paroisses, et qu’il peut en témoigner sous serment. À ce jour, aucun de nous n’a reçu de dédommagement, puisque les terres ne nous ont jamais appartenu et qu’on est parti « de notre plein gré ».
Ce texte se veut un hommage à toutes les familles qui ont vécu à Saint-Bernard-des-Lacs et qui ont côtoyé mes parents. Merci aux gens de Cap-Seize qui gardent la mémoire de notre village vivante, entre autres avec la chapelle SaintBernard-des-Lacs.

Le camp d’Alexis Pelletier et de sa famille à Saint-Bernard-des-Lacs avant que les Pelletier se dotent d’une maison plus spacieuse, début des années 1930. Il s’agit de Viateur Pelletier à gauche, grand ami de Fernand Pelletier qui se tient à droite.
Collection famille Pelletier
Ce texte s’inspire de la lettre qu’adresse Céline Pelletier aux deux paliers gouvernementaux pour demander un dédommagement pour les familles de Saint-Bernard-des-Lacs qui ont dû quitter les lieux. Elle y raconte leur « parcours de vie » dans le village.
Remerciement aux Archives nationales du Québec qui ont mis gracieusement à disposition leur photographie.

Paysage typique d’un rang de colonisation à Saint-Louis-de-Gonzague, vers 1938. Photographe : J.B. Pouliot. ANQ Québec. Office du film du Québec. E6,S7,SS1,D2,P2595

À quelques kilomètres au nord de Saint-Omer, c’est dans les montagnes se profilant à l’horizon qu’un nouveau village voit le jour à l’automne 1864 : Mission Saint-Louis. En plein développement, en 1932, de nouveaux lots accueillent des défricheuses et défricheurs plus au nord et une nouvelle communauté voit le jour : Biron. En 1939, ces deux secteurs, Mission SaintLouis et Biron, s’unissent dans le cadre d’une érection canonique sous l’appellation paroisse Saint-Louis-de-Gonzague. Malgré une population de 704 personnes, au sein de 75 familles, recensées en 1950, Saint-Louis-de-Gonzague ne deviendra jamais une municipalité.
Jean-Louis LeBlanc
Ancien résident de Saint-Louis-de-Gonzague
Saint-Louis : une des plus vieilles missions
Mission Saint-Louis débute avec l’arrivée, en provenance de SaintOctave-de-Métis, de la famille de Louis Litalien et de son épouse, Anastasie Dumas. En quelques années, attirées par les surfaces fertiles et les plateaux à déboiser, plusieurs familles quittent la côte de la baie des Chaleurs pour migrer vers cette communauté naissante.
Les recensements de l’époque affichent nombre de patronymes d’origine acadienne, tels les Thériault,
Arseneau, LeBlanc, Landry, Godbout, Mercier ou Nadeau qui vont s’inscrire dans l’histoire de Saint-Louisde-Gonzague.
En 1869, afin de faciliter l’accès à ce nouveau territoire, les villages de Carleton et de Saint-Jeanl’Évangéliste (Nouvelle) financent la construction d’une route qui prend le nom de route Saint-Louis. Sur le terrain, l’arrivée des familles fait ressortir le besoin de défricher de nouveaux lots. En 1878, deux frères, Samuel et Charles LeBlanc, de même que Joël Mercier, ouvrent

Un panneau de bienvenue accueille les gens à Saint-Louis-de-Gonzague. Photographe inconnu
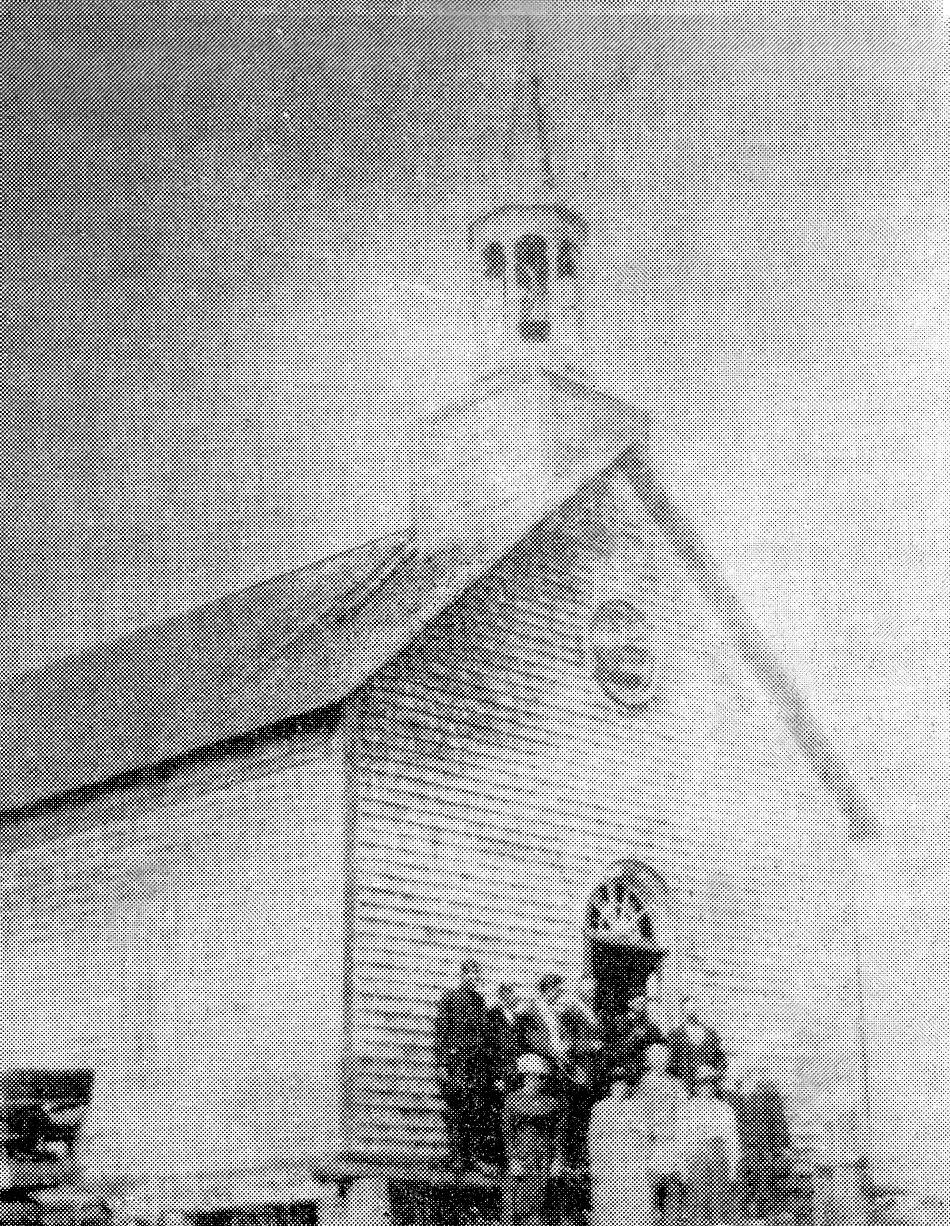
La chapelle construite en 1890. Cette photo est le plus ancien document visuel rattaché à l’histoire de Saint-Louis-de-Gonzague.
Saint-Louis-de-Gonzague, 1963.
le rang IV qui devient le cœur de Mission Saint-Louis. Dans cette foulée, en 1880, c’est le début du rang V, grâce à l’initiative d’Elzéar Thériault, de Pierre Landry et de Jean Litalien. Ce rang V devient, pour un temps, la limite nord de l’occupation humaine de ce territoire.
Sur ce rang, dans les années 1890, une chapelle est construite par le curé de Carleton, l’abbé FrançoisAdelme Blouin, de qui relève la petite
Anecdote amusante, cette photographie du secteur Biron se retrouve parmi nos amis Gaulois! En effet, il est possible de la voir dans le livre documentaire Astérix chez les Québécois (2018) qui retrace les liens culturels, historiques et politiques entre le Québec et cette célèbre série de bandes dessinées. Il faut dire que ce « petit village qui résiste encore et toujours à l’envahisseur » a de quoi trouver des échos ici!
communauté de Mission Saint-Louis. L’abbé Blouin fait don d’un tableau de Saint-Louis-de-Gonzague que, selon la petite histoire, l’ancien curé de Carleton, Louis-Joseph Desjardins, aurait apporté de France peu après 1790.
Autour de la petite église se greffent des écoles, un marchand, et s’organise une population de 189 habitants·es qui sont pour la plupart des agroforestiers. Une commission scolaire est mise sur pied en 1894 alors qu’un bureau de poste ouvre ses portes en 1908. Des sagesfemmes, telles Émilie Berthelot, puis Marie-Louise Mercier, dite Mémère Louise, voient aux naissances sur tout le territoire. En 1922, cette communauté est annexée au niveau civil à Saint-Omer, municipalité ayant été formée en 1902.
Biron : une communauté agroforestière
En 1932, des citoyennes et citoyens de Saint-Louis et d’ailleurs décident de défricher plus au nord sur le territoire afin d’avoir un petit lopin de terre bien à eux. Ainsi, un nouveau secteur qui prend l'appellation de Biron, du nom de Fulgence Biron, premier curé de Saint-Omer, se développe avec l’arrivée de Dominique Boudreau et de Léandre LeBlanc, considérés comme étant les fondateurs de Biron. D’autres les suivent et prennent
racine sur les trois nouveaux rangs du secteur, soit le rang Biron, le rang Carleton et le rang du Plan Vautrin. Ce dernier nom fait référence au plan de colonisation développé par le gouvernement québécois de 1934 à 1937 pour lutter contre la crise économique en incitant les gens à s’installer sur de nouvelles terres.
Saint-Louis-de-Gonzague : un statut particulier
En septembre 1939, Mission SaintLouis et Biron s’unissent pour former Saint-Louis-de-Gonzague. Le secteur de Mission Saint-Louis se détache ainsi de Saint-Omer, mais uniquement sur le plan canonique. Sur le plan civil, cette communauté demeure dans le giron de Saint-Omer.
Dès 1939, l’église de la toute nouvelle paroisse est construite sur le rang Biron, qui devient rapidement le cœur du village. Puis, suivent le presbytère, l’épicerie, le dispensaire, le bureau de poste, des petits commerces et la caisse populaire. Une vie communautaire rassemble les familles. De plus, un corps de majorettes, les Fleurs de Saint-Louis, anime les fêtes du village.
Dans les années 1960, la localité connaît un certain développement. En matière d’éducation, à l’automne 1961, un couvent ouvre ses portes dans le secteur de Biron avec l’enseignement jusqu’à la 11e année par


de la salle paroissiale de Biron, les aînés des garçons, au sein des familles d’agriculteurs, participent à un concours d’automne mettant en valeur les plus beaux veaux du village.
les Sœurs de la Charité de Québec. En 1965, pas moins de 140 élèves fréquentent les trois écoles sur le territoire de Saint-Louis. Sur le plan forestier, ressource première de l’économie du village, le printemps 1964 voit la formation de l’Association coopérative forestière qui va être créatrice d’emplois en forêt.
La fin des beaux jours
Vers la fin des années 1960, le vent tourne, ce qui entraîne des changements majeurs. L’agriculture perd graduellement du terrain et le système agroforestier se meurt lentement. L’exode se pointe à l’horizon. Les services à la population diminuent d’année en année, si bien que plusieurs familles du village
Né en 1887 à Mission Saint-Louis, Jean-Marie Prudent Landry démontre une force impressionnante dès son plus jeune âge. Malgré sa petite taille de 1,6 mètre (5 pieds et 4 pouces), il réalise des exploits. Prudent commence à se produire en spectacle à son arrivée à Montréal en 1904 et réalise ensuite plusieurs tournées un peu partout dans le monde. Mentionnons, entre autres, qu’il participe au cirque de l’homme fort de l’époque Louis Cyr et est membre de la troupe « The Landry Big Trio » avec nul autre que Buffalo Bill. Prudent Landry devient particulièrement connu au Canada et aux États-Unis grâce à la force de sa mâchoire qui lui vaut son surnom. Il tord et déroule des fers à cheval avec sa bouche et lève jusqu’à 872 kg (1 920 livres) avec ses dents!
Marié à Cécile Fradette et père de quatre enfants, il occupe divers emplois pour faire vivre sa famille à Alma où il s’installe. Même si ses visites dans sa région natale sont rares, il y fait une tournée où il affronte les hommes forts du coin. Il revient en Gaspésie pour une dernière fois à 73 ans et s’éteint à 86 ans en 1973.
de Saint-Louis-de-Gonzague, en particulier du secteur de Biron, décident de migrer vers d’autres cieux à la recherche d’un avenir meilleur. En 1972, le petit village rassemble 81 familles alors que l’année suivante, il n’en compte plus que 42. Les difficultés économiques, l’éloignement et la difficulté d’accès par une route non pavée serpentant la montagne auront raison de cette partie du village de l’arrière-pays, dont le cœur est situé dans le rang le plus éloigné.
Dans ce contexte, le 22 mai 1974, une assemblée citoyenne forme un comité chargé de négocier une entente avec le gouvernement du Québec portant sur la fermeture du secteur de Biron uniquement. Entre le comité et les représentants du gouvernement, une entente intervient selon laquelle le territoire sera fermé à l’habitation dès 1974. Tous les résidents·es de Biron doivent avoir quitté définitivement le rang avant le 1er octobre 1974. Sur le plan administratif, un décret du gouvernement procède à la fermeture des rangs Biron et Plan Vautrin, alors que l’évêché de Gaspé supprime la paroisse canonique. Des décennies plus tard, tout ce qui demeure
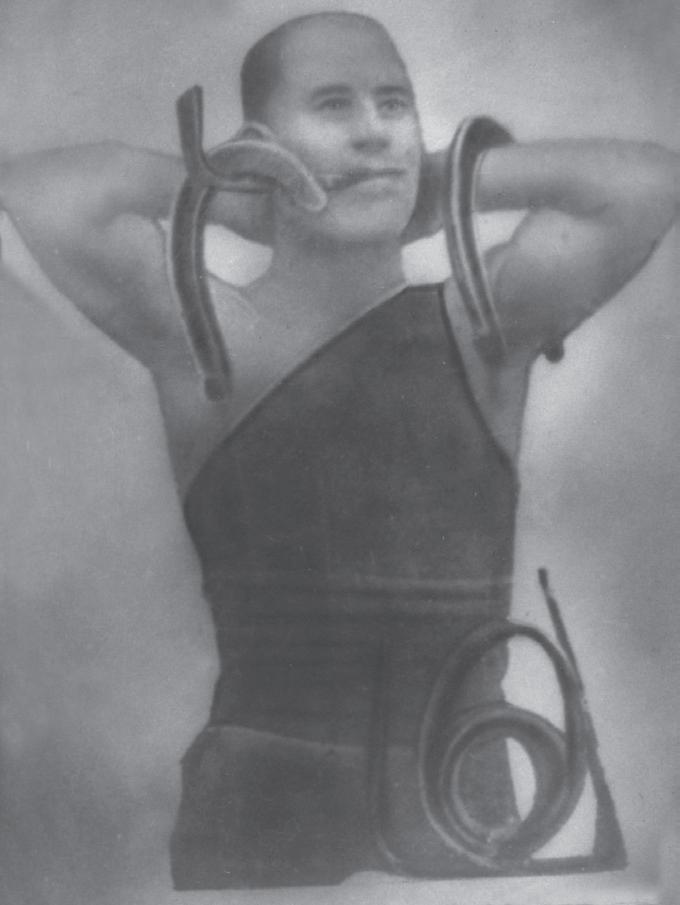
sur le rang Biron est le cimetière qui continue d’être entretenu afin de commémorer les ancêtres.
Mais en 1976, un mouvement de résistance émerge dans le secteur du vieux Saint-Louis alors que plusieurs refusent tout simplement de signer l’entente gouvernementale qui est proposée à la communauté de Mission Saint-Louis. Ce refus explique que des familles vivent toujours sur ce territoire.
Un territoire qui ne veut pas mourir
Les anciennes et les anciens de Saint-Louis-de-Gonzague conservent


leurs racines dans leur cœur, continuant de s’identifier à ce village où ils ont vu le jour. En 2014, de grandes retrouvailles ont permis de souligner avec émotion et fierté le 150e anniversaire d’occupation de ce territoire qui ne veut pas mourir.
Contrairement à d’autres villages de l’arrière-pays gaspésien, ce n’est pas le gouvernement qui a pris l’initiative de fermer le secteur. Ce sont les citoyennes et citoyens qui ont demandé à partir, car les conditions économiques et sociales n’étaient plus favorables pour continuer à y vivre, d’autant plus que le secteur Biron n’était pas constitué en municipalité.
Toutefois, l’autre secteur, soit Mission Saint-Louis, a résisté à la fermeture en 1976 et, aujourd’hui, le sommet de cette montagne continue de vivre et la résilience des gens, y demeurant encore, démontre qu’il est possible de garder un territoire vivant.
Je dédie ce texte à nos ancêtres défricheurs, nos grands-parents et parents et à tous ceux et celles qui y habitent encore, car c’est grâce à vous si Saint-Louis-de-Gonzague n’est pas juste qu’un souvenir!
Le contenu de ce texte provient de deux panneaux d’interprétation réalisés par la ville de Carleton-sur-Mer, installés au parc La Grande-Envolée dans le secteur Saint-Omer, dans le but de commémorer l’histoire de ces lieux.
Remerciements à Paul Lemieux pour sa collaboration.
Remerciement aux Archives nationales du Québec qui ont mis gracieusement à disposition leurs photographies.

incendiées à Sainte-Bernadette-de-Pellegrin, 1971. Musée de la Gaspésie. Fonds Société de conservation de la Gaspésie. P91/36

Tel que mentionné, dont dans le précédent photoreportage, toutes les traces humaines sont effacées des villages lors de leur fermeture. Fait étonnant au départ, c’est la Southern St. Lawrence Forest Protective Association qui se voit confier ce mandat par l’Office de planification et de développement du Québec (OPDQ). Rappelons que le Bureau d’aménagement de l’Est du Québec (BAEQ) réalise l’étude sur la planification et le développement régional de 1963 à 1966 et que c’est l’OPDQ qui applique sa mise en œuvre à partir de 1968. La Southern St. Lawrence Forest Protective Association (qui deviendra la Société de conservation de la Gaspésie en 1972) a pour mission de protéger la forêt des incendies et de lutter contre les feux de forêt. En 1970, l’OPDQ lui demande de « nettoyer » les villages fermés gaspésiens en incendiant les maisons et bâtiments, tout en s’assurant que le feu ne se propage pas à la forêt environnante. Le Centre d’archives du Musée de la Gaspésie conserve le fonds d’archives de l’organisme et possède ainsi toute une galerie de photos de résidences en feu et de terrains en broussaille.
Les rares témoins qui survivent à ce raz-de-marée se comptent sur les
Il est mentionné dans le numéro précédent que le seul cimetière à être entièrement déménagé est celui de Saint-Jean-de-Brébeuf. Pour plus de précisions, spécifions que d’autres corps ont pu être déplacés par les familles qui le souhaitaient, comme dans les cimetières de Sacré-Cœur-Deslandes ou Sainte-Bernadette-de-Pellegrin. Généralement, c’est la succession qui prenait la décision de payer pour le maintien du lot au cimetière ou la relocalisation de la défunte ou du défunt. Si cette option était retenue, c’était à la famille de procéder au déplacement du corps.
doigts d’une main, principalement des édifices publics. Par exemple, l’église de Saint-Octave-de-l’Avenir devient le local des cadets, un programme fédéral, ce qui permet de maintenir la bâtisse. Paradoxalement, ce sont les cimetières des villages qui sont les principales traces tangibles in situ de la vie et de l’occupation humaine des lieux. Ces cimetières sont entretenus bénévolement par les anciens résidents·es et leur descendance.
Une vie qui subsiste
Malgré les fermetures des localités et l’interdiction d’y résider, certains villages voient arriver quelques roulottes pour la belle saison. D’autres encore se font visiter durant la période de la chasse alors que
des cabanes de fortune sont dissimulées ici et là. Un filet de vie refuse de s’éteindre… D’autres lieux, comme une partie du rang XV (Garin) à Saint-Elzéar ou le secteur Saint-Louis, voient de nouvelles personnes s’installer depuis quelques années. Il va sans dire que les retrouvailles des anciens résidents·es sont les moments les plus animés, preuves s’il en faut que les villages demeurent bien vivants dans la mémoire de ses habitants·es.
DÉCOUVREZ
D’AUTRES TEXTES ET REPORTAGES, DONT SUR GRANDEGRAVE, GRANDEVALLÉE-DES-MONTS, LAC-AU-DIABLE, ETC.







1. Sans titre, cimetière à Saint-Nil, 2019.
© Aurélie Le Maître
2. Sans titre, Saint-Thomas-de-Cherbourg, 2023. © Aurélie Le Maître
3. Calvaire dans le cimetière à Saint-Edmondde-Pabos, 1971.
Musée de la Gaspésie. Fonds Société de conservation de la Gaspésie. P91/15
4. Maison en flamme à Saint-Octave-de-l’Avenir, 1971.
Musée de la Gaspésie. Fonds Société de conservation de la Gaspésie. P91/76
5. Un des panneaux du kiosque-expositon à Saint-Fidèle-de-Ristigouche, 2024.
Photo : Annette Sénéchal
6. Cimetière à Saint-Louis-de-Gonzague, vers 1971. Musée de la Gaspésie. Fonds Société de conservation de la Gaspésie. P91/82
7. L’église à Saint-Octave-de-l’Avenir lors de sa bénédiction, un des rares témoins toujours debout, 1939.
Musée de la Gaspésie. P54 Fonds Robert Fortin. P57/1b/4/37
Saint-Fidèle-de-Ristigouche avec le deuxième dispensaire à droite, années 1940. Collection Bernard Ouellet Image tirée de : Suzanne Bourdages, St-Étienne, St-Conrad, St-Fidèle. Album souvenirs, 1990, p. 275.

Au sommet d’une grande côte, au nord de la municipalité Ristigouche-Sud-Est, se trouvait jadis un village riant, entouré de pommiers, de lilas et autres embellies végétales. Depuis 1974, cette petite localité accrochée au cran de roche est retournée à la forêt. Ses anciens habitants·es ne ratent toutefois pas d’occasion pour la garder bien vivante. Voici sa petite et sa grande histoire.
Camillia Buenestado Pilon
Consultante en patrimoine et archiviste
Saint-Fidèle se trouve dans le canton de Ristigouche, à la lisière du canton de Mann. Il possède plusieurs noms selon qu’on l’adresse par le nom de la mission, de la paroisse ou du village. On retrouve ainsi les noms de Saint-Fidèle-du-Chemin-Kempt, Kempt Road Hill (pour le distinguer de Kempt Road, soit RistigoucheSud-Est), Kempt Road dans les recensements (pour nous confondre encore plus!), Saint-Fidèle-de-Ristigouche, etc.
Le fait écossais près de la rivière Ristigouche
Avant l’inauguration du chemin Kempt en 1833, voie terrestre liant Grand-Métis à Pointe-à-la-Croix, les routes maritimes représentent les seuls moyens de voyager jusqu’au Nouveau-Brunswick ou de se rendre dans la vallée du Saint-Laurent. La création d’une route terrestre étant nécessaire pour des raisons notamment militaires et postales, en 1828, un vaste chantier est entamé pour tracer les 157 kilomètres (98 milles)
de cette future route. Le chemin Kempt, nommé en l’honneur du gouverneur général James Kempt, est entre autres construit par des Écossais issus des provinces maritimes. Le grand incendie de Miramichi de 1825 occasionne aussi la venue de centaines de travailleurs écossais en provenance du Nouveau-Brunswick dans cette nouvelle région à ouvrir. Ainsi, au début du 19e siècle, l’embouchure de la rivière Ristigouche est particulièrement représentée par le fait écossais.
Cette communauté essaimera notamment sur le territoire qui deviendra Saint-Fidèle, situé directement sur cette route, et dans les villages environnants.
La première fois que l’on rencontre des Écossais·es dans cette région est dans le recensement de 1825, alors que la section intitulée « Restigouche » mentionne quelques noms écossais et anglais : Hane, Moore, Morrison, Annett, Cox, Adams, Dumbas, Busteed, Donaldson, Mann, Chamberlain. Bien que plusieurs sources affirment que François-Xavier Grégoire et Madeleine Garon, originaires de la Beauce, s’installent à Saint-Fidèle entre 1830 et 1840, ceux-ci n’apparaissent qu’en 1871 dans les recensements. Les francophones arriveront plutôt dans la seconde moitié du 19e siècle.
Des origines diversifiées
En 1861, date du premier grand recensement nominatif canadien, se trouvent dans le canton de Ristigouche les familles Martin, Gallant et Pelletier. La famille Doyle, d’origine irlandaise, habite alors le canton de Mann. Le recensement relève particulièrement des familles anglophones, dont les Prentice, Mann, Irvin, McDavid, Connors, Smith, Adams, Comly, Downs, Dixon, Glover, Furlo, etc. Des Mi'gmaqs sont aussi du nombre : des Pole et des


Archpole, des Wist, Labauve, Dedam, Caplan et Morrison.
C’est en 1871 que l’on retrouve enfin recensées la famille de François Grégoire et Madeleine Garon, puis celle de Philippe Ferland et sa femme Florence, la fille de François et Madeleine. Ceux-ci sont probablement arrivés plus tôt. Dans ce recensement, on retrouve également des Boucher, Gagnon, Tremblay, Labrecque, Charette et Pelletier, en plus d’autres noms écossais, irlandais, et de personnes originaires des États-Unis et d’autres provinces maritimes. À partir de ce moment, la région connaît un afflux de Canadiennes françaises et de Canadiens français en provenance des vieilles paroisses de la vallée du SaintLaurent.
En effet, la fin du 19e siècle et le début du 20e entraîneront des efforts soutenus pour peupler les nouveaux cantons. Dans les années 1920, des terres sont vendues dans les premiers rangs du canton de Ristigouche. On dit qu’elles sont fertiles et qu’il y a de belles érablières. Par la suite, de nombreuses personnes provenant de partout autour du Québec et venues travailler au moulin Champoux de Listuguj viendront s’établir à Saint-Fidèle à la suite de sa fermeture dans les années 1930. Plusieurs d’entre elles deviendront agricultrices. D’autres choisissent d’œuvrer dans l’industrie forestière, la rivière Kempt étant d’ailleurs jadis utilisée pour la drave. Dans le recensement
de 1931, Saint-Fidèle est présent sous le nom « Kempt Road ». Bellarmin Landry et sa femme Victoria ont une ferme laitière. Florence Ferland est rentière, Angeline Cyr est institutrice, et plusieurs femmes sont dites aide-ménagères ou servantes. En 1937, date de l’incorporation du village, les francophones rachètent les terres des anglophones et ceux-ci s’installent plutôt dans le hameau de Broadlands, selon l’Album souvenir St-Étienne, St-Conrad et St-Fidèle. Les pionnières et pionniers cultivent l’avoine, l’orge et les fourrages verts, le foin et la pomme de terre. Selon l’Inventaire des ressources naturelles et industrielles datant de 1937, les défricheuses et défricheurs tirent aussi leur argent de la vente du bois qu’ils prennent sur leur lot, et de leur travail dans les moulins à bois. Certains citoyens et citoyennes dépendent également des secours directs. D’ailleurs, en 1940, la situation est difficile pour plusieurs habitants·es, qui demeurent toujours dans des camps rudimentaires, en attente de recevoir des octrois gouvernementaux afin de se faire construire.
D’autres personnes provenant des villages de la Baie-des-Chaleurs s’y annexent également. À son apogée en 1943, la population du village totalise 113 familles. Par la suite, celle-ci décroît, malgré la venue de plusieurs services tels qu’une coopérative, un syndicat forestier, de nombreuses écoles, une caisse populaire, des

ANQ Québec. Office du film du Québec. E6,S7,SS1,D2,P8689
postes à essence et magasins, pour ne nommer que ceux-là. La communauté de Saint-Fidèle sera relativement mixte et composée des familles Ouellon/Ouellet, Sénéchal, Gaudet, Arbour, Grégoire, Cormier, Rousseau, Landry, Pratte, Bélanger, Ferland, Glazer, et tant d’autres.
De mission, à paroisse, à village
En 1897, la mission de l’ImmaculéeConception-de-Marieville se constitue. Celle-ci englobe les populations de Sillarsville et de Broadlands. En ce qui a trait à la création officielle de la mission de Saint-Fidèle, les sources se contredisent. Dans tous les cas, entre 1897 et 1904, une mission est créée, mise sous le patronage de Saint-Fidèle-de-Sigmaringen, et desservie par les pères Capucins de Listuguj. À ce moment, une école-chapelle est également érigée. La desserte de la mission par les Capucins durera jusqu’en 1923, année où le diocèse de Gaspé s’incorpore indépendamment de celui de Rimouski, et Saint-Fidèle sera dès lors desservie par le curé de Saint-André-de-Restigouche jusqu’en 1936. Puis, Saint-Fidèle reçoit son premier missionnaire résidant, Rosaire Parent, qui bénit la chapelle et fait construire un presbytère. Les registres de la paroisse semblent ouvrir du même coup. Saint-Fidèle s’érige canoniquement le 24 octobre 1946 selon le curé Léo Bérubé.
En 1967, les paroisses de Saint-Fidèle et Saint-André sont jumelées. Sur le plan civique, la municipalité de Ristigouche-Partie-Sud-Est est fondée en 1906. Celle-ci englobe également le territoire de SaintFidèle. Dans les années 1930, celui-ci s’agrandit. La partie nord des rangs I et II s’ouvrent et, en 1935, s’ajoutent le rang III (Saint-Étienne) et celui de Saint-Conrad. En 1937, la municipalité de Saint-Fidèle-de-Ristigouche est officiellement créée et le premier maire est Alexis Ferland.
… vers la fermeture
Comme nous le mentionnons plus haut, la population de Saint-Fidèle atteint un sommet en 1943. Par la suite, le village connaît une lente décroissance malgré l’arrivée de nouveaux services qui connectent Saint-Fidèle aux villages environnants, comme l’électricité en 1952 et le téléphone en 1965. Vers 1958-1959, le moulin à bois ferme, puis en 1969, c’est au tour du bureau de poste. La même année, la commission scolaire de Saint-Fidèle fusionne avec celles qui l’entourent pour prendre le nom de Ristigouche. Les écoles ferment graduellement et, en 1972, les jeunes doivent voyager jusqu’à Pointe-à-la-Croix pour aller à l’école. De nombreuses familles choisissent alors de quitter.
L’existence légale de Saint-Fidèle prend fin en 1974 dans la foulée des fermetures des villages par le
Bureau d’aménagement de l’Est du Québec. À sa fermeture, il ne reste que six familles. On dissout les coopératives, démolit les bâtiments. De nombreuses maisons sont déménagées dans le village de RistigoucheSud-Est. En 1975, la paroisse est officiellement dissoute. En 1983, le territoire faisant partie de Saint-Fidèle est annexé à Pointe-à-la-Croix.
Pour la suite de Saint-Fidèle Plusieurs rassemblements ont eu lieu pour célébrer l’existence de Saint-Fidèle et de ses vaillants bâtisseurs et bâtisseuses. Aujourd’hui, il reste le cimetière auprès duquel on a inauguré un parc des Bâtisseurs, une maquette de l’église reconstituée, et le club de motoneige Marquis de Malauze. Puis, à l’été 2024, des retrouvailles ont souligné le 50e anniversaire de la fermeture du village pour se rappeler ces familles d’ici et d’ailleurs qui ont sorti de terre un village aujourd’hui retourné à la forêt, mais dont la mémoire orale et les archives assurent une suite dans le temps, une suite dans le monde.
Remerciement aux Archives nationales du Québec qui ont mis gracieusement à disposition leur photographie.

Pierre Nadeau (1845-1917) quitte son village natal de Saint-Charles-de-Bellechasse, près de Lévis, pour se rendre à Dalhousie au Nouveau-Brunswick, probablement en raison de son travail sur le chemin de fer. Pierre semble avoir tout un caractère : il sera excommunié deux fois! La première parce qu’il fait partie des francs-maçons et la seconde parce qu’il construit une église protestante. Durant cette période, les journaux montent en popularité et les pâtes et papiers sont ainsi très demandés; Dalhousie est en pleine effervescence.
La traversée vers la Gaspésie
Pierre Nadeau se marie avec Émily dite Amélia McIntyre (≈ 1853-1881) en 1870 avec qui il aura sept enfants, dont un fils nommé Peter (1872-1911). Veuf, il épouse la sœur d’Émily, Marguerite McIntyre (1856-1916) vers 1883-1884. Charles Harrisson Nadeau (1883-1972) est l’aîné de cette nouvelle union. Les Nadeau vivent toujours à Dalhousie en 1891. Puis, Peter épouse Lydia Lamb à Percé en 1897. La famille a ainsi traversé de l’autre côté de la baie des Chaleurs, Dalhousie étant en face de Miguasha. Les Nadeau s’installent en effet à Cascapédia où Pierre est propriétaire du moulin. À noter que Pierre, son père Gabriel et son fils Peter sont inhumés à Saint-Jules.
Les années florissantes à Port-Daniel À partir d’ici, les versions diffèrent. L’une d’elles mentionne que Peter et son frère John quittent Cascapédia pour ouvrir un moulin à scie à Port-Daniel vers 1900-1902 : la Port Daniel Lumber Company. Leur demi-frère Charles vient travailler pour eux dès ses 16 ans. Les Nadeau vendent le moulin à un Américain du nom de P.O. Vile vers 1910. Il fait faillite quelques années plus tard et Charles rachète le moulin. Une autre source stipule qu’en 1909, un P. Nadeau est gérant de la Port Daniel Lumber Company appartenant à G. E. Mercier de Dalhousie. Propriétaire ou employé, Peter y est présent puisque le recensement de 1911 le situe à Port-Daniel–Gascons. Dans tous les cas, les versions s’accordent pour dire que Charles H. Nadeau prend en charge la scierie autour


Le deux-mâts Annie M. Nadeau voit le jour sur le chantier de Charles H. Nadeau en 1918; c’est lui qui transportera la croix de granit à Gaspé en 1984. Musée de la Gaspésie. Fonds Richard Gauthier. P162/5

Le moulin à scie Nadeau à Port-Daniel, vers 1900.
de la Gaspésie. Collection Marcel
P77/83/16/150/169
de 1918, fort probablement en la rachetant à des Américains et en fait une entreprise prospère. Entre-temps, Charles se marie avec Annie Mae Gagnon de Port-Daniel en 1911; le couple aura neuf enfants. Deux de ses fils, William (qui épousera Aline Canac-Marquis) et Norbert (qui reviendra de la guerre avec une épouse écossaise du nom de Catherine Finlayson), l’épaulent, puis lui succèdent. La Charles H. Nadeau & Fils Limitée exporte du bois aux États-Unis et à Saint-Pierre-et-Miquelon, en plus de fabriquer des caisses de transport pour la morue salée séchée destinée à l’Italie. Le moulin emploie jusqu’à 125 travailleurs, en plus des magasins et des camps de bûcherons. Charles détient aussi un chantier naval sur la grève, près de la route de Clemville, où est construit le Annie M. Nadeau en 1918 ainsi que le Mina Nadeau. De 1965 à 1970, l’entreprise possède aussi un moulin à Barachois. Francis Nadeau est le dernier propriétaire de la scierie à Port-Daniel qui ferme à la suite d’un incendie au début des années 1980. D’autres Nadeau détiennent des moulins dès la fin du 19e siècle, dont à Saint-Omer, Saint-Siméon-deBonaventure et New Richmond. S’agit-il de la même lignée? Ce qui est certain, c’est que les nombreux membres de la famille Nadeau s’y connaissent en moulin, et ce, depuis plusieurs générations.
Famille Nadeau, années 1950. De gauche à droite : Tommy Gagnon qui est le frère d'Annie Mae Nadeau, Frances Nadeau, William « Bill » Nadeau, son épouse Aline, Norbert Nadeau, son épouse Catherine, Reginald Nadeau, l’épouse de Tommy Gagnon, l’épouse de Conrad Nadeau, Conrad Nadeau, ? et Annie May Gagnon Nadeau.
Collection Francine Heyne Nadeau
Recherche : Jean-Marie Thibeault
Rédaction : Marie-Josée Lemaire-Caplette
Direction : Julie Fournier-Lévesque


Mobilisation de l'Opération Dignité II dans l’église d’Esprit-Saint, 1971. Centre de mise en valeur des Opérations Dignité
Les Opérations Dignité sont avant tout un mouvement populaire d’indignation face au « plan de l’Est » des gouvernements canadien et québécois dans les années 1960 et 1970. Ce plan vise en apparence à « améliorer les conditions de vie des familles », objectif noble s’il en est, mais en les expropriant de leurs terres et de leurs maisons sans leur offrir une meilleure situation d’autre part! Les deux gouvernements ont appauvri et humilié des milliers de familles dans ce grand bouleversement. Ainsi, avec ce plan, les gouvernements ont exproprié et poussé à l’exil plus de 21 000 personnes avec des compensations ne permettant pas de repartir dignement dans la vie. Ils ont brûlé les maisons, les fermes, les églises, les écoles pour faire disparaître tout le patrimoine économique, culturel et social de 30 villages ruraux et provoqué un exode massif dans de nombreux autres villages ruraux de l’Est-du-Québec (Bas-Saint-Laurent et Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine).
Martin Gagnon
Coordonnateur, Centre de mise en valeur des Opérations Dignité
La plupart des familles sont replacées dans des habitations à loyer modique (HLM) à Chandler, Gaspé, Matane, Rimouski et Sainte-Anne-des-Monts. Faute d’emploi, elles vivent de l’aide sociale, dévalorisées, dépouillées de leurs terres et marginalisées dans leurs
communautés d’accueil. Outrés de voir comment les familles sont traitées lors des expropriations et des fermetures de villages, plusieurs municipalités ainsi que des citoyennes et citoyens de l’Est se mobilisent pour dénoncer ce traitement et arrêter la destruction de nos régions rurales.
D’impressionnantes mobilisations
De grands rassemblements citoyens à Sainte-Paule en 1970 (3 000 personnes), à Esprit-Saint en 1971 (6 000 personnes), aux Méchins en 1972 (300 délégués·es) et à Matane en 1973 (3 000 personnes)
Dès le début de la mise en œuvre des fermetures de localités en 1970, 19 curés rédigent Le manifeste des curés en colère face aux expropriations massives planifiées par le gouvernement et au mépris envers la population rurale. Trois d’entre eux, Charles Banville, Jean-Marc Gendron et Gilles Roy, fondent les Opérations Dignité pour donner une voix « aux petites gens ».
Opération Dignité I voit le jour le 22 septembre 1970 à Sainte-Paule, un des premiers villages à être visé par l’expropriation, qui est situé dans ce qui deviendra la MRC de Matane. S’ensuivent les Opérations Dignité II à EspritSaint (1971) derrière Rimouski et III aux Méchins (1972). La résistance s’organise et prend de l’ampleur avec la couverture médiatique qui y est consacrée.
Le gouvernement recule enfin en 1972 en mettant fin au programme d’expropriations et en 1974 en mettant un terme aux « migrations volontaires » (coupures de services visant à pousser la population à l’exil). Malgré l’expropriation d’une dizaine de villages et la fermeture d’une vingtaine d’autres, ce grand mouvement de mobilisation populaire a freiné le dépeuplement rural. Surtout, il a permis à de nombreux villages de résister, de se prendre en main et de se doter de moyens pour voir à sa survie, principalement en matière d’emploi lié aux ressources naturelles.
réussissent à faire reculer les deux gouvernements en avril 1974, il y a 50 ans cette année. Ces grands rassemblements portent le nom d’« Opérations Dignité » et sont constitués en organisme à but non lucratif (OBNL) pour favoriser la prise en main du développement local par les communautés. Les Opérations Dignité mènent des batailles depuis 30 ans. De ces batailles sont nés les Groupements forestiers, les Organismes de gestion en commun de la forêt, le grand déclubage (fin des clubs privés de chasse et de pêche), la création des usines de Cabano, Sayabec, Matane, Esprit-Saint, et le maintien du chantier maritime des Méchins, entre autres. Toutes ces batailles visent à créer de l’emploi dans nos régions en transformant localement les ressources naturelles. Les nombreuses actions des Opérations Dignité permettent de redonner la fierté de vivre en milieu rural et de s’y épanouir. D’un « plan de déménagement », les Opérations Dignité en auront fait un véritable grand chantier d’appropriation du développement local de notre territoire!
En 1990, les trois Opérations Dignité s’unissent pour fonder la Coalition Urgence Rurale du Bas-SaintLaurent et continuer la défense et la promotion de la ruralité. Les enjeux demeurent nombreux pour le maintien des écoles rurales, des bureaux de poste, des services de proximité ainsi que pour la création d’emploi et la gestion intégrée et durable des ressources naturelles. En Gaspésie,
en 1991, le Ralliement Gaspésien et Madelinot réunit 8 000 personnes à Chandler, et prend aussi la défense de la ruralité de la région en faisant la promotion des mêmes principes d’autogestion du territoire rural et régional dans une perspective de développement durable.
Des conséquences désastreuses
En 2006, les gens d’Esprit-Saint, soucieux de ne pas oublier les évènements des années 1960 et 1970 dans nos régions, décident de développer un centre d’interprétation et de recherche sur les Opérations Dignité, comme patrimoine de notre histoire et symbole de la sauvegarde de plus de 110 municipalités de la fermeture dans les années 1970. Ce Centre voit le jour à Esprit-Saint en 2009 avec son exposition multimédia et son centre d’archives et de recherches sur la ruralité Gilles-Roy. Depuis 15 ans, le Centre réalise ainsi les recherches et cumule les archives sur ce grand bouleversement, qui a vu nos deux régions perdre plus de 37 % de la population rurale et qui font de l’Est-du-Québec le territoire rural le plus dévitalisé du Québec selon l’indice de vitalité économique (IVE) de l’Institut de la statistique du Québec. Grâce à ses recherches, il est possible d’étudier et de mieux documenter ces évènements historiques et leurs impacts sur nos régions.
C’est trop facile de nous taxer de naïveté et de se réfugier dans l’inaction! […] protester contre l’incurie et la lenteur administratives, face à l’option préconisée en faveur de notre région : celle d’organiser des travaux de sylviculture plutôt que d’investir dans l’assistance sociale ou de verser continuellement de pieux subsides, dévalorisants pour ceux qui les reçoivent et scandaleux pour ceux qui les autorisent. […]
Quant à la misère de notre milieu, qu’on nous fasse grâce de la rappeler, pour éviter d’humilier nos gens devant cette faute collective qu’on semble vouloir leur imputer à eux seuls.
Extrait du Manifeste des curés en colère, 1970 LISEZ LE
MANIFESTE DES CURÉS EN COLÈRE

Charles-Samuel Lepage, extrait du Plan canton Romieu, à cheval sur les comtés de Matane et Gaspé, 1911. Le rang IV sera complètement fermé au sud des Méchins.
ANQ Québec. Fonds Ministère des Terres et Forêts. E21,S555,SS1,SSS1,PR.18C
Au plan social, ce sont plus de 21 000 personnes expropriées ou poussées à l’exil, 30 villages fermés, 16 municipalités fusionnées par décret sans consultation formant les villes de Gaspé et de Percé, et une opération de propagande pour dévaluer le mode de vie rural, qui va largement contribuer à la dévitalisation rurale de l’Est-du-Québec.
Au plan humain, les personnes délocalisées ne sont pas compensées à la juste valeur de leur propriété en raison des décrets de fermeture, seuls les cimetières des villages fermés demeureront sur place, sans que le gouvernement se charge de l’entretien.
Un désir de pérennité
Au plan culturel, les artistes se joignent aux revendications des familles touchées en composant
des chansons, notamment Gilles Vigneault (Ti-Nor), Paul Piché (Gigue à Mitchouano), Daniel DeShaime (St-Octave-de-l’Avenir), Gaston Mandeville (Le vieux du Bas-du-Fleuve), Isabelle Pierre (St-Thomas-de-Cherbourg), etc. Le monde du cinéma et du documentaire produit les films Chez nous, c’est chez nous (1972) de Marcel Carrière, Les Smattes (1972) et Le grand dérangement de Saint-Paulin-Dalibaire (1984) de Jean-Claude Labrecque, etc. Au théâtre, les pièces Les marchands de ballounes (1975), On est parti pour rester (1978) et L’Incroyable et ineffaçable histoire de SainteDignité-de-l’Avenir (2022 et 2024) du Théâtre du Bic reflètent l’importance de ces évènements dans l’Estdu-Québec.
Les médias sociaux, où les ex-résidents·es et descendants·es restent
en contact, partagent des photos et documents, transmettent les informations familiales et organisent les retrouvailles, perpétuent en ligne les villages fermés.
Redonner de la dignité aux familles
Le Centre de mise en valeur relance une autre Opération Dignité pour les familles expropriées et poussées à l’exil par le plan de l’Est dans les années 1970. Cette opération en cours vise à leur redonner un minimum de dignité. Après plusieurs années de recherche sur le bilan du plan de l’Est et des impacts sur nos régions, le Centre a mis en branle quatre années d’hommages aux familles exilées et de commémorations des 50 ans des Opérations Dignité. Deux tournées ont été réalisées dans chaque MRC de l’Est-duQuébec. Plus de 3 000 personnes ont assisté aux spectacles hommages organisés par le Centre et le Théâtre du Bic avec la pièce L’incroyable et ineffaçable histoire de SainteDignité-de-l’Avenir qui relate l’histoire des fermetures et des Opérations Dignité. La pièce a reçu le prix « coup de cœur » du public en 2022. Lors de sa tournée hommage, le Centre a lancé cinq pétitions pour redonner de la dignité aux familles de l’Est-du-Québec expropriées et poussées à l’exil, qui revendiquent :
1- des excuses officielles aux familles expropriées de l’Est-du-Québec par l’Assemblée nationale du Québec et le Parlement fédéral, comme pour les expropriés·es de Forillon, Mirabel et Kouchibougouac au Nouveau-Brunswick;
2- une réclamation des compensations aux familles expropriées aux mêmes proportions que pour les familles de Mirabel;
3- l’entretien régulier des cimetières des villages fermés et des chemins d’accès;
4- une reconnaissance comme « patrimoine culturel évènement de l’histoire du Québec » de l’évènement qu’est ce « grand bouleversement de l’Est-du-Québec », notamment pour protéger les lieux tels que les cimetières et monuments

commémoratifs, et les églises de Saint-Octave-de-l’Avenir, de SaintePaule, d’Esprit-Saint et de Les Méchins;
5- un appui à la mise en place de la Route de la mémoire des « Chemins des défricheurs » qui vise à relier par un parcours touristique les villages fermés et les villages de la résistance rurale de l’Est-du-Québec.
Par devoir de mémoire, le Centre travaille à la rédaction d’un livre sur l’histoire de ces évènements majeurs des années 1960, 1970 et 1980 dans l’Est-du-Québec. Ce phénomène de marginalisation et d’ostracisation étatiques des populations rurales est unique à un point où même les livres d’histoire sur nos régions n’en traitent ni les faits ni les impacts. Le thème retenu est : « Le grand bouleversement de l’Est-du-Québec » qui rappelle à la fois les expropriations et les fermetures ainsi que les mobilisations populaires des Opérations Dignité.

Retrouvailles à Saint-Nil, 2024. Centre de mise en valeur des Opérations Dignité
Pour en savoir plus : Le Centre de mise en valeur des Opérations Dignité est situé à Esprit-Saint. Il est possible de visiter l’exposition et de consulter son centre d’archives et de recherches sur la ruralité Gilles-Roy sur réservations. Les cinq pétitions sont en ligne sur le site de l’Assemblée nationale.
Remerciement aux Archives nationales du Québec qui ont mis gracieusement à disposition leur archive.



Les membres du Groupement Agro-Forestier de la Ristigouche se portent volontaires pour apporter du bois de chauffage aux sinistrés·es de Saint-Jeansur-Richelieu lors de la crise du verglas, 1998. Groupement coopératif agro-forestier de la Ristigouche
Dès la fin des années 1960, de nombreux villages se retrouvent sur la liste noire du « plan de l’Est », celle des localités vouées à disparaître. Face à l’avenir incertain qui leur est réservé, des communautés tentent de prendre leur destin en main et de « sauver » leur village. Rosaire Beaulieu (1922-1997) est du nombre. Cet homme, c’est le visionnaire derrière L’Ascension-de-Patapédia. « La frousse nous a pris. Je suis allé voir les gars et je leur ai dit que, pour ma part, je n’étais pas prêt à plier bagage. Il y a assez de bois chez nous, en plus de toutes les possibilités d’agriculture, que si nous ne sommes pas capables de survivre ici, nous ne survivrons nulle part ailleurs. »1 clame-t-il. C’est ainsi que naîtra le premier groupement forestier du Québec qui compte aujourd’hui plus de 50 ans d’existence.
Marie-Josée Lemaire-Caplette
Rédactrice en chef
En collaboration avec Sylvie Beaulieu Fille de Rosaire Beaulieu et originaire de L’Ascension-de-Patapédia
Située à une trentaine de kilomètres (20 milles) à l’ouest de Matapédia, la mission de L’Ascension-de-Patapédia voit le jour en 1936 et devient municipalité en 1968. Faisant partie des tout premiers à ouvrir la forêt pour bâtir le village, Rosaire Beaulieu n’a pas l’intention de laisser son coin de pays mourir. « Subissant les méfaits de la crise économique des années 1930, ce
peuple de défricheurs a le courage de pénétrer dans l’arrière-pays. Le godendard [grande scie sans cadre manipulée par deux personnes], le sciotte et la hache à deux taillants viennent à bout de bâtir une région. C’est ainsi que même si ce sol était maudit en certains jours de découragement, l’enracinement des années porte un attachement profond à ce coin de pays. »2 raconte-t-il.
La force du nombre Jusque-là entièrement dévoué à ses bovins et à sa terre à bois, Rosaire se met à l’action afin d’éviter toute éventualité de fermeture. Il est intimement convaincu que chacun·e a le droit de vivre décemment dans son milieu de vie. Sa réflexion place la forêt au centre de la solution, ressource naturelle qu’il connaît bien. Il croit qu’il est possible d’aménager
la forêt des environs de telle sorte qu’elle devienne rentable. La thèse en génie forestier de Fernand Coté du ministère des Terres et Forêts vient alors de paraître et porte sur le regroupement des propriétaires. Rosaire souhaite ainsi appliquer sur le terrain cette idée en rassemblant les propriétaires de boisés privés de L’Ascension-dePatapédia, Saint-François-d’Assise, Saint-Alexis-de-Matapédia, SaintAndré-de-Restigouche et Matapédia. « C’est comme ça que nous avons commencé à véhiculer notre slogan : aménager au lieu de déménager. »3 se rappelle Rosaire qui s’est allié à Armand Bélanger, Roméo Fournier et Jacques Dufour. Inspirés par les Opérations Dignité qui se déroulent en parallèle, les quatre hommes organisent maintes réunions dans leur maison ou sur le perron des églises. Rosaire Beaulieu remplace même le curé lors du sermon à l’église afin d’expliquer le projet et de rassembler les gens, se souvient sa fille Sylvie. Peu à peu, un groupe se forme autour d’eux.
« Et voilà que, devant la menace de fermeture de leurs paroisses, ces gens s’élèvent contre l’exploitation et le pillage des grandes compagnies forestières. Cette même population des années trente traîne les cicatrices du passé : la jeune génération et quelques vieilles branches à demi séchées par l’usure du temps refusent de plier bagage; ils refusent l’exil pour gagner leur
vie à l’extérieur de la région. C’est alors qu’ils choisissent de mettre leurs lots boisés sous aménagement en créant des Organismes de gestion en commun. Cette mise en commun des terres consacre l’effort de toute une population pour vivre de ses ressources. »4 raconte Rosaire Beaulieu.
C’est ainsi qu’une cinquantaine de propriétaires mettent en commun 1 200 hectares de forêt. L’étendue du territoire fait en sorte qu’ensemble, les propriétaires sont aptes à soumissionner pour tenter de mettre la main sur des contrats du gouvernement. Rosaire Beaulieu et ses compatriotes préparent un plan de redressement économique et social qu’ils présentent au ministre des Terres et Forêts, Thomas Kevin Drummond (1930-2021). À première vue, les fonctionnaires sont frileux. Le 4 mars 1971, lors de la tempête du siècle, trois représentants du gouvernement provincial viennent pour une réunion à L’Ascension. Sylvie Beaulieu se rappelle bien ces jours cruciaux : « Étant donné la mauvaise météo, ils restent bloqués chez-nous trois jours… Mon père avait le gros bout du bâton et il a réussi à faire passer ses idées à ces fonctionnaires qui se pensaient au bout du monde. Quelle victoire pour un gars qui avait une 10e année complétée en cours du soir pour adultes à l’âge de 48 ans! ».
Le ministère des Terres et Forêts se laisse finalement convaincre et

Enseigne du Groupement coopératif agro-forestier de la Ristigouche, 2024.
Photo : Sylvie Beaulieu
accorde 5 000 $ (équivalant à un peu plus de 38 000 $ aujourd’hui) à ce qui sera le premier groupement forestier. Pour ce faire, l’union des propriétaires doit se constituer légalement. Le ministre Drummond vient leur remettre le chèque en main propre, et ce, avant même que la compagnie soit officiellement formée. De plus, pour atteindre un budget opérationnel de 50 000 $, certains propriétaires hypothèquent leurs biens afin d’obtenir un prêt de 45 000 $ (correspondant à environ 345 000 $ de nos jours). Le Groupement Forestier de la Ristigouche inc. est créé en 1971 avec à sa tête nul autre que Rosaire Beaulieu. Il s’agit du premier organisme de gestion en commun (OGC) du Québec, qui donnera naissance à plus d’une cinquantaine d’autres par la suite.
S’ensuit un premier contrat en 1972 : 35 $/acre pour des coupes de bois précommerciales sur 1 200 acres.
Groupement coopératif agro-forestier de la Ristigouche





Il s’agit du premier contrat d’aménagement de la forêt à être signé au Québec. L’année suivante, les membres du Groupement obtiennent un contrat de plantation d’un million d’arbres en forêt publique, ayant priorité d’emploi sur les autres travailleurs forestiers. Les projets ne manquent pas et le Groupement se dote de machinerie. En 1981, 10 ans après la fondation, les 240 actionnaires-propriétaires et 45 actionnaires-employés·es ont dégagé 140 000 $ (environ 450 300 $ aujourd’hui) de profit après impôts, profit totalement réinvesti dans la compagnie. Ce choix permet de créer Les fermes Ristigouche inc. qui redonnent vie aux fermes abandonnées par la culture céréalière ou l’élevage de bovins de boucherie. Ce sont 450 hectares de terres qui retournent à l’agriculture dans la région.
En 2021, alors qu’il fête ses 50 ans, le Groupement coopératif agro-

forestier de la Ristigouche est devenu une coopérative avec un chiffre d’affaires de 2,8 millions $, 41 employés·es et 193 membrespropriétaires de boisés. Les bons résultats se poursuivent, ceux de 2024 sont assez exceptionnels tant pour l’exploitation, l’aménagement forestier que l’érablière où un record est battu : 300 barils de sirop d’érable ont été produits.
Une richesse rentable
Grâce à cette initiative qui a misé sur les ressources naturelles, mais également sur la prise en charge par les communautés locales, aucun village du secteur n’a été fermé. Le taux d’emploi a même augmenté et les travailleuses et travailleurs peuvent encore aujourd’hui œuvrer et habiter dans leur région, souhait cher à Rosaire Beaulieu. Maintenant, le slogan du Groupement est : « Aménage la forêt en harmonie avec sa nature ».
Homme de terrain derrière les organismes de gestion en commun du Québec en ayant mis sur pied le premier modèle de groupement forestier qui inspirera tous les autres, Rosaire Beaulieu reçoit, entre autres, la décoration de Grand Officier de l’Ordre du Mérite forestier et le diplôme de Très grand Mérite exceptionnel, tous deux décernés par le ministère de l’Énergie et des Ressources du Québec. Comme le dit un article de la revue de l’Association forestière québécoise : « On dira de ce genre d’homme que c’est une personne engagée. Dans un autre contexte, on parlerait d’un bâtisseur de pays. »5. Rosaire Beaulieu ajouterait sans doute que c’est avant tout la force d’une collectivité qui a permis de créer le Groupement et de garder les villages vivants.
La réussite du Groupement coopératif est due à tous les gens de Matapédia-Les Plateaux qui ont crû à la survie deleurvillage.Plusde50 ansplustard, la relève est toujours présente face à un avenir des plus prometteur. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.
Remerciement aux Archives nationales du Québec qui ont mis gracieusement à disposition leur photographie.

Notes
1-3-5. Serge Beaucher, « Aménager au lieu de déménager », revue Forêt conservation, Association forestière québécoise, 1984, p. 36.
2-4. Rosaire Beaulieu, « Avant-propos » dans Maurice Drapeau et Jean-Guy Gagnon, Défaire la défaite! Histoire des luttes des paroisses du Bas-du-Fleuve, Édition S.A.I.R.E.Q., 1982, p. 8-9.


Extrait du journal de bord de Jean-Baptiste-Antoine Ferland à propos de la splendeur de la grève à Sainte-Anne-des-Monts, 1836. Musée de la Gaspésie. P86 Fonds Jean-Baptiste-Antoine Ferland.
Jusqu’en 1836, le territoire québécois compte un seul diocèse, celui de Québec. C’est cette même année que l’abbé Jean-Baptiste-Antoine Ferland (1805-1865) accompagne Mgr Pierre-Flavien Turgeon (1787-1867) lors de sa visite épiscopale dans la région gaspésienne. Publié en 1861 dans Les soirées canadiennes, le récit de cet abbé démontre qu’il est un témoin privilégié de la vie en Gaspésie au début du 19e siècle grâce à sa description très précise de la géographie et de la vie des habitants·es de la péninsule. Le Musée de la Gaspésie conserve le journal de bord de l’abbé Ferland et celui de Mgr Turgeon racontant cette visite.
Marie-Pierre Huard Archiviste, Musée de la Gaspésie
Premier arrêt, Sainte-Anne-des-Monts
Le 15 juin 1836, l’abbé Jean-Baptiste Ferland pose les pieds sur le pont de la goélette Sara au port de Québec. C’est le 19 juin qu’il voit la terre gaspésienne lorsqu’il passe devant Cap-Chat. « Vers 4 heures, nous passons au pied du Cap-Chat. Ce monticule paraît avoir 3 à 400 pieds [90 à 120 mètres] de hauteur et sépare le district de Québec d’avec celui de Gaspé. […] La rivière du
Cap-Chat, à une lieue plus bas que le Cap, est le site d’un établissement renfermant 6 familles. Malgré leur petit nombre, et quoique leur chapelle tombe en ruine, ces habitants voudraient que le missionnaire demeurât quelque temps chez eux tout aussi bien qu’à Ste. Anne [Sainte-Anne-des-Monts] dont ils ne sont éloignés que d’une lieue. »
La goélette continue sa route jusqu’à Sainte-Anne-des-Monts que l’abbé Ferland décrit comme étant
un poste agréable et salubre. C’est le premier arrêt des hommes d’Église. L’endroit comprend notamment une chapelle et une maison pour les missionnaires ainsi que 37 familles. Ils mangent avec MM. Beaumont et Lemieux, ce dernier étant propriétaire de la Seigneurie, qui leur racontent leurs histoires de pêche. Ils s’affairent pendant deux jours aux activités de la mission et à celles de la pêche. Pas moins de 70 personnes reçoivent le sacrement de la confirmation!
Le 21 juin, ils retournent sur la goélette et longent la côte. L’abbé Ferland est en admiration devant le paysage, mais il se désole devant le faible nombre de familles établies entre Sainte-Anne-des-Monts et Grand-Étang. Il y va d’une proposition : « En ouvrant des chemins pour unir ces lieux au reste de la Province, la Législature en encouragerait l’établissement. Les sommes dépensées pour aider aux indigents dans certaines paroisses seraient suffisantes pour cet objet, et ceux aujourd’hui qui se reposent sur la charité publique y trouveraient un moyen plus honorable de gagner leur vie. »
Mgr Turgeon est beaucoup plus pragmatique dans ses écrits. L’arrêt à Sainte-Anne-des-Monts est le seul compte-rendu de son voyage. Il rédige un résumé de ses actions et propose cinq recommandations. Le journal nous apprend qu’en plus des 70 confirmations, il a procédé à


150 communions. Parmi ses recommandations, il mentionne que la nouvelle chapelle soit lambrissée à l’intérieur et l’extérieur le plus tôt possible et, qu’à l’avenir, l’élection du marguillier se fasse aux deux ans.
« Encore la morue, la morue partout »
Le deuxième arrêt est réalisé à Rivière-au-Renard. Encore une fois, l’abbé Ferland y va d’une belle description : « Quelques maisons éparses habitées par 18 familles; une quarantaine de barges à l’ancre, un cul de poule de Jersey faisant ici le commerce, des vigneaux, des cook rooms pour une moitié de ligne, une chapelle de 20 pieds [6,1 mètres] taillée […]. »
Une grande constatation est faite lorsqu’il débarque sur la grève : il écrit qu’il y règne une puanteur! En effet, il remarque que plusieurs têtes de morues et autres détritus de ce poisson pourrissent sous un soleil brûlant. Plus tard dans la journée, l’abbé Ferland prouve de nouveau qu’il est un fin observateur et est de bonne écoute. Il explique dans son récit le fonctionnement de la saison de la pêche pour les pêcheurs et leur famille avec un certain souci du détail. Il mentionne qu’il faut 110 morues sèches pour former un quintal et que le rhum est disponible pour le prix trop élevé de 10 shillings le gallon et que même à ce prix, les habitants·es ne s’en privent pas! Toujours aux prises avec l’odeur de la morue, les passagers de la goélette sont heureux de se rendre compte que celle-ci diminue au fur et à mesure qu’il parcourt le chemin jusqu’à la chapelle. Mais lorsque les portes sont ouvertes, ils se cachent
le nez à deux mains tellement la puanteur est omniprésente. C’est que, dans un souci de bien préparer cette visite, le missionnaire du village leur mentionne que les gens ont lavé le bâtiment avec du savon à l’huile de morue! Les offices religieux sont tenus dans la chapelle avec des pêcheurs qui tentent de résister au sommeil.
« L’Anse au Gris fond »
Les deux hommes partent le soir même pour L’Anse-au-Griffon. Le village est ainsi nommé en raison du fond sablonneux qui est gris. L’abbé Ferland remarque que plusieurs personnes dans ce village proviennent de l’extérieur et sont employées par la compagnie Janvrin ainsi que les maisons Buteau et LeBoutillier. Il est surpris par le foisonnement des activités avec les goélettes présentes pour établir des échanges. « La chapelle, plus grande que celle de la Rivière-au-Renard, était remplie; ce dernier poste ayant député une partie de sa population : de fait, presque tous ceux qui ont été confirmés aujourd’hui sont de ce lieu. »
Et comme c’est le cas pour les autres villages, il se désole quelque peu de voir tout le potentiel agricole qui n’est pas utilisé. Tout cela au profit de la pêche : « Les terres sont bonnes, produisant du bled [blé], de l’orge, etc. Mais, ainsi que dans les autres parties du district de Gaspé, l’agriculture est presque abandonnée pour la pêche. »
La mission se termine vers midi et l’équipage reprend la route maritime : direction Gaspé! Un périple à suivre dans la prochaine chronique.


L’an 2024 marque le 100e anniversaire de l’arrivée des Ursulines à Gaspé. Pour l’occasion, le Musée de la Gaspésie présente l’exposition Religieuses, enseignantes et… scientifiques!, coproduite par le Site historique Marguerite-Bourgeoys et le Musée des Ursulines de Trois-Rivières. Bien que les dernières ursulines aient quitté Gaspé en 2020, leur souvenir demeure profondément ancré dans la mémoire collective gaspésienne. Si leur Monastère, autrefois perché sur les collines surplombant la baie de Gaspé, n’est plus là pour témoigner de leur présence, quelques artefacts précieux subsistent au Musée de la Gaspésie pour rappeler leur contribution au développement de la région, principalement en matière d’enseignement.
Vicky Boulay Conservatrice, Musée de la Gaspésie
Avant d’être nommé évêque de Gaspé, Mgr Ross est le principal de l’École normale de Rimouski, dirigée par les Ursulines. C’est donc naturellement qu’il se tourne vers cette congrégation religieuse pour assurer l’éducation des jeunes filles dans sa ville épiscopale. D’ailleurs, les sept pionnières proviennent toutes de Rimouski. Les Ursulines initient véritablement leur œuvre en Gaspésie le 14 septembre 1924 au Baker Lodge, lieu qui leur est gracieusement prêté en attendant la construction du Monastère. Ce dernier ouvre ses portes le 15 août 1925 et abrite la Communauté, le Noviciat, l’École Normale,
l’École ménagère et le Pensionnat. En 1944, deux ailes sont ajoutées au corps central pour répondre à l’accroissement constant des élèves, puis une autre suit pour les chambres en 1964. Derrière le bâtiment, on retrouve un jardin, des terrasses, des vergers, une serre, un poulailler et une ferme pour combler les assiettes du réfectoire. Des préaux sont également construits pour se reposer. Après la fermeture du Monastère en 1970, les Ursulines continuent de rayonner en Gaspésie jusqu’à leur départ de la région 50 ans plus tard. Les artefacts conservés au Musée rappellent cette période effervescente du Monastère.

- Mère Sainte-Catherine-de-Sienne (Blanche Goulet) – 1882-1936
- Mère Sainte-Angèle (Rose-Anna Bélanger) – 1891-1979
- Mère Saint-André (Lydia Harvey) – 1895-1991
- Mère Sainte-Cécile (Antoinette Martel) – 1896-1966
- Sœur de Saint-Laurent (Desneiges Belzile) – 1895-1960
- Sœur Sainte-Véronique (Rose-Anna Langlois) – 1895-1960
Le culte et la vie quotidienne
La collection comprend évidemment divers objets liturgiques tels qu’un bénitier, des étoles et des bougeoirs, ainsi que des objets de la vie quotidienne, comme un presse-jus, une baratte à beurre, des fers à repasser et des pichets. Parmi ceux-ci figurent deux morceaux de savon du pays ainsi que des couteaux à savon de sœur Alice O’Connor (19111997), soulignant l’autonomie de cette communauté. Le Musée de la Gaspésie conserve également un coffre de couture qui a appartenu à mère Sainte-Angèle-de-Mérici (RoseAnne Bélanger), l’assistante de la mère fondatrice, Sainte-Catherinede-Sienne.
La musique
D’autres objets de la collection des Ursulines témoignent de l’importance de l’enseignement de la musique et des arts visuels au sein du Monastère de Gaspé.

En plus d’une grosse caisse qui servait à « scander les rythmes d’entrées et de sorties, aux heures de festivités et des séances pédagogiques »1, le Musée de la Gaspésie conserve une harpe ayant appartenu à mère Sainte-Cécile (Antoinette Martel), qui enseigne la musique de 1924 à 1944. Ce précieux instrument lui a été offert par Mgr Ross et l’a rejointe à Gaspé en 1925. Fabriquée en érable doré, la harpe porte la signature des fabricants : Browne & Buckwell / Makers New York. Elle est ornée de cariatides ailées, comporte 44 cordes et est équipée d’un mécanisme à sept pédales.
Les arts visuels
Le talent artistique de mère SaintAndré (Lydia Harvey) est largement connu, elle qui enseigne les arts de 1924 à 1970. C’est elle qui réalise les très grands tableaux de toutes les scènes du chemin de croix qui ornent les murs de la chapelle. Mère Saint-André remet à Fabien Sinnett, alors entrepreneur en décoration d’intérieur et commerciale, deux coussins satinés qu’elle a confectionnés et peints à la main. L’un est noir et arbore deux grandes roses, l’une est de couleur rose foncé et l’autre est de couleur orangée. Les feuilles autour des roses sont vertes avec des touches de rouge et des détails de veines. L’autre coussin est blanc et revêt d’un côté une rose entourée de plusieurs petites fleurs colorées dans des tons de jaune, orange, violet, rose et bleu. De l’autre côté, le dessin représente deux fleurs rouges, probablement des coquelicots, avec quelques feuilles vertes et des tiges fines noires.

La nappe du pape à Gaspé
De mère Saint-André, le Musée conserve également une nappe que son frère, le chanoine Ludger Harvey, lui a offerte. Cette nappe devait d’abord être remise au pape Pie XII pour souligner le 20e anniversaire de son pontificat, le 2 mars 1959. Malheureusement, il décède avant la tenue des célébrations, en octobre 1958. La nappe est donc mise en vente et c’est le chanoine Ludger Harvey, alors qu’il est de passage à Rome au début des années 1960, qui l’achète. Il s’agit d’une nappe faite de toile fine et brodée à la main de broderie vénitienne. Cette dernière est reconnaissable par ses motifs constitués à l’aide de différents points de remplissage.
Au-delà des objets matériels conservés, l’héritage le plus précieux laissé par les Ursulines à Gaspé et ailleurs sur la péninsule réside dans leur dévouement à l’éducation et dans les souvenirs impérissables qu’elles ont gravés dans la mémoire de centaines de jeunes filles gaspésiennes.
Note 1. Sœur Clémence Bernard, « Les arts », Revued’histoire delaGaspésie, no 46, 1974, p. 158-163.

Mariage de Lilian Aubert et Albert Langlois dans la paroisse Saint-Dominique à Montréal, 19 juillet 1941. Lilian est la fille d’Edmund Aubert et Aimée Laflamme, et l’arrière-petite-fille de George.
Collection Doris Bourget et Erin Aubert
George Aubert naît le 15 mai 1805 à Saint-Jean sur l’île anglo-normande Jersey et décède le 27 mars 1869 à l’Île Bonaventure. Il est le fils de George et Mary Gallix/Gallie. George épouse Marie Anne Morrissey le 16 février 1829 à l’Île Bonaventure; de leur union seront issus cinq enfants : Angélique (1831), Héléna Jane (1835), George (1838), Suzanne (1840) et Jean Baptiste (1843). Il épouse en secondes noces Mary Ann Lamb le 2 novembre 1846, aussi à l’Île Bonaventure. Avec Mary Ann, il aura neuf autres enfants : Charles George (1847), Pierre Abel (Peter) (1848), Sarah Ann (1850), François Xavier (1843), James (1855), Victoria (1857), Magdelen (1859), Anastasie (1861) et Joseph (1867). Les enfants de George nés de ses deux mariages sont de confession catholique et sont toutes et tous élevés dans la langue anglaise, certains·es sont bilingues. George Aubert doit sa renommée à sa participation active à la vie communautaire sur l’île. Entre autres, le livre Les principales familles de l’Île, leur contribution à la communauté donne en exemple son soutien financier à l’érection de la chapelle : « Il semble que George Aubert ait contribué de ses deniers
La communauté de Percé compte des résidents·es de différentes origines, descendant des nombreux ancêtres de langue anglaise. On y dénombre autant des personnes de religion protestante que catholique puisque les premiers habitants·es de l’Île Bonaventure sont issus des deux communautés. La famille dont il est question ici est celle de George Aubert, premier de ce patronyme et le plus connu, arrivé à l’Île Bonaventure vers 1825.
Élaine Réhel
Généalogiste et résidente de Percé
aux coûts de construction de la chapelle catholique sur l’Île Bonaventure. À ce sujet, le curé Guilmet note en 1868 : « Il reste dû à George[s] Aubert sur la première entreprise, 110,92 $. La chapelle n’est pas obligée de solder cette balance d’une manière absolue, car il était entendu que la chapelle lui donnerait ce qu’elle pourrait sans s’obliger ». Pour régler la question, on avait décidé qu’à sa mort, George Aubert et son épouse auraient des funérailles gratuites dans la chapelle de l’Île et
qu’on ne lui devrait plus rien ensuite. À l’époque, un service coûtait 1,33 $ [équivalant aujourd’hui à environ 40 $]. »1
Une implication locale qui se transmet
Le petit-fils de George et le fils de James, Edmund Aubert, se marie avec Angèle Denise Aimée « Emma » Laflamme à Percé le 1er février 1916. Edmund travaille pour la famille Valpy. Il s’occupe de l’élevage et de l’abattage de visons, de l’entretien
George Aubert et Marie/Mary Gallix/Gallie Saint-Jean, Île Jersey
George Aubert et Mary Ann Lamb Île Bonaventure, 2 novembre 1846 Il est veuf de Marie Anne/Mary Ann Morrisey qu’il a épousée le 16 février 1829 à l’Île Bonaventure.
James Aubert et Mary Bridgit Lecouteur Percé, 7 novembre 1882
Edmund Aubert et Angèle Denise Aimée « Emma » Laflamme Percé, 1er février 1916
Erin Aubert et Doris Bourget Percé, 2 juin 1959
Michel Aubert et Joanne Aubert, enfants d’Erin

des propriétés et du bois de chauffage de cette famille.
Pour sa part, l’arrière-petit-fils de George et le fils d’Edmund, Erin Aubert, vit toujours à Percé. Il y épouse Doris Bourget le 2 juin 1959. Le couple exploite des commerces
dans le village, dont le restaurant Le Pigalle pendant de nombreuses années. Son frère Ludger Aubert possède quant à lui le Star Motel, devenu plus tard le motel Fleur de Lys. Il est à noter que Doris Bourget est la mairesse de Percé de 1991 à 1999.
C’est à la fin des années 1960 qu’il est décidé que l’Île Bonaventure va tomber sous la gouverne de l’État québécois pour la création d’un parc national. Bien qu’il ne demeure alors que des résidents·es estivaux, tous les propriétaires sont tout de même expropriés en 1971. Walter Maloney, dont la famille habite l’île depuis 1907, est le dernier à quitter les lieux en 1973. La famille Aubert n’est pas touchée par l’expropriation, ayant quitté l’île quelques décennies auparavant pour s’établir principalement à Percé.
Note 1. Madeleine Tanguay, Rémi Plourde et Chantal Soucy, Les principales familles de l’Île, leur contribution à la communauté.
VOYEZ LA LIGNÉE DESCENDANTE DE GEORGE AUBERT ET MARIE/MARY GALLIX/GALLIE


Dans le livre Le Régiment de la Chaudière, 1889-2004, on lit ceci : « Pour plusieurs raisons, le régiment de La Chaudière occupe une place à part parmi les unités canadiennes-françaises. On sait qu’il a été le seul régiment levé au Québec à participer, le 6 juin 1944, à l’invasion de la Normandie, la plus grande opération militaire de l’histoire. Mais La Chaudière ne s’est pas illustré qu’à cette occasion. […] Sur son itinéraire figurent les noms de plusieurs villes et localités, sites de combats mémorables qui lui ont valu le respect des troupes alliées et allemandes. On se souvient que le Canada a pris part à l’occupation de l’Allemagne une fois les hostilités terminées. Or, le Régiment de La Chaudière a été également la seule unité canadienne-française qu’on a appelée à participer à cette importante mission. […] Ce régiment revendique aussi l’honneur de compter parmi les plus vieilles unités de la milice canadienne. »1
Le Régiment de La Chaudière, qui n’arrive pas à rassembler suffisamment de soldats, décide d’étendre sa zone de recrutement au Bas-Saint-
Louis-Georges Labbé est le cadet des neuf enfants de Rosede-Lima Dorion (1875-1959) et Charles Labbé (1871-1933) des Failles (« Le Fall ») à Percé. Il sert lors de la guerre de 1939-1945 comme « lance-caporal » que l’on traduit par caporal adjoint, matricule E9414, Front du Régiment de la Chaudière. Le soldat Labbé passera 50 mois outre-mer.
Armand Labbé Neveu de Louis-Georges Labbé et originaire de Percé
Laurent, à la Gaspésie et aux Îles-dela-Madeleine. Louis-Georges Labbé, 21 ans, célibataire, de Les Failles, décide donc de s’enrôler volontairement à Cap-d’Espoir le 12 septembre 1940; selon ses dires, il veut goûter à la vie de l’armée. Sur le document de son enrôlement, on mentionne que de 1936 à 1940, en hiver, il est « lumberjack » (bûcheron) à 4 $ par jour pour son père Charles; de 1930 à 1940, en saison, il est pêcheur avec son père, et son frère, Henri, pour les Jersiais Biard, entre autres, à 25 $ la semaine. On dit de lui qu’il est un garçon poli, mais peu loquace. Fils de pêcheur, il a dû quitter l’école de rang, pourtant à côté de chez lui, à 11 ans, après sa 2e année. On dit aussi qu’il a une bonne conduite et qu’il sait jouer de l’accordéon. On ne dit pas qu’il parle l’anglais; je crois que non. Curieusement, le 17 février 1941, à 700 kilomètres (435 milles) de l’entraînement à Valcartier, le Dr Guy Fortier l’admet à l’Hôtel-Dieu de Gaspé; le soldat se plaint de vives douleurs abdominales accompagnées de nausées marquées. On diagnostique une colite et une congestion pulmonaire, et on procède à l’appendicectomie. Louis-George quitte l’hôpital le 26 février. Pourquoi être allé si
loin pour cette intervention? Même une personne-ressource aux Anciens Combattants n’a pu répondre à cette question.
Toujours est-il qu’à partir du 9 mars 1941, il suit l’instruction militaire et l’entraînement complet, d’une durée d’environ six mois, comme fantassin, fusiller (« rifle ») et aide de camp (« batman »), telle qu’est sa volonté, à Sussex au NouveauBrunswick. Puis, le 27 juillet 1941, à Halifax en Nouvelle-Écosse, il est du convoi HX 141, et le 11 août 1941, il arrive à Liverpool, au RoyaumeUni. En partant vers l’Europe, le régiment d’infanterie de la Chaudière compte trois bataillons et des services militaires.
Le 15 avril 1942, on admet le soldat Labbé au Canadian General Hospital, probablement à Farnborough, au sud de l’Angleterre. Il y subit une intervention chirurgicale à cause d’une verrue au tendon d’Achille droit, mais s’en est suivi un hématome qui retarde sa guérison. Il quitte l’hôpital le 16 mai afin de rejoindre son unité. Par après, sur un document qui ne mentionne pas de date, un major demande une radiographie pour une blessure à une cheville.

La Compagnie D du Régiment de la Chaudière. Dans la 1e rangée, assis, on indique que le 5e à partir de la droite est le « Sdt Labbée, L. », qui est fort probablement Louis-George Labbé malgré l’absence du G et la mauvaise orthographe de Labbé. Sur au moins un document, on le nomme Labbée, Louis.
Image tirée de : Jacques Castonguay et Armand Ross, Le Régiment de la Chaudière, 1889-2004, Lévis, Forces armées canadiennes, 2005, 644 p.
L’exploit militaire canadien
Le soldat Louis-Georges participe au débarquement de Normandie, le jour J du 6 juin 1944. Le Régiment de la Chaudière, dont les hommes seront surnommés « Les Chauds », débarque à Bernières-sur-Mer (Juno Beach) et affronte la 716e Division d’infanterie allemande, perdant au cours de la journée 120 hommes, dont 15 tués. Durant tout le mois de juin, Les Chauds se battent sans répit, entreprennent la reconquête avec d’autres unités canadiennes, et participent à la libération de plusieurs villes. À la fin de la guerre, le Régiment de la Chaudière compte 212 soldats tués et 793 blessés.
La famille de Louis-Georges, selon ce que l’on m’a raconté, a alors très peu de ses nouvelles, mais un jour, on peut lire dans le journal ses nom et prénom figurant sur une liste de soldats légèrement blessés. Sa mère, Rose-de-Lima « Délima » Dorion-Labbé, reçoit ensuite un premier télégramme du directeur intérimaire des archives militaires l’informant d’une légère blessure au front de son fils. Mme Dorion-Labbé ne sait ni lire ni écrire, et bien sûr, n’a pas le téléphone… À la suite de cette blessure, on hospitalise le soldat Louis-Georges, le 10 juin 1944; il se plaint de douleurs à la tête, apparemment à la suite d’une blessure causée par un fragment de mine marine. Le dossier mentionne aussi un léger traumatisme des tissus à la cage thoracique lombaire gauche. Le 16 juin, on l’admet au Roman Convalescent Hospital (Royal Canadian Army Medical Corp) à Colchester en Angleterre. On recommande alors deux semaines de convalescence avant le retour à son unité.
Le 24 décembre 1944, diagnostic de l’impétigo : infection de la peau très contagieuse, mais bénigne, en résulte deux semaines de repos. Une deuxième blessure, le 26 février 1945, cette fois à la cuisse gauche; puis hospitalisation deux jours plus tard. Curieusement, on le dit décédé le 3 mars, ce qui est faux. Un deuxième télégramme est envoyé à sa mère : « […] nature de la blessure maintenant signalée comme étant blessure de balle cuisse gauche stop aucun autre détail ne suivra à moins que l’état du patient ne soit considéré grave ou dangereux par les autorités médicales ». Après une intervention chirurgicale au Canadian General Hospital, on l’admet, le 6 avril, au Roman Way Convalescent Hospital pour sa convalescence. Il semble avoir son congé le 4 mai. Lors de sa libération, on lui accorde une allocation de 100 $ pour des vêtements civils.
Le soldat Louis-Georges reçoit des médailles : étoile de 1939-1945, étoile France-Allemagne, médaille de la
Défense, médaille canadienne du Volontaire, barrette pour le service outre-mer, médaille de guerre 19391945. Je crois les avoir vues au mur de sa cuisine. On m’a dit qu’il les a emportées, à son décès, épinglées à son habit de soldat.
Quelle solde (salaire de soldat) lui vaut son engagement dans l’armée? On peut lire que les soldats canadiens gagnent à l’époque 1,50 $ (équivalant à 26,50 $ aujourd’hui) par jour, donc 45 $ par mois; on les surnomme d’ailleurs les « quarantecinq ». On paie le soldat quotidiennement et il reçoit 0,50 $ par jour de permission. Mais j’ai cru lire que le soldat Louis-Georges a peut-être gagné moins avant 1943.
Un retour surprise
Pendant son absence, les seules nouvelles que sa mère et sa famille ont reçues sont celles provenant de l’article de journal et des deux télégrammes; on croit donc le pire. Selon une cousine, un soir, tard ou dans la nuit, notre brave soldat descend du train à Coin-du-Banc, à environ un mille (1,6 km) de chez lui. Il marche avec son bagage et frappe à la porte : sa mère, madame Délima ainsi qu’on l’appelle, se lève, un peu anxieuse, et va répondre. Quand elle aperçoit son beau LouisGeorges, elle croit à un revenant, mais sa joie l’emporte vite sur cette triste croyance.
À son retour, mon oncle LouisGeorges veut reprendre son métier
Document médical de la dernière blessure du soldat Labbé à la cuisse, 1945. Ce document indique, au centre à droite, qu’il est décédé le 3 mars 1945 alors qu’il est transféré.
Collection Armand Labbé



Des membres de la famille Dorion-Labbé aux Failles, Percé, entre 1935 et 1940. À l’avant, Joseph et Louis-Georges; à l’arrière, Roméo, Rose-de-Lima Dorion-Labbé, Jean-Baptiste et Théodore.
Collection Armand Labbé
de pêcheur et utiliser les crédits de réadaptation pour améliorer son attirail de pêche. Il épouse Évangéline Daraîche (1924-2006) le 31 décembre 1946. Tous deux ont 11 enfants, dont trois sont morts très jeunes. Ils habitent la maison familiale plusieurs années. Il est un peu ennuyé par sa blessure, mais à cette époque, on prend bien soin des anciens combattants. Vers la fin des années 1960, son épouse et lui trouvent du travail à Montréal et ne reviennent que l’été. Puis, il vend la maison à un neveu, Richard Labbé, qui l’habite encore.
Après plusieurs démarches, j’ai réussi à obtenir copie du montant de ce qu’on appelle la « pension de l’armée ». Le soldat Labbé a droit à une pension d’invalidité comme célibataire de 570,49 $, comme homme marié de 142,62 $ et une allocation pour soins de 172,60 $.
50 ans plus tard
En mai 1995, lors du 50e anniversaire de la libération de la France, tous les soldats de la Deuxième Guerre mondiale encore vivants ont droit à une cérémonie organisée à Bayeux, visant à rendre hommage à ceux qui ont péri lors de la bataille de Normandie. Bayeux a été la première ville libérée par les troupes alliées après le débarquement. LouisGeorges Labbé s’y rend, mais, lors d’une visite au cimetière des soldats de son régiment, il a une mauvaise surprise… Une pierre tombale ou une croix porte son nom et la date de son décès, à la fin de la guerre : on l’a cru mort le 3 mars 1945 alors qu’il était à l’hôpital, comme indiqué sur le document erroné.
En août, trois mois après son retour de la cérémonie, mon oncle Louis-Georges dit ne pas « feeler »… À la demande tenace de son épouse, il consulte son médecin. Un jour, après avoir reçu les résultats d’examen, il rentre chez lui, l’air piteux :
-Pis, son vieux, quelles nouvelles? lui demande son épouse.
-Pis, ben le docteur m’a dit que j’avais un cancer silencieux qui s’est réveillé.
-Comment ça?
-Il dit que je dois avoir vécu un choc, mais j’me d’mande ben de quoi y parle…
-Mais voyons, son vieux, t’as vu ta tombe en France, c’est pas assez?
-Tu penses?
-Ouais… Pis astheure?
-Astheure, y vont m’soigner.
La santé de Louis-Georges décline
peu à peu et il décède le 4 février 1995, quelques jours après la mort de son frère, mon père, Roméo (1909-1995). À Percé, au parc Logan, on retrouve une plaque commémorative en l’honneur des anciens combattants de Percé de la guerre 1939-1945; on y a inscrit les nom et prénom de LouisGeorges Labbé.
Je garde de mon oncle LouisGeorges le souvenir d’un homme affable, généreux, patient, souriant et jovial. Il était fier de ses médailles, mais jamais ne nous parlait de la guerre. Je me souviens, qu’au jour de l’An, il a souvent attelé son Bill, cheval blond et fringant, pour venir nous chercher, un mille plus loin au moins, pour aller fêter la nouvelle année chez lui, au son de son accordéon à « pitons ». Une belle randonnée au son des grelots, à partir du centre du village jusqu’aux Failles, que l’on nommait « Le Fall ».
Remerciements à Mme Brousseau des Anciens Combattants à Ottawa, pour ses conseils judicieux et sa diligence à me fournir le dossier militaire de mon oncle; à une cousine, Pierrette Labbé, pour sa mémoire; à un fils de Louis-Georges, Marcel, qui a autorisé cette publication; à Pierre Boulianne, auteur de La guerre de mon père (2020), pour son aide : ses connaissances et son expérience m’ont été d’une grande utilité.
Note
1. Jacques Castonguay et Armand Ross, LeRégimentde la Chaudière, 1889-2004, Lévis, Forces armées canadiennes, 2005, 644 p.

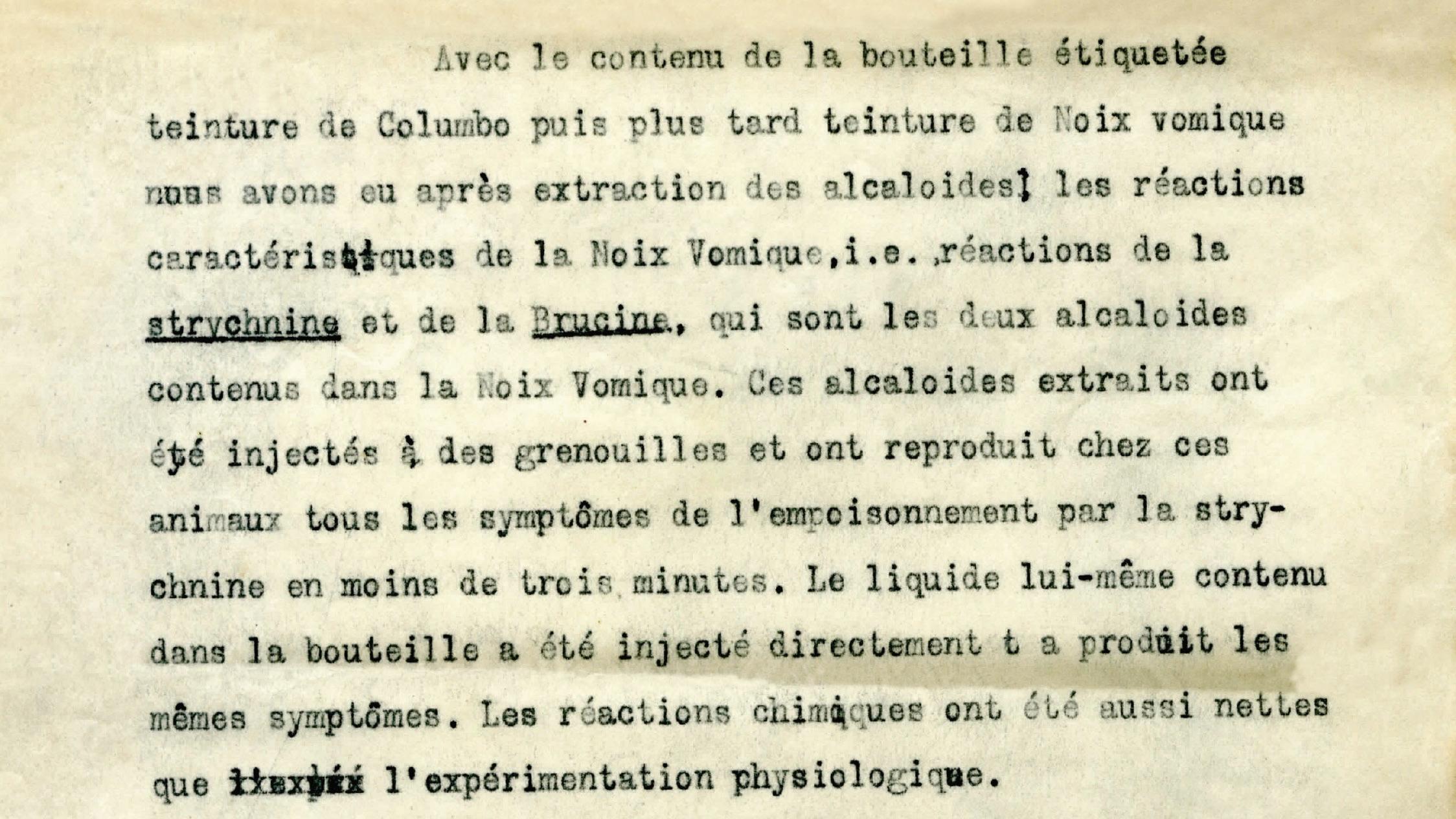
Extrait du rapport d’autopsie sur le cadavre de Célanire Lafontaine rédigé par le Dr Arthur Vallée, professeur d’anatomie pathologique et de chimie médicale à l’Université Laval, 1909. On y lit que le contenu des bouteilles du Dr Samson a été testé sur des grenouilles afin d’en déterminer le contenu. ANQ Gaspé. TP9,S4,SS26,SSS1
Sous un ciel assombri de novembre 1911, le curé de Grande-Rivière Alphonse D’Amour préside les funérailles du Dr Marcel Samson, tristement connu pour avoir causé la mort de son épouse deux ans plus tôt. Son court mariage avec Célanire Lafontaine avait été célébré dans la même paroisse le 3 octobre 1905, alors qu’elle était âgée de 38 ans. Le Dr Samson était pour sa part âgé de 47 ans; il avait eu une première carrière dans la cléricature. Rien ne laissait présager à ce moment la tragédie qui surviendrait moins de quatre ans plus tard.
André Ruest
Technicien en documentation, Archives nationales à Gaspé
Guillaume Marsan
Archiviste-coordonnateur, Archives nationales à Rimouski et à Gaspé
Le 11 mars 1909, le coroner Joseph-Arthur Pidgeon se rend à la résidence du Dr Samson à la demande de ce dernier, afin d’y mener une enquête à la suite du décès de Célanire Lafontaine, qui a rendu l’âme la veille. Quelques proches ayant accouru au chevet de la malade viennent témoigner
de ses derniers moments, qu’ils décrivent comme étant terribles. Il semble qu’elle criait, était agitée et se plaignait de douleurs aux jambes. Quelques heures avant son décès, elle aurait affirmé à une voisine, Eugénie Mercier, qu’elle était en pleurs depuis huit jours et qu’on l’avait empoisonnée.
Accident fatal…
Le récit du Dr Samson est particulièrement intéressant à cet égard. Le mari affirme en effet au coroner Pidgeon qu’il a commis une erreur fatale : il soutient être descendu à la cave pour chercher un médicament afin de soulager les souffrances de son épouse. Puis, s’apercevant

Enveloppe de la lettre envoyée par le Dr Samson au coroner Joseph-Arthur Pidgeon à Percé, 1909.
ANQ Gaspé. TP9,S4,SS1,SSS1
que certaines étiquettes de flacons étaient décollées à cause de l’humidité, il les aurait replacées au meilleur de sa connaissance. Cependant, croyant administrer à son épouse de la teinture de colombo, médicament reconnu pour ses propriétés apéritives, il lui aurait plutôt donné de la noix vomique, source importante de strychnine, un puissant alcaloïde extrêmement toxique. La strychnine provoque chez l’humain des spasmes musculaires et de fortes douleurs; la mort survient généralement par asphyxie. Son utilisation n’est pas nouvelle, ce poison étant administré à très petites doses en médecine depuis le milieu du 19e siècle. Il est aussi
tristement connu pour avoir été utilisé par l’un des premiers tueurs en série, le diplômé en médecine de l’Université McGill Thomas Neil Cream, surnommé « l’empoisonneur de Lambeth » (une ville près de Londres). Ce dernier a été pendu en novembre 1892 pour l’assassinat de quatre prostituées par administration de strychnine. Le poison est largement répandu à l’époque puisqu’il sert à éliminer la vermine et les rongeurs.
… ou meurtre?
Après avoir entendu plusieurs témoignages, le coroner conclut que l’épouse du Dr Samson est décédée accidentellement, à la suite de
Extrait du rapport d’exhumation du cadavre de Célanire Lafontaine par le Dr Arthur Vallée, 1909.
ANQ Gaspé. TP9,S4,SS26,SSS1
l’absorption de strychnine par inadvertance. Toutefois, le doute persiste sur le niveau de responsabilité du Dr Samson dans cette affaire. Certains témoignages laissent croire que l’empoisonnement était intentionnel. À la demande de l’assistant procureur général de la province, le Dr Arthur Vallée, professeur d’anatomie pathologique et de chimie médicale à l’Université Laval, doit donc se rendre au cimetière de Grande-Rivière, le 1er juillet 1909, afin d’exhumer le corps de la défunte et de procéder à une autopsie, en ayant soin de récupérer divers organes et du liquide corporel. L’analyse des viscères est réalisée dans les laboratoires de l’Université Laval par le Dr Vallée et l’abbé Phileas Filion, professeur de chimie. On utilise le procédé de Dragendorff pour mettre en évidence les alcaloïdes potentiellement contenus dans les viscères. Les résultats sont formels : Célanire Lafontaine est décédée des suites de l’absorption de noix vomique. Sans plus tarder, la machine judiciaire se met en marche. Le Dr Samson est officiellement accusé de meurtre par empoisonnement; les procureurs de la Couronne croyant détenir suffisamment de preuves pour l’inculper. Le procès s’ouvre devant la Cour du Banc du Roi au palais de justice de Percé quelques mois plus tard. Les journaux nationaux de l’époque, principalement La Patrie,

s’intéressent rapidement à l’affaire. Le 22 octobre 1909, un entrefilet indique que le Dr Samson, quelques mois avant la mort de son épouse, aurait dit à François Lafontaine, cousin de la défunte : « Le diable peut l’emporter au fond de l’enfer, si tu veux l’amener au bord d’un cap puis la jeter par-dessus, je te donne 100 piastres! »1 Quatre jours plus tard, dans le même journal, un article recense les témoignages entendus lors du procès à Percé. Plusieurs médecins, témoins de la défense, mentionnent qu’il est facile de confondre la teinture de colombo et la noix vomique et que l’empoisonnement de Mme Samson a pu se faire de façon accidentelle. Ces témoignages d’experts viennent jeter un doute crucial dans l’esprit des membres du jury.
Une peine scandaleuse
Le 26 octobre, les jurés en arrivent à la conclusion que le Dr Samson est coupable d’homicide involontaire.
ment » des avocats de la défense ont permis de convaincre le juge et le jury que le Dr Samson n’est pas un meurtrier, mais qu’il y aurait eu plutôt négligence criminelle. « La Cour ordonne que ledit Joseph Marcel Samson soit emprisonné et soumis à des travaux forcés au pénitencier de Saint-Vincent-de-Paul, près de la ville de Montréal, pour une durée de deux ans, à compter de ce jour, et qu’à la fin de cette période, il soit libéré. »2
Certains journaux crient au scandale : la peine du Dr Samson, seulement deux ans de prison, leur semble nettement insuffisante. Le Quebec Chronicle écrit dans son édition du 4 novembre 1909 que « beaucoup de voleurs reçoivent davantage, et les cambrioleurs cinq à dix fois plus, de sorte que nous ne pouvons que présumer qu’aux yeux du juge, le meurtre d’une femme n’est qu’une peccadille insignifiante, à moins qu’il ne soit accompagné de violence et d’effusion de sang »3
Dr Samson ne profitera de sa liberté que pour une courte durée : il s’éteindra le 6 novembre 1911, quelques semaines après sa sortie du pénitencier Un mystère plane autour de cette mort prématurée, le Dr Marcel Samson n’ayant que 54 ans lors de son décès Toutes les recherches effectuées afin d’élucider cette mort sont cependant demeurées infructueuses.
Notes
1 « Le procès du docteur Samson » , La Patrie, 22 octobre 1909, p 1
2. Verdict du procès du Dr Marcel Samson, 26 octobre 1909; ANQ Gaspé, Fonds Cour du Banc du Roi, TP9,S4,SS1
3. « Fiat Justitia », TheQuebec Chronicle, 4 novembre 1909, p 2; traduction libre
CONSULTEZ LES ARCHIVES : JUGEMENT, SENTENCE, DÉCLARATION, RAPPORTS D’EXHUMATION ET D’AUTOPSIE…

ABONNEMENTCADEAU
Gâtez votre entourage avec un abonnement-cadeau, un présent 100 % gaspésien qui se prolonge toute l’année.
magazinegaspesie.ca I 418 368-1534, poste 104




L’APPEL DE TEXTES

Correctifs du n° 210
-p. 9, dans la légende de la photo du haut, on aurait dû lire Esprit-Saint et non Saint-Esprit
-p. 42, dans la légende de la photo du bas, on aurait dû lire Alma Lacasse au lieu de Régina
Faites-nous part de vos commentaires et suggestions sur le Magazine Gaspésie : magazine@museedelagaspesie.ca 418 368-1534, poste 106
Les pastilles Web à la fin de certains articles vous invitent à consulter un extra en accès libre sur notre site Web : magazinegaspesie.ca








Gaspé - Cap d'Espoir - Petite Vallée
Tél. : 418 368-5425 | info@groupeohmega.com | www.groupeohmega.com

Kaleda Ullah, Vice-présidente adjointe Courtière en assurance de dommages des entreprises
Marsh Canada Ltée | Service aux consommateurs et entreprises Programme d’assurance exclusif pour les membres de l’AMC 1 Place Ville-Marie, bureau 1500, Montréal, Québec, H3B 2B5 +1 514 285 5942 | kaleda.ullah@marsh.com www.marsh.com
Une Compagnie de Marsh McLennan




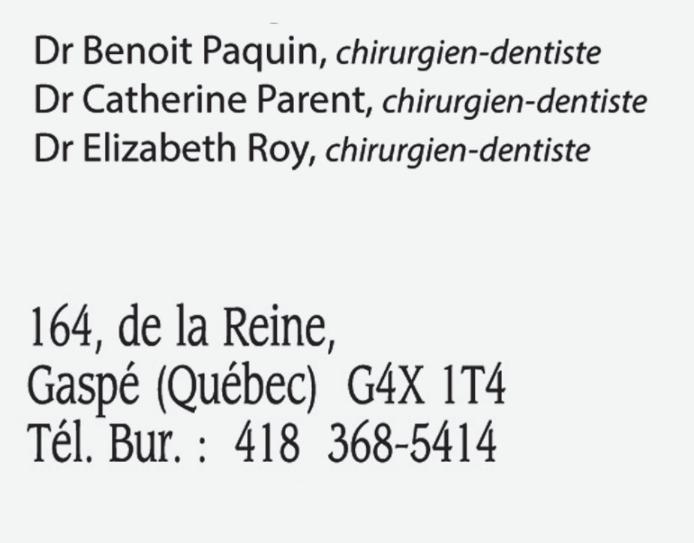






Venezrencontrer une équiped’experts quivous guidera dans l’accomplissement devos petitsetgrands projets!

INSPIRATION ETCONSEILS ÉCO ATTITUDE CONSEILS PEINTURE RÉNOVATION ET DÉCORATION


151, boul. deGaspé,Gaspé Tél. : 418368-2234 info@kega.co

parcs.canada.ca/ristigouche


