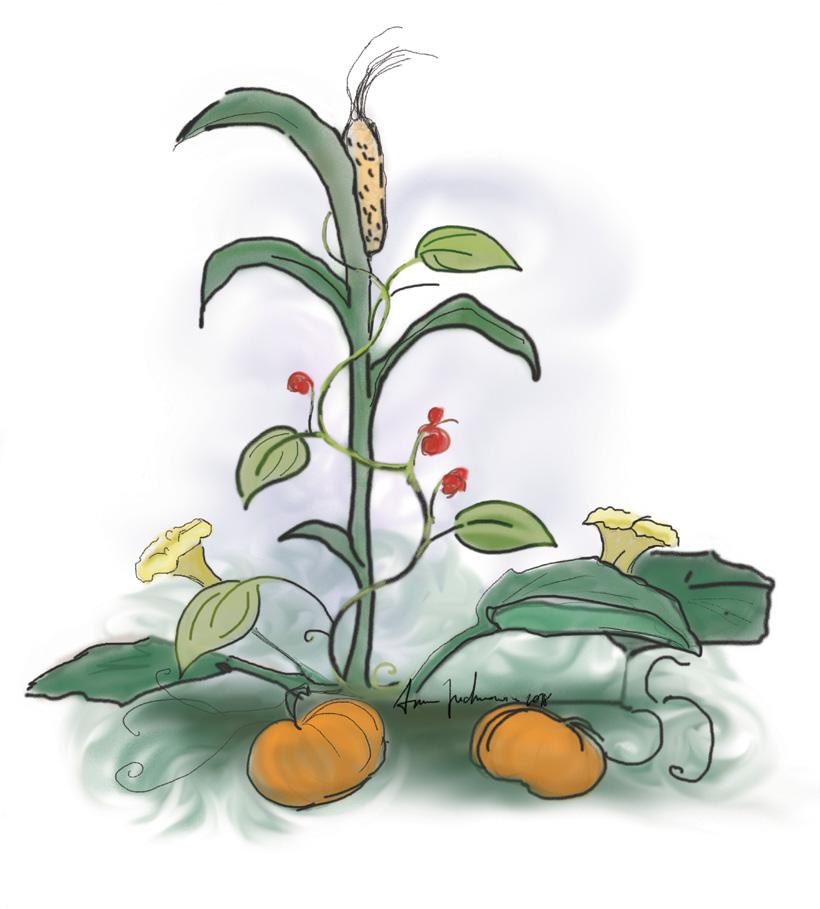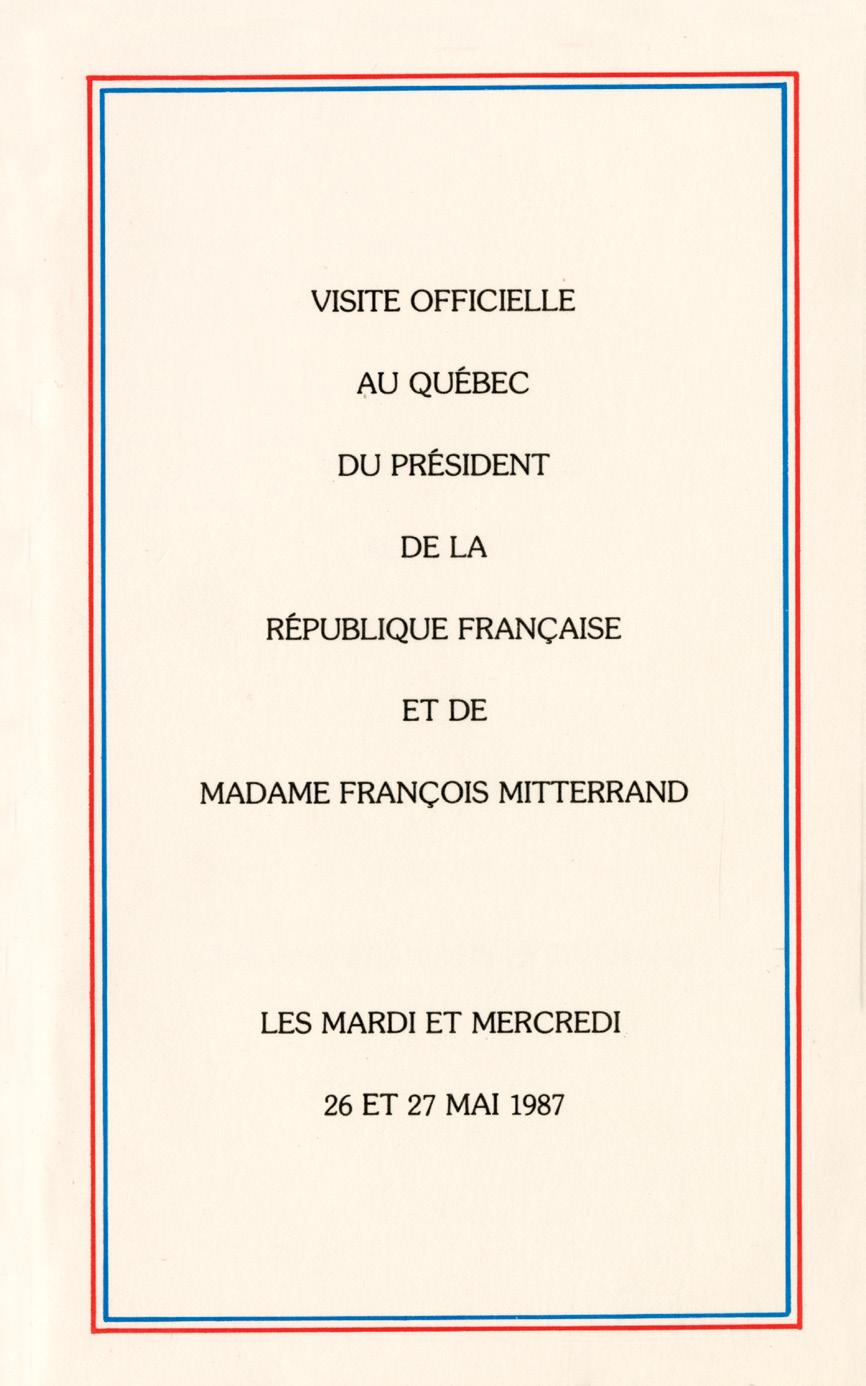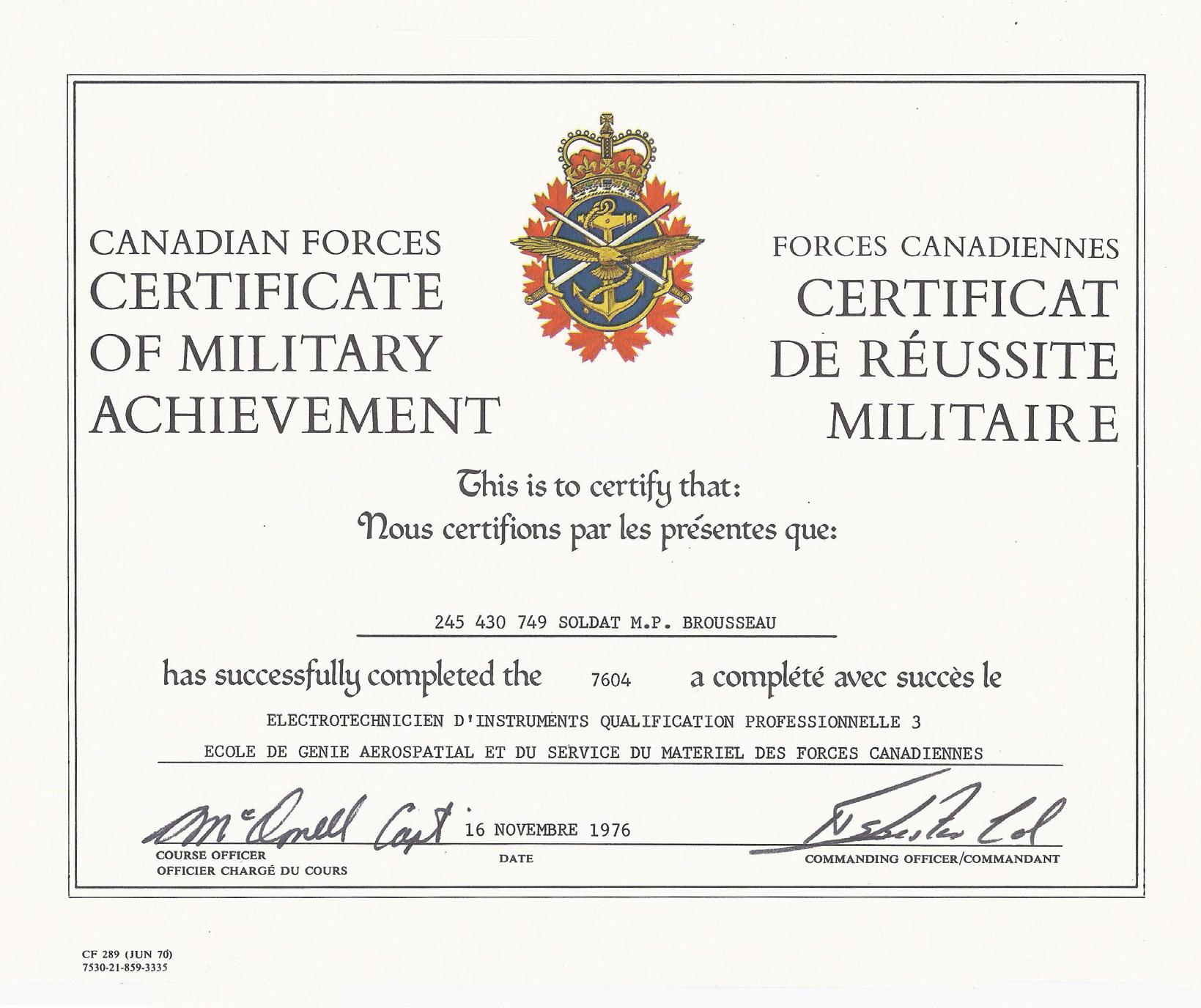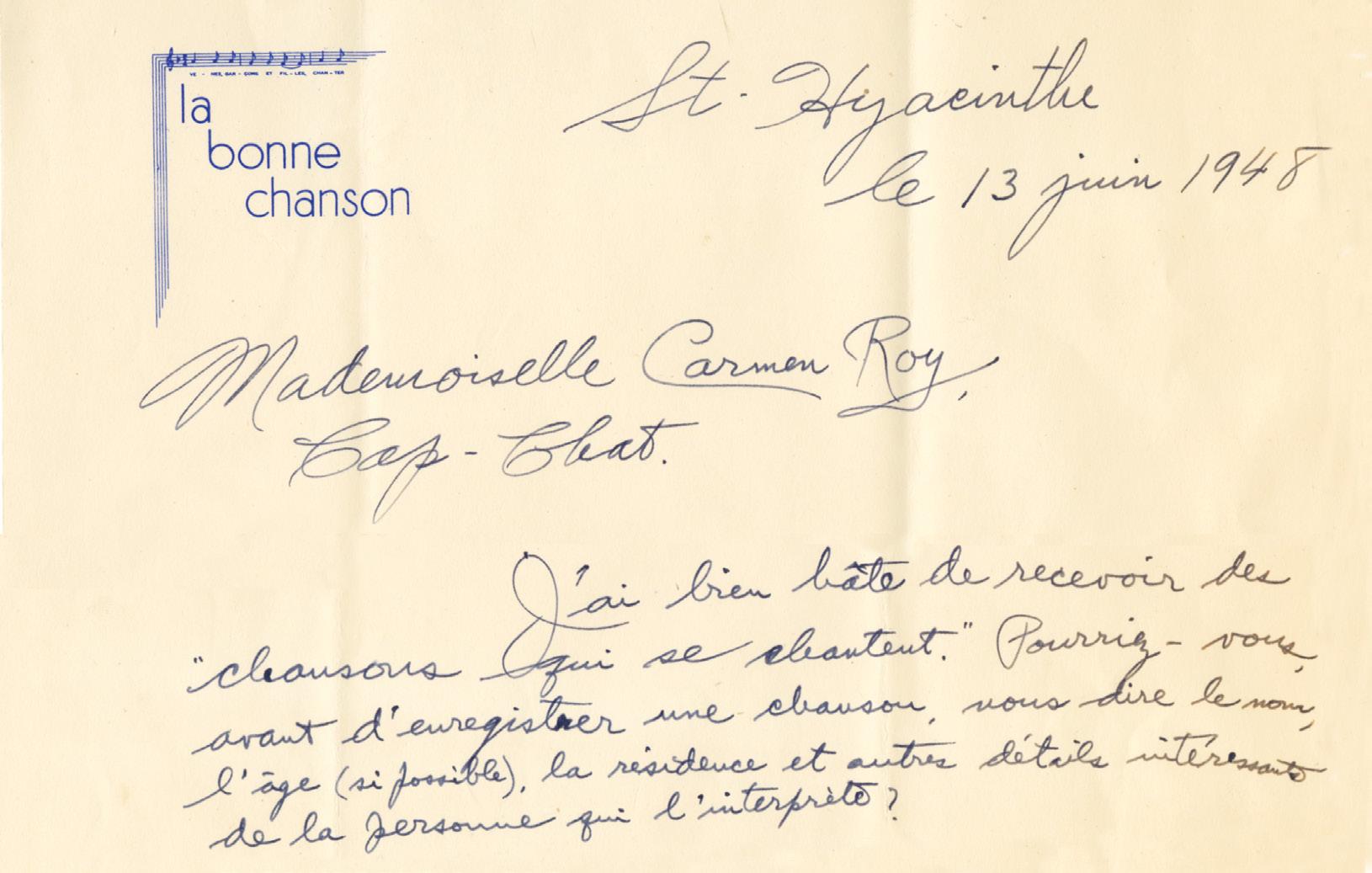6 minute read
ELSIE REFORD : EXOTIQUE ET NATURALISÉE
Elsie Reford (1872-1967) est surtout reconnue pour avoir façonné un domaine horticole aux portes de la Gaspésie; ses jardins auront 100 ans en 2026. À la suite de leur ouverture au public le 24 juin 1962, les Jardins de Métis sont devenus avec le temps un des fleurons de la région et un de ses attraits les plus fréquentés. C’est le premier investissement majeur du gouvernement Lesage pour créer des pôles d’attraction sur la route touristique de la Gaspésie.
Au moment de son ouverture en 1962, on vante le Domaine Reford (le site porte le nom de Jardins de Métis seulement depuis 1978) et sa collection de « plantes ornementales ». Aujourd’hui, les spécialistes en horticulture divisent les plantes entre plantes exotiques et plantes indigènes. Et le plus souvent, on ajoute deux autres catégories, soit les plantes naturalisées et les plantes envahissantes. Les plantes naturalisées sont des plantes exotiques qui se reproduisent naturellement dans leur nouvel environnement, comme le Rosa rugosa ou la Marguerite blanche.
Advertisement
Les plantes exotiques envahissantes modifient l’écosystème naturel, comme l’Érable de Norvège, la Berce de Caucase ou le Phragmite, et font partie de celles contre lesquelles on lutte pour les enlever ou les contrôler.
La valorisation des plantes indigènes du Québec prend de l’ampleur après qu’Elsie a quitté la scène. Les guides Fleurbec commencent à se promener dans les mains des randonneuses et randonneurs, et des botanistes à partir de 1975, en initiant plusieurs à la reconnaissance des plantes indigènes autour de nous. Où se situe donc Elsie
Reford dans la culture et la mise en valeur des plantes indigènes de la vallée du Saint-Laurent? Autodidacte, elle commence son jardin à l’été 1926. L’histoire familiale raconte qu’Elsie, alors atteinte d’une appendicite, doit laisser de côté pour l’été sa vraie passion, la pêche au saumon. Le jardinage est conseillé par son médecin; une activité plus sereine pour une femme « fragile » en récupération de chirurgie. Elle a alors passé le cap des 54 ans.


32 ans de passion
Elsie Reford commence son travail de jardinière. Elle arrête seulement à la fin de l’été 1958, à l’âge de 86 ans. Tous les jours, ou presque, de mai à octobre, pendant 32 ans, ses carnets de notes témoignent de son amour pour le jardinage et de son intérêt pour les plantes et leur rendement à Grand-Métis. Elle réussit à implanter et à cultiver sur son domaine des dizaines d’espèces exotiques, la plus remarquée étant le pavot bleu provenant de l’Himalaya. Bien avant l’apparition des cartes de zones de rusticité des plantes d’Agriculture Canada, son jardin est un champ d’essai. « Trial and error » (essaierreur) est son guide. Son portefeuille et sa patience l’aident à implanter des espèces rares (et coûteuses) pour voir leur capacité à résister au climat du bord du fleuve
Saint-Laurent. Subissant un échec une année, on change telle plante de place (de même que de sol et de fertilisant) l’année suivante. Elle cumule les échecs, mais ses réussites sont nombreuses.
Dès la fin des années 1930, elle commence à partager ses succès avec les plantes dans des articles qu’elle écrit pour des revues spécialisées publiées au Royaume-Uni et aux États-Unis, notamment ceux de la Société royale d’horticulture de
Londres et de la North American Lily Society.
Le défi des plantes exotiques
Elles aussi jugées « fragiles », les plantes exotiques sont devenues pour elle un défi horticole sans pareil. Et malgré la qualité de ses jardiniers, elle vante surtout le climat comme l’allié naturel le plus aidant, car la neige hâtive l’hiver ainsi que la fraîcheur et l’humidité l’été offrent aux plantes exotiques les conditions idéales pour favoriser leur acclimatation dans un écosystème fort différent de leur habitat naturel. On calcule environ 3 500 espèces, variétés et cultivars dans sa collection, une collection qui a peu d’équivalent au Canada dans les années 1930, à l’exception du Jardin botanique de Montréal, des Jardins Burlington en Ontario et des jardins de Jennie Butchart à Brentwood Bay, près de Victoria en Colombie-Britannique. Même si le vocabulaire distingue la plante exotique de l’indigène, pour le jardinier ce clivage n’est pas important. Elsie Reford est plutôt motivée par le désir de pouvoir offrir une floraison sur une saison entière. Le jardin est une pièce de théâtre, il y a des vedettes horticoles et plusieurs acteurs dans un second rôle. On parle de plus en plus de « scénographie horticole », reconnaissant que le jardin et ses plantes sont un ensemble et que la jardinière ou le jardinier est à la fois auteur, chorégraphe, metteur en scène et technicien. Les plantes indigènes et exotiques sont utilisées pour leur force et leur beauté, de même que les plantes annuelles sont incorporées pour ajouter couleurs de floraison ou de feuillage, hauteur ou parfum. L’aménagement de son jardin est aussi inspiré des principes et exemples du « wild gardening » ou jardinage sauvage, un mouvement né en Angleterre à la fin du 19e siècle, sous l’influence du jardinier et écrivain irlandais William Robinson, auteur du livre The Wild Garden (1870). Ce mouvement favorise l’intégration des plantes indigènes et exotiques.
L’importance des plantes indigènes
Les plantes indigènes sont importantes aux yeux d’Elsie Reford. Au début, elles jouent un rôle secondaire. Avec le temps, elle apprend que certaines plantes d’ici sont essentielles. Par exemple, bien avant que les recherches des dernières décennies établissent le rôle et la relation entre les arbres et les mycorhizes dans la croissance des racines des plantes, elle lutte pour préserver les arbres. Les épinettes, mélèzes, cèdres, bouleaux, peupliers et sorbiers ne sont pas coupés, mais plutôt préservés pour offrir une protection aux plates-bandes et espèces qui poussent à leurs pieds. Leur forme et leur écran vert offrent aussi une arrière-scène fort importante pour mettre en vedette les espèces pleines de couleurs. Des arbres exotiques, notamment des pommiers, pommetiers, marronniers, noyers et aubépines sont ajoutés pour bonifier la forêt de feuillus.
Un vaste terrain de jeux
Dotée d’un domaine de près de 1 000 acres avec des boisés, des champs, des cours d’eau et les rives de la rivière Mitis sur plus de quatre kilomètres, Elsie Reford ne manque pas d’endroits pour prélever des plants dans leur milieu naturel. Mais ses explorations en « touring car » (voiturette de tourisme) pour montrer les beautés de la région avec ses invités·es sont transformées en explorations botaniques. Elle fait souvent la cueillette en milieu naturel (ce qui est fortement déconseillé et même contraire à la loi aujourd’hui). Souvent, son carnet indique que ses yeux d’horticultrice sont toujours en alerte. Et que sa pelle, sa truelle et son seau ne sont jamais loin. On a donc des talles de cypripèdes (Cypripedium parviflorum) et des colonies de fougères qui sont le fruit de ses explorations botaniques il y a plus de 80 ans. Son intérêt pour les orchidées indigènes, qu’elle a même légué à son petitfils Robert, qui explore avec elle les fossés et les boisés, a fait de lui un orchidophile et un ornithologue averti.

Son amour des lys engendre une de ses grandes déceptions comme collectionneuse, car le Lis du Canada (Lilum canadense), la seule espèce indigène du lys, ne lui offre que des échecs. Le lys pousse et fleurit pour elle, mais ne survit pas aux hivers. On a réussi à l’implanter ces dernières années, mais le criocère du lys, un insecte envahissant du Japon, nous offre des défis qu’Elsie Reford n’a pas eu à relever. De domaine privé à jardin populaire
Le frère Marie-Victorin connaît bien la Gaspésie. Est-ce que l’auteur de la bible des plantes indigènes du Québec, Flore laurentienne, est une inspiration pour Elsie Reford? Leur correspondance est muette sur le sujet, mais on croit que MarieVictorin fait partie des « experts botaniques » cités dans son carnet, qui se sont arrêtés pour voir son domaine à Grand-Métis et qui l’ont quitté fort impressionnés. On sait que son bras droit, Henry Teuscher, architecte-paysagiste et concepteur du Jardin botanique de Montréal, s’y est arrêté plus d’une fois. Après une première visite en 1940, Teuscher et Elsie Reford s’échangent des plantes. Teuscher fait la promotion de l’œuvre d’Elsie dans ses conférences à Montréal et à New York. C’est grâce à son enthousiasme et à sa réputation que les jardins d’Elsie Reford ont été sauvegardés, ayant convaincu le gouvernement qu’un domaine privé aux portes de la Gaspésie pouvait devenir un jardin public et populaire.
Aujourd’hui, on reconnaît l’avantgardisme dans l’approche d’Elsie Reford. Son jardin est témoin d’une époque, mais aussi d’une approche écologique moderne. Elle était une femme exotique, mais qui s’est naturalisée. Son jardin demeure un heureux mélange de plantes de diverses régions du monde, dont bon nombre de la région qu’elle a transformées avec son jardin.