
magazinegaspesie.ca



magazinegaspesie.ca

inspiré par la nature, distillé avec passion.

LE MAGASIN GÉNÉRAL J. A. GENDRON DE PÈRE EN FILS
Paulette Cyr
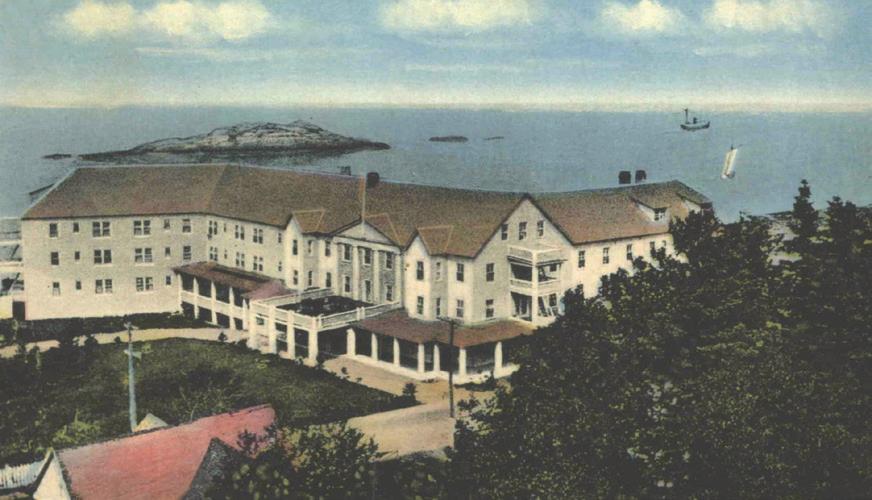
LES HÔTELS DE MÉTIS ET LEURS HÔTELIERS
Alexander Reford

Notre patrimoine
Avril – Juillet 2025 212, vol. 62, n° 1
DANS LES COULISSES DE LA RESTAURATION DE LA GASPÉSIENNE N° 20
Pierre-Luc Morin et Corentin Briand
Couverture
Thérèse Laflamme et Yvon Preston, gérant, dans la Coopérative à Rivière-au-Renard, années 1950-1960.
Photo : Ladislas Pordan
Musée de la Gaspésie. P268 Fonds Ladislas Pordan.
Armand Labbé
Éditeur
Pauline Cyr
Steeve Landry
Yolande Dubois
Christian
Joanie Robichaud
LA SCIERIE DE LA DISCORDE : LA CHALEURS BAY MILLS DANS LA COMMUNAUTÉ MI’GMAQUE DE LISTUGUJ
David Bigaouette
Michel
ENTREPRENEURIALE S’EMPARE DE L’ANSE-À-VALLEAU
Jean-Yves Dupuis
Nos archives
LA GASPÉSIE AU TEMPS DES MISSIONS –JEAN-BAPTISTE-ANTOINE RACONTE; LA SUITE
Marie-Pierre Huard
43 Nos objets
MARCEL LAMOUREUX : COLLECTIONNEUR DE CŒUR
Vicky Boulay
45
Nos personnages « OUHANDEURFOULE »
Jean-Claude Clavet 47
Nos évènements CURIOSITÉS À L’HÔTEL LEVER
Anne Sohier
SUIVEZ LE MAGAZINE SUR FACEBOOK!

Merci à nos employés qui ont déployé de multiples efforts afin d’accomplir les nombreux travaux de 2024.
L’année 2025 amènera son lot de défis mais l’équipe de la Société du chemin de fer de la Gaspésie sera prête à poursuivre le développement de ce merveilleux projet de transport ferroviaire régional!
Éditeur : Musée de la Gaspésie
Fondé en 1963, le Magazine Gaspésie est publié trois fois par an par le Musée de la Gaspésie. Le Magazine vise la diffusion de connaissances relatives à l’histoire, au patrimoine culturel et à l’identité des Gaspésiennes et des Gaspésiens. Il est membre de la Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP).
Comité de rédaction
Marie-Pierre Huard, Jean Lamarre, Gabrielle Leduc, Marie-Josée Lemaire-Caplette, Paul Lemieux et Jean-Philippe Thibault
Abonnements et ventes
418 368-1534 poste 104 boutique@museedelagaspesie.ca
Rédactrice en chef
Marie-Josée Lemaire-Caplette 418 368-1534 poste 106 magazine@museedelagaspesie.ca
Coordination et publicités
Gabrielle Leduc
418 368-1534 poste 102 coordo.direction@museedelagaspesie.ca
Recherche iconographique
Marie-Pierre Huard 418 368-1534 poste 103 archives@museedelagaspesie.ca
Rédaction et collaboration
David Bigaouette, Michel Bond, Vicky Boulay, Corentin Briand, Jean-Claude Clavet, Paulette Cyr, Pauline Cyr, Yolande Dubois, Jean-Yves Dupuis, Marie-Pierre Huard, Armand Labbé, Steeve Landry, Pierre-Luc Morin, Cynthia Patterson, Alexander Reford, Joanie Robichaud, Christian Roy et Anne Sohier
Conception graphique et infographie
Maïlys Ory
Révision linguistique
Ginette Haché
Distribution en kiosque
Jean-François Dupuis
Impression Numérix
Plateforme numérique magazinegaspesie.ca
Dépôt légal
Bibliothèque et Archives Canada, ISSN 1207-5280 (imprimé)
ISSN 2561-410X (numérique)
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ISBN 978-2-924362-42-6 (imprimé) ISBN 978-2-924362-43-3 (pdf)
Copyright Magazine Gaspésie
Reproduction interdite sans autorisation
Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada.
Toute personne intéressée à faire paraître des textes conformes à la politique du Magazine Gaspésie est invitée à les soumettre à la rédactrice en chef. Celle-ci soumet ensuite une proposition d’articles au comité de rédaction.
Le Magazine Gaspésie n’est pas un média écrit d’opinion, mais encourage le pluralisme des discours pour autant qu’ils reposent sur des fondements. Les autrices et auteurs sont responsables de leurs textes. Seuls les textes où cela est spécifiquement mentionné relèvent de l’éditeur.
Les textes sont écrits de manière inclusive afin de refléter son objet et son approche. Le vocabulaire épicène est utilisé autant que possible. Le Magazine Gaspésie applique la règle de féminisation par dédoublement et les graphies tronquées à l’aide de points médians. L’accord de proximité est utilisé à des fins de lisibilité.
Droits d’auteur et droits de reproduction
Toutes les demandes de reproduction doivent être acheminées à : Copibec (reproduction papier) : 514 288-1664 | 1 800 717-2022 | licences@copibec.qc.ca
Abonnement
1 an (3 nos) : Canada, 31 $ ; Hors Canada, 85 $ (taxes et frais de poste inclus)
Vente en kiosques
Prix à l’exemplaire : 10,75 $ (taxes en sus) - Liste des kiosques sur le site Web
Magazine Gaspésie
80, boulevard de Gaspé, Gaspé (Québec) G4X 1A9 418 368-1534 poste 106 magazine@museedelagaspesie.ca magazinegaspesie.ca

Encore aujourd’hui, la Gaspésie regorge de petits commerces locaux et d’entreprises qui sont nés à l’initiative de gens d’ici. Bien sûr, des chaînes s’implantent peu à peu dans la région, mais la longue tradition d’entrepreneuriat demeure. Que ce soit par nécessité, par désir d’être son propre patron ou par volonté de répondre à un besoin sans dépendre de l’extérieur, le nombre de Gaspésiennes et Gaspésiens qui se lancent en affaires est particulièrement élevé. D’un côté, il y a celles et ceux, débrouillards et vaillants, qui ont l’habitude de réaliser de petits miracles avec presque rien. De l’autre, il y a cette culture entrepreneuriale qui arrive avec les Anglo-normands·es, nombreux à s’établir en Gaspésie. Contrairement au catholicisme, le protestantisme valorise l’instruction ainsi que la réussite matérielle et financière. L’exemple le plus connu est évidemment Charles Robin, dont la compagnie est la deuxième entreprise ayant eu la plus grande longévité au Canada. Rappelons que la compagnie Robin, fondée en 1766, est présente en Gaspésie et dans les Maritimes pendant plus de 250 ans. Les entreprises se développent autour des piliers économiques gaspésiens, les pêcheries, l’industrie forestière et plus tard le tourisme, sans
oublier la panoplie de commerces de vêtements, de meubles ou de divertissements, ou encore ceux axés sur le service de proximité : épiceries, pharmacies, garages, soins esthétiques, etc. Le succès de ces entreprises demande de la part de leurs dirigeants·es un bon instinct, un esprit créatif, un goût du risque ainsi qu’une capacité d’adaptation et d’innovation, entre autres qualités. Que ce soit à petite ou grande échelle, ces entrepreneurs·es vivent des mésaventures et des réussites, en plus de subir les répercussions d’évènements extérieurs comme des guerres et des pandémies.
Comme c’est souvent le cas en Gaspésie, la « business » est une affaire de famille! Associés·es, employés·es ou même bénévoles, il n’est pas rare que plusieurs membres de la famille s’impliquent, sans compter les générations suivantes qui prennent la relève et permettent aux entreprises de perdurer dans le temps. Pensons aux McCallum, Lelièvre, Lemoignan, Bourdages, Goupil, Leboutillier, Tapp, et bien d’autres.
Parmi ces entrepreneurs·es gaspésiens, il y a des figures célèbres comme Ricardo Larrivée, natif de
Cap-Chat, qui se distingue dans le milieu culinaire, et Cora Mussely Tsouflidou, originaire de Caplan, qui propose des déjeuners dans ses multiples restaurants. Surtout, il y a des centaines de personnages connus dans leur village, et dont le parcours est inspirant, que ce soit le propriétaire d’un magasin général ayant peu d’instruction ou la gestionnaire qui lance une nouvelle offre sur le marché. Parce que, pour réussir en affaires, il faut aussi de l’entregent et de la loyauté, que ce soit en jasant avec la clientèle au comptoir, en dirigeant les ouvriers ou en entretenant des liens avec les partenaires et fournisseurs.
Ce numéro veut faire honneur à tous ces entrepreneurs·es qui affrontent vents et marées pour offrir des produits et services à la population locale, qui créent des emplois, qui font preuve de générosité en redonnant à la communauté et qui contribuent à la vitalité et même à la survie des villages. Au fil des pages, vous découvrirez certaines de ces petites et grandes initiatives qui ont marqué, chacune à leur façon, leur localité et leur époque.
Marie-Josée Lemaire-Caplette
Rédactrice en chef du Magazine Gaspésie, Musée de la Gaspésie
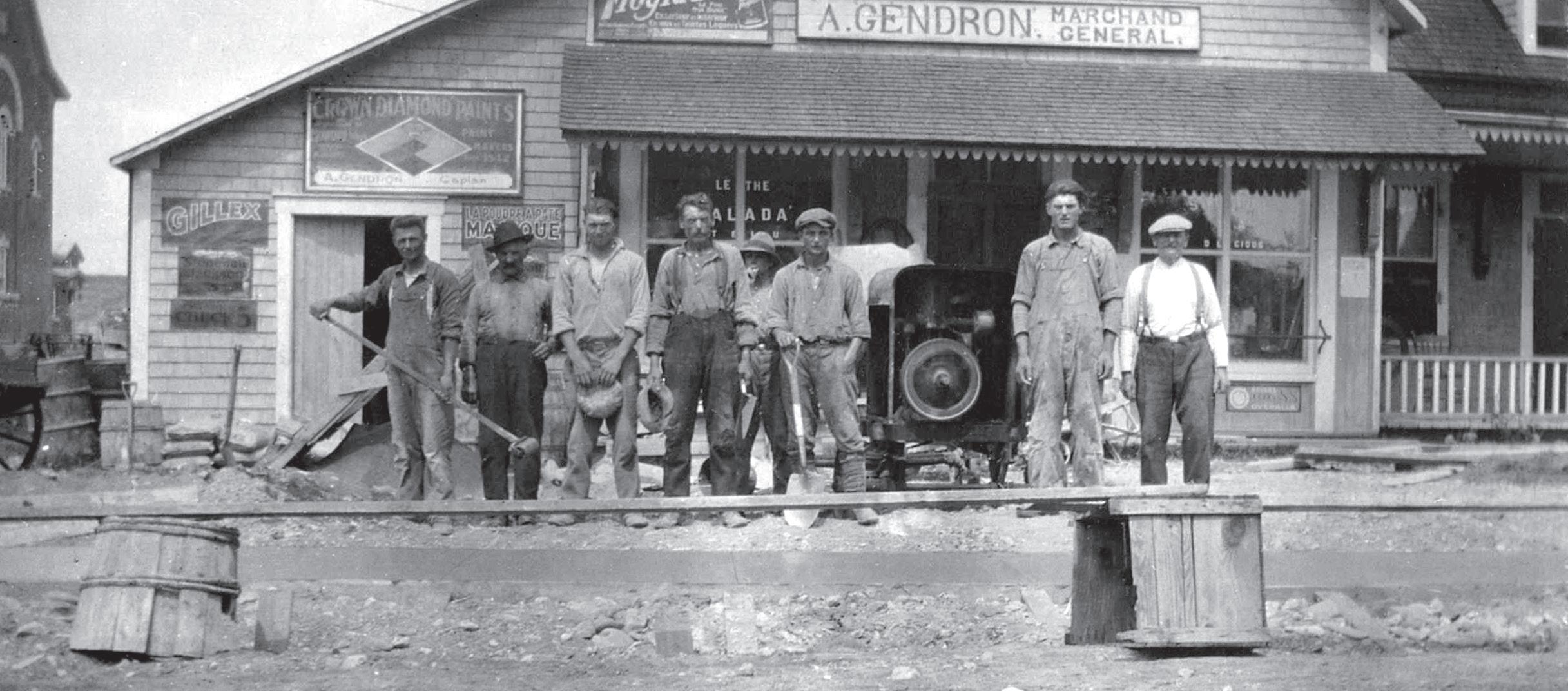
Magasin général J. A. Gendron, années 1920. On remarque sur l’enseigne « A. Gendron », qui deviendra plus tard « J. A. Gendron ». On y voit André Cyr (3e à gauche) ainsi que Joseph-Arsène Gendron père complètement à droite et le fils derrière avec son chapeau et sa pipe. Musée de la Gaspésie. Fonds J.A. Gendron. P283/2
Joseph-Arsène Gendron (1861-1950) prend officiellement possession de son magasin-résidence à Saint-Charles-de-Caplan (aujourd’hui Caplan) le 14 juillet 1917, une solide construction recouverte de bardeaux de cèdre à l’est de l’église. Au fil des ans, plusieurs bâtiments contigus ont été ajoutés à la structure initiale selon les besoins familiaux et économiques des occupants·es. Ces agrandissements donnent à l’ensemble un style architectural qui ne passe pas inaperçu. Aujourd’hui, le bâtiment est classé immeuble patrimonial par le ministère de la Culture et des Communications.
Paulette Cyr Passionnée d’histoire et résidente de Caplan
Originaire de Saint-Octave-deMétis et résidant à SainteFlorence dans la vallée de la Matapédia, Arsène arrive à Caplan accompagné de son épouse Amanda Sénéchal (1867-1944) et des deux derniers de leurs 15 enfants, Amanda, 13 ans et Joseph-Arsène, bientôt 8 ans. Le nouveau propriétaire est familier avec la Baie-des-Chaleurs, il a été commis voyageur dans la région pour la vente d’équipements de ferme.
Vente, troc et crédit
Sous l’enseigne « A. Gendron Marchand Général », Arsène père se
spécialise dans la vente d’instruments aratoires, et le commerce du bois de pulpe et de chauffage. Le marchand se ravitaille en divers produits manufacturés chez les grossistes de Québec et de Montréal. Il achète aussi des produits des agriculteurs ou échange des marchandises contre de la viande, de la volaille, de l’avoine, parfois du poisson et, surtout, des œufs qu’il expédie par centaines de douzaines à des grossistes de La Matapédia ou de Rimouski. Il faut avoir les reins solides pour supporter la vente à crédit omniprésente dans les affaires; l’accès aux liquidités est limité dans la
région et de nombreux clients·es font « marquer » leurs achats jusqu’au moment des récoltes, de la fin de la saison de pêche ou du retour du chantier forestier.
Une période sombre
Dès 1917, Arsène père est nommé juge de paix pour le district provincial de Gaspé, une fonction qu’il a exercée auparavant pour le district de Rimouski. Du côté financier, la situation se corse : la Loi sur l’impôt de guerre du fédéral pour le financement du conflit mondial touche à la fois au revenu particulier du marchand et à celui de son commerce. Cependant,


les tracas d’argent deviennent secondaires dès la fin de la guerre lorsque le cauchemar de la grippe espagnole frappe de plein fouet la population. Des gens de tous les âges meurent les uns après les autres. En octobre 1918, les autorités ordonnent la fermeture de tous les endroits publics pour un mois, même les églises, et tous les rassemblements sont interdits. Par bonheur, l’épidémie se résorbe au printemps presque aussi vite qu’elle est venue!
Amanda mère et Arsène père vivent une période sombre lors du décès de leur fille Emma en 1921. Déjà veuve à 20 ans, elle laisse derrière le petit Paul et les grands-parents se voient confier les soins de l’enfant. Le commerce étant intégré à la maison familiale, Amanda fille y travaille jusqu’à son mariage en 1922 et Arsène fils fait ses débuts comme aide, puis commis. Il commence à travailler au magasin pour de bon dès 16 ans et apprend tous les rudiments du métier sous la supervision paternelle. L’expansion donnée au commerce par Arsène père l’amène à tisser des liens avec les gens des environs. Le magasin est souvent le lieu de rencontre des villageois·es et des nouvelles de toutes sortes y circulent; il arrive même à l’occasion au marchand de jouer une partie de dames sur le comptoir avec ses amis.
Le gouvernement provincial inaugure en grande pompe le boulevard Perron (aujourd’hui la route 132) à l’été 1929; cette nouvelle route apporte une circulation inhabituelle. À l’automne, l’économie de la région subit toutefois les contrecoups du krach boursier. En peu de temps, le chômage augmente, l’industrie forestière est au ralenti et de nombreuses familles reçoivent l’aide de l’État.
Le temps des réjouissances À l’été 1930, Arsène fils (1909-1992) marque un grand tournant dans sa vie : il épouse Stella Lelièvre
(1908-1978) le 3 septembre à l’église Saint-Joseph de Cap-d’Espoir. Pour l’occasion, son père lui vend des parts dans le magasin général. Le jeune couple commence dès lors la vie commune dans la demeure des parents du marié. À la même période, l’électricité est mise en fonction pour les maisons du village en bordure du boulevard Perron et la famille Gendron profite enfin de ce service tant espéré.
Arsène père s’implique dans sa communauté en devenant membre fondateur du conseil d’administration de la caisse populaire de SaintCharles-de-Caplan en 1934. Les affaires au magasin reprennent peu à peu. Dans une lettre de présentation en tant qu’associé, Arsène fils écrit : « Je suis un homme d’affaires de Caplan qui se spécialise dans le commerce de détail. […] Quant aux articles que j’achète, ils me sont livrés par bateau ou par train. Je préfère toutefois utiliser le transport par bateau, car il est beaucoup moins cher. Imaginez, l’an dernier, en 1935, j’ai dû débourser 3 $ pour faire transporter une tonne de mélasse par bateau alors qu’il m’en a coûté cette année 14 $ par train. »1 Le chemin de fer ne produit pas les résultats escomptés dans la Baiedes-Chaleurs.
Amanda mère et Arsène père sont honorés à l’occasion de leur 50e anniversaire de mariage en 1935 avec une messe solennelle chantée en l’église
L’imposante bâtisse du magasin général J. A. Gendron à Caplan, années 1930-1940. Musée de la Gaspésie. Fonds J.A. Gendron. P283/2


Saint-Charles par leur fils, l’abbé Paul Gendron, curé de la paroisse de Sainte-Thérèse-de-Gaspé. Le 17 septembre 1938, le couple septuagénaire signe une donation en faveur d’Arsène fils. Ce dernier devient le seul propriétaire du magasin et de la maison attenante. Stella et Arsène fils sont maintenant parents de deux filles et un garçon. Au cours de l’automne, la municipalité installe des lampadaires au cœur de la paroisse, une innovation qui illumine le soir venu la façade du magasin et son enseigne.
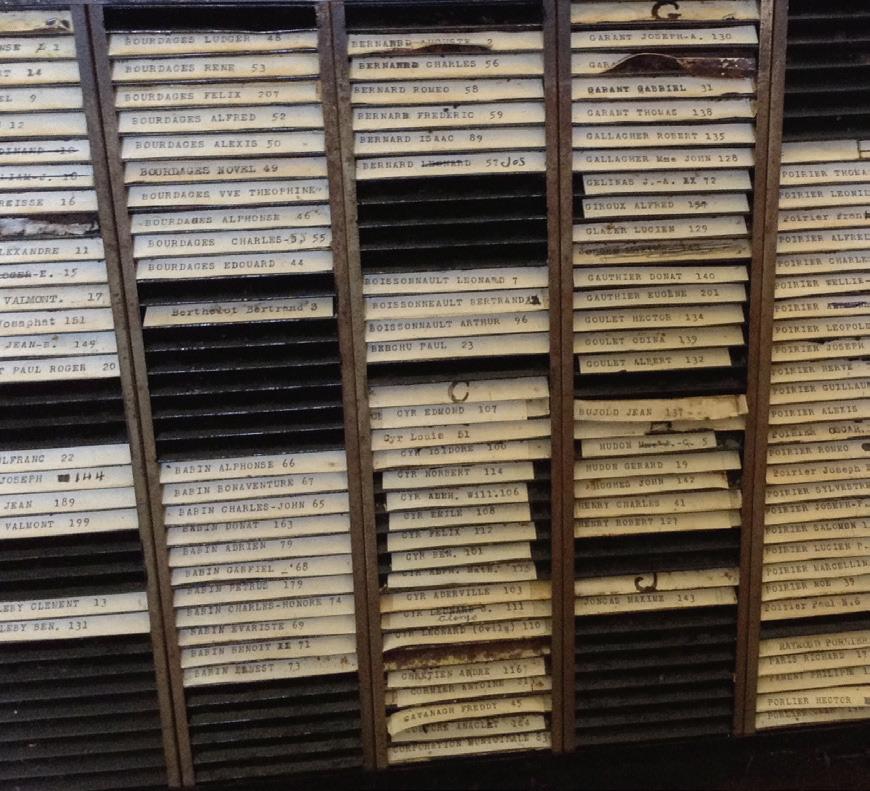
Une page se tourne
Dès que le Canada déclare la guerre à l’Allemagne en 1939, l’insécurité s’installe. Arsène fils doit faire des ajustements dans son commerce et suivre les recommandations de la Commission des prix et du commerce en temps de guerre puisque le gouvernement prend le contrôle de l’économie afin de freiner la hausse des prix. Pour sa part, le marchand doit composer avec les coupons de rationnement dès 1943; ses clients·es doivent présenter ceux-ci pour acheter, entre autres, du sucre, du thé, du beurre et de la viande. En 1944, le vent tourne en faveur des Alliés tandis qu’au Canada, la conscription imminente devient une vive inquiétude pour la population. Le Capitaine-abbé Paul Gendron est aumônier pour le 3e Bataillon de réserve des Fusiliers du Saint-Laurent lorsque sa mère décède le 7 août 1944 à l’âge de 77 ans. Les funérailles d’Amanda Sénéchal Gendron ont lieu à l’église Saint-Charles qui rassemble pour l’occasion de nombreux parents et amis·es dans la grisaille de la guerre. Stella et Arsène fils sont maintenant parents de cinq enfants et le marchand compte sur son précieux héritage pour assurer le bien-être de sa progéniture. Arsène père suit son épouse dans la mort le 18 août 1950
à 89 ans. L’église Saint-Charles est bondée de parents, amis·es, voisins·es, marchands·es, dignitaires et membres du clergé pour les funérailles. Son décès est souligné dans le journal L’Action catholique : « Une touchante manifestation d’estime a été rendue à la mémoire de M. Arsène Gendron, rentier et ancien marchand, de Saint-Charles de Caplan […] Le service fut chanté par le fils du défunt, M. l’abbé Paul Gendron, curé de Gascons. »2
Un page de l’histoire du magasin général J. A. Gendron est tournée avec le départ du patriarche; Arsène fils poursuit l’œuvre de son père. Aujourd’hui, le magasin général se trouve sur le site reconstitué du Village gaspésien de l’Héritage britannique, la pointe Duthie, à New Richmond où le bâtiment a été déménagé.
Notes
1. Josep-Arsène Gendron (fils), Lettre de présentation comme associé, 1936; Musée de la Gaspésie, Centre d’archives, P283 Fonds J. A. Gendron.
2. « Funérailles de M. Arsène Gendron », L’Action catholique, 28 septembre 1950, p. 18.

De gauche à droite : Armand Labbé, Isabelle
Donohue et Réal Labbé devant le premier magasin en bois dans la côte du Pic de l’Aurore, 1952. Collection Armand Labbé

Avec le recul, je constate que les divers magasins qu’a possédés ma famille constituent une belle aventure, surtout pour des gens peu instruits. Mon père, Roméo Labbé (1909-1995), n’a qu’une 4e année, et « feuble », comme il le disait. Dans ce temps-là, vers 1920, on commence à travailler jeune, car il faut aider à faire vivre sa famille. Mon père sait lire et compter; cependant, il écrit au son. Mais ma mère, Isabelle Donohue (1914-1993), possède une 7e année, et forte! Leur aventure commence dans les années 1930 dans les Failles (surnommé « Le Fall »), hameau d’une quinzaine de maisons situé près de Percé. Elle témoigne des débuts de la vocation commerciale de cette destination touristique en émergence, avec l’offre des « souvenirs de Percé ».
Armand Labbé
Fils d’Isabelle Donohue et Roméo Labbé, et originaire de Percé
Coke spécial pour les habitués
Depuis quelques années, mon frère et moi entendons parler, entre les branches, d’un coke spécial qu’aurait vendu mon père. Quand il en est question, je vois son visage se figer et ma mère pincer les lèvres. Mon père refuse d’en parler. L’affaire du coke spécial en reste donc là, même si elle nous intrigue… Mais un soir du temps des Fêtes, alors que mon père
a pris un ou deux verres de gin et ma mère un peu de brandy, mon frère et moi ramenons le sujet sur le tapis.
-Envoueille donc, Roméo, ça fait quasiment 50 ans de ça, dit ma mère.
-Penses-tu? demande-t-il, en retenant un sourire…
-Je vais vous le conter, mais farmezvous avec ça.
Mon frère et moi nous nous regardons discrètement… Nous allons enfin savoir!
-Dans l’Fall, dans les années 1930, dans le temps de la Crise, j’avais un p’tit magasin près du c’hmin, sur notre terrain. Je vendais des cigarettes, du chocolat, pis toutes sortes d’affaires; c’était comme un p’tit dépanneur. Les gens des alentours venaient aux nouvelles, pis jaser. C’est là que je vendais du coke spécial. Je prenais un coke, j’ôtais l’bouchon, j’ôtais un peu de liqueur, pis je la remplaçais par du rhum

blanc ou du whisky de contrebande; avec ma capeuse, je remettais un bouchon.
Mon père se sent tout à coup à l’aise de nous raconter cela et ma mère a des regards complices. La célèbre « capeuse », nous l’avions vue souvent, mon frère et moi; mon père n’a jamais voulu nous dire à quoi elle servait.
Mon père continue :
-Après, j’ouvrais une trappe dans le plancher, en arrière du comptoir, pis je mettais la bouteille au frette dans le p’tit ruisseau qui coulait en-d’ssour de mon magasin. Ceux qui le savaient pas pensaient qu’un coke spécial, c’était un coke frette. Mais ceux qui le savaient prenaient ben leur temps à le boire. Je le vendais dix cennes au lieu de cin’ cennes.
-D’où venait le rhum? demande mon frère.
-C’était du Saint-Pierre. On appelait ça du Moonshine parce que la rencontre avait lieu en mer à la pleine lune entre les gars de là-bas pis des pêcheurs. Y’avait pas de téléphone.
-Comment tu faisais pour avoir ça? -Ça, c’est une chose que j’peux pas vous dire. Y’avait du brandy, du rhum et du trois-dans-un. La boisson était tellement rare que parsonne ne les dénonçait. L’ouvrage, pis l’argent
étaient rares aussi. J’ai jamais pensé que je nuisais à parsonne avec ça et j’en vendais jamais plusse qu’un à quelqu’un par jour.
Coquillages de mer à vendre
Et l’aventure continue dans la côte du Pic de l’Aurore, entre 1945 et 1955, alors que nous habitons une maison de quatre pièces, que mon père a construite avec l’aide d’amis. Dans cette maison d’été, ni eau ni électricité, mais à proximité, un ruisseau. L’objectif d’Isabelle et de Roméo est de faire quelques sous « en vendant des affaires aux touristes » parce qu’il y en a déjà beaucoup qui descendent la côte pour arriver à Percé.
Au départ, vers 1950, mon frère Réal et moi, encore enfants, nous nous installons l’été, avec une petite table, le long de cette côte à forte pente, en gravelle. Il y passe des touristes en auto, plus rarement à pied. Les automobilistes doivent y penser d’avance avant de s’arrêter à notre petit commerce et certains·es reculent après avoir vu notre installation rudimentaire. Mais nous sommes les premiers du village à tenir ainsi boutique! Nous vendons des coquillages, des oursins et des étoiles de mer, que mon père ramène de la pêche. Nous avons aussi du tissage de ma mère et il nous arrive de vendre du pain chaud et de la bonne tarte aux pommes. C’est là que nous apprenons des rudiments de l’anglais; quand des touristes américains nous questionnent, nous avons la réponse suivante : « Wait a menute, I’m gonna get my mommy. ». Il faut dire que ma mère est bilingue parce que son père, un fier Irlandais, l’est, même s’il est illettré. Ce premier été, nous avons fait 15 $ (équivalant aujourd’hui à 187 $1), selon mon père. Puis, mon père construit une tente avec une toile de barge qui nous sert d’abri. Au moins deux fois, de forts vents la déménagent en bas de la côte, mais comme mon père a inventé la patience, nous la réinstallons… « Cinquante-deux belles piasses [586 $ de nos jours], les enfants, cet été », nous dit alors ma mère, fièrement.

L’année suivante, dès la fonte des neiges, mon père s’attelle à la tâche pour construire un magasin en bois d’environ 12 pieds sur 12 (3,7 mètres). On utilise le même comptoir rudimentaire, mais avec un tiroir pour l’argent et des tablettes. Nous avons même loué un « frigidaire » à l’eau, que nous allons chercher au ruisseau, pour offrir de la « liqueur ». Enfin, des commerçants itinérants nous vendent toutes sortes d’articles, que nous revendons facilement.
Nous avons ce petit magasin dans la côte du Pic de l’Aurore pendant deux ou trois étés. La maison familiale sert plus tard à construire le premier motel de la série que nous y voyons aujourd’hui. En 1955, mon père
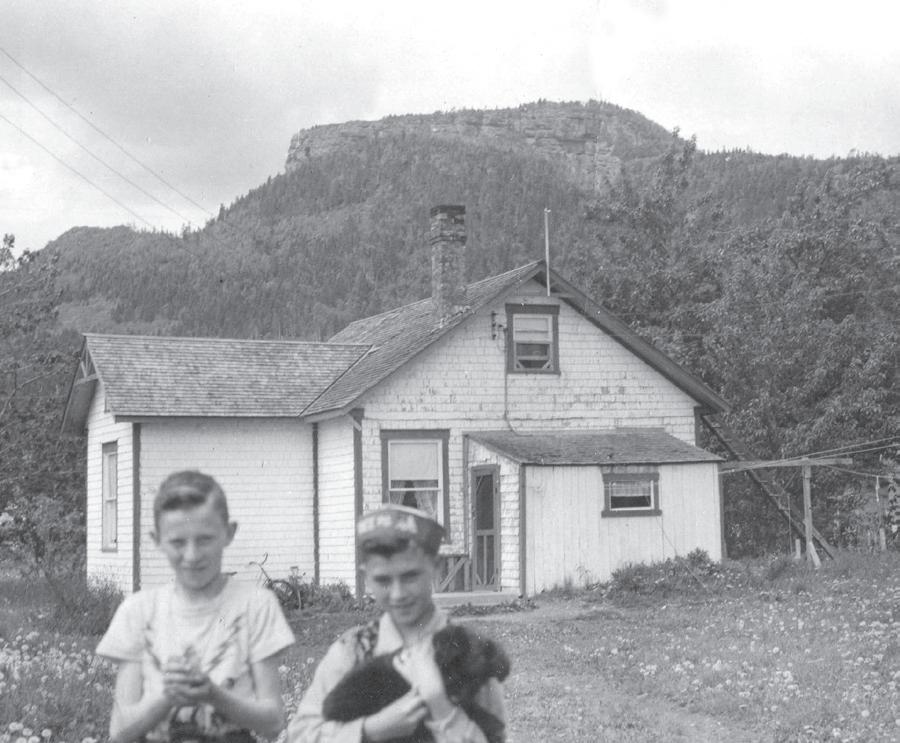

achète une résidence inhabitée depuis un long moment : 1 500 $ (équivalant à 17 000 $ aujourd’hui), rue de l’Église. Il veut nous rapprocher de l’école. Après une reconstruction, cette maison devient, en 2015, un atelier et un magasin de bijoux : Espace Wazo.
Souvenirs artisanaux
Après notre déménagement, mon père fait transporter le petit magasin par son ami de toujours et voisin, Raoul Narcisse-Bourget; tous deux placent la bâtisse sur un gros traîneau artisanal attelé à un tracteur. Mon frère et moi avons alors droit à une belle « ride »! Comme le magasin est alors situé le long de la rue principale, pas loin de la rue du quai, il y vient beaucoup plus de touristes. « On va ouvrir du matin jusqu’au soir, à 10 h et plus longtemps. » dit mon père.
D’un été à l’autre, mon père agrandit le commerce, si bien que le magasin original est devenu un petit entrepôt. Il y a toutes les commodités, plusieurs comptoirs, une petite caisse enregistreuse, un « cooler à liqueurs » et un à crème glacée, laquelle nous arrive de Matane par camion. Nous vendons aussi des cigarettes, des petits gâteaux, du chocolat, des chips, etc.
C’est aussi, comme nous le disons à l’époque, un magasin de souvenirs. Outre les choses importées que des vendeurs itinérants nous proposent, nous vendons des petits bateaux fabriqués par des artisans des environs. Nous offrons aussi des bijoux en agate, que montent mon frère et ma mère, et des épinglettes avec de petits coquillages collés avec une pince à sourcils. Mon père fait des cendriers, des lampes et même des maisonnettes en bois, ornés de petites pierres de la plage. Cela, sans autre outil qu’une scie à découper manuelle et un petit marteau. Autres exclusivités : les étoiles de mer vidées et séchées soigneusement et des morceaux de filet de pêche. Mon père sait aussi vider des homards et des crabes, dont il ne reste que la carapace.
Au milieu des années 1960, et à sa grande fierté, mon père quitte son emploi à la Coopérative où il gagne 0,50 $ (5 $ actuels) de l’heure pour se consacrer à la boutique : Au Coin du Souvenir. À partir de ce jour, il prend grand plaisir à expliquer aux touristes comment on piège les homards, entre autres secrets de la mer, et à parler de ses 22 laborieuses années de pêche à la morue à la rame. C’est pour lui et ma mère une grande satisfaction.
Un jour, en 1977, mon frère, Réal (1942-2002), propose à mes parents d’acheter leur commerce. Mes parents, tous deux dans la soixantaine, jugent alors avoir assez travaillé et acceptent volontiers. Un peu avant, en 1974, avec son épouse, Marguerite, Réal loue l’ancienne école anglaise protestante, sise à côté de la maison familiale, pour en faire La Boutique à l’Ancre. Puis en 1976, Marguerite et Réal construisent Le Goéland, qu’ils exploitent pendant 10 ans et où mes parents vendent encore leurs exclusivités. J’y travaille au moins cinq étés. En 1986, c’est la vente de la maison familiale et de celle voisine, appartenant à mon frère. Vente aussi du Goéland et cession du bail de l’école protestante, devenue L’Ancienne École. Tout ce beau monde quitte Percé, vers L’Ancienne-Lorette, en banlieue de Québec. Le Goéland change de mains deux fois et demeure à ce jour une boutique de souvenirs. On y voit encore le lettrage que j’ai dessiné et peint avec mon frère…
Note
1. Les équivalences dans les textes sont basées sur l’outil de calcul de l’inflation de la Banque du Canada.

Le
Boutiques Le Goéland et L’Ancienne École
Philippe John Mauger (1857-1941) quitte sa ville natale de Saint-Ouen sur l’île anglo-normande Jersey pour s’installer à Grande-Rivière en 1876, où il occupe un poste au comptoir de la Charles Robin & Company. Cette nouvelle vie est attirante pour le jeune homme, mais les conditions de travail sont difficiles : les Robin ne sont pas tendres avec leurs employés. Trois ans plus tard, il renonce à sa religion protestante et devient catholique afin d’épouser Rose-Délima Beaudin (1862-1944), une descendante du corsaire Léon Roussy. Philippe John Mauger perd toutefois son emploi au même moment, probablement en raison de son changement de religion. Il décide alors d’apprendre le métier de forgeron d’un ami qui est établi aux îles Saint-Pierre-et-Miquelon. À son retour à Grande-Rivière, Philippe John construit une forge où il œuvre le reste de sa vie. Le couple aura 16 enfants.
Un commerce familial
Un de leur fils, Émile (1880-1937), apprend les ficelles du métier et devient également garagiste. Malheureusement, il décède subitement et c’est son fils Adolphus qui prend la relève de la forge et du garage. À l’âge de 13 ans, ce dernier va étudier la mécanique automobile, la comptabilité, puis la soudure avant de revenir à 20 ans dans son village natal. Plus tard, son frère Lionel lui donne un coup de main. En 1941, la forge est agrandie et des pompes à essence sont installées, mais un incendie ravage l’installation au milieu des années 1940. Adolphus rebâtit le tout en béton et y ajoute une section pour vendre et réparer les appareils ménagers. Ce même hiver, les deux frères partent à Montréal apprendre l’électricité et la plomberie. Ils électrifieront, entre autres, les maisons environnantes. À noter que Lionel enseigne aussi la mécanique des moteurs de bateaux à l’école des pêcheries.

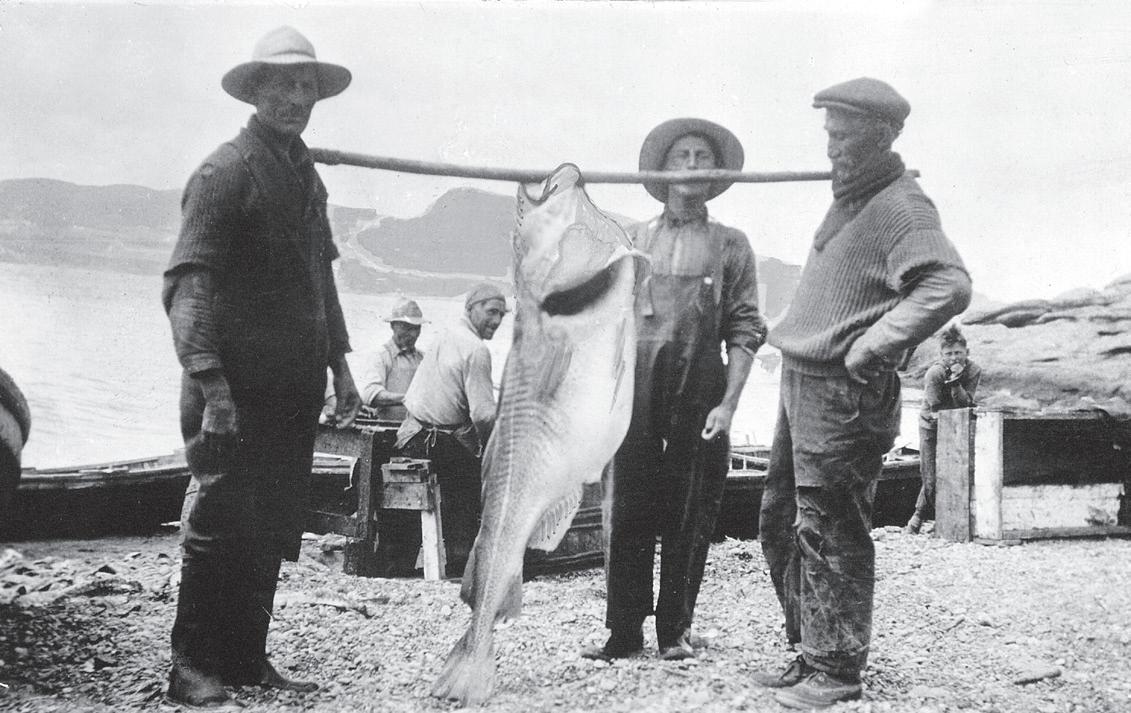
C’est à 16 ans que Jean-Louis, le fils d’Adolphus et de Rose-Anna Gagnon, commence à travailler pour l’entreprise. Passionné d’automobiles, il devient concessionnaire Ford en 1986. Le garage familial est ainsi réaménagé et l’espace triplé. Il construit également un atelier où il entrepose et répare les automobiles sous le nom Pièces d’auto JLM inc. De plus, Jean-Louis possède un garage à New Richmond, qui sera ensuite vendu, et un autre à Gaspé, devenant ainsi l’un des plus grands concessionnaires Ford de l’Est-du-Québec. Surnommé affectueusement le géant, Jean-Louis exploite toujours avec passion ses entreprises qui comptent plus de 100 employés·es sur la pointe gaspésienne.
En plus de Grande-Rivière, d’autres branches de Mauger descendantes des îles anglo-normandes se sont établies en Gaspésie, notamment à l’Île Bonaventure et à Paspébiac.
Recherche : Jean-Marie Thibeault
Rédaction : Marie-Josée Lemaire-Caplette
Direction : Julie Fournier-Lévesque


Coiffeur et coiffeuses à l’œuvre dans le Salon Heather à la place Jacques-Cartier à Gaspé, 1972. Heather Maloney est à droite.
Les petites entreprises constituent l’essentiel de la structure commerciale à Gaspé pendant des décennies. Le restaurant et les motels Adams, Les Breuvages Gaspé de McCallum, Photo Cassidy, White’s Bar and Motels, le magasin de tissus de Mme Allard ou le magasin de vêtements pour femmes de Mme Chrétien n’en sont que quelques exemples. Le salon de coiffure d’Heather Maloney fait partie du nombre.
Cynthia Patterson
Cliente d’Heather Maloney et résidente de Barachois
En 2002, Heather Maloney déclare dans une entrevue au journal The Gaspé Spec : « Je vise définitivement à célébrer mon 40e anniversaire! ». Décembre 2024, Heather passe en revue la table à dîner, recouverte d’affiches en carton faites maison, annotant au feutre des textes et des photos qui soulignent de nombreux évènements de sa vie professionnelle. Il y a 20 ans maintenant qu’Heather
a fêté ce 40e anniversaire. En 2025, elle souligne ses 60 ans à titre de femme d’affaires.
Le début d’une aventure
Heather est née à Douglastown en 1946, troisième enfant et première fille d’une famille de 13 enfants. En 1962, peu avant ses 16 ans, Heather quitte la maison, une décision pragmatique qui n’est pas rare à l’époque. Elle déménage en chambre et
pension pour 1 $ (équivalant à 10 $ aujourd’hui) par jour à Wakeham (secteur limitrophe de Gaspé). Elle a entendu dire que Joyce Patterson a besoin d’une personne dans son salon de coiffure de l’hôtel Baker pour laver les cheveux. Heather apprécie vraiment son été. Elle aime tout : le travail, le salaire, les pourboires et son environnement.
En 1964, Heather est résolue à obtenir les qualifications professionnelles

22 mai 1963. Grâce aux lettres de Dean, la Gaspésie semble moins loin. En raison de l’expérience professionnelle qu’Heather a déjà acquise, l’école de formation Mary Hue détermine qu’elle n’a besoin de suivre qu’un mois de cours. Le 29 janvier 1965, Heather reçoit son certificat et rentre chez elle pour rejoindre Joyce Patterson à titre de coiffeuse qualifiée. Une mise en plis coûte 1,25 $ (près de 12 $ aujourd’hui), une coupe et une mise en plis 3,25 $ (30 $) et une permanente 10 $ (94 $). Sa première cliente lui restera fidèle pendant 58 ans.

en tant que coiffeuse. Elle demande un prêt de 500 $ (environ 4 800 $ actuels) à la banque pour couvrir le coût du cours et, le 3 janvier 1965, elle se rend à Montréal pour la première fois. Tout est nouveau pour la jeune femme de 18 ans. Les membres de sa famille l’encouragent, tout comme les lettres quotidiennes de son petit ami, Dean Patterson. Dean est l’un des quatre survivants de la tragédie du pont Beaver Dam, sur la route entre Gaspé et Murdochville. Six de ses collègues de la mine de Murdochville sont morts noyés le
En 1966, Heather travaille pour Gérald Gagnon qui vient d’ouvrir un salon rue de la Reine. Elle est l’une des trois employés·es du salon et c’est la première fois qu’elle se retrouve dans un milieu de travail francophone. Gérald ne parle pas anglais et Heather ne connaît pas le français, mais la femme de Gérald, bilingue, travaille à proximité et aide Heather à s’intégrer.
Le grand saut
D’autres changements l’attendent. Quelques mois plus tard, Heather et Dean se marient. Deux ans plus tard, Heather, enceinte de son premier enfant, décide de faire le grand saut et, le 6 juin 1968, elle ouvre son propre salon indépendant à Gaspé. Elle embauche ses premières employées, quatre jeunes femmes. L’une

d’elles, assistante au lavage de cheveux, restera en poste pendant 18 ans. Désormais responsable du personnel, des commandes, des finances, etc., Heather apprend au fur et à mesure, en prenant soin de tenir méticuleusement ses registres quotidiens et en déléguant les services de paie et de comptabilité. Cet été-là, Heather ne prend que 10 jours de congé à la suite de la naissance de Stefanie, et développe petit à petit son entreprise.
En 1971 naît Craig, son deuxième enfant. Dix jours plus tard, elle reprend son horaire de travail du samedi au mardi, rapportant à la maison des sacs de serviettes à laver le soir. Toujours prompte à reconnaître les bonnes occasions, Heather est stratégique et demande à l’avance l’obtention d’un espace au sein du grand édifice en construction au centre-ville afin d’y déménager son commerce. Elle planifie le financement, la décoration et l’équipement de son salon qui, en 1972, est l’un des premiers commerces à s’installer dans le nouveau centre commercial de Gaspé, la place Jacques-Cartier. Ses journées sont longues et bien remplies, commençant à 8 h et se terminant à 16, 17 ou 18 h. Durant la période de Noël, des mariages et des remises de diplômes, elle commence à 6 h 30. C’est l’époque des paillettes d’or en aérosol!
En 1983, l’immeuble montre des signes d’usure et des rénovations s’avèreront bientôt nécessaires. Heather décide qu’il est temps de quitter son emplacement. Pendant deux ans, tel que convenu, Heather travaille avec la nouvelle propriétaire, Yvette Couture, tout en restant à l’affût des
possibilités. À cette époque, elle occupe aussi un deuxième emploi. Après avoir terminé son travail au salon à 14 h 30, elle se rend à la polyvalente et commence à 15 h sa tâche d’enseignante d’un nouveau programme de formation pour adultes en coiffure, dispensé par Manpower. Elle forme 22 étudiants·es, dont 14 obtiennent leur diplôme.
Le 1er février 1985, Heather ouvre officiellement le Salon Heather à Sunny Bank (secteur de Gaspé), qu’elle dirige toujours 40 ans plus tard. Le salon a nécessité un investissement financier important afin de procéder à un agrandissement de la maison familiale, comprenant une entrée séparée. Mais cette fois, elle a investi dans un immeuble qui lui appartient. La première assistante au shampoing du salon est sa fille, Stefanie. Des années plus tard, Chelsea, la fille de Stefanie, travaillera également avec sa grandmère pendant ses vacances d’été. Au cours de ses années d’activité, Heather sert des clients·es anglophones et francophones dans un rayon d’au moins 60 km (37 milles) et emploie 37 personnes.
Le cœur sur la main
Entre 1985 et 1990, Heather répond aux demandes des résidents·es en proposant des coupes, des mises en plis et des permanentes au centre de soins Monseigneur Ross. En 1998, elle ouvre un salon au Manoir St-Augustin, une résidence pour personnes âgées, où elle travaille tous les mercredis pendant 10 ans. Son engagement envers les gens l’amène à donner une permanente

à une personne hospitalisée, à offrir ses services à une personne à domicile souffrant de graves problèmes de santé et, comme elle le lui avait promis, à coiffer une fidèle cliente dans son cercueil.
La famille et la communauté ont toujours eu une place dans l’horaire chargé d’Heather. Elle trouve le temps de coudre et de tricoter 58 courtepointes et plaids, tous offerts en cadeau à des personnes confrontées à des difficultés ou afin de souligner des moments particuliers de leur vie. Elle se porte volontaire pendant 10 ans en tant que correspondante communautaire du Gaspé Spec, prend la parole lors d’une manifestation à l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes et revêt souvent un costume de père Noël. En 2020, Heather ferme temporairement son entreprise, comme des millions d’autres personnes, à cause du virus de la COVID-19. Avec Dean, son mari, elle conçoit 1 378 masques, qu’ils envoient dans tout le Québec et l’Ontario, et même en France, en les affranchissant à leurs frais.
Ces détails de la vie d’une femme forte, originaire d’un milieu rural, qui possède et gère toujours sa propre entreprise à Sunny Bank, nous sont parvenus parce qu’il y a des années, un client a offert à Heather un cahier de notes à la couverture fleurie. Motivée, Heather le remplit rapidement. Elle essaie d’écrire tous les jours et de rattraper son retard si elle saute une journée, à la même table où nous sommes assises aujourd’hui, alors que 10 carnets sont désormais complets. Ces pages

révèlent son énergie, sa détermination, sa persévérance, son autodiscipline, sa gestion efficace du temps, sa capacité à reconnaître les occasions et de s’en saisir avec promptitude. Elles révèlent également, enraciné dans la foi, son amour de la famille, de ses amis·es, de sa clientèle et de sa communauté.
Remerciements à Vision Gaspé-Percé Now et Jules Chicoine-Wilson pour la traduction.
Heather Maloney souligne ses 60 ans de carrière dans son salon de coiffure, 2025. Collection Heather Maloney VERSION
8-A, rue de la Cathédrale 418 368-2122
Magasin V. Cyr et fils inc. à Maria, années 1970-1980.
Collection famille Cyr

Valmore Cyr (1884-1967) commence à travailler très jeune à la ferme familiale à Maria pour aider son père malade. À 19 ans, il devient gérant d’une beurrerie qu’il achète plus tard, avant de la revendre à la Coopérative de Maria. Entre-temps, il ouvre une épicerie qui se transforme au fil du temps en magasin général. À 22 ans, il épouse Brigitte Fugère (1886-1908), qui lui donne une fille, Anita. Après le décès de Brigitte, il épouse en secondes noces Léontine Lucier (1880-1966), avec qui il a trois enfants : Eugénie, Alice et Charles. C’est ce dernier, seul garçon, qui reprendra le commerce paternel.
Pauline Cyr
Fille de Charles Cyr et Jeanne d’Arc Dionne, et originaire de Maria
Charles (1918-1986) suit son cours classique au Séminaire de Gaspé où il excelle en latin et en grec ancien, ses matières favorites. Il étudie aussi au Collège Brébeuf, puis au Catholic High School, tous deux à Montréal. Jeune homme, il rencontre Jeanne d’Arc Dionne à Maria, où elle vient l’été pour aider sa sœur aînée, Thérèse, épouse du Dr Martin, à prendre soin de ses nombreux enfants. Jeanne d’Arc et Thérèse sont nées dans le Maine, aux États-Unis, dans une famille productrice de pommes de terre. Le couple fait de longues promenades sur le quai de Maria, maintenant disparu, mais qui est alors le lieu tout désigné des rendez-vous romantiques. Le
21 juin 1944, Charles épouse Jeanne d’Arc et fait construire une jolie maison à côté du magasin. Ils y élèvent cinq enfants : Jacques, Henriette, Esther, Pauline et Charlotte.
Des hauts et des bas Valmore cède finalement le magasin général à son fils. Peu à peu, Charles V. Cyr et fils inc. se transforme en magasin de matériaux de construction. Comme les affaires sont florissantes, il ouvre un deuxième magasin à Dalhousie, au NouveauBrunswick, puis un à Bonaventure et un dernier à Amqui. En plus du commerce au détail, il se lance dans le commerce en gros. Tout comme son père, Charles fait preuve d’un excellent sens des affaires et s’avère
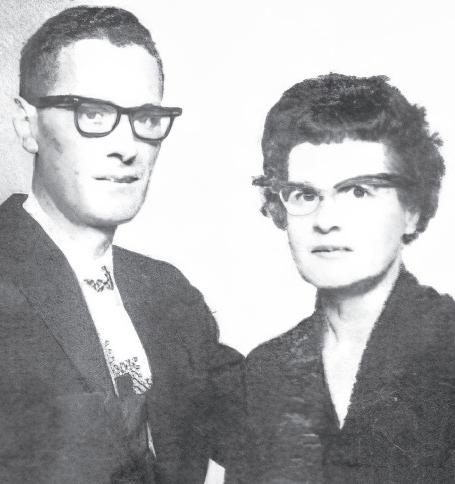

Photo : Charles-Eugène Bernard Musée de la Gaspésie. Fonds Charles-Eugène Bernard et Estelle Allard. P67/B/3a/2/60
un participant actif dans la prospérité du village. Sa contribution est fort bénéfique pour toute la région. Cependant, au cours des années 1970, sa réussite attire l’attention d’une personne mal intentionnée. Un homme d’affaires de MontJoli se présente à lui et une belle amitié se forge entre eux au fil du
temps, au point où Charles accepte de s’associer avec lui. Cet homme établit avec succès une stratégie de fraude à long terme, en convainquant Charles d’engager sa propre secrétaire au siège social, à Maria. D’importantes sommes d’argent sont ensuite détournées. Ce n’est qu’après plusieurs années que Charles découvre la trahison de son meilleur ami. Lorsque la supercherie est enfin révélée, le choc est dévastateur pour toute la famille! Cette épreuve ne sera toutefois pas la dernière.
Charles fait venir des wagons chargés de bois de l’Ouest canadien. Les livraisons arrivent directement à son entrepôt sur des rails construites à cet effet. Malheureusement, dans les années 1980, l’entrepôt est détruit lors d’un incendie possiblement criminel. Un autre coup dur.
L’absence de relève À l’approche de la retraite, Charles doit commencer à penser à la relève.
Son seul fils, Jacques, s’est fait frapper par une auto à l’âge de 6 ans, accident qui lui a laissé des séquelles permanentes. Il lui reste quatre filles. Or, il lui semble inconcevable que son entreprise puisse être gérée par une femme. À l’époque, les femmes sont plutôt destinées à devenir mères au foyer. Charles n’a donc jamais songé à léguer l’entreprise à l’une de ses filles. Cependant, elles poursuivront des études universitaires à Québec ou Montréal et s’orienteront vers d’autres professions : notaire, restauratrice d’œuvres d’art, journaliste-traductrice, psychologue.
Charles se résigne donc à trouver un acheteur et choisit finalement de vendre son entreprise à un jeune homme de Carleton-surMer. Par la suite, l’entreprise, redevenue une quincaillerie, connaîtra d’autres propriétaires. Toujours debout, le bâtiment est présentement inoccupé.


Cap-Chat a connu plusieurs entrepreneurs·es et gens d’affaires au cours de son histoire industrielle. Certains·es sont natifs de Cap-Chat alors que d’autres, aux origines variées, s’enracinent dans la localité située sur la côte de Gaspé-Nord avec une telle ardeur qu’elle devient leur port d’attache. Sans réduire l’importance d’hommes et de femmes qui ont laissé une trace inoubliable dans d’autres domaines, personne ne marque autant l’industrie forestière que James « Jim » Russell (1900-1981). Sous sa gouverne, la James Richardson Company Ltd devient le plus grand employeur gaspésien dans les années 1950, prouvant ainsi que le véritable moteur économique de cette époque de l’histoire de Cap-Chat est l’industrie du bois. Cette industrie fait vivre, directement ou indirectement, la population pendant presque un siècle, soit de 1878 à 1976.
Steeve Landry
Auteur et originaire de Cap-Chat
James Gordon Russell est né le 16 août 1900 dans une maison située sur le « banc de sable » à Cap-Chat. Il est l’aîné de la fratrie du couple formé de Gertrude Grace Gordon et de John « Johnie » Stewart Russell (1870-1934), un industriel. Malgré les origines écossaises de ses parents, James est donc bel et bien un Gaspésien! Au début des années 1900, c’est à son père qu’est confié le développement des
installations de la James Richardson Company (J. R. Co.) à Cap-Chat. De nombreux moulins à bois de l’entreprise se trouvent sur un vaste territoire côtier s’étendant de Matane à Grande-Vallée. Johnie prouve rapidement qu’il est l’homme de la situation. Sous sa direction, l’entreprise capchatiennes progresse à un tel point qu’elle lui permet de faire construire sa magnifique résidence nommée « Blink Bonnie » sur une
hauteur de la localité en 1904. Johnie et son épouse Gertrude, respectivement originaires de Montréal et Sherbrooke, forment un couple aussi complice en affaires qu’en amour. Après une enfance passée auprès des autres jeunes de Cap-Chat et ses études à Lennoxville, James débute dans le monde des affaires dans les Maritimes avant de faire un séjour dans l’Aviation royale canadienne à l’âge de 18 ans.
Un dirigeant audacieux
Démobilisé en 1920, James « Jim » Russell entre à l’emploi de la J. R. Co. comme mesureur de bois, ce qui lui permet de côtoyer les bûcherons sur les différents chantiers de la compagnie. Durant la décennie suivante, il gravit plusieurs échelons, jusqu’à devenir un partenaire financier de son père et de son oncle Willie Russell en 1929. Au mois de septembre de la même année, il épouse Anne Stewart, une infirmière de Montréal venue à Cap-Chat pour prendre soin de sa mère. L’union est heureuse, mais le couple n’aura pas d’enfant.
Au décès de son père qui survient en 1934, James prend la direction des installations de Cap-Chat avec l’intention de faire de cette municipalité un centre important de fabrication, de transformation et d’exportation de bois de fuseau et de charpente en Gaspésie. Les défis sont grands, mais James Russell les surmonte avec succès, tout en préservant les emplois de centaines de personnes qui travaillent pour la compagnie. Même si la dépression fait perdre d’importants acheteurs canadiens à la J. R. Co. et que les stocks de bois s’accumulent pendant quelques années dans les cours des scieries, James Russell prend une décision qui sera déterminante pour l’avenir économique de Cap-Chat. Il décide de vendre une importante quantité du bois entreposé en dessous du prix coûtant. Cette stratégie d’affaires permet à la compagnie de poursuivre ses activités et à de nombreuses familles de traverser ces temps difficiles. Plusieurs
diront que même si les gens de Cap-Chat ont connu la pauvreté durant cette période sombre, ils n’ont jamais connu la misère. L’après-guerre apporte avec elle l’effervescence souhaitée sur le plan économique. Comme l’Europe doit se reconstruire, la demande en bois atteint des sommets inégalés, les carnets de commandes sont remplis et les différents moulins à scie de la région fonctionnent à plein régime.
Depuis les débuts de la J. R. Co., l’entreprise possède ses propres scieries, dont le moulin à bois de fuseau construit sur le delta de la rivière Cap-Chat, le moulin à boulot érigé à l’embouchure de la rivière près du premier quai et le gros moulin dont l’inauguration officielle a lieu en 1925. Pour répondre à la demande grandissante de ses clients internationaux, en particulier à celle de la J. & P. Coats, la compagnie James Richardson doit s’approvisionner auprès des propriétaires privés de moulins à scie. Ainsi, plusieurs ouvriers travaillent indirectement pour la compagnie à partir de leurs moulins aux Capucins, aux Méchins, à Saint-Octave-de-l’Avenir et à Cap-Chat bien entendu.
De 1934 à 1965, la population de Cap-Chat triple presque, atteignant 5 000 personnes avec la fusion du village et de la paroisse, et vit ses plus belles années de prospérité économique. Malgré les ravages de la récession des années 1930, James Russell trouve le moyen de tirer son épingle du jeu. Il investit dans diverses entreprises, guidé par de précieux conseillers.
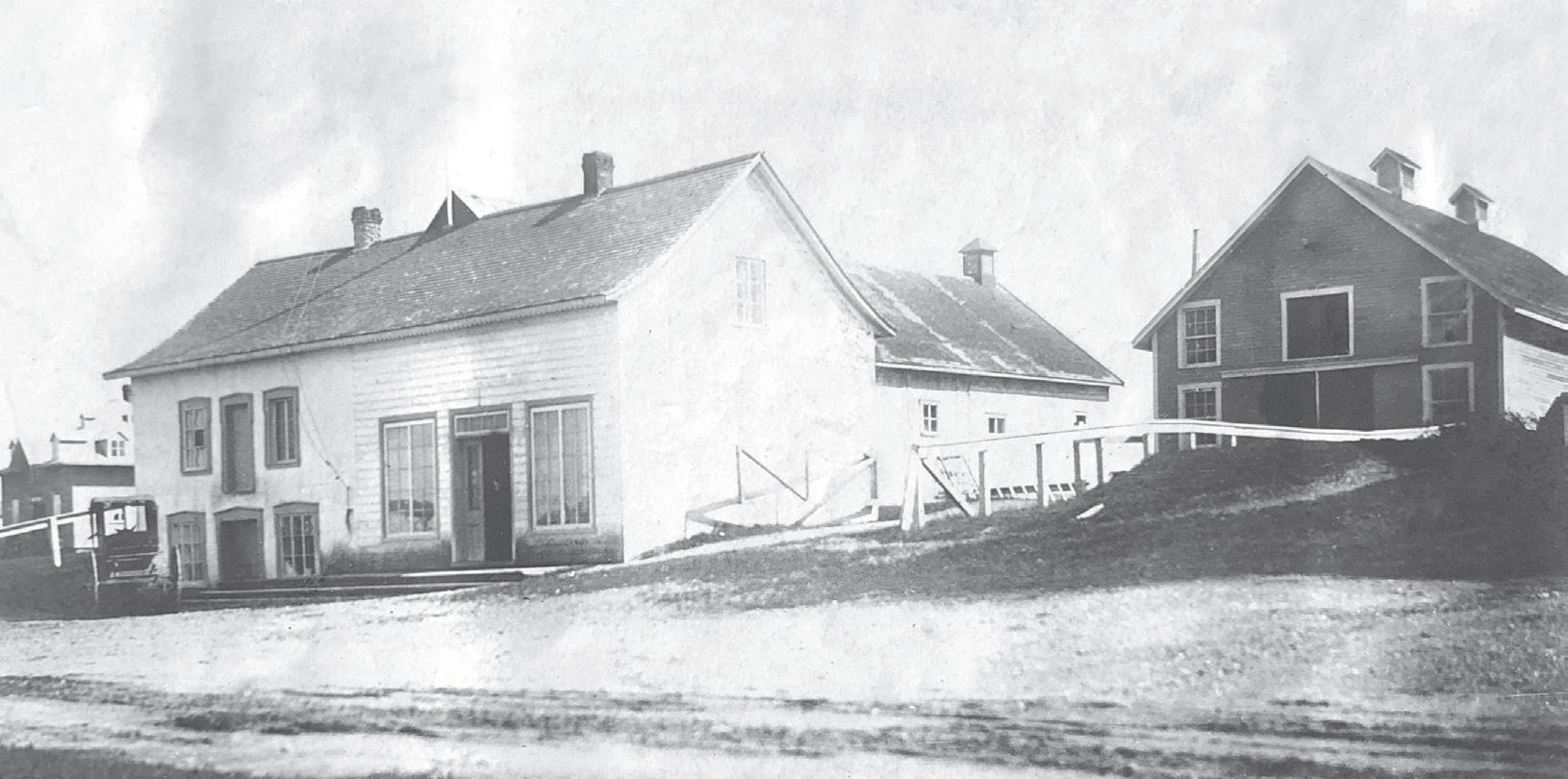
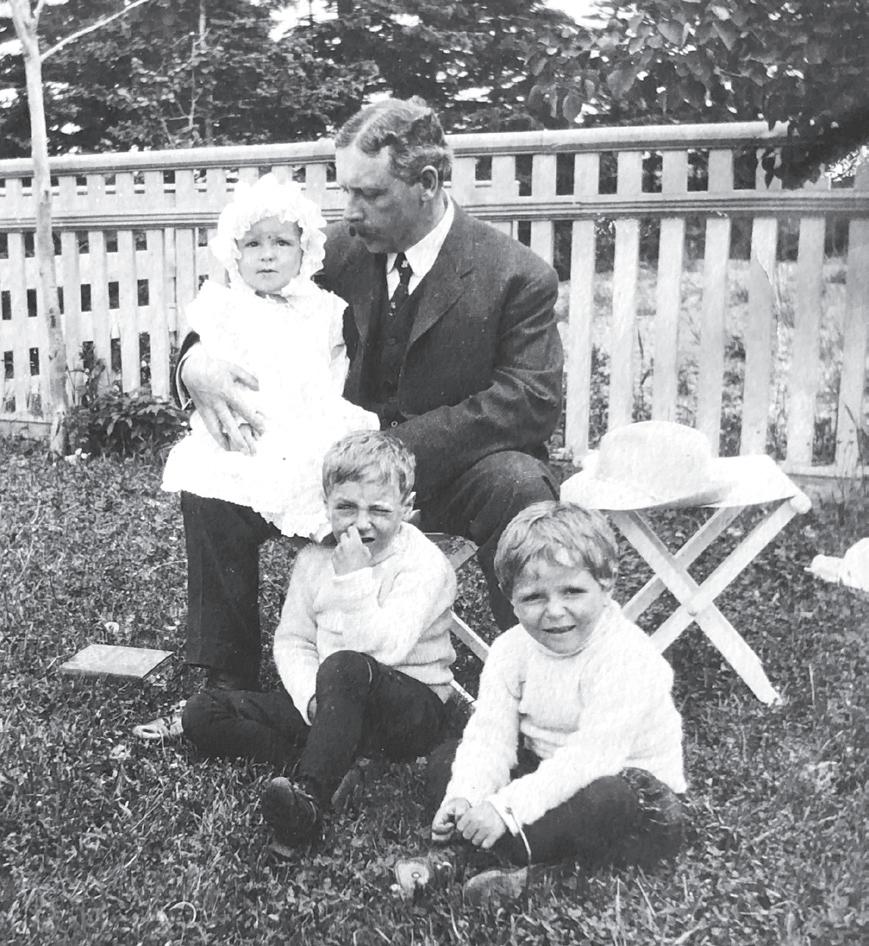
De fidèles alliés
Les principaux partenaires d’affaires de James Russell se trouvent dans son entourage immédiat. Ils travaillent déjà pour la compagnie ou sont des fournisseurs de biens et services. Parmi ceux-ci, on retrouve Louis Landry, avec qui il s’associe dans l’achat du magasin général de la rue Notre-Dame Est et lors de l’implantation du réseau électrique. Malgré l’impopularité de cette dernière entente auprès de la population, la décision du maire Louis Landry permet à la municipalité d’engranger un beau profit lors de la vente de son réseau à HydroQuébec.
Le magasin, l’entrepôt et les bureaux de la James Richardson Company, rue Notre-Dame Est à Cap-Chat. À l’extrême droite, on voit l’écurie de la compagnie.
L’homme d’affaires et capitaine Edgar Jourdain ainsi que le Dr Émile Pelletier s’associent aussi à James Russell dans la construction d’un quai en eaux profondes. Cette occasion s’avère fructueuse pour la J. R. Co. qui peut charger directement à Cap-Chat sa production de bois sur des navires transatlantiques de fort tonnage.
Un mécène généreux
Sur le plan social, les nombreuses implications de James Russell et de la J. R. Co. auprès de clubs et d’associations de la région font de lui, non seulement un mécène, mais aussi un dirigeant bien informé. Il n’hésite pas à investir dans la prospection des Mines Madeleine. Que ce soit

pour fournir tout l’équipement aux joueurs de hockey et de baseball, pour financer différents organismes ou comme bienfaiteur à vie de la Société historique de la Gaspésie (aujourd’hui le Musée de la Gaspésie), le nom de la compagnie James Richardson apparaît partout! Il entretient des liens durables, dont une grande amitié développée par son père avec le philanthrope Robert Samuel McLaughlin, président de la General Motors Canada, qui loue les droits de pêche au saumon sur la rivière Cap-Chat de 1908 à 1964. À la suite de l’incendie de 1951 qui détruit une grande partie de l’axe commercial du quartier du Faubourg, James Russell n’hésite pas à engager l’ingénieur Léo McLaren pour dessiner les plans du réseau d’aqueduc dont la ville décide de se doter pour éviter que pareille situation ne se reproduise!
Ironie du sort, c’est un incendie qui détruit le gros moulin de la compagnie en 1976 et qui provoque la fin de l’histoire de la James Richardson Company à Cap-Chat. On doit cependant se rappeler que c’est durant le règne de James Russell que la compagnie devient le plus grand employeur de la Gaspésie dans les années 1950. À de multiples reprises, il a l’occasion de montrer son appui à ses employés·es et à la communauté de Cap-Chat. Le président-directeur général de la James Richardson Company reçoit la médaille du Centenaire décernée par le gouvernement du Canada à ses citoyennes et citoyens les plus méritants. James Russell nous quitte en février 1981 à Cap-Chat après y avoir passé toute sa vie, et repose au cimetière de Pointe-Leggatt à Grand-Métis. Fier de sa personne, il se disait d’abord Gaspésien! Plusieurs anciennes et anciens de la région de
Gaspé-Nord gardent le souvenir d’un grand homme généreux et jovial. Le député à l’Union Nationale et maire de Cap-Chat, François Gagnon (1922-2017), dira de James « Jim » Russell qu’il était un gentilhomme et un citoyen d’élite incapable de dire non.
Pour en savoir plus : Les photographies de la collection Maud « Mollie » Russell sont conservées à la Société d’histoire de la Haute-Gaspésie alors que des archives et artefacts de la famille Russell y sont actuellement présentés dans le cadre de l’exposition Cap-Chat, 100 ans noir sur blanc.



Il faut d’abord avoir une vision et croire en ses projets; certains diront « un rêve ». Entreprendre, c’est partir de rien et saisir les occasions de bâtir de toutes pièces une entreprise capable de se développer et de relever des défis. Pour passer du rêve à l’action, il faut de l’innovation, de la persévérance, de la tolérance à l’incertitude et de la patience. Le chemin du succès est parsemé d’imprévus. Cette histoire, c’est celle de l’accomplissement de mon rêve : créer un centre de thalassothérapie.
Yolande Dubois Entrepreneure et fondatrice d’Aqua-Mer
Pionnière en région dans le monde des affaires
Je suis née à Sainte-Élisabeth-deWarwick dans le Centre-du-Québec en 1935 dans un milieu familial entrepreneurial où les femmes jouaient déjà un rôle déterminant. À 17 ans, j’ouvre mon premier salon de coiffure à Plessisville. Influencée par mes nombreux stages de perfectionnement en Europe, je propose à ma clientèle féminine et masculine des services nouveaux en coiffure, en esthétique et en bien-être. S’ensuivent des agrandissements et l’ouverture, en 1965, d’un deuxième salon à Victoriaville : les Instituts de beauté XXe Siècle, pour un total de 35 employés·es.
Expansion et innovation
Comme je le mentionne souvent : « En affaires, il n’y a pas de manuel d’instruction. On doit se faire confiance et se fier à son instinct. Chacun doit faire preuve de jugement, de perspicacité et d’audace. ». Je crée en 1973 le Laboratoire Thermyc, à Victoriaville et plus tard à Laval, spécialisé dans la fabrication de produits de soin de la peau de grande qualité. Ceux-ci sont rapidement reconnus en Europe. La création de la compagnie l’Estrel Diffusion permet à ces produits d’être distribués au Canada et aux États-Unis. Pour sa part, l’Académie d’esthétique Yolande Dubois se spécialise dans la formation
d’esthéticiennes et de thérapeutes, par des programmes de thérapies naturelles en esthétique. Cette institution offre par la suite de l’aide aux finissantes qui souhaitent ouvrir et gérer des instituts d’esthétique dans leur région respective.
Une croissance accélérée axée sur la mer
Mes formations en balnéothérapie et en thalassothérapie sont à la source de mon grand rêve : créer un centre spécialisé en thalassothérapie offrant des cures marines de remise en forme dans une approche globale, du jamais vu au Québec et même dans toute l’Amérique du Nord.

Avec mon conjoint, Jules Corriveau, je développe une nouvelle ligne de produits à base d’algues marines gaspésiennes : L’Estrel-sur-Mer, je mets sur pied le Réseau Aqua-Santé, et surtout, le 1er juin 1985, j’ouvre Aqua-Mer, le premier centre de thalassothérapie en Amérique du Nord, à Carleton-sur-Mer.
Le rêve d’une vie
Les qualités minéralogiques des algues marines de la Gaspésie nous ont incités à demander un permis à Pêches et Océans Canada pour la cueillette et la transformation d’algues et le développement de produits respectant les nouveaux principes esthétiques reconnus en Europe.
Pour faire de la vraie thalassothérapie, il faut absolument que l’eau de mer soit pompée au large des côtes et qu’elle soit en mouvement continu pour conserver son potentiel bioélectrique. Le climat marin est aussi un facteur déterminant dans une cure de thalasso. L’eau de mer, l’air marin et les algues contiennent des minéraux, des oligo-éléments et surtout des ions négatifs qui donnent de l’énergie à l’état pur. Les bienfaits d’une cure marine de cinq à six jours durent de cinq à six mois.
De nouveaux défis
Faire connaître les bienfaits des cures marines, globales et prolongées auprès d’un marché jusqu’alors attiré par des solutions rapides, presque miraculeuses, s’impose alors comme le défi de base. Conférences, articles et explications détaillées au début de chaque cure font peu à peu reconnaître les bienfaits du « prendre soin de soi ».
Pour combler les attentes des curistes, une formation spécialisée en milieu de travail est proposée à tout le personnel. Les domaines de l’hôtellerie, de l’animation, de l’entretien et de la restauration font l’objet également d’un encadrement professionnel. Ainsi, pendant 30 ans, des centaines d’employés·es dévoués et bien formés ont fièrement fait carrière chez Aqua-Mer et ont contribué au succès de l’entreprise. Une réussite qui n’était pas gagnée au départ avec les défis climatiques et les difficultés liées au transport de la clientèle vers une région si belle, mais si éloignée des centres urbains.
L’ouverture d’un deuxième centre de thalassothérapie, Aqua-Rive au Manoir Richelieu à La Malbaie, contribue aussi au rayonnement de la thalasso au Québec. Les deux centres sont à l’origine de l’ouverture des centres de balnéothérapie et de spas dans les villes et les régions de l’Amérique du Nord n’ayant pas un accès direct à la mer. Grâce à la formation spécialisée reçue à l’Académie Yolande Dubois, les Relais de la Mer voient le jour, permettant à la clientèle d’entretenir les bienfaits de leur cure plus près de leur milieu.
Ayant pris ma retraite en 2018 à l’âge de 83 ans, je suis rassurée de savoir qu’Aqua-Mer peut continuer sa mission depuis que j’ai passé le flambeau à Jocelyne Ouellet, exdirectrice du centre de thalassothérapie du Manoir Richelieu, ainsi qu’à son conjoint Jean-François Pilote.
Un succès consacré
Au fil des ans, le centre de thalassothérapie Aqua-Mer a accueilli des milliers de curistes, six mois par année. Ces curistes ont découvert et apprécié les bienfaits de la thalassothérapie et les beautés de la Gaspésie.
Dès 1986, nos entreprises sont reconnues au Gala Méritas, au Grand prix du tourisme gaspésien, et à plusieurs reprises, par les Mercuriades, ainsi qu’au Jeffrey Joseph Award International. Ces accomplissements sont mentionnés dans l’ouvrage Cent soixante femmes du Québec 1834-1994 et dans le palmarès 50 femmes de pouvoir du Centre et de l’Est du Québec présidé par l’honorable Pauline Marois.
Je n’ai pas cessé de croire en mon projet et ma passion m’a permis de persévérer afin de mettre sur pied Aqua-Mer, l’œuvre de ma vie. Pendant plus de 30 ans, avec mon associé et conjoint, nous avons attiré une clientèle de plus en plus nombreuse et de plus en plus diversifiée, contribuant ainsi au développement économique et touristique de Carleton-sur-Mer et de la Gaspésie. Je peux affirmer fièrement : « Mission accomplie! ».


« Avoir la bosse des affaires » désigne un talent naturel ou un flair exceptionnel pour les transactions commerciales. Plusieurs membres de ma famille, soit les Roy de Val-d’Espoir, ont certainement hérité de ce trait. Ces Roy, connus à Gaspé et dans ses environs pour leur esprit entrepreneurial, laissent assurément une empreinte dans la région.
Christian Roy
Arpenteur-géomètre retraité, fils de Noël Roy, et résident de Pointe-Saint-Pierre
MCes Roy entrepreneurs en Gaspésie
Tout d’abord, Alcide, cultivateur, éleveur et barbier, se distingue par
on grand-père Joseph (18891969), marié à Léa Bilodeau (1890-1973), s’installe à Vald’Espoir dans les années 1930, accompagné d’autres Beauceronnes et Beaucerons, qui sont réputés pour leur sens des affaires. Mon grand-père est un agriculteur et éleveur qui vend ses produits, comme des chevaux. Parmi sa descendance, plusieurs de ces Roy entrepreneurs partagent quelques traits communs. Ils n’ont pas ou peu d’instruction puisque ce n’est pas valorisé par grand-père. Toutefois, ils ont souvent épousé des femmes instruites. Mon oncle Denis, par exemple, est marié à une diplômée des Ursulines : la « célèbre tante Céline » des annonces Roy Nissan, propriété de son fils Jocelyn. Enfin, ce sont des gens résilients. Leur volonté d’entreprendre les pousse à relever constamment de nouveaux défis.
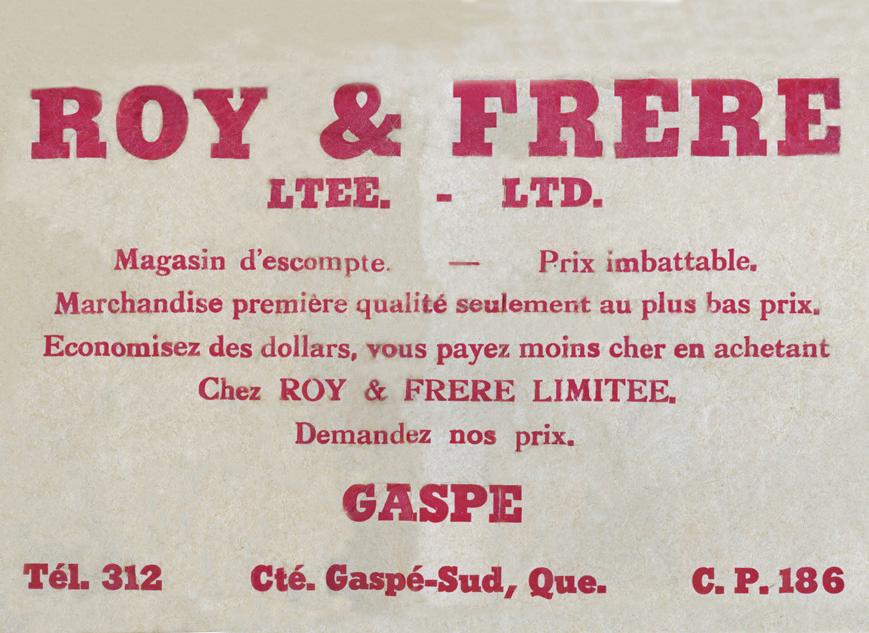
Publicité de Roy & Frère ltée, début des années 1960. Collection famille Roy
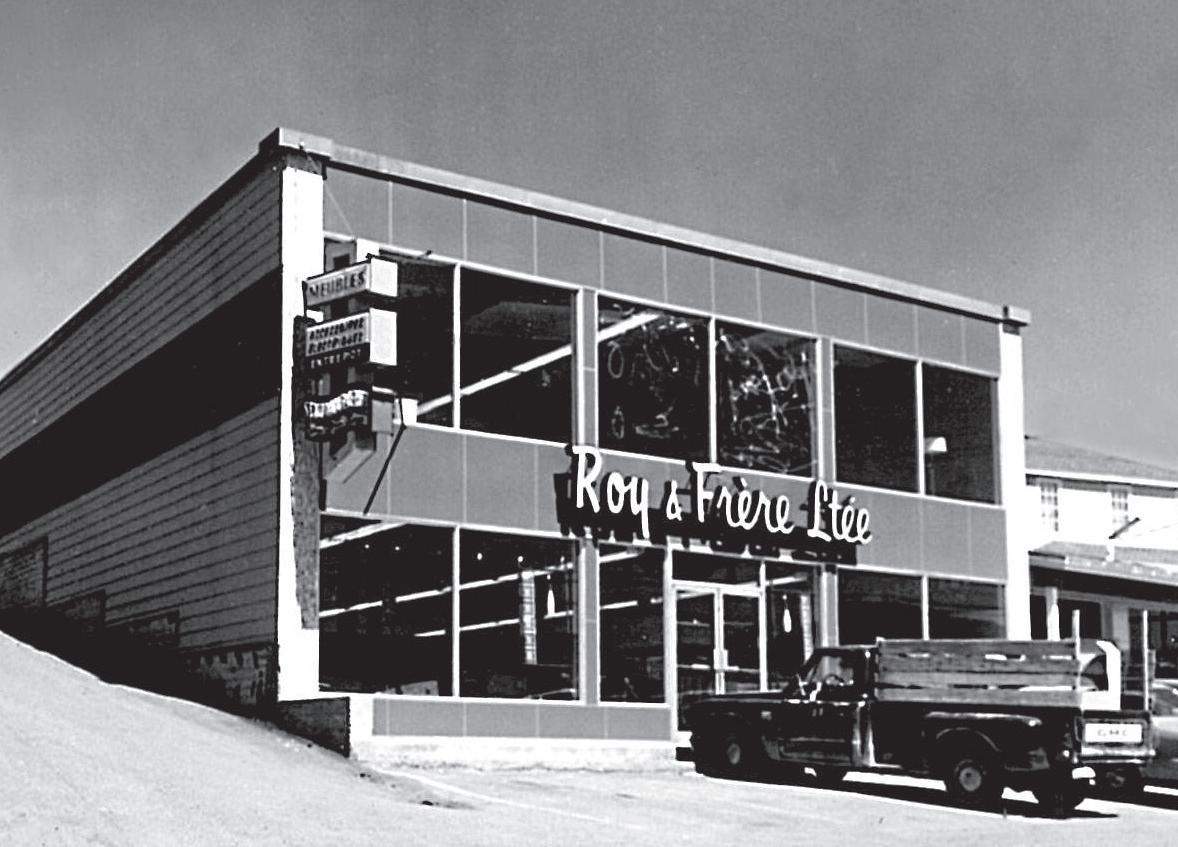
sa nomination comme « personnage historique » de Percé, avec ses fils : Clément, qui possède un dépanneur, et Lucip, propriétaire de plusieurs bars. Il y a aussi Henri, suivi de sa fille Doris, du camping Océan, qui tient un magasin général alors que son fils Laurent est le propriétaire de la quincaillerie Handy Andy, puis du Rona avec l’aide de sa femme Marguerite Pomerleau et de leur fille Jenny. Ensuite il y a Lucien, qui possède une épicerie. Ses fils suivent ses traces : Ghislain avec une tabagie et comme investisseur immobilier, Réal avec un magasin de sport, et Richard avec un dépanneur. Il y a aussi Denis et ses fils, Jocelyn et Alain, qui s’établissent dans le secteur automobile, opérant des garages Toyota, Ford et Nissan. Pour sa part, Émilien tient une quincaillerie, un garage automobile et un dépanneur.
Enfin, Noël, mon père, s’illustre dans la fabrication de portes et fenêtres, la restauration, la quincaillerie, la plomberie, le chauffage, les meubles et l’immobilier.
L’aventure de Noël Roy Noël est né en Estrie, à Saint-Hubertde-Spaulding, le 25 septembre 1924. Après la Deuxième Guerre mondiale, pendant laquelle il travaille à Arvida, il s’établit à Val-d’Espoir en ouvrant une petite entreprise spécialisée dans
la fabrication de portes et fenêtres, et ce, sur le terrain de son père au centre du village. Sa première grosse commande est la réalisation des portes et fenêtres de l’hôtel La Normandie à Percé. Il vend ce lot en 1953. L’année suivante, il acquiert un petit restaurant, un genre de « snack bar », équipé de « machines à boules ». Dans l’acte de vente, on précise que la vente comprend « trois tables de billard et les accessoires, un frigidaire pour crème glacée et le prélart sur le plancher ». Les affaires prospèrent, mais mon père, « jeune » avec ses 27 ans, décide de quitter Val-d’Espoir.
Il envisage alors d’ouvrir une quincaillerie à Murdochville. Comme ma mère, Gabrielle Beaudry (1931-2016), refuse de s’installer dans ce « lieu isolé », il décide de fonder, en 1954, Roy & Frère ltée, une quincaillerie rue Lesseps (rebaptisée depuis rue Chrétien), à Gaspé, avec son frère Émilien. Ils ont des moyens financiers restreints et doivent emprunter 10 000 $ (équivalant à 114 000 $ aujourd’hui) à leurs proches. Toutefois, mon oncle Émilien ne tarde pas à céder ses parts à mon père dans l’entreprise. La cause : une mésentente sur leur rôle respectif dans la marche des affaires… Il faut dire que ces Roy ont plutôt du caractère!
Cette quincaillerie se transforme en magasin général proposant aussi
des services d’électricité, de plomberie et de chauffage ainsi que des meubles et des vêtements. Finalement, Noël ouvre deux autres succursales, situées respectivement à Grande-Rivière et à Paspébiac, avec un total d’une quinzaine d’employés·es. Chaque année, au magasin de Gaspé, le père Noël offre des cadeaux à tous les enfants qui se présentent, comme dans les magasins de Montréal (Dupuis et Frères, Eaton, etc.). De plus, mon père commandite de nombreuses équipes de hockey et de balle molle. Le 31 décembre 1963, tandis que tout le personnel célèbre dans notre maison voisine de la quincaillerie, un incendie d’origine électrique ravage l’ensemble du bâtiment abritant le magasin. Il est fort probable que mon père n’a alors pas souscrit à une assurance incendie. Il décide donc de rebâtir rue de la Reine, où se trouve le cœur commercial de Gaspé.
Les péripéties s’enchaînent
En 1964, il réussit à s’implanter temporairement dans un petit bâtiment sis à l’emplacement actuel du restaurant Mastro. Enfin, il réussit à acquérir un beau terrain pour 7 500 $ (environ 70 700 $ de nos jours), situé au coin des rues de la Reine et Morin en 1965, à son nom personnel, et non pas à celui de la société. Ce détail, en apparence anodin pour qui n’est pas dans le domaine des affaires, aura des conséquences désastreuses plus tard. Mon père y érige une magnifique bâtisse, dont le rez-de-chaussée accueille une quincaillerie et le deuxième étage, un magasin de meubles. Pour financer sa construction, il contracte un prêt à son nom propre de 88 000 $ (équivalent à 801 400 $ aujourd’hui) auprès de la banque à un taux d’intérêt de 7,25 %. Les versements mensuels s’élèvent à 610 $ (soit 5 500 $ actuellement). Après quelques années, il fait face à des difficultés financières qui le forcent à « déposer le bilan ». Son montage financier fait en sorte que tout est à son nom personnel, Roy & Frère n’y étant mentionné que comme intervenant; tout y passe : Bâtiment du magasin Roy & Frère ltée, rue
le magasin et la maison. Mon père se retrouve sans rien du jour au lendemain.
Que faire avec huit enfants, dont je suis le plus vieux avec mes 15 ans, sans aucune perspective? Qu’à cela ne tienne, grâce à deux connaissances d’affaires, il peut acquérir un terrain à la sortie ouest de la ville, secteur aujourd’hui fortement commercial, mais qui, à l’époque, ne compte que deux commerces automobiles, soit Simpsons, et Williams et Kruse Automotives. Noël décide donc de bâtir un immeuble de deux étages, dans lequel notre nouvelle maison est intégrée. Cette construction est un véritable chemin de croix, mais elle mérite certainement d’être racontée. L’obtention du financement n’est pas une mince affaire : les institutions financières hésitent à accorder des prêts et les taux d’intérêt sont exorbitants. C’est finalement la belle-famille de

Noël qui contribue et, grâce aux efforts combinés du charpentier Jos Normand et de mon père, cet édifice voit le jour. Mon père exploite principalement un commerce de vente d’ameublement sous plusieurs noms, soit de façon chronologique : Centre d’Économie enr., Gaspé Électrique, Le Coûtant Plus et enfin Centre du Meuble Gaspé ltée. En outre, il loue plusieurs espaces, notamment pour un comptoir Simpsons-Sears, à Musica Couleur, à Électrolux ltée et enfin au Club Coop de Gaspé. Après une première tentative de vente de son immeuble ratée en 1974, il le vend finalement en 1978 à trois hommes d’affaires de Gaspé pour 180 000 $ (environ 765 600 $ actuels).
Néanmoins, en tant que locataire et agissant toujours sous l’enseigne Centre du Meuble Gaspé ltée, il poursuit la direction de son entreprise axée sur la vente de mobilier et d’électroménagers jusqu’en 1984.
La fin des affaires? À 60 ans, l’heure de la retraite a-t-elle sonné? C’est mal connaître le personnage! Il s’associe effectivement avec moi pour acheter un grand terrain au centre-ville, immeuble qui avait été acheté par le gouvernement du Québec pour déménager le palais de justice de Percé à Gaspé. On y fait un développement domiciliaire, et ce, de concert avec mon oncle Denis. Après avoir vendu ces immeubles, il vit alors une retraite paisible dans l’une des maisons qu’il a construites pour moi avec l’aide de mon frère Jean-Claude le long de la rivière
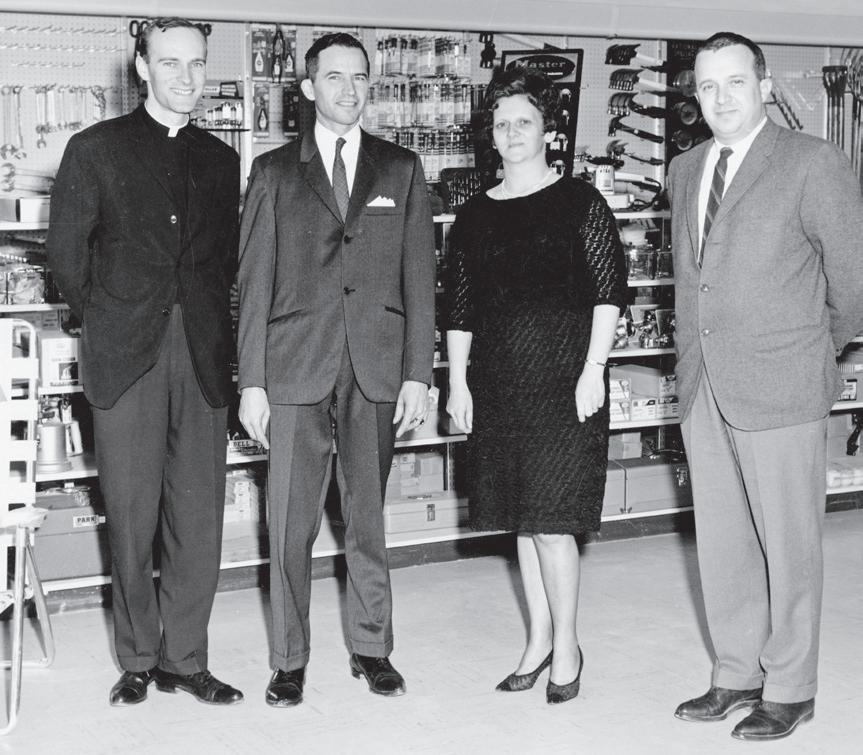
Saint-Jean. Eh oui, il bâtit, à temps perdu, des maisons pour ses enfants!
Le gène de l’entrepreneuriat est-il transmissible? Peut-être que oui. Les garçons de mes oncles Denis, Alcide et Lucien, tiennent commerce. Dans ma famille, Denise et moi avons eu notre bureau d’arpenteurs-géomètres et mon frère, Gilles, son bureau de consultant en génie électrique. Contrairement à son père, mon père ne nous a jamais poussés à suivre ses traces dans le commerce de détail et il nous a encouragés à poursuivre nos études aussi loin que nous le désirions.











En plus de sa vocation agricole évidente, Caplan a toujours été une communauté dynamique. Des premiers commerçants·es aux entrepreneurs·es modernes, les habitants·es ont cultivé un esprit d’innovation et un sens de la famille élevé. Ce riche héritage témoigne certainement de la créativité des Caplinoises et Caplinots à relever les défis pour continuer de se développer. Le côté entrepreneurial, mais surtout festif, des gens de Caplan s’est notamment transposé dans les commerces qui avaient pignon sur rue, le village ayant eu non pas un, mais sept bars en activité, dont cinq simultanément.
Joanie Robichaud
Consultante en communication et développement régional, et originaire de Caplan
Une vie nocturne prisée
Claudine Poirier est aux premières loges de cette effervescence puisque son père, Gervais Poirier, est le propriétaire de l’hôtel Petit Bocage, l’un des endroits les plus populaires de Caplan. « À la fin des années 1950, mon père a commencé à agrandir notre maison pour y annexer une salle à manger et des chambres, dans l’idée d’ouvrir un bar. Parce qu’à l’époque, on ne pouvait pas ouvrir un bar seulement, qu’on ap-
pelait un « grill », ça prenait aussi un motel », explique-t-elle. C’est l’esprit innovant de Gervais Poirier qui lui permet d’établir la réputation de son établissement. « Mon père était très brillant. Même s’il avait seulement une 2e année, il comptait tout dans sa tête, et quand il avait besoin d’écrire, c’est ma mère qui devait le faire. Pourtant, il savait toujours le nombre exact de chambres qui étaient louées ou de caisses de bières vendues. »

L’hôtel Petit Bocage est peut-être le plus reconnu des établissements de Caplan, mais il n’est pas le seul, puisque quatre autres bars sont ouverts dans les années 1970 : l’hôtel Le Manoir, l’hôtel des Sapins (auparavant appelé hôtel Kerr), l’Auberge de la Rivière (aussi appelé Chez Ludger) et Le Gaspésien.
Kathy Brière a, elle aussi, pu constater que les bars de Caplan sont des incontournables des années 1970 et 1980. « Mes parents sont revenus de la ville au début des années 1960 pour reprendre le commerce de mon oncle Arthur, se souvient-elle. C’était un hôtel situé en plein cœur du village. On a d’ailleurs été expropriés en 1976, pour faire passer la route 132. Aujourd’hui, quand on tourne pour aller jusqu’à SaintAlphonse, on est à l’endroit exact où était situé Le Gaspésien. » Son père, Guy Brière, a bien essayé de trouver une façon de conserver l’établissement, mais en vain. « Au départ, mon père voulait reculer l’hôtel, mais la municipalité voulait faire un parc. C’est mon oncle Fernand, qui habitait en face de chez nous, qui a décidé de transformer sa maison en un restaurant-bar. Mon père est finalement devenu son associé et c’est lui qui a géré l’établissement jusque dans les années 1980. »
Kathy Brière se rappelle également certaines particularités de l’époque. « Il y avait le côté hôtel, le côté bar, mais il y avait aussi le côté taverne du Gaspésien. C’était un endroit où les femmes n’ont pas toujours eu le droit d’entrer. D’ailleurs, les fenêtres étaient construites plus hautes,

justement, pour préserver l’intimité de l’endroit. »
« Quand il y avait des élections, ça brassait dans les bars, se remémore Martine Brière, qui a aussi travaillé au Gaspésien, l’établissement de son oncle. On n’allait pas dans les maisons, c’était dans les bars que les gens avaient leurs rencontres sociales, parce qu’ils pouvaient boire de l’alcool. » En 1985, les gouvernements du Québec et du Canada renforcent les lois contre l’alcool au volant, ce qui a des impacts sur les habitudes des gens, notamment en lien avec la fréquentation des bars.
Le Gaspésien a changé de mains quelques fois avec les années, puis l’établissement brûle en 2021 alors que le nouveau propriétaire de l’édifice, Fernand Robichaud, vient d’y installer les locaux de sa boucheriecharcuterie. Il en va de même pour l’hôtel Petit Bocage, détruit par les flammes en 2015, après avoir été une résidence pour personnes âgées durant plusieurs années. La majorité des autres bâtiments qui
Située sur un territoire mi’gmaq non cédé, la municipalité de Saint-Charlesde-Caplan est née, par résolution, le 1er janvier 1875, bien que deux générations y soient déjà installées. Une partie des habitants·es de l’époque sont des descendants·es des réfugiés·es acadiens installés à Bonaventure. Depuis, le territoire s’est peuplé au rythme des vagues d’immigration dans la région. Aujourd’hui, Caplan, dont le nom a été raccourci en 1964, compte près de 2 000 citoyennes et citoyens.
En 2025, Caplan célèbre son 150e anniversaire et plusieurs activités sont organisées pour l’occasion.
sont utilisés comme bars à l’époque sont toujours présents à Caplan.
L’hôtel Le Manoir est aussi devenu une résidence pour personnes âgées, tandis que l’hôtel des Sapins est aujourd’hui un établissement touristique (Auberge Cap Chaleurs), alors que l’Auberge de la Rivière a été transformée en immeuble à logements.
L’entrepreneuriat, de génération en génération De nombreuses fermes sont en activité sur le territoire, bien souvent gérées de père en fils. Des commerces qui traversent les générations marquent aussi l’identité de Caplan. C’est le cas de MJ Brière, spécialisé dans l’équipement agricole, qui vient de fêter son 50e anniversaire. La propriétaire, Manon Brière, a repris le commerce de son père, Magella, et ses deux enfants travaillent avec elle aujourd’hui. « Pour moi, c’était la suite logique, explique-t-elle. Mon fils, Alexandre, est maintenant actionnaire de


l’entreprise tandis que ma fille, Marie-Joëlle, vient de commencer et évalue s’il y a un potentiel pour elle, parce que c’est dans un domaine complètement différent de ses études. Elle est pleine d’idées! »
Dominique Cyr fait également partie des gens qui ont repris un commerce familial. « Ma mère, Roberta Dugas, faisait de la couture depuis l’âge de 14 ans et c’était un rêve pour elle d’avoir son entreprise. Et elle l’a réalisé avec Dom Tissus, mais sa santé ne lui permettait pas de continuer. C’est pour ça que j’ai repris le flambeau en 1997 et je n’ai jamais eu de regrets. »
Il va sans dire que l’histoire de Caplan témoigne d’une longue tradition entrepreneuriale où la détermination et le savoir-faire se sont transmis de génération en génération. Des commerces familiaux aux établissements emblématiques, chaque initiative reflète l’adaptation de la communauté aux réalités de l’époque. Aujourd’hui, plusieurs de ces entreprises existent toujours, portées par des descendants·es qui poursuivent le travail amorcé par leurs prédécesseurs·es. Cet esprit de transmission entrepreneuriale a certainement marqué l’histoire de Caplan et continue d’influencer son développement, tout en rappelant l’importance des liens familiaux et du rôle des entreprises locales dans la vitalité de nos villages gaspésiens.

Remerciements à Kathy Brière, chargée de projet pour le 150e anniversaire de Caplan, pour sa collaboration.


ABONNEMENT VERSION IMPRIMÉE OU VIRTUELLE
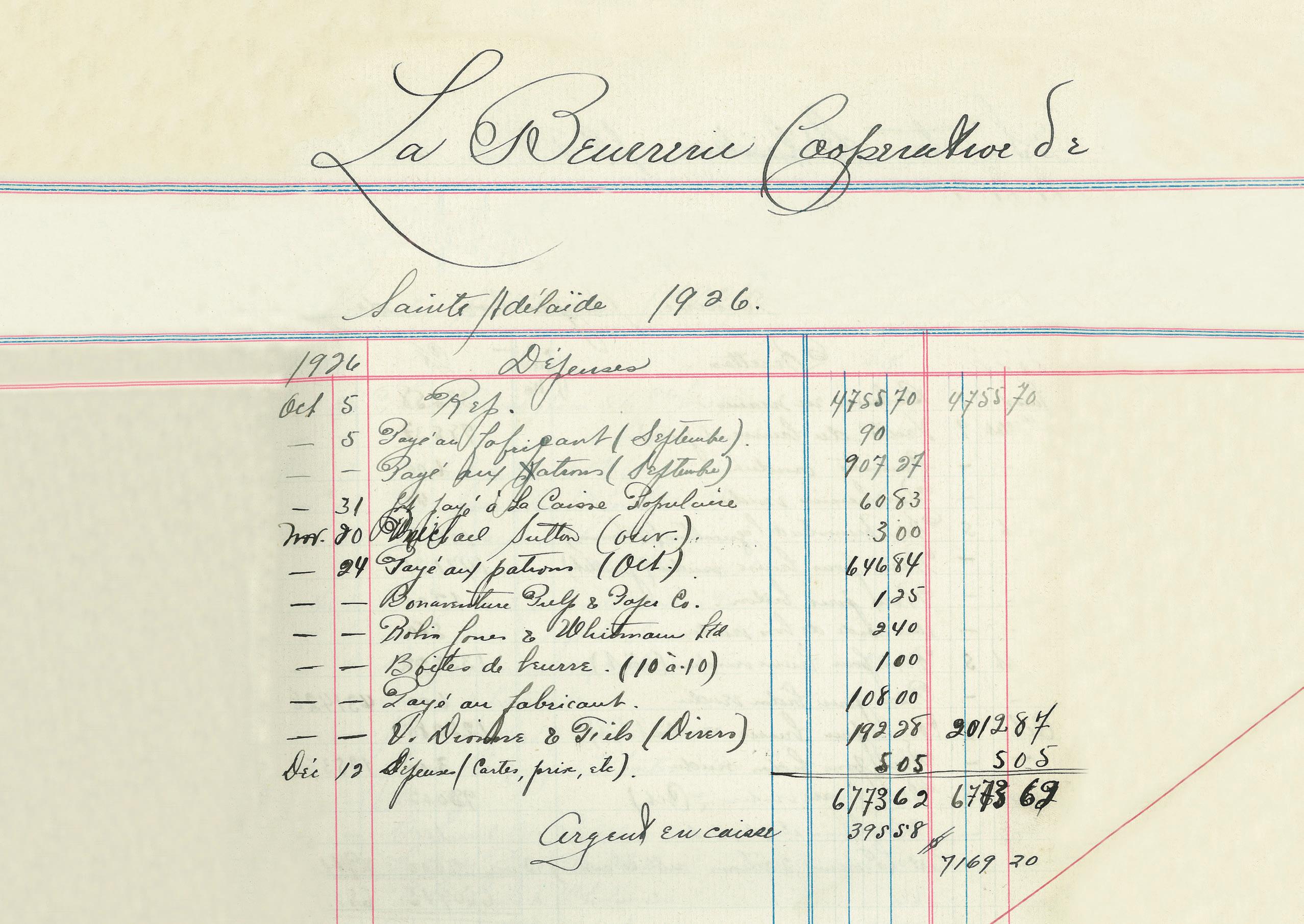
Extrait d’un registre de comptes, ici les dépenses, de la Beurrerie Coopérative à Sainte-Adélaïde-de Pabos, 1926.
Musée de la Gaspésie. Fonds Beurrerie Coopérative de Ste-Adélaïde-de Pabos. P10/2/1
De l’extérieur, l’imposante usine de transformation des produits de la mer impressionne, la vitrine de la librairie intrigue et la façade du magasin de jouets attise la curiosité. À l’intérieur, les étalages de produits et le sourire du personnel tentent de séduire la clientèle. Derrière la partie visible se trouve un bureau, généralement au fond du commerce, à l’étage ou encore à la maison, qui contient toute la « paperasse ». Avoir la bosse des affaires ne suffit pas! L’entrepreneur·e doit aussi être en mesure d’assumer les tâches de gestion et d’administration. Licences et permis, factures, comptes clients, ententes avec les fournisseurs, « slips » (bulletins) de paie, comptabilité et plus encore sont nécessaires au bon fonctionnement. Bien avant l’apparition des logiciels
sophistiqués, les registres sont tenus à la main, et sans calculatrice!, puis à la machine à écrire. Il faut donc savoir compter avec efficacité.
Les entreprises doivent également afficher leurs couleurs, que ce soit avec du papier à en-tête ou grâce à l’incontournable enseigne qui orne la façade. De plus, tout comme aujourd’hui, il faut attirer la clientèle. Les petites annonces dans les programmes de festivals ou autres évènements et dans les journaux locaux sont des plus populaires, tout comme les objets promotionnels aux couleurs du commerce. Les entrepreneurs·es doivent aussi user de ruses, entre autres, avec des systèmes de coupons. D’abord, des ententes sont réalisées entre une compagnie et le magasin général du coin, souvent la propriété de ladite compagnie, et
des coupons ou jetons échangeables uniquement à ce magasin sont remis aux employés·es. De même, des timbres-coupons sont en circulation et servent de monnaie. Enfin, la commandite est un moyen d’affichage répandu, particulièrement auprès des équipes sportives, tout en permettant aux commerçants·es de redonner à la communauté. Oui, il faut de l’audace pour se lancer en affaires et de l’instinct pour développer l’entreprise, mais il y a toute une partie invisible qui ne doit pas être négligée et qui nécessite des aptitudes. Dans les plus grandes entreprises, de nombreuses personnes assurent généralement les fonctions administratives, mais dans les petits commerces, c’est souvent la patronne ou le patron qui fait tout, avec l’aide de son entourage.
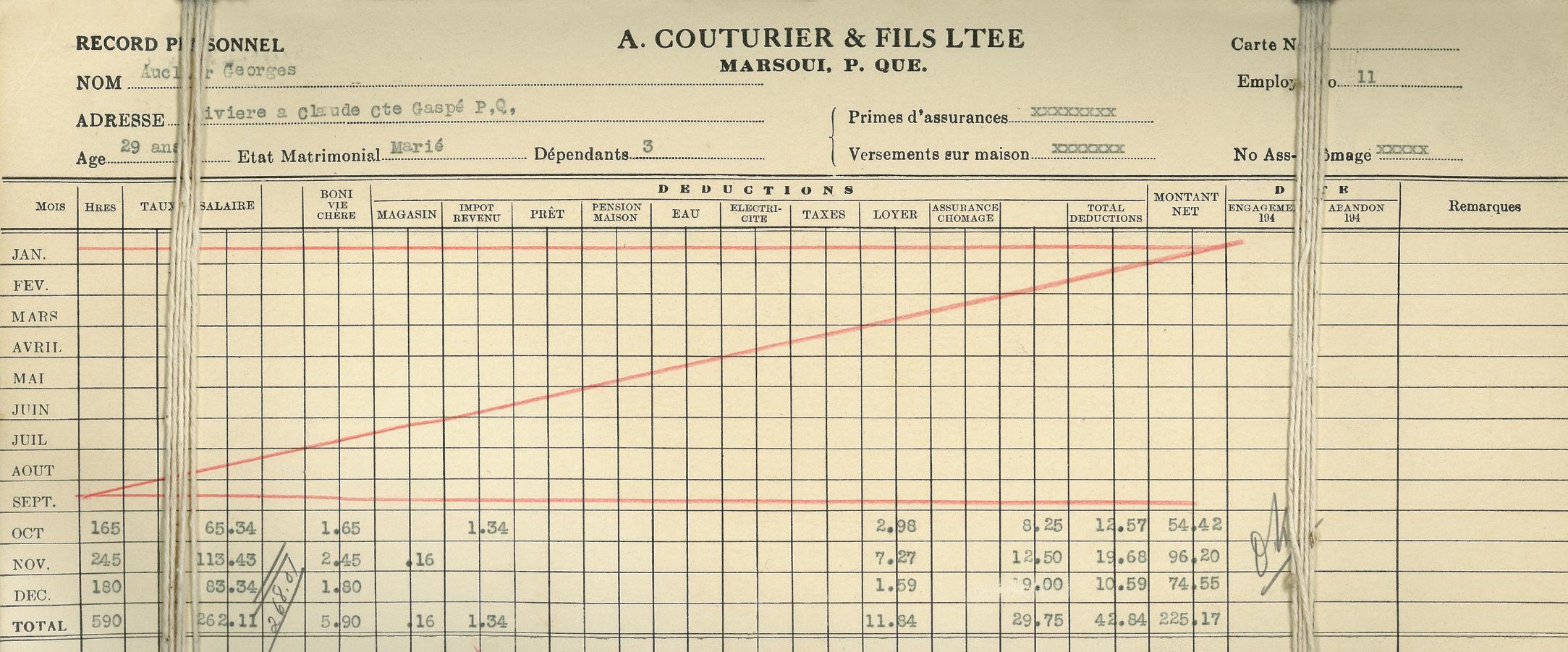




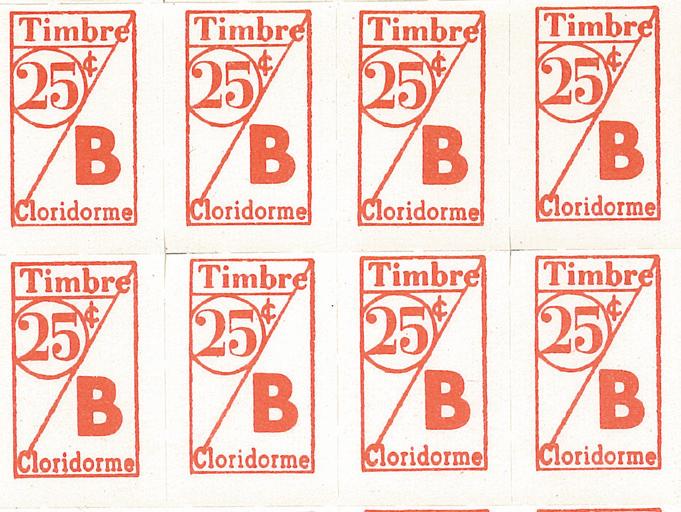
1. Bulletin de paie de Georges Auclair, de Rivière-à-Claude, employé d’Alphonse Couturier et fils ltée à Marsoui, 1944.
Musée de la Gaspésie. Fonds Alphonse Couturier. P231/11
2. En-tête de la Robin, Jones & Whitman Limited, 1934.
Musée de la Gaspésie. Fonds Robin, Jones and Whitman. P8/14/1/2/2,3
3. Enseigne de l’hôtel Pointe-Saint-Pierre fondé en 1933 par John Fauvel, puis racheté en 1936 par Hubert Cabot, qui le gère jusqu’à son décès en 1948, 1940.
Musée de la Gaspésie
4. Calculatrice mécanique provenant du magasin général d’Hermas Réhel à Bridgeville, vers 1960. Musée de la Gaspésie. Don d’Élaine Réhel
5. Extrait de la licence municipale accordée à William Anselm Tapp pour exploiter un magasin général à Barachois, 1958.
Musée de la Gaspésie. Fonds William Anselm Tapp. P27/8/37
6. Timbres de 0,25 $ permettant d’acheter au magasin général à Cloridorme.
Musée de la Gaspésie. Fonds Magasin général de Cloridorme. P207/5

Métis est autrefois la capitale de l’hébergement de la région. En 1929, lorsque le boulevard Perron ouvre et que le tour de la Gaspésie est inauguré, on compte plus de 500 lits dans plus d’une vingtaine d’établissements commerciaux à Métis. Son économie touristique n’a guère d’égale dans la région. Aujourd’hui, Métis dénombre à peine trois douzaines de lits dans seulement trois établissements commerciaux. Qu’est-il arrivé à cette destination balnéaire à la mode, aux portes de la péninsule gaspésienne?
Alexander Reford Directeur, Jardins de Métis
Métis possède une histoire touristique différente de celle des autres villages de la Gaspésie. Il est parmi les premiers villages riverains à envisager le tourisme dans son avenir. Dès 1849, on le vante comme une possible destination estivale. Lorsque les descendants·es du fondateur de la communauté, John MacNider, cherchent à louer ou à vendre la seigneurie de Métis en 1849, ils la présentent comme une destination santé où « on pourrait construire un hôtel pour accueillir les gens désireux de vivre à la campagne si le choléra faisait son apparition à Québec l’été prochain. »1
Hôtel Turriff, premier établissement touristique
Ce sont les « voyages aux eaux salées » qui attirent les premiers touristes. Les croisières au départ de Québec sont offertes une fois par été à partir de 1856. Les voyageuses et voyageurs descendent du bateau à Rimouski et font le trajet en calèche jusqu’à Métis. Ils logent dans la maison d’un fermier écossais dont la porte d’entrée donne sur le Saint-Laurent. L’été suivant, Robert Turriff fait la publicité du premier établissement touristique commercial : « l’hébergement est bon et la table est garnie de ce que le pays peut offrir de meilleur. »2
Le coût est de 5 $ (environ 200 $ aujourd’hui) par semaine pour une occupation simple et 4 $ pour une occupation double à l’hôtel Turriff. Cependant, tout le monde à Métis n’est pas satisfait. Comme les bateaux à vapeur arrivent à Rimouski un dimanche, ceux qui les amènent à Métis en calèche doivent travailler durant cette journée. C’est « un obstacle insurmontable pour ceux qui désirent sanctifier ce jour »3, écrit un auteur anonyme dans les pages du Montreal Witness Turriff est un descendant de l’un des premiers colons de Métis, l’un des quelques Écossais que John MacNider a incités à émigrer pour
s’installer dans sa seigneurie. Entrepreneur né, Turriff possède une propriété agricole qui s’étend en retrait de la seule plage de sable sur le rivage rocheux, ce qu’on appelle aujourd’hui « Turriff’s Beach ». Moins d’un an après l’ouverture de son premier établissement, il annonce avoir construit une « nouvelle maison » pour accueillir les visiteuses et visiteurs « agréablement située sur une pointe de la baie de PetitMétis, où l’eau est aussi salée qu’on peut le souhaiter, et où la baignade est excellente »4. Un tarif réduit est offert aux ministres de l’une ou l’autre des églises, une politique de marketing astucieuse conçue pour encourager l’équivalent des influenceuses et influenceurs du 19e siècle à soutenir son établissement.
Le succès de Turriff lui vaut des concurrents. En 1867, George Sylvain fait paraître une annonce pour une maison « propice aux bains d’été »5 à Sandy Bay. L’année suivante, le Quebec Daily Mercury annonce l’ouverture d’un nouvel hôtel de 20 chambres par John Taylor, « récemment arrivé d’Angleterre »6. Turriff répond en ouvrant le Turriff Hall en 1871. Un client satisfait en fait l’éloge au lectorat du Montreal Daily Witness : « M. Turriff, un homme aisé et excellent, a érigé ici un hôtel spacieux, bien agencé, propre et ordonné; les repas sont copieux et bien cuisinés, les conditions sont modérées. Les personnes dont les tables ne sont pas très richement approvisionnées ne doivent pas
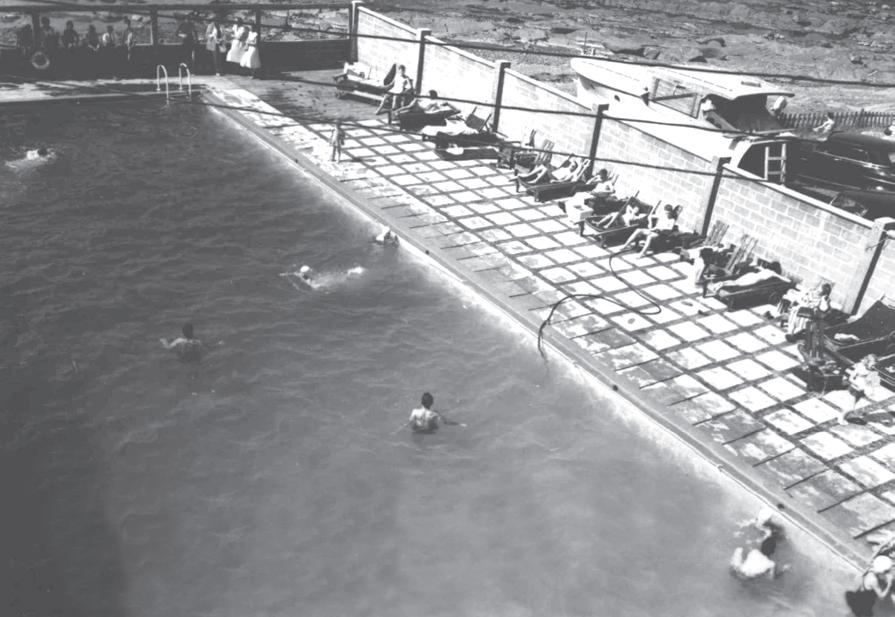

s’attendre à une cuisine Delmonico [alors le principal restaurant de New York] dans chaque maison de campagne, où elles peuvent descendre, pour quatre shillings par jour […] Nous avons un saumon frais meilleur que celui que l’on trouve habituellement sur les tables des souverains. »7.
Une destination populaire Métis commence à attirer l’attention. Le journaliste Ulric Barthe, qui passe ses étés à Baie-des-Sables, se sert des pages de La Gazette de Sorel pour faire la promotion de la localité à « ceux qui cherchent le repos, la tranquillité, le bon air, les bains de mer et le sans-gêne »8. Le lieu de villégiature souhaite ainsi séduire les « bonnes personnes », c’est-à-dire les Montréalais·es anglophones, comme William Dawson, recteur de l’Université McGill, qui y construit un chalet en 1876. Un si grand nombre de professeurs de McGill suivent Dawson que l’artère principale est parfois appelée « l’avenue McGill College ».
L’inauguration du service du chemin de fer Intercolonial (ICR) en 1876 rapproche Métis de Montréal. Les passagères et passagers débarquent à la gare de Petit-Métis, où ils sont accueillis par une flotte de calèches tirées par des chevaux pour les emmener en bas de la colline jusqu’à leur hôtel ou chalet. L’ICR ajoute des voitures supplémentaires en été pour répondre au nombre croissant de voyageuses et voyageurs à destination de Métis. Le service est si efficace que les hommes d’affaires montréalais en font une
destination de fin de semaine, quittant la ville par le train du soir pour rejoindre leurs familles le samedi matin. La gare est une véritable fête les dimanches soirs, les femmes et les enfants faisant leurs adieux aux pères qui retournent en ville pour travailler. Ce rituel persiste jusqu’à l’achèvement du Canada and Gulf Terminal Railway, qui ajoute une gare à Petit-Métis, où la même atmosphère de carnaval règne pendant des décennies.
L'économie de l'expérience
La croissance du commerce entraîne un boom de la construction. William Astle ouvre le Seaside House, connu localement sous le nom de « Castle Astle ». Il se vante d’être le plus grand des hôtels de Métis, avec 150 chambres. Les Astle s’installent à Métis dans les années 1830. Près de l’hôtel, des chalets sont construits pour accueillir celles et ceux qui aspirent à la vue sur le Saint-Laurent et à l’accès au bord de l’eau. Plutôt que de ruiner l’industrie hôtelière, les propriétaires de chalets contribuent à sa croissance. Les familles Turriff et Astle développent une économie florissante de propriétés locatives. Des chalets sont bâtis pour répondre aux besoins de la liste croissante de Montréalais·es qui préfèrent Métis aux communautés côtières de Cacouna et de Murray Bay (aujourd’hui La Malbaie). Les plus riches construisent leur propre maison, mais la majorité se contente de prendre une chambre dans l’un des hôtels pendant cinq ou six semaines. Même celles et ceux qui logent dans des chalets prennent

leurs repas dans les hôtels pour éviter d’avoir à organiser la venue d’un cuisinier ou à s’approvisionner pendant les mois d’été.
Les hôteliers créent l’économie de l’expérience. Des excursions vers les chutes de la rivière Métis ou pour profiter de la vue depuis les rangs sont organisées par les habitants·es avec des chevaux et des calèches. La pêche à la truite est proposée sur les lacs voisins. Des salles à manger, des salons de quilles et même une piscine d’eau salée font partie des services complémentaires proposés. Des concerts sont organisés dans les hôtels, les bénéfices contribuant à la construction d’églises pour servir les vacancières et vacanciers dévots, d’une chapelle méthodiste en 1866 et de l’église Little Metis Presbyterian Church en 1884.
Les familles Turriff et Astle forment la classe entrepreneuriale de Métis. Les familles Blue, Campbell, Meikle et Macalister ouvrent des commerces pour fournir des produits d’épicerie, des cadeaux et des pensions. Après le Seaside House en 1881, les Astle inaugurent le Boule Rock Hotel en 1900 et le Metis Lodge en 1929. Les descendants·es de John MacNider, qui possède une propriété au centre du village, se joignent à l’industrie du tourisme avec le Cascade Hotel en 1886. « Vue imprenable sur la mer, pension de première classe. En face
du télégraphe et du bureau de poste. »9 Le village est le premier de la région à se doter d’un service d’incendie volontaire et à installer des bouches d’incendie pour relier les maisons au réseau d’aqueduc municipal. Le débat sur qui en bénéficierait et qui paierait révèle des tensions dans le village. Les contribuables soutiennent que la « partie hôtelière du village » doit payer pour des services dont les autres parties du village ne bénéficient pas.
Le boom hôtelier
L’âge d’or des hôtels de Métis se situe entre 1929 et 1967 avec l’ouverture du tour de la Gaspésie qui amène un nouveau type de touristes : celles et ceux désireux d’explorer l’Amérique du Nord en voiture. Des « tours opérateurs » (voyagistes) commencent également à proposer des séjours d’une semaine dans la région. Un séjour à Métis constitue souvent le point de départ et d’arrivée de la tournée de la Gaspésie. La route panoramique stimule la construction de nouveaux hôtels. Fred A. Astle ouvre le Metis Lodge, avec 45 chambres. Son attrait particulier comprend certaines chambres avec salle de bain privée, eau chaude et froide dans toutes les chambres, et éclairage électrique. Le chauffage central est un autre attrait. L’hôtel Parkwood
voit le jour en 1931. L’hôtel Boule Rock ajoute des suites avec salle de bain privée à 75 de ses 100 chambres et une piscine d’eau salée chauffée de 30 pieds sur 70 (21 mètres sur 9), avec un instructeur de natation. Des soirées dansantes et des concerts pour 200 personnes sont organisés dans la salle à manger. La communauté possède sa propre pharmacie qui fournit une gamme de produits. Toutefois, la Grande Dépression met à mal les hôtels et leur survie.
Métis est l’un des premiers villages à former une association pour promouvoir une destination dans la région, un « syndicat de promotion », à l’origine des associations touristiques régionales actuelles. Le Metis Beach Chamber of Commerce publie plusieurs brochures regroupant tous les hôteliers majeurs et inventoriant les nombreux attraits de Métis. « Sans rhume des foins » est l’un des nombreux slogans utilisés pour promouvoir la destination!
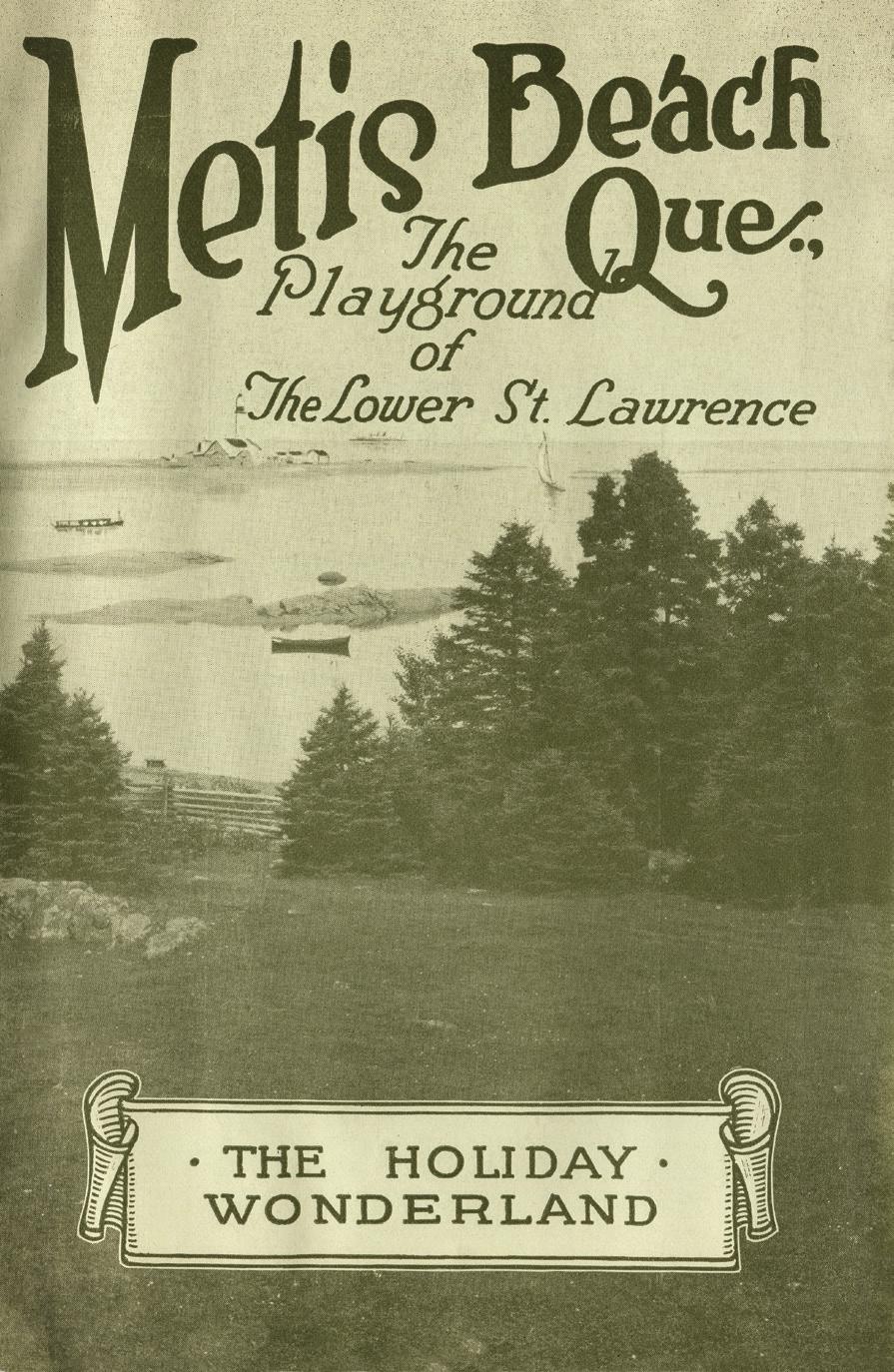
L’économie touristique est suffisamment prospère pour que les propriétaires d’hôtels aient à chercher ailleurs leur personnel. Lorsque les communautés environnantes des Boules, de Baie-des-Sables et de Mont-Joli ne suffisent pas, les entrepreneurs·es ont recours à l’importation de personnel hôtelier du Nouveau-Brunswick. Les cuisiniers sont recrutés à Montréal. Plusieurs hôtels construisent des logements pour leurs travailleuses et travailleurs pendant les mois d’été.
Les registres des hôtels du Seaside House, du Boule Rock, du Cascade et du Killiecrankie Inn qui sont préservés montrent que la clientèle vient principalement de Montréal, mais aussi d’Ottawa, de Toronto et d’ailleurs. La majorité est constituée de clients·es fidèles de la classe moyenne, qui occupent les mêmes chambres année après année. Les registres des hôtels confirment à quel point la région, et Métis en particulier, attire des touristes de
l’extérieur du Québec, bien plus nombreux que celles et ceux qui visitent la région aujourd’hui.
La bulle touristique commence à éclater dans les années 1950. Le nombre croissant de résidents·es estivaux qui reviennent change la dynamique de Métis et sa politique. La pression s’accroît pour supprimer la route 6 (actuelle 132) et la circulation qui traverse le village. Avec la déviation de l’autoroute, les automobiles contournent la localité. Les motels commencent à peupler le paysage touristique. Certains ouvrent à Sainte-Flavie et à Baie-des-Sables, mais pas à Métis. Les propriétés hôtelières sont construites sur des terrains de la taille d’une carte postale, avec peu ou pas de place pour le stationnement. Les propriétaires d’hôtels doivent faire face à l’augmentation du coût des assurances et à l’obligation d’ajouter des sorties de secours et des escaliers extérieurs. Le danger d’incendie est réel; plusieurs hôtels
brûlent : l’hôtel Parkwood en 1940, le Turriff Hall en 1941 et le Metis Lodge en 1958. Aujourd’hui, il reste peu de vestiges de l’économie hôtelière autrefois florissante. Les hôtels sont célébrés par des plaques historiques qui racontent l’histoire des familles d’entrepreneurs·es qui les ont construits et des générations de touristes qui en ont fait leur résidence d’été.
Notes
1. LeJournaldeQuébec, 5 avril 1849.
2-3. The Montreal Witness, 15 juillet 1857.
4. The Montreal Witness, 26 juin, 1858.
5-6. TheQuebecDailyMercury, 14 juillet 1868.
7. The Montreal Witness, 30 juiillet, 1879
8. « Les Excursionnistes », LaGazettedeSorel, 28 juin 1870.
9. TheMontrealDailyWitness, 15 mai 1886.

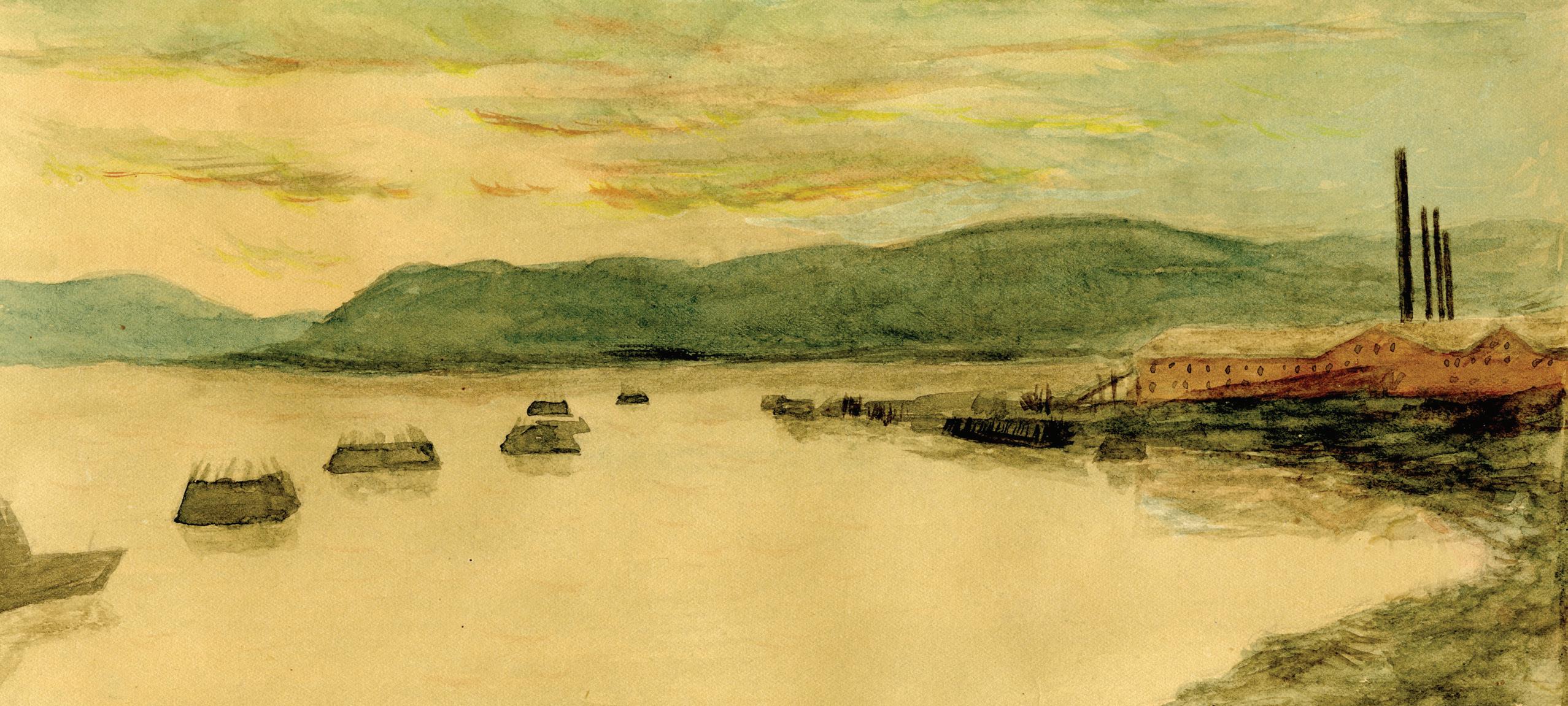
Frère Crispin, moulin à scie d’Édouard Lacroix, aquarelle, 18 x 26,5 cm, 1934.
ANQ Rimouski et Gaspé. Fonds Mission des Pères Capucins de Sainte-Anne-de-Ristigouche. P9,S200,SS4,P3
En 1902, la Chaleurs Bay Mills, propriété de John et David Champoux de Disraeli dans ChaudièreAppalaches, s’installe à Listuguj sur des terrains en location à la fois de l’église des Capucins et de la réserve des Mi’gmaqs. Les principaux acteurs concernés, le département des Affaires indiennes, les missionnaires capucins et les Mi’gmaqs, sont alors en faveur de cette industrie pour ses avantages économiques. Sa présence vient toutefois déranger la communauté de Listuguj en raison du désir d’expansion des Champoux, de l’afflux d’ouvriers allochtones venus y travailler et de la location de maisons de la communauté à ces derniers.
David Bigaouette Doctorant en histoire, Université de Montréal, et résident de Gaspé
La Chaleurs Bay Mills est gérée jusqu’en 1926 par les frères Champoux, qui possèdent aussi un moulin à Causapscal, pour ensuite être vendue à la Canadian International Paper Company. Puis, elle est achetée en 1928 par Édouard Lacroix, de la Madawaska Corporation Limited, déjà établie à Carleton-sur-Mer, qui en assure la gestion jusqu’à sa fermeture vers 1948.
La tentative d’expropriation de la réserve
Après avoir installé leur scierie, les
Champoux ont l’idée, vers 1914, de construire un nouveau moulin de pâtes et papiers à Listuguj. Chez les Mi’gmaqs, la question de savoir s’il faut louer ou non d’autres terrains aux industriels divise la communauté. Une pétition s’oppose à la location, alors qu’une autre pétition, qui est en réalité une initiative des Champoux, vise à faire valoir la voix des personnes demeurant dans la partie est de la réserve, qui désirent céder leurs terrains. Voyant que la situation est tendue dans la communauté et cherchant à en tirer
avantage, les Champoux proposent aux Affaires indiennes d’avoir recours à une section de la Loi sur les Indiens afin d’exproprier la réserve pour leur bénéfice. Pour le département des Affaires indiennes, tant qu’une majorité de Mi’gmaqs se positionne contre la location de nouveaux terrains, impossible d’en faire plus pour ce nouveau projet et pas question d’utiliser la loi pour exproprier la réserve. Profitant de leur réseau d’influences à Ottawa, les Champoux continuent leurs démarches auprès de la Chambre des communes, où un projet de

modification de la Loi sur les Indiens concernant la clause sur l’expropriation se trame. Si cette modification est votée, les Champoux pourront peut-être acquérir le territoire de la réserve. Lors des débats parlementaires, le député libéral Charles Marcil s’y oppose afin de protéger les intérêts des Mi’gmaqs et des Capucins. Au final, la Chambre vote en majorité pour la modification de la loi, mais le Sénat refuse son application : aucune disposition ne permet de trouver une réserve en remplacement de celle qui serait expropriée. Ce refus enlève aux Champoux la possibilité d’exproprier la réserve, au grand plaisir des Capucins et des Mi’gmaqs.
Une « invasion des Blancs » de la réserve?
D’autre part, la venue d’ouvriers allochtones installés dans la communauté pour le travail à la scierie suscite des réactions auprès des Mi’gmaqs en ce qui a trait à l’embauche et à la location de maisons aux nouveaux venus. À maintes reprises, les Mi’gmaqs accusent la scierie d’embaucher des ouvriers allochtones au détriment des Autochtones. Au fil du temps, une compétition pour l’embauche se crée au sein de la communauté. La situation culmine en 1931, en contexte de crise économique et de manque de travail, alors que des ouvriers mi’gmaqs se rebellent et bloquent l’accès à la scierie aux ouvriers allochtones pour faire pression sur la compagnie, maintenant devenue propriété d’Édouard Lacroix, afin qu’elle emploie plus de Mi’gmaqs. Finalement, les partis s’entendent pour que l’administration de la scierie dresse une liste des Mi’gmaqs à l’emploi afin d’assurer un roulement qui favorise tout le
monde. À cette époque, le travail au sein de la scierie se fait de plus en plus rare et décline jusqu’à sa fermeture définitive.
Plus que le travail, la question de l’hébergement des ouvriers allochtones suscite des débats et crée des divisions au sein de la population mi’gmaque. Alors qu’il est prévu que les ouvriers allochtones soient logés à Campbellton au NouveauBrunswick, les Champoux profitent de leur location des terres au nord de l’église afin d’y bâtir des maisons pour les y installer. Malgré ces nouvelles constructions, il n’y a toujours pas assez de maisons pour loger tous les ouvriers. Des Mi’gmaqs profitent alors du manque d’habitations pour construire à leur tour des maisons et de les louer aux ouvriers allochtones afin d’en tirer un revenu.
Encore une fois, la population est divisée sur cette gestion de location de maisons. L’opposition des Mi’gmaqs à louer des maisons aux Allochtones s’explique par le manque important de maisons disponibles pour la communauté, notamment les nouveaux couples, et par la crainte que cette location de maisons favorise l’emploi des Allochtones dans une scierie qui devait en principe prioriser l’embauche des Mi’gmaqs. On redoute aussi que les Allochtones troublent la paix dans la communauté, soit par la vente illégale d’alcool ou par des relations amoureuses « illégitimes » avec des Autochtones. À l’inverse, une partie des Mi’gmaqs se positionne plutôt en faveur de la location de maisons aux ouvriers allochtones, considérant les revenus qui en résultent. Ils prétendent que chacun a le droit de faire ce qu’il veut de sa propriété personnelle et que personne ne peut s’ingérer dans leurs affaires.
Le conseil de bande tente lui aussi de faire des politiques pour gérer les locations de maisons. La question est de savoir qui en a la légitimité : est-ce le conseil de bande ou le propriétaire de la maison? En 1921, le conseil de bande demande un vote populaire sur l’interdiction de louer des maisons appartenant à des Mi’gmaqs. Le résultat : la majorité est en faveur de l’interdiction. Malgré le vote, le département des Affaires indiennes croit qu’il n’est pas nécessaire d’ordonner l’expulsion de toutes ces personnes, considérant la détresse occasionnée et la perte de revenus encourue par les propriétaires mi’gmaqs. Malgré la réticence de plusieurs Mi’gmaqs, le système de locations semble être maintenu.
Pour le meilleur et pour le pire
La scierie de Listuguj est un bel exemple qui illustre comment une industrie peut être prête à tout pour arriver à ses fins, même au détriment d’une communauté, mais aussi comment elle peut diviser une population, en devenant une source continuelle d’ennuis pour les uns et d’avantages pour les autres. Bien que l’on puisse constater une coexistence difficile entre les Mi’gmaqs, la compagnie et les ouvriers allochtones, force est de constater que l’épisode de l’établissement de la scierie à Listuguj fait écho, non seulement à des intérêts économiques différents, mais aussi à des dynamiques communautaires complexes où sont présents des désaccords, des luttes et des inégalités dans une situation où tout le monde tente de tirer avantage des retombées de l’industrie. L’arrivée de la Chaleurs Bay Mills et d’ouvriers allochtones apparaît comme un changement majeur pour la communauté mi’gmaque. Inévitablement, elle est venue modifier l’espace ainsi que le climat social et économique de la communauté autochtone, pour le meilleur et pour le pire.
Remerciements aux Archives nationales du Québec qui ont mis gracieusement leur archive à disposition.
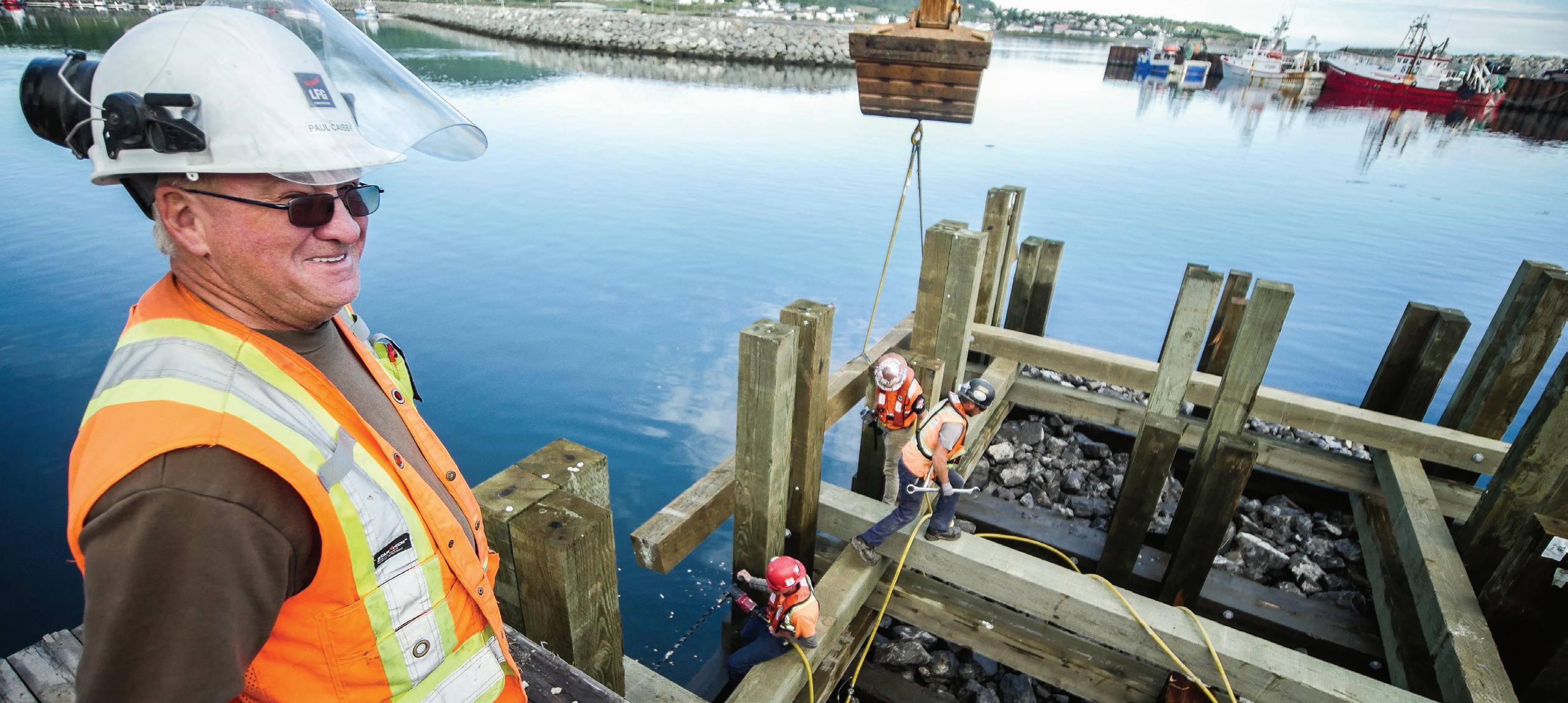
L’année 2025 marque les 50 ans de LFG Construction, qui doit son acronyme aux fondateurs Jean-Guy Landry, Donald Falardeau et Gaétan Gallant. Au fil des ans, l’entreprise de Carletonsur-Mer est devenue l’une des plus importantes entreprises de construction au Québec.
Michel Bond
Directeur des ressources humaines, LFG Construction
Comme beaucoup d’autres, les fondateurs travaillent alors à l’extérieur de la région, faute d’emplois dans leur localité. Pour y remédier, ils décident de créer leur propre emploi dans la construction résidentielle, et ce, dans leur village natal. Ils sont alors loin de se douter de l’expansion que prendra LFG. Elle connaît en effet une belle croissance en cinq décennies, passant d’un premier projet d’aménagement d’une entrée de cour privée à la réalisation de constructions de centrales thermiques, de parcs éoliens, de quais, de maisons des aînés·es, etc. Peu de temps après la création de l’entreprise, M. Gallant décide de quitter. Quelques années plus tard, Gilles Arseneault, qui effectue un retour dans la région et que les fondateurs connaissent bien, se joint à l’équipe.
LFG Construction réalise un premier projet commercial en 1978 avec l’usine de pâtes et papiers à New Richmond. C’est le début de plusieurs autres projets dans ce domaine avec les usines à Chandler, Matane et Rivière-du-Loup, alors que le volet résidentiel perd de son importance. Les actionnaires font de tout et sont présents sur les chantiers pour des périodes intenses de travail, notamment pour les arrêts annuels de maintenance (« shutdown »). La mine de Murdochville est un client important et LFG exporte même son expertise pour les entreprises minières ailleurs au Québec, et jusqu’en Ontario.
Durant les années 1980, LFG Construction est également présent dans le domaine des pêches. Érection d’usines de poissons salés à
Grande-Rivière et à Gascons, rénovation de l’usine à L’Anse-à-Beaufils, construction d’usines pour l’élevage de saumons à Saint-Omer et à Nouvelle ainsi que d’une usine d’élevage de moules à Saint-Omer.
En 1993, Claude Lapointe joint l’entreprise à titre de gestionnaire.
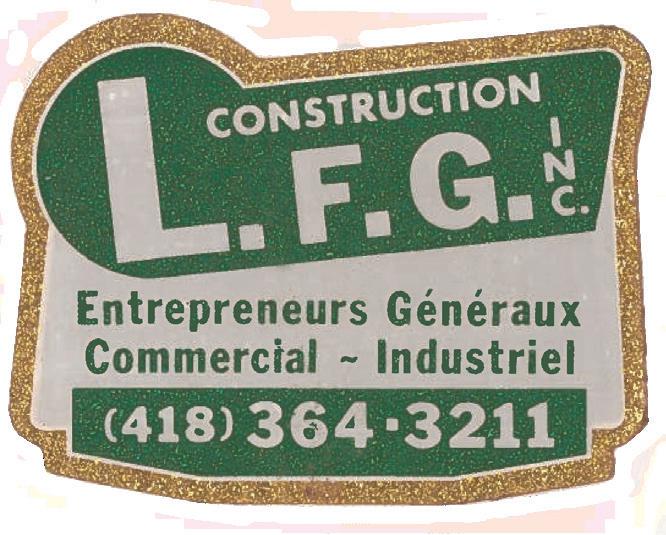

LFG démarre alors Techno-Acier (aujourd’hui CFI Métal), une compagnie de fabrication d’équipements et d’ouvrages métalliques, qui ouvre de nouvelles perspectives. Un peu plus de 20 ans après le début de l’aventure, les deux derniers membres fondateurs quittent et M. Lapointe devient actionnaire avec Jean Leblanc et Gilles Arsenault. À cette époque, le déclin du secteur des pâtes et papiers s’amorce dans la région. C’est aussi à ce moment que Mines Gaspé ferme à Murdochville. Une restructuration économique débute alors en Gaspésie avec l’émergence du secteur éolien.
Le grand défi
Les dirigeants de LFG sont face à un
à Gaspé, LM Glassfiber (aujourd’hui LM Wind Power), projet qui constitue sa plus grande réalisation depuis sa création. Au même moment, elle s’implique dans la mise sur pied du parc éolien à L’Anse-à-Valleau.
En 2009, Claude Lapointe devient l’unique actionnaire. C’est à ce moment, après plusieurs années de démarches, que LFG Construction devient partenaire de Construction Énergie Renouvelable avec EBC et TCI, deux grandes entreprises du Québec. Ne possédant pas toute l’expertise liée à l’éolien, cette alliance permet à LFG de participer à la construction de plus de 18 parcs éoliens au Québec et en Ontario en 15 ans, pour une puissance de plus de 2 000 mégawatts. Malgré ce
En 2019, LFG fait l’achat d’un bâtiment à New Richmond pour y installer son garage et son entrepôt. Cela permet de bien préparer les chantiers, d’effectuer les réparations de ses équipements et de recruter des employés·es de bureau vivant à l’est de la Baie-des-Chaleurs. Pour la région, l’entreprise se positionne comme un employeur important et ses projets génèrent des retombées économiques considérables pour les autres entreprises et les communautés environnantes.
Après plus de 30 ans dans l’entreprise, dont 13 années comme actionnaire unique, le temps est venu pour M. Lapointe de passer le flambeau. Il peut compter sur une relève. Occupant des fonctions stratégiques dans l’entreprise, Guillaume Lapointe, fils de Claude, Benoit Dubé et Steven Renouf deviennent, le 1er mai 2021, les nouveaux actionnaires. Leur jeunesse et leur dynamisme combinés à l’expérience des équipes en place et au soutien de Claude Lapointe permettent à l’entreprise d’atteindre de nouveaux sommets.
LFG possède aujourd’hui des bureaux à Carleton-sur-Mer, New Richmond, Sept-Îles, Rimouski et Québec. Plus de 250 personnes forment la grande famille LFG, sans compter les entreprises sous-traitantes. Depuis 50 ans, LFG Construction est devenue un partenaire incontournable de la construction en



VISIONNEZ LE FILM
L’ANSE-À-VALLEAU, UN JOUR… (1978) DE MICHEL GAUTHIER

L’Anse-à-Valleau, porte d’entrée ouest de ce qui constitue aujourd’hui la ville de Gaspé, est un petit hameau sur le chapelet de villages ceinturant la Gaspésie. Comme ses cousins, il a su évoluer dans différents secteurs d’activités grâce à la résilience, la débrouillardise, la fierté et la vaillance de ses résidents·es. Il n’y a pas de doute, le sens des affaires est contagieux à L’Anse-à-Valleau!
Jean-Yves Dupuis Passionné d’histoire et originaire de L’Anse-à-Valleau
D’un côté, la forêt
L’exploitation forestière est un élément important du développement de L’Anse-à-Valleau dès l’arrivée des premières familles au milieu du 19e siècle. Il faut construire les maisons, les dépendances et les embarcations de pêche pour les résidents·es et pour les villages environnants.
Gaudias Boulay est le premier à exploiter un moulin à scie à l’ouest du village. Il a su contaminer sa descendance en lui transmettant son esprit entrepreneurial. Son petit-fils Éloi installe son premier moulin en 1948, qu’il déménage ensuite, faute d’espace. Camille, fils d’Éloi, reprend les rênes de la compagnie, alors que Roberto, son petit-fils, poursuit les opérations avec des produits transformés. La majorité des familles du village peuvent se vanter d’avoir vu au moins un des leurs travailler pour ce sympathique et généreux entre-
preneur qui a su transmettre ses acquis et sa détermination. Dans la foulée du développement du sciage, des services de camionnage se développent, particulièrement dans les familles Boulay.
Mon grand-père Elzéar Dupuis et plusieurs de ses frères donnent aussi le ton dans ce domaine, mais à plus petite échelle, répondant à la demande de bois de construction avec l’expansion du village. Origène Mathurin suit la cadence en faisant tourner son moulin avec quelquesuns de ses huit fils.
Dans le domaine des pêches, la dynamique est plutôt familiale, particulièrement chez certains Dupuis où la fibre des affaires est transmise de père en fils. Délaissant la barge, mon oncle Antoine Dupuis achète le premier chalutier au village, la
Tabatière, qu’il vend à son frère Gérard quelques années plus tard pour acquérir le Bienvenu. Plusieurs de ses frères le suivent en achetant leur propre chalutier. L’histoire se poursuit alors que les fils et petits-fils suivent la vague familiale. Le développement des pêches nécessite
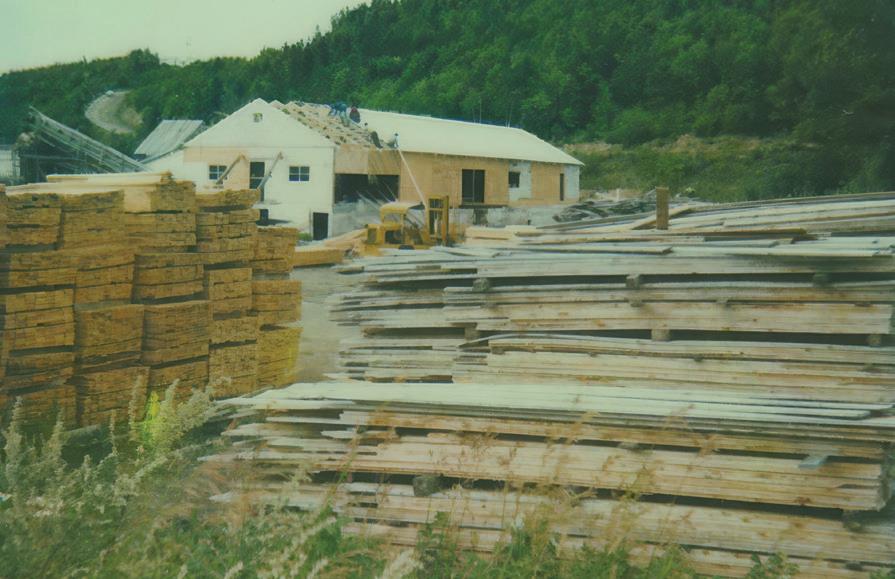
alors la construction d’un havre en 1954, remplaçant le quai, communément appelé le quai des Dupuis. Le havre de pêche devient rapidement un lieu social débordant les limites du village.
Hyacinthe Boulay gère pendant plusieurs années l’usine de transformation de poisson, puis dirige une pisciculture en partenariat avec son neveu Victorice et un autre fils du village, Louis-Marie Dupuis. Animé par sa fougue entrepreneuriale, Hyacinthe se tourne aussi vers l’élevage de renards et de visons, créant ainsi plusieurs emplois.
Plus tard, le tourisme
Avec le développement du réseau de transport, la Gaspésie devient une région incontournable. L’Anse-àValleau suit la tendance et le développement de l’industrie touristique sourit aux entrepreneurs·es. Ainsi s’implante l’hôtel d’Elzéar Dupuis. S’ensuivent l’hôtel et les cabines Gaieté des frères Ludger et Eugène Boulay dans les années 1930, dont les infrastructures sont gérées plus tard par Rébecca O’Connor, veuve d’Eugène, et par leur fils Victorin. Celles-ci sont finalement reprises par son neveu Victorice, suivi par sa fille Chantal, qui possède actuellement le motel camping des Ancêtres. Ludger Boulay exploite plus tard Le Gaspésien, qu’il cède à son fils Léon, avant

d’être racheté par Jean-Pierre Auclair. Hélas, aujourd’hui, Le Gaspésien n’est plus en opération, mais il laisse de nombreux souvenirs, entre autres, à celles et ceux qui y ont séjourné, le temps d’une lune de miel.
Dans la foulée apparaissent les motels et le bar le Bateau blanc de la famille de Narcisse Dupuis, repris depuis par Raoul Dupuis; ce complexe est aujourd’hui fermé. Face à la demande, s’ajoute le camping Le Pavillon, initiative de Georges Dupuis.
Toujours, l’alimentation et la restauration
Un village n’en est pas un sans son magasin général! Au tournant du 20e siècle, Joseph Tapp et Gédéon Mathurin implantent les leurs, suivi de celui de Cyrias Dupuis, qui inclut un service d’essence et une épicerie. Pour sa part, Lionel Boulay, ayant

vendu son magasin général, ouvre une épicerie dans l’ancienne école, au Vallon Gaspésien, qui est rachetée par Xavier Mathurin et revendue à Raynald Dupuis. Cet édifice abrite aujourd’hui des logements. Enfin, Donat Dupuis laisse également sa trace avec ce que nous appelons aujourd’hui un dépanneur; que de bons cornets de crème glacée nous y avons dégustés!
L’Anse-à-Valleau fait aussi sa marque dans le domaine de la restauration. Le Roitelet, tenu par Camille Dupuis, est l’un des lieux de rassemblement des « tites » jeunesses et de réceptions à l’occasion de mariages dans les années 1960. À celui-ci s’ajoute un service d’épicerie, qui deviendra l’unique vocation du Roitelet plus tard. Depuis, elle est devenue un bureau d’information touristique administré par le comité local de développement. Enfin, L’Anse-à-Valleau ne compte pas une, mais bien trois cantines! Il y a celle de Gustave Dupuis et celle de Victorien Côté, qui gère aussi une station d’essence, ainsi que celle de Georges Dupuis à son camping Le Pavillon.
Des services en complément
Et ce n’est pas terminé! Une communauté active a besoin de services complémentaires pour conserver sa vitalité. Nous retrouvons donc des services comme le garage de Ludger Gaudreau, exploité par la suite par Éloi Boulay. S’ajoute celui de Léopold Dupuis, qui est aujourd’hui la propriété de Roberto Boulay. Et pendant ce temps, à l’ouest du village, André Mathurin ouvre son garage de débosselage.
Les besoins des nombreuses familles nécessitent souvent des services spécialisés. Onias Tapp avec sa forge répond à la demande avec son service de réparation et de fabrication de divers outils et accessoires. Qui n’a pas glissé, roulé ou labouré en pensant à cet homme habile?
Onias Tapp a su transmettre à ses fils ses compétences techniques, car plusieurs d’entre eux œuvrent toujours dans le domaine de la machinerie lourde.
Continuons en transport avec le service de taxi en automobile et en « snowmobile » (autoneige) de Hyacinthe Boulay; plusieurs se souviennent des longs voyages Gaspé-Montréal. Dans ce même domaine, à la suite de la fermeture des écoles du village, il faut organiser le déplacement des élèves et c’est ainsi qu’arrivent les Transports Gustave Dupuis, entreprise qui est vendue à Bernard Jalbert de PetitCap et qui est encore en opération. Victorice Boulay arrive aussi dans le décor en transportant des élèves à Gaspé.
Mon grand-père Nazaire Mathurin saisit l’occasion de développer son entreprise en peinturage, entraînant ses fils et petits-fils dans son sillon. La demande étant forte, plusieurs fils de mon oncle Alcide Dupuis se manifestent, créant ainsi une saine concurrence. Nous assistons aussi au développement de services de livraison de gazoline et d’huile à chauffage avec les services de Radolphe Boulay, suivi par son fils Alain, et celui de JeanPaul Dupuis.
Les femmes, ces collaboratrices Une multitude d'autres actrices et acteurs permettent à L’Anse-àValleau d’évoluer au fil des ans. L’activité économique est longtemps portée par les hommes, laissant ainsi les femmes s’occuper particulièrement de la maisonnée et de « l’élevage » des enfants. Il convient de reconnaître ce que je nommerais l’entrepreneuriat domestique grâce à la créativité et aux talents de gestion des grands-mères, mères, sœurs, filles dans le développement social. Comme ailleurs, à L’Anseà-Valleau, ces vaillantes femmes participent à l’évolution de leur communauté.
Parallèlement se développent des services de coiffure avec Lauréanne Dupuis, Maria Dupuis et Kathleen Gleeton. Par ailleurs, Gracia Francœur et Emelda Dupuis tiennent une boutique de tissus et patrons de couture. Comment oublier Albina Élément, couturière? Je la vois encore cousant à la lueur de la lampe à l’huile… Que de dextérité et de mérite! De plus, qui n’a pas vu passer ma mère, Florence Mathurin, représentante de produits Avon et Fuller? Ce travail, considéré comme un loisir pour elle, lui permet de connaître toutes les familles de la paroisse. C’est comme une entreprise familiale alors que les enfants collaborent à l’empaquetage et à la livraison.
Indispensables loisirs
La vie d’une communauté ne reposant pas uniquement sur l’offre de


Collection
produits et services, l’entrepreneuriat se manifeste aussi dans le milieu communautaire, assurant ainsi une saine qualité de vie. Au fil des ans s’organisent des comités pour la réalisation d’activités, de même que pour la tenue de carnavals, festivals des sports, spectacles et concours. Encore aujourd’hui, le comité des loisirs et le comité de développement local assurent l’organisation d’évènements à caractère sportif, culturel, social et communautaire. Et que dire du trio des sœurs Blandine et Priscillia Poirier, et Marianne Côté qui ont su ramener sur son territoire le phare de Pointe-à-la-Renommée!
Un élan qui se poursuit
Hôtel d’Elzéar Dupuis, années 1930. Ce bâtiment, qui a connu des transformations, a aussi accueilli des classes durant un an, faute d’espace dans les deux écoles. Son fils Yvon Dupuis et son épouse Gisèle Joncas y gèrent aussi le bureau de poste durant plusieurs années.
Collection famille Dupuis
Avec le recul, force est de constater que mon village natal, à l’instar de ses cousins, est en mode d’autosuffisance ou presque pendant longtemps. L’entrepreneuriat y est devenu contagieux : toutes les familles fondatrices laissent leur marque. Bien que nous remarquions une baisse de l’offre de produits et services, grâce à ces bâtisseuses et bâtisseurs, la relève peut continuer sur cet élan. En appréciation de leurs initiatives, entonnons ensemble la chanson de Paul Davis : « Il est si beau mon village »…
Remerciements à toutes les personnes qui ont partagé leurs souvenirs du village et de leur famille.
Pour en savoir plus : Des panneaux d’interprétation, installés sur la grève entre l’ancien et le nouveau quai, commémorent l’histoire de L’Anse-à-Valleau.
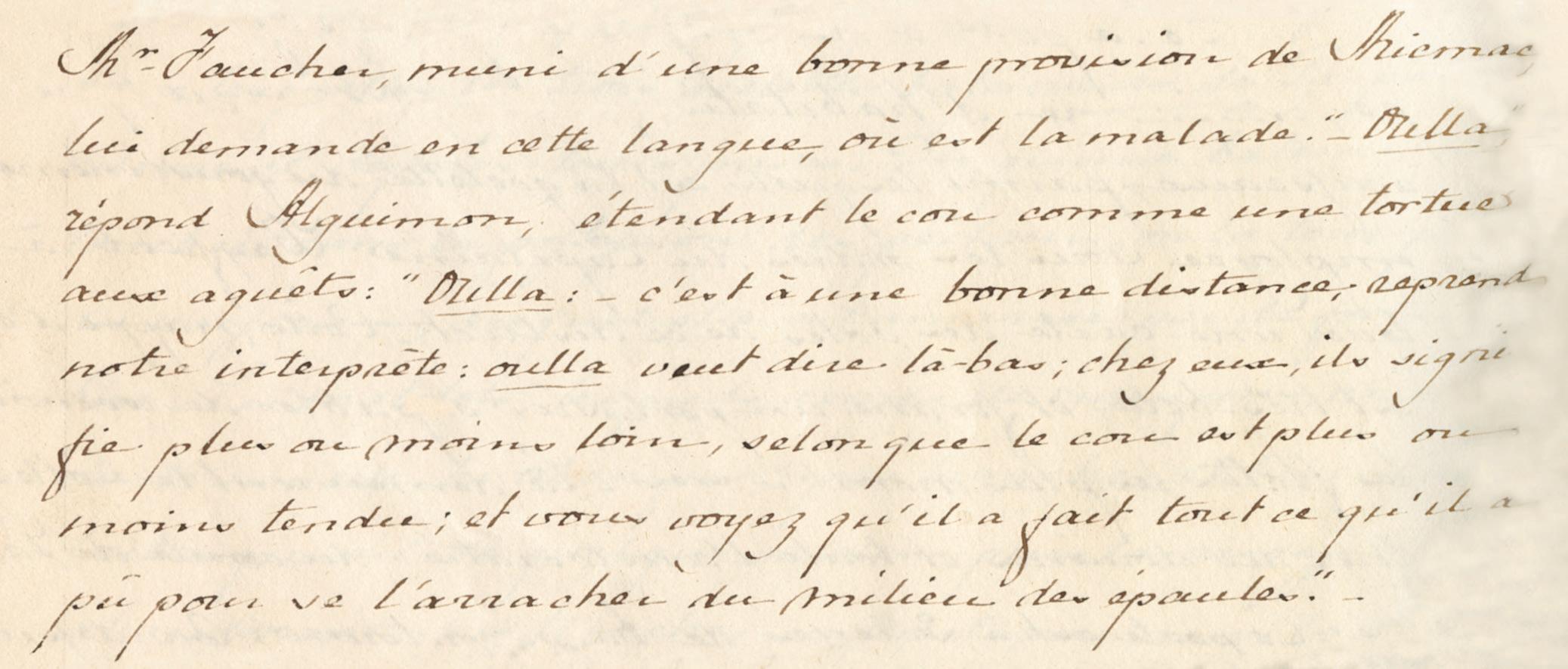
Extrait du journal de bord de Jean-Baptiste-Antoine Ferland relatant un échange entre un Autochtone venu quérir de l’aide pour son amie malade et un membre de l’équipage à propos de la distance à parcourir, 1836. Musée de la Gaspésie. P86 Fonds Jean-Baptiste-Antoine Ferland.
Dans la dernière chronique, l’abbé Jean-Baptiste-Antoine Ferland (1805-1865) accompagne Mgr Pierre-Flavien Turgeon (1787-1867) lors de sa visite épiscopale et se rend, entre autres, dans les missions de Sainte-Anne-des-Monts, Rivière-au-Renard et L’Anse-au-Griffon. Grâce aux descriptions très détaillées de son journal de bord, il est possible de bien visualiser l’état des villages côtiers de la péninsule en 1836. L’article précédent se termine alors que la goélette fait voile vers Gaspé; il est temps de continuer le périple.
Marie-Pierre Huard Archiviste, Musée de la Gaspésie
En route vers Douglastown
Le 25 juin vers midi, la goélette quitte L’Anse-au-Griffon vers Gaspé. La prochaine destination : Douglastown. Sur leur chemin, les deux ecclésiastiques croisent un navire avec deux chaloupes, l’une accrochée à bâbord et l’autre à tribord, ainsi qu’avec une douzaine de personnes sur le pont. Cette goélette effraie l’abbé Ferland. Il comprend très rapidement que ce sont en fait des chasseurs de baleines de Gaspé! En effet, les baleines sont très présentes dans les eaux du golfe. Depuis plusieurs jours, l’abbé Ferland les voit souffler leur air, plonger et remonter quelques mètres plus loin.
La goélette passe devant Cap-desRosiers et longe la falaise jusqu’à « Fourillon » et au cap de la Vieille, nommé ainsi parce qu’il ressemble à une vieille femme. Finalement, ils arrivent dans la baie de Gaspé qu’il décrit comme « une nappe d’eau de trois lieues de largeur s’enfonce entre deux terres, à une profondeur de six lieues ». Lorsqu’ils prennent une pause dans les villages de L’Anse-Saint-Georges et Grande-Grave, l’abbé Ferland avertit les habitants·es catholiques qu’ils seront à Douglastown le lendemain. À Douglastown, ils croisent juste avant d’accoster M. Davis, un juif anglais, qui croit par erreur que c’est
le « bâtiment » d’Halifax qu’il attend d’une journée à l’autre. L’abbé Ferland aime particulièrement ce village fondé par un Écossais 60 ans auparavant. « Nous débarquons au milieu des monticules de morue élevés de tout côté. On entrevoit sur le sommet du coteau l’humble chapelle perdue dans un bocage de sapins. C’est vers ce point que nous dirigeons nos pas parmi les expressions de joie de ces braves gens. Pour le moral, cette mission est la meilleure du comté de Gaspé. La population presque toute catholique est composée d’individus généralement honnêtes, polis, intelligen[t]s et religieux. » De plus, il mentionne que les gens de ce
village sont plus éduqués que dans les autres missions puisque, depuis plusieurs années, un maître d’école y habite. Beaucoup de personnes sont présentes dans la chapelle de Douglastown. Même les gens de Gaspé s’y rendent pour assister à l’office. Lorsqu’ils sont de retour dans le bassin de Gaspé, un jeune Autochtone monte à bord du navire afin de requérir les services de Mgr Turgeon, car son amie est gravement malade. L’évêque quitte avec le jeune homme et revient dans la soirée.
Petit crochet à Malbaie
Le lendemain, ils quittent aux petites heures du matin pour Malbaie. Malgré la petitesse de la mission, Malbaie est un endroit animé grâce à la pêche. La modeste chapelle domine le village. La vue devant la délégation est une chaîne de montagnes se terminant avec le « Roc-Percé » et ses deux arches. Ils sont reçus chez Guillaume Girard, un protestant responsable de la construction de la chapelle catholique. Ce Jersiais d’origine est arrivé en Gaspésie sans le sou, et maintenant, il fait une petite fortune en étant responsable de 17 barges de pêche. Depuis le printemps, pas moins de 1 000 quintaux de morue ont été déposés sur ses vigneaux! L’abondance de la morue dans ce secteur est telle que cela peut mener à des mésaventures. L’abbé Ferland l’explique en ces mots : « Telle est
l’abondance de la morue que dernièrement l’on a découvert dans la rivière de la Malbaie plus de 300 quintaux de morue pourrissant sur la grève. Dans son ardeur à poursuivre la caplan [le capelan], elle s’était laissée entraîner dans cette petite rivière où le décroissement subit des eaux la laissa à sec. ». La mission n’étant pas très populeuse, ils partent vers Percé la journée même.
Percé, le vice et la morue À Percé, ils sont accueillis par John Leboutillier, député de Gaspé. L’abbé fait une grande description de Percé et des pêcheurs, spécialement ceux qui viennent d’ailleurs exclusivement pour la saison. Plusieurs jeunes gens partent du district de Québec pour venir jusqu’à Percé travailler pour les compagnies de pêche. « Une si grande affluence de personnes, et particulièrement de jeunes gens éloignés de la surveillance de leurs paren[t]s, cause parfois de grands désordres, et corrompt les mœurs de beaucoup de pêcheurs. C’est surtout les dimanches, jours où les occupations cessent en partie que s’élèvent les querelles, à la suite desquelles les délinquan[t]s vont faire une retraite dans la prison. »
L’abbé Ferland semble avoir eu un petit cours sur le commerce de la morue tout en étant un fin observateur. Lorsque les pêcheurs reviennent sur le rivage à la suite
de leur longue journée de travail, ils déchargent leur barge dans la joie. Ils échangent aussi leur poisson contre de la marchandise (sel, lignes, hameçon, etc.) aux « traders » (commerçants). Jean-BaptisteAntoine Ferland mentionne aussi que « la morue sèche est ou marchande ou de réfection. Lorsqu’après avoir été traitée, elle se trouve n’avoir ni tache ni meurtrissure, la morue est marchande; cette espèce est ordinairement achetée par M. Robin qui la paie plus cher que les autres et l’envoie au Brésil, en Espagne ou en Italie. La morue de réfection est exportée aux Isles ou en Canada. ». Les deux hommes d’église demeurent plusieurs jours à Percé. Ils soupent avec John Leboutillier, se rendent sur l’île Bonaventure et ils prennent le temps de se familiariser avec les gens, les coutumes et les paysages de cet endroit de la péninsule. C’est la première fois depuis le début du voyage que l’abbé Ferland a la chance de dormir dans un lit sur la terre ferme.
Bien que la goélette Sara poursuive sa route, c’est avec la fin du séjour à Percé que se termine le contenu du journal de bord que possède le Centre d’archives.
LISEZ LE RÉCIT INTÉGRAL

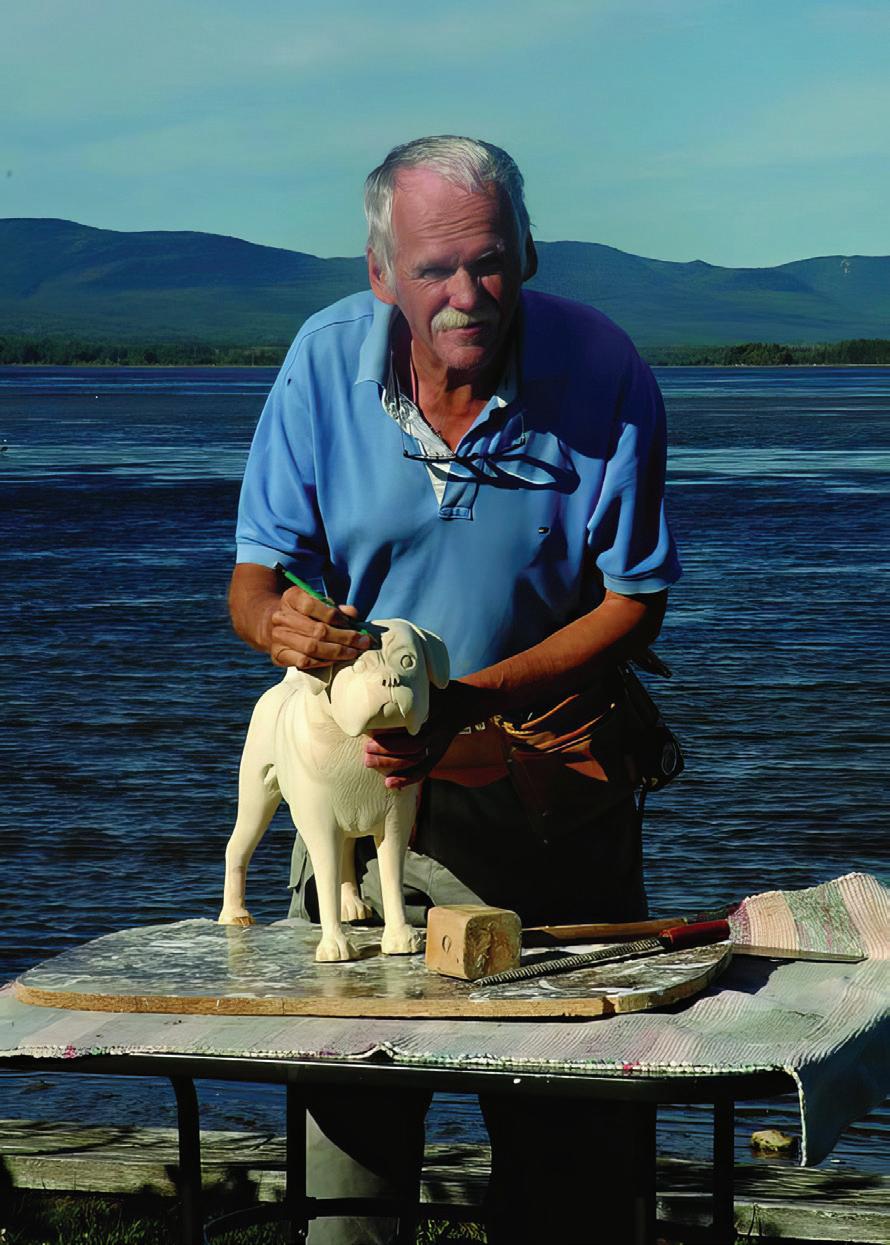
Le 15 mars 2024, Marcel Lamoureux, collectionneur et artiste bien connu de Gaspé, s’est éteint, entouré de ses proches. De son vivant, il est un collaborateur assidu du Musée de la Gaspésie, participant au fil des décennies à l’enrichissement de ses collections. En plus de sa grande contribution à la sauvegarde du patrimoine gaspésien, Marcel Lamoureux s’est adonné à la sculpture et a revêtu la carrière d’artiste sous le pseudonyme de Quinze. Son parcours rappelle l’importance cruciale que jouent ces fidèles du patrimoine sur le terrain, constamment à l’affût des joyaux à conserver.
Vicky Boulay Conservatrice, Musée de la Gaspésie
Le passionné d’objets anciens Originaire de Coaticook en Estrie, Marcel Lamoureux collectionne les vieux objets depuis sa tendre enfance. En effet, il fréquente très tôt les marchés aux puces des environs et aiguise son œil pour repérer les bonnes occasions. C’est en 1973 que lui et sa famille déménagent à Gaspé et qu’il commence un emploi au Cégep de la Gaspésie et des Îles dans le département de l’audiovisuel. Parallèlement, il continue de collectionner et de marchander les antiquités, et porte une attention singulière au patrimoine gaspésien, particulièrement convoité par les antiquaires ainsi que par les collectionneuses et collectionneurs étrangers. Marcel Lamoureux se forge rapidement une réputation notable dans la région. Il entretient des liens étroits avec, entre autres, Richard Gauthier, ethnologue gaspésien et conservateur à Parcs Canada à Québec. Ce dernier fait souvent appel à Marcel Lamoureux pour dénicher des pièces uniques du patrimoine de la péninsule.
Marcel Lamoureux devient un collaborateur clé du Musée de la Gaspésie lorsque Pierre Rastoul est nommé directeur en 1979. En effet, une analyse de la jeune collection
du Musée révèle des lacunes dans le domaine de la culture maritime. Le directeur sollicite donc l’aide de Marcel Lamoureux pour assembler une collection représentative de ce pan de l’histoire régionale. Grâce à ses contacts et à son expertise, il permet l’acquisition de pièces uniques, contribuant ainsi à renforcer l’identité culturelle gaspésienne. Il prend également un soin méticuleux à colliger le plus d’informations possible sur l’objet. Empruntant à l’ethnologie, il interroge les gens avec qui il fait affaire sur les fonctions et utilités de l’objet, sur sa fabrication et son histoire. Il acquiert
ainsi des connaissances précieuses et partage le fruit de ses recherches par l’entremise du Magazine Gaspésie notamment.
Parmi les objets les plus intéressants acquis de Marcel Lamoureux, notons plusieurs outils en lien avec la chasse à la baleine, comme des lances et des harpons. Le Musée compte également des outils liés à la confection et à la réparation des voiles, dont un étui de bois contenant des aiguilles ainsi que des paumelles de cuir et de métal utilisées pour enfoncer l’aiguille dans le tissu de la voile afin d’y pratiquer des coutures. Sans oublier des


Marcel Lamoureux, Échange conséquentiel, bois, plastique et autres matériaux, 33 x 44,5 x 68,6 cm,
la naissance de « Quinze », une identité artistique audacieuse qui lui permet d’explorer librement de nouvelles avenues créatives.
récipients de corne, autrefois emplis de gras animal qu’on emploie pour oindre les aiguilles afin de faciliter leur passage dans le tissu résistant, des brunissoirs de bois dur utilisés pour aplanir les plis et les coutures d’une voile.
Quinze : l’alter ego artistique À la fin des années 1990, Marcel Lamoureux amorce un tournant décisif dans son parcours en ajoutant le rôle de créateur à celui de collectionneur. Il éprouve depuis son enfance une affection particulière pour l’art, reproduisant les tableaux de grands maîtres avec minutie. Inspiré par l’art populaire qui exerce chez lui une véritable fascination, il commence à sculpter ses premiers morceaux de bois avec des outils rudimentaires. Cette démarche marque
Sous ce pseudonyme, Marcel Lamoureux s’affirme comme un artiste multidisciplinaire dont les sculptures polychromes allient humour et réflexion sociale. À travers des saynètes en trois dimensions, il met en scène des personnages et aborde des thèmes variés tels que le matérialisme ou les croyances religieuses. L’artiste fait également référence à des artistes majeurs comme Jackson Pollock et Marcel Duchamp, qui sont de grandes inspirations pour lui. Refusant les conventions du marché de l’art, il choisit de ne pas vendre ses œuvres, et privilégie une démarche artistique où cohabitent art populaire et art élitiste. Ses créations, accessibles et percutantes, invitent ainsi à une réflexion sur les enjeux de la société contemporaine. Le Musée de la Gaspésie conserve deux pièces réalisées par Quinze. L’une est acquise en 2017 et se nomme Échange conséquentiel. Elle met en scène Jacques Cartier et un homme du 21e siècle échangeant des biens symboliques, tels un portrait du roi François 1er, une canette et un magazine. Ce dialogue visuel souligne l’apport du passé à la modernité et offre une relecture du personnage de Cartier. L’autre, acquise en 2019, s’intitule Chasseur de baleine en pause-café. D’autres œuvres de Quinze se retrouvent aujourd’hui dans les collections du Musée POP à Trois-Rivières et à l’Université de Sherbrooke.
La contribution de Marcel Lamoureux dépasse largement le contenu de cette chronique. Son parcours souligne l’importance des passionnés·es qui, par leurs liens privilégiés avec la communauté, jouent un rôle clé dans la préservation et la valorisation du patrimoine. Grâce à leur engagement, des trésors culturels uniques trouvent leur place dans la mémoire collective, enrichissant notre compréhension de l’histoire et de la culture gaspésiennes.
Il est possible de voir l’œuvre Chasseur de baleine en pause-café dans le n° 200 sur l’art populaire.
Remerciements à Simon Lamoureux, fils de Marcel, et Jean-Marie Fallu pour leur collaboration.

Étoupe, maillet et fers à calfater. Le calfatage est l’étape qui consiste à boucher, notamment avec de l'étoupe goudronnée, les joints et les interstices d'un bateau pour le rendre étanche. Musée de la Gaspésie. Collection Marcel Lamoureux



Vernaculaire
En 1962, Contes du pays incertain reçoit le Prix littéraire du Gouverneur général. Dans cette œuvre brille Une fâcheuse compagnie Ferron y raconte une rencontre pour le moins singulière. Tout jeune médecin, il descend à Rivière-Madeleine (aujourd’hui Sainte-Madeleinede-la-Rivière-Madeleine) en juillet 1946. Au cœur d’un hiver où il doit couvrir, en autoneige, « sa Gaspésie à lui entre Mont-Louis et Cloridorme, sur 60 milles [97 km] de côte »3, l’escortent des cochons en liberté alors que, pour ses soins, il visite un habitant. Rencontre inusitée, cependant là où ce conte m’intéresse encore davantage, c’est dans la découverte du mot « portuna ». Quand sa profession l’appelle dans le village de Saint-Yvon, il passe par le marchand où celui-ci, de la fenêtre de son magasin, lui indique la demeure qui l’espère. Ferron entend au sujet de sa trousse : « Acré, dit le marchand, vous avez là, docteur, un beau portuna! »4 Ferron adopte ce vocable original parce qu’il l’utilise quelques lignes plus loin et qu’il le fait réapparaître, notamment, dans La conférence inachevée, publiée à titre posthume en 1987 : « Horace Goupil, dit le Rouge, me précède cérémonieusement, les bras raides, écartés du corps, tenant à la main mes deux précieux portunas. À Gros-Morne, comme ailleurs sur la côte, on ne me les laisse pas
Comment ne pas sentir l’obligation du legs vis-à-vis le géant de la littérature québécoise Jacques Ferron (1921-1985) quand 2025 marque le 40e anniversaire de son décès? Il pratique la médecine à Madeleine de 1946 à 1948; il magnifie le conte oral gaspésien en lui conférant une dimension littéraire; il nomme la « province de Gaspésie » par-devers ses villages. Nous choisissons ici de lui faire honneur grâce aux mots. « Ouhandeurfoule »1 (« wonderful », merveilleux) pasticherait peut-être Ferron.
Jean-Claude Clavet Résident de Gaspé
Les mots eux-mêmes peuvent avoir leur aura. 2
porter. »5. Dès lors, une semence langagière régionale, toute vernaculaire, d’un marchand, au milieu de la 4e décennie du 20e siècle, se trouve enchâssée dans la grande littérature québécoise.
Ferron cherche le sens de la Maraîche et de la Magonne qu’il entend dans les villages de la côte. Toutes deux forment un couple de personnages ténébreux parce qu’elles incarnent la mort rôdant sur la mer. Effectivement, qui savoure la littérature orale des contes, apprend
que les phénomènes physiques se métamorphosent en puissances vivantes avec une présence charnelle, que ce soit la Mi-Carême, le Loup-Garou, Mattempa ou, ici, la Maraîche et la Magonne. L’une hante les eaux l’été et l’autre, l’hiver. La première angoisse le pêcheur au point qu’il quitte son mouillage quand il la soupçonne d’être trop près pendant que la seconde signifie l’ultime fin si la mauvaise fortune condamne à tomber dedans. Un maître des mots, tel Ferron, s’oblige à traquer leur interprétation étymologique. S’y appliquant avec magonne et maraîche, il offre ces explications : « Gonne, en français ancien, signifiait une grande tunique, et la magonne, avec son préfixe péjoratif,

Jacques Ferron à sa table de travail montre bien l’écrivain à l’œuvre. Ici, il pose comme gagnant du prix Athanase-David, la plus haute distinction attribuée à une personne pour sa contribution remarquable à la littérature québécoise, 1977.
Jules Rochon ANQ Québec. Fonds Ministère des Communications. E10,S44,SS1,D77-780,P1

Phare à Madeleine, 1934. « Entre le phare de la Madeleine et le port de Mont-Louis la séparation de la terre et des eaux, vu la hauteur de la falaise, est incontestable. » 6, passage qui marque comment Ferron sait peindre la géographie gaspésienne. Société d’histoire de la Haute-Gaspésie
qui en dérive peut-être, est moins ce frasil, le point mou du recouvrement, que son envers caché, la mort perfide, une des sombres divinités de la mer »7. Quelques lignes plus loin, Ferron poursuit : « La maraîche provient probablement, elle aussi, du français ancien par l’amalgame d’un adjectif, marage-marin, et d’un nom, marage-affliction »8. Ce qu’il faut démontrer : erre l’Implacable, semblable en cela aux revenants·es qui hantent parfois les alentours des villages.
Le pays sans nos contes retourne à la confusion. 9
Ferron recourt à la figure légendaire d’Antée, fils de Gaïa (la Terre) et de Poséidon (la Mer), pour fonder la valeur du conte dans l’identité du pays. Antée ne perd aucun combat, quelle que soit la force de l’adversaire, tant que ses pieds demeurent mariés à la terre qui le nourrit. C’est entendre que le pays dispose d’une puissance vivace s’il sait s’enraciner dans le terreau qui le constitue et, à ce titre, et le mot et le conte y contribuent substantiellement. Choisir un mot relève d’une volonté stylistique et esthétique, certes. Par-delà, il signifie un précieux attachement aux racines.
Remerciements aux Archives nationales du Québec et à la Société d'histoire de la Haute-Gaspésie qui ont mis gracieusement leurs photographies à disposition.
Notes
1. Jacques Ferron, « De stricte observance », La charrette des mots, Trois-Pistoles, Éditions Trois-Pistoles, 2006, p. 16.
2. Walter Benjamin, CharlesBaudelaire, Paris, Petite Bibliothèque Payot, 1938-1939, réédition 2002, p. 200, note*.
3. Jacques Ferron, Gaspé-Mattempa, Outremont, Lanctôt Éditeur, 1980, réédition 1997, p. 17.
4. Jacques Ferron, Contes, Montréal, Bibliothèque québécoise, 1968, réédition 1993, p. 61.
5. Jacques Ferron, « Les têtes de morues », La conférence inachevée, Montréal, Lanctôt Éditeur, 1998, p. 115.
6. Jacques Ferron, « Chronique de l’Anse Saint-Roch », Contes, Montréal, Bibliothèque québécoise, 1993, p. 263.
7. Jacques Ferron, « La magonne et la maraîche », Lire Ferron, L’Actionnationale, vol. CXI, n° 8, octobre 2021, p. 12.
8. « La magonne et la maraîche », Op.Cit., p. 13.
9. Jacques Ferron, « Suite à Martine », Contes, Montréal, Bibliothèque québécoise, 1993, p. 175.


Je ne sais pas si vous êtes comme moi : j’adore les histoires situées dans un hôtel, où qu’il soit dans le monde! Les intrigues sont foisonnantes, croustillantes et dans certains cas, carrément historiques. Pensons au « bed in » avec John Lennon et Yoko Ono en 1967 au Queen Elizabeth à Montréal, ou encore, lors de la Deuxième Guerre mondiale, aux Alliés (Roosevelt, Churchill et Mackenzie King) qui se sont réunis à deux reprises au Château Frontenac à Québec pour discuter stratégie. Dans la petite histoire de Marsoui, un hôtel a aussi connu ses moments glorieux : l’hôtel Marsoui, familièrement appelé hôtel Lever, qui célèbrerait 100 ans en 2025.
Anne Sohier Administratrice, Comité de développement de Marsoui
Situé au beau milieu du village, rue Principale, l'hôtel compte alors quelques cabines et, chose très rare à l’époque, une pompe à essence. Il connaît les belles années de l’ouverture en 1929 de la fameuse route panoramique, aujourd’hui la 132. À l’origine, il porte le nom d’hôtel Marsouins. Albert Lever, propriétaire fondateur, transforme sa grande maison familiale en hôtel avec salle à manger. Sa fille, Yvonne,
véritable bras droit, est une figure incontournable dans l’histoire de cet hôtel. Du haut de ses 4 pieds et 8 pouces (142 cm), elle n’a peur de personne. Car ce ne sont pas que des curés qui passent à l’hôtel! Elle est aussi bonne cuisinière et la salle à manger est connue pour ses repas de poisson. Son frère, Roger, prend la relève de son père dans la gestion de l’hôtel et l’administre jusqu’à son décès en 1975. Yvonne restera
toujours à ses côtés. Roger y élève sa famille, avec sa femme Henriette, leur fille Lina et leurs trois fils, Dan, Nelson et Éric.
Un repère de contrebandiers De 1925 à 1935, l’alcool est rare et il faut se rendre à Matane ou Rivièredu-Loup pour en acheter. Avec la prohibition américaine, la contrebande est florissante. L’hôtel, vu sa situation géographique, est idéal

pour les contrebandiers de l’époque alors que Marsoui est connu comme « cache » par les « bootleggers » (contrebandiers). À leur départ de l’hôtel, ils devaient bien en laisser un peu aux hôteliers en guise de remerciement pour leur discrétion. Tante Yvonne, comme on l’appelle, cache cet alcool sous son lit et en revend dans de petites flasques aux gens du coin.
Un passage pour les vedettes
Les registres d’un hôtel peuvent paraître banals de prime abord, avec seulement une date, un nom, un lieu d’origine et une signature. Les voyageuses et voyageurs de cette époque sont soit des commis voyageurs, de riches Américains venus pêcher le saumon ou des citoyennes et citoyens, arrivant l’hiver en « snowmobile » (autoneige), de passage pour se rendre en ville. J’y ai même retrouvé le nom de mon père, en 1941, âgé de 18 ans. Pourquoi coucher à l’hôtel alors qu’il habite à deux pas? J’imagine que
la maison est pleine de « visite »? Il est hors de question d’installer la parenté à l’hôtel. On pourrait aussi penser à une frasque de jeunesse? Comme chacun·e le sait : ce qui se passe à l’hôtel, reste à l’hôtel!
Le registre de l’hôtel Marsoui recèle quelques surprises. Bien sûr, on peut y voir des figures du milieu politique, de l’éducation ou du clergé. On y retrace en 1934, Paul Gouin, du tout nouveau parti politique, l’Action libérale nationale. Aussi, on y trouve Bernard Boivin, botaniste étudiant, de passage au printemps 1940, accompagné par nul autre que celui qu’il qualifiera plus tard de mentor, son professeur : le frère MarieVictorin. La faune est des plus variées, allant du baryton Louis Gravel à un Allemand venu de Berlin pendant la guerre! Mais la palme revient, sans contredit, à un certain Charlie Chaplin, accompagné de l’actrice May West, qui signent le registre en 1940. L’acteur Gary Cooper, escorté de l’actrice Myrna Loy, fait de même en 1941. Difficile d’affirmer sans aucun doute si ce sont vraiment eux. Pas de photographies, mais leurs noms et signatures y sont bel et bien inscrits. Une petite recherche m’indique que Gary Cooper a eu plusieurs aventures extra-conjugales et que Myrna Loy est une amie d’enfance. Les mœurs dans le milieu cinématographique américain de l’époque ouvrent les portes toutes

Collection famille Lever
grandes à ce genre d’aventures. Pour sa part, M. Chaplin est en Amérique cette année-là, et May West est une amie. Tout porte ainsi à croire qu’ils ont bien séjourné à l’hôtel Marsoui. Au décès de Roger Lever, les enfants partis, Henriette vend l’hôtel à Daniel Rioux, de Sainte-Anne-des-Monts. Il l’opère une quinzaine d’années. Par la suite, plusieurs propriétaires se succèdent, avec plus ou moins de succès. Je souligne toutefois le passage de quatre femmes déterminées, audacieuses pour l’époque, qui prennent les rênes de 1989 à 1995 et en font un lieu original en y offrant des conférences et des souperscauseries avec des personnalités du milieu politique et social. À sa tête,
Registre de l’hôtel Lever avec les signatures de Charlie Chaplin et Mae West en provenance d’Hollywood, 1940.
Collection famille Lever
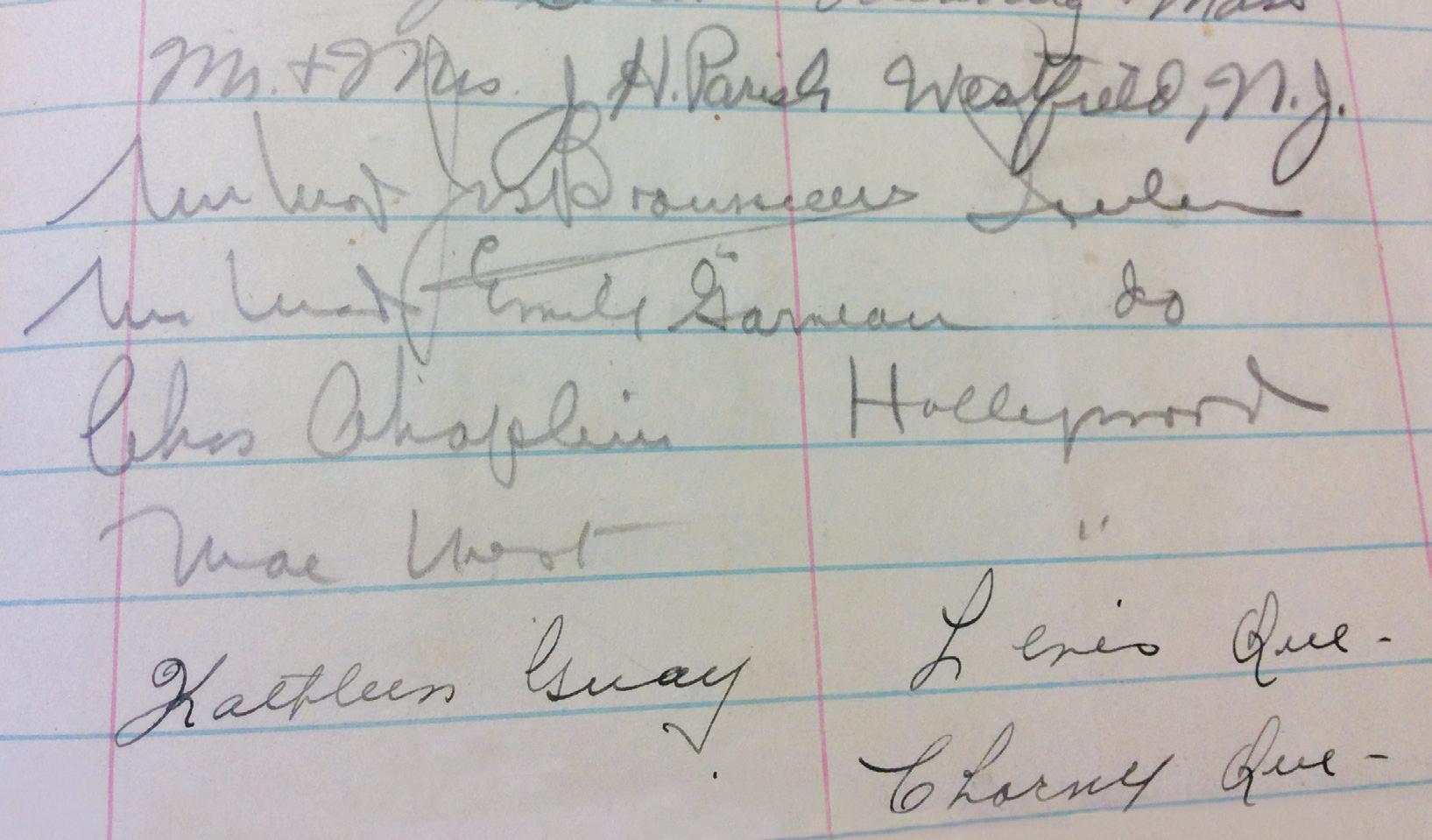



Un brin d’histoire sur la famille Lever Charlie Lever arrive de Jersey, île anglo-normande, vers 1870. Il se marie en 1874 avec Marcelline Henley. Ils ont une douzaine d’enfants, dont Albert. Vaillants cultivateurs de père en fils, les membres de cette famille pionnière sont aussi de généreux donateurs et donatrices, offrant le terrain pour la nouvelle église, le cimetière et le presbytère. Ils transmettent à leurs descendants·es des valeurs d’entraide et de solidarité et plusieurs d’entre eux deviendront de précieux bénévoles pour des organismes de Marsoui.

la mairesse actuelle, Renée Gasse, et ses trois partenaires et cousines, les sœurs Madone, Jovette et Josée Gasse. Le propriétaire actuel, Bernardo Cruz, y opère depuis une dizaine d’années un gîte saisonnier. Écrire cette chronique m’aura permis de fouiller dans notre histoire collective et aura certainement ravivé mon rêve de voir l’histoire de Marsoui sur grand écran. L’hôtel Lever n’est peut-être pas chargé d’histoire comme le Château Frontenac, mais il possède sans aucun doute des curiosités dignes d’être soulignées. Fermez les yeux et imaginez l’affiche avec tante Yvonne, cigarette au bec, qui pêche à la ligne. Vous achetez un billet?
LISEZ L’ARTICLE UNE VÉRITABLE CACHE À MARSOUI, PARU DANS LE N° 193




Dans la nuit du 24 au 25 novembre 2023, n’eût été la vigilance de deux passantes et de l’intervention rapide des pompiers, une pièce importante du patrimoine maritime gaspésien, la Gaspésienne n° 20, aurait bien pu disparaître à tout jamais dans les flammes. Malgré le triste spectacle qui s’offre aux passants·es au lever du jour, bien malin celui ou celle qui pourrait aujourd’hui deviner qu’un incendie a ravagé le flanc tribord de ce bateau. Comment de telles cicatrices ont-elles pu être effacées? Nous vous proposons ici de découvrir les coulisses de ce projet de restauration hors du commun!
Pierre-Luc Morin Chaloupier
Corentin Briand Chaloupier
Un bateau unique
Tout d’abord, un bref rappel historique. Les Gaspésiennes, ce sont une série de 50 bateaux construits entre 1955 et 1960 suivant une volonté du gouvernement du Québec de contribuer à la modernisation des pêches en Gaspésie. Dessinés par Howard Chapelle, un architecte naval de Nouvelle-Écosse, les plans de ce bateau sont toutefois directement inspirés des barges traditionnelles de la région, un type d’embarcation que les pêcheurs gaspésiens utilisent depuis 150 ans.
Dans le cas de la n° 20, elle est construite en 1958 pour les besoins du pêcheur Thomas Boucher, de Newport. Après un peu plus de quatre décennies de navigation dans la Baie-des-Chaleurs, son dernier propriétaire, Michel Boissonneault de New Richmond, en fait don au Musée de la Gaspésie en 2002 afin d’assurer sa préservation. Des travaux de restauration réalisés en 2016 par une équipe comptant plus de 40 bénévoles permettent de la rendre accessible au public à partir de l’année suivante.

Les pompiers terminent d’éteindre l’incendie qui a ravagé le côté tribord de la Gaspésienne n° 20 dans la nuit du 23 au 24 novembre 2023.
Devenir charpentier de marine ne s’apprend pas à l’école au Québec. Derrière ce projet de sauvetage de la Gaspésienne n° 20 se cache aussi celui d’un métier. Après avoir été marin, puis gardien de phare, Daniel St-Pierre travaille dans divers chantiers navals avant de fonder son propre atelier, au Bic, en 2003. Alors âgé de 21 ans et fraîchement formé dans les métiers du meuble, PierreLuc Morin le rejoint en 2007. Venu de France pour étudier en ébénisterie, le jeune Corentin Briand poursuit cette chaîne en devenant en 2021 l’apprenti de Pierre-Luc. Ayant atteint l’âge de la retraite, Daniel suit à distance ce projet de restauration et est très fier de voir sa relève se dédier ainsi au patrimoine maritime!
Nouveau chapitre pour la Gaspésienne n° 20 L’incendie accidentel survenu aux abords du Musée de la Gaspésie en 2023 s’inscrit maintenant dans l’histoire de ce bateau emblématique. Une importante partie de sa coque s’est en effet transformée en charbon, les dommages s’étendant jusqu’à l’intérieur de la cale à poisson, et affectant des pièces de structure majeures.
Une réelle volonté de sauver la Gaspésienne se fait sentir, tant par l’équipe du Musée que par les Gaspésiennes et Gaspésiens amoureux de patrimoine maritime. Un défi s’impose : trouver l’expertise pour restaurer un bateau comme il ne s’en fait presque plus au Québec. C’est au courant du mois de février que le téléphone sonne chez nous, chaloupiers du Bic, un trio d’artisans du Bas-Saint-Laurent. La technicienne en muséologie du Musée de la Gaspésie, Sandra Turcotte, nous invite à soumissionner pour ce grand chantier. Responsable du projet, elle veillera au bon déroulement des opérations tout au long de la restauration.

Une visite sur les lieux nous permet de réellement comprendre l’ampleur de l’aventure qui va suivre. Figé dans la glace des hivers gaspésiens, le bois, gorgé de l’eau des lances à incendie, a eu la vie dure. Notre première rencontre avec Sandra Turcotte nous permet également de comprendre le choc que l’équipe a eu cette nuit-là, alors qu’elle qualifie affectueusement la Gaspésienne n° 20 de « l’emblème du Musée ». Avec un tel témoignage, il est clair qu’un soin particulier est à adopter pour la réalisation d’un chantier comme celui-ci.
Un défi de taille
La majorité du bois à remplacer est de l’épinette blanche, une essence naturellement présente dans l’Estdu-Québec. Habitués à travailler avec les artisans-scieurs de notre région, nous avons pu nous procurer ce bois scié spécialement pour les besoins de la Gaspésienne. Les planches dans lesquelles tailler des bordages (planches formant la coque) sont les plus difficiles à trouver, car elles doivent être les plus larges possibles, les plus longues possibles et avec le moins de nœuds possible. En bref, nous avons « écrémé » la cour de nos scieurs qui ont parfois débité leurs plus belles billes pour nous! L’autre essence requise est le
chêne blanc, très utilisé en charpenterie de marine traditionnelle pour la charpente des bateaux en raison de sa grande rigidité et de sa bonne résistance à l’humidité. Puisque cet arbre ne pousse pas dans notre région, ce bois doit être commandé chez un marchand de bois d’ébénisterie de Québec, à 700 km de sa destination finale!
Après plusieurs semaines de préparations, c’est finalement le lendemain de la Fête nationale du Québec que les travaux de restauration s’amorcent à bord du bateau. Des travaux, au départ discrets, dans l’antre de la Gaspésienne, afin de restaurer sa charpente abîmée

Les membres ployés prennent forme un à un : des étais permettent de maintenir courbées ces pièces de bois le temps qu’ils refroidissent complètement, 2024.
en certains endroits par le feu, mais aussi fortement fragilisée par le temps, l’humidité et l’humain. L’étape la plus spectaculaire de la restauration de la charpente est certainement la pose des membres, ces pièces qui ressemblent un peu à des « côtes » dans le « squelette » du bateau. Scène typique des chantiers navals d’autrefois, ces pièces de chêne blanc sont placées plus d’une heure dans une étuveuse; un bain de vapeur qui les assouplit afin de pouvoir leur faire épouser les formes de la coque. On parle de ployage du bois; c’est un travail qui demande méthode, force physique et vitesse, puisqu’après seulement deux minutes, le bois aura déjà trop refroidi et durci pour qu’on puisse en faire quoi que ce soit!
La solidité de la charpente maintenant retrouvée, nous pouvons enfin nous atteler aux réparations de la coque extérieure. Semaine
La charpente, qui avait été dégradée et modifiée avec le temps, a pu être reconstituée grâce aux plans d’origine.
après semaine, la noirceur des vestiges de l’incendie disparaît, au grand soulagement de l’équipe du Musée, pour laisser place aux nouveaux bordages de la coque. Ces planches d’épinette, qui atteignent parfois 20 pieds (6 mètres) de long, sont façonnées une à une, dans des formes spécifiques où aucune n’est identique. Tranquillement, mais sûrement, le côté tribord du bateau retrouve son aspect d’origine, par le maillage des anciennes et nouvelles pièces de bois. Jambettes, sabords, pavois et bordages de pont ont par la suite pris forme sous le regard des passants·es, sans oublier la restauration des accastillages et le retour des couleurs d’origine.
Charpentiers… et enquêteurs!
Un réel travail de recherche est mené tout au long du projet dans les photos, plans et documents


Ces baguettes de bois, nommées lattes de brochetage, permettent de déterminer la répartition des bordages qui constituent la coque. D’abord théorique, cette répartition est ensuite peaufinée par le regard aiguisé des charpentiers. Cette méthode traditionnelle demande beaucoup d’instinct et d’observation des lignes.
d’archives afin de respecter l’authenticité de cet artefact. Ces analyses et découvertes nous permettent de recréer des pièces parfois disparues ou modifiées au fil des rénovations passées, et de restituer le plus fidèlement possible l’allure que la Gaspésienne n° 20 pouvait avoir lors de sa sortie de chantier en 1958, sans pour autant effacer les traces de l’histoire qu’elle a vécue. Ainsi, de nombreuses pièces d’époque sont soigneusement démontées et numérotées au besoin pour les réinstaller plus tard. Certaines pièces sont réparées plutôt que remplacées, toujours dans un souci d’authenticité et de respect de ce bateau historique.
Ce projet de restauration hors du commun prend fin le 17 novembre 2024, alors que les premiers flocons de neige commencent à tomber. Après cinq mois de travaux, la Gaspésienne n° 20 a pu retrouver son allure tant appréciée!
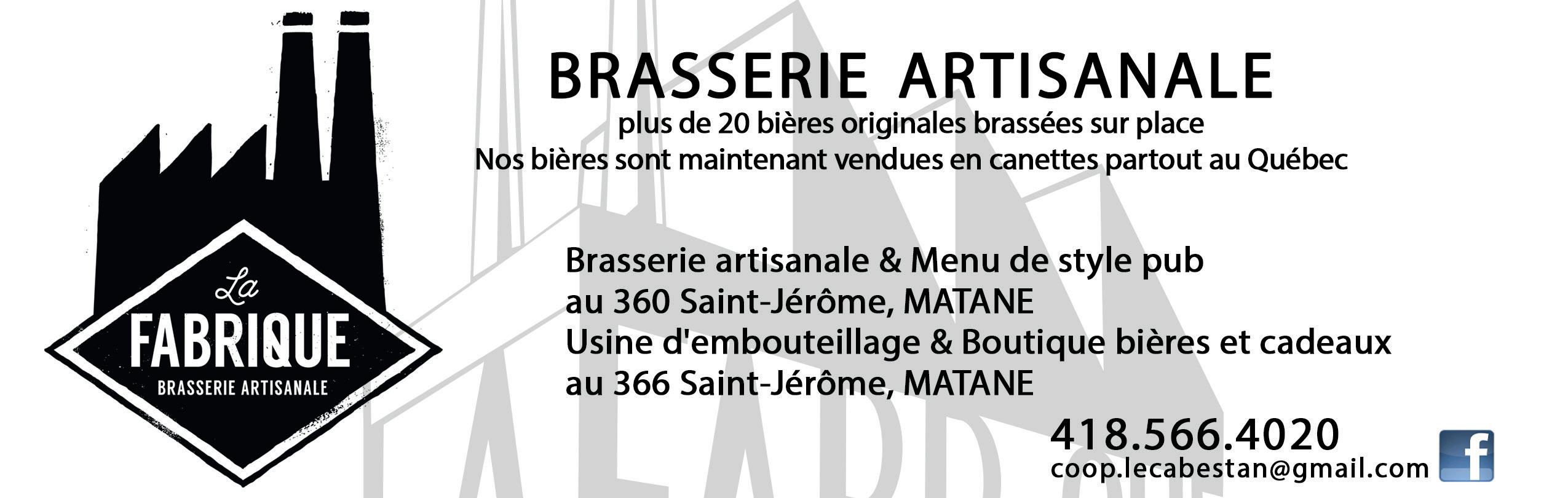
CONSULTEZ
L’APPEL DE TEXTES

Ciné-parc Cartier à Saint-Majorique, 2010.
Correctifs du n° 211
-p. 9, dans la légende de la photo du haut, on aurait dû lire Aurèle Fraser, et non Lucien
-p. 49, la cérémonie commémorative pour les soldats a bien lieu en 1994, et non 1995
Faites-nous part de vos commentaires et suggestions sur le Magazine Gaspésie : magazine@museedelagaspesie.ca 418 368-1534, poste 106
Les pastilles Web à la fin de certains articles vous invitent à consulter un extra en accès libre sur notre site Web : magazinegaspesie.ca




Gaspé - Cap d'Espoir - Petite Vallée
Tél. : 418 368-5425 | info@groupeohmega.com | www.groupeohmega.com

Kaleda Ullah, Vice-présidente adjointe Courtière en assurance de dommages des entreprises
Marsh Canada Ltée | Service aux consommateurs et entreprises Programme d’assurance exclusif pour les membres de l’AMC 1 Place Ville-Marie, bureau 1500, Montréal, Québec, H3B 2B5 +1 514 285 5942 | kaleda.ullah@marsh.com www.marsh.com
Une Compagnie de Marsh McLennan



Cadeaux
Matériel d’artiste
Jeux et jouets éducatifs

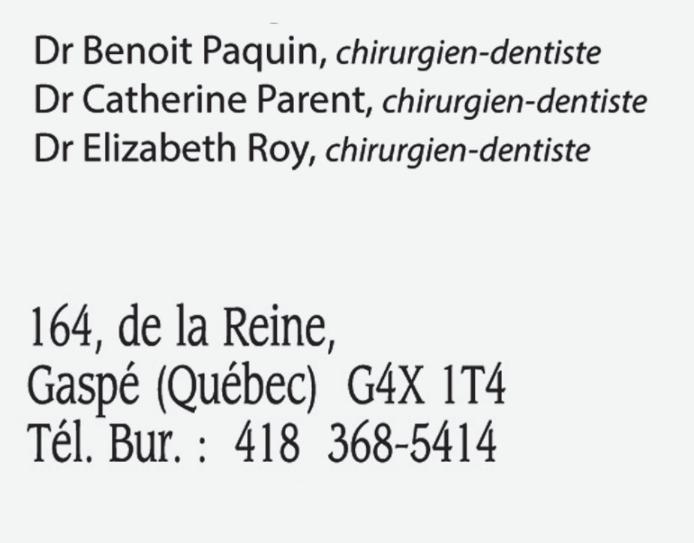





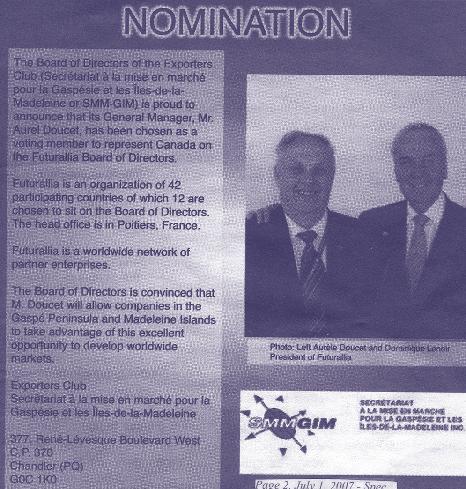



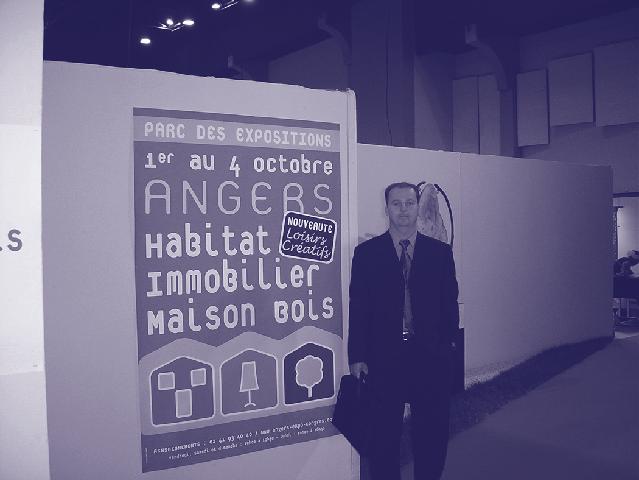



Depuis trois décennies, GÎMXPORT accompagne les entreprises de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine dans leur développement et leur expansion vers de nouveaux marchés. Cet accomplissement est rendu possible grâce à l’engagement de notre conseil d’administration, composé de leaders d’affaires visionnaires qui contribuent au dynamisme économique de notre région.

p Vice-président, E. Gagnon et Fils



M. Jocelyn Tennier
secrétaire-trésorier Directeur, Imprimerie des Anses vice-p Menu-Mer





Gaétan Denis, administrateur Propriétaire, La Crevette du Nord Atlantique et Les Crustacés de Malbaie





Guy Pardiac administrateur Consultant, Pardiac Consultation

















Venezrencontrer une équiped’experts quivous guidera dans l’accomplissement devos petitsetgrands projets!

INSPIRATION ETCONSEILS ÉCO ATTITUDE CONSEILS PEINTURE RÉNOVATION ET DÉCORATION


151, boul. deGaspé,Gaspé Tél. : 418368-2234 info@kega.co
Imprégnez-vous du moment
au rythme de la nature
parcs.canada.ca/forillon


Embrace the moment
and feel the rhythm of nature
parks.canada.ca/forillon
