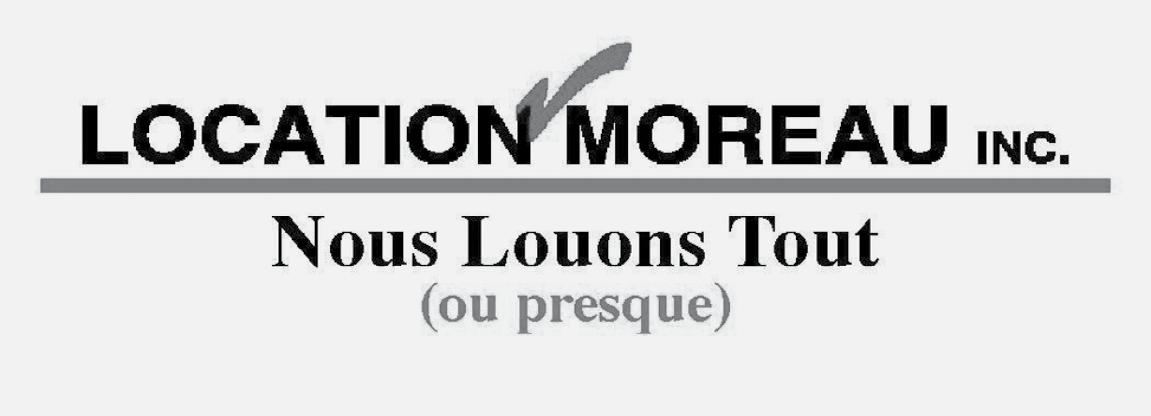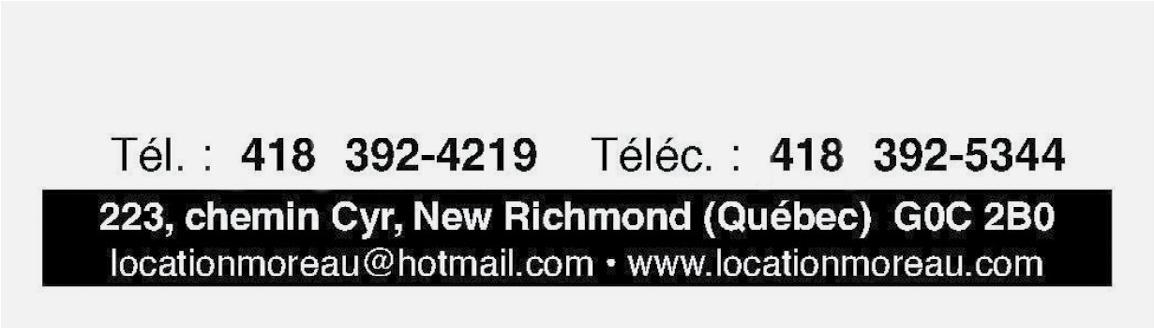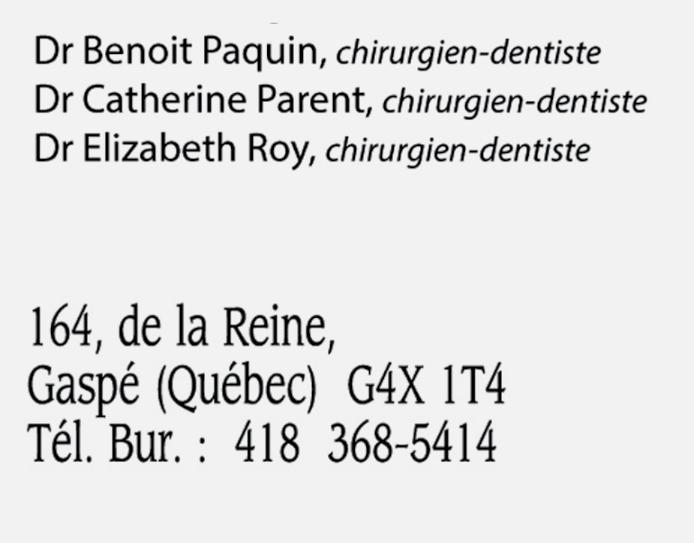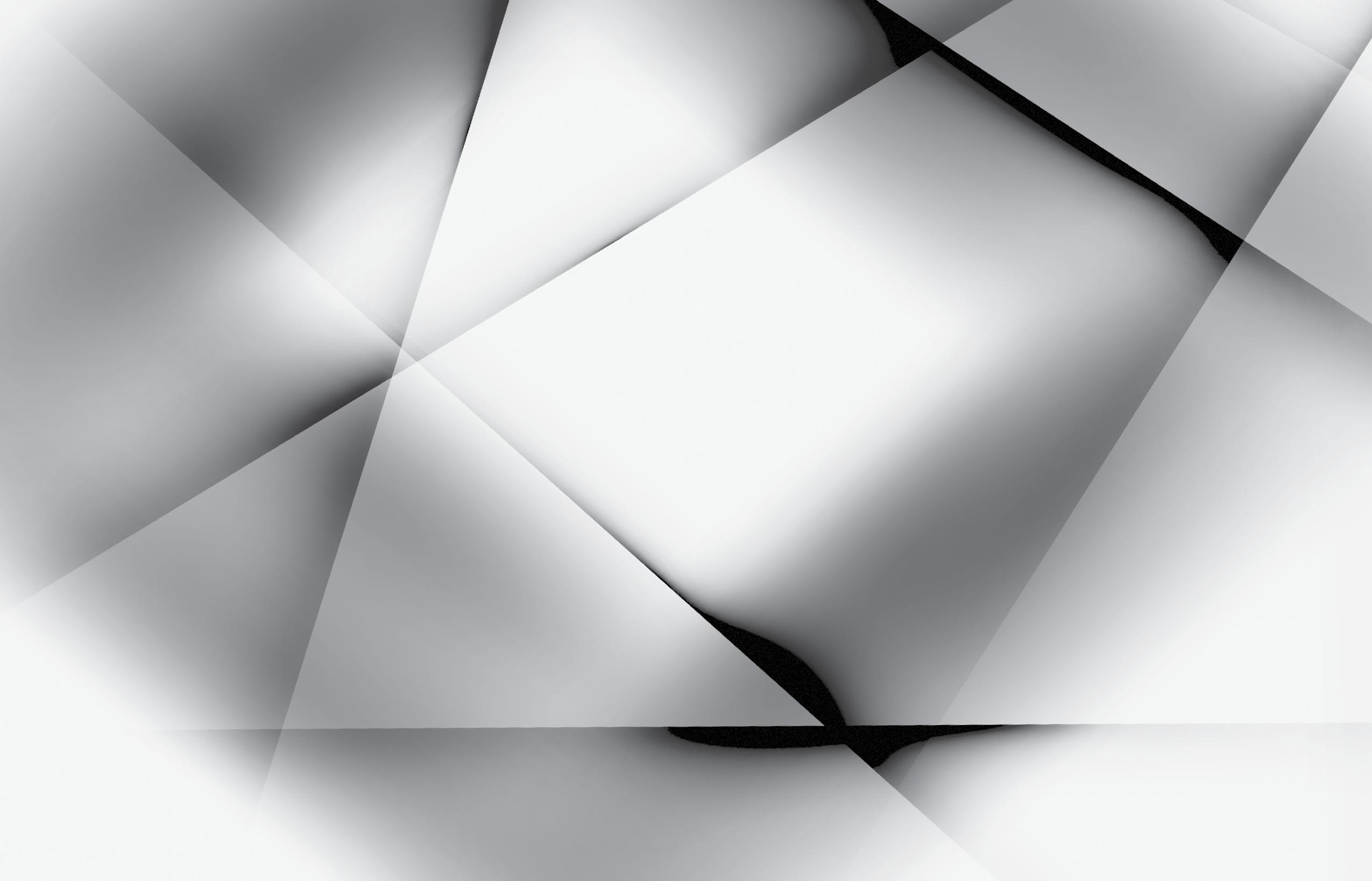magazinegaspesie.ca MAGAZINE D’HISTOIRE AOÛT – NOVEMBRE 2023 10,50 $ N° 207 60 ans SE RASSEMBLER L’ART DE 45 ANS D’ENVOLÉES POUR MONT-SAINT-PIERRE FÊTES GRANDIOSES POUR LE 4E CENTENAIRE DE L’ARRIVÉE DE CARTIER À GASPÉ 20 ANS DE BLUES AU BORD DE LA MER
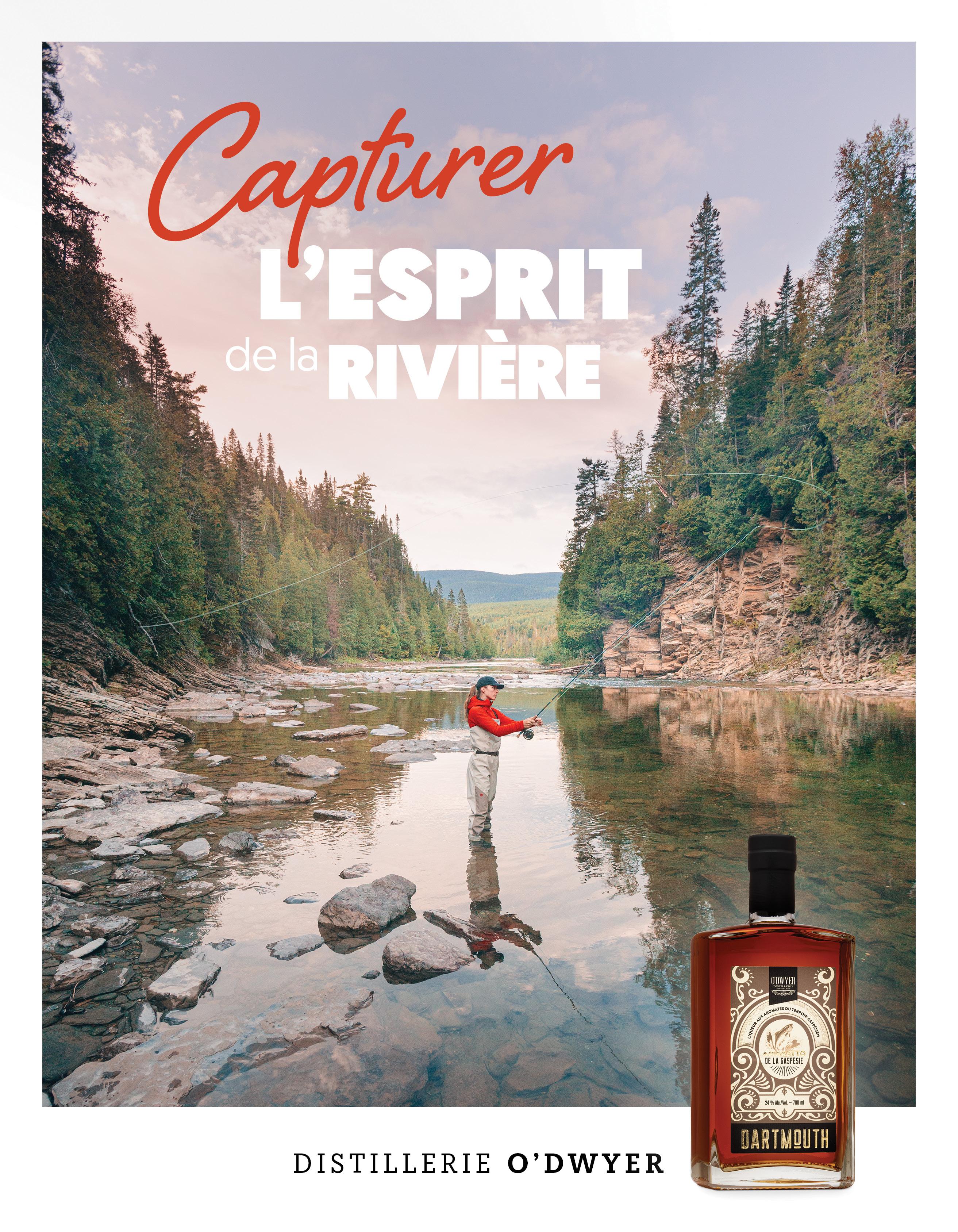
207 : L’ART DE SE RASSEMBLER
Août – Novembre 2023
207, vol. 60, n° 2
4 MAWIO'MI OU LE RASSEMBLEMENT TRADITIONNEL DES MI’GMAQS
Lita Isaac
6 LA COMMÉMORATION DU TRICENTENAIRE MI’GMAQ
David Bigaouette
Dossier
UN HOMMAGE À LA MER
Gisèle O’Connor
8 LA PREMIÈRE MESSE AU MONT SAINT-JOSEPH
Paul Lemieux
12 LE PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE AU QUAI
Danielle Jean
13 FÊTES GRANDIOSES POUR LE 4E CENTENAIRE DE L’ARRIVÉE DE CARTIER À GASPÉ
Sylvain Boudreau
SUIVEZ LE MAGAZINE SUR FACEBOOK!
17 SOUVENIRS DU WAKEHAM-YORK HOME COMING FESTIVAL

Elaine Bechervaise Patterson, Lois Bechervaise et Cynthia Patterson
20 45 ANS D’ENVOLÉES POUR MONT-SAINT-PIERRE
Claude Mercier et Marie-Josée Lemaire-Caplette
26 UNE AVENTURE UNIQUE POUR LES PASSIONNÉS·ES DE PLEIN AIR
Cindy de Lozzo et Claudine Roy
28 Photoreportage
C’EST LA FÊTE!
30 METTRE EN LUMIÈRE LE CINÉMA DOCUMENTAIRE
Maxime Boucher
VAL-D’ESPOIR : LES PREMIERS PAS D’UN CARNAVAL

Réal-Gabriel Bujold
31 BOIS FLOTTÉ : LA GENÈSE D’UN FESTIVAL DE SCULPTURES INSPIRÉ DU FOLKLORE
Marc-Antoine DeRoy
33 VINGT ANS DE BLUES AU BORD DE LA MER
Paul Lemieux
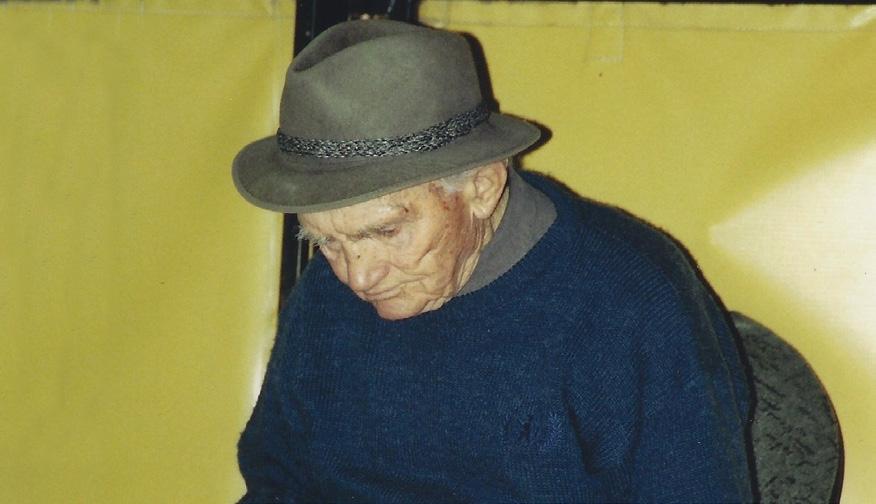
36 PETITE-VALLÉE AU TEMPS DES PRÉCURSEURS·ES
Élaine Réhel et David Richard
38 JETER L’ANCRE DEPUIS PRÈS DE DEUX DÉCENNIES EN MUSIQUE
Marie-Michèle Plante et Steve Pontbriand
41 Nos archives
LA CARTE POSTALE, GRANDES ET PETITES COMMUNICATIONS
Marie-Pierre Huard
Nos personnages
GEORGE SHEEHAN, HOMME D’AFFAIRES GÉNÉREUX
Michael Sheehan
Couverture
Bénédiction des bateaux au quai de Rivière-au-Renard, probablement lors du centenaire en 1955.
Musée
la Gaspésie. P268 Fonds Ladislas Pordan.
Éditeur
43 Nos objets
SAISIR L’INSTANT PRÉSENT
Vicky Boulay
48 Nos Gaspésiennes
MARIE BOUDOT (1715-1805)
Janet Harvey
51 Nos évènements
LISEZ UN RÉCIT SUR LE PÈLERINAGE À POINTE-NAVARRE, PAR JACINTHE FOURNIER
PROJET ÉOLE : L’HISTOIRE D’UN TITAN GASPÉSIEN
Patrick Kenney
Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 1 ]
Dossier
N°
Photo : Ladislas Pordan
45
de
Collection Réal-Gabriel Bujold
10 24
Collection famille Sheehan
Chronique
Août – Novembre 2023
N° 207, volume 60, numéro 2
Éditeur : Musée de la Gaspésie
Fondé en 1963, le Magazine Gaspésie est publié trois fois par an par le Musée de la Gaspésie. Le Magazine vise la diffusion de connaissances relatives à l’histoire, au patrimoine culturel et à l’identité des Gaspésiennes et des Gaspésiens. Il est membre de la Société de développement des périodiques culturels québécois (SODEP).

Comité de rédaction
Marie-Pierre Huard, Gabrielle Leduc, Marie-Josée Lemaire-Caplette, Paul Lemieux, Élaine Réhel et Jean-Philippe Thibault
Abonnements et ventes
Eileen Fortin-Lansloot
418 368-1534 poste 104 boutique@museedelagaspesie.ca
Rédactrice en chef
Marie-Josée Lemaire-Caplette
418 368-1534 poste 106 magazine@museedelagaspesie.ca
Coordination et publicités
Gabrielle Leduc
418 368-1534 poste 102 coordo.direction@museedelagaspesie.ca
Recherche iconographique
Marie-Pierre Huard
418 368-1534 poste 103 archives@museedelagaspesie.ca
Rédaction et collaboration
Lois Bechervaise, Elaine Bechervaise Patterson David Bigaouette, Maxime Boucher, Sylvain Boudreau, Vicky Boulay, Réal-Gabriel Bujold, Marc-Antoine DeRoy, Cindy de Lozzo,Janet Harvey, Marie-Pierre Huard, Lita Isaac, Danielle Jean, Patrick Kenney, Paul Lemieux, Claude Mercier, Gisèle O’Connor, Cynthia Patterson, Marie-Michèle Plante, Steve Pontbriand, Élaine Réhel, David Richard, Claudine Roy et Michael Sheehan
Conception graphique et infographie
Maïlys Ory | Graphiste
Révision linguistique
Robert Henry
Distribution en kiosque
Jean-François Dupuis
Impression
Deschamps Impression
Plateforme numérique magazinegaspesie.ca
Dépôt légal
Bibliothèque et Archives Canada, ISSN 1207-5280 (imprimé)
ISSN 2561-410X (numérique)
Bibliothèque et Archives nationales du Québec, ISBN 978-2-924362-32-7 (imprimé)
ISBN 978-2-924362-33-4 (pdf)
Copyright Magazine Gaspésie
Reproduction interdite sans autorisation
Nous reconnaissons l’appui financier du gouvernement du Canada.
Toute personne intéressée à faire paraître des textes conformes à la politique du Magazine Gaspésie est invitée à les soumettre à la rédactrice en chef. Celle-ci soumet ensuite une proposition d’articles au comité de rédaction.
Le Magazine Gaspésie n’est pas un média écrit d’opinion, mais encourage le pluralisme des discours pour autant qu’ils reposent sur des fondements. Les autrices et auteurs ont la responsabilité de leurs textes. Seuls les textes où cela est spécifiquement mentionné relèvent de l’éditeur.
Les textes sont écrits de manière inclusive afin de refléter son objet et son approche. Le vocabulaire épicène est utilisé autant que possible. Les textes appliquent la règle de féminisation par dédoublement et les graphies tronquées à l’aide de points médians. L’accord de proximité est utilisé à des fins de lisibilité.
Droits d’auteur et droits de reproduction
Toutes les demandes de reproduction doivent être acheminées à : Copibec (reproduction papier) : 514 288-1664 | 1 800 717-2022 | licences@copibec.qc.ca
Abonnement
1 an (3 nos) : Canada, 30 $ ; É.-U., 56 $ ; Outre-mer, 79 $ (taxes et frais de poste inclus)
Vente en kiosques
Prix à l’exemplaire : 10,50 $ (taxes en sus) - Liste des kiosques sur le site Web
Magazine Gaspésie
80, boulevard de Gaspé, Gaspé (Québec) G4X 1A9 418 368-1534 poste 106 magazine@museedelagaspesie.ca magazinegaspesie.ca
LeMagazineGaspésieesttout en couleurs grâceaux caisses Desjardins delaGaspésie.
ÊTRE ENSEMBLE, TOUT SIMPLEMENT
Pour les Gaspésiennes et les Gaspésiens, tous les prétextes sont bons pour se rassembler et célébrer ensemble, et ce, depuis longtemps. Les évènements festifs ne manquent donc pas dans la région! Certaines célébrations ont disparu de nos calendriers alors que d’autres se perpétuent depuis plusieurs décennies.
La plupart de ces évènements sont issus de longues traditions et font écho à l’histoire passée ou récente. Ainsi, il va de soi que plus nous remontons le temps, plus les rassemblements sont liés à des cérémonies ou des fêtes religieuses. De plus, rien d’étonnant à ce que plusieurs regroupements soient rattachés à la pêche ou à la mer, de l’ouverture de la saison de pêche aux tournois, en passant par les régates et les festivals de voile. Il n’est pas surprenant non plus de constater que les festivals de musique et de contes soient nombreux, rappelant les bonnes veillées gaspésiennes où résonnaient violon, piano, guitare et harmonica.
Certains évènements sont aussi marqués par les saisons et voient le jour dans différentes localités, comme la Fête des récoltes, le Festival des sucres, la bénédiction des bateaux ou encore les carnavals d’hiver. D’autres sont plus spécifiques comme le Festival international de jardins à Métis qui a cours depuis près de 25 ans ou encore le carnaval féministe La Riposte qui en est à sa toute première édition cette année.
Peu importe la thématique et le lieu, les festivals permettent aux communautés locales de se réunir et d’accueillir les touristes, en plus d’offrir une vitrine exceptionnelle à la Gaspésie dans les médias régionaux, nationaux et parfois même internationaux.
Commémorations historiques, rencontres sportives, évènements artistiques, réunions gourmandes… la liste des occasions pour se rassembler est longue, du sujet le plus
traditionnel au plus insolite! Ce numéro estival revient ainsi sur quelques évènements populaires d’antan et retrace l’historique de certains qui continuent de rayonner de nos jours.
La grande famille du Magazine Gaspésie

Comme vous le savez, l’année 2023 marque les 60 ans d’existence du Magazine Gaspésie. Quoi de mieux que ce thème festif et rassembleur pour poursuivre les célébrations! Pour souligner ces six décennies, nous voulons augmenter le nombre d’abonnements à la revue. Nous avons besoin de vous pour atteindre notre objectif : c’est le moment de vous abonner ou de faire plaisir à votre entourage et ainsi, d’intégrer la grande famille du Magazine Gaspésie! Vous pouvez vous abonner en ligne au magazinegaspesie.ca ou par téléphone au 418 368-1534 poste 104.

Marie-Josée Lemaire-Caplette
• Serviceprofessionnel etcourtois
• Équipementde dernièretechnologie
• Trèsbelinventairede monturesenvogue
Vosoptométristes defamille:
Dre LucieTremblayODet
Dr LouisThibaultOD
Rédactrice en chef du Magazine Gaspésie, Musée de la Gaspésie
ENVUEGASPÉ 8-A,ruedelaCathédrale
Divers macarons à l’effigie de festivals et d’évènements gaspésiens à travers le temps. Musée de la Gaspésie
418.368.2122
[AVANT-PROPOS]
Diverses communautés des Premières Nations ainsi que le grand public sont présents et de plus en plus nombreux au Mawio’mi de Listuguj; ici en 2022.
MAWIO'MI OU LE RASSEMBLEMENT TRADITIONNEL DES MI’GMAQS
Après des années d’interdiction par le gouvernement fédéral, l’organisation annuelle d’un pow-wow a repris à Listuguj en 1993. Cette grande fête du partage célèbre les communautés, la culture et l’identité des Premières Nations. « Pow-wow » est l’appellation moderne pour désigner le Mawio’mi qui signifie rassemblement en mi’gmaq. À l’origine, l’évènement mettait en valeur la beauté, la force, l’esprit et l’endurance du peuple mi’gmaq. Aujourd’hui, il s’agit davantage de maintenir les liens avec les traditions et de susciter un sentiment de fierté chez les Premières Nations. À l’aube du prochain rassemblement, découvrons le déroulement de cette rencontre ancestrale où danse, musique, nourriture et artisanat sont au cœur des festivités.

Vendredi matin, 6 h, heure du Nouveau-Brunswick que nous suivrons tout au long de la fin de semaine, nous allumons le feu sacré. Il restera allumé durant les trois jours du pow-wow, 24 heures sur 24, grâce au gardien du feu qui le surveille. Des cérémonies spirituelles y seront célébrées durant les festivités. Le vendredi soir, sous la grande tente, a lieu une soirée d’animation musicale par des groupes locaux. Les samedi et dimanche matins à 6 h se déroule une cérémonie
du lever du soleil au feu sacré. Le petit-déjeuner est ensuite offert gratuitement de 6 h jusqu’à 9 h. À 13 h a lieu la Grande Entrée, la cérémonie d’ouverture.
Une célébration de la culture sous toutes ses formes
Le samedi, la Grande Entrée commence avec l’introduction dans l’arène du maître de cérémonie qui présente les vétérans et les danseuses et danseurs traditionnels
qui défilent, suivis du chef et du conseil de bande, puis des danseurs en chef et de tous les autres participants·es. Vêtus de costumes colorés, les danseurs et danseuses se produisent dans l’arène. À 17 h, nous célébrons notre festin traditionnel sous la grande tente avec un repas composé d’orignal, de saumon, de têtes de violon, de légumes et de desserts maison, honorant ainsi les pêcheurs, les chasseurs et les cueilleurs. Ce que nous faisons, c’est que nous servons nos Anciens, nos
[ 4 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023
Lita Isaac Membre du comité organisateur du pow-wow depuis 1993, Gouvernement mi’gmaq de Listuguj
Photo : Félix Atencio-Gonzales
[DOSSIER]
batteurs de tambour et nos danseurs, puis le reste du public. Environ 1 000 personnes dégustent leur repas sous la grande tente. Après le festin, nous avons une soirée traditionnelle de danse et de tambour avec une compétition amusante et des prix, pour ne faire qu’un.
Le dimanche, les visiteuses et visiteurs peuvent magasiner dans les kiosques et découvrir les arts et le magnifique artisanat réalisés par les Premières Nations. Capteurs de rêves, mitaines traditionnelles, bijoux et autres objets significatifs sont offerts. Tous les commerçants·es de nourriture sont également des Premières Nations. Aucun alcool ni aucune drogue ne sont permis durant tout le rassemblement, comme c’est toujours le cas durant les pow-wow.

En 2022, le Mawio’mi a accueilli 5 000 personnes des diverses Premières Nations et du grand public ainsi que 400 danseuses et danseurs, neuf groupes de percussionnistes

et 50 artisans·es, toutes et tous autochtones. Nous invitons tout le monde et espérons que chacun·e aura la chance de vivre la belle cérémonie de danse et de chant au
feu sacré ainsi que le festin traditionnel afin de repartir avec quelque chose dans son cœur, dans son âme et dans ses souvenirs. We’lalioq (merci).

La danse est au cœur du rassemblement, chacune d’elle a une signification particulière, 2022. Photo : Félix Atencio-Gonzales

3 NUMÉROS En ligne : magazinegaspesie.ca | Par téléphone : 418 368-1534 poste 104 Abonnez-vous ou offrez-le en cadeau! magazinegaspesie.ca MAGAZINE D’HISTOIRE AOÛT – NOVEMBRE 2023 10,50 $ N° 207 60 ans SE RASSEMBLER L’ART DE 45 ANS D’ENVOLÉES POUR MONT-SAINT-PIERRE FÊTES GRANDIOSES POUR LE 4E CENTENAIRE DE L’ARRIVÉE DE CARTIER À GASPÉ 20 ANS DE BLUES AU BORD DE LA MER 30 $ taxes incluses seulement
[DOSSIER] ABONNEMENT VERSION IMPRIMÉE OU VIRTUELLE
LA COMMÉMORATION DU TRICENTENAIRE MI’GMAQ
En 1910 ont lieu à Listuguj les célébrations de la commémoration du tricentenaire mi’gmaq visant à célébrer les 300 ans de l’adhésion des Mi’gmaqs au catholicisme et leur fidélité à la religion. Pendant les trois jours de festivités se déroulant du 24 au 26 juin 1910, des autorités civiles et religieuses, la population catholique ainsi que des représentants·es de plusieurs communautés mi’gmaques des Maritimes assistent à des cérémonies, des chants, des discours, des danses, des repas, des feux d’artifice, des bénédictions et une exposition d’artisanat et d’antiquités mi’gmaques. Un chant national en mi’gmaq est même composé, des objets souvenirs distribués et un monument commémoratif est aussi érigé en souvenir des célébrations.
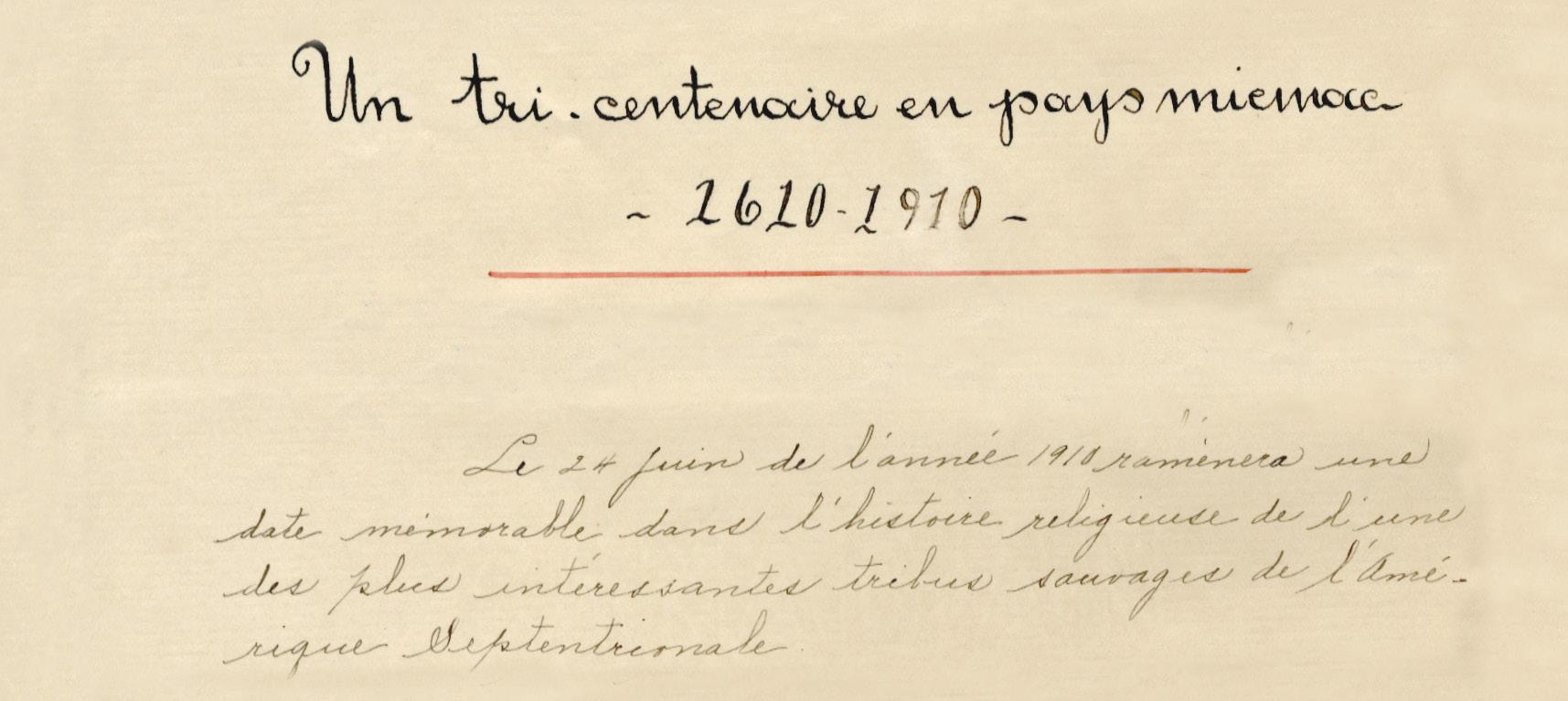 David Bigaouette
David Bigaouette
L’importance des commémorations
Les commémorations sont des rappels historiques d’évènements marquants qui permettent la construction d’une mémoire collective et qui favorisent une identité nationale propre à un groupe et à ses individus grâce aux logiques identitaires qui se dégagent de ces commémorations. Le maintien d’une cohésion sociale au sein d’un groupe devient possible à travers des références passées et l’expérience historique commune, que ce soit sur le plan
de la langue, de l’ethnicité, du territoire, de la religion, etc. Les commémorations deviennent aussi des instruments politiques et identitaires qui fixent les relations de pouvoir entre le groupe et la classe des dirigeants·es à travers des images et des symboles qui se retrouvent dans la matérialité et dans des lieux spécifiques (monuments, performances, spectacles, etc.). Ainsi, il est possible de décoder la construction des identités nationales à travers une lecture des commémorations et des techniques utilisées pour « parler » à la
nation. Dans le cas du tricentenaire mi’gmaq de 1910, plusieurs manifestations de ce type deviennent visibles pour célébrer les 300 ans de l’adhésion des Mi’gmaqs au catholicisme.
Un espace de rencontres et d’échanges
Le tricentenaire mi’gmaq veut favoriser un espace de rencontres et d’échanges entre catholiques. Des Mi’gmaqs de plusieurs communautés des Maritimes se retrouvent à Listuguj afin de célébrer leur catholicisme.
[ 6 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023
Doctorant en histoire, Université de Montréal, et originaire de Saint-Siméon-de-Bonaventure
[DOSSIER]
Extrait d’une correspondance du père Casimir à propos de la préparation de la fête, suivie de l’autorisation de l’évêque de Rimouski Mgr Blais, 1909. ANQ Gaspé. P9,S15,SS2,D1
Même que des chefs, capitaines et conseillers mi’gmaqs se seraient consultés à huis clos afin de délibérer sur certaines affaires. Une cérémonie du « nesgeoet » (chants, discours et danses) est déployée devant le public. En plus de cette réunion des Mi’gmaqs, les autres pratiquants·es catholiques de toutes origines ont pu se rassembler pour s’imprégner à la fois du catholicisme des Mi’gmaqs, mais aussi de leur histoire et de leur culture traditionnelle.
Le tricentenaire est aussi un espace discursif axé sur une interprétation de l’histoire. Dans les discours des autorités religieuses, on peut en effet lire sur l’importance des alliances avec la France pour l’adhésion des Mi’gmaqs au catholicisme, sur l’importance du voyage de Jacques Cartier et de ses contacts avec les premiers habitants·es de Gaspé et surtout, sur l’importance du baptême en 1610 du chef Membertou. Du côté des Mi’gmaqs, le grand chef traditionnel John Denny prononce un discours rempli de reconnaissance aux missionnaires français qui ont apporté le catholicisme et aux ancêtres qui ont accepté la religion. Ces discours s’incarnent notamment dans l’érection du monument commémoratif.
Des figures importantes gravées dans un monument
Afin de garder un souvenir de la commémoration du tricentenaire,
un monument est érigé sur le site de l’église de Sainte-Anne-deRistigouche. L’emplacement du monument n’est pas un hasard : les missionnaires capucins cherchent à légitimer l’Église catholique en rappelant aux Mi’gmaqs, à travers le monument, l’importance de la présence de missionnaires français en Nouvelle-France, tout en faisant des liens avec l’adhésion des Mi’gmaqs au catholicisme. Deux figures apparaissent sur le monument : Membertou et Sainte Anne.

Le tricentenaire mi’gmaq de 1910 s’appuie sur le fait que le grand chef mi’gmaq Membertou s’est fait baptiser en 1610 à Port-Royal par le missionnaire Jessé Fléché. Le chef apparaît sur le monument comme la personnification de toute la nation mi’gmaque, première nation autochtone à avoir adhéré au catholicisme au Canada. Selon l’interprétation des Capucins, Membertou se serait donné pour mission de travailler à la conversion de la tribu entière et que le baptême du grand chef est le jour 1 à partir duquel tous les Mi’gmaqs deviennent catholiques. Il est représenté à genou et acceptant le sacrement.
L’autre figure est Sainte Anne, la patronne des Mi’gmaqs. Elle aurait été introduite par les missionnaires français Vimont et Vieuxpont auprès des Mi’gmaqs en 1628 sur l’Île du Cap-Breton en l’honneur d’Anne d’Autriche, reine de France et épouse
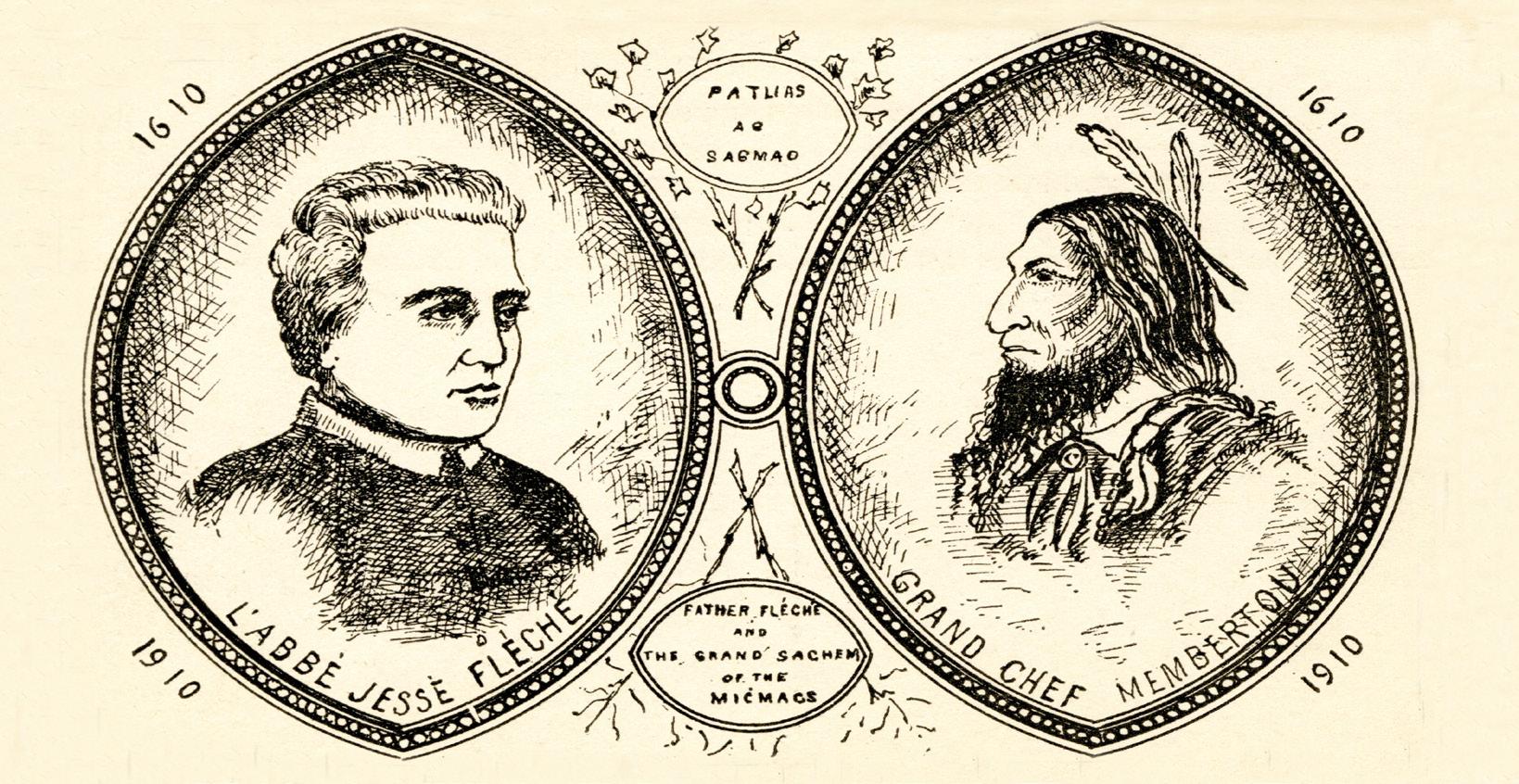
de Louis XIII. C’est ainsi que le culte de Sainte Anne s’est répandu chez les Mi’gmaqs au fil du temps. En réalité, l’adoption de la sainte par les Mi’gmaqs est une transposition de la figure de Nogami, la grandmère ourse de Glooscap, issue des croyances traditionnelles mi’gmaques. Comme Nogami, Sainte Anne possédait des vertus de guérison et de protection. En utilisant Sainte Anne, les Mi’gmaqs se sont ainsi accommodés de l’expression d’une forme de syncrétisme dans laquelle on se doit de respecter le statut de grand-mère et celui d’aînée. Les figures de Membertou et de Sainte Anne sont alors des symboles utilisés par les Capucins afin de renforcer l’identité religieuse spécifique des Mi’gmaqs.
Finalement, les Capucins tentent, à travers la commémoration, de démontrer au public l’importance du catholicisme dans l’identité des Mi’gmaqs à l’aide de symboles religieux significatifs pour ces derniers. Pour leur part, les Mi’gmaqs réussissent à la fois à démontrer leur fidélité au catholicisme, mais aussi les aspects spécifiques de leur culture. L’objectif de la commémoration de 1910 est de voir les Mi’gmaqs maintenir leur tradition catholique sous la bienveillance des missionnaires capucins.
Remerciements aux Archives nationales du Québec et Cimetières du Québec qui ont respectivement mis gracieusement à disposition leurs archives et photographies.
Carte postale représentant l’abbé Jesse Fléché et le grand chef Henri Membertou, 1910. L’illustration apparaît aussi dans le livre Souvenir d’un IIIe centenaire en pays Micmac. Sist gasgemtelnaganipongegeoei Migoitetemagani oigatigen. Souvenir of the Micmac tercentenary celebration. 1610-1910, publié par les frères mineurs capucins. ANQ Gaspé. P9,S200,SS2,SSS2,D1,P15
Œuvre du statuaire Carli de Montréal, le monument est érigé à côté de l’église de Sainte-Anne-de-Ristigouche en 1910 par le père Pacifique de Valigny, 2016.
[DOSSIER]
Photo : Gilles Lavoie Cimetières du Québec
LA PREMIÈRE MESSE AU
MONT SAINT-JOSEPH
Le 6 septembre 1934, un important rassemblement réunit une foule de paroissiennes et paroissiens au sommet du mont Saint-Joseph à Carleton-sur-Mer, initiant une tradition de pèlerinage qui s’étalera sur des décennies. À l’origine de cet évènement se trouve un prêtre, le nouveau curé de Carleton, l’abbé Joseph-Grégoire-Clément Plourde.

Une nouvelle vocation
L’habitude de fréquenter le sommet du mont Saint-Joseph à des fins religieuses date du 19e siècle. À ce chapitre, l’histoire retient le nom de sœur Marcelle Mallet, des sœurs de la Charité de Québec, qui, en 1868, fait l’ascension de la montagne pour y déposer une statue du SacréCœur. Ce coup d’envoi est suivi, en juillet 1878, par l’initiative de la Société Saint-Jean-Baptiste de Carleton, de la plantation d’une croix de 7 mètres (23 pieds) au sommet. En 1918, une statue, récupérée sur la devanture de l’église de Carleton, y est déposée. Puis en 1925, à l’initiative
du curé Édouard-Pierre Chouinard, une souscription publique permet d’amasser 217 $ (environ 3 600 $ aujourd’hui) pour l’achat et l’installation dans une niche d’une statue de Saint-Joseph de 2 mètres (6,5 pieds), en bois recouvert de plomb et plaqué or.
Plus que jamais, des hommes et des femmes s’aventurent dans les sentiers de la montagne pour aller se recueillir et exprimer leur ferveur au sommet de la montagne.
L’arrivée du curé Plourde
Le 10 septembre 1933, l’abbé Plourde accède à la cure de Carleton. L’homme
manifeste une foi inébranlable en Saint-Joseph et n’est pas insensible aux liens que ses paroissiennes et paroissiens entretiennent avec la montagne.
Dans l’esprit du curé Plourde, un projet va naître. En juillet 1934, dans une lettre adressée à Mgr Ross, évêque du diocèse de Gaspé, il fait part de ses intentions : « Voulant rendre plus vive et plus efficace cette dévotion à Saint-Joseph, je désirerais conduire mes paroissiens en pèlerinage sur la montagne et là célébrer une fois l’an et solennellement la messe sur le piédestal de la statue, un sermon serait donné et
[ 8 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023
Paul Lemieux Historien et résident de Carleton-sur-Mer
[DOSSIER]
La foule se presse autour de l’autel dressé devant la niche de la statue de Saint-Joseph lors de la première messe sur la montagne, 1934. Écomusée Tracadièche
une collecte faite pour les bonnes œuvres. […] Le chemin qui y conduit, tout en étant abrupt, est bon pour les voitures automobiles et hippomobiles. Au sommet avec un peu de travail, nous pouvons trouver place pour environ 50 chars et autant de chevaux et plusieurs centaines de personnes, quantité : 1000. […] Si la température le permet, le pèlerinage aurait lieu le 15 août, fête des Acadiens, mes paroissiens le sont presque tous. […] La messe serait célébrée à dix heures. Puis goûter et retour en procession pour descendre la montagne au chant des cantiques. […] Notre bonheur serait à son comble si Votre Excellence pouvait, cette année au moins, présider ce pèlerinage, y prêcher ou chanter la messe à son bon plaisir. »1
Comme réponse, le curé Plourde reçoit l’assentiment de son évêque pour organiser cette messe et la répéter tous les ans. Mgr Ross ne sera pas présent à cet office religieux qui, pour une raison inconnue, sera décalé au début de septembre.
Le grand jour
Le dimanche 19 août 1934, en chaire, le curé Plourde lance une invitation à ses ouailles à assister à une messe qui sera célébrée le jeudi 6 septembre à 10 h au sommet de la montagne. Dès ce moment, une corvée se met en branle pour aménager les lieux, aplanir le terrain, édifier une estrade et un autel et décorer le site.
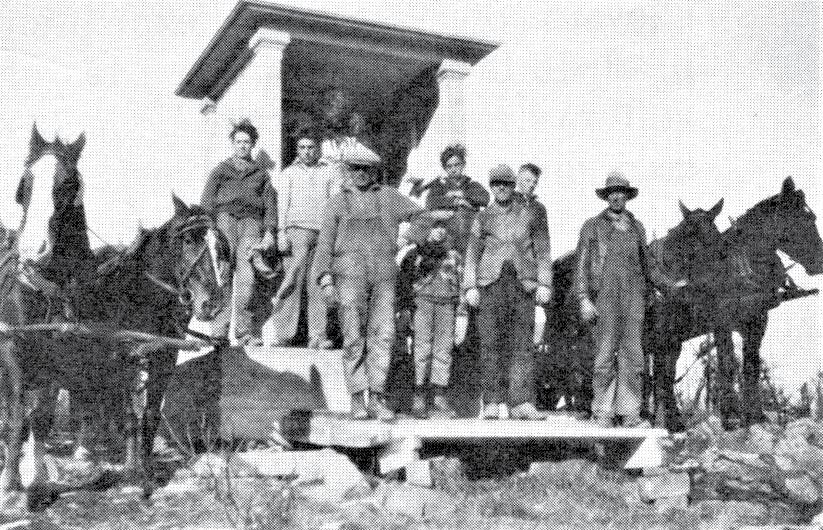
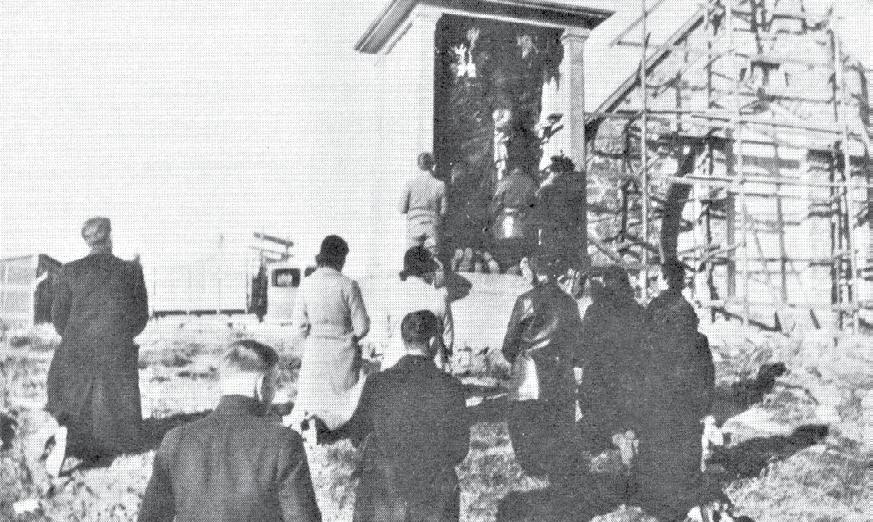
Au niveau de l’accès, la route qui serpente le flanc de la montagne a subi d’importants travaux à l’été 1932, grâce à une subvention de 1000 $ (environ 20300 $ aujourd’hui) de l’honorable Hector Laferté, ministre de la Colonisation, de la Chasse et des Pêcheries, qui passe tous ses étés à Carleton. Ces travaux permettent d’améliorer l’état du chemin, de l’élargir un peu, de déboiser et d’aplanir les abords de la route afin de la rendre carrossable.
La journée du 6 septembre débute à 7 h par la distribution de la communion à l’église de Carleton pour éviter que les gens fassent l’ascension de la montagne l’estomac vide, compte tenu qu’à l’époque, il fallait être à jeun depuis trois heures pour recevoir la communion.

Après déjeuner se fait l’ascension dans un ordre très précis. Dans un premier temps, les gens à pied sont invités à entreprendre la montée, suivis par les gens en voiture à cheval jusqu’à 9 h 30. Après, les automobiles et les camions, chargés d’hommes et de femmes, prennent la route. Toute la circulation est coordonnée par des officiers de la voirie. Il faut préciser que, malgré les travaux de 1932, le chemin de la montagne ne permet pas aux véhicules de se rencontrer
le long du parcours. C’est pourquoi un plan d’accession est mis en place pour éviter la congestion.
Vers 10 h se fait la messe devant la foule endimanchée, se tenant debout autour de l’autel décoré pour l’occasion. Après la messe, un pique-nique permet un moment de détente, puis les gens se rassemblent à nouveau autour de la statue de Saint-Joseph pour réciter des prières et entonner des cantiques. Puis, c’est le signal de la descente de la montagne et le retour vers le village en suivant l’ordre inverse, soit les automobiles et les camions, les voitures tirées par des chevaux et finalement les gens à pied, mettant ainsi fin à cette journée qui passera à l’histoire.
Le succès de cette première messe fera en sorte que l’abbé Plourde cogitera un projet encore plus grand, soit de construire une chapelle au sommet de la montagne. Ce rêve, grâce à une corvée qui mobilisera le village, deviendra réalité l’année suivante, en 1935.
Note
1. Micheline LeBlanc, Un Sommet de la Foi à Carleton, Carleton-sur-Mer, avril 1996, 173 p.
Des pèlerins se recueillent devant la statue de SaintJoseph, tout près de la chapelle en construction, 1935. Collection Paul Landry
Des ouvriers préparent le terrain et construisent l’autel en prévision de cette première messe, 1934.
Collection Yvon Bernard
UN HOMMAGE À LA MER
La bénédiction des bateaux est une tradition ancienne dont l’origine remonte à l’époque où les marins passaient de longs mois en mer. Elle se déroule dans de nombreux villages maritimes à travers le monde et a pour but de protéger les pêcheurs et les marins, de commémorer ceux ayant perdu la vie, mais aussi de célébrer la mer. Rivière-au-Renard, capitale québécoise des pêches, honore cette tradition, tout comme de nombreuses localités gaspésiennes.

Gisèle O’Connor Membre, Corporation de développement de Rivière-au-Renard et résidente de Rivière-au-Renard
La bénédiction des barges est une fête religieuse instaurée par le curé Élias P. Morris, curé de Rivière-au-Renard de 1887-1930. Il est à la dévotion de Sainte-Anne dont la fête est le 26 juillet et c’est à cette date en 1912 qu’a lieu la première bénédiction des barges. Chaque année, le dimanche près du 26 juillet, la fête est célébrée. Les rues sont ornées d’arches vertes de sapin et de cèdre. Les pêcheurs décorent également leurs bateaux à leur goût pour l’évènement, principalement avec des branches
d’arbre : sapin, cèdre et même feuillus. Le prêtre, accompagné d’un invité d’honneur, des enfants de chœur et de la chorale, se rend sur le quai. Il récite les prières d’usage et bénit les bateaux qui patientent en file, prêts à défiler dans l’anse. Après les prières et les chants, le célébrant et ses accompagnateurs embarquent dans une barge désignée et les pêcheurs lèvent l’ancre et se suivent pour former une procession sur l’eau, ce qui présente un spectacle populaire et enjoué au son des chants comme Partons,
la mer est belle. Le cortège vogue dans l’anse et une gerbe de fleurs blanches est déposée sur l’eau en souvenir des marins perdus en mer.
Au fil du temps, la bénédiction des barges devient la bénédiction des bateaux : Gaspésiennes, chalutiers ou crevettiers. La date est changée pour le 24 juin, mais elle demeure toujours religieuse. La Saint-Jean-Baptiste et son petit garçon frisé, de préférence blond, est populaire. Il y a la parade des autos, décorées et klaxonnant, qui défilent pour ensuite aller au quai pour la bénédiction. Le curé est là avec
[ 10 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023
Fête des pêches à Rivière-au-Renard, entre 1975 et 1985.
[DOSSIER]
Photo : Bernard Bélanger, Le Pharillon Musée de la Gaspésie. Fonds Journal Le Pharillon. P285/4/3
La Nuit des homardiers
Depuis quelques années, un rassemblement est organisé à La Vieille Usine de L’Anse-à-Beaufils pour la mise à l’eau des casiers à homards. Percé étant la première zone à sortir ce crustacé en avril, cette fête permet de souligner le début de la saison de pêche. Musique, petitdéjeuner et observation du lever du soleil sont au programme, sans oublier la bénédiction des bateaux par le curé, alors que plus de 150 capitaines prennent la mer, de Mont-Louis à Miguasha, pour déposer entre 35 000 à 40 000 casiers.
À l’époque, ce rituel regroupait la parenté et les proches des pêcheurs qui venaient aider à mettre les casiers à l’eau. Bien que la forme soit un peu différente aujourd’hui, la tradition se perpétue et offre un magnifique spectacle sur l’eau à ceux et celles qui ont le courage de se lever en plein nuit pour encourager les pêcheuses et pêcheurs.
la chorale et accueille la foule avec des prières et des chants. Les gens rassemblés et joyeux embarquent dans les gros chalutiers très décorés, le temps de prendre le large pour déposer une gerbe de fleurs et revenir. Beaucoup de touristes viennent visiter leur famille à cette période.
Une grande fête pour célébrer la pêche Puis, vient le Festival des pêches, en 1970. La bénédiction devient l’évènement important du festival. Après la messe de la Saint-Jean-Baptiste, la bénédiction des bateaux est prête à être célébrée, les bateaux sont désormais décorés de fanions colorés. Le curé et ses accompagnateurs sont prêts à accueillir les paroissiennes et paroissiens et les touristes. La foule peut atteindre entre 900 et 1 000 personnes. C’est très festif et convivial. Le Festival des pêches est célébré de 1970 à 1990 et une reprise a lieu en 2006 pour le 150e anniversaire du village. Le Festival des pêches est un festival qui ne peut mieux correspondre au vécu du village de Rivière-au-Renard. Et si grandes soient les difficultés rencontrées par l’industrie de la pêche, les citoyennes et citoyens prennent le temps, une fois par année, de fêter et de rendre hommage à la mer.

Pour la bénédiction des bateaux, presque tous les pêcheurs se font un devoir d’être présents à cette manifestation. C’est un spectacle tout à fait féérique et inoubliable que la balade de tous ces chalutiers
décorés sur la mer. Gilles Tapp, pêcheur possédant 43 ans d’expérience, a appris la pêche avec son père, Zéphirin. Il a commencé la pêche avec la barge et ensuite avec un chalutier. Gilles Tapp a ainsi connu la bénédiction des barges à l’époque la plus spectaculaire. Il raconte qu’après les vêpres, le dimanche, le prêtre, habillé avec un surplis par-dessus sa soutane, se rendait au quai pour la cérémonie. Les pêcheurs accueillaient alors leurs familles : enfants, père et mère, jusqu’à 10 ou 15 personnes par barge.

C’est une véritable fête qui prend toute sa signification, mais avec les années, la participation à la bénédiction des bateaux a décliné pour différentes raisons. Comme les pêcheurs ne peuvent plus se présenter à l’usine en même temps, il est de plus en plus difficile de les regrouper au quai en pleine saison de pêche. De plus, pour des raisons de sécurité et des exigences de compagnies d’assurances, les capitaines ne peuvent plus faire monter les gens à bord de leurs chalutiers. Pour ces raisons entre autres, la cérémonie de la bénédiction des bateaux a quelque peu perdu de sa popularité au fil des années.
Remerciements à Gilles, René et Louise Tapp ainsi qu’à Mariette Mainville pour leurs souvenirs ainsi qu’à La Vieille Usine de L’Anse-à-Beaufils pour avoir mis gracieusement à disposition sa photographie.
Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 11 ]
Départ des bateaux vers 3 h du matin lors de la Nuit des homardiers à L’Anse-à-Beaufils, 2022.
Photo : La nomade photographie
La Vieille Usine de L’Anse-à-Beaufils
[DOSSIER]
Le Havre aux maisons appartient au pêcheur Gilles Tapp, 1982. Il est rempli de monde et tout décoré à l’occasion de la bénédiction des bateaux. Collection Gilles Tapp
Rassemblement et soirée musicale lors des Jeudis soir Ô quai à Sainte-Flavie, 2019. Municipalité de Sainte-Flavie

LE PLAISIR D’ÊTRE ENSEMBLE AU QUAI
Depuis l’existence du quai à Sainte-Flavie, les gens ont pris l’habitude de s’y réunir. Ce chemin qui s’avance dans la mer attire à l’époque de nombreux curieux et curieuses pour observer l’arrivée des bateaux de pêche, avec leurs cargaisons abondantes, et des goélettes qui transportent des marchandises comme le bois de pulpe. Même qu’en 1939, un petit navire baptisé Mont-Joli fait du transport maritime de marchandises et de passagers entre les deux rives. Il y a toujours des rassemblements sur ce quai, surtout quand un pêcheur de la place capture le plus gros poisson et ce ne sont pas des « histoires de pêcheurs »!
Danielle Jean
Agente de développement et communications, municipalité de Sainte-Flavie
Des photos d’archives relatent des pêches miraculeuses qui font office de contes légendaires comme un requin de 13 pieds (3,9 mètres) pesant 1 900 livres (860 kg) et un flétan de 7 pieds (2,1 mètres) de 345 livres (157 kg) pêchés par Louis Verreault en 1929. Il y avait du filet dans ça pour toute une grosse famille et tout le monde voulait être ami avec ce pêcheur! Aujourd’hui, le quai de Sainte-Flavie attire toujours autant de gens qui viennent s’émerveiller devant le magnifique coucher de soleil, pour venir jaser un bon coup avec les voisins·es et profiter de la douce brise de la mer ou pour venir pêcher sur le quai avec des proches. Les poissons sont moins gros, mais la pêche est bonne; éperlans, soles ou petits flétans (quand la mer est généreuse) font le bonheur des pêcheuses et pêcheurs. Il faut juste être patient·e et attendre que la marée montante nous apporte ses fruits, car on dit que « la patience est amère, mais son fruit est doux ».
Lieu de rassemblement populaire
Sainte-Flavie, la porte d’entrée de la Gaspésie touristique, là où on passe deux fois quand on fait le tour de la péninsule, là où la route 132 Est garde son orientation même vers le nord et nous offre une vue imprenable sur les montagnes nordcôtières et sur l’immensité de notre beau fleuve Saint-Laurent. Le quai s’est refait une beauté depuis que le fleuve, qu’on appelle ici la mer, s’est déchaîné lors de la tempête des grandes marées en 2010. Ce lieu de rassemblement populaire s’est fait malmener et fracasser par les vagues créant une longue brèche, comme une faille après un tremblement de mer.
Depuis sa reconstruction en 2012, le sourire est revenu sur le visage des abonnés·es du quai. Afin de célébrer, animer et s’approprier ce « nouveau » lieu de rassemblement, pourquoi ne pas organiser un évènement pour rendre hommage
à tant de beauté que nous offre la nature? Voilà donc qu’une idée a germé et que les Jeudis soir Ô quai sont devenus une tradition depuis 2013. Cela fait maintenant 10 ans qu’à tous les jeudis de juin à août, les amatrices et amateurs de musique et de culture se réunissent pour célébrer le plaisir d’être ensemble. Cornemuse, guitare, accordéon, piano, rock, traditionnelle, country, toutes les musiques pour tous les goûts, font chanter, taper du pied et danser. Touristes et gens de la région apportent leur chaise et s’installent dans ce décor enchanteur et festif, et ce, gratuitement.
Et rappelez-vous que sur le quai à Sainte-Flavie, on y vient en amoureux, en famille, en solitaire, que vous veniez du Québec, de l’Ontario ou d’Europe, il y aura toujours quelqu’un pour placoter une légende ou l’histoire du pêcheur qui a attrapé un requin de 1 900 livres!
[ 12 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023
[DOSSIER]
FÊTES GRANDIOSES POUR LE 4E CENTENAIRE DE L’ARRIVÉE DE CARTIER À GASPÉ
En juin 1929, le sénateur et ancien député fédéral de Gaspé, Rodolphe Lemieux, lance l’idée de souligner le quadricentenaire de l’arrivée de Jacques Cartier à Gaspé en 1934. Malgré la crise économique, l’idée est accueillie avec enthousiasme un peu partout au pays ainsi qu’en France et en Angleterre. L’appui du Vatican concrétise le projet.
Sylvain Boudreau
Le sénateur David-Ovide L’Espérance, président du comité régional de Gaspé et qui réside à Percé durant l’été, dévoile en juillet 1934 une programmation ambitieuse, élaborée par le comité national du Canada et celui de France. Les fêtes se tiendront à Gaspé les 25 et 26 août. Au programme : accueil de navires et d’une délégation française à bord du paquebot Champlain, dévoilement d’une croix en hommage à Cartier, banquet, feux d’artifice, fête de nuit, chorale, messe pontificale, etc.
Le comité régional donne le mandat à une dizaine d’anciens élèves des Écoles des Beaux-Arts de Montréal et de Québec de concevoir toutes les décorations pour Gaspé ainsi que celles qui figureront sur les barges participant à l’évènement.
On crée un costume d’époque qu’acceptent de porter de « jolies Gaspésiennes », qui consiste en une robe normande traditionnelle agrémentée d’une touche bretonne.
À la mi-août, on informe le public que près de 4 000 chambres sont disponibles entre Douglastown, Gaspé et Rivière-au-Renard. On suggère cependant aux résidents·es de la côte d’apporter des tentes, tel que le conseille d’ailleurs l’évêque de Gaspé, Mgr Ross! Aucun stationnement de véhicule ne sera toléré à l’intérieur de la localité, mais des stationnements seront disponibles à proximité et des agents de la Police provinciale dirigeront le trafic. Enfin, des trains spéciaux sont organisés par le CNR pour venir assister aux célébrations.
Réplique miniature de la croix en bois plantée par Jacques Cartier conçue pour les célébrations du 400e de sa venue à Gaspé, 1934. La réplique fait 4 pieds (1,2 mètres) de haut et les deux panneaux ont été réalisés par un artiste de l’École des BeauxArts de Montréal ou de Québec.

Collection Sylvain Boudreau

Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 13 ]
Historien et originaire de Carleton-sur-Mer
Foule lors de la cérémonie d’inauguration de la Croix du Souvenir, 1934. La croix est déplacée deux fois par la suite et se trouve aujourd’hui sur le site de Berceau du Canada.
Musée de la Gaspésie. Collection Centre d’archives de la Gaspésie. P57/6b/106.1
[DOSSIER]
Quelques-unes des personnalités présentes
- Pierre Étienne Flandin, ministre français des Travaux Publics et chef de la mission française
- Sébastien Charlety, recteur de l’Université de Paris
- Henry Bordeaux et le duc de Lévis-Mirepoix, écrivains et membres de l’Académie française
- Charles de la Roncière, Fortunat Strowski et Fernand Gregh, écrivains
- Franc Nohain, écrivain et journaliste à l’Écho de Paris
- Firmin Roz, enseignant et historien
- Louis Blériot, célèbre aviateur
- Richard Bedford Bennett, premier ministre du Canada
- Roger Kayes, amiral et représentant officiel du gouvernement britannique
- Warren D. Robbins, ministre des États-Unis au Canada
- Ésioff-Léon Patenaude, lieutenant-gouverneur du Québec
- Charles-Philippe Beaubien, Georges Perry Graham, David-Ovide L’Espérance, Raoul Dandurand et Rodolphe Lemieux, sénateurs
- Arthur Sauvé et Alfred Duranleau, présidents conjoints des fêtes et ministres
- Louis-Alexandre Taschereau, premier ministre du Québec
Gaspé sous le signe de la fébrilité
Le 25 août 1934, les hôtels sont remplis à pleine capacité et plusieurs maisons sont transformées en hôtellerie d’occasion. Des tentes plantées près de la gare abritent 50 militaires provenant du Royal 22e Régiment ou des Fusiliers du St-Laurent alors que d’autres reçoivent des scouts ainsi que des visiteuses et visiteurs. L’arrivée massive de toutes ces personnes fait passer soudainement le statut de Gaspé à celui de métropole, et ce, pour au moins 48 heures.
Sur toutes les maisons de Gaspé flottent les couleurs françaises ou anglaises et l’activité est grande dans la municipalité. La Croix du Souvenir, une imposante pièce de granit de 42 tonnes et 30 mètres de haut, se dresse majestueusement et domine la baie de Gaspé. Des haut-parleurs sont disposés tout autour afin de permettre à l’assistance d’entendre les discours prononcés lors du dévoilement. Les stations CKAC de Montréal et CHRC de Québec vont diffuser toutes les cérémonies. La population
et les visiteuses et visiteurs attendent impatiemment l’arrivée du Champlain qui amène les distingués invités·es.
Plusieurs navires sont déjà présents dans la baie de Gaspé, dont trois vaisseaux de guerre français, le Vauquelin, le D’Entrecasteaux et le Ville d’Ys, alors que la Grande-Bretagne est représentée par le Dragon On compte aussi le destroyer canadien Saguenay et le Richelieu avec à son bord les voyageuses et voyageurs du congrès des municipalités. Plusieurs navires du gouvernement canadien sont amarrés au quai, tels
que le Lady Grey, le brise-glace Saurel, l’Acadia, le Mardep, le Gaspesia, le Druid, le Loos et deux vedettes du Revenu national. Trois hydravions évoluent dans le ciel tandis que des barges sillonnent la baie de Gaspé dans tous les sens.

Des fêtes grandioses
Le Champlain arrive à Gaspé à 11 h avec à son bord les 150 délégués·es français et des centaines de passagères et passagers. Deux avions le survolent en lui jetant des fleurs pendant que hurlent et résonnent toutes les sirènes du port et que le Saguenay tire une salve de 21 coups de canon. Soixante-dix barges « aux voiles festonnées de dessins légendaires et des armoiries de la Normandie et de la Bretagne »1 vont à la rencontre du paquebot. Parmi la délégation, on compte des politiciens, des universitaires, mais aussi des écrivains. Le gros de la délégation débarque à Gaspé au début de l’après-midi et reçoit un accueil très chaleureux. Il est près de 16 h lorsque débute la cérémonie officielle. Le régiment des Fusiliers du St-Laurent est le premier à se rendre sur le promontoire où a été érigée la croix, puis on voit défiler la fanfare du Royal 22e Régiment, les militaires portant l’habit rouge de gala, le capitaine Charles O’Neil en tête. La fanfare est rejointe par 100 chanteuses et chanteurs d’une chorale de Québec, sous la direction de Jean-Marie Beaudet et du baryton Placide Morency. Les marins des navires français et anglais viennent ensuite se placer en arrière du monument. Une estrade a été construite autour de la croix et les
[DOSSIER]
Le paquebot Champlain dans la baie de Gaspé, 1934. Département de la Défense. A4752-7
scouts viennent y former une garde d’honneur.
La foule acclame l’arrivée du cardinal Rodrigue Villeneuve, le délégué apostolique Mgr Andréa Cassulo, Mgr François-Xavier Ross, qui s’avère « l’âme de ces fêtes grandioses », ainsi que plusieurs autres évêques et membres du clergé de toutes les parties de la province et du Canada. Les applaudissements se poursuivent à l’arrivée des ministres, sénateurs et autres représentants gouvernementaux.
Un spectacle féérique
La fanfare du Royal 22e Régiment lance les premières notes de La Marseillaise et l’immense assistance, évaluée alors à 15 000 personnes, venue de partout et qui couronne le promontoire, écoute chapeau bas la chorale de 100 voix. L’émotion est grande. Après un discours inspiré du lieutenant-gouverneur Patenaude, on dévoile enfin la croix de Jacques Cartier. À ce moment, les navires français tirent une salve d’artillerie et des pièces pyrotechniques fusent de la colline sise à l’arrière de l’estrade, tandis que des fusées éclatent en faisant voltiger sur la scène et jusque dans la baie une pluie de petits drapeaux français, anglais et américains. Le premier ministre du Canada Bennett lit ensuite un message royal du roi George V. Un peu plus tard, une cérémonie touchante a lieu alors que 60 jeunes filles en costumes d’époque viennent, quatre par quatre, déposer des fleurs au pied de la croix de Cartier. Par la suite, le discours du ministre Flandin enthousiasme la foule par son éloquence sur Cartier et le peuple canadien. La démonstration se termine par le Ô Canada
En soirée, un banquet officiel regroupant environ 600 personnes se tient sous de grandes tentes à côté du séminaire. Bennett et le premier ministre du Québec Taschereau y tiennent des discours de circonstance, ce dernier faisant même parler Cartier comme s’il était lui-même présent! À 23 h, c’est la fête de nuit avec un splendide feu d’artifice tiré des deux rives du bassin où les navires de guerre dans la rade
font entrecroiser vers le firmament les jets puissants de leurs phares, alors que le Champlain éclaire les flots noirs comme un palais éblouissant et que 150 barges illuminées naviguent sur la baie. Le spectacle, qui dure pendant plus d’une heure, est vraiment spectaculaire.
Damase Potvin, envoyé spécial de La Presse, en fait le portrait suivant : « Cette fête de nuit qui était au programme fut merveilleusement réussie. Le temps était idéalement beau et la lune ne fut pas la moindre des clartés apparaissant dans le ciel. Tout le village et la colline en arrière étaient illuminés de feux de Bengale et sur le vert sombre de la colline se détachait très nette et brillante la croix de pierre dévoilée en après-midi. […] Pendant la soirée, de petites barques illuminées circulèrent autour du Champlain, pendant que ceux et celles qui les montaient chantaient en cœur des chants canadiens. […] Leurs gracieuses évolutions autour du navire intéressèrent vivement nos visiteurs, qui les acclamèrent avec enthousiasme. »2

Une clôture solennelle
Les fêtes se terminent le dimanche 26 août par une messe pontificale en plein air tenue sur le soubassement de la future basilique, et célébrée par le cardinal Villeneuve. La chorale de Québec,
Festival Jacques-Cartier
Évènement historique majeur, la venue de Jacques Cartier à Gaspé est soulignée de maintes façons et a fait de ce navigateur un personnage emblématique. Dans cette optique, le Festival Jacques-Cartier est créé afin de commémorer l’arrivée de l’explorateur en terre canadienne et la diversité du peuplement ethnique en Gaspésie. Cet évènement a lieu presque toutes les années au mois de juillet de 1975 à 1991. Il vise également à agrémenter la vie touristique et culturelle de la population de Gaspé et des touristes en visite dans la région. Le Festival Jacques-Cartier a connu quelques grandes réalisations dont la plus marquante est sans doute la mise sur pied du méga spectacle Précieuse est


Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 15 ]
la mer
Animation dans la cathédrale lors de la première édition du Festival Jacques-Cartier à Gaspé, 1975.
Musée de la Gaspésie. Collection Marcel Lamoureux. P77/2/5
À gauche : Bas-relief représentant vraisemblablement Jacques Cartier, découvert à Cap-desRosiers en 1908. Une gravure au dos indique « J.C. 1704 ». Musée de la Gaspésie. Don de Camille-Eugène Pouliot
À droite : Logo du Festival Jacques-Cartier inspiré du médaillon tel qu’illustré sur le premier programme du festival, 1975.
[DOSSIER]
Collection Marco Cotton
Site de la messe pontificale célébrée en plein air par le cardinal Villeneuve, 1934. Musée de la Gaspésie. Collection Marcel Lamoureux. P77, 83/16/151/106
C’est ici que sur nos côtes Jacques Cartier planta la croix France ta langue est la nôtre on la parle comme autrefois Si je la chante à ma façon, j’suis Gaspésienne et pis j’ai ça d’bon
Extrait de la chanson La Gaspésienne pure laine, de Mme Édouard Bolduc, composée à l’occasion des Fêtes du 400e
accompagnée de façon parfaite par la fanfare du 22e Régiment, chante la messe Regina Pacis de Pietro Yon. Mgr Camille Roy, recteur de l’Université Laval, y va ensuite d’un magistral sermon ayant pour titre La Croix de Gaspé.
Après la messe célébrée par un temps superbe, Mgr Cassulo bénit la pierre angulaire et les fondations de la future basilique. La cérémonie religieuse prend fin vers midi et demi. Au début de l’après-midi, le Champlain quitte le port, de même que plusieurs frégates, et les flottilles d’autos se
mettent à filer sur toutes les routes sortant de Gaspé.
Ces fêtes sont un véritable succès. Environ 30 000 personnes y prennent part et toute la presse du temps est unanime pour en souligner l’aspect grandiose. Dans un bilan fait un peu plus tard, le sénateur L’Espérance affirme « que la Providence a été avec nous et nous avons eu une température magnifique, idéale, pendant toute la durée des Fêtes. […] L’ordre le plus parfait a régné dans les cérémonies officielles, le service de la circulation a fait l’étonnement et l’admiration
de nos visiteurs […] La Gaspésie, déjà si recherchée des touristes, a montré qu’elle sait bien accueillir les étrangers et les fêtes du 4e centenaire donneront une impulsion nouvelle au tourisme dans ce pays si pittoresque, vers lequel les yeux de l’univers ont été tournés pendant des jours qui sont pour nous inoubliables. »3.
Notes
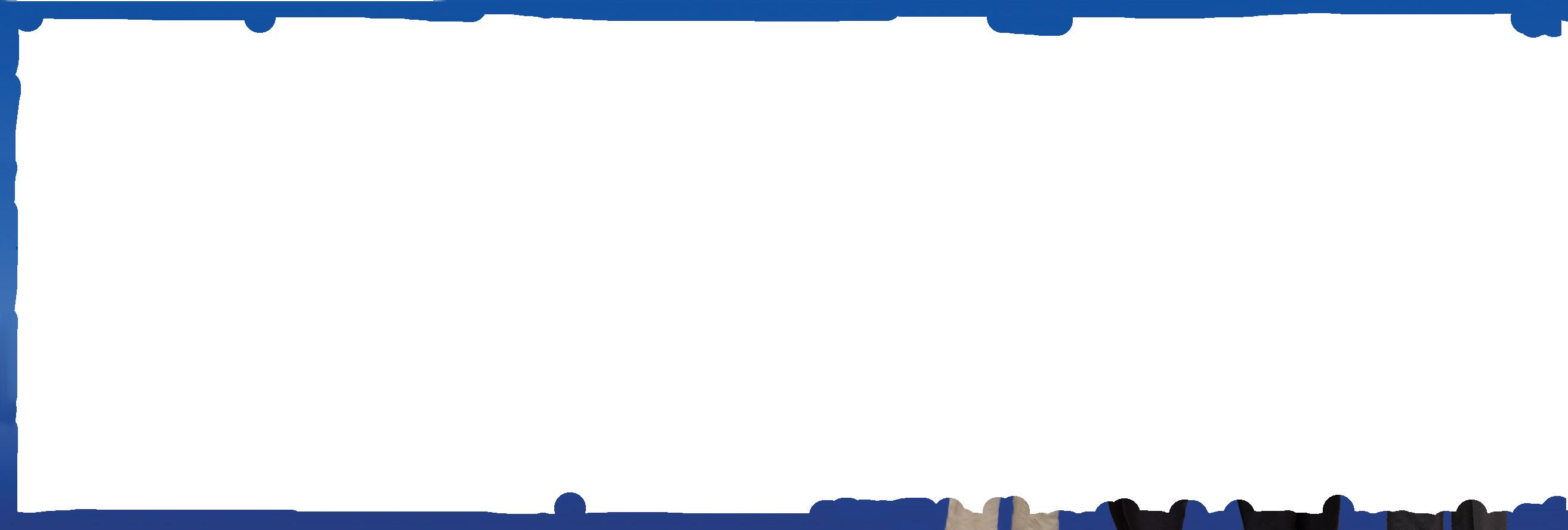
1. La Tribune, 28 août 1934.
2. Ephrem-Réginald Bertrand, « Cartier scelle l’amitié anglo-canadienne; Des fêtes inoubliables se sont déroulées à Gaspé », La Presse, 27 août 1934, p. A 1.
3. L’Événement, 12 septembre 1934.
DIAPORAMA

[DOSSIER]
PHOTO DU FESTIVAL JACQUES-CARTIER
SOUVENIRS DU WAKEHAM-YORK HOME COMING FESTIVAL
Nous sommes quatre autour de cette table de cuisine à l’hiver 1977 : Albert et Elaine Patterson, Art Jones et Lois Bechervaise. Nous discutons de la manière dont nous pourrions rassembler les gens pendant l’été, lorsque celles et ceux qui sont partis reviennent à la maison. C’est ainsi que naît le Wakeham-York Home Coming Festival qui perdurera pendant 25 ans, un évènement qui est à l’époque assez inusité.
Récit d’Elaine Bechervaise Patterson et Lois Bechervaise Membres fondatrices, Wakeham-York Home Coming Festival et résidentes de Gaspé
Rédigé par Cynthia Patterson
Amie, Wakeham-York Home Coming Festival et résidente de Barachois
Au printemps 1978, nous postons 200 invitations à des Gaspésiennes et Gaspésiens vivant à l’extérieur de la région. Nous lançons aussi un appel aux familles du coin pour que les gens nous fournissent les noms et les adresses de leur parenté. Nous payons de nos poches les frais de photocopie et de poste. L’invitation dit simplement : « Welcome Home » (Bienvenue à la maison). Pas encore de program-

mation pour les attirer, seulement l’annonce des dates, mais les gens sont enthousiastes. Oncle Wilson, capitaine de navire à la retraite, septuagénaire vivant à Montréal, reçoit son invitation et décide tout de suite de venir.
Il y a beaucoup à faire! Nous avons des réunions hebdomadaires. Un comité du festival est constitué, composé de bénévoles désireux de travailler dur pour que l’évènement
ait lieu. Notre neveu, Zane, dessine le logo et le peint sur un grand panneau en bois qui est installé à l’entrée du festival, sur le terrain de jeu de Wakeham à Gaspé. Barbara Coull écrit Home Coming Song qui devient notre chanson-thème. Entre autres choses, nous avons besoin d’une scène, il nous faut donc la construire. La première personne qui dansera dessus est Arthur Annett.
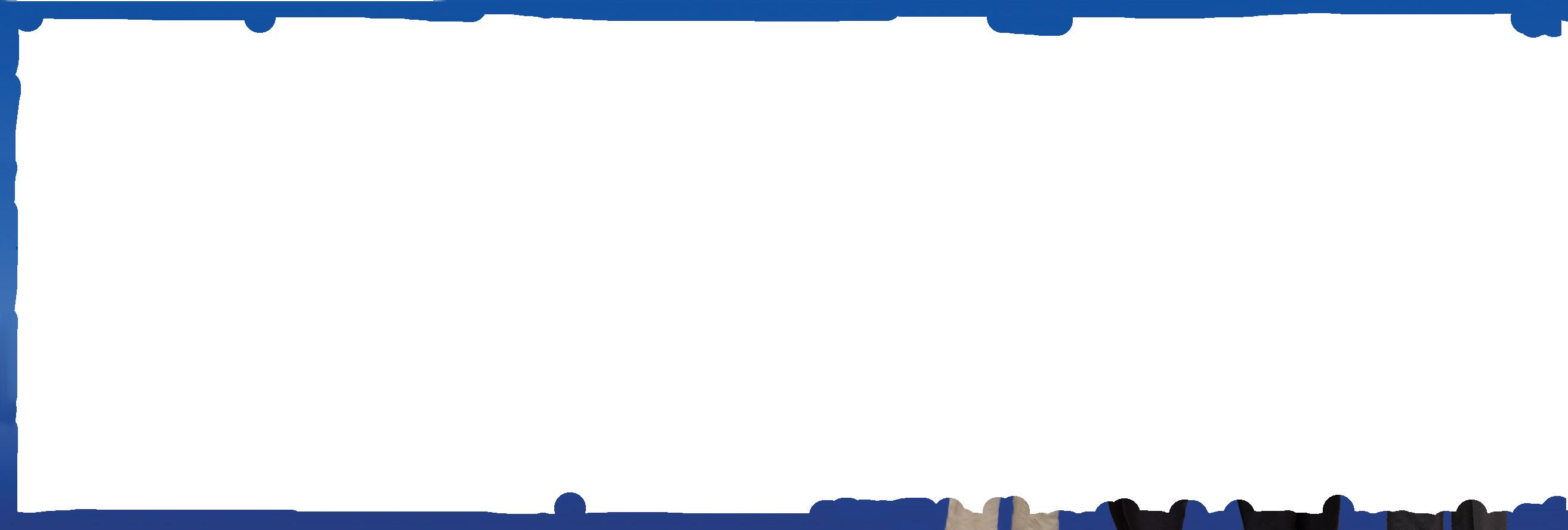
Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 17 ]
[DOSSIER]
Une ambiance festive règne sur le terrain de jeux de Wakeham à Gaspé pendant le Wakeham-York Home Coming Festival, milieu des années 1980. Collection Elaine Bechervaise Patterson et Lois Bechervaise
Le premier festival a lieu en juillet 1978. Il dure 10 jours, incluant deux fins de semaine. Nous avons un programme chargé : il y en a pour tous les goûts et tous les âges. À son apogée, le festival attire environ 15 000 personnes, anglophones et francophones, venues de toute la côte. Nous avons une équipe de bénévoles pour chaque évènement, ainsi que des équipes de nettoyage. Nous louons un autobus scolaire et payons un chauffeur pour faire le tour de la rivière, de Sandy Beach, de Haldimand et de Pointe-Navarre. Nous voulons que tout le monde puisse venir, même s’ils n’ont pas de voiture ou s’ils sont assez raisonnables pour ne pas prendre le risque de conduire en état d’ébriété. Les trajets en autobus sont gratuits. L’argent dépensé par la communauté revient à la communauté. Bien sûr, nous avons des dépenses à combler, mais l’argent restant permet d’aider des associations et des écoles locales.
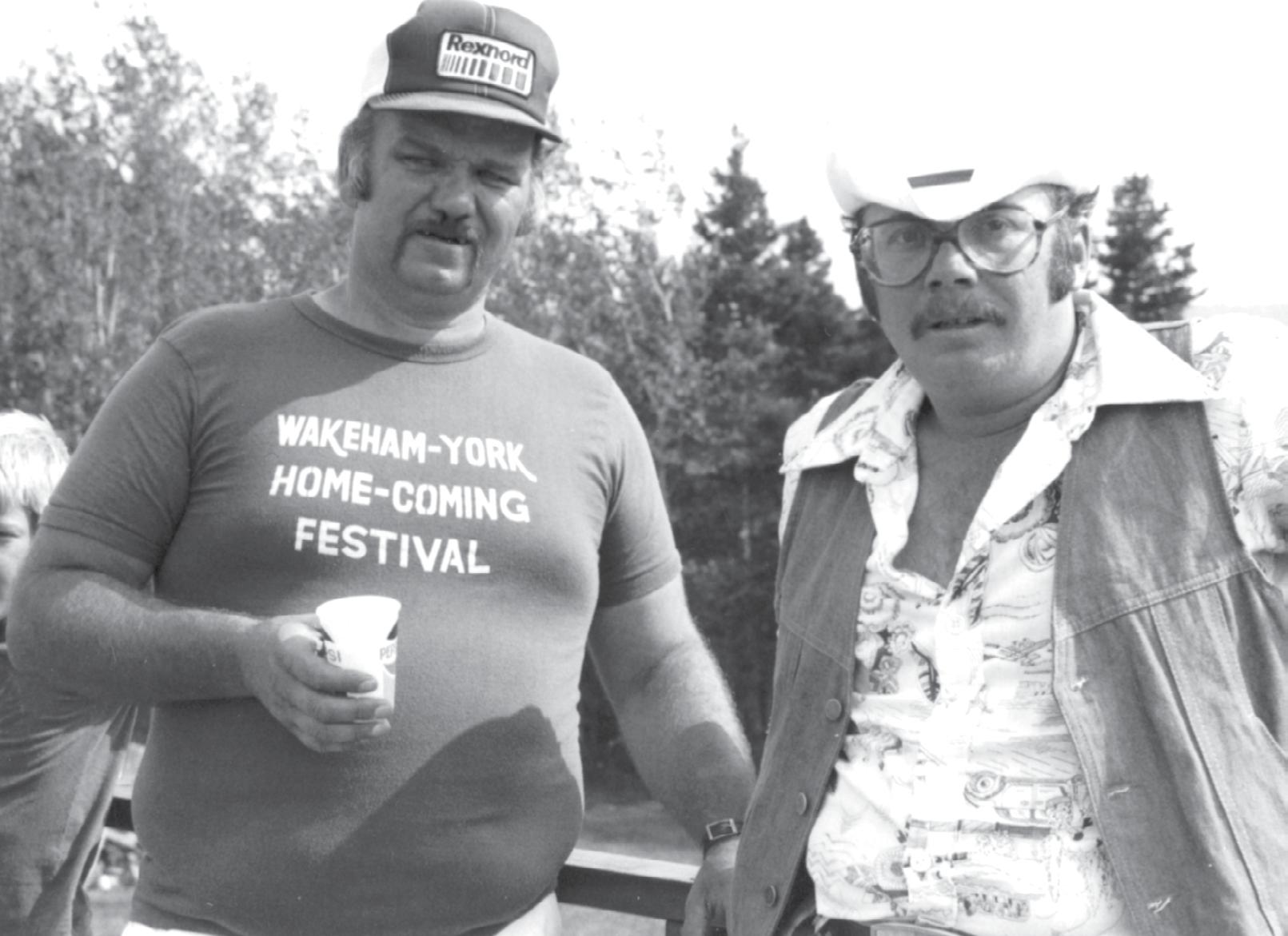
Bonne bouffe, musique et animations
Parmi les activités organisées, beaucoup de repas! Les gens aiment manger avec leurs amis·es et leur famille. Muffins mania, bar à salade,
souper spaghetti, banquet de rôti de bœuf, etc. Au début, la bière Molson est le principal commanditaire. Plus tard, nous avons changé pour Labatt’s. Et oui, la bière coule à flots! Pour leur part, les petitsdéjeuners commencent à 6 h du matin et 100 personnes peuvent faire la queue.
Et de la musique! Il y en a, de la musique! Ce n’est pas un vrai repas entre proches sans une bonne ambiance musicale. Concours de violon et spectacles amateurs, l’âge des artistes varie de 4 à 84 ans. Les pères jouent pour leurs filles, les cousins chantent ensemble; tout le monde est bienvenu sur scène et apprécié. Avec le temps, nous avons également fait venir de grands noms de l’extérieur : Jimmy C. Newman, Charlie Pride et d’autres. Et bien sûr, nous avons dansé. La scène est mise à rude épreuve. Une fois, nous avons organisé une soirée hawaïenne et tout le monde s’est déguisé. Robbie Robertson, vêtu d’une jupe en gazon, a volé la vedette!

Nous avons aussi organisé des compétitions amicales. Forces et habiletés sont mises à l’épreuve : tir à la corde, saut en hauteur, course en canoë, qui peut faire un feu et faire bouillir de l’eau le plus
rapidement, etc. Sans oublier les activités avec des animaux! Spectacles d’animaux de compagnie, courses de cochons graissés et bingos de bouse de vache! Le concours de Miss Wakeham-York est également un évènement très prisé. Environ 25 adolescentes et jeunes femmes y participent. Elles sont jugées pour leurs talents. Elles peuvent choisir de chanter, de jouer d’un instrument, de faire de l’artisanat ou de la nourriture.
Défilé de chars allégoriques en clôture
Le festival se termine le deuxième dimanche. Un service religieux anglican se tient en plein air. Il est très fréquenté et est dirigé pendant de nombreuses années par l’archidiacre Kendrick. Vient ensuite le défilé. De nombreux groupes, entreprises et particuliers y participent. Nous nous rassemblons au stationnement de l’aréna de Gaspé, nous traversons ensuite la ville et remontons la route jusqu’au terrain de jeu de Wakeham dans de magnifiques chars allégoriques.
Les gens travaillent dur pour confectionner ces chars. Il y en a toute une variété! Les enfants défilent en tant que jeannettes, castors, louveteaux, guides et scouts. Les femmes de l’Église anglicane participent elles aussi. Le char « Home Coming » a à son bord toutes les concurrentes de Miss Wakeham-York. Et les animaux
[ 18 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023
Albert Patterson, président du festival, et Art Jones, vice-président, sont deux personnalités phares de l’évènement, vers 1980.
Collection Elaine Bechervaise Patterson et Lois Bechervaise
Elaine Bechervaise Patterson et Lois Bechervaise, membres fondatrices de l’évènement, se remémorent des souvenirs des belles années du festival, 2023.
[DOSSIER]
Photo : Cynthia Patterson
ne sont pas exclus : le char d’Ada Carter présente une de ses vaches et deux de ses poules! Notre père, Leslie Bechervaise, construit une réplique en bois de l’église SaintJames de Wakeham. Elle a tant de petits détails! Elle a une cloche et même un petit archidiacre Kendrick
juste devant la porte. Mais Albert trouve qu’il manque quelque chose. Un jour, il se rend à la véritable église et enregistre sur cassette le son de la cloche. Il installe son enregistreur à l’intérieur de la réplique pour que le tintement de la cloche puisse être entendu depuis le char allégorique.
LES ÉDITIONS GID LES ÉDITIONS GID
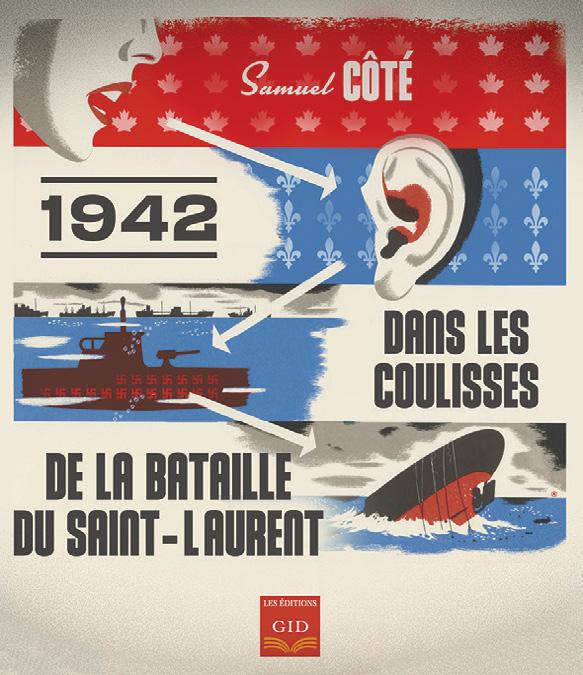
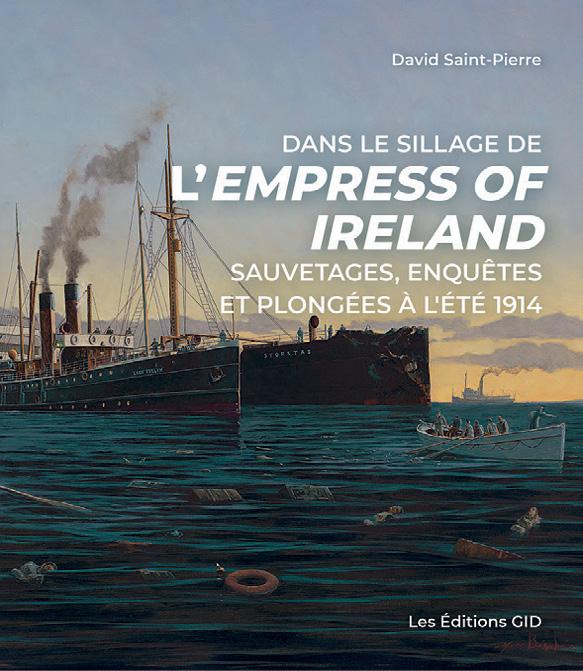
Le festival se renouvelle pendant 25 ans. Nous pensons avoir apporté beaucoup de plaisir à beaucoup de monde, y compris à nous-mêmes. C’est un moment extraordinaire de notre vie, dont nous nous souviendrons longtemps. Comme le dit la chanson de Mary Hopkin : « Those were the days my friend, we thought they’d never end. We’d sing and dance forever and a day. » (« C’était le bon temps, mon ami, nous pensions qu’il ne finirait jamais. Que nous chanterions et danserions pour toujours. »).

Remerciements à Vision Gaspé-Percé Now et Jules Chicoine-Wilson pour la traduction.
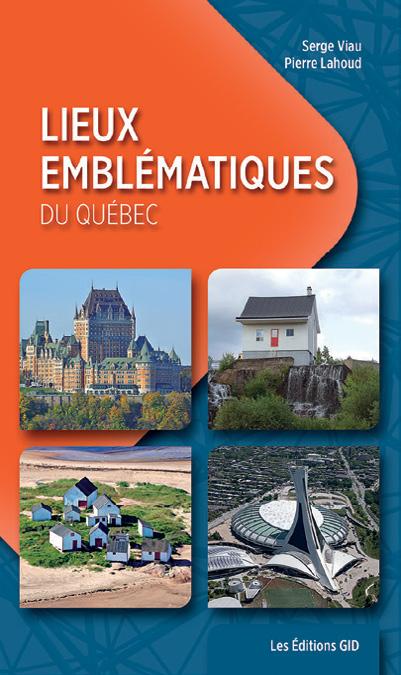
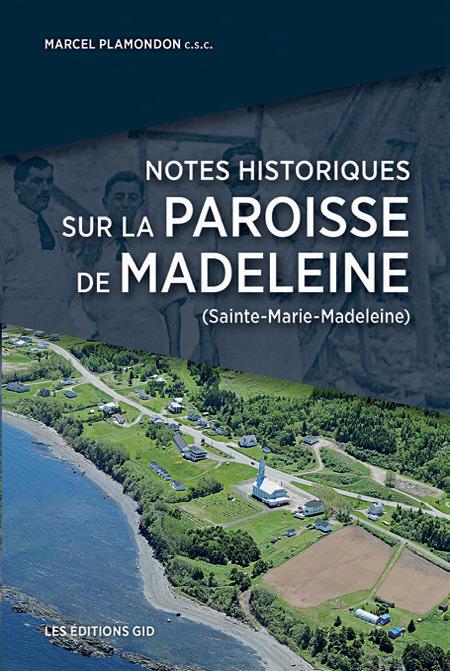
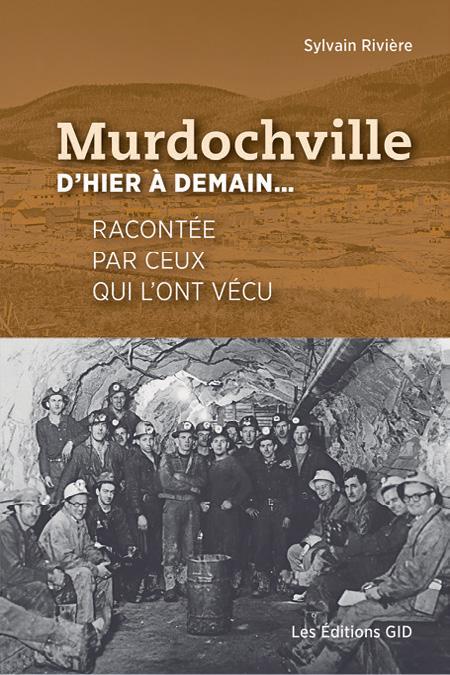
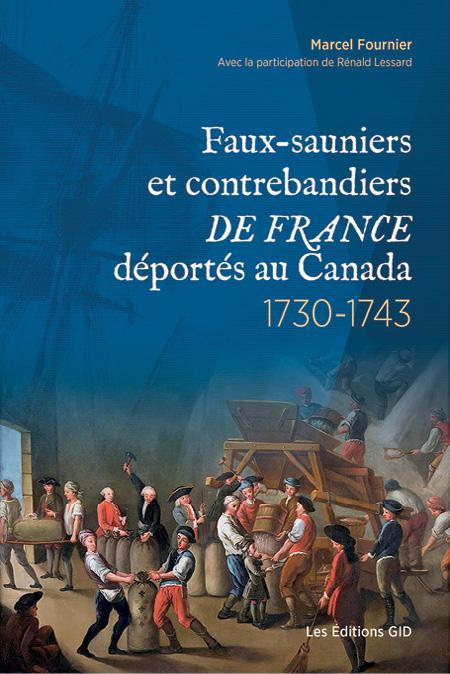

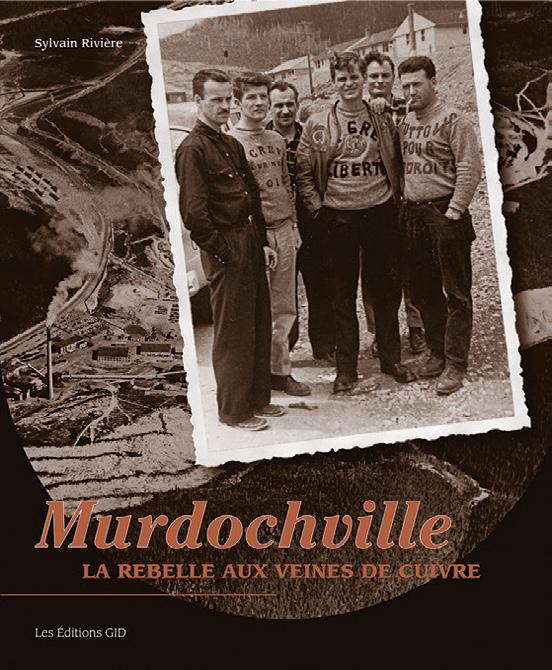
Août - Novembre 2023 |
leseditionsgid.com 418 877-3666
David Saint-Pierre 978-2-89634-531-1 i 34,95 $ Pascal Alain
978-2-89634-515-1 i 29,95 $ Samuel Côté 978-2-89634-533-5 i 34,95 $ Marcel Fournier 978-2-89634-523-6 i 34,95 $ Sylvain Rivière 978-2-89634-528-1 i 34,95 $ Sylvain Rivière 978-2-89634-530-4 i 39,95 $ Marcel Plamondon c.s.c. 978-2-89634-526-7 i 34,95 $ Serge Viau
Lahoud 978-2-89634-534-1 i 29,95 $ Nouvelle
et Pierre Lahoud
et Pierre
collection
ANGLAISE [DOSSIER]
Les « castors » sur un char lors du défilé de clôture du festival, vers 1982. Collection Elaine Bechervaise Patterson et Lois Bechervaise
VERSION
45 ANS D’ENVOLÉES POUR
MONT-SAINT-PIERRE
Il y a déjà 45 ans que la Fête du vol libre existe à Mont-Saint-Pierre. Sa toute première édition a rassemblé pas moins de 40 vélideltistes canadiens et américains et une foule de 8 000 personnes, un chiffre impressionnant pour ce village d’environ 500 habitants·es. « La beauté du paysage, la stabilité des vents, l’accueil chaleureux de la population ont fait rêver ces hommes volants. »1 La panoplie d’activités et les compétitions de deltaplane ont un tel succès que la fête se perpétue depuis, propulsant Mont-Saint-Pierre au rang des sites d’exception.


Claude Mercier
Membre fondateur, Corporation vol libre et résident de Mont-Saint-Pierre
Marie-Josée Lemaire-Caplette Rédactrice en chef
Le sport du deltaplane (aile libre avec structure rigide) naît au début des années 1970 et se développe rapidement. Par une journée de l’été 1976, le ciel est clair et une légère brise caresse le visage des gens de Mont-SaintPierre qui restent bouche bée en apercevant l’immense cerf-volant qui voltige au-dessus de leurs têtes pour se poser gracieusement dans un champ. Ignorants jusqu’à l’existence même du deltaplane, ils sont témoins du premier vol à MontSaint-Pierre; celui-ci est exécuté par Rob Mckenzie. L’été suivant, deux vélideltistes renommés parcourent la Gaspésie à la recherche de sites d’envol. Ces pilotes de brousse d’origine bretonne, les père et fils Marcel et Gilles Bourrish, sont émerveillés
par leurs essais : ils viennent de découvrir l’endroit idéal pour pratiquer le deltaplane. Sa particularité est que les décollages se font à partir de la falaise du mont SaintPierre à une altitude de 1 350 pieds (430 mètres). C’est le début de l’ère du vol libre pour ce village du nord de la péninsule.
Succès colossal dès la première édition
C’est en 1978 que la Corporation de développement de la municipalité reçoit une lettre de Gilles Bourrish demandant s’il serait possible d’organiser une rencontre de vol libre à Mont-Saint-Pierre. Claude Mercier qui travaille pour l’œuvre des terrains de jeux (OTJ) est alors pressenti pour prendre en main
le programme d’une telle activité. Comme il accepte, s’ensuit la fondation d’un comité parrainé par l’OTJ qui a pour mandat d’organiser la première Fête du vol libre qui se tiendra du 23 juin au 2 juillet et qui
[ 20 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023
Claude et Carole Mercier, Omer Cloutier, Murielle Coulombe et Jacques Mercier, membres fondateurs de Vol libre, 1977.
Collection Claude Mercier
[DOSSIER]
La foule assiste à l’atterrissage d’un vélideltiste, vers 1978-1979. Collection Claude Mercier
comprend un rassemblement de pilotes et des activités de réjouissance. Tout est à penser, programmer et réaliser en très peu de temps, mais tout le monde met la main à la pâte. On prépare du bois de quai, on le transporte sur la montagne, on construit les rampes de lancement, on imprime des laissez-passer, on se procure des trophées, on organise le transport des gens sur le mont, on trouve un fournisseur pour les repas, etc. On met aussi sur pied une foule d’activités, dont l’officialisation de l’appellation des noms de rues qui porteront le nom des familles souches, la célébration du jubilé d’argent de l’église, l’inauguration de la croix sur le mont Saint-Pierre, la compétition de motocross, des spectacles, des feux d’artifice, le tout couronné par un souper de reconnaissance. Plus de 8 000 personnes envahissent le village, c’est la fête!
Le comité travaille si bien que l’Association du vol libre est enregistrée le 9 août 1978 et est constituée en corporation l’année suivante, en plus d’être inscrite aux Fêtes populaires du Québec. Les principaux fondateurs sont Claude Mercier, Robert Boileau, Jacques Jaillet ainsi que Gilles et Marcel Bourrish.
C’est donc reparti pour une deuxième édition, avec en poche plus de temps et l’expérience acquise. Les activités populaires comme la compétition de motocross et le feu de la Saint-Jean-Baptiste sont renouvelées alors que des activités des plus originales sont aussi organisées comme le marché aux guenilles, la soirée de la cerise en plein air, le rallye canot-bottines, ou le théâtre de marionnettes. En parallèle, le vélideltiste reconnu Mike Ward démarre son entreprise de vol en tandem pour le grand public.
Place au championnat canadien
L’été 1980 restera pour toujours une des pages les plus importantes de l’histoire de Mont-Saint-Pierre. La localité sera l’hôte à la fin août du premier championnat canadien de vol libre à se dérouler au Québec. Les bénévoles du comité sont devant
une tâche immense à accomplir puisqu’il faut aussi organiser la Fête du vol libre, mais ils s’y attèlent avec enthousiasme et bonne volonté. Quelques semaines plus tard, tout est enfin prêt, de l’hébergement au transport des pilotes et de leurs ailes sur la montagne, sans oublier les déplacements des juges. Malgré cela, la tension monte; la météo est exécrable tout l’été. La magie opère toutefois puisque le matin de l’ouverture, le 22 août très exactement, les merveilleux courants thermiques qui valent la réputation d’Hawaï nord-américaine à Mont-SaintPierre se mettent de la partie pour rendre les conditions de vol exceptionnelles.
Mont-Saint-Pierre est en effervescence : plus de 42 pilotes représentant sept provinces sont inscrits au championnat, des journalistes abondent de partout, et une foule immense est fascinée par le spectacle qu’offrent les 120 départs en deltaplane par jour. Pour couronner le tout, le champion est un Québécois : Michel Tremblay de SaintFulgence au Lac-Saint-Jean. Une page d’histoire vient de s’écrire, pour la population, mais aussi pour le Québec.

Mont-Saint-Pierre accueillera également le championnat de 1983, qui
sera couronné par Wellie Muller de l’Alberta, et celui de 1985, année du dernier championnat canadien de vol libre qui sera remporté par Marc Bourbonnais de l’Ontario. Que d’organisation, de sueurs et de travail investis! Pour sa part, la Fête du vol libre se poursuit, ayant un tel succès que la route 132 s’en trouve parfois paralysée! En plus de faire du site un incontournable pour le deltaplane et plus tard le parapente (aile libre sans structure rigide), l’évènement est important en termes de retombées économiques et de développement. La fête permet d’obtenir des subventions qui permettent d’aménager des infrastructures au bénéfice de toute la localité : toilettes publiques, aires de pique-nique, routes sur la montagne, kiosque touristique, terrain de jeux, sans oublier le complexe de vol libre et le seul simulateur de vol reconnu au Québec. Mont-Saint-Pierre est désormais désigné comme la capitale du vol libre au Québec et dans l’Est du Canada, mais rien de tout cela n’aurait été possible sans la mobilisation et la générosité de ses villageois·es.
Note
Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 21 ]
1. Claude Mercier, « Mont-St-Pierre, le 6 août 1983 », Bécois-volant, vol. 4, no 16, 1983, p. 20.
La Gaspésie offre une vue spectaculaire aux parapentistes.
[DOSSIER]
Photo : Yvon Volé Enr. (Les passagers du vent)
ÉCOLE DE PERMACULTURE DE VAL-D’ESPOIR : PRENDRE SOIN DE LA DIVERSITÉ HUMAINE ET ÉCOLOGIQUE
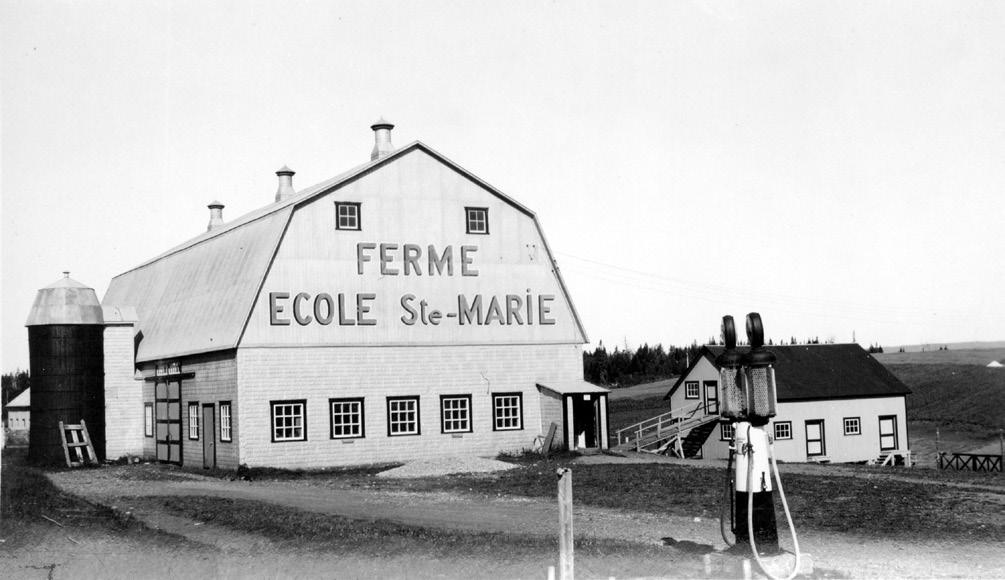
Est-ce que la permaculture est un concept avec lequel vous êtes familier? Popularisé à la fin des années 1970, le terme permaculture faisait référence initialement à une agriculture permanente qui, s’inspirant de la nature, faisait une plus large place aux plantes vivaces. La notion de permaculture s’est par la suite élargie et se présente aujourd’hui comme une approche systémique d’aménagement et de gestion des environnements naturels et de développement des communautés. Puisant à différentes disciplines telles que l’écologie, l’agro-écologie, la sociologie et l’éthique notamment, la permaculture rassemble un ensemble de principes, ainsi que des outils méthodologiques permettant de concevoir plusieurs types de systèmes. À titre d’exemples, la permaculture s’applique à des domaines aussi variés que l’agriculture régénératrice, l’écoconstruction, la résilience climatique, ou encore l’entrepreneuriat social.

Une première école québécoise de permaculture

Alors que l’approche permacole gagne en popularité partout à travers le monde, elle reste relativement méconnue au Québec. Cependant, ceci pourrait bientôt changer grâce à une initiative émanant de Val-d’Espoir, village au nom évocateur, où germe tranquillement la première école de permaculture au Québec. Héritière d’un riche passé agricole, la communauté de Val-d’Espoir a abrité une école d’agriculture entre 1930 et 1961. Aujourd’hui, l’École de permaculture de Val-d’Espoir poursuit le travail amorcé depuis plus de vingt ans par les Bio-Jardins Rocher-Percé, le Centre d’interprétation et de formation en agro-écologie et le Laboratoire rural Produire la santé ensemble afin de cultiver des écosystèmes sains, diversifiés et nourriciers.
Initié par la ville de Percé en 2019, le projet de l’École de permaculture de Val-d’Espoir est, depuis février 2021, porté par la Société de développement économique de Percé (SDEP), un organisme à but non lucratif ayant pour mission d’incuber et de développer des initiatives socio-économiques. Au courant de l’été 2021, une campagne de sociofinancement, qui a permis d’amasser plus de 55 000 $, venait confirmer l’intérêt de la communauté pour le projet et en juillet 2022, la Fondation communautaire Bas-Saint-Laurent-Gaspésie-LesÎles et la Société de développement économique de Percé annonçaient la création du Fonds pour l’École de Val-d’Espoir (FEVE) grâce au très généreux don d’un million de dollars de monsieur Daniel Leboeuf, résident de Percé. L’École de permaculture de Val-d’Espoir a depuis obtenu des aides monétaires du provincial et de la MRC du Rocher-Percé pour son démarrage.
Bâtiment de l’École d’agriculture, années 1940-1950. Musée de la Gaspésie. P275 Fonds École d’agriculture de Val-d’Espoir.
Élèves de l’École d’agriculture, années 1940-1950. Musée de la Gaspésie. P275 Fonds École d’agriculture de Val-d’Espoir.
Cueillette.
[PUBLIREPORTAGE]
Photo : Ricochet design
Un projet participatif Afin de bien implanter l’École de permaculture, la Société de développement économique de Percé travaille, depuis le mois d’août 2021, avec un comité aviseur formé de spécialistes de la permaculture, et un travail de consultation a fait l’objet d’une recherche participative menée en collaboration avec l’Université du Québec à Montréal. Le processus de recherche a permis de mettre en place les premières activités de l’École en utilisant l’éthique et les principes de la permaculture et de contribuer ainsi au caractère innovant de celle-ci. Un premier Certificat de design en permaculture, formation intensive de 14 jours, donnée en septembre dernier en collaboration avec P3 Permaculture, a attiré des étudiants·es de partout au Québec. Durant cette formation, le groupe a notamment conceptualisé une première phase d’aménagement du terrain de l’École. Le concept a ensuite été retravaillé en novembre dans un cours d’introduction à la permaculture qui s’adressait spécifiquement aux membres de la communauté. Cette dernière formation, donnée par Fertiles, une entreprise spécialisée en permaculture, se poursuivra en juin et sera axée sur l’implantation d’une haie brise-vent qui viendra protéger les parcelles mises en culture cet été.
Grâce à une approche pédagogique participative et par projet, le site de l’École se construit en mettant les étudiants·es, les gens de la communauté et les permaculteurs·rices au centre du procédé créatif. En ce sens, la multitude de formations offertes à l’École répondra aux besoins de ces différentes communautés (locales et permacoles) et misera sur la valorisation de leurs savoirfaire et de leurs ressources. La notion de prendre soin de la diversité humaine et écologique dans une perspective de partage et de réciprocité figure parmi les valeurs fondatrices de l’École. En créant une offre de formations et de services accessible et adaptée aux besoins des communautés, l’École utilise une approche pédagogique non formelle inspirée par les mouvements relatifs à l’éducation à l’environnement et poursuit l’objectif d’inclure et de valoriser les connaissances, les réalités et les ressources de ses communautés. Conséquemment, une partie des ressources de l’École sera mise à la disposition des communautés afin de soutenir les initiatives permacoles locales.
Afin de démarrer la saison estivale en force, la SDEP vient d’embaucher à l’École de permaculture une coordonnatrice, un chargé de projet en permaculture, une chargée d’enseignement et un préposé aux infrastructures. Cette nouvelle équipe veillera à l’enracinement de l’École dans la communauté à travers le déploiement d’activités et de formations en lien avec les aménagements prévus dans la planification de l’École.


Pour en savoir plus et vous renseigner sur les formations à venir, vous pouvez consulter le site web de l’École www.ecoledepermaculture.ca ou encore suivre les pages Facebook de l’École de permaculture de Val-d’Espoir et de la Société de développement économique de Percé.

Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 23 ]
Première cohorte du certificat de design en permaculture.
Photo : Ricochet design
Apprendre à observer.
Photo : Ricochet design
Délimiter les courbes avec précision.
[PUBLIREPORTAGE]
Photo : Ricochet design
VAL-D’ESPOIR : LES PREMIERS PAS D’UN CARNAVAL
Qui aurait pu prévoir que plus de 55 ans plus tard, le carnaval de Val-d’Espoir existerait toujours! Il a traversé les décennies depuis la fin des années 1960 et est devenu un évènement très prisé dans la région de la pointe gaspésienne. Avec les années, le carnaval a su apporter un dynamisme, un élan de fierté et une joie de vivre renouvelée dans la population. Il s’est raffiné et enjolivé de belles enluminures au fil du temps. Durant les années 2000, avec le « glamour » de la Saint-Valentin, la grande Traversée de la Gaspésie en ski de fond s’est jointe à lui ainsi que la chaleureuse marmotte Fred qui se fait un doux plaisir d’annoncer un printemps hâtif ou non. On a même vu quelques ducs devenir rois et des dames mariées des villages environnants devenir reines à leur tour… Mais il y a eu les premiers balbutiements, ceux de la fin des années 1960 et les tous débuts des années 1970. Permettez-moi ici de vous en faire souvenance.

Réal-Gabriel
Hiver 1966. La saison froide est interminable dans mon coin de Gaspésie et comme à chaque année, les bancs de neige se dressent partout, majestueux, comme pour lancer des défis que personne n’arrive à relever. L’énorme église du village trône sur son monticule au cœur de la paroisse. Tout à côté, à l’est, se trouve la vieille
église à peine âgée d’une quarantaine d’années et dont on a enlevé le clocher. Elle a été transformée en bâtiment multifonctionnel par un jeune prêtre décédé trop tôt en 1965, l’abbé Hector Fournier. Un nouveau curé, l’abbé Gilbert Desrosiers, particulièrement dynamique dans le village et très aimé de ses paroissiennes et paroissiens, y voit
une occasion de l’utiliser comme centre culturel, voire même sportif, bâtiment dans lequel on y présente des pièces de théâtre, des soirées de danse, différents chanteurs westerns, des bazars, des kermesses, ainsi que de multiples divertissements pour les enfants.
Et pourquoi pas un premier carnaval dans le village! Un peu
[ 24 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023
Bujold Écrivain et originaire de Val-d’Espoir
Char allégorique pour le carnaval alors que l’évènement prend de l’ampleur, 1972. Comme dans tous les carnavals du pays, il se doit d’y avoir le bonhomme, chaleureux et souriant, symbole de la féérie des festivités. Collection Réal-Gabriel Bujold
improvisé, soudainement, comme ça… pour agrémenter la longue « ennuyance » des hivers trop longs! Pour remplacer les réjouissances du Mardi gras ou de la Mi-Carême!
Une seule reine parmi les six duchesses
Six duchesses choisies comme il se doit parmi la jeunesse du village, un bonhomme un peu clownesque, ressemblant timidement à celui du Carnaval de Québec… des activités diverses, une mascarade, un concours de scie mécanique, des courses de motoneiges, des soirées de bingo, de musique et de danse, et bien sûr, le couronnement de la reine comme apothéose de cet évènement. Eh oui! Six premières duchesses dans leur robe de mariée empruntée ici et là aux quatre coins du village : Marie-Paule Beaudry, Claire Bujold, Maria Cloutier, Colombe Couture, Jeanine Couture et Monique
Roy. Chacune des duchesses doit vendre des billets. Et pour chaque montant de 25 $ reçu, une capsule à son nom est glissée dans un grand réceptacle. Lors de la soirée du couronnement, la première duchesse qui voit trois de ses capsules sortir de la boîte est couronnée. À chaque tirage, une chandelle est allumée.
C’est ainsi que Jeanine Couture est élue reine du premier carnaval
C’est bien là notre affaire
À nous le carnaval! (bis)
Il n’a pas son pareil
Le carnaval de Val-d’Espoir
C’est bien là notre affaire
À nous le carnaval.
Hymne du carnaval, à chanter sur l’air de La destinée, la rose au bois
du village. La frénésie est au rendezvous dans la salle de récréation du couvent de Val-d’Espoir. La population est en liesse, on chante, on rit, on danse… on crie des bravos… L’évènement est créé. Sa Majesté Jeanine 1ère interprète Oui, devant Dieu, devant les hommes. Elle a une voix merveilleuse. Les premiers pas sont timides, mais plus tard, le couronnement aura lieu dans l’église… et la reine pourra s’asseoir sur un trône ayant servi à recevoir les divers messeigneurs de l’Évêché de Gaspé lors de leurs visites pour les confirmations.

Une participation collective Mais qui donc se cache dans le bonhomme cette année? Armand Gariépy? Raoul Langlois? René Bourget? Et tous ces déguisements lors de la mascarade! Thérèse Mercier en madame de Pompadour, Colette Couture en sorcière bien-aimée…
des clowns… des vampires, de sombres vagabonds…
Et qui donc a fait tous ces desserts pour la grande kermesse? Mireille Roussy? Hélène Poulin? Josette Vallerand? Et ce gros gâteau à trois étages avec un p’tit bonhomme de neige su’l’ dessus pour lequel on vend des billets avant de le faire « rafler »? Et tourne et tourne la bonne vieille roue de fortune. Ah! Les merveilleuses premières années du carnaval.
Puis des reines se sont succédé au fil des années qui ont suivi… jusque durant la décennie 2020. Les parures des duchesses se sont embellies, les activités se sont raffinées… Tous les profits vont à l’entretien de l’église du village. Il semblerait que ça va de soi, qu’au fil des ans, on ait toujours tout donné pour payer les dépenses et remettre les profits à la Fabrique.
Puis, on a fini par démolir la vieille église, c’était à l’époque de la fermeture de tant de petits villages en Gaspésie. Val-d’Espoir y a échappé. C’était le début d’un temps nouveau, comme le chantait Renée Claude. Tout le monde était beau, tout le monde était gentil. Et puis, est-ce candide de le dire, mais pour Val-d’Espoir… tous les espoirs étaient permis.

Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 25 ]
Joseph Poulin conduit quelques duchesses dans un traîneau, 1968. Collection Réal-Gabriel Bujold
La première reine du carnaval de Val-d’Espoir, Jeanine Couture, interprète une chanson, 1966. Malheureusement, elle décédera trois ans plus tard, en février 1969.
Collection Réal-Gabriel Bujold
UNE AVENTURE UNIQUE POUR LES PASSIONNÉS·ES DE PLEIN AIR
Depuis plusieurs années, les Traversées de la Gaspésie (TDLG) sont devenues des évènements incontournables pour les amatrices et amateurs de sports d’hiver, d’automne et de nature. Elles permettent aux participants·es de parcourir les paysages spectaculaires de la région gaspésienne en ski de fond, en raquette et en bottine. Avec deux évènements par an, l’un en hiver et l’autre à l’automne, l’organisation rayonne toute l’année.

Les Traversées de la Gaspésie (TDLG) sont l’œuvre de Claudine Roy et de Thierry Pétry, fondeuse et fondeur émérites qui, en 1984, parcourent le Québec en ski de fond : une aventure de 2 000 kilomètres entre Gaspé et Hull, sur 35 jours. En 2003, ces deux sportifs invitent des amis·es à découvrir la Gaspésie en ski, créant ainsi la TDLG, qui deviendra plus tard les TDLG avec l’ajout d’un parcours automnal. Il s’agit d’une organisation à but non lucratif qui œuvre activement à la mise en valeur de la Gaspésie. En plus de se démarquer par leur concept unique, les TDLG
favorisent le tourisme hors-saison dans la région et contribuent directement à l’économie locale pendant les saisons moins achalandées.
D’abord un évènement humain
Claudine Roy est un pilier indéniable du succès de l’évènement vu sa longévité en tant que présidente. Elle s’implique autant dans le financement que dans l’élaboration des activités d’animation qui font de chacune des éditions des moments magiques. Thierry Pétry, vice-président de l’organisme, s’assure que les tracés sélectionnés offrent plusieurs points
de vue magnifiques, tout en offrant un regard sage sur l’évolution générale des TDLG. Les membres du conseil d’administration, l’équipe permanente, les équipes contractuelles ainsi que tous les bénévoles s’impliquent aussi activement dans l’organisation des évènements.
Le but des Traversées est de faire rayonner la communauté gaspésienne. « Je suis passionnée par mon pays, la Gaspésie, et je veux que les participants découvrent l’accueil légendaire des Gaspésiens. On entend souvent des préjugés sur la région. », mentionne Claudine. Pour elle, les TDLG sont un « grand
[ 26 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023
Cindy de Lozzo
Directrice générale, Traversées de la Gaspésie
Claudine Roy Co-fondatrice et présidente, Traversées de la Gaspésie
[DOSSIER]
Les fondeuses et fondeurs dans toute la splendeur du paysage hivernal gaspésien, 2009. Photo : Charles Bilodeau, Ricochet design Traversées de la Gaspésie
Traversée en bateau
En 2009, pour célébrer le 475e anniversaire de l’arrivée de Jacques Cartier à Gaspé, Claudine Roy a l’idée de recréer cette arrivée en partant de Montréal en bateau en direction de la baie de Gaspé. Elle embarque toute son équipe dans ce beau périple. La traversée dure une semaine à bord du bateau, avec des escales pour faire du ski de fond ou de la raquette. Et quel périple! Au milieu de la semaine, des vents de 100 km/h et une accumulation de 30 centimètres de neige provoquent la formation de glace, immobilisant le bateau et ses 300 passagers.
Claudine Roy prend cet imprévu avec philosophie : « C’est incroyable ce que l’on vit. Jacques Cartier avait lui aussi dû se cacher dans la baie de Gaspé en remontant la baie des Chaleurs à cause d’une tempête de neige », mentionne-t-elle. Après 36 heures coincé dans la glace, le bateau a pu reprendre la navigation et la traversée a pu se poursuivre.
évènement humain ». « Les Traversées, c’est une famille d’amis. Les gens tissent des liens et reviennent d’année en année. Tout le monde a son histoire. C’est un mélange de culture, de social et de sport. Les gens en profitent au maximum. On ne dort pas beaucoup! », dit-elle. Depuis ses débuts il y a 20 ans, la Traversée en ski connaît une croissance rapide et est maintenant considérée comme l’un des plus grands évènements de sports d’hiver au Québec. Elle attire des participants·es de partout dans le monde, avides de découvrir les montagnes, les vallées et les rivières de la région gaspésienne.
Une aventure sportive et naturelle
Chaque année, les parcours sont renouvelés pour offrir une expérience
unique. En hiver, le groupe chausse des skis de fond ou des raquettes afin de découvrir la région sous son manteau blanc, alors qu’en automne, la randonnée pédestre est à l’honneur lorsque les couleurs sont à leur paroxysme. Avec plus de 200 kilomètres à traverser, cette aventure sportive et naturelle permet de découvrir la Gaspésie sous un nouveau jour. « La Traversée n’est pas une compétition. », précise Claudine. Chaque personne y va à son rythme. « Si pour un skieur, faire 15 km représente tout un défi, ce sera son défi à lui. », souligne-t-elle.

Pendant la semaine de l’évènement, les participants·es sont logés dans des auberges et des refuges. Les repas sont préparés par des chefs locaux avec des produits frais et de qualité, offrant ainsi une occasion de découvrir la cuisine gaspésienne. Des animations sont présentes tout au long de la journée, avec des dégustations, des spectacles, des interprétations sur les sentiers et des surprises pour rendre l’expérience inoubliable. Les soirées sont animées par des artistes locaux, ajoutant une ambiance conviviale et chaleureuse.
Les Traversées de la Gaspésie sont également riches en traditions, telles que la dégustation de shooters locaux, accompagnée de l’accordéon de Sylvie. La soirée de clôture est également très attendue avec
un thème différent chaque année, rassemblant les participants·es dans une ambiance festive pour célébrer leur accomplissement.
Mais aussi, les grandes Traversées sont une source intarissable de belles rencontres où les amitiés se créent facilement. Dès le premier jour, on ressent cette atmosphère amicale et familiale qui émane des échanges. L’arrivée est l’un des moments les plus excitants. On peut voir tous ces visages, certains déjà connus et chéris, d’autres inconnus que l’on apprendra à connaître et à apprécier tout au long de la semaine.
Un impact communautaire Les Traversées de la Gaspésie ont un impact économique significatif sur la région en attirant des participants·es du monde entier, ce qui entraîne d’importantes retombées économiques pour les commerces locaux. De plus, l’organisme met un point d’honneur à travailler avec des producteurs d’ici pour offrir et faire découvrir la culture, les traditions et la qualité gaspésiennes.
Cependant, les retombées économiques ne sont pas le seul apport des Traversées à la communauté. Elles contribuent à faire connaître la région et à la promouvoir comme une destination touristique de choix, même en dehors de la haute saison. De célèbres journalistes ou artistes, par leur talent et leur notoriété, font la promotion de cette belle région. Grâce à toutes ces personnes, les TDLG traversent les frontières et rayonnent à l’international.

Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 27 ]
Des animations réjouissent les participants·es lors des pauses, 2003.
Photo : Nathalie Mongeau, Ricochet design Traversées de la Gaspésie
La grande équipe de la Traversée hivernale lors de sa 20e édition, 2023.
Photo : Ricochet design Traversées de la Gaspésie
Les anniversaires sont sans aucun doute la raison de célébrer la plus courante et c’est pourquoi de nombreuses municipalités soulignent avec fierté le leur. Que ce soit un 50e ou un 100e, cette occasion permet de rassembler la communauté et de souligner l’histoire d’une localité. Les « fêtes de village » sont souvent mises sur pied dans cet esprit de créer un grand évènement annuel. Musique, danse, parade, animations, élection d’une reine, soirée spéciale, etc. sont généralement au rendezvous. Les carnavals ne font pas exception : ils sont organisés pour mettre en valeur les activités hivernales et égayer la longue saison blanche. Que ce soit à L’Anse-auGriffon, Murdochville, Chandler ou Grande-Rivière, les lieux où faire la fête ne manquaient pas par le passé. Bien que certaines fêtes de village perdurent, elles se sont passablement essoufflées au fil du temps.
C’EST LA FÊTE!
Des rassemblements populaires diversifiés Certains festivals, disparus ou actuels, permettent, pour leur part, de se rassembler autour d’une thématique ou d’une activité bien précise. Que ce soit le folklore à Cap-Chat, le patrimoine vivant ou le saumon à Carleton-surMer, la musique à Cap-d’Espoir, les crevettes à Matane, les régates dans différentes localités, le cinéma ou la bière à Percé, les sujets sont des plus variés, allant du traditionnel à l’insolite. Par exemple, le Tournoi de pêche à Saint-Siméon-de-Bonaventure se tient annuellement depuis 1965, ce qui en fait l’un des plus anciens festivals en continu de l’est du Québec. Les premières années, il n’est pas rare que les prises des pêcheurs atteignent 300 et même 400 livres de poissons! Bien qu’il soit populaire, souvenons-nous de 1977 où pas moins de 89 bateaux se sont inscrits, le festival ne se limite pas au tournoi avec sa panoplie d’activités. Faisant honneur à son passé forestier, le
secteur de la vallée de la Matapédia et des Plateaux a de son côté fondé le Festival des cordes de bois. Les résidents·es des différents villages créent des œuvres à l’aide de bûches de bois qu’ils installent devant leur maison ou autres lieux, créant ainsi un grand parcours à ciel ouvert d’art populaire.
Enfin, des rassemblements se forment aussi autour d’évènements uniques comme une commémoration ou une visite officielle. Le 21 juin 1959, la reine Elizabeth II et le prince Philip arrivent à Gaspé à bord du yacht Britannia pour une visite d’environ trois heures. Le couple royal signe le livre d’or de la ville, se rend à la Croix du Souvenir qui marque la prise de possession des terres par Jacques Cartier et assiste à une cérémonie à l’église anglicane Saint-Paul. Une foule de 6 000 personnes est présente pour saluer Sa Majesté dont le passage donnera son nom à une rue du centre-ville de Gaspé : la rue de la Reine.
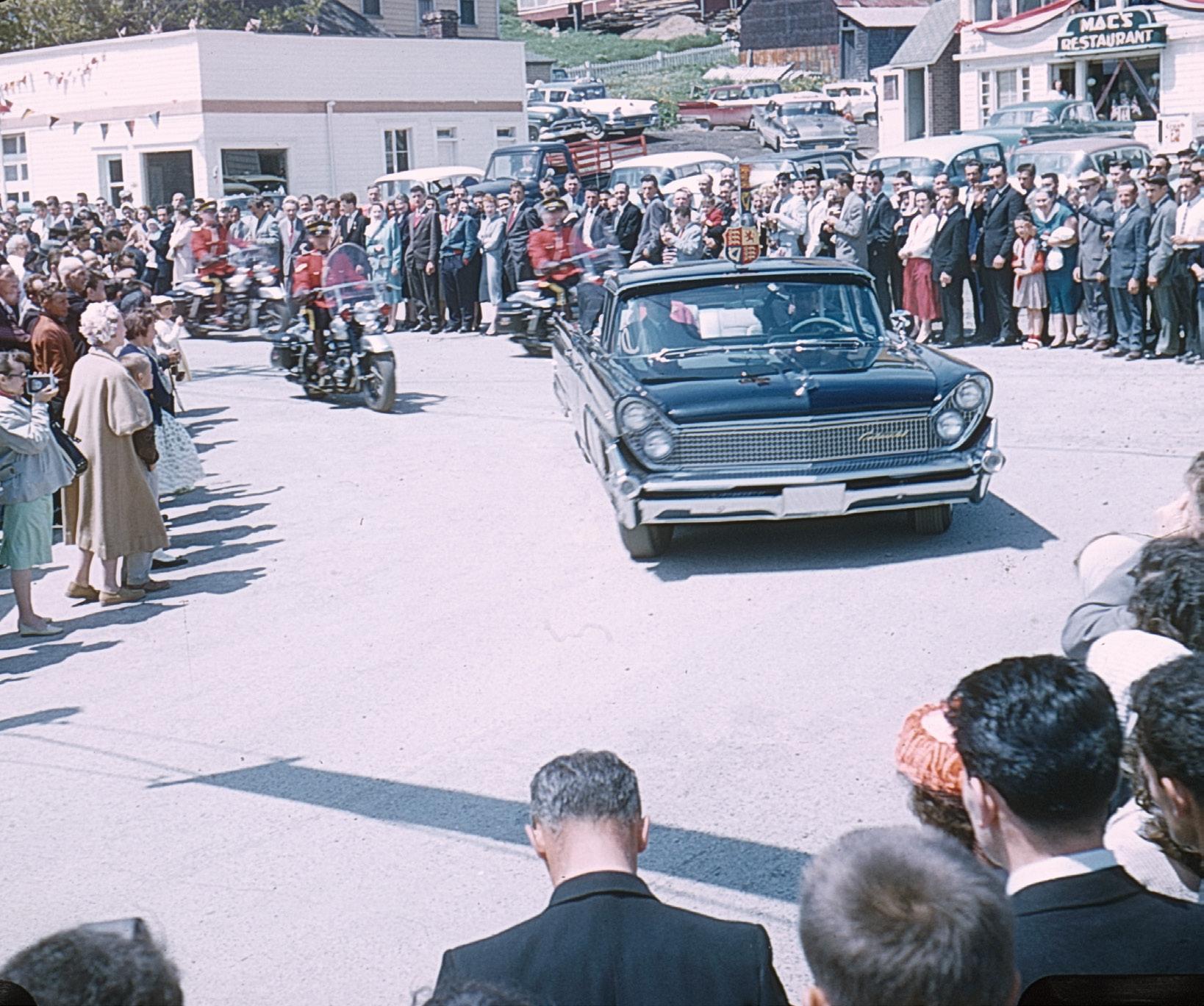
 La reine dépose des fleurs au pied de la Croix du Souvenir à Gaspé, 1959. Musée de la Gaspésie. Fonds Augustines de Gaspé. P46/3d/1/7
La reine dépose des fleurs au pied de la Croix du Souvenir à Gaspé, 1959. Musée de la Gaspésie. Fonds Augustines de Gaspé. P46/3d/1/7
[PHOTOREPORTAGE] [ 28 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023
Une foule se masse dans les rues de Gaspé pour apercevoir la voiture royale de la reine Elizabeth II et du prince Philip, 1959. Musée de la Gaspésie. Fonds Famille Agnesi de Douglastown. P306/3/3/1,4-73
1. Festival et tournoi de pêche à SaintSiméon-de-Bonaventure, 1978. Tournoi de pêche de Saint-Siméon
2. Foire à Barachois, vers 1920-1925. Musée de la Gaspésie. Fonds Ethel Cass. P297/3/6,127

3. Festival de L’Anse-au-Griffon, entre 1975 et 1985.


Photo : Bernard Bélanger, Le Pharillon Musée de la Gaspésie. Fonds Journal Le Pharillon. P285/4
4. Foule déguisée, fanfare et grand bruit pour le tintamarre de la Fête nationale de l’Acadie qui est célébrée chaque 15 août à Bonaventure, 2022.

Photo : Geneviève Smith Musée acadien du Québec

5. Foule lors des régates de Carleton-surMer, vers 1960-1965.
Photo : Charles-Eugène Bernard Musée de la Gaspésie. Fonds Charles-Eugène Bernard et Estelle Allard. P67/B/5a/1/11
6. Sculpture devant une maison lors du carnaval de Grande-Rivière, 1965.

Photo : Luc Imbeau Musée de la Gaspésie. Fonds Luc Imbeau. P296/1/G/8-20

7. Une installation de Jean-Yves Pinault à Saint-François-d’Assise dans le cadre du Festival des cordes de bois, 2018.
Photo : Jocelyne Gallant
2 4 5 1 3 6 7 [PHOTOREPORTAGE] Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 29 ]
METTRE EN LUMIÈRE LE CINÉMA DOCUMENTAIRE
Par la richesse des sujets et les enjeux qu’il aborde, le cinéma documentaire a cette capacité de rassembler les gens et de susciter les discussions. Le Festival Vues sur mer est né de cette envie de faire découvrir le cinéma documentaire à la population gaspésienne et de permettre des échanges avec les artistes et artisans·es. Fondé par le ciné-club Cinélune de Gaspé qui présente du cinéma de répertoire et des passionnés·es du documentaire, la première édition de l’évènement s’est tenue en 2011. Depuis, Vues sur mer, l’un des seuls festivals à se consacrer exclusivement au documentaire, s’est bâti la réputation d’être intime, chaleureux et accueillant.

Les premières éditions se déroulent à la Petite Églize de Gaspé, une salle d’une capacité d’à peine 100 places. Ce lieu contribue au développement de cet esprit de collégialité et de proximité entre les spectatrices et spectateurs et les cinéastes. Le public de la première heure se souviendra des rassemblements au sous-sol de l’église, du bar au fond de la salle et de l’étroitesse des lieux. Certains festivaliers et festivalières apportaient un petit coussin pour plus de confort sur leur chaise!
Tout en conservant son ambiance chaleureuse et un accès privilégié avec les cinéastes invités·es, le festival migre, en 2019, dans un nouveau quartier général au Centre de création diffusion de Gaspé. Un déménagement rendu nécessaire afin de répondre à l’augmentation de l’achalandage et pour diffuser les films
dans des conditions technologiques plus performantes. Grâce, entre autres, aux membres fondateurs Monica Normand et Simon Bujold qui sont toujours des actrice et acteur clés de l’évènement, le festival a su garder son esprit rassembleur initial.
Saluer les documentaristes et leurs œuvres
Le Festival Vues sur mer est vite devenu un allié du documentaire québécois. On le sait, le cinéma documentaire n’est pas celui qui est le plus distribué dans les salles. Avec en moyenne une vingtaine de films diffusés par édition, il permet chaque année de mettre en lumière des documentaires d’ici et d’ailleurs, de saluer le travail de cinéastes de la première heure, en plus de faire rayonner des documentaristes de la relève et de la Gaspésie,
comme Jean-François Aubé, JeanFrançois Caissy, Olivier Poulin ou Duane Cabot. Au fil des années, de nombreuses œuvres puissantes sur des thèmes variés ont marqué les spectatrices et spectateurs. Que ce soit notamment par le travail du documentariste animalier gaspésien Harold Arsenault, le cinéma social et humaniste de Carl Leblanc, les films engagés d’Ève Lamont ou les œuvres sociopolitiques d’Hugo Latulippe, les documentaires diffusés à Vues sur mer ont su toucher les cordes sensibles de nombreux cinéphiles. Chaque année, toujours dans les premières semaines d’avril, en même temps que le temps des sucres et les autres balbutiements du printemps, Vues sur mer accueille avec excitation les cinéphiles. Une tradition maintenant bien ancrée durant laquelle le cinéma documentaire bourgeonne.
[ 30 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023
Maxime Boucher Directeur de la programmation, Festival Vues sur mer
[DOSSIER]
Les cinéphiles attendent le début de la projection lors de la 3e édition de Vues sur mer dans la Petite Églize de Gaspé, 2013. Festival Vues sur mer
BOIS FLOTTÉ : LA GENÈSE D’UN FESTIVAL DE SCULPTURES INSPIRÉ DU FOLKLORE

Ces jours-ci, c’est pour moi une 15e année de souvenirs pour un été qui me voyait revenir en Gaspésie depuis peu. L’année 2008 restera pour moi une année charnière. Fraîchement diplômé de l’Université Laval, je quitte Québec en janvier, alors que s’affiche le célèbre 400e au sommet du Complexe G pour commémorer les quatre siècles de fondation de la capitale par Champlain. En descendant l’autoroute 20, puis la 132, j’ai la tête pleine d’espoirs de moi-même contribuer à mon coin de pays. Micheline Pelletier, la mairesse de Sainte-Anne-des-Monts à l’époque, m’aidera à tracer mon chemin pour participer au développement de la Haute-Gaspésie.
Au tournant du millénaire, un festival est nommé les « Grandes Marées ». Sur le terrain du Centre Explorama (devenu Exploramer), l’idée est alors de créer une véritable fête populaire estivale. De cela, par l’impulsion de Monique Campion, directrice de l’institution, émerge un symposium de sculptures sur bois de plage, appelé « bois flotté ». Quelques belles éditions ont lieu.
Réinventer un évènement
En prévision de l’été 2008, l’administration municipale cherche à relancer l’idée d’un festival dont le centre
d’intérêt serait la sculpture sur bois flotté. Micheline Pelletier désire en faire une signature pour la ville, pour la région. La nouvelle directrice de la culture, Monique Campion, partage cette même vision; étant bien sûr la fondatrice du symposium en 2001.
Embauché comme coordonnateur de l’évènement, je mets toutes mes énergies et mes idées à profit. En quatre ou cinq mois, nous devons faire sortir de terre ni plus ni moins qu’un festival… Une rencontre fondatrice a lieu avec Mme Campion, Sandra Gauthier (devenue directrice d’Exploramer) et moi-même. Le nom Fête du Bois flotté est
adopté rapidement. Une programmation diversifiée et une signature graphique sont conçues dans les semaines suivantes. Le ton est donné pour les années à venir.
Au moment de la recherche de partenaires financiers, ayant toujours le 400e en tête, je décide de solliciter la société responsable de l’organisation. Notre demande est acceptée. On se rappelle que le « Fêtons nos 400 ans! » est alors partout dans les grands médias écrits et télévisés. Pour profiter de ce filon et mousser notre évènement, je réussis à convaincre Mme Pelletier d’offrir un cadeau à la Ville de Québec pour son 400e. Une
Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 31 ]
Marc-Antoine DeRoy Coordonnateur, première édition de la Fête du Bois flotté
[DOSSIER]
L’artiste ZO sculpte un morceau de bois de mer à l’aide d’une scie mécanique pendant une édition de la Fête du Bois flotté. Fête du Bois flotté
commande est passée au sculpteur ZO ainsi qu’à l’atelier du Vieux Rabot détenu par David-Yan Auclair pour la réalisation du piédestal. Pour la remise de l’œuvre, le maire Régis Labeaume nous reçoit à l’hôtel de ville. Les journaux de la capitale sont présents pour couvrir l’évènement. Outre Montréal, nous sommes la seule ville québécoise à offrir un legs à Québec. De partout dans le monde, les offrandes affluent. La sculpture se trouve toujours dans le salon d’apparat de l’hôtel de ville de Québec. Notre mythologie à nous Au conseil d’administration de la société d’histoire où je siège depuis mon retour, j’ai côtoyé des personnes exceptionnelles, dont l’incomparable J.-Augustin St-Laurent. Avant et après les rencontres, il me parlait inévitablement de son sujet de prédilection : les chanteurs et conteurs de Tourelle rencontrés par Marius Barbeau lors de son voyage nord-gaspésien de 1918. Dans sa jeunesse, M. St-Laurent a d’ailleurs connu certaines de ces personnes, devenues aujourd’hui légendaires. Quelques années auparavant, j’ai visité deux grands musées internationaux : le Metropolitan Museum à New York et le Louvre à Paris. Les œuvres issues des grands mythes de l’Antiquité y regorgent. Jusqu’au 19e siècle en effet, de nombreux artistes européens tirent leur inspiration de deux ouvrages fondateurs : L’Iliade et l’Odyssée. À l’aube de la première édition de la Fête du Bois flotté, me vient donc l’idée de fournir une thématique aux artistes qui permettrait en même temps
de valoriser notre folklore, notre mythologie régionale. J.-Augustin St-Laurent m’avait converti! Tel le père Germain Lemieux, ethnologue de renom natif de Cap-Chat, je considère que notre folklore hérité de la vieille France paysanne ne doit pas rougir devant la mythologie gréco-romaine. Monique Campion acquiesce à cette idée. Cela me donne des ailes et le festival qui naît possédera un côté original qui va perdurer jusqu’à l’édition 2021.
Le conte est sélectionné par Gaétan Pelletier, artiste et citoyen impliqué, dans le répertoire de Barbeau consigné à Tourelle en 1918. Patrice Michaud procède à la lecture au début des festivités, devant les sculptures et la foule. Il débute alors sa carrière. À cette époque, l’artiste de Cap-Chat est très actif dans le milieu du conte et ses spectacles en sont truffés. Au demeurant passionné d’histoire, il est la personne toute désignée pour ce mandat.
Le roi Vaillancourt
Cet été-là, Sainte-Anne-des-Monts vit pratiquement deux festivals en un. Quelque part au printemps, Claude Prévost, un Marsois d’adoption, vient me voir au bureau en arguant qu’il serait souhaitable pour l’évènement du Bois flotté qu’un de ses amis artistes occupe un certain espace. L’ami n’est nul autre que… Armand Vaillancourt. La présence de ce sculpteur de grande renommée à notre évènement permettrait assurément de mettre en lumière nos actions. Toutes et tous sont emballés, non pas sans une certaine appréhension vu sa prestance. Nous, nous démarrions
Armand Vaillancourt pose devant sa gigantesque sculpture intitulée Drapeau blanc alors que deux grues viennent de la mettre en place sur le site de la marina, 2008. L’œuvre de 55 pieds (16,7 mètres) et 21,5 tonnes se veut un symbole de solidarité représenté par tous les billots mis ensemble. Fête du

un festival de province. Bien que tout cela nous dépasse un peu, y compris l’administration municipale, la mobilisation, puis les résultats sont grandioses. Une gouvernance difficile à orchestrer accouche d’une œuvre démesurée. Aujourd’hui, SainteAnne-des-Monts peut s’enorgueillir de posséder un « Vaillancourt »; que nous gagnerions d’ailleurs à mettre davantage en scène.
DIAPORAMA PHOTO D’ERIC GARSONNIN DE SCULPTURES DES ANCIENNES FÊTES
 Bois flotté
Bois flotté
[DOSSIER]
VINGT ANS DE BLUES AU BORD DE LA MER
Pendant deux décennies, de 1993 à 2012, les abords de la plage municipale de Carleton-surMer ont accueilli un évènement musical unique : le Festival international Maximum Blues. Vingt éditions au cours desquelles les inconditionnels de la note bleue se sont donné rendezvous pour savourer cette musique jouée par des musiciennes et musiciens d’ici et d’ailleurs.
 Paul Lemieux
Paul Lemieux
Entre la mer et la montagne
Le cadre géographique, entre la mer et la montagne, a inspiré le comité organisateur, alors que s’implante cet évènement d’un genre musical inédit en Gaspésie. Cette proximité de la grève et de la mer devient rapidement l’une des marques de commerce de ce festival pas comme les autres. « Coincé » entre le boulevard Perron et la baie des Chaleurs, le Maximum Blues accueillera ses
milliers de visiteuses et visiteurs dans cet espace restreint, cette proximité de la mer et de l’air salin participant à la création d’une ambiance particulière.
L’évènement se tient la première fin de semaine du mois d’août. « La fin des vacances de la construction est loin d’avoir occasionné une baisse de l’achalandage touristique dans la région de Carleton. La tenue de ce festival culturel que constitue
Maximum Blues, mettant l’accent sur la musique du même nom, contribue à étirer la période de pointe pour les hôteliers, restaurateurs et commerçants »1, écrit le journaliste Gilles Gagné dans Le Soleil du 6 août 1993.
Le soir inaugural, le mercredi 4 août 1993, la tête d’affiche est le Steven Barry Band, un groupe qui multipliera ses présences à Carleton au fil des ans. Mais en première partie, des musiciens locaux, le
Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 33 ]
Historien et résident de Carleton-sur-Mer
[DOSSIER]
Le site en bord de mer est l’une des marques de commerce du festival Maximum Blues. Ville de Carleton-sur-Mer
groupe Blues Talk, formé de Norman Parent, Jacques Bélanger, Daniel Lanneville, Dan Bernier et Michel Roy, cassent la glace de ce nouveau festival.
Un engouement rapide
D’année en année, les amatrices et amateurs de blues se font nombreux à Carleton. Ils sont près de 2 000 lors de la première édition en 1993. Par la suite, bon an, mal an, le festival attire jusqu’à 23 000 personnes au cours de la fin de semaine. La rareté des évènements consacrés au blues fait le succès de Carleton qui attire une clientèle tant du Québec que des Maritimes. Jeunes et moins jeunes se massent devant la grande scène où guitaristes, harmonicistes, saxophonistes et pianistes offrent des prestations exaltantes. Certaines années, comme en 1999, le festival accueille 160 artistes, incluant les groupes gospel se produisant à l’église Saint-Joseph.

Au cours des années de fort achalandage, le Maximum Blues connaît des soirées mémorables, avec jusqu’à 4 000 personnes sur le site, comme c’est le cas le mercredi 1er août 2007. Lorsque les
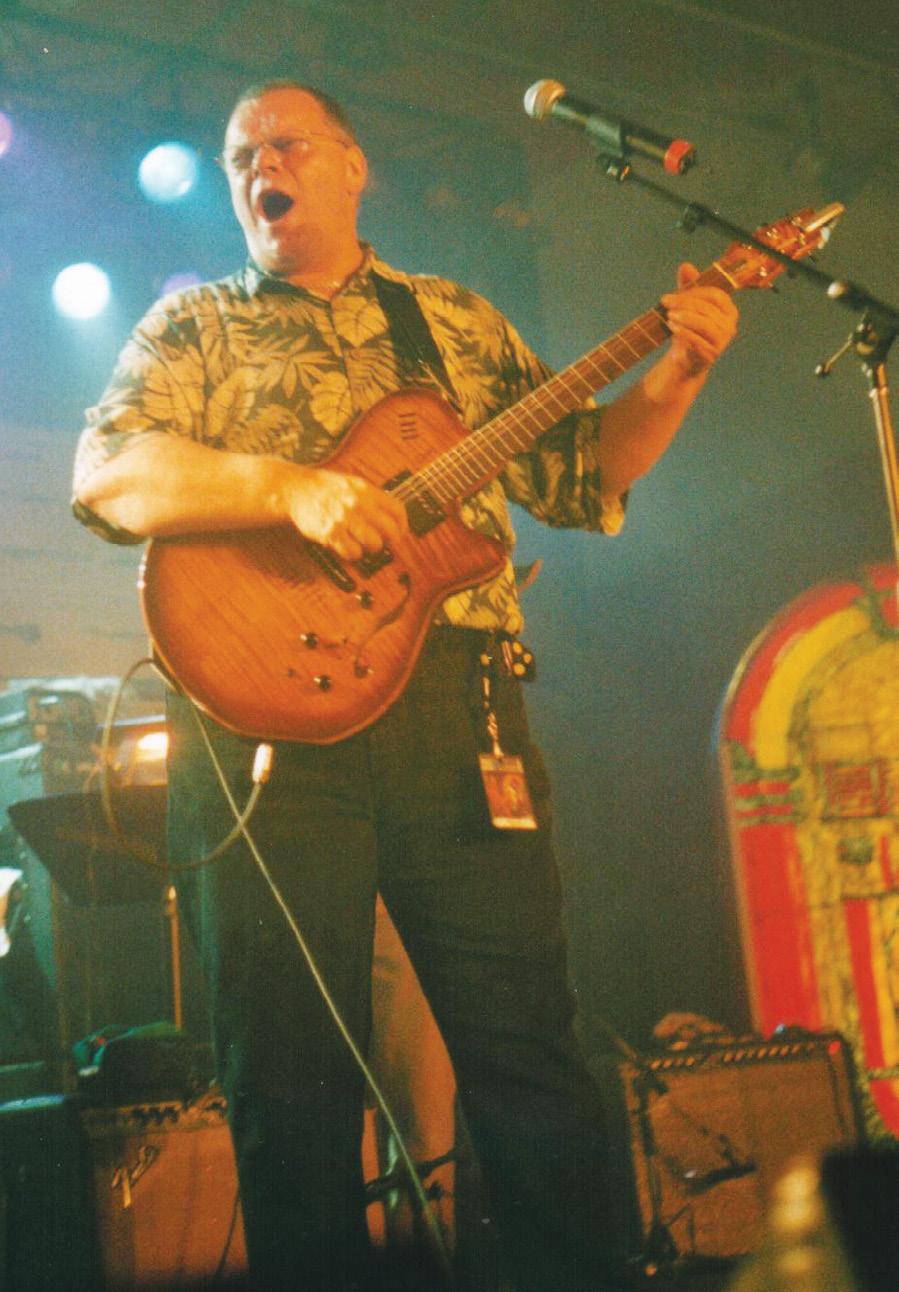
grands spectacles s’achèvent, une dizaine de bars, le St-Barnabé, L’Abri et autres, prennent la relève en musique. À leur fermeture, de nombreux musiciens se retrouvent à la marina pour des « jam » de fin de nuit, pour le plus grand plaisir des amatrices et amateurs.
Musiciennes et musiciens d’ici et d’ailleurs
De tout temps, la programmation de l’évènement est ouverte aux différentes formes de blues. « Notre programmation est vaste. Elle vise à faire découvrir de nouveaux talents et toutes les facettes du blues, à savoir le gospel, le soul, le Chicago blues, le Texas style, le Rythm and Blues et le style Blues-rock notamment. »2, selon le directeur général du festival, Pierre Ménard, dans Le Devoir de 2006. Plusieurs musiciens laisseront une empreinte profonde dans la mémoire collective du Maximum Blues. Si certains tels Eddy « the Chief » Clearwater, Eddie Shaw and the Wolfgang ou Lucky Petersen, sont connus à l’échelle internationale, d’autres, tels les Québécois Bob Walsh, Carl Tremblay, Jimmy James, Steve Hill ou Ray Bonneville feront les belles nuits du festival. Dans la
baie des Chaleurs, le festival fait émerger des talents, tels Pat the White, surnommé « l’enfant du Maximum Blues », tout comme les groupes Bottleneck Blues Trio, Bout d’ligne Blues Band et 132 Est.
Le vent dans les voiles
Au fil des ans, le Maximum Blues étend son réseau de contacts et son attractivité, le qualificatif « international » étant désormais accolé à son nom. Dans cette vague, un jumelage est établi en 2001 avec la ville de Clarksdale, au Mississippi où se tient le Sunflower River Blues and Gospel Festival. La chanteuse québécoise Nanette Workman, native de cet État du Sud des États-Unis, sert d’intermédiaire pour faciliter cette entente. Plusieurs « bluesmen » gaspésiens auront l’occasion d’aller se produire au Mississippi. En retour, le Maximum Blues accueille des artistes de là-bas. Durant ces mêmes années, le Maximum Blues procède à l’enregistrement des groupes locaux qui
[ 34 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023
Blues et soleil pour cette foule venue assister à un spectacle en après-midi. Ville de Carleton-sur-Mer
[DOSSIER]
Le musicien québécois Bob Walsh (1947-2016) dont le nom est étroitement associé au Maximum Blues pendant des années. Ville de Carleton-sur-Mer
se produisent au festival. À compter de 1998, un CD est lancé chaque année pour la plus grande joie des amatrices et amateurs de blues qui peuvent se remémorer de bons souvenirs de l’édition précédente.
La fin
En janvier 2013, le couperet tombe sur le Festival international Maximum Blues, à la suite de l’assemblée générale annuelle de l’organisme qui décide d’y mettre fin en raison de difficultés financières récurrentes. La diminution des subventions gouvernementales et des commandites, la dette accumulée et l’absence de liquidités contraignent les membres du conseil d’administration à prendre cette décision.
Au cours des années précédentes, le festival a fait face à une baisse de popularité, se traduisant par une fréquentation de 10 000 à 12 000 participants·es en 2012, la multiplication des festivals de blues au Québec et au NouveauBrunswick expliquant le désintéressement d’une partie de la clientèle. « En 1997, nous étions le seul évènement majeur de musique blues dans les deux provinces. Maintenant, il y en a plus d’une dizaine.

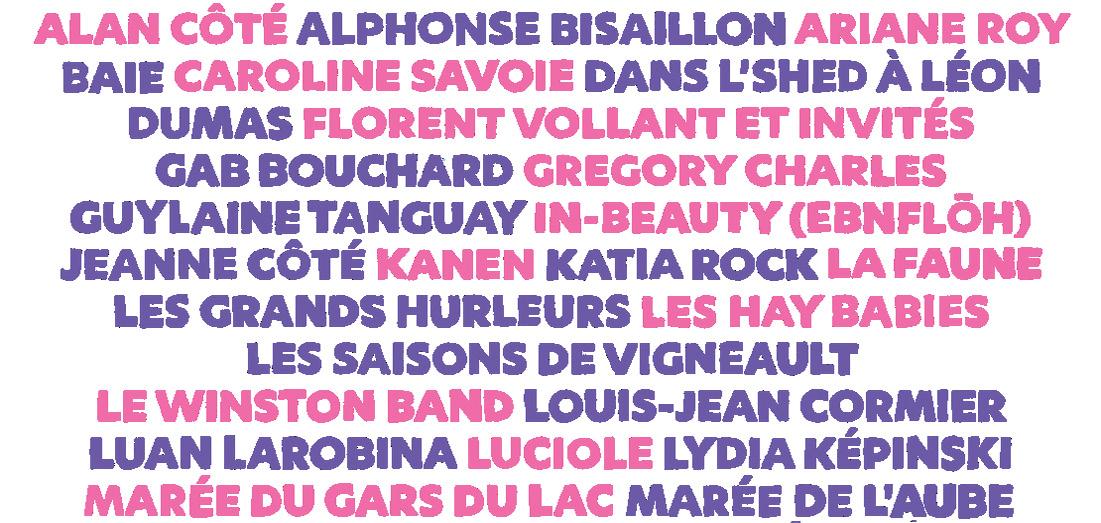
Et en Gaspésie, l’offre culturelle est plus importante, alors que la population stagne. »3, témoigne Alain Desjardins, vice-président du conseil d’administration, dans le Graffici en 2013.
Les passionnés·es de blues sont devenus orphelins d’un évènement, mais il est resté certainement des milliers de souvenirs impérissables et de notes bleues dans la mémoire de ceux et celles qui ont vécu le blues au bord de la mer.
Remerciements à la Ville de Carletonsur-Mer qui a mis gracieusement à disposition ses photographies.
Notes
1. Gilles Gagné, « Le Festival Maximum Blues étire la saison touristique », LeSoleil, 6 août 1993, p. B 1.

2. Thierry Haroun, « Festival Maximum Blues - Carleton sur une note bleue », LeDevoir, 20 juin 2006.
3. Antoine Rivard-Déziel, « Le Festival Maximum Blues de Carleton-sur-Mer s’éteint », Graffici, 16 janvier 2013.
festivalenchanson.com




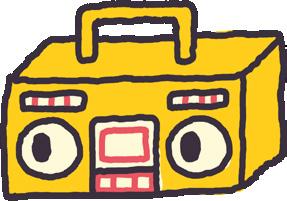
Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [
28 JUILLET AU 5 AOÛT 2023
[DOSSIER]
Eddie King (1938-2012), célèbre musicien de Chicago, sous le grand chapiteau du Maximum Blues. Ville de Carleton-sur-Mer
PETITE-VALLÉE AU TEMPS DES PRÉCURSEURS·ES
Cette année, on en est à la 40e année du Festival en chanson de Petite-Vallée, un des plus importants du genre au Québec. Que sont devenus les participants·es des premières années? Au départ, il s’agit surtout de mettre en lumière des talents locaux par un concours composé de deux catégories dédiées uniquement à l’interprétation. Récits de deux gagnants·es de la première heure.
Été 1983, première édition du Festival en chanson. J’y participe en duo en compagnie de ma sœur. Nous interprétons la chanson Lui de Michèle Torr, un succès de 1980. Je ne me souviens pas du nombre de concurrents·es, mais il y en a quand même plusieurs. Cette première est remportée par Guylaine Parker de Murdochville dans la catégorie A.

Été 1985, je me présente à nouveau, mais en solo cette fois. J’ai travaillé énormément. Chaque participant·e n’a qu’une seule chanson à interpréter, ça doit être la bonne! Je choisis La belle promeneuse de Michel Rivard. Je n’ai jamais suivi de cours de chant et je ne sais pas lire la musique. J’y vais beaucoup à l’oreille, ce que je fais toujours aujourd’hui.
Donc, en 1985, je remporte la catégorie B alors qu’Élaine Réhel gagne la A.
En 1986, je tente à nouveau ma chance avec, cette fois, une chanson de Richard Séguin : J’te cherche partout. Comme j’ai déjà remporté la B, je dois nécessairement m’inscrire dans la A; ce que je fais parce que je veux absolument chanter. Quelle n’est pas ma surprise d’apprendre qu’on me décerne la palme A! Je deviens donc le premier à remporter les honneurs des deux catégories et, de surcroît, deux années de suite. La personne qui gagne la B est ma cousine, Fanny Côté, qui gagnera la A l’année suivante. Tout au long de la période où le festival est un concours, nous sommes les seuls·es à avoir remporté les deux catégories.
En 1987, je fais donc un spectacle
d’une heure uniquement avec des chansons d’auteurs québécois. Par la suite s’ouvre le volet auteurcompositeur-interprète. J’y participe et je me rends en finale en 1990 et 1991. Je ne gagne pas, mais j’y apprends beaucoup.
Après avoir formé le groupe David et Goliath qui roule sa bosse entre 1987 et 1989, je fais cavalier seul pendant plusieurs années. La pandémie est arrivée et je me suis laissé prendre au jeu de faire des prestations en direct de façon régulière sur ma page Facebook Chansons Francophones. Cela a donné naissance à la formation Spécial Trio qui se veut une sorte de retour sur scène de trois des membres fondateurs de David et Goliath, toujours en français!
[ 36 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023
David Richard Gagnant, Festival en chanson de Petite-Vallée en 1985 et 1986, et originaire de Grande-Vallée
Au centre, Élaine Réhel (à droite de l’animateur) et David Richard (avec les lunettes), gagnante et gagnant du Festival en chanson de Petite-Vallée, 1985.
[DOSSIER]
Photo : Bernard Bélanger, Le Pharillon Musée de la Gaspésie. Fonds Élaine Réhel. P261
En 1985, un collègue de travail me suggère de m’inscrire au festival, qui est à l’époque un concours. On cherche des candidats·es et les inscriptions se font rares pour la 3e édition. Premier samedi de juillet, me voici à la salle paroissiale de Petite-Vallée, qui tient aussi lieu de chapelle. J’ose une performance a capella, une première. De plus, je choisis un répertoire de folklore traditionnel. Le grain de mil et À la claire fontaine, selon l’interprétation, à l’époque, d’Édith Butler.
Certains critères d’évaluation sont, à mon avis, ceux qui ont fait la
différence pour moi : la présence sur scène, le choix des chansons, l’originalité. La justesse de ma voix est encore à travailler. Au début, on s’inscrit dans la Catégorie A (celle que j’ai gagnée) ou B, en interprétation. Pas d’auteur-compositeur-interprète à l’époque. L’année suivante, la gagnante ou le gagnant est invité à faire un tour de chant d’une heure en première partie du concours.
Après Petite-Vallée, je déménage aux Îles-de-la-Madeleine. L’expérience du festival m’a donné le goût de continuer. Je m’implique donc dans une revue musicale au théâtre du Vieux Treuil au Site historique de la Grave à Havre-Aubert. Pendant les années vécues aux Îles, je chante de nombreuses fois dans divers évènements et je travaille avec le groupe Suroît. Ensuite, de retour en Gaspésie, en 2006, je présente un spectacle de chansons de Georges Brassens à quelques endroits, sous le nom du trio La Marguerite, avec mes amis Roger Lavoie et Paul Francœur.
Mon passage à Petite-Vallée fait partie d’une de mes plus belles expériences de vie. Je me souviens du Café de la vieille Forge, de la Maison Lebreux et de cette chère Denise qui m’a accueillie comme une maman, de son fils Simon et d’Allan
40 ans en chanson

Fondé en 1983, le Festival en chanson est d’abord un concours local amateur qui s’insère dans la programmation du Festival de la Parenté. La même année, un café ouvre ses portes dans la forge nouvellement restaurée. Les deux organisations évolueront ensuite ensemble. Radio-Canada diffusera le festival à partir de 1988 à la radio, ce qui donnera à l’évènement une visibilité accrue. Puis, on introduit le concept d’artiste-parrain ou marraine en 1990 qui donne un nouvel élan au festival, un concept qui est toujours en place aujourd’hui sous le nom de passeur ou passeuse. La programmation culturelle se diversifie et la formule du concours est abandonnée. C’est en 1992 que le Festival en chanson devient une entité. Ce festival voué à la chanson francophone se déploie depuis dans le décor majestueux de Petite-Vallée.

qui est le chef d’orchestre de tout ça. Je n’ai pas fait une carrière dans la chanson, mais ce festival demeure un évènement marquant de ma vie. Merci aux gens de Petite-Vallée qui sont des passionnés·es de la chanson.
Vieille forge de Petite-Vallée. La boutique de forge d’Alfred LeBreux est transformée en caféthéâtre. Une salle de spectacles lui est annexée en 2001 pour devenir le Théâtre de la Vieille Forge, qui est victime d'un incendie en 2017. Musée de la Gaspésie. Fonds Journal Le Pharillon P285/4/3,4

Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 37 ]
Élaine Réhel
Gagnante, Festival en chanson de Petite-Vallée en 1985, originaire de Bridgeville et résidente de Percé
Disque vinyle 45 tours de la chanson thème du Festival de la Parenté, 1984.
Musée de la Gaspésie. Fonds Élaine Réhel. P261/8/6
Élaine Réhel lors de sa prestation au Festival en chanson de Petite-Vallée, 1985.
Photo : Bernard Bélanger, Le Pharillon Musée de la Gaspésie. Fonds Élaine Réhel. P261
[DOSSIER]
JETER L’ANCRE DEPUIS PRÈS DE DEUX DÉCENNIES EN MUSIQUE
Le Festival Musique du Bout du Monde (FMBM) est né d’une volonté de jeunes Gaspésiens et Néo-Gaspésiens et Gaspésiennes d’offrir à la communauté un évènement ouvert sur le monde, qui célèbre les différences culturelles par la musique et d’autres médiums. Ces jeunes passionnés·es de musique sont alors désireux de s’engager socialement tout en participant au développement culturel, économique et touristique de leur région. Ils forment, en 2002, un comité organisateur et regroupent autour d’eux une multitude de partenaires. En 2004, une première édition du Festival Musique du Bout du Monde voit le jour. Près de 20 ans plus tard, l’évènement continue de rassembler des milliers de personnes chaque été, aux quatre coins du grand Gaspé.
 Marie-Michèle Plante
Marie-Michèle Plante
Codirectrice générale, Festival Musique du Bout du Monde
Steve Pontbriand
Codirecteur général, Festival Musique du Bout du Monde
Ancré dans l’histoire
L’histoire de la ville de Gaspé inspire le comité organisateur et la programmation offerte est résolument tournée vers l’international. Dès la
première édition, une grande variété artistique est proposée, tirée de ce passé. La ville hôte porte une longue histoire d’échanges et de rencontres, elle qui est au 19e siècle un point
tournant dans le monde portuaire. À l’époque, Gaspé accueille des consulats de l’Italie, de l’Allemagne, des États-Unis, du Portugal, de la Norvège et du Brésil, un héritage
[ 38 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023
[DOSSIER]
Alash Ensemble au cap Bon-Ami, 2018. Le spectacle au lever du soleil est un évènement phare du FMBM qui allie musique et paysage. Photo : Ricochet design Festival Musique du Bout du Monde
qui inspire l’équipe du festival. C’est cette ambiance d’échanges, de frénésie et de rencontres si caractéristique des villes portuaires que l’organisation s’efforce de perpétuer au fil du temps. Quant au nom de l’évènement, il est directement associé à la signification du mot mi’gmaq « Gespeg, » qui signifie « là où la terre prend fin », soit le bout du monde.
La diversité est le leitmotiv qui anime l’équipe de programmation depuis les tous débuts. L’évènement s’est donné pour objectif de surprendre son public avec des propositions originales issues de cultures diverses et ainsi créer une sorte de fenêtre ouverte sur le monde facilement accessible à la population gaspésienne. Ce sont plus de 1 000 prestations qui ont été présentées au fil des ans par des artistes de partout dans le monde.
Le festival se démarque aussi par une offre culturelle qui se déploie dans divers médiums artistiques. En plus d’un volet important de sa programmation qui implique les arts de la scène, chaque édition est marquée par une multitude de prestations d’arts de rue. Clowns, acrobates, cracheurs de feu, projections de documentaires, improvisations, théâtre de rue et autres propositions circassiennes contribuent à la création de souvenirs impérissables dans l’esprit des festivalières et festivaliers.

Ancré dans sa communauté
Un des éléments essentiels de la réussite des activités du festival est lié aux partenariats qui se sont tissés au fil du temps. Une multitude d’entreprises et d’organismes collaborent aux activités de diverses façons. Que ce soit en troc ou en commandites, le festival compte sur le soutien de plus de 50 partenaires par édition. Il en résulte, entre autres, un déploiement d’animations partout dans le grand Gaspé, de L’Anse-au-Griffon à Douglastown, en passant par le centre-ville de Gaspé. Les activités attirent près de 20 000 participants·es chaque année. Une importante proportion du public sont des visiteuses et visiteurs venus de partout au Québec pour l’occasion, stimulant ainsi l’économie locale tout en faisant bénéficier la région d’un rayonnement non négligeable.
Dès ses débuts, l’évènement vise à inclure et à rassembler le plus largement possible les habitants·es du territoire : « parmi les nombreux objectifs que nous avions au moment de créer l’évènement, il y avait celui de stimuler le sentiment d’appartenance à notre milieu et de rapprocher les trois principales communautés linguistiques de notre territoire : francophone, anglophone et autochtone. » se souvient Frédérick Ste-Croix, co-fondateur du Festival Musique du Bout du Monde.
Chaque édition est soutenue par le déploiement de plus de 250 béné-
voles qui sont la colonne vertébrale du FMBM. Leur savoir-faire, leur dévouement et leur bonne humeur en font un évènement reconnu pour la qualité de son accueil et pour la richesse des rencontres qu’on y fait. Le bénévolat au cœur de la grande famille du FMBM apparaît aussi comme une importante porte d’entrée au sein de la communauté pour de nombreux Néo-Gaspésiennes et Néo-Gaspésiens qui ont la chance de tisser des liens significatifs en participant à la réalisation d’un évènement résolument ouvert sur les diversités.
Ancré dans son environnement
En 2019, l’organisation s’est dotée d’une vision qui témoigne de l’évolution du festival 15 ans après sa création : créer des expériences et faire vivre des rencontres inoubliables grâce à cette alliance unique entre les cultures du monde et la majesté du territoire. C’est cette vision qui guide la grande équipe du Festival Musique du Bout du Monde pour le déploiement des prochaines éditions. Le milieu naturel si distinctif qu’offre Gaspé fait maintenant partie intégrante de l’expérience offerte aux festivalières et festivaliers. Que ce soit au sommet du mont Béchervaise ou au cap Bon-Ami dans le parc national Forillon, les activités s’inscrivent en harmonie avec le riche paysage du territoire qui l’accueille.
 La rue de la Reine à Gaspé devient piétonne pour accueillir les nombreux festivaliers et festivalières qui profitent des animations, 2018.
Photo : Roger St-Laurent Festival Musique du Bout du Monde
Spectacle de Lakou Mizik sous le chapiteau, 2019.
La rue de la Reine à Gaspé devient piétonne pour accueillir les nombreux festivaliers et festivalières qui profitent des animations, 2018.
Photo : Roger St-Laurent Festival Musique du Bout du Monde
Spectacle de Lakou Mizik sous le chapiteau, 2019.
[DOSSIER]
Photo : Ricochet design Festival Musique du Bout du Monde
PA RC N ATI O NA L DE M I G UA S H A
Terri to i r e p r o tég é . E xpérien ce g randeur n a tu r e .
Lorsque les poissons régnaient sur le monde…
Faites un détour de 380 millions d’années et partez à la découverte de l’univers fascinant des poissons fossiles du parc national de Miguasha.
Unique au monde, classé site du patrimoine mondial de l’UNESCO, le parc vous o re une expérience familiale se déclinant en une vaste série d’activités à la portée de tous.

LA CARTE POSTALE, GRANDES ET PETITES COMMUNICATIONS
Vers la fin du 19e siècle, la carte postale fait son entrée dans le monde des communications. Simple et efficace, elle devient populaire très rapidement. Elle permet même d’envoyer un message sans être dans l’obligation d’avoir une enveloppe. En 1869, l’Europe est le premier continent à l’utiliser. Le Canada emboîte le pas deux ans plus tard et la carte postale se propage partout dans le pays. La Gaspésie ne fait pas exception.
Marie-Pierre Huard Archiviste, Musée de la Gaspésie

Au début, c’est le gouvernement qui a la mainmise sur la circulation des cartes postales. Il l’utilise pour ses messages d’affaires. Nous sommes loin des cartes colorées; seule une gravure de la reine Victoria est permise! En 1895, le privé fait son entrée. Deux ans plus tard, les cartes postales sont dorénavant illustrées. Les familles anglophones et francophones de la Gaspésie n’échappent pas à ce nouveau type de communication et les raisons de leur utilisation sont fortement similaires.
Les cartes postales dans le fonds de cette famille anglophone, au nombre de 241, vont de 1905 à 1921. Ces échanges sont les témoins typiques de l’époque. La grande majorité des cartes postales sont envoyées lors de différentes fêtes : Noël, Jour de l’An, Saint-Valentin, Pâques, Saint-Patrick, etc.
Ces cartes sont le moyen de communication par excellence alors que les familles n’ont pas encore la chance d’avoir le téléphone. En effet, le 12 décembre 1907, Mme Fred Gilles (ou Gillis), qui réside à Port-Daniel,

reçoit une carte postale de Gascons! Susan Chedor[e] lui demande si elle a bien reçu les haut-parleurs pour son phonographe et si oui, si elle peut les lui envoyer par la poste puisque la route est mauvaise! Les messages peuvent être très courts comme le montre la carte envoyée par M.J. à Fred Gilles le 14 mars 1910. Elle lui écrit simplement : « Tu dois être occupé avec tes filets », nous laissant supposer que Fred se prépare pour la saison de pêche!
Les évènements mondiaux touchent aussi cette famille. Le 24 mars 1917, Russell rédige une carte postale
Fonds Famille Gillis
Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 41 ]
Recto d’une carte postale envoyée par Blanche Lamontagne à son oncle George, 1905. Musée de la Gaspésie. Fonds Théodore-Jean Lamontagne. P32/11/1
à James Gillis. Il lui écrit : « Cher James, je suis présentement en route vers Halifax. J’écrirai dès que j’ai une chance. Mon adresse va être Army Post office, London Eng. ». Nous comprenons facilement que ce Russell est un soldat qui part en direction de l’Angleterre pour combattre. James reçoit aussi une carte plus légère de la part d’une jeune fille qui se nomme Georgiana. Elle lui écrit simplement : « Cher James, Je serai bientôt à la maison pour aller pêcher et nous allons avoir du plaisir. Je vais aller chercher des hameçons. ». C’est ainsi qu’elle termine son message!

Fonds Théodore-Jean

Lamontagne
Les cartes postales de cette famille établie sur la rive nord de la péninsule sont un peu plus détaillées que celle de la famille Gillis et souvent personnalisées. Les Lamontagne possèdent un magasin général à Sainte-Anne-des-Monts. Georges Lamontagne, fils de Théodore-Jean Lamontagne, reçoit au mois d’avril 1905 de Juliette de Cap-Chat une carte postale lui demandant : « Dismoi si tu as de la mousseline fond blanc et picots blancs pour robes ou si tu dois en recevoir prochainement. Si tu en as, aie donc la bonté de m’en envoyer 10 vgs. Si non [sic] réponds! ». Un an plus tard, c’est sa nièce vivant à Cap-Chat qui lui écrit : « Cher oncle, Avez-vous encore au magasin de la craie coloré[e] […] Je trouverais à en vendre ici, à mes compagnes de classe. Dis-moi le prix de la boîte de ces couleurs et je vous enverrai l’argent. ».
Bien entendu, le fonds comprend des cartes postales envoyées par la future poétesse Blanche Lamontagne alors qu’elle est à l’extérieur de Sainte-Anne-des-Monts. Pour cette adolescente résidente au couvent des sœurs de la Charité à Cacouna, l’espace réservé au message n’est pas suffisant, elle écrit donc sur l’image imprimée! Le 13 septembre 1905, fortement inspirée, elle rédige une longue carte postale à son oncle. « Mon bien cher oncle, Si loin, si loin de Gaspé, je pense à tous ceux que j’aime, que j’ai dû laisser. Comment n’auriez-vous pas mon meilleur souvenir vous le meilleur gâteur d’enfants, qui m’avez fait sentir si souvent votre bon cœur. Je vous espère tous en excellente santé et j’envoie à chacun une foule de baisers. […] Si toutefois vous venez par ici en voyage ou même plus loin qu’ici, il serait bien facile, cher petit oncle, de

venir sonner au couvent. Le trajet est court de la station à ma cage. »
Les cartes postales demeurent populaires jusqu’à la fin de la Première Guerre mondiale. Pour la Gaspésie, l’inauguration du boulevard Perron en 1929 mène à l’augmentation du tourisme. Dès lors, ce moyen de communication connaît un regain. C’est l’arrivée massive des cartes postales illustrées à partir de clichés de photographes de la région, notamment d’Albert Cassidy ou de Charles-Eugène Bernard. Les touristes s’en procurent comme souvenir ou bien pour raconter leurs vacances. Même si les moyens de communication ont évolué avec le temps, les cartes postales demeurent encore populaires principalement dans les régions touristiques. Quoi de mieux encore aujourd’hui de s’en procurer afin de conserver un souvenir de notre voyage!
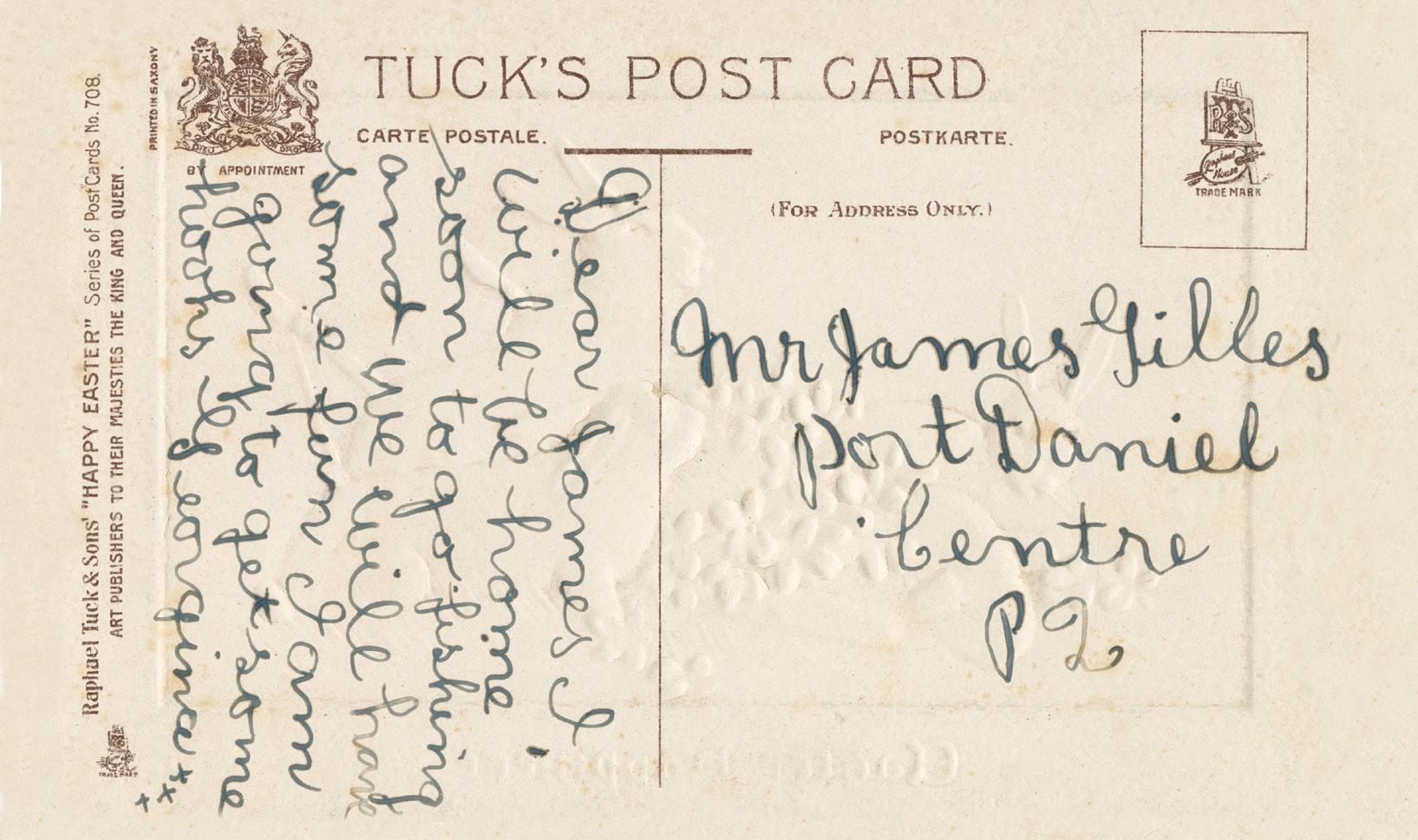
du Magazine Gaspésie et de la mise en valeur de notre riche histoire! Fier partenaire
Député
Stéphane Sainte-Croix
de Gaspé
[NOS ARCHIVES]
Verso d’une carte postale envoyée par Georgina à James Gillis, vers 1910-1915. Musée de la Gaspésie. Fonds Famille Gillis. P272/198
SAISIR L’INSTANT PRÉSENT
On prend des photographies tantôt par plaisir, pour garder des souvenirs, tantôt pour documenter, pour garder des traces d’un monde qui est en perpétuel changement. D’autres font de la photographie pour nourrir une soif de créativité, pour explorer les limites qu’offre le médium. Et c’est ainsi depuis les tous débuts de la photographie. Tous ceux et celles qui ont possédé les appareils photo présentés ci-dessous avaient eux aussi leurs raisons bien précises de saisir l’instant présent.
Carmen Roy et la nécessité de documenter
L’ethnologue et folkloriste Carmen Roy (1919-2006) est née à Bonaventure et a grandi à Cap-Chat. En 1947, alors qu’elle enseigne le français à l’Université Laval, à Québec, elle fait la rencontre de Marius Barbeau qui l’initie à la recherche en folklore. Sous sa recommandation, elle est engagée comme folkloriste au Musée national du Canada (aujourd’hui le Musée canadien de l’histoire) pour consigner son matériel collecté.
De 1948 à 1952, Carmen Roy mène un vaste projet d’enquête orale dans la péninsule gaspésienne. Parallèlement, elle poursuit des études en France pour finalement compléter un doctorat à l’Université de Paris (Sorbonne), intitulé Littérature orale en Gaspésie. Employée du Musée national du Canada, Carmen Roy contribue à créer la Division de Folklore qui deviendra le Centre canadien d’études sur la culture traditionnelle et qui aujourd’hui porte le nom d’Études culturelles.

La masse documentaire compilée par Carmen Roy est conservée au Musée canadien de l’histoire. Au Musée de la Gaspésie, nous conservons un de ses appareils photographiques, un Rollei 35, un outil essentiel dans le travail quotidien de Carmen Roy. Il s’agit d’un appareil à viseur 35 mm, conçu par Heinz Waaske pour Rollei. Le Rollei 35 détient pendant un certain temps le titre de plus petit appareil photo 35 mm plein format au monde. Malgré son prix élevé, il est

Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 43 ]
Vicky Boulay Conservatrice, Musée de la Gaspésie
Quelques appareils tirés des collections; de gauche à droite : Appareil photo Autographic Junior No.1 de Kodak Canada, vers 1925 (don de Yvette Cassivi).
Ciné-caméra modèle A-7 16 mm de Keystone, achetée par Félix Molloy pour Robert Flam, vers 1955 (don d’Omérille Gonthier Molloy. Collection Gaspésia).
[NOS OBJETS]
Appareil photo Six-20 Brownie Junior ayant appartenu à Gertrude Beaudoin, vers 1940 (don de Denise Coulombe). Musée de la Gaspésie
l’un des appareils 35 mm les plus vendus jusqu’à ce qu’il soit dépassé par les appareils à mise au point automatique.
Mme Bolduc : entre souvenir de famille et vie de tournées
L’appareil photographique de Mme Bolduc (1894-1941) a croqué sur le vif plusieurs instants de sa vie familiale et de ses tournées. Ses photographies ont été rassemblées dans un album-souvenir par sa fille cadette Fernande, donné au Musée de la Gaspésie.
L’appareil possédé par Mme Bolduc est un Rainbow Hawk-Eye No 2 Model B. Il est fabriqué à la fin des années 1920 par la division canadienne de la Eastman Kodak, fondée en 1899, la Canadian Kodak Co Ltd. C’est un appareil composé d’un boîtier en bois recouvert de similicuir et d’un viseur à réflexion unique; il utilise une pellicule 120, aussi appelé moyen format.
Ladislas Pordan et l’éveil d’une passion Né à Hosszupereszteg en Hongrie, Ladislas Pordan (Làszlo Pordan, 19192014) est prêtre, philosophe et enseignant qui s’est aussi fait connaître comme photographe en Gaspésie. Les bouleversements politiques entourant l’annexion de la Hongrie à l’Union des républiques socialistes soviétiques l’obligent à quitter son pays natal. Il accepte alors l’offre de Mgr Albini Leblanc d’exercer son ministère en Gaspésie. En plus de ses fonctions de vicaire, il enseigne au Séminaire de Gaspé ainsi qu’au Cégep de la Gaspésie et des Îles, de 1958 à 1984.
Il nourrit une véritable passion pour la photographie. Durant son séjour à Rome, son sens artistique s’éveille au contact des œuvres des musées de Milan, Venise et Assise. Au début des années 1950, il reçoit son premier appareil photographique comme cadeau de la part des paroissiennes et paroissiens de Paspébiac. Au fil des ans, sa pratique se professionnalise; il présente des expositions et enseigne la photographie au Cégep.
Les deux appareils photographiques lui ayant appartenu que le Musée conserve sont un Olympus 35 RC et un Spotmatic F de Asahi Pentax. L’Olympus 35 RC est un appareil photo télémétrique 35 mm fabriqué par Olympus au Japon dans les années 1970. Pour sa part, le Spotmatic F, également de fabrication japonaise, est le dernier de la série des Spotmatic à être introduit sur le marché en 1973.

Gérard D. Levesque dans la caméra de Roy Langevin
Roy Langevin (1928-2002) est l’organisateur des campagnes électorales de Gérard D. Levesque (1926-1996), député libéral provincial pour Bonaventure pendant plus de 37 ans. Pour effectuer son travail d’organisateur et capter les évènements à teneur politique auxquels participe le député, Roy Langevin utilise la caméra familiale, une Kodak Brownie Turret f/1.9 8 mm.
D’abord connu comme homme d’affaires dans la région, Roy Langevin flirte également avec la photographie au début de l’âge adulte, dans les années 1950. Après avoir suivi une courte formation, il photographie, dans son village natal, les
évènements comme les mariages. C’est presque naturellement qu’il devient l’organisateur des campagnes électorales de Levesque. En effet, ils se connaissent depuis la tendre enfance puisque les deux hommes ont grandi l’un en face de l’autre.
Le Kodak Brownie Turret f/1.9 8 mm est fabriqué par Kodak Limited en Angleterre en 1955. Il s’agit d’une caméra cinéma pour film 8 mm à double tirage avec une charge de 25 pieds (7,6 mètres). Elle est équipée de trois objectifs sur une tourelle rotative : un 13 mm, un 24 mm et un grand angle de 9 mm. Un accessoire accompagne la caméra, un Cine Kodak Folding Movie Light qui consiste en une barre d’éclairage électrique de quatre ampoules sur laquelle peut se fixer la caméra. Deux interrupteurs montés sur le boîtier permettent de choisir entre un éclairage à deux ou quatre lampes.
Que ce soit à des fins artistiques, documentaires ou personnelles, la photographie demeure populaire. L’évolution technologique de ces appareils méritent aussi que nous nous y attardions alors que nous sommes entrés dans l’ère numérique et que la pellicule fait désormais partie de l’histoire.
 Ciné-caméra Kodak Brownie Turret f/1.9 8 mm ayant appartenu à Roy Langevin. Musée de la Gaspésie. Don de Jean Langevin
Ciné-caméra Kodak Brownie Turret f/1.9 8 mm ayant appartenu à Roy Langevin. Musée de la Gaspésie. Don de Jean Langevin
[NOS OBJETS]
De gauche à droite : Rollei 35 de Carmen Roy (don de la famille Gagnon); Spotmatic F et Olympus de Ladislas Pordan (don de Ladislas Pordan). Musée de la Gaspésie
GEORGE SHEEHAN, HOMME D’AFFAIRES GÉNÉREUX
Mon père George Sheehan a laissé sa marque dans l’industrie du bois, dans l’élevage de chevaux et dans sa communauté de Cap-d’Espoir. Tout débute avec sa naissance à Sayabec, en novembre 1909, période durant laquelle son père George J. occupe justement un emploi de contremaître dans un moulin à scie de ce village de la vallée de la Matapédia.
Michael Sheehan
Fils de George Sheehan et résident de Gaspé

Au retour de Sayabec, la famille Sheehan s’installe à la Brècheà-Manon, paroisse faisant partie de Grande-Rivière. Alors adolescent, mon père fréquente le Séminaire de Rimouski ainsi que son frère aîné James, avant de poursuivre leurs études en Gaspésie, à l’ouverture du Séminaire de Gaspé en 1926. Mon père n’aimant pas trop les études, il décide donc de rentrer chez lui pour aider son père et son frère cadet Bernard. Ce dernier le remplace alors au Séminaire et y complète son cours classique.
George aide son père durant environ un an avant de s’aventurer sur le marché du travail.
C’est à la Banque Canadienne Nationale de Chandler qu’il présente une demande d’emploi. Il est engagé à Paspébiac où il y travaille environ deux ans. Comme il sait qu’il ne deviendra pas président de la banque, il décide de quitter cet emploi et de se diriger vers Montréal. On l’avertit qu’il sera difficile de trouver un emploi dans la grande ville, mais mon père réplique qu’il ne cherche pas nécessairement
un emploi : il veut devenir boxeur. Après avoir fréquenté les salons de boxe durant quelques semaines, il réalise que ce n’est pas un milieu qui lui plaît et il décide de revenir dans son patelin, en Gaspésie. Il retournera toutefois à Montréal plus tard et travaillera dans le domaine de la construction à l’édifice Sun Life.
Près de 60 ans dans l’industrie du bois
En 1936, mon père George se marie à Emelia (Amelia) Jones, fille de Michael (Mike) Jones de Petit-Pabos.
Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 45 ]
[NOS PERSONNAGES]
George Sheehan avec son jockey, Abel Denis Huard, à la piste de Pabos, 1988. Collection famille Sheehan
Ils ont dix enfants, sept garçons et trois filles. Mon père commence sa vie dans l’industrie du bois, vers 1935, en achetant du bois de pulpe à Val-d’Espoir et l’année suivante, il achète un magasin général à Cap-d’Espoir. Pas longtemps après, il commence à vendre du bois à la Gaspesia Sulphite. Il nous a raconté que durant une réunion avec les directeurs de cette compagnie, au printemps 1937 ou 1938, la Gaspésia n’avait pas les moyens de payer leurs achats de pulpe avant l’automne. Un M. Chouinard de Chandler a convaincu les vendeurs de pulpe de prendre une chance et ils ont alors décidé de livrer le bois sans être payés avant plusieurs mois.
Au tout début des transactions avec les bûcherons, il y a une certaine compétition entre les acheteurs de bois de pulpe et particulièrement avec les Robin. Mon père a dit à un M. Roy de Val-d’Espoir qu’il lui payerait 0,50 $ de plus la corde pour son bois. Ils se sont entendus et cela a permis à M. Roy de s’acheter un habit et quelques articles pour la maison avant son mariage.
Au début des années 1950, mon père possède un moulin à scie le long du chemin Lemieux, près de Val-d’Espoir. Par la suite, il le déménage à Cap-d’Espoir où il engage environ 20 employés. Quelques années plus tard, il construit un autre moulin le long de la route 6 (l’actuelle 132) à Douglastown, pour ensuite le déplacer le long de la rivière SaintJean. De 1953 à 1965, tout près de ce moulin, il érige un camp pour que les quelque 80 bûcherons et employés du moulin puissent s’y loger.

Un jour, lors d’un voyage à bord du train en direction de Montréal, il rencontre par hasard un monsieur qui lui demande ce qu’il fait dans la vie. Mon père lui répond qu’il œuvre dans l’industrie du bois. L’homme que mon père ne connaît pas lui dit qu’il pourrait acheter son bois. Et c’est ce qui s’est produit, car peu après, mon père lui expédie du bois par bateau à Cornwall, en Ontario.
Mon père vend du bois jusqu’en 1992. Il est obligé d’arrêter parce qu’il disait que : « Le moulin Gaspésia trouvait qu’il y avait trop d’acheteurs et, graduellement, ils se sont débarrassés des gens âgés et j’étais du groupe. »1. Quelques années avant, mon frère John lui a demandé s’il ne devrait pas arrêter d’acheter du bois. Mon père lui a répondu : « C’est facile, les gens m’appellent, je vais mesurer leur bois, je leur fais un chèque, ils sont heureux et moi aussi. ». Même à 82 ans, il ne voulait toujours pas arrêter.
Mon père n’a pas le temps de s’occuper du magasin général, c’est plutôt ma mère et un commis, Roméo (Pio) Collin, qui le gèrent. À la suite du décès de M. Collin, en 1966, c’est mon frère Edmund qui prend la relève. Je me souviens que les employés du moulin à scie ainsi que les camionneurs de pulpe font leur épicerie au magasin régulièrement.
La passion des chevaux et du chant
En plus de travailler à gérer ses affaires dans l’industrie du bois, mon
père vend des chevaux de ferme et, plus tard, il fait l’élevage de chevaux de course qu’il vend à l’encan annuel à la piste Blue Bonnets, à Montréal. À l’âge de 96 ans, il est reconnu comme le doyen des entraîneurs de course au Canada.

Il vend de bons chevaux. « Cape Cove Daisy a gagné 219 000 $ et elle course encore. En 2003, elle fait le mille en 1.54,02. Un autre de sa ferme, Cape Cove Breeze, a rapporté 156 000 $. J’ai été cinq fois dans le cercle des vainqueurs à l’hippodrome de Montréal dont deux avec Cape Cove Champ. »2 Dans cet article du Havre, Harold Duguay, président de la piste de course de Pabos, dit de mon père : « C’est un gars qui connaît la génétique des chevaux. Il est très fort. C’est un bon éleveur et ses chevaux se sont démarqués. »3
Malgré le fait que mon père mène une vie active, il est aussi maire de Cap-d’Espoir durant quelques années, mais il disait : « Pour être en politique, il faut être un bon orateur ». Comme il ne se considère pas comme tel, il quitte la mairie pour vaquer à ses affaires. Parmi ses autres activités, il est aussi membre de la chorale de l’église pendant près de 50 ans. Je me souviens qu’il chantait toujours l’Adeste Fideles à la messe de minuit.
Dans un article du magazine Agir de 2007, on dit : « M. Sheehan est un amour d’homme, un personnage vraiment très attachant qui marche allègrement vers son centenaire,
[ 46 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023
George Sheehan avec un jeune cheval, à Cap-d’Espoir, vers 2000. Collection famille Sheehan
Première maison familiale annexée au magasin général. La famille y habite jusqu’en 1972, année de l’expropriation.
[NOS PERSONNAGES]
Collection famille Sheehan
« celui qui a fait le temps, il en a fait en masse ». L’œil pétillant et la mémoire précise, il se raconte. »4.
Jacques Kasma a produit un film sur la vie de mon père en 2007. Dans ce documentaire, les gens ont dit de lui qu’il était « an honest man, a very obliging man » (« un homme honnête, un homme très serviable »), qu’il était un homme d’affaires qui a fait beaucoup pour sa paroisse de Cap-d’Espoir.
La famille Sheehan continue de faire travailler les gens de leur secteur de la Gaspésie. Mon frère Raymond est le propriétaire de l’usine E. Gagnon et Fils à SainteThérèse-de-Gaspé. Dans les moments forts de la saison des fruits de mer, avec la participation de ses fils Bill, George et Jerry, il peut engager plus de 650 personnes incluant celles de l’immigration saisonnière du Mexique (entre 40 et 80) pour pourvoir les postes vacants.
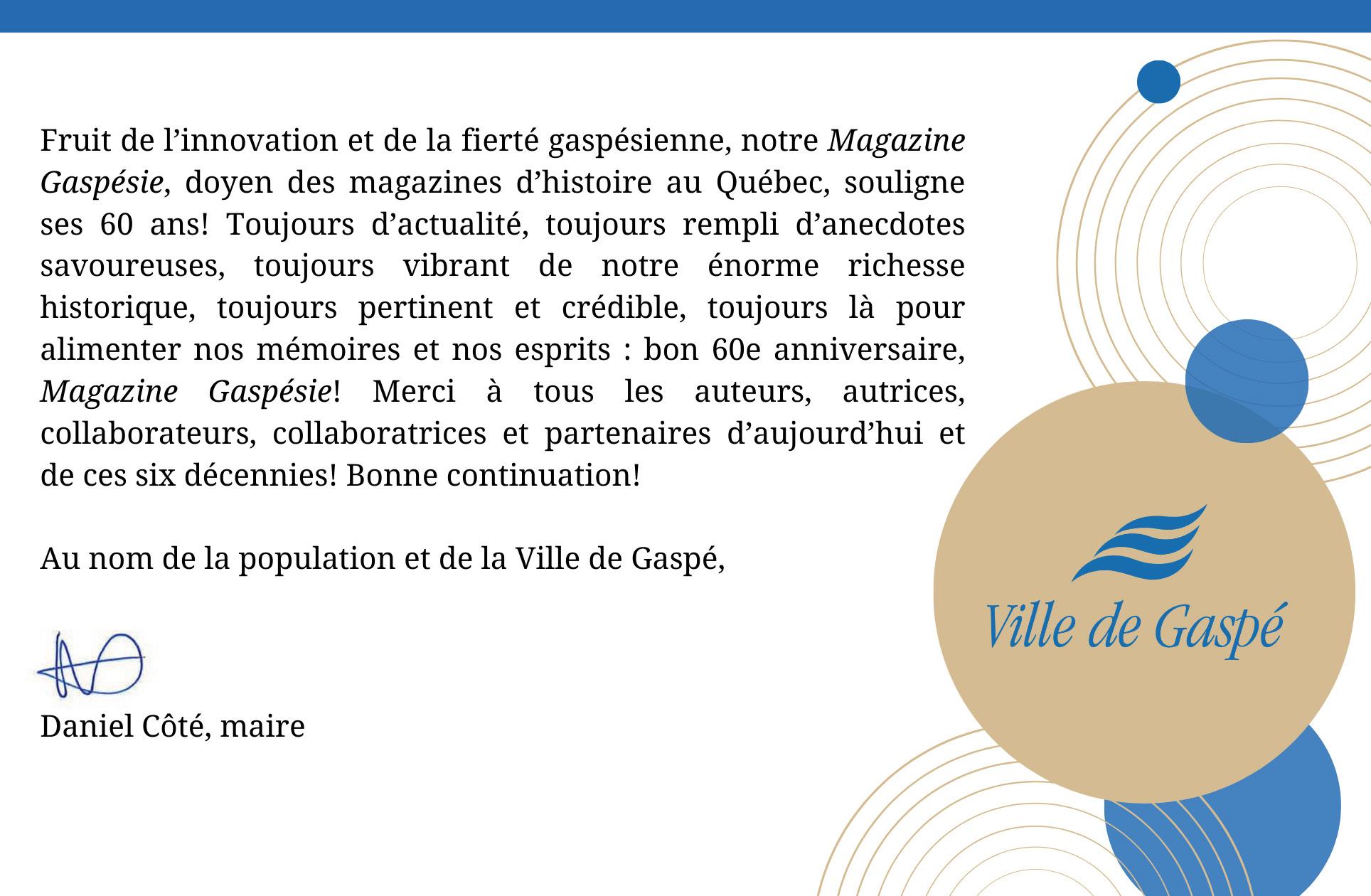
Notes
 1. TheGaspeSpec, 7 octobre 2001.
2-3. Le Havre, 20 août 2006.
4. Agir, janvier 2007.
La famille Sheehan à l’occasion du 60e anniversaire de mariage de Emelia Jones et George Sheehan, 1996. Collection famille Sheehan
VISIONNEZ LE FILM GEORGE SHEEHAN, BIENTÔT 100 ANS, DE JACQUES KASMA
1. TheGaspeSpec, 7 octobre 2001.
2-3. Le Havre, 20 août 2006.
4. Agir, janvier 2007.
La famille Sheehan à l’occasion du 60e anniversaire de mariage de Emelia Jones et George Sheehan, 1996. Collection famille Sheehan
VISIONNEZ LE FILM GEORGE SHEEHAN, BIENTÔT 100 ANS, DE JACQUES KASMA
MARIE BOUDOT (1715-1805)
Marie Boudot (parfois dite Boudeau) est née il y a plus de trois siècles, en 1715. Des milliers de personnes ayant vécu ou vivant en Gaspésie et dans toute l’Amérique du Nord descendent de sa lignée. Selon la publication Évidences de communautés métisses autour de la baie des Chaleurs, Marie est la fille de Jean Boudot et d’une femme mi’gmaque ou métisse inconnue. Les faits documentés sur la vie de Marie et de son époux Jean Chicoine sont peu nombreux. Dans cet article, je tenterai de combler les vides entre les faits connus par des hypothèses fondées sur l’histoire de l’époque, afin de donner un aperçu de ce que Marie aurait vécu au cours de ses longues 90 années de vie.
Nous savons que Marie et Jean ont une première fille nommée Louise, née en 1744, ainsi que d’autres enfants. Marie a également une sœur, elle aussi nommée Louise, née vers 1720,
qui épouse Aubin LeCoufle et s’installe à Cascapédia. Dans le Journal des évènements de la colonie, on indique que Jean Chicoine, à PointeSaint-Pierre, est témoin de l’arrivée de navires britanniques dans la baie
de Gaspé en 1746. Les registres révèlent que Marie et sa sœur sont inscrites au recensement de 1761 par Pierre du Calvet en tant que veuves résidant à Barachois avec leurs enfants, et que Marie décède en
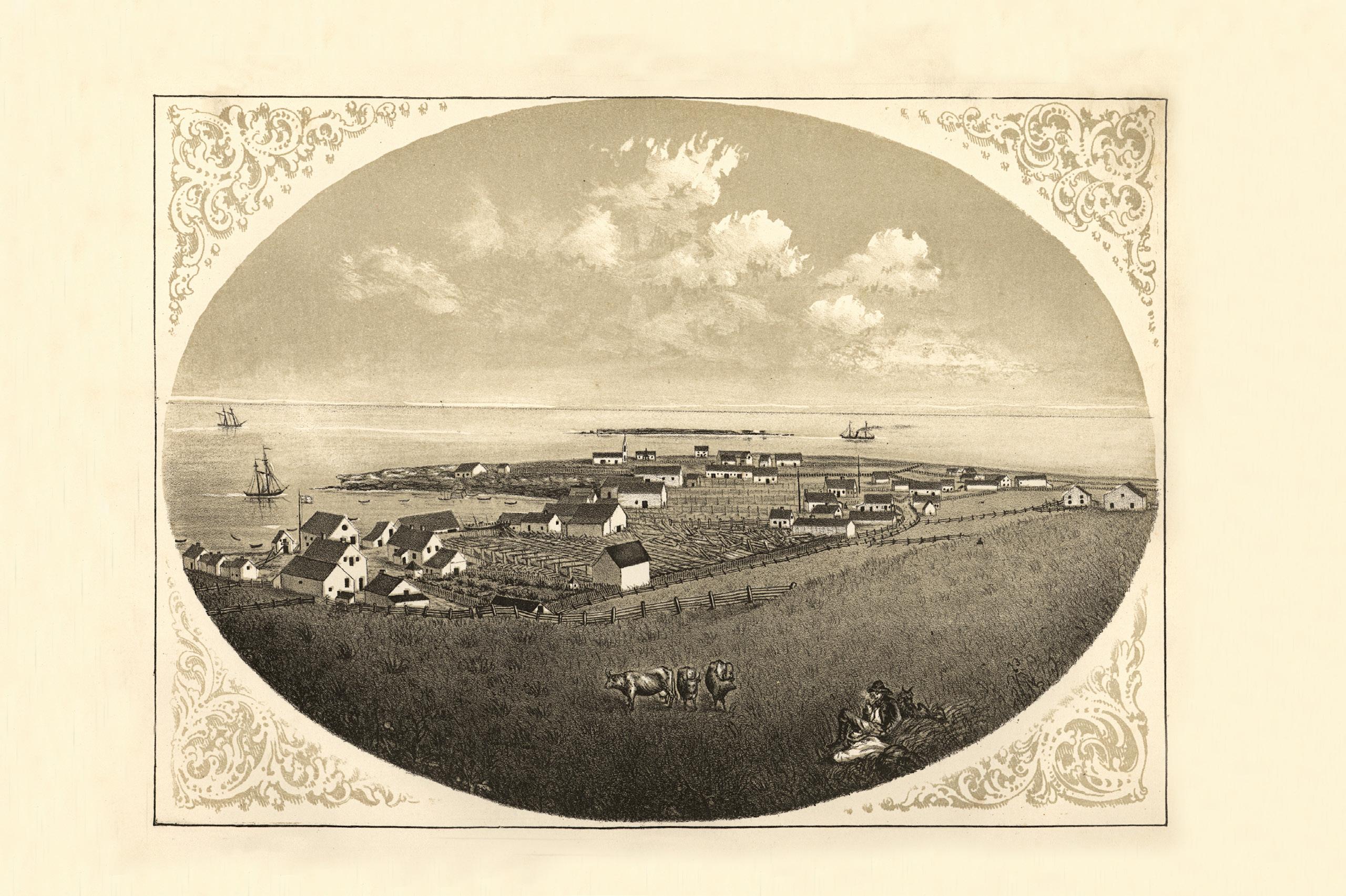
[ 48 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023
Janet Harvey
Présidente, Comité de développement de Barachois et les environs, descendante de Marie Boudot, et résidente de Belle-Anse
[NOS
Thomas Pye, Pointe-Saint-Pierre, gravure, 1864. Musée de la Gaspésie
GASPÉSIENNES]
1805 et est enterrée à Pointe-SaintPierre.
Un héritage mi’gmaq
C’est un fait reconnu que les Mi’gmaqs vivent à l’extrémité de la péninsule gaspésienne depuis des milliers d’années. La carte de Marc Lescarbot de 1609 montre un camp mi’gmaq sur la rive nord de la baie de Malbaie, dans la région située entre Pointe-Saint-Pierre et Barachois. En 1675, le prêtre récollet père Hugolin décrit un établissement mi’gmaq près de la localité de Petite-Rivière (aujourd’hui Barachois), où Pierre Denys de La Ronde fonde, en 1672, le premier établissement français permanent de la péninsule gaspésienne. En 1690, 25 ans avant la naissance de Marie, les Britanniques rasent les installations érigées par de La Ronde, ne laissant derrière eux que des terres défrichées. Cependant, les Mi’gmaqs sont sûrement restés dans la région après le passage des Britanniques. Comme il ne fait aucun doute que Marie est elle-même métisse, il est très possible qu’elle soit une descendante des familles mi’gmaques de cette région.
À l’époque, les allochtones résident généralement dans une maison en rondins aussi appelée maison simple alors que les Mi’gmaqs s’installent dans des wigwam ou tipis, installés le long de la côte en été
pour la pêche, et déplacés vers les bois pour la chasse en hiver. Bien que nous ignorions quels savoirs leur a été transmis, il est possible que certaines traditions et habiletés mi’gmaques aient été enseignées aux deux sœurs, Louise et Marie, par leur mère.
Un mariage mixte
Marie Boudot rencontre et épouse Jean Chicoine quelque temps avant 1744, date de naissance de leur fille Louise. Des indices laissent croire que Jean est un marchand à Barachois et qu’il possède une maison et un magasin. Les terres au centre de Barachois ayant été défrichées par les premiers colons français qui y ont vécu de 1672 à 1690 (établissement de Petite-Rivière), il aurait été facile de s’y établir.
En juillet 1758, Marie et Jean ont sans doute appris que les Britanniques se sont emparés de Louisbourg. En septembre, lorsqu’ils voient les navires de Wolfe à l’horizon de la baie de Gaspé, Marie et Jean se retirent probablement avec leurs enfants dans les bois. Depuis les collines surplombant la baie, ils auraient vu la fumée s’élever de l’incendie de leur maison et de leur magasin et se seraient rendu compte qu’un hiver rigoureux les attendait avec huit enfants à nourrir.
Quelque temps après la destruction des établissements par Wolfe,
la sœur de Marie, Louise, et ses jumeaux nouveau-nés, viennent à Barachois en provenance de Cascapédia. Lors du recensement de 1761, Marie est inscrite comme veuve de « Jean Sicoin » avec neuf enfants, et sa sœur Louise, également comme veuve d’Aubin LeCoufle, avec sept enfants. Les deux sœurs et leurs 16 enfants, âgés de 0 à 18 ans vivent vraisemblablement ensemble.
Nous ne savons pas ce qu’il est advenu des maris Jean Chicoine et Aubin LeCoufle pendant la guerre avec les Britanniques, mais nous savons que Jean est encore en vie à Barachois en 1760, l’année suivant la prise de Québec, puisque son fils Jean-Baptiste est né en 1761. Les actes de décès de Jean Chicoine ou d’Aubin LeCoufle n’ont pas encore été retrouvés.
Une nombreuse descendance
Après la fin de la guerre en 1763, des anglophones s’installent dans la région et reçoivent des terres du gouvernement. À cette époque, la vie doit être bien difficile pour Marie, mère monoparentale de neuf enfants. Son fils aîné Aubin, âgé de 14 ans, doit assumer de nombreuses fonctions de « chef de famille ». Au fil des ans, cinq de ses neuf enfants meurent; les quatre survivants fondent leur propre famille.
La fille aînée de Marie, Louise, épouse Jean Jacques Bond en 1763 à Pointe-Saint-Pierre, à l’âge de 19 ans.
Frederick William Blaiklock, extrait du Plan of the township Mal Bay showing the granted and unconceded lands in front range, 1858. Vers la fin du 18e siècle, Aubin Chicoine et sa famille s’installent sur une propriété connue plus tard sous le nom de lot 28 à Barachois alors que Jean-Baptiste Chicoine fait de même sur le lot 16 situé à Belle-Anse. Leurs descendants·es sont toujours propriétaires des lots respectifs. ANQ Québec. E21,SSS5,SS1,SSS1,PM,4B
 Lot 16
Lot 16
28 [NOS GASPÉSIENNES]
Pointe-Saint-Pierre Lot
L’année suivante, Marie devient grand-mère à 49 ans, lorsque son premier petit-fils, Louis, naît. À cette époque, Marie s’occupe encore de certains de ses enfants, le plus jeune, Jean-Baptiste, étant âgé de trois ans. Louise et Jean Bond ont dix enfants. Leurs descendants vivent encore aujourd’hui à Pointe-Saint-Pierre.
En 1770, Catherine, une des filles de Marie, se marie au très jeune âge de 15 ans avec James (John) Henley. Leur premier enfant, Louise, naît en 1772, et ils auront au total trois garçons et cinq filles. James meurt en 1791, alors que leur dernier-né a moins d’un an. Cette année-là, Catherine demande un titre de propriété pour 50 acres de terres à Pointe Verte (Pointe-Saint-Pierre).
Catherine décède en 1814, à l’âge de 59 ans.
Le fils aîné de Marie, Aubin, épouse une métisse, Marie-Anne David, en 1771, et ils ont leur premier enfant, Michel-Antoine, en 1772. Aubin Chicoine et sa famille s’installent sur une propriété connue plus tard sous le nom de lot 28, à l’ouest de Big Brook (aujourd’hui appelé ruisseau du Prêtre) à Barachois. Aubin et Marie-Anne ont trois garçons et six filles. Leur fille Marguerite épouse William de Sainte-Croix, des îles Anglo-Normandes, en 1803. Une autre de leurs filles, Angélique, épouse en secondes noces John Tapp en 1805. Leurs fils prennent le nom de Chicoine-dit-Cotton, et, plus tard ne conservent que le nom de Cotton. Une partie du lot 28 appartient toujours aujourd’hui aux familles Cotton et Sainte-Croix.
En 1791, alors que Marie est âgée

de 75 ans, son plus jeune fils, Jean-Baptiste, épouse Véronique Quemeneur (dite Laflamme) à Barachois. Ils ont six garçons et sept filles. Jean-Baptiste est le premier propriétaire enregistré du lot 16, situé à Belle-Anse, où se trouve un mouillage protégé pour les bateaux de pêche, où il vit jusqu’à l’âge de 73 ans, s’éteignant en 1834. Leurs descendants possèdent et habitent encore des parties du lot 16.
Aujourd’hui, Pointe-Saint-Pierre est un lieu paisible où il ne reste que quelques maisons, mais à l’époque, Marie est témoin de la croissance d’une communauté effervescente où des immigrants·es de Jersey et de Guernesey ainsi que des Loyalistes ayant reçu des terres en échange de services rendus à la couronne britannique fondent diverses entreprises, notamment de pêche et de
construction navale.
De Grande-Vallée à Maria, les noms Chicoine, Cotton, Sainte-Croix, Bond, Tapp et Henley figurent encore aujourd’hui dans l’annuaire téléphonique. Les descendants·es de Marie Boudot et de Jean Chicoine se sont aussi répandus dans toute l’Amérique du Nord, de la ColombieBritannique à la Nouvelle-Écosse, et de la Californie jusqu’en Alaska.
Remerciements à Vision Gaspé-Percé Now et Jules Chicoine-Wilson pour la traduction ainsi qu’aux Archives nationales du Québec qui ont mis gracieusement à disposition leurs cartes.

[ 50 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023 Spécialités : livres, jeux éducatifs, jeux, papeterie, cartes sportives 168, de la Reine, Gaspé, G4X 1T4 Tél.: 418 368-5514
[NOS GASPÉSIENNES]
Marc Lescarbot, extrait de la Figure de la Terre Neuve Grande Rivière de Canada et côtes de l’océan en la Nouvelle France, 1609. Sous la pointe de « Gachepé » à droite, on aperçoit un camp mi’gmaq. Archives nationales du Québec. 97952
VERSION ANGLAISE
PROJET ÉOLE : L’HISTOIRE D’UN TITAN GASPÉSIEN
Il y a 35 ans déjà, la plus haute éolienne à axe vertical au monde est entrée en fonction. Dominant la route 132 à Cap-Chat du haut de ses 110 mètres (361 pieds), elle intrigue les visiteuses et visiteurs dès leur arrivée en Haute-Gaspésie. L’immense construction d’acier de près de 400 tonnes, également la plus haute structure illuminée le soir en Gaspésie, est devenue un élément distinctif et indissociable de la région.
Celle qu’on appelait à l’époque « l’éolienne de Cap-Chat » constitue un projet de recherche et développement mené par l’Institut de Recherche en Électricité du Québec (IREQ) et par le Conseil National de Recherche Canada (CNRC) pour le compte d’Hydro-Québec. Les objectifs visés par cet ambitieux projet sont alors de développer ces technologies au nord de l’Amérique, confirmer la faisabilité d’un aérogénérateur vertical mégawatt, en vérifier les performances et les coûts, et générer les apprentissages et les connaissances nécessaires au développement de ce type de système. Le budget attribué de 35,2 millions $, qui provient à parts égales du CNRC et de l’IREQ,
est destiné à l’acquisition du site, à l’aménagement et aux fondations, à la construction de la centrale et de l’éolienne. Cette somme prévoit également couvrir les coûts d’exploitation pour la période de test.
Le Québec, déjà un leader mondial en matière d’hydroélectricité, a la volonté affirmée de se démarquer également dans ce domaine.
Élaborée sur papier dès 1981 par les équipes d’ingénieurs de l’IREQ et du CNRC, la construction se déroule de 1985 jusqu’en 1987, et est suivie d’une période de rodage de plusieurs mois, afin de s’assurer du bon fonctionnement de tous les systèmes. Éole entre finalement en service dès 1988 afin d’ajouter sa production au réseau électrique

L’éolienne arrive en morceaux au quai avant d’être transportée sur le site, vers 1985. La section centrale de la colonne (3 sections au total) pèse plus de 92 tonnes! Deux chargeuses (« loaders ») sont attelées au camion afin d’être en mesure de grimper la côte pour accéder au site.
 Projet Éole
Projet Éole
Août - Novembre 2023 | MAGAZINE GASPÉSIE [ 51 ]
Patrick Kenney Responsable de l’interprétation et du développement de contenu, Projet Éole
Construction
1986.
et assemblage de Éole,
Projet Éole
[NOS ÉVÈNEMENTS]
québécois. La construction de cet immense chantier fait la une des journaux de l’époque et nécessite les efforts de centaines d’ouvriers du bâtiment, camionneurs, grutiers, techniciens, etc. La centrale expérimentale fournit son énergie au réseau jusqu’en avril 1993, lorsque des vents violents et irréguliers endommagent le roulement principal à la base de l’appareil, provoquant l’arrêt forcé de l’éolienne. En raison des coûts et des défis techniques qu’aurait nécessités la réparation de ce qui est en réalité un prototype, la décision est prise de mettre fin au projet.

De prototype à attrait touristique
L’exploitation du site à des fins récréotouristiques quant à elle, remonte à l’époque où Éole fonctionne encore. Étant visible de la route, l’intrigante structure attire les curieuses et curieux dès le moment où elle émerge dans le paysage. Cet afflux de touristes accaparant le travail des techniciens sur place, on confie le mandat à une petite entreprise cap-chattienne de gérer le flot des centaines de personnes qui se présentent à l’entrée du site. Le public de l’époque reçoit une petite présentation sur les motifs environnementaux justifiant les recherches sur l’éolien, fait le tour de l’enceinte du site dans un petit autobus aménagé en conséquence et termine leur exploration par une brève visite guidée lorsque l’éolienne
n’est pas en marche. À la fin du projet de recherche, on continue les visites sous cette forme pendant plusieurs années, ajoutant l’activité de grimpe accompagnée de guides jusqu’au sommet de l’impressionnante tour centrale. Très populaire pendant longtemps, cette formule perd malheureusement l’intérêt des visiteuses et visiteurs, s’étiole, et par manque d’entretien, le site tombe en désuétude et le contenu des visites se perd au fil des saisons, jusqu’à la quasi-fermeture dans les dernières années.
En 2019, Projet Éole est récupéré par deux nouveaux investisseurs, Benjamin Leduc et Benoit Benneteau, tous deux désireux de redonner vie à ce chapitre important du patrimoine industriel et technologique québécois. Dans un premier temps, on s’attaque à la remise en ordre du site, de la centrale électrique et de l’éolienne. Éclairage à l’intérieur du bâtiment, plomberie et électricité entre autres, doivent être remis aux normes. La formule un peu archaïque des visites guidées est graduellement abandonnée pour faire place à un musée technologique en visite auto-interprétée, avec des guides en maraude présents pour répondre aux questions du public. Puisque le Projet Éole est aussi entouré des éoliennes du parc Le Nordais, tout premier parc éolien implanté au Québec, un lieu d’interprétation sur cette forme de production d’énergie est également développé où on peut y
découvrir l’histoire et le fonctionnement de cette technologie.
Afin d’améliorer également l’aspect récréatif des lieux, des sentiers sont aménagés par la nouvelle équipe, permettant un contact avec la nature tout en admirant les éoliennes. Un belvédère d’observation est aménagé sur le toit de la centrale électrique et un éclairage moderne et coloré de l’éolienne est mis en place. Des jardins de permaculture et de petits arbres fruitiers sont aussi ajoutés. En plus d’améliorer l’aspect général des lieux, cette démarche vise à ajouter au contenu offert à la clientèle, les thématiques de l’autonomie alimentaire et de l’économie circulaire à celles de l’éolien et des changements climatiques déjà présentées.
La pertinence de développer la filière éolienne québécoise n’étant plus à remettre en cause compte tenu des impacts des changements climatiques actuels, il est important de souligner le rôle qu’a eu le Projet Éole dans le développement de ces recherches. Mal adapté à la production commerciale, mais ayant rempli son mandat sur le plan scientifique, Éole se dresse fièrement aujourd’hui en monument dédié au génie avant-gardiste de ces pionniers qui ont voulu dompter le vent.
 Extérieur et intérieur de la centrale électrique, 2022. Projet Éole
Extérieur et intérieur de la centrale électrique, 2022. Projet Éole
DIAPORAMA PHOTO [NOS ÉVÈNEMENTS]
Éole, la plus haute éolienne à axe vertical au monde, est un symbole fort de Cap-Chat, 2022. Projet Éole
Prochain thème Univers sonore
CONSULTEZ L’APPEL DE TEXTES
Correctif du n° 206
-p. 16, en légende, on aurait dû lire photo : Michel Bégin et non Maxime St-Amour
-p. 21, en légende, on aurait dû lire Calipso bulbeux et non Cypripède royal
C’est votre Magazine!
Faites-nous part de vos commentaires et suggestions sur le Magazine Gaspésie : magazine@museedelagaspesie.ca 418 368-1534 poste 106

Pastilles Web
Les pastilles Web à la fin de certains articles vous invitent à consulter un extra en exclusivité sur notre site Web : magazinegaspesie.ca
[NOS PARTENAIRES]

M C
La cloche du navire Fearless devenue la cloche d’une école à Percé, 1876. Musée de la Gaspésie
[ VOTRE MAGAZINE]







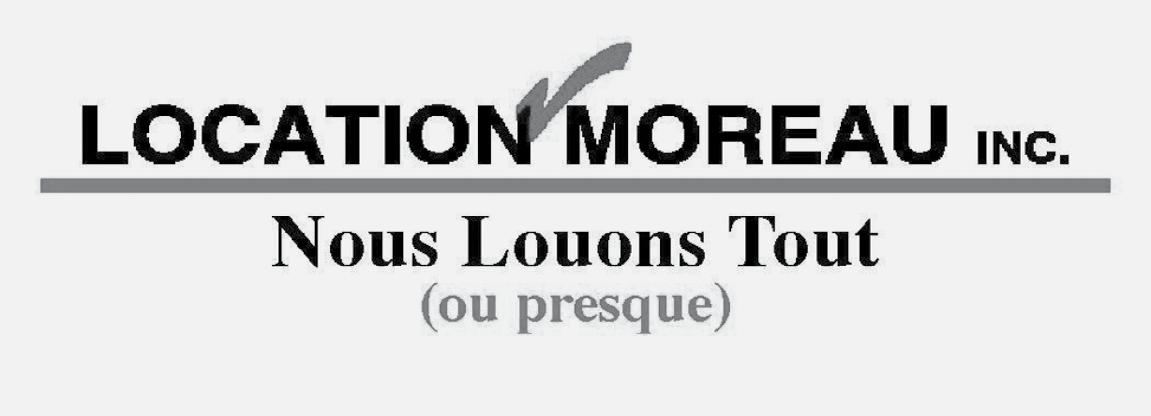
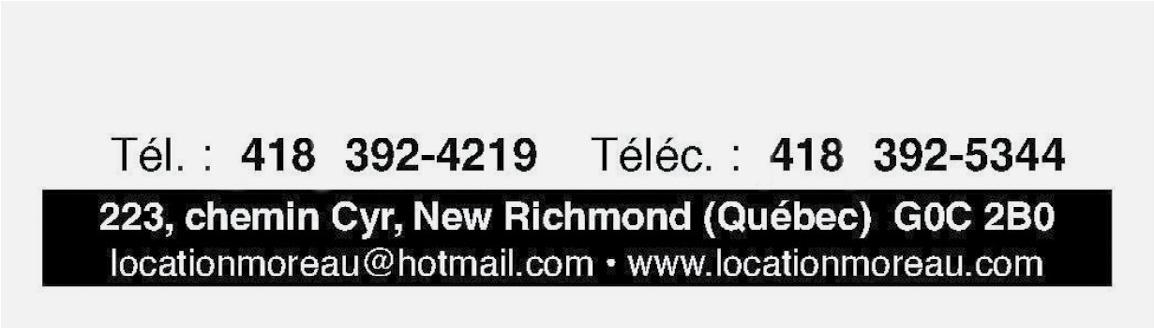

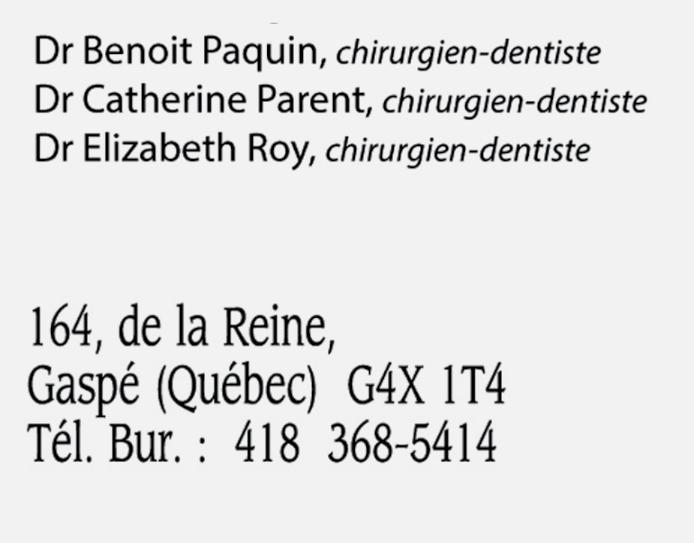


[ 54 ] MAGAZINE GASPÉSIE | Août - Novembre 2023 Chez-nous, c'est le service ! ÉLECTRICITÉ • PLOMBERIE • CHAUFFAGE Gaspé - Cap d'Espoir - Petite Vallée Tél. : 418 368-5425 | info@groupeohmega.com | www.groupeohmega.com Poissonnerie & Fumoir Les Pêcheries Gaspésiennes Inc. 5, rue de la Victoria (Parc Industriel) C.Pp 2973, Rivière-au-Renard (Québec) G4X 5G3 418 269-5999 www. pecheriesgaspesiennes .com SoniaServant,Propriétaire 159boul.deGaspé|418368-5433 •Papeterie •Informatique •Cadeaux •Matérield’artiste •Jeuxetjouetséducatifs FAITESPLUSAVEC HAMSTER ÀVOSCÔTÉS 156,ruedelaReine,Gaspé(Québec)G4X1T4 T418360-0363F418360-0091www.scmnotaires.com INFORMER.ACCOMPAGNER.PROTÉGER. D r André Banville M.V.
Katherine
Dre
Brousseau M.V.
Écoutez la voix des gens d’ici!
À NE PAS MANQUER SUR NOS ONDES DU LUNDI AU VENDREDI
Le monde selon Jack
De 6h à 9h
Avec Jacques Henry et Richard O’Leary
Le Punch
De 13h à 15h
Avec Dave Ferguson
Caro au boulot
De 9h à 12h
En compagnie de Caroline Farley
Il était une fois dans l’Est
De 15h à 18h
Avec Yannik Bergeron
Les Hits du midi
De 12h à 13h
Pour un midi tout en musique!





Destination Country
De 18h à 19h30
Une heure 100% Country!
radiogaspesie.ca


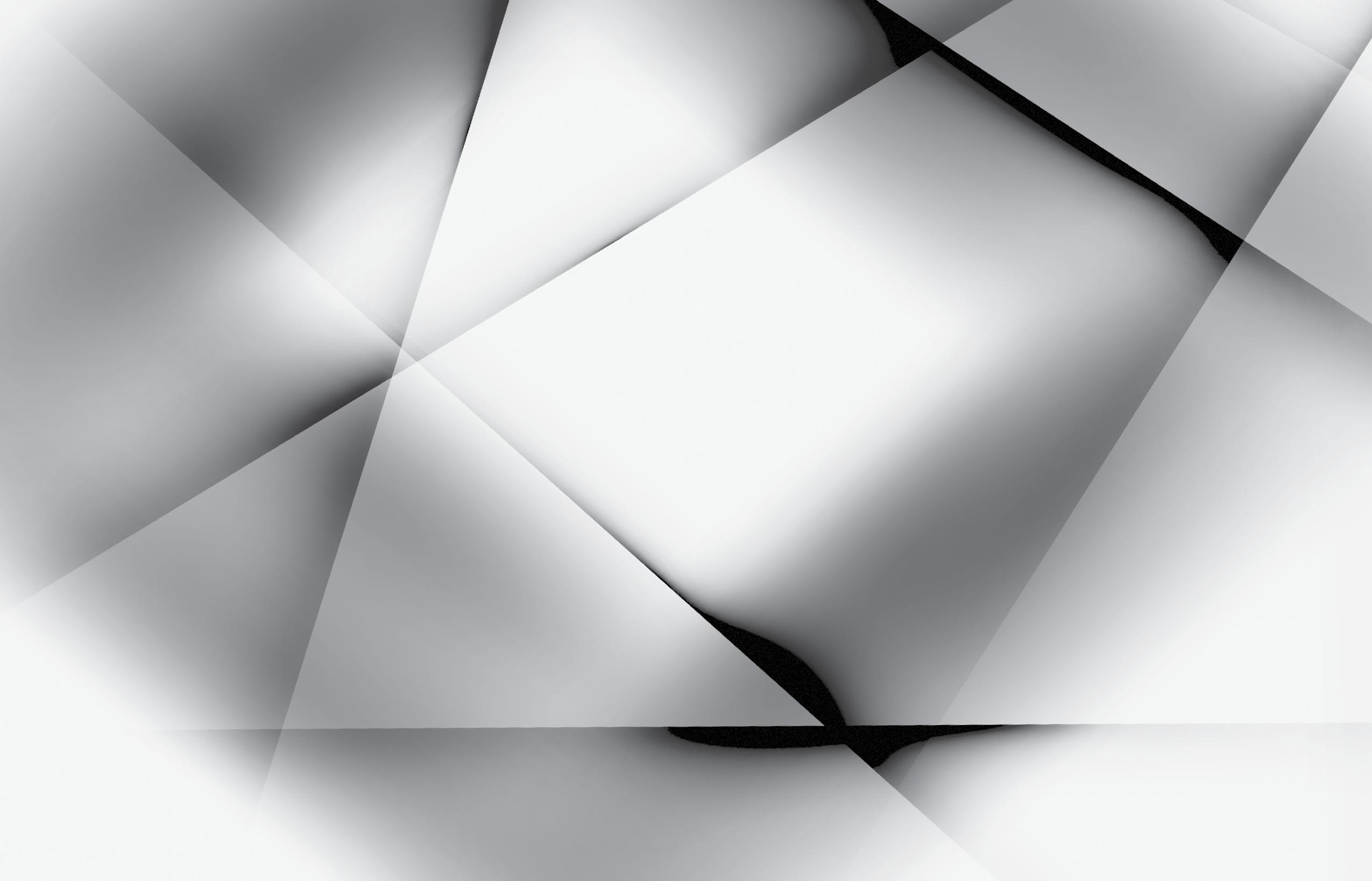


Bienvenue chezvous
Venezrencontrer une équiped’experts quivous guidera dans l’accomplissement devos petitsetgrands projets!


151, boul. deGaspé,Gaspé Tél. : 418368-2234 info@kega.co

INSPIRATION ETCONSEILS ÉCO ATTITUDE CONSEILS PEINTURE RÉNOVATION ET DÉCORATION












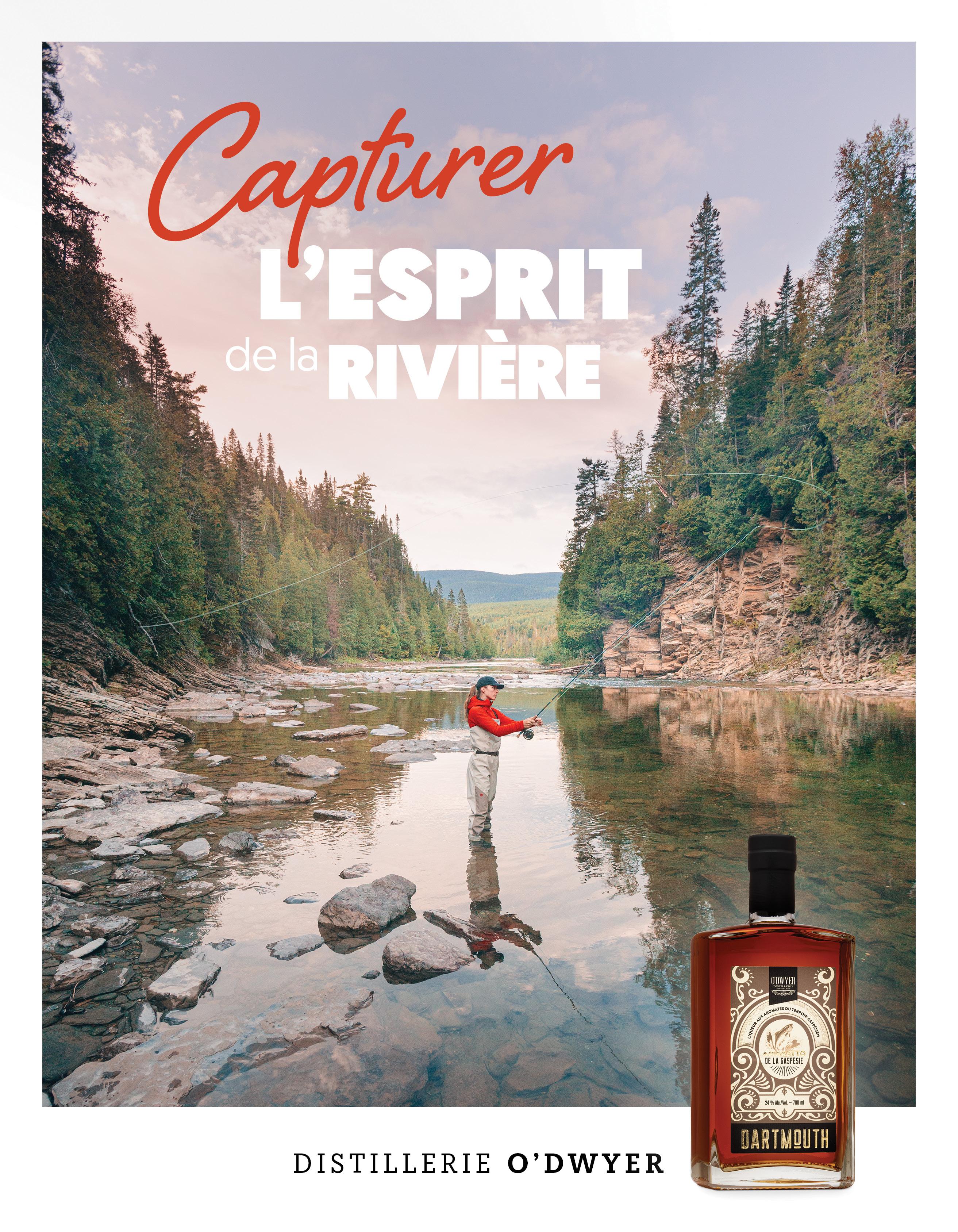


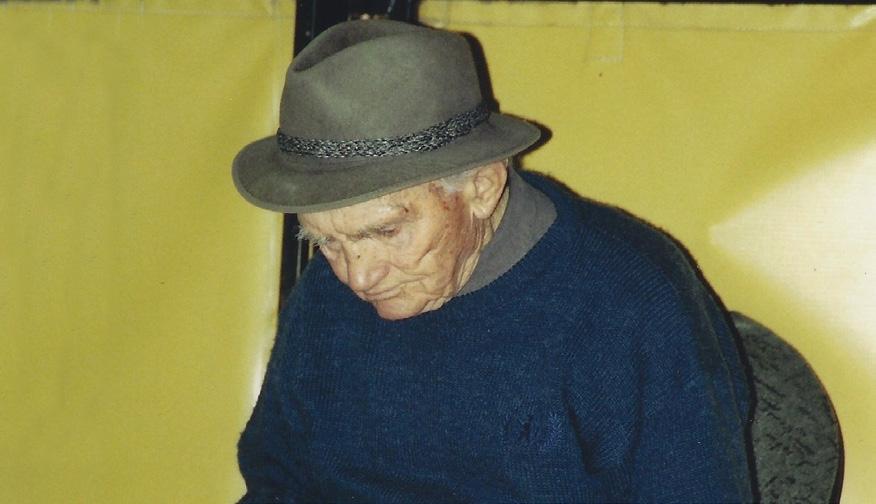









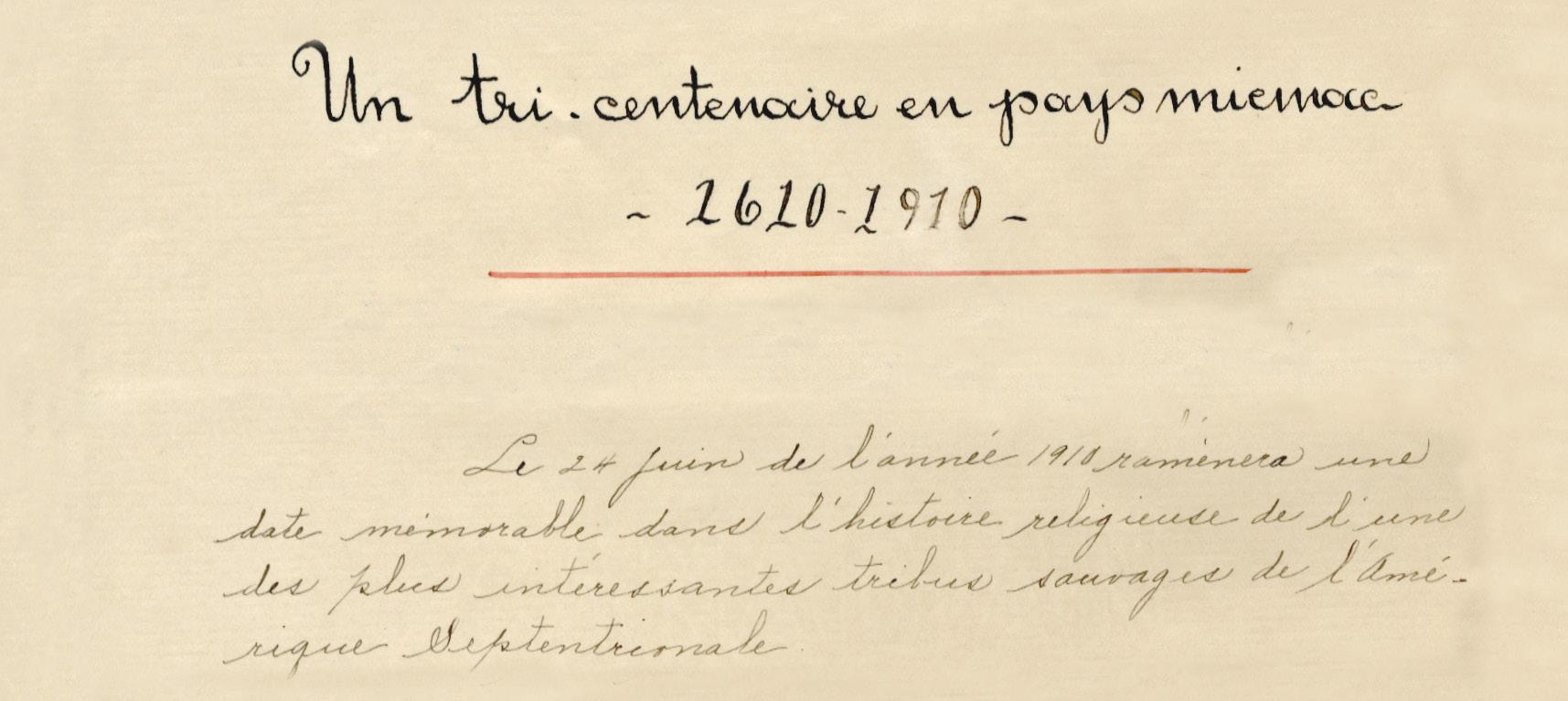 David Bigaouette
David Bigaouette

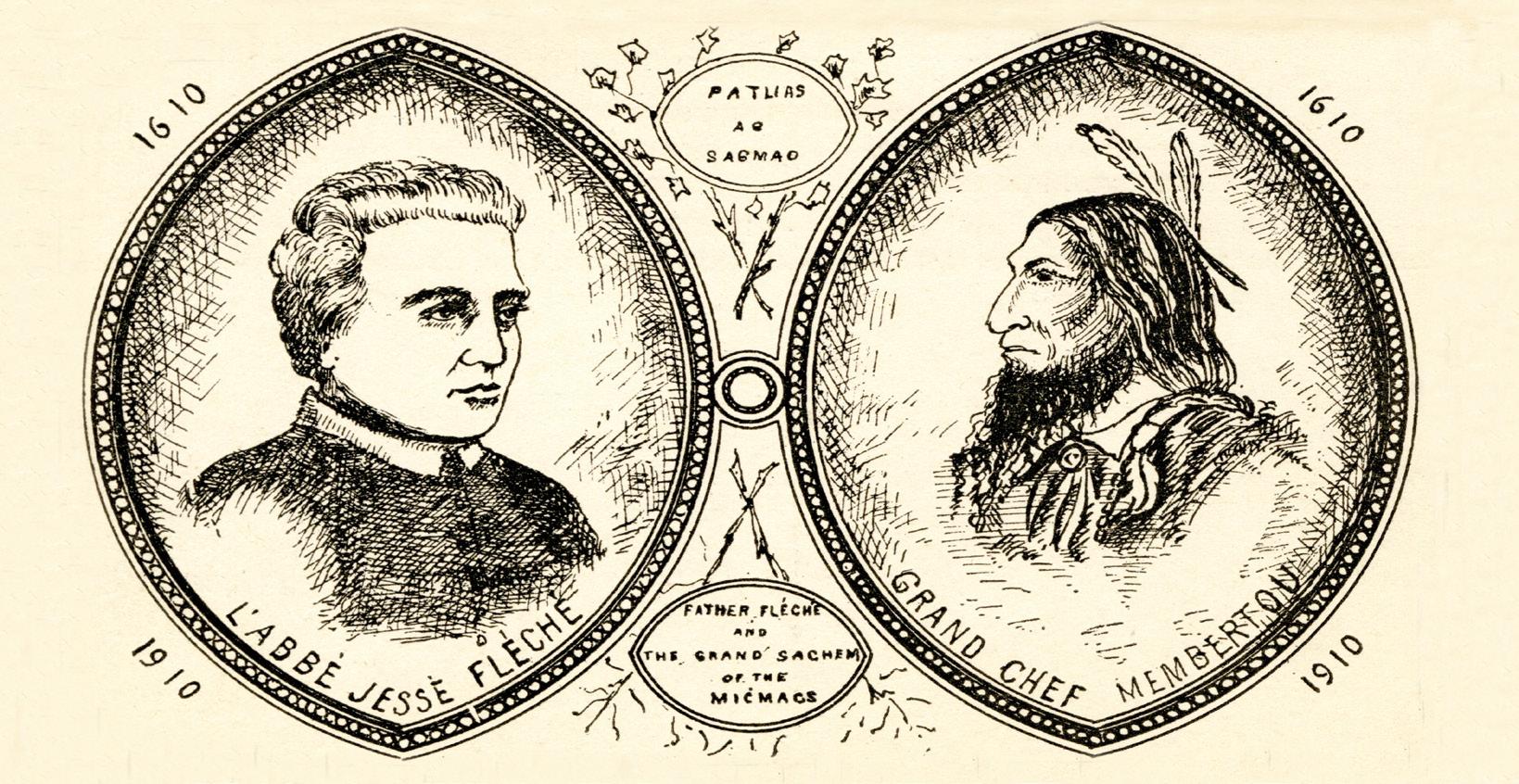

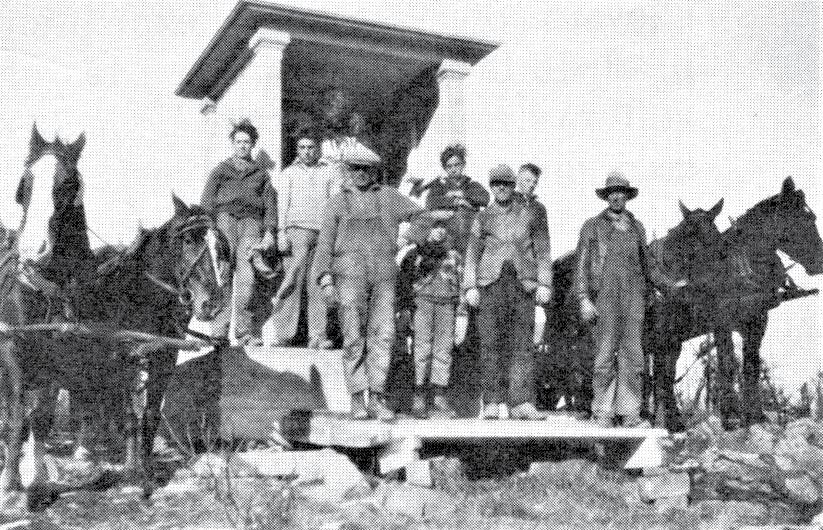
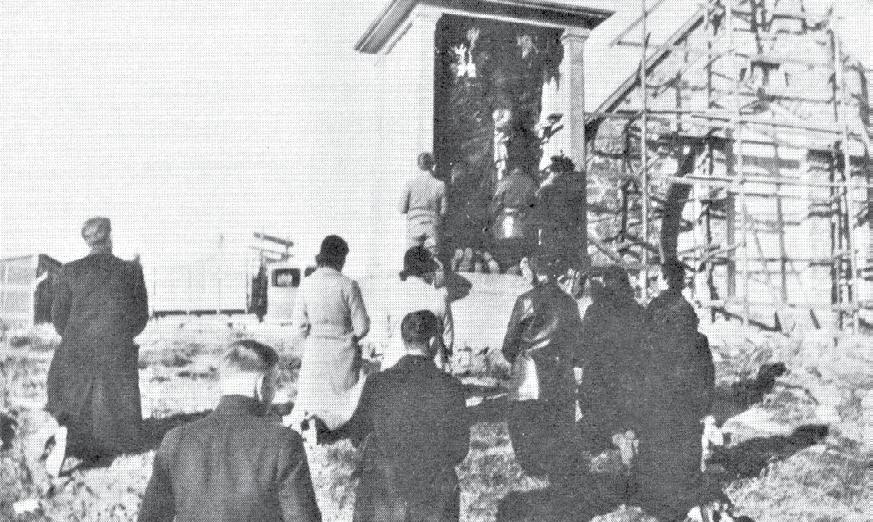











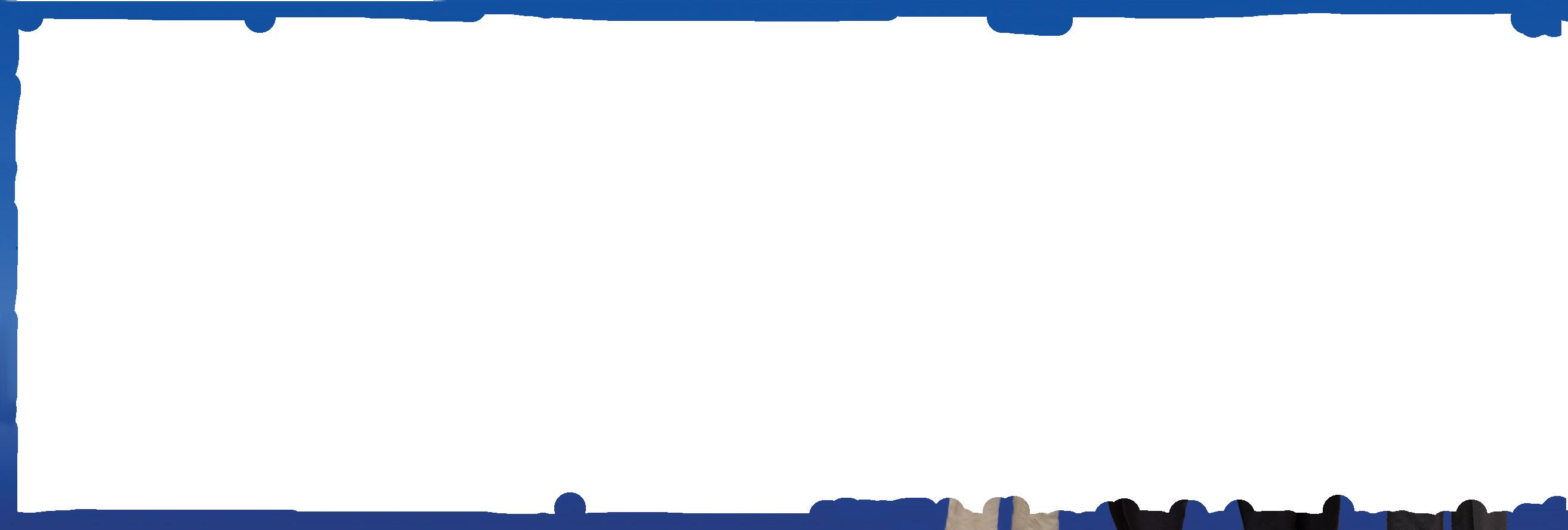


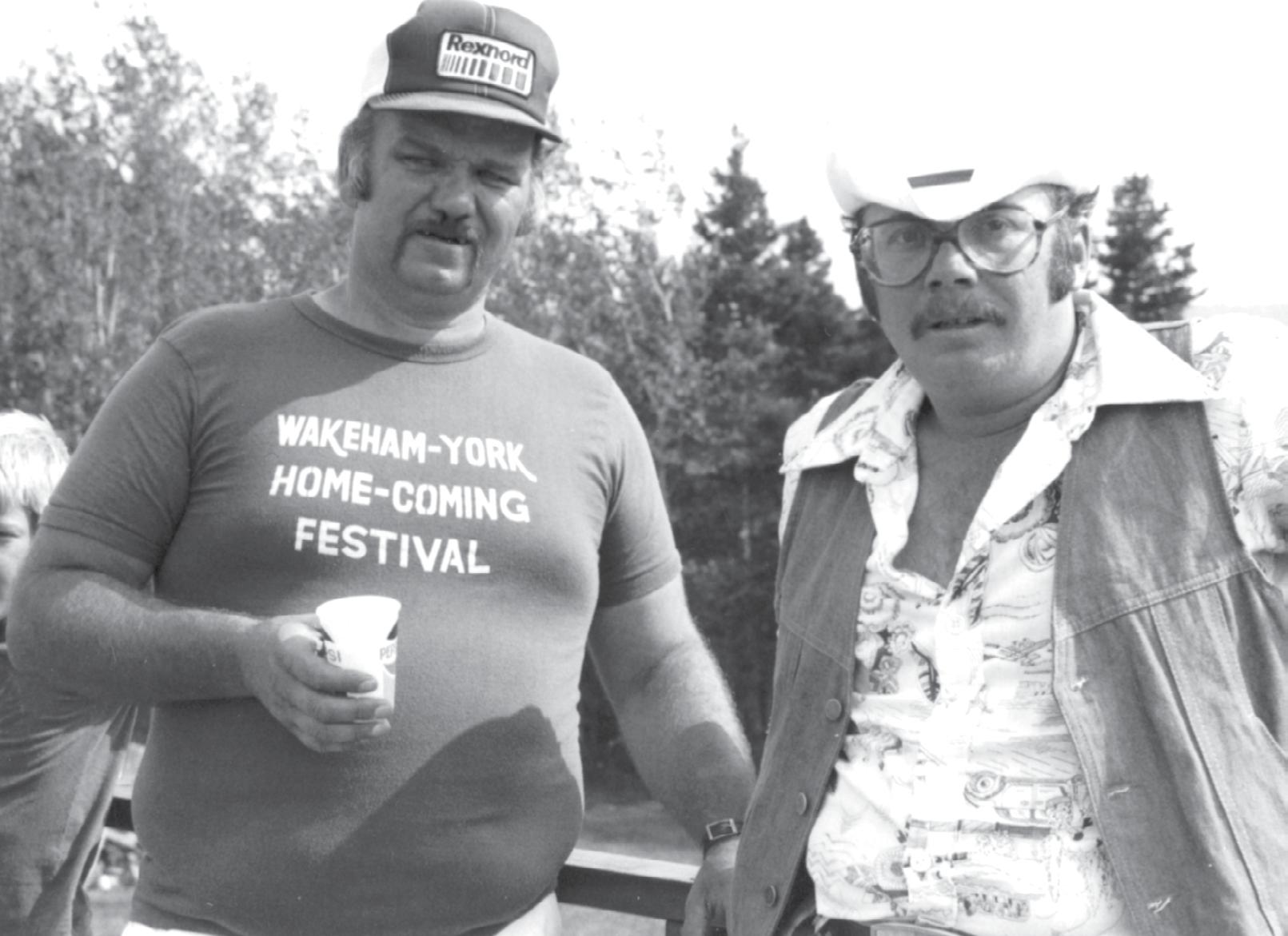

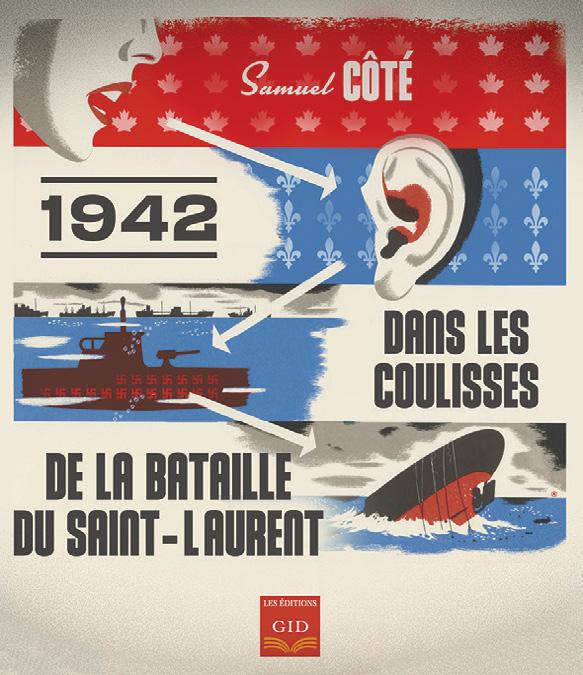
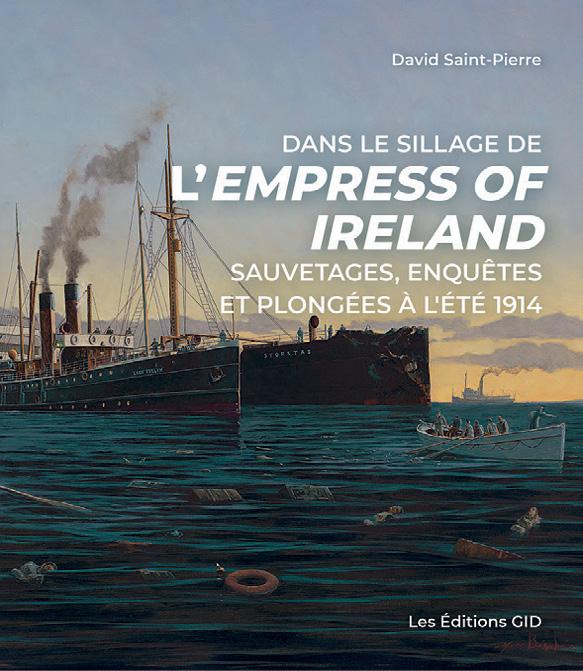

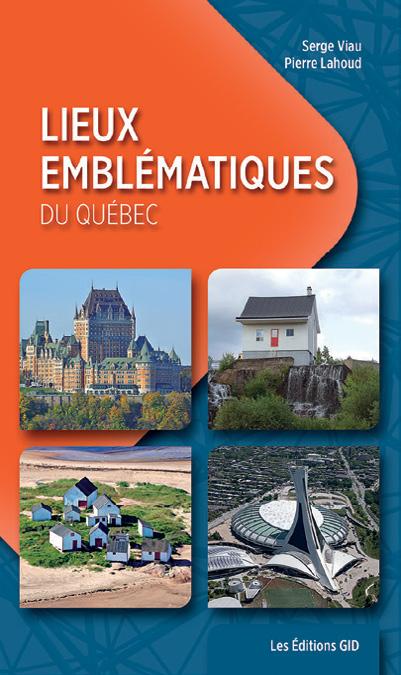
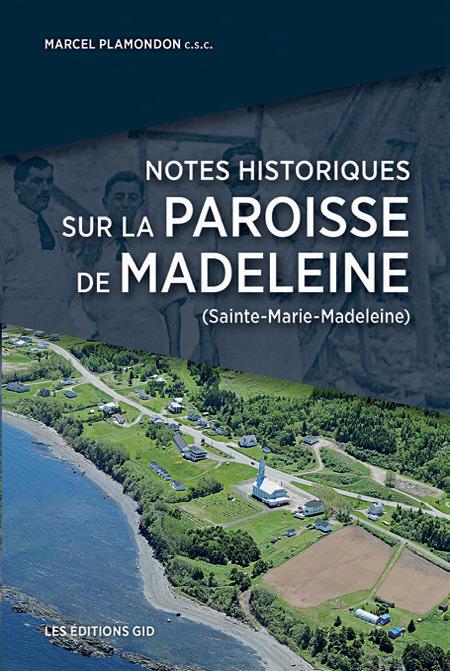
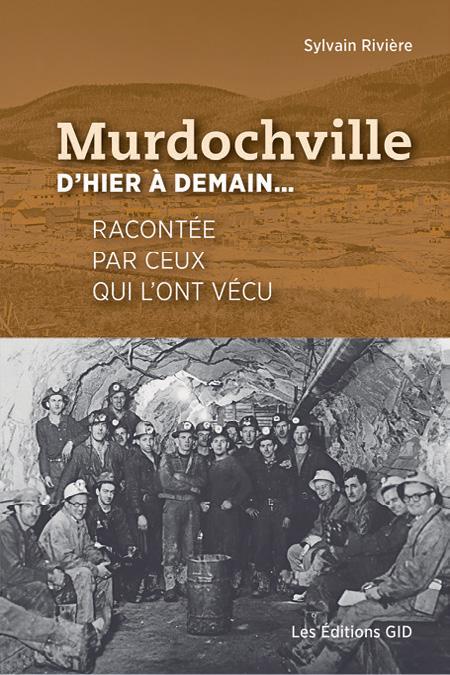
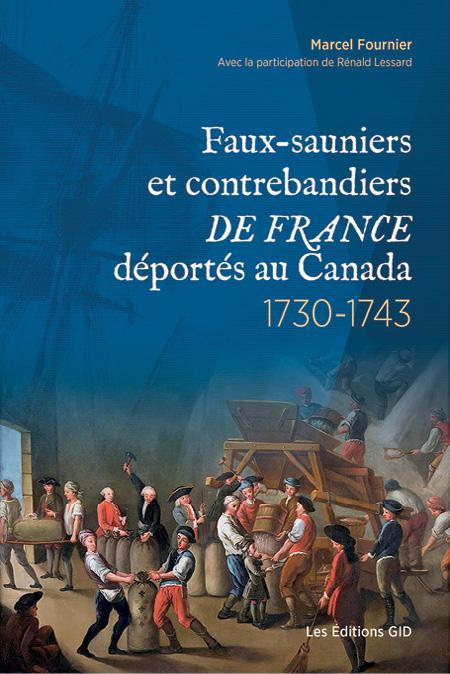

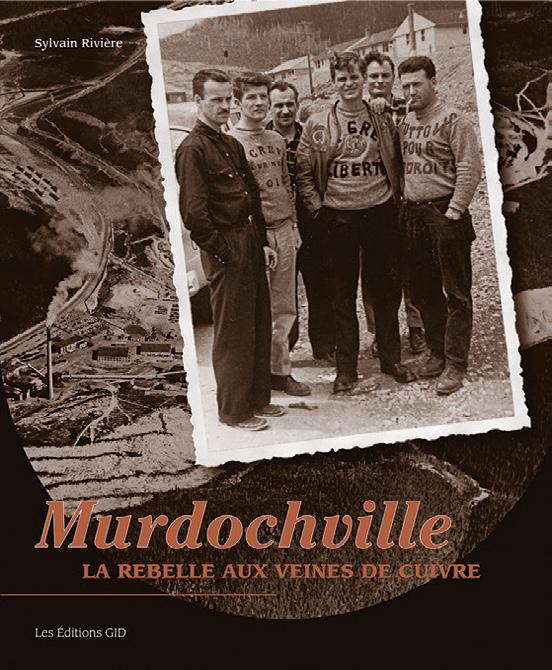



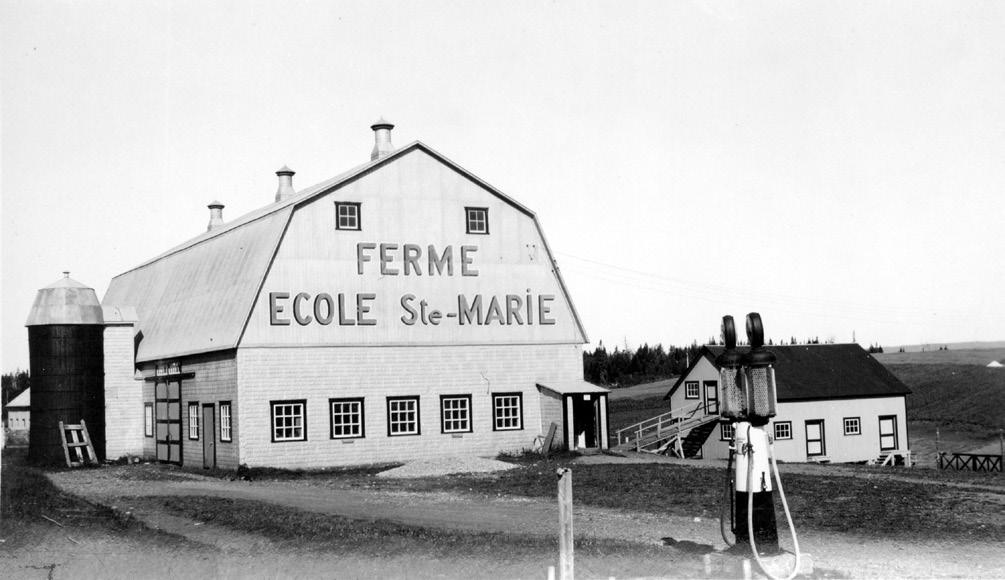











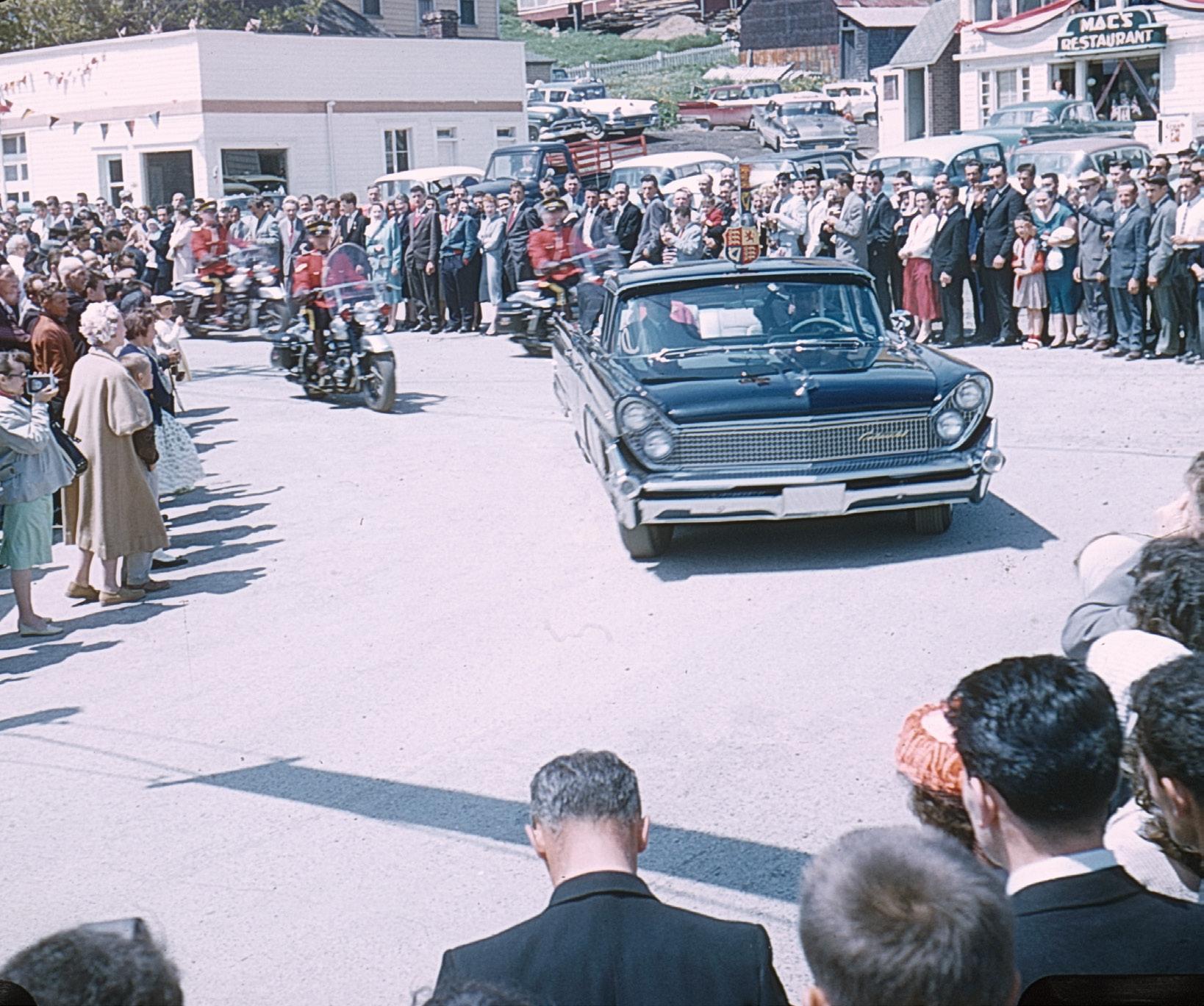
 La reine dépose des fleurs au pied de la Croix du Souvenir à Gaspé, 1959. Musée de la Gaspésie. Fonds Augustines de Gaspé. P46/3d/1/7
La reine dépose des fleurs au pied de la Croix du Souvenir à Gaspé, 1959. Musée de la Gaspésie. Fonds Augustines de Gaspé. P46/3d/1/7










 Bois flotté
Bois flotté
 Paul Lemieux
Paul Lemieux

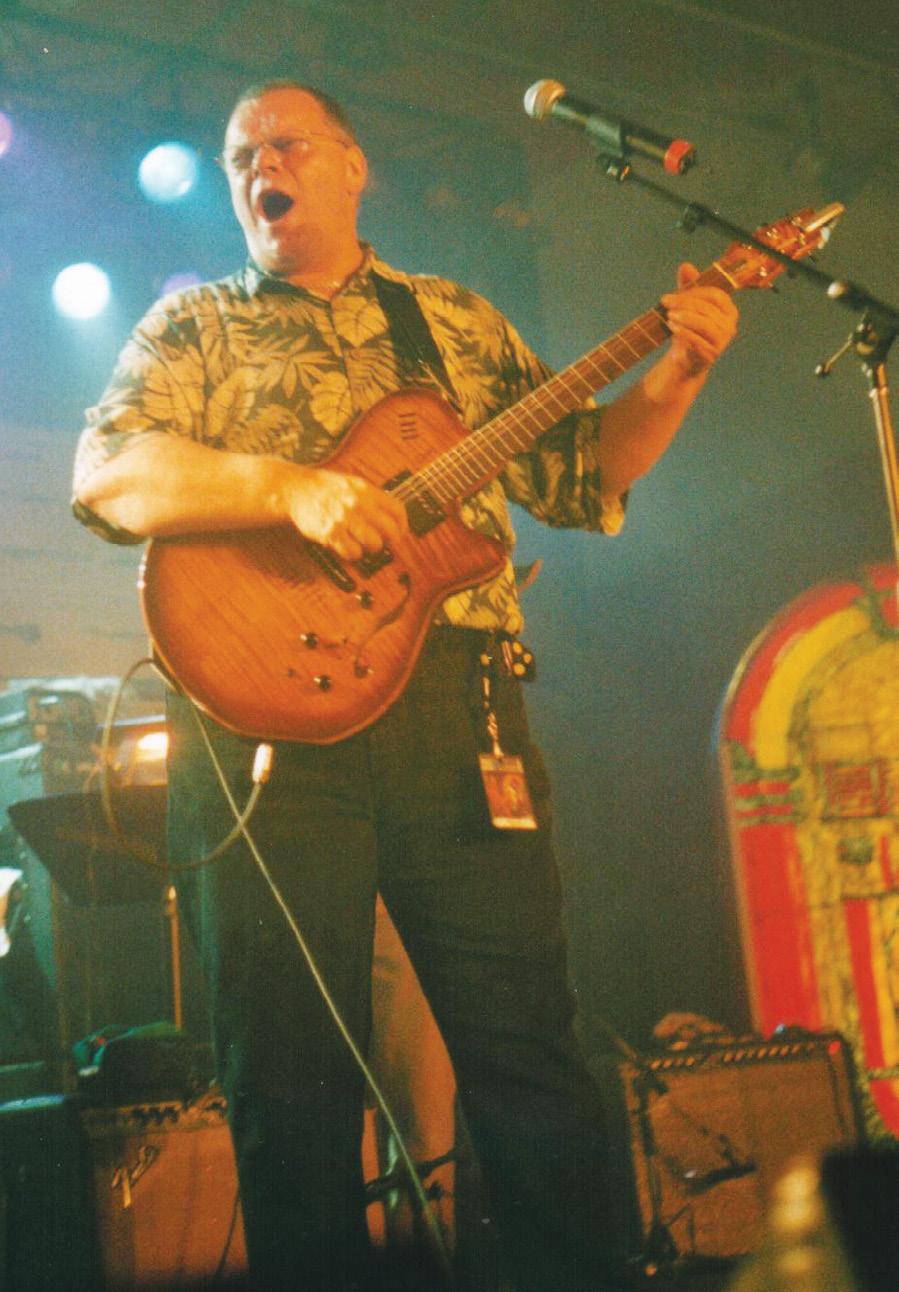

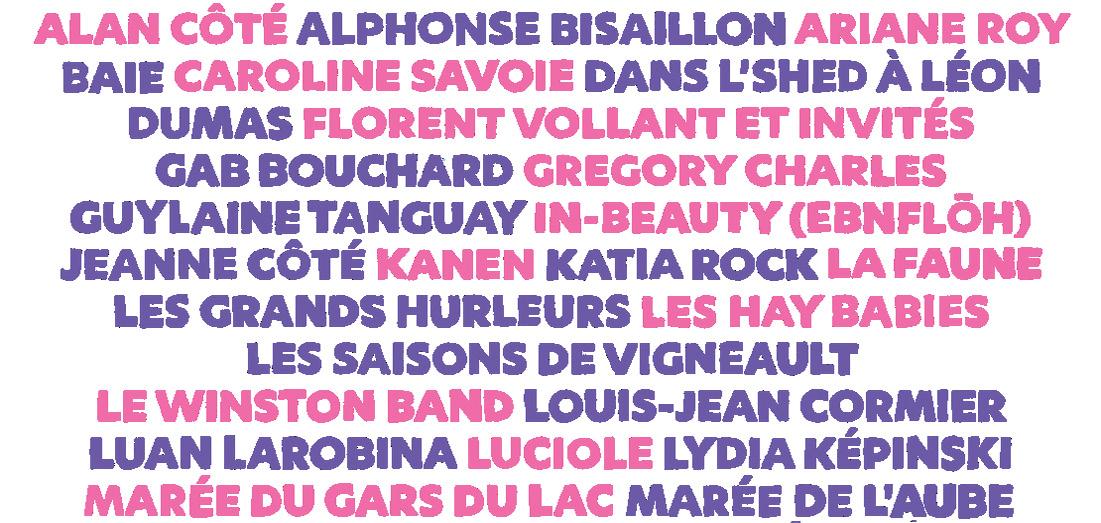





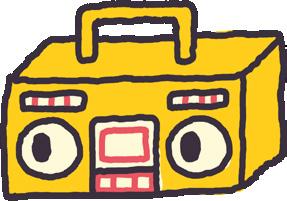




 Marie-Michèle Plante
Marie-Michèle Plante

 La rue de la Reine à Gaspé devient piétonne pour accueillir les nombreux festivaliers et festivalières qui profitent des animations, 2018.
Photo : Roger St-Laurent Festival Musique du Bout du Monde
Spectacle de Lakou Mizik sous le chapiteau, 2019.
La rue de la Reine à Gaspé devient piétonne pour accueillir les nombreux festivaliers et festivalières qui profitent des animations, 2018.
Photo : Roger St-Laurent Festival Musique du Bout du Monde
Spectacle de Lakou Mizik sous le chapiteau, 2019.





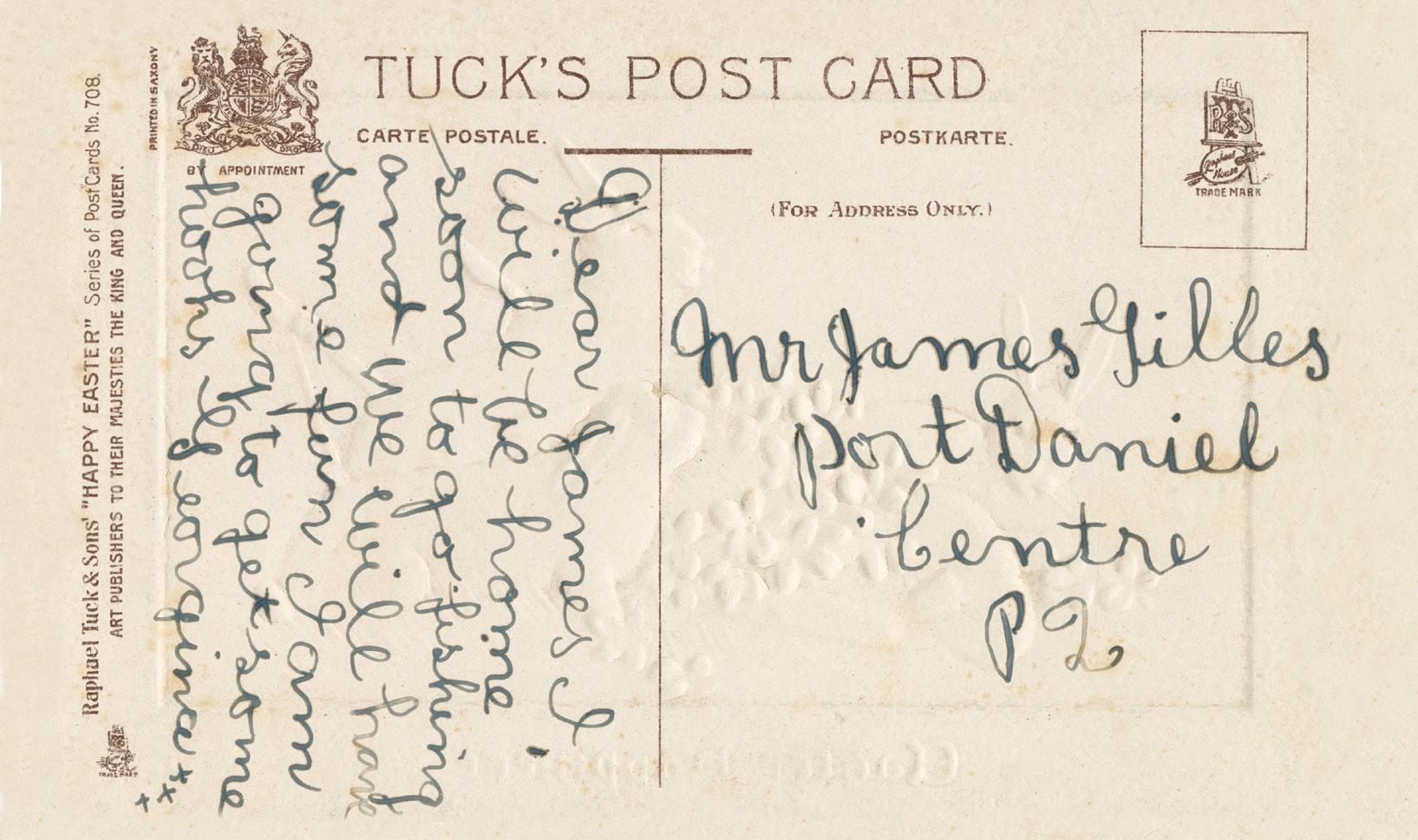


 Ciné-caméra Kodak Brownie Turret f/1.9 8 mm ayant appartenu à Roy Langevin. Musée de la Gaspésie. Don de Jean Langevin
Ciné-caméra Kodak Brownie Turret f/1.9 8 mm ayant appartenu à Roy Langevin. Musée de la Gaspésie. Don de Jean Langevin



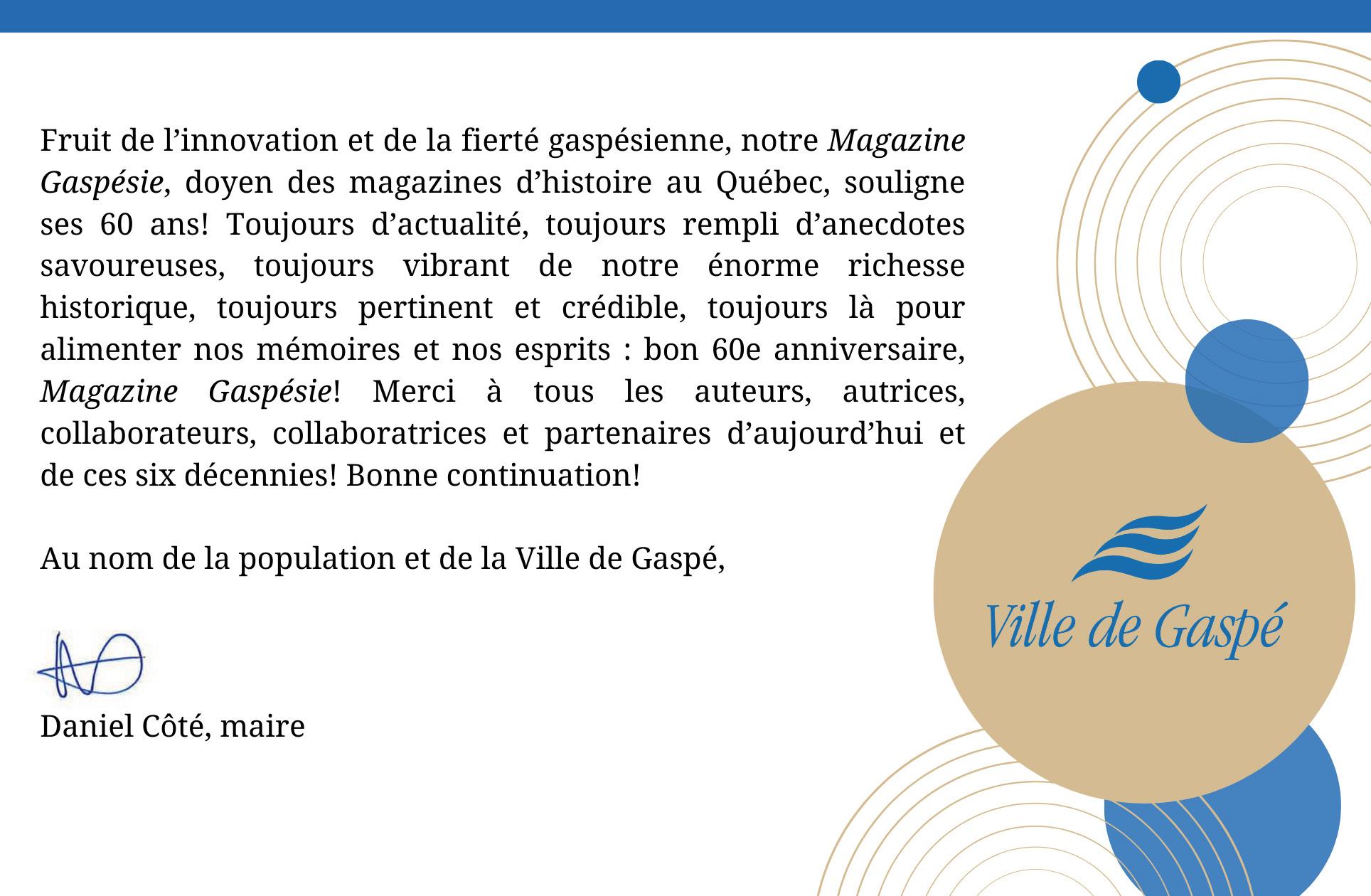
 1. TheGaspeSpec, 7 octobre 2001.
2-3. Le Havre, 20 août 2006.
4. Agir, janvier 2007.
La famille Sheehan à l’occasion du 60e anniversaire de mariage de Emelia Jones et George Sheehan, 1996. Collection famille Sheehan
VISIONNEZ LE FILM GEORGE SHEEHAN, BIENTÔT 100 ANS, DE JACQUES KASMA
1. TheGaspeSpec, 7 octobre 2001.
2-3. Le Havre, 20 août 2006.
4. Agir, janvier 2007.
La famille Sheehan à l’occasion du 60e anniversaire de mariage de Emelia Jones et George Sheehan, 1996. Collection famille Sheehan
VISIONNEZ LE FILM GEORGE SHEEHAN, BIENTÔT 100 ANS, DE JACQUES KASMA
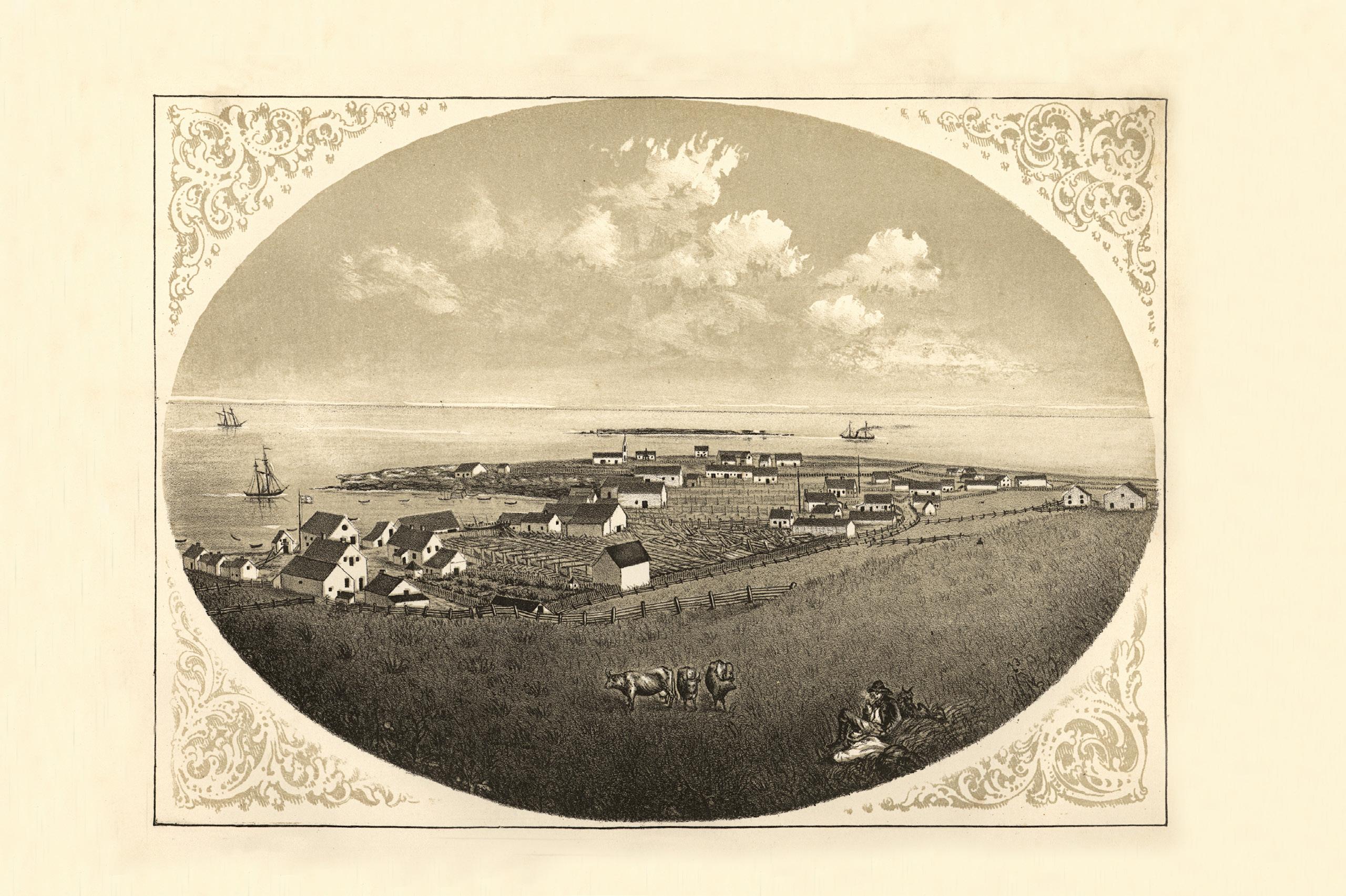
 Lot 16
Lot 16



 Projet Éole
Projet Éole

 Extérieur et intérieur de la centrale électrique, 2022. Projet Éole
Extérieur et intérieur de la centrale électrique, 2022. Projet Éole