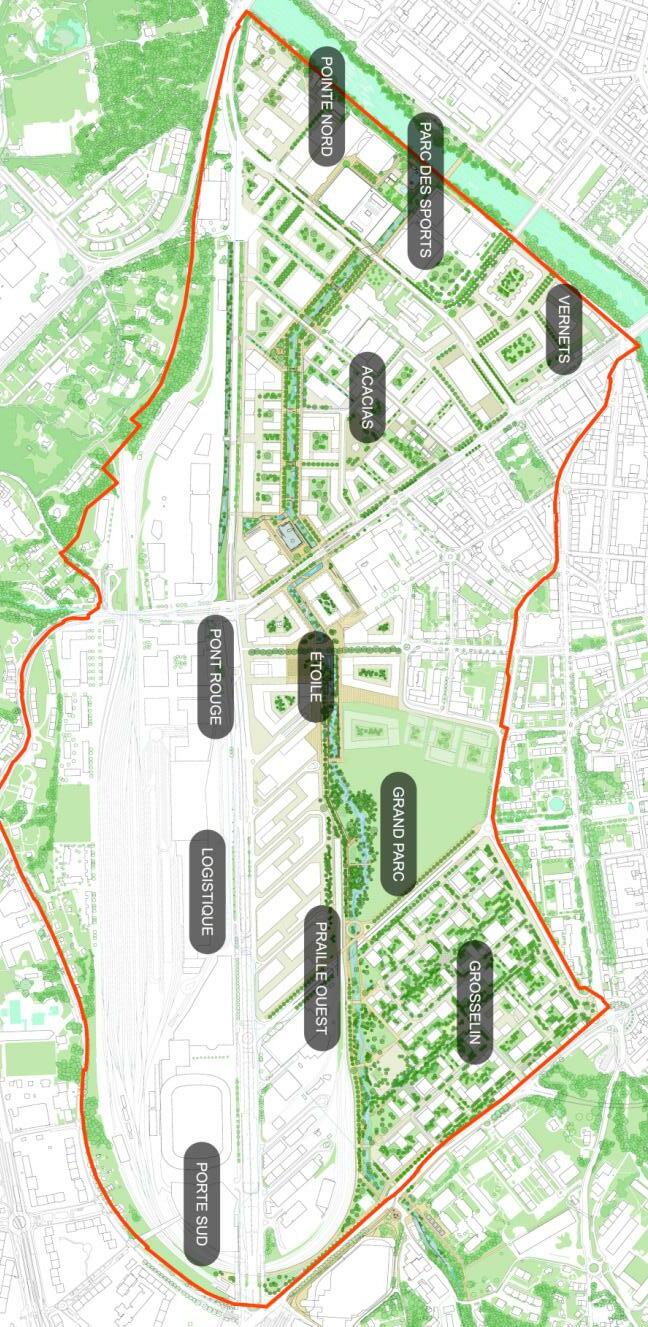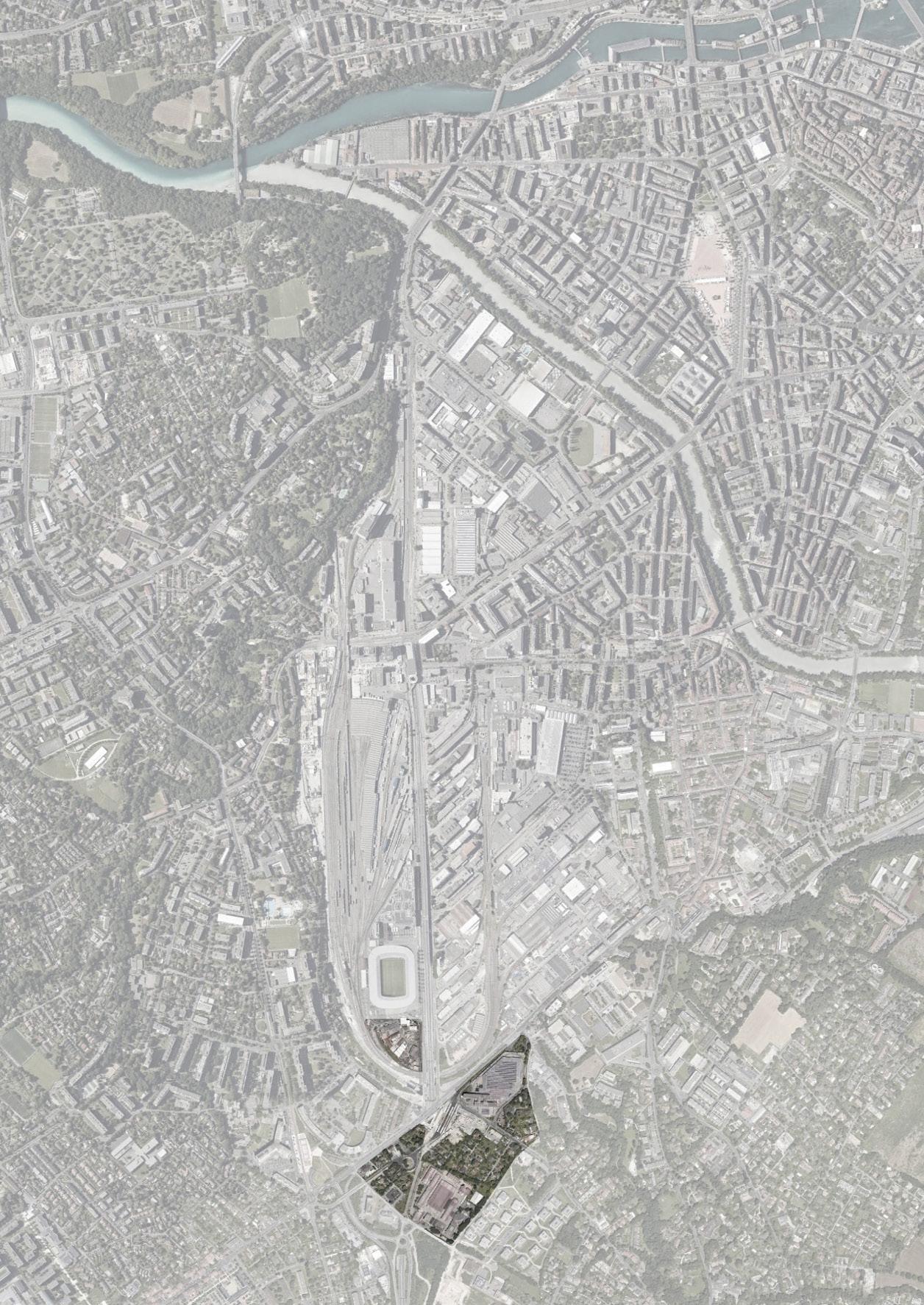La tour et son rapport à la ville

Loïc Steiner
Mémoire de thèse
Responsable mémoire de thèse
Responsable projet de thèse
Loïc Steiner
Blanca Vellés de Uribe
Alicia Escolar
Joint Master of Architecture HES-SO Semestre d’Automne Genève - janvier 2023

Remerciements
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont contribué à la production de ce mémoire.
Je voudrais dans un premier temps remercier Blanca Vellés pour son suivi en temps que responsable de mémoire de thèse et Alicia Escolar pour son suivi en tant que responsable de projet de thèse.
Je tiens également à remercier Philippe Meier pour ses conseils, discussions et références sur le sujet du mémoire.
Je tiens aussi à remercier Stephen Griek pour le temps qu’il m’a accordé durant notre discussion.
Je remercie Valérie Vicard pour la relecture et correction de ce mémoire.
Je remercie Katerina Botsis pour ses conseils et son soutien durant l’élaboration de ce mémoire.
Enfin, je tiens à remercier toutes les personnes qui m’ont soutenu durant ce travail.
La tour et son rapport à la ville
5
Avant-propos
Pourquoi ce sujet ?
La tour comme élément pictural évident sort de l’ordinaire. Dans un paysage européen familier, elle fait varier la skyline d’une ville. Elle modifie les rapports entre les volumes continus du tissu existant. D’ordinaire, elle se détache d’une lecture continue pour sauter aux yeux de l’observateur. Mais, est-elle indispensable?
On parle souvent de la tour dans le langage courant ou dans les projets d’architecture mais a-t-on vraiment déjà eu l’opportunité d’étudier en profondeur le sujet et ainsi le maîtriser au mieux pour proposer des projets dont on s’est complètement approprié la thématique.
Dans des écrits et théories décrites par Kevin Lynch dans L’image de la cité, une ville a besoin d’identité pour exister dans l’imaginaire des individus. Ce n’est que par l’identité et la particularité en addition à d’autres points importants que la ville développe un caractère et s’éloigne de ce qu’on appelle la ville générique. Au delà de cette identité, un des points qu’il met en avant est celui du repère dans la ville. En ce sens, la tour apparaît donc comme un point de repère qui compose et fait exister cette ville, définit un quartier, un îlot urbain.
Dispositif familier
Les tours sont des figures architecturales qui sont présentes depuis plusieurs années dans un grand nombre de mes projets d’architecture: un hôtel dans le Tessin aux abords du lac de Lugano aux ambitions territoriales fortes et faisant écho aux projets de tours tessinoises d’architectes comme Rino Tami .
Des tours comme points de repère et marqueurs d’entrée dans un nouveau quartier de la ville du Havre. Ville composée de plusieurs gabarits hauts proposés par le cabinet d’architecture des frères Perret. Ou encore une série de tours composées avec socles dans un nouveau quartier en développement à Yverdon-les-Bains.
La tour et son rapport à la ville
7
Conviction personnelle
De par sa hauteur naturelle, la tour dégage en sa base un espace public important. On observe qu’il existe un rapport évident entre l’augmentation de la hauteur et l’augmentation de la dimension de l’espace public au pied de cette dernière.
J’ai donc une conviction personnelle que la tour peut régler des situations urbaines complexes liées au tissu de la ville et au besoin de densification actuel et futur.
Ainsi, j’ai l’envie de proposer des hypothèses sur la réussite de dispositifs de tour, qu’elles soient composées et au nombre de plusieurs ou bien isolées et solitaires.
Le choix de travailler sur la notion de rapport entre la tour et l’espace public s’impose donc dans mon processus d’apprentissage et d’approfondissement des connaissances comme prolongement naturel. Cela est aussi une opportunité pour moi de proposer une hypothèse sur un dispositif ou une méthode d’implantation de tour qui la rendrait objectivement vertueuse pour la ville et son espace public.
La tour et son rapport à la ville
9
Table des matières
Introduction Enjeux Problématique Méthode
Qu’est-ce qu’une tour?
Un parcours des tours
Les premières tours Les types de tour Technologie et modernité L’importance du rez-de-chaussée Les tours aujourd’hui
Etudes de cas Tour Bel-Air, Lausanne Tour d’Ivoire, Montreux Wolkenwerk, Zürich Zölly Tower, Zürich
Choix du site d’étude
Bibliothèque de tours Tours de l’Etoile et projet du PAV, Genève: vers le choix d’un site Discussion Choix du site Programme Conclusion
Bibliographie
13 15 19 21 25 31 33 37 43 49 53 57 63 85 103 125 149 157 171 190 197 207 211 215
La tour et son rapport à la ville
11
Introduction
La tour et son rapport à la ville
13
«Une autre image animée s’insinue dans ma tête, celle d’une ville qui se déforme par la montée en graine des constructions dont la base s’amenuise. [...] Comment ne pas songer à l’énorme big bang programmatique qui se prépare ? A quoi ressembleront les espaces de production de demain ?»
Carnet de voyage, SIA, décembre 2022
Enjeux
Le sort de la tour
À ses origines, la tour était un élément qui servait et appartenait à la ville et à la communauté. Elle constituait un élément central des relations sociales et spatiales entre les individus aussi diverses et variées qu’elles aient pu être. L’apparition de nouveaux modes de consommation et d’une société capitaliste pousse l’archétype de la tour comme symbole de puissance et de réussite financière. Avec des acteurs sociaux et communautaires qui deviennent des acteurs financiers, le domaine public trop cher à entretenir est vendu au plus offrant. Dès lors, l’espace public généré à la base de la tour et son rapport à la ville est négligé et disparaît. Dans les pays précurseurs de ce mode de construction en hauteur (pour l’habitat et les bureaux) comme les Etats-Unis, on reconnaît rapidement les tours (skyscrapers) comme élément vertical qui tend à chercher la hauteur. Les tours se multiplient à grande vitesse les unes à côté des autres et toutes ensembles, ne ressemblent plus à des tours mais à un ensemble de bâtiments hauts créant un nouveau niveau habitable. Aujourd’hui, lorsque que le propriétaire ou le locataire «monte» d’un étage dans la tour, le prix augmente significativement et au dernier étage de la tour, celui qui paie le plus cher semble pouvoir dire qu’il est le plus puissant, au dessus de tout le monde.
La tour et son rapport à la ville
15
Introduction
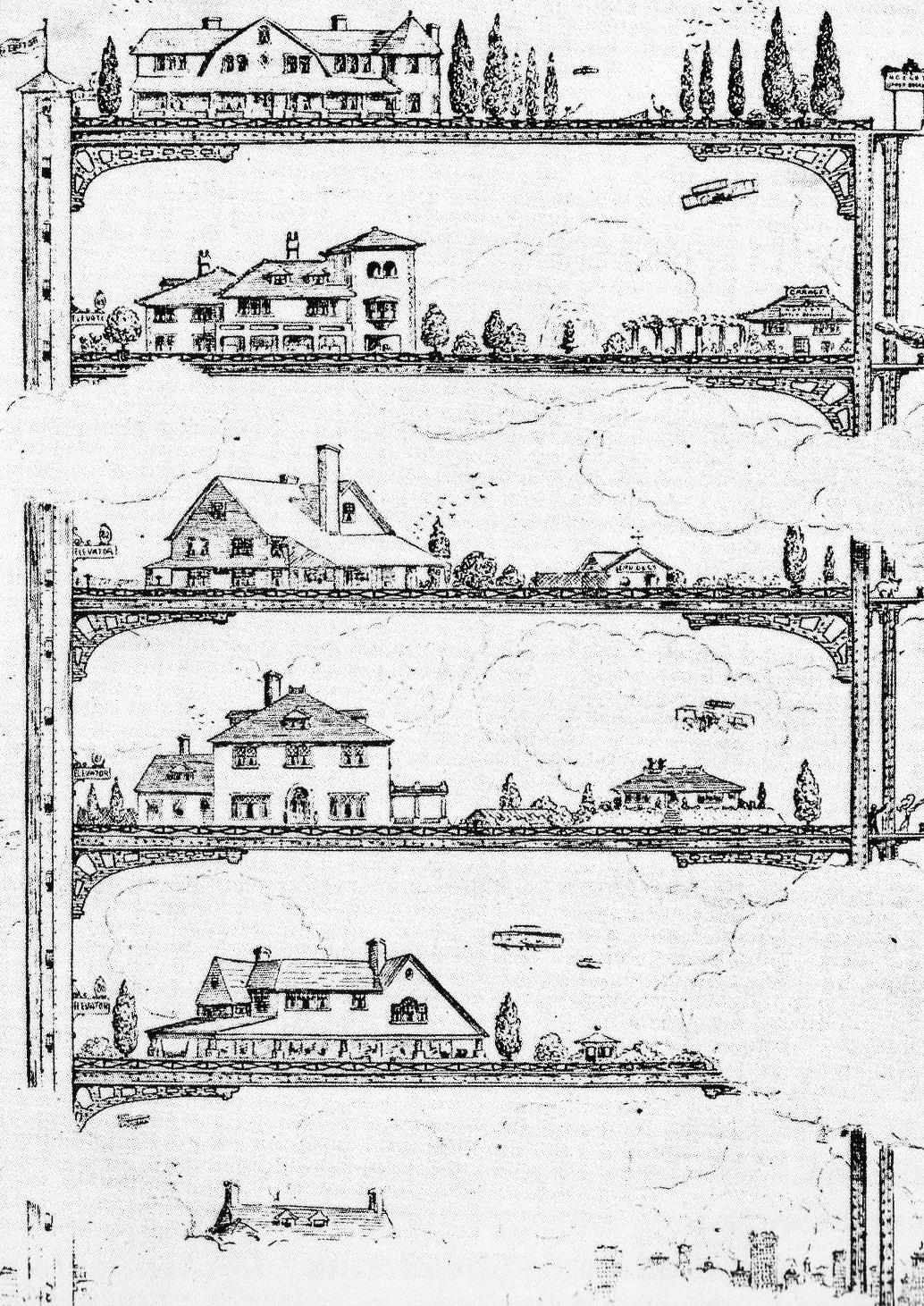
Figure 01_Théorème de 1909
Densification
Dans New York Délire, Rem Koolhaas parle du théorème de 1909 dans lequel un gratte-ciel idéal et utopique est présenté. Il permet «la production d’un nombre illimité de sites vierges sur un emplacement métropolitain donné»1. Cela semble être la solution à tous les problèmes des frontières horizontales et à l’étalement urbain. Aujourd’hui, en Suisse et plus particulièrement à Genève, la forte demande de logements et de densité laisse apparaître des questions autour de la légitimité de la tour dans la ville. Au temps de la construction de coopératives d’habitat avec des tendances à un compromis entre occupation du sol et gabarit en hauteur mais aussi de l’individualisation de la société et de la révision de loi sur l’aménagement du territoire, la tour peut-elle être une réponse adaptée aux besoins actuels et à venir de la société ? Cette manière de faire l’architecture répond à l’individualisation de la société mais sûrement pas à la problématique liée à la condition de la ville comme l’on veut la produire: avec des échanges et des interactions.
L’objectif de ce travail est de comprendre au travers de l’étude de tours liées fortement à la ville et conçues à différents moments et époques, comment ce mode de construction en hauteur peutil faire bénéficier de nouveaux espaces publics de qualité. Cela autant dans la vision territoriale et évidente que développe une tour que dans la vision proche et immédiate qu’est son rapport à l’espace public direct.
La tour et son rapport à la ville
17
Introduction
1Rem Koolhaas, New York Délire, p.83
Problématique
Afin d’établir une problématique idéale pour parler de ce sujet, il convient d’être conscient que la tour, dans notre époque contemporaine pose une série de questionnements quant à sa place dans la société et la période de densification actuelle. Comme dit précédemment les enjeux sont multiples et dépendent fortement du lieu d’étude et d’implantation du projet. Chaque ville et quartier adoptent des politiques de densification différentes et doivent alors concevoir des quartiers adaptés aux besoins en pensant à la possibilité d’intégrer des tours dans ces derniers.
Les détracteurs s’accordent à dire que la tour n’est économiquement et/ou urbanistiquement pas viable: élément sortant de l’ordinaire de par sa nature et sa forme, la population de Romandie est méfiante face au développement des tours. Par la problématique suivante et le document de recherche associé, je vais tenter de montrer que la tour peut avoir un rôle vertueux dans l’aménagement du territoire urbain, dans l’établissement de relations entre les individus, dans le rapport visuel au territoire et dans la proposition d’espaces de vie identitaires de qualité.
Comment questionner et comprendre le rôle de la tour dans la ville et son rapport à l’espace public?
Comment la création d’une ou de plusieurs tours depuis l’aspect programmatique vers son caractère urbain et territorial peut-elle définir un nouvel espace public de qualité accessible à tous?
La tour est-elle un moyen de créer des nouveaux ilots d’urbanité dans des grandes villes où les centres se multiplient?
Ainsi ces questionnements tendent à être des sous-parties d’une réflexion plus générale:
Comment la tour peut-elle participer au développement de nouveaux espaces publics pour la ville?
La tour et son rapport à la ville
19
Introduction
Méthode
Afin de comprendre et de créer un fil conducteur à ce mémoire, je procéderai de la manière suivante en effectuant une recherche appliquée:
Dans un premier temps, j’étudierai l’histoire des tours depuis les premiers cas connus dans l’histoire de l’humanité jusqu’aux tours cherchant à répondre aux problématiques actuelles et futures en intégrant leur contextualisation (théorique, économique, géographique, idéologique et climatique). Puis je parlerai des inventions technologiques qui auront permis aux tours de prendre de la hauteur et enfin de la manière dont la Suisse s’est appropriée cette influence et thématique. La documentation apportée permettra d’aborder la notion de tour dans la ville.
Dans un second temps, j’effectuerai une liste des tours majeures construites en Suisse depuis 1930 parmi lesquelles je choisirai les plus pertinentes dans le cadre de cette recherche et les étudierai (exemples et contre-exemples).
Chaque objet d’étude sera analysé à différentes échelles en tenant compte du contexte de construction et donnera lieu à une conclusion et à un état de l’art sur cette dernière. Cette conclusion se fera sous la forme d’un cours paragraphe conclusif et d’un schéma récapitulatif qui permettra de résumer les différents critères évoqués.
Les points critiqués dans les études de cas seront les suivants: Vision territoriale Concept d’implantation et rapport au paysage lointain
Socle et rapport direct à la ville Rapport au sol, résolution des premiers niveaux et gestion des vides
Programme et typologie Mixité/uniformité du programme, gestion de la typologie
Structure et environnement Choix de la structure, matériaux mis en œuvre, pérennité de la construction
La tour et son rapport à la ville
21
Introduction
Méthode
Dans un troisième temps et ce dans le but de définir le site de projet, je vais diriger la méthode d’étude de cas précédente vers la ville de Genève.
Ainsi, après avoir développé une «bibliothèque des tours à Genève», je m’intéresserai au projet des tours de l’Etoile conjointement au développement du quartier du PAV avec un avis de Stephen Griek sur la notion de tour et sur le développement de Genève.
Cette recherche permettra dans un premier temps d’obtenir une base de connaissances solide vis-a-vis des tours en Suisse, puis dans un second temps d’établir les règles pour la définition d’un site de projet à Genève et pour le développement d’un programme cohérent et fonctionnel.
La tour et son rapport à la ville
23
Introduction
Qu’est-ce qu’une tour?
La tour et son rapport à la ville
25

Figure 02_Seagram Building
Aujourd’hui, la tour se définit en premier par ses caractéristiques formelles. Un bâtiment devient une tour grâce à son rapport proportionnel entre son développé en plan et son développé en élévation. Ainsi, on pourrait presque définir une équation qui définirait un bâtiment comme une tour lorsque le rapport entre sa hauteur et sa largeur est supérieur à 1,8. Ce n’est évidemment pas aussi simple que cela. La forme de la tour que l’on connaît aujourd’hui n’a pas toujours existée comme telle. Les tours ont évolué avec leur temps et leur contexte. On connaît certaines tours dont on pourrait discuter leur dénomination tant leurs proportions semblent faire penser à des barres. Cependant la hauteur inédite et particulière qu’elles développent durant la période de construction, fait d’elles des bâtiments classés comme des tours.
Socle, corps et couronnement
De manière générale, on s’accorde à dire que la tour est composée d’un socle, d’un corps et d’un couronnement. Bien entendu, cela dépend de l’interprétation de l’architecte et des mœurs de la société.
Mies van der Rohe construit le Seagram building dans les années 1950 avec l’utilisation des ces trois parties distinctes: un grand socle public composé par une place surrélevée en granite et un rez-dechaussée en double hauteur libéré par la structure ponctuelle en acier et le noyau de distribution et de technique central. Un corps qui compose la majorité de la tour avec ses 37 niveaux de bureaux puis un couronnement imposant sur les derniers étages de la tour.
Le tout exprime la structure en béton armé avec des profils métalliques fins en façade.
Ainsi, de nos jours ces trois éléments ne font pas toujours partie de la composition de la tour.
La tour et son rapport à la ville
27
Qu’est-ce qu’une tour?
Skyline de la ville de Montreux
Skyline de l’île de Manhattan
28
La tour se définit de manière plus forte par rapport au contexte dans lequel elle est implantée. Ainsi, une tour dans un quartier d’immeubles de faible hauteur pourra être de hauteur bien plus faible qu’une tour dans un quartier dense de bureaux composé de bâtiments de hauteurs plus importantes (6 étages pourraient être suffisants dans un quartier résidentiel de faible densité tandis que la tour ne ferait que se confondre avec le tissu près d’autres bâtiments de grande hauteur). Les tours créent avec les autres bâtiments le visage des villes, elles sont des points de repère. Dans L’image de la cité, Kevin Lynch parle de cinq critères qui créent une image mentale d’une ville non générique. L’un de ces critères: le repère peut être défini par la tour qui permet de forger une image commune, de définir un sentiment d’appartenance et de permettre de s’orienter dans l’espace.
Normes et contraintes techniques
En Suisse, les normes d’accès aux pompiers ne favorisent pas l’implantation des tours. Dès 30m, le bâtiment doit se doter d’issues de secours supplémentaires et de prescriptions techniques complémentaires. Les accès aux espaces extérieurs deviennent plus contraignants et les voies de fuite sont plus grandes et plus nombreuses. Cela augmente significativement le coût de construction et les contraintes techniques lors du chantier. Peu de personnes sont prêtes à encaisser le coût de cette densification verticale dans laquelle le rapport entre la surface de service et la surface utile peut rapidement devenir un problème: plus la tour est haute plus il faut garantir d’ascenseurs, moins il reste de place pour les espaces vivables et utiles à l’habitant.
La tour et son rapport à la ville
29
Qu’est-ce qu’une tour?
Un parcours des tours
La tour et son rapport à la
31
ville

Figure 03_Tour de Babel
A sa genèse, la tour est un emblème religieux construit par l’homme visant à atteindre le ciel et les entités qui selon les écrits y règnent. D’abord un élément unique comme centralité d’un espace, la tour se ramifie de plus en plus aux constructions horizontales pour ainsi composer des ensembles complexes tels que des châteaux ou des remparts.
Plus tard, la fonction de la tour s’est déclinée vers plusieurs modèles bien précis, parmi lesquels on peut citer les modèles défensifs, religieux, symboliques, résidentiels puis techniques.
Les premières cités
En 5’500 av. J.-C., après trois mille ans de développement lent, naissent des villages et des communautés agricoles. Les premières citées s’implantent sur les hauteurs et se développent dans les vallées du Tigre et de l’Euphrate (aujourd’hui composées par des pays comme la Syrie ou l’Irak) pour disposer d’un accès à l’eau facilité.
Au fil des années et des siècles, les techniques s’améliorent, notamment celle de l’irrigation. Dès lors, des colonies de la région de la Mésopotamie deviennent les premières grandes villes connues avec des «cités» de plus de 10’000 habitants: la révolution urbaine a commencé.
Ce processus culmine dans les cités-états sumériennes à partir de 3’000 av. J.-C. Les villes et les cités se différencient par l’organisation sociale: elle change et évolue, elle est de plus en plus élaborée et est le résultat de la spécialisation et de la diversification des tâches.
La région de Sumer, berceau de la civilisation manque de pierre, c’est pourquoi les maisons ont été construites avec de la terre crue, matériau facilement maléable.
Les murs des maisons ont ainsi été construits avec la technique de l’adobe. Usés par le temps, les abandons et les intempéries, de nombreux édifices sont démolis et entassés sur place. Ce qui donne lieu après quelques siècles, à la croissance du niveau naturel de la ville, formant un monticule artificiel: un tell.
La tour et son rapport à la ville
33
Un parcours des tours
Figure 04_Représentation de la ziggourat

34
Ur, cité clé de l’empire chaldéen pendant le XXIème siècle av J.-C était entourée d’un mur intérieur dans lequel se trouvaientt des bâtiments tels que les temples dédiés à Nannar et Ningal, les bureaux administratifs, les entrepôts et surtout, la Ziggourat. «Les premières tours étaient donc des tours à gradins qui dans la religion incarnent l’idée symbolique de l’escalier qui unit le ciel et la terre, lien entre la divinité et les hommes.
Dédié au dieu de la lune Nannar, la ziggourat est probablement la plus ancienne référence de tour qui existe et l’inspiration de la Tour de Babel»1
Symbole de l’existance d’une civilisation, la tour de Babel est à la fois l’élément qui démontre les capacités techniques de l’Homme ainsi que ses ambitions. Elle est certainement la tour la plus connue de l’histoire de l’humanité.
Nous verrons que ce symbole prôné par la tour évoluera fortement pendant les prochains siècles pour s’adapter aux besoins des sociétés et du contexte environnemental.
1Blanca Vellés de Uribe
La tour et son rapport à la ville
35
Un parcours des tours
 Figure 05_Palazzo Vecchio
Figure 05_Palazzo Vecchio
On peut classer les tours construites dans l’histoire en plusieurs types
Les tours militaires
Pendant la Rome Antique, les romains utilisent les termes Turris et Burgus pour désigner les tours isolées construites pour surveiller la frontière de l’Empire. Au Moyen-Age, différents types de tours défensives sont utilisés: les tours de flanquement, les tours d’angle, la tour-porte (combinaison ingénieuse de deux dispositifs architecturaux primaires) et les châtelets. Ensuite, les tours de guet sont utilisées pour la surveillance, elle permettent d’augmenter le rayon de vision et la capacité à anticiper les évènements. On les connaît principalement dans les tristement célèbres camps de concentration et peuvent encore être vues dans les prisons, et les postes frontière. Elle témoignent, pour des raisons différentes d’aujourd’hui, du besoin de dégager des rayons de vision importants.
Les tours communautaires & tours de villes
Les villes européennes du Moyen Âge étaient murées, et leurs bâtiments principaux étaient conçus avec des tours. Elles servaient à la fois à défendre et à distinguer. En Europe, les riches familles et les institutions s’affrontaient de manière passive grâce à la construction de tours de ville qui leur appartenaient. Elles étaient un symbole de richesse et de pouvoir ainsi q’une démonstration du savoir faire et du pouvoir social et politique.
On reconnaît dans ce type de tours, des exemples anciens à Florence avec le Palazzo Vecchio (image de gauche), la mairie de Bruxelles composée d’un corps et d’une tour imposante directement sur la Grande-Place, centre de la ville ou encore la très grande tour de l’hôtel de ville du Havre dans laquelle on retrouve un belvédaire et une grande salle de conférence dans ses derniers niveaux.
La tour et son rapport à la ville
37
Un parcours des tours

Figure 06_Monastère
Saint-Antoine
Les tours religieuses
Dans l’architecture paléochrétienne, on construisait déjà des églises composées par des tours mais sans transept. Elles pouvaient posséder plusieurs d’entre elles, et être placées à différents endroits, selon le modèle de plan de l’église. En Europe occidentale, à partir du VIe siècle, les tours des églises servaient de point de défense. Dans l’architecture byzantine, deux tours étaient placées en façade.
Le monastère de Saint-Antoine dans le désert arabique en Egypte à environ 155 km au sud du Caire fut la première église construite sur le continent africain. Il est d’ailleurs considéré comme tel avec le monastère Saint-Paul. Dotée de deux tours, elle dévoile sa dévotion à une entité puissante en direction du ciel. Les tours du monastère représentent la majeure partie de la construction. On note l’importance du symbole dans ces croyances.
Dans les cités médiévales, les monastères faisaient partie de la couche de fortification, ils étaient étroitement liés au pouvoir de la ville. En France par exemple, la fin de l’antique union entre l’Eglise et le pouvoir politique en 1905 marque la fin de cette étroite relation. Leurs tours avaient donc un rôle défensif tout autant que religieux.
Enfin, les époques romanes et gothiques célèbrent les édifices avec des tours de plus en plus hautes et de plus en plus fines. Parfois des dixaines de mètres au dessus de la charpente ne sont constitués que de fines pointes.
Aujourd’hui on parle des églises et de leur clocher qui sonnent simplement l’heure ou s’affichent esthétiquement dans le ciel des villes.
La tour et son rapport à la ville
39
Un parcours des tours
 Figure 07_Tour Elisabeth | Big Ben
Figure 07_Tour Elisabeth | Big Ben
Les tours technologiques
Un type de tour qui est apparu plus récemment est celui de la tour technologique dont le but est souvent unique comme par exemple d’indiquer l’heure ou de servir à construire des éléments plus grands ou plus importants. Le plus représentatif est la tour-horloge Elisabeth du Big Ben (Parlement de Westminster, Londres) ou les tours de télévision et de radio construites sur des hauteurs afin de propager des ondes radios. On retrouve également des tours de communication dans les villes. Leur usage d’émetteur est souvent couplé à un usage d’habitat et de bureaux. Ainsi on réalise la hauteur nécessaire à l’émission et à la réception des ondes avec une construction utile à la ville. C’est le cas de la tour de la télévision RTS à Genève qui s’oppose à des tours d’émission comme l’émetteur TV Bettingen S Chrischona de Bâle.
On aperçoit parfois dans le paysage des tours de refroidissement. Elles sont liées aux industries lourdes telles que les centrales à charbon, nucléaires... Leur rôle est purement technique puisqu’elles évacuent «vers le milieu extérieur la chaleur issue de systèmes de refroidissement (climatisation, centrales électriques ou procédé industriel) en faisant circuler de l’eau chaude dans un flux d’air. C’est un échangeur de chaleur entre l’eau et l’air ambiant.»1
Les tours d’habitation, de bureaux et mixtes
Ce sont les formes de tour les plus courantes aujourd’hui qui seront développées dans les études de cas de ce mémoire.
On peut dire que le gratte-ciel comme on le connaît aujourd’hui est né des suites de deux évènements importants: la mise au point de l’ascenseur et de sa sécuritsation et le grand incendie de Chicago de 1871.
1Tour aéroréfrigérante, Wikipédia
La tour et son rapport à la ville
41
Un parcours des tours

Figure
08_Premier ascenseur sécurisé
Les tours prennent de la hauteur
Avant le monte-charge existait le treuil mais il ne permettait pas le transport de personnes par manque de sécurité en cas de disfonctionnement. Seules les marchandises étaient alors concernées. C’est à Chicago que naît l’ascenceur comme on le connaît aujourd’hui.
Otis présente le monte-charge à Parachute en 1854 lors d’une démonstration à la «Crystal Palace Exposition».
C’est la première fois que le grand public peut admirer un ascenseur sécurisé dont le système permettra de garantir la sécurité des utilisateurs pendant son utilisation. Le présentation est un show, une mise en scène qui restera gravée dans l’histoire.
Dès cette avancée technologique réalisée, les étages les plus élevés dans les tours prennent de la valeur et par extension, les tours s’allongent et s’agrandissent à l’infini avec comme seules contraintes les gabarits des villes et les capacités techniques et tectoniques des structures.
Des systèmes de plus en plus efficaces
Il faudra attendre 1866 pour que les premiers hôtels à New-York puissent bénéficier du système. Il vise pour l’instant une petite proportion de la population mais voit déjà les limites de ses capacités. Le principal défaut de ce système était sa vitesse. À ses débuts, il parcourait 0,2 mètres par seconde, ce qui le rendait moins attractif. Mais la demande étant si forte, le système ne tarde pas à s’améliorer. En 1878, Otis vendait déjà deux nouveaux produits hydrauliques dont la vitesse pouvait atteindre 3 à 4 mètres par seconde. C’est en 1880 en Allemagne que naît l’ascenseur électrique que l’on connaît aujourd’hui. Puis en 1924 un ascenseur complètement autonome muni d’excellents automatismes et dispositifs de sécurité.
La tour et son rapport à la ville
43
Un parcours des tours

Figure 09_Construction de la tour Bel-Air
Les tours arrivent en Suisse
En Suisse, les projets de tour sont éparpillés dans tout le pays, témoins d’époques et de moments historiques bien précis. Les stratégies d’implantation de ces tours changent et témoignent d’un lien fort entre société et aménagement urbain.
Les premières tours sont timides et se fondent dans le tissu urbain alentour. La tour de Rive à Genève (1934-1938) ou la tour d’habitation rue Frédéric-Chaillet à Fribourg (1929-1932) ne décollent pas très haut.
Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale que les bâtiments prennent véritablement de la hauteur. On voit naître divers projets de tours comme avec l’architecte et urbaniste A. H. Steiner qui construit deux tours d’habitations dans le Heiligfeld entre 1950 et 1952. Les adeptes des tours considèrent toutefois que les tours en Suisse restent petites et plutôt timides. Ce qui entre en conflit avec l’opinion populaire générale de l’époque.
Symbole de l’habitat moderne, souvent destiné à un style de vie avant-gardiste, le type semble idéal pour développer de nombreuses tours en Suisse: «Les résident-es (dont de nombreuses familles avec enfants) soulignaient notamment la simplicité des contacts sociaux rendus possible par cette forme de logement : une tour d’habitation permettait de nouer facilement des contacts au gré de ses envies, mais sans aucune obligation. Une impression positive qui demeure largement répandue de nos jours.»1
1Eveline Althaus_ Les tours d’habitation au fil du temps
La tour et son rapport à la ville
45
Un
tours
parcours des

46
Figure 10_Vue de l’ensemble de tours Hardau à Zürich
Essor de l’habitat entre les années 1960 et 1970
La Suisse voit avec l’explosion démographique une augmentation de 25% de la population entre les années 1950 et 1970. De nombreuses tours et ensembles d’habitations naissent dans les zones périphériques des villes dans lesquelles les habitants migrent.
Aujourd’hui, ce sont ces mêmes ensembles et constructions de grande échelle qui sont dénigrés et laissés pour compte, témoins d’une croissance phénoménale mais en proie aux nombreux détracteurs.
Un nouveau souffle sur la tour d’habitation
Aujourd’hui, des nouvelles règles poussent les architectes à concevoir des bâtiments de plus en plus denses avec une empreinte au sol réduite. C’est principalement la révision de la LAT (loi sur l’aménagement du territoire) qui a dirigé l’urbanisme dans cette direction. Le sol est de moins en moins disponible, il devient une ressource rare pour laquelle la construction en hauteur est une solution adaptée.
Il reste cependant à s’écarter des idées reçues et véhiculées par les constructions des années 1960 qui sont trop souvent associées aux notions de banlieues et de grands ensembles bétonnés.
On pourrait aussi parler de Röstigraben architectural. En effet, au delà de Berne et dans la Suisse allemande, on accueille la construction des tours avec beaucoup de fierté. Il reste à voir si cela sera le cas pour la Suisse romande dans les années à venir.
« La charge culturelle y est beaucoup plus forte qu’en Romandie. La dimension artistique et expérimentale est beaucoup plus admise.»1
1Bruno Marchand
La tour et son rapport à la ville
47
Un parcours des tours
Axonométrie, détachement de l’espace public
Axonométrie, définition et front face à l’espace public
48
Le rez-de-chaussée comme prolongation de la ville
Nous le verrons dans les prochaines pages de ce mémoire mais le traitement du rez-de-chaussée des tours est primordial. Les tours composées ou non qui ont respecté cette condition ont su développer un projet de qualité, vivant et connecté à la ville.
On note que les tentatives de connexion à la ville ne sont pas toujours des réussites. Mais elles doivent toujours être définies clairement par le concept d’implantation et par la volonté architecturale de son projeteur.
Deux attitudes
Préfère-t-on se lier fortement à l’espace public avec un socle qui longe les espaces comme la tour Bel-Air peut le faire ou préfère-t-on assumer une forme de détachement en se retirant du tissu existant comme la tour Edipresse des architectes Pierre Bussat et JeanMarc Lamunière peut le faire ?
La première axonométrie illustre un détachement de l’espace public.
On note que la tour libère un espace au sol et crée une nouvelle poche, une sorte de respiration dans la continuité de la ville. Ce dispositif est parfois combiné à une libération du rez-de-chaussée avec une tour sur pilotis comme le ferait Le Corbusier dans ses projets d’habitations.
Le seconde axonométrie présente une définition forte et un front face à l’espace public, ici une rue. L’attitude de la tour rend la lecture de l’espace claire, comme le besoin de rattacher fortement au tracé et à l’histoire du lieu.
Elle intervient à deux échelles distinctes: celle de l’espace public direct et celle du quartier et/ou du territoire.
La tour et son rapport à la ville
49
Un parcours des tours

Figure 11_Tour Albert
La tour comme résolution de situations complexes
Certaines tours ont aussi l’ambition de connecter et de jouer avec la topographie directe du lieu. C’est le cas de la tour Bel-Air à Lausanne que nous aurons le temps d’aborder plus tard dans le mémoire ou encore de la tour Albert à Paris dans le 13ème arrondissement construite entre 1958 et 1960.
Cette tour dispose d’un rez-de-chaussée inférieur accessible depuis la partie basse du projet et d’un rez-de-chaussée supérieur accessible au 6ème étage et faisant office de belvédère. Ces deux étages font chacun office de rez-de-chaussée qui est lié à un niveau de la différent de la ville et crée ainsi une continuité artificielle de l’espace public dans le corps de la tour. Dans la culture parisienne, cette nature et cette vision de ces rez-de-chaussées libérérés de toute façade, font que l’élément est devenu la tour «coupée en deux». On note que cette expression de façade joue aussi un rôle important dans le jeu d’échelle. La première partie du bâtiment possède un corps dont le gabarit est similaire aux bâtiments proches tandis que le reste de la tour se projette vers le ciel. La réalité et le recul a montré avec l’abandon du projet de passerelle et plus généralement avec l’abandon du projet d’urbanisme qui devait enjamber les voies de garage du métro, que le belvédère n’était pas viable s’il n’était pas relié au reste de la ville. En effet, il n’a jamais été rendu accessible au public.
La tour doit donc fonctionner avec le quartier entier et pas seulement avec son environnement immédiat pour garantir un usage viable de ses espaces qui entretiennent un rapport direct avec le sol de la ville.
La tour et son rapport à la ville
51
Un
parcours des tours

Figure 12_432 Park Avenue
Le problème de Manhattan
La presqu’île de Manhattan représente le capitalisme à son paroxisme. De nos jours, au sud de Central Park, les gratte-ciels les plus hauts de la ville voient le jour. Le quartier, désormais appelé Billionaires Row, abrite des tours dont la hauteur dépasse les 400 mètres avec parfois des largeurs de 18 mètres seulement.
Ces buildings ne sont plus des moments d’architecture mais bien des œuvres dans lesquelles les hommes les plus riches de la planète investissent. D’ailleurs la plupart de ces appartements sont immenses, occupent la plupart du temps un étage complet voire plusieurs et sont souvent innocupés. Ils sont le marqueur contemporain du capitalisme.
Depuis vingt ans, les astuces et tours de force se sont multipliés pour éviter d’avoir à se cantonner aux règlements des zones et aux gabarits de New-York. La skyline de Manhattan change radicalement et les anciennes plus hautes tours de la ville qui sont des tours de bureaux laissent place à des nouvelles tours destinées à la résidence secondaire.
Le cas de 432 Park Avenue
La tour construite par le bureau d’architecture Rafael Viñoly représente cette conversion de l’architecture d’habitat vers l’architecture d’investissement. En ajoutant des étages techniques qui permettent au vent de filer dans le corps du bâtiment où les niveaux sont libérés de toute façade sans le déstabiliser, la tour gagne 25% de sa hauteur. En effet, dans la réglementation urbanistique de la ville, seuls les étages «utiles» comptent dans l’attribution de la hauteur maximale et ces manipulations permettent de s’affranchir ou de contourner les règlements.
La tour et son rapport à la ville
53
Un parcours des tours
Etudes de cas
Comprendre les stratégies d’implantation des tours
La tour et son rapport à la ville
55
Etudes de cas Comprendre les stratégies d’implantation des tours
Afin d’établir une analyse objective, il convient de déterminer des bases évidentes pour tout le monde. Il faut éviter de s’embarquer dans des débats sans fin sur la beauté subjective des tours mais plutôt sur des critères concrets et intelligents qui servent naturellement le bien-être de la société:
« Les débats sur ces projets sont généralement passionnés et passionnels et démontrent qu’il est urgent de se doter de bases claires pour mener un débat objectif, pour évaluer de tels projets et au final pour pouvoir se décider.»1
A cette fin, ce chapitre débute par une liste aussi complète que possible de l’ensemble des tours présentes sur le territoire suisse. Avec des tours datant de toutes les époques de construction et certaines encore non réalisées.
Ensuite, j’ai choisi d’étudier en détail cinq tours (indiquées en rouge) que je juge comme intéressantes et vertueuses architecturalement parlant et qui ont d’une manière ou d’une autre marquées la culture Suisse.
Elles possèdent toutes des qualités architecturales évidentes et pour certaines ont fait l’objet d’intérêt pour des expositions, tables rondes et discussions comme l’exposition «De Bel-Air à Babel» à la villa Le Lac de Le Corbusier. Nous verrons qu’elles sont intéressantes pour des raisons différentes et qu’elles serviront à établir des règles pour la proposition d’un projet de tour sur un site défini à la fin de ce mémoire.
1Tribu Architecture, Tours : mode d’emploi
La tour et son rapport à la ville
57
Villes densité et habitants
500’000 12’000
400’000
300’000
Figure 13_Répartition de la densité en Suisse 100’000

hab./km2 nb. hab. 8’000 4’000
200’000
Genève Zürich Montreux Lausanne
Population et densité par habitant
58
Quelques chiffres et observations sur la Suisse
La Suisse compte aujourd’hui environ 8’800’000 habitants pour une superficie totale de 41’285 km2 ce qui en fait un pays moyennement dense comme par exemple l’Italie. Avec une densité d’environ 216 hab/km2. Elle est composée par différents types de paysage qui auront une influence directe sur la culture de la construction du pays: la montagne avec les chaîne des Alpes au sud, le Jura au nord et le plateau suisse sur une grande partie du territoire.
Comme pour la plupart des pays, la population se regroupe autour des grandes villes. En Suisse, les cinq plus grandes villes sont les suivantes: Zürich, Bâle, Berne, Genève et Lausanne. Ces villes deviennent de manière évidente des centres à densifier avec des méthodes de constructions diverses et variées. Leur développement est différent selon les secteurs d’activités qu’ils utilisent dans leur économie.
Ensuite, certaines villes plus petites se développent le long des axes de communications et aux abords des nombreux lacs qui composent le paysage helvétique. Neuchâtel, Lugano ou encore Montreux disposent de qualités territoriales importantes qui les placent comme des villes attrayantes à des distances raisonnables des plus grandes villes déjà très occupées.
Certaines villes comme Genève ou Zürich se sont développés autour de leur lac respectif mais ne laissent aujourd’hui que très peu de chances aux constructions de grande hauteur près de ces atouts territoriaux. Leur développement se fait donc plus dans les périphéries et les extensions de la ville.
D’autres villes comme Montreux se dotent d’objets de grande hauteur proche du lac pour s’en servir directement dans le concept de réalisation de la tour.
La tour et son rapport à la ville
59
Bâle Genève
Carte de la répartition des tours en Suisse
Berne
Tours étudiées dans le mémoire
Zürich
Lugano
60
Les tours en Suisse
Canton de Genève
Tour de Rive, Marc-Joseph Saugey, Genève, 1935
Tours de Carouge, Georges Brera et Paul Waltenspühl, Carouge, 19581973
Hotel Intercontinental, Georges Addor, Genève, 1961-1967
Tour de la RTS, Arthur Bugnat, Genève, 1963-1970
Tours du Lignon, Georges Addor, Genève, 1966-1969
Tours de Lancy, Jean-Marc Lamunière, Lancy, 1968
Tour Les Ailes, Aeby Perneger & Associés SA, Meyrin, 2013-2019
Tour des Vergers, Groupe H, Meyrin, 2014-2018
Lyon 77, 3BM3 Atelier d’architecture SA, Genève, 2016-2020
Tour Opale, Lacaton & Vassal, Chêne-Bourg, 2018-2020
Tours de l’Etoile, Pierre-Alain Dupraz Architectes,Carouge, non réalisé
Canton de Vaud
Tour Bel-Air, Alphonse Laverrière, Lausanne, 1932
Tour Edipresse, Jean-Marc Lamunière, Lausanne, 1960-1964
Tour D’Ivoire, Hugo Buscaglia, Montreux, 1964-1968
Tour Invictus, Dolci architectes, Yverdons-les-bains, 2016-2019
Tour des Balcons du Mont, CCHE SA, Lausanne, 2016
Tour de l’îlot sud, Fehlmann Architectes, Morges, 2018-2021 Tour de Malley gare, Aeby Perneger & Associés SA, Prilly-Malley, non réalisé
Canton du Valais
Tours d’Aminona, A-F Gaillard, Crans-Montana, 1960-1978
Canton de Berne
Tscharnergut et Fellergut, Hans Reinhard, Gret Reinhard, Eduard Helfer, Berne ouest, 1966-1980 Palais des congrès, Max Schlup, Bienne, 1966 Coop-City-Hochhaus, Hans Dietziker, Granges, 1975 Bäretower Ostermundigen, Burkard Meyer, Ostermundigen, 2018-2022
Canton de Lucerne
Hochzwei, Arge Marques Bühler, Lucerne, 2012
Canton de Saint-Gall
Der Silberturm, Heinrich Graf, Saint-Gall, 1973-1977 Spitalhochhaus, Saint-Gall, 1975 Rathaus, Hans Bleiker, Saint-Gall, 1976
Canton des Grisons
Lacuna-Hochhaus, Domenig Archikten, Coire, 1975 City West, Domenig Architekten, Coire, 2012
Canton de Fribourg
Hôtel NH, Fribourg, 1975
Tour Soprano, Fidanza & Lehmann Associés, Fribourg, 2006-2009
Canton de Bâle
Entenweid, Bâle, 1952
Lonza Hochhaus, Hans Rudolf und Peter Suter, Bâle, 1960-1962
Wohnhochhaus, Otto Senn, Bâle, 1965
Biz-Turm, Burckhardt+Partner AG, Bâle, 1972-1977
Messeturm, Morger & Degelo, Bâle, 2000-2003
St. Jakob-Turm, Herzog & de Meuron, Bâle, 2006-2008
Tour Roche 1, Herzog & de Meuron, Bâle, 2011-2015
Grosspeter Hochhaus, Burckhardt+Partner AG, Bâle, 2014-2017
Tour Roche 2, Herzog & de Meuron, Bâle, 2018-2022
Meret Hoppenheimer Hochhaus, Herzog & de Meuron, Bâle, 201-2019
Baloise Park, Miller & Maranta, Diener & Diener, Valerio Olgiati, Bâle, 2015-2020
Claraturm, Morger Partner Architekten AG, Bâle, 2017-2021
Canton de Zürich
Tours d’habitation Heiligfeld, A. H. Steiner, Zürich, 1955
Tour Zur Palme, Haefeli Moser Steiger, Zürich, 1960-1964
Sulzer-Hochhaus, Suter & Suter, Winterthur, 1962-1966
Hardau, Max P. Kollbrunner, Zürich, 1976-1978
Roter Turm, Burkard Meyer, Winterthour, 1996-2000
Axa_Winterthur-Turm, Burkard, Meyer, Winterthur, 1999
Mobimo Tower, Diener & Diener, Zürich, 2002-2011
Sunrise Tower, Atelier ww, Max Dudler, Zürich, 2003
Prime Tower, Gigon Guyer, Zürich, 2008-2011
Hard Turm Park Tower, Patrick Gmür Architekten AG, Zürich, 20092013
Zölly Tower, Meili Peter Architekten, Zürich, 2009-2014
Hoher Haus West, Leoliger Strub, Zürich, 2011-2013
Escher Terrasses, E2A Architekten, Zürich 2011-2014
Jabee Tower, SattlePartner, Dübendorf, 2016-2019
Wolkenwerk, Von Ballmoos Partner Architekten AG, Zürich, 2017-2020 Hochhaus Baslertrasse, Galli Rudolph Architekten AG, Zürich, 20182022
Rocket&Tigerli, SHL architects, Winterthur, en cours
Canton du Tessin
Casa Torre, Rino Tami, Lugano, 1957
Canton de Neuchâtel
Tour Espacité, Richter & Dahl Rocha, La Chaux-de-Fonds, 1994
Tour de l’OFS, Bauart Architectes SA, Neuchâtel, 2000-2003
Canton d’Argovie
Telli-Hochhaus, Aeschbach-Felber-Kim, Aarau,1973
Canton de Zoug
Hochhaus Parktower, Cometti Truffer Hodel, Zoug, 2009 Hochhaus B125, Konrad Hürlimann, Zoug, 2010-2014 Hochhaus Obstverband, Luca Deon, Zoug, 2012-2014
61
Tour Bel-Air Lausanne
La tour et son rapport à la ville
63
100’000
50’000
2020 1850 1930
Evolution de la population à Lausanne (source: Wikipédia)
90 ans
60 ans
150’000 30 ans
Pyramide des âges à Lausanne 2020 (source: Wikipédia)
66
Contextualisation
La ville de Lausanne connaît une croissance démographique importante. Elle fait aujourd’hui partie des cinq plus grandes villes de Suisse.
Avec une population de 17’108 habitants en 1850, elle gardera une croissance légère jusqu’au début du XXème siècle et va ainsi doubler sa population. En 1930, date de la construction de la tour Bel-Air, Lausanne atteint une population de plus de 75’000 habitants. La croissance sera d’autant plus forte les 40 années qui suivent pour atteindre quasiment les 140’000 habitants qui la compose d’ailleurs aujourd’hui.
De nos jours, la ville de Lausanne a un visage particulier. En témoigne la pyramide des âges sur la page de gauche avec une très forte proportion de la population dont la tranche d’âge se situe entre 20 et 35 ans. La population de Lausanne est très jeune et étudiante, plus que la moyenne Suisse. Cette règle s’observe autant pour les hommes que pour les femmes.
Lausanne est perçue comme une ville dynamique, prête à accepter l’innovation et les changements. Avec des campus de recherche comme l’EPFL (école polytechnique fédérale de Lausanne), on s’attend à entrevoir des expérimentations jusque dans le spectre de l’architecture. Chose faite avec des projet comme la tour Bel-Air à l’époque mais pourtant très critiquée. L’agglomération a aussi tendance à rediriger les densités bâties de la ville sur sa périphérie en adoptant des règles d’urbanisme et de gabarits clairs et restrictifs. Sûrement une des raisons pour lesquelles, les constructions de grande hauteur restent peu nombreuses dans le centre de Lausanne.
La tour et son rapport à la ville
67
Tour Bel_Air Lausanne
68 www.geo.admin.ch est un portail d'accès aux informations géolocalisées, données et services qui sont mis à disposition par l'administration fédérale Responsabilité: Malgré la grande attention qu'elles portent à la justesse des informations diffusées sur ce site, les autorités fédérales ne peuvent endosser aucune responsabilité quant à la fidélité, à l'exactitude, à l'actualité, à la fiabilité et à l'intégralité de ces informations.






































































Droits d'auteur:
de la Confédération suisse. http://www.disclaimer.admin.ch/conditions_dutilisation.html 1934 empty text
autorités
300m 200 100 0 Echelle 1: 10'000 Imprimé le 02.01.2023 21:53 MEZ https://s.geo.admin.ch/9c9f9dd239 Figure 14_Carte historique de Lausanne, 1934 sans échelle
Contextualisation
Dès 1930, Lausanne va considérablement changer. Beaucoup de quartiers insalubres du centre historique sont démolis et les industries sont déplacées.
La ville qui s’étend déjà jusqu’au lac avec des quartiers d’immeubles de quelques étages, que ce soit au dessus de la gare ou en dessous va continuer à se développer.
C’est un véritable élan pour la construction de nouveaux bâtiments en contrebas de la vieille ville de Lausanne. La ville construit alors beaucoup au sommet des trois collines (principalement autour de Saint-François) et la population augmente considérablement jusqu’à atteindre les 100’000 habitants en 1940. C’est dans ce contexte de fort changement et développement que la tour Bel-Air Métropole se dévoile.
«Allons-nous vraiment laisser sans protestation s’accomplir cette offense à la raison et au bon goût que serait la construction de la tour du Bel-Air Métropole?»1
C’est ce que dit du premier projet de tour de Suisse le rédacteur en chef de la Gazette de Lausanne, Georges Rigassi. Le ton est ainsi donné pour ce que seront à l’avenir les enjeux et les combats passionnels que seront la conception et l’intégration d’un nouveau moyen de concevoir et d’habiter la ville en Suisse.
1Thiery Meyer, 24 heures, 1930: L’affaire de la tour Bel-Air, d’après une citation de 1930
La tour et son rapport à la ville
69
Tour Bel_Air Lausanne
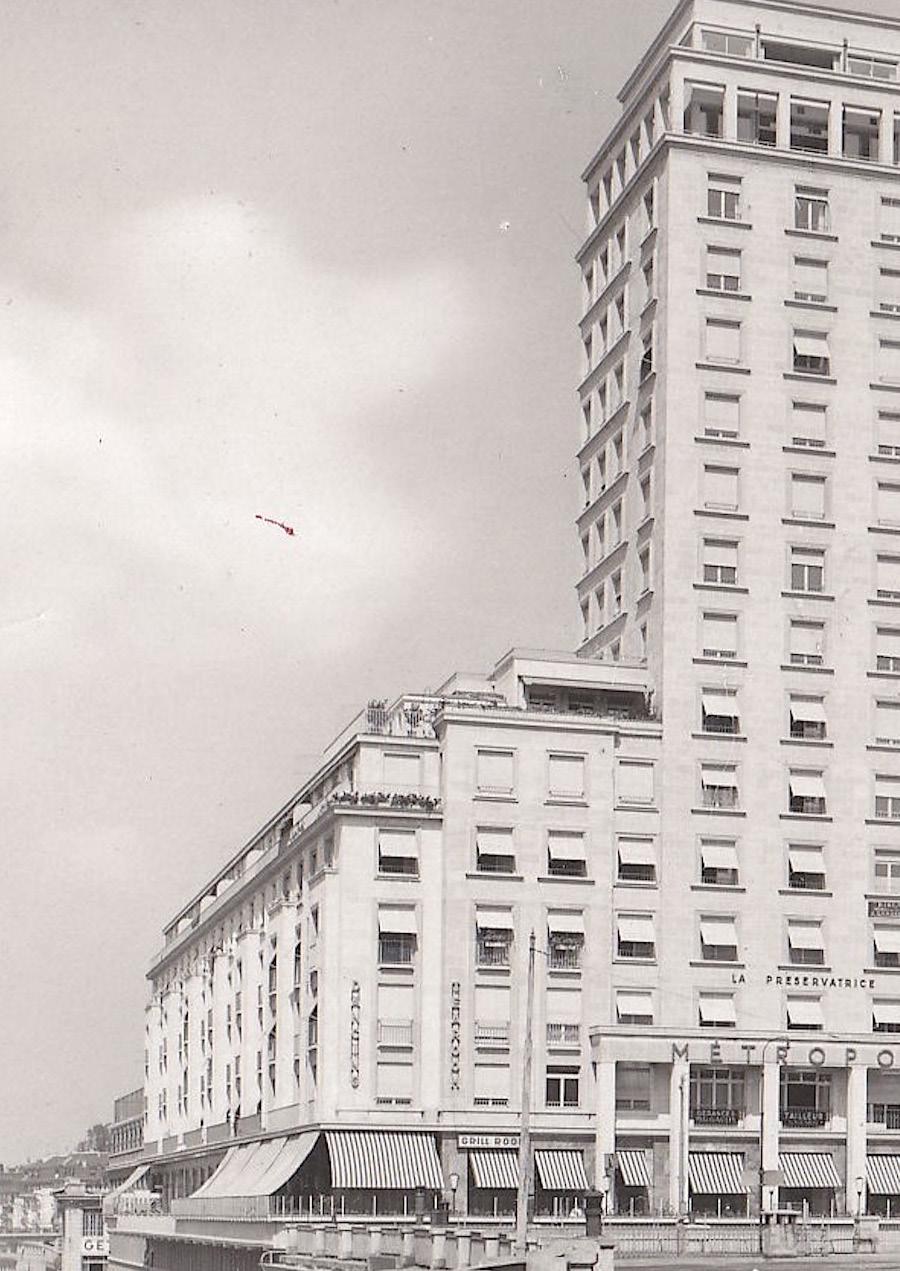
Figure 15_Photographie
de la tour Bel-Air

Plan de situation 1:10’000
72
Données
Date de construction
Lieu de construction
Architecte Hauteur Densité
1932 Lausanne, Suisse Alphonse Laverrière 55 à 68 mètres, 15-19 étages modérée
Considéré comme le premier gratte-ciel de Suisse, la tour Bel-Air est un hommage et une considération pour l’architecture new-yorkaise. C’est l’architecte Alphonse Laverrière qui rapporte avec ses bagages des images et influences de buildings comme le World Tower Building (1915) ou encore le Equitable Building (1915) de Manhattan et des enseignements de bâtiments comme le Flatiron Building (1903) qui constituent les premiers bâtiments de grande hauteur dont le programme est celui de l’habitat et du bureau.
Le projet divise évidemment la population lausannoise, elle pense d’une part que l’édifice va détériorer le paysage de la ville ou bien même entrer en conflit avec la majestueuse cathédrale de Lausanne et la dépasser. Quelle symbolique lui resterait-il alors?
De plus, dans un contexte économique instable, il représente indéniablement l’impuissance économique avec son inspiration de Wall Street et son krach boursier très récent de 1929.
La tour et son rapport à la ville
73
Tour Bel_Air Lausanne

74
Figure
16_Photographie façade ouest
Vision territoriale
En 1934, la ville de Lausanne a un nouveau visage. Près de son centre, au dessus du quartier que l’on connaît aujourd’hui comme le Flon, la tour Bel-Air domine et dialogue calmement avec la cathédrale de Lausanne. La tour s’assume, elle est la première de Suisse, elle marque à jamais la coupe et la sykline de la ville de Lausanne.
La tour est implantée de manière à assumer un devant et un derrière clair, elle va chercher à obtenir un rapport au paysage avec une projection des façades nord, sud et est sur les Alpes, la ville de Lausanne, sa cathédrale et le lac Léman.
La tour Bel-Air restera l’unique tour de la ville de Lausanne pendant de nombreuses années. Encore aujourd’hui la topographie du lieu rend l’implantation de bâtiments comme des tours difficile. C’est ce que nous verrons dans le paragraphe «socle et rapport direct à la ville».
Une apparence et des proportions critiquées valent à la tour de nombreuses critiques mais ne questionnent pas pour autant son impact urbain face au territoire.
Coupe du centre-ville de Lausanne
La tour et son rapport à la ville
75
Tour
Lausanne
Bel_Air
Figure 17_Elévation est sans échelle

76
Socle et rapport direct à la ville
La tour Bel-Air possède une situation particulière qui est pourtant bien commune à la ville de Lausanne. Implantée dans la pente naturelle de la ville, son socle doit naturellement effectuer le lien entre la partie haute qui est la rue des Terreaux et la partie basse qui est la rue de Genève. La hauteur de la tour varie donc entre 19 étages depuis la rue de Genève et 15 étages depuis la rue des Terreaux.
Alphonse Laverrière assure cette transition en exprimant en façade une coursive qui marque la continuité du niveau de la rue des Terreaux au dessus de la rue de Genève.
La tour réagit donc aux rues et à la ville de manière frontale avec un grand socle (illustration page suivante) et une hiérarchie des éléments exprimés en façade.
Reconnaissance d’un front de rue
Le bâtiment marque un rapport évident aux gabarits alentours de la ville de Lausanne avec un premier volume bas de sept niveaux. Cette première partie renforce le lien de la tour avec l’îlot métropole et les bâtiments de la vieille-ville lui faisant face avec le même gabarit.
Au sud, la partie basse de l’îlot permet à la rue de Genève d’être clairement définie et visuellement terminée par la coursive cinq niveaux plus hauts.
La tour s’inscrit dans une logique de langage double, comme un jeu à plusieurs échelles entre les rues et passages immédiats et les toitures de la ville de Lausanne.
Ensuite, dans une composition classique et par une série de retraits, la forme de la tour se dessine petit à petit en façade et, ce, dès les premiers étages depuis la rue.
La tour et son rapport à la ville
77
Tour Bel_Air Lausanne
Figure 18_Plan des premiers étages de la tour échelle originale 1:100

78
Programme et typologie
Programme
La tour a comme ambition de proposer grâce à une composition mixte de son corps et de son socle un programme diversifié. En effet, sur un total d’environ 11’000 m2, 4’700 sont dédiés aux bureaux, 2’400 aux commerces, 2’700 à choix entre bureaux et commerces puis 1’600 aux logements concentrés principalement dans le corps de la tour Ainsi le socle majoritairement commun et public catalyse les interactions entre la rue des Terreaux très empruntée et le socle de la tour.
Cependant, l’intervention marque une importante césure entre les deux niveaux de la ville: seul l’escalier extérieur à l’est permet de lier les deux niveaux de la ville.
Typologie
La tour est très largement ouverte sur les façades nord, sud et est et cherche ainsi à ouvrir les perspectives et les vues sur la cathédrale de Lausanne, la ville et le lac Léman. Elle est en revanche plus fermée sur la façade ouest (façade se projetant sur l’îlot que la tour vient compléter). On retrouve dans cette orientation un escalier dans l’angle nord-ouest qui vient distribuer les étages de la tour.
On comprend que la tour est très largement orientée comme le laissait imaginer la composition classique de la façade est et sa colonnade en façade est.
La distribution des logements de l’îlot est assurée par des cages d’escaliers exprimées en façade sur la cour intérieure de l’ìlot. Les pièces de services comme les salles de bain et les WC sont organisés autour de ces cages d’escaliers.
Le choix typologique de la tour semble pourtant aller à l’encontre de la volonté de l’orientation et de l’ouverture de la tour sur le paysage.
La tour et son rapport à la ville
79
Tour Bel_Air Lausanne
Figure 19_En haut, vue depuis un appartement dans le dernier étage de la tour

Figure 20_En bas, vue de l’entrée de la tour

80
Structure et environnement Structure
Malgré une composition et une inspiration très classiques, la tour se dote des dernières techniques que le domaine de la construction peut offrir. La structure métallique de l’ouvrage d’au moins 2’000 tonnes d’acier est réalisée pour la plupart sur site avec des éléments soudés sur place. Cette manière de faire a permis aux travaux d’être particulièrement rapides et efficaces pour un bâtiment de cette ampleur.
La structure est directement liée aux affectations multiples de l’ensemble: dans les étages inférieurs, des profilés métalliques accueillent un plancher en béton tandis que dans les nombreux étages supérieurs destinés aux logements, les profilés accueillent quant à eux un plancher en bois plus léger permettant à la tour de s’élever avec plus de légèreté.
Bâtiment bientôt centenaire, les récents diagnostics effectués montrent que la structure est intacte, seuls sont nécessaires des travaux de remise en état des produits anti-corrosifs de la structure métallique.
Environnement
Les matériaux mis en œuvre pendant la construction étaient pour la grande majorité de qualité avec une durée de vie exemplaire. Seules des interventions ponctuelles ont été réalisées au cours des dernières décennies.
La récente grande rénovation a mis en lumière les problèmes de présence d’amiante dans la construction. Ce qui a fait l’objet de nombreuses interventions de désamiantage depuis 2014.
La tour semble pouvoir continuer son chemin d’icône de la construction Suisse pour les années à venir.
La tour et son rapport à la ville
81
Tour Bel_Air Lausanne

82
Figure 21_Vue du passage vers la rue des Terreaux depuis la rue de Genève
Tour modèle
La tour Bel-Air Métropole est un symbole fort en Suisse. Il nous apprend que l’implantation de la tour doit être justifiée et fortement réfléchie. Il est important de noter les différentes échelles abordées dans ce projet entre le rapport du socle à la ville immédiate et le rapport de la tour au paysage. Ces différentes échelles ne doivent pas être un frein aux interactions sociales du centre de la ville mais un levier d’actions pour la mise en place de programmes et de types d’appartements variés et pensés de concert avec l’orientation paysagère.
Tour Bel-Air
Vision territoriale modèle
Socle et rapport direct à la ville une interface entre deux niveaux de la ville
Programme & typologie mixité évidente mais manque de perméabilité
Structure pérennité et lien au programme
Environnement un bâtiment qui dure dans le temps
La tour et son rapport à la ville
83
Tour Bel_Air Lausanne
8
0
Tour d’Ivoire Montreux
La tour et son rapport à la ville
85

Figure 22_Publicité pour la ville de Montreux

Montreux
Montreux
20’000
15’000
2020 1900 1960
Evolution de la population à Montreux (source: Wikipédia)
90 ans
60 ans
25’000 30 ans
Pyramide des âges à Montreux 2020 (source: Wikipédia)
88
Contextualisation
La ville de Montreux est une ville peu peuplée. Avec une topographie peu évidente, son étalement urbain est très compliqué et réduit. En 1900, la ville comptait environ 14’000 habitants et elle augmente rapidement jusqu’à 18’000 en 1910. Cependant, la ville ne connaît pas d’augmentation significative de la population mais une perte de 4’000 habitants jusque dans les années 1960, période à laquelle la tour d’Ivoire sera construite dans une stratégie de publicité pour la ville de Montreux. On parle d’ailleurs de «nouveau souffle» pour la ville qui s’illustre en effet par les chiffres avec un retour aux chiffres que l’on connaissait en 1910 puis une augmentation jusqu’à 26’000 habitants aujourd’hui.
La population de Montreux est une population plus âgée que celle de Lausanne. Elle est d’ailleurs vieillissante et tire le portrait d’une ville plutôt calme qui n’est pas enclin au changement. Sa position géographique protège la ville de la bise et crée un micro-climat particulièrement doux qui fait souvent penser à la côte d’Azur dans le sud de la France. Cette côte montreusienne aussi composée par la ville de Vevey et la ville de La Tour-de-Peilz s’appelle aujourd’hui la Riviera.
On pourrait presque comparer la région avec la ville de Monaco. Cependant, aujourd’hui on reconnaît que les deux villes ne se ressemblent pas tant leurs densités d’habitants et de constructions sont différentes.
La tour et son rapport à la ville
89
Tour d’Ivoire Montreux
Plan de situation 1:10’000
90
Données
Date de construction Lieu de construction
Architecte Hauteur Densité
1964-1968 Montreux, Suisse Hugo Buscaglia
76 mètres, 26 étages élevée
«Élaboré dans un contexte de pénurie de logements et d’essoufflement économique et touristique»1, la tour d’Ivoire de Montreux est rapidement devenue un monument dans l’imaginaire montreusien.
Le contexte géographique et topographique de la ville pose des questions évidentes à propos de la forme urbaine à développer pour répondre aux besoins de la ville de Montreux. Ville implantée entre l’imposant flanc de montagne du Lavaux d’un côté et le grand lac Léman de l’autre. La question suivante se pose: comment garantir un espace public de qualité dans le centre ville tout en construisant suffisamment de logements dans ce contexte de pénurie? Pour l’architecte, la réponse est évidente, la tour est la seule forme urbaine qui dans son contexte géographique permet de «ménager en centreville une zone de verdure et une échapée sur le lac et les Alpes»2. D’ailleurs Hugo Buscaglia préconisait de multiplier l’intervention qui a fait l’objet de dérogations et de faire de la tour d’Ivoire un cas d’école. Ce qui ne fut pas le cas.
1Archives de Montreux, mars 2021, la Tour d’Ivoire : repas panoramiques, d’après une citation de MOSER, Patrick, BRIDEL, Adrien, 2019, De Bel-Air à Babel : un rêve de grandeur. Vevey : Call me Edouard, 2019, p. 89
2Archives de Montreux, mars 2021, la Tour d’Ivoire : repas panoramiques, p. 2
La tour et son rapport à la ville
91
Tour d’Ivoire Montreux

92
Figure 23_La tour d’Ivoire et son échaffaudage mobile pendant la construction
Vision territoriale
C’est avec une réponse de presque 80m de hauteur que Hugo Buscaglia place son bâtiment dans le paysage. Le projet est la seule tour qui s’inscrira dans le portrait et la skyline de la ville de Montreux. La tour va dépasser d’au moins 10 étages la plupart des bâtiments existants. Elle s’implante avec force et agit comme un point de repère de la côte du Lavaux scintillant grâce au crépis couleur «ivoire» issu de la volonté de l’architecte et dont le nom a été donné à la tour.
La tour s’oriente de manière évidente vers le cirque des Alpes et les côtes du Lavaux. Avec son caractère nautique élancé, elle propose une vue presque complète sur toute sa circonférence et laisse aussi apparaître des loggias sur les angles de la façade sud. Cette attitude contemplative est, et restera son atout majeur pour les décennies à venir.
La ville de Montreux décide de réaliser dans les derniers étages de celle-ci un restaurant qui permet aux touristes et habitants de pouvoir jouir de cette hauteur et d’utiliser la partie extérieure comme un belvédère artificiel faisant le tour du bâtiment. Dès lors, la ville de Montreux possède l’avantage de proposer de diner soit les pieds dans l’eau soit «la tête dans les nuages»1.
Coupe de la ville de Montreux
1La Tour d’Ivoire sans couronne, L’Est vaudois, 7 décembre 1996
La tour et son rapport à la ville
93
Tour d’Ivoire Montreux
Figure
24_Elévation
est de la tour
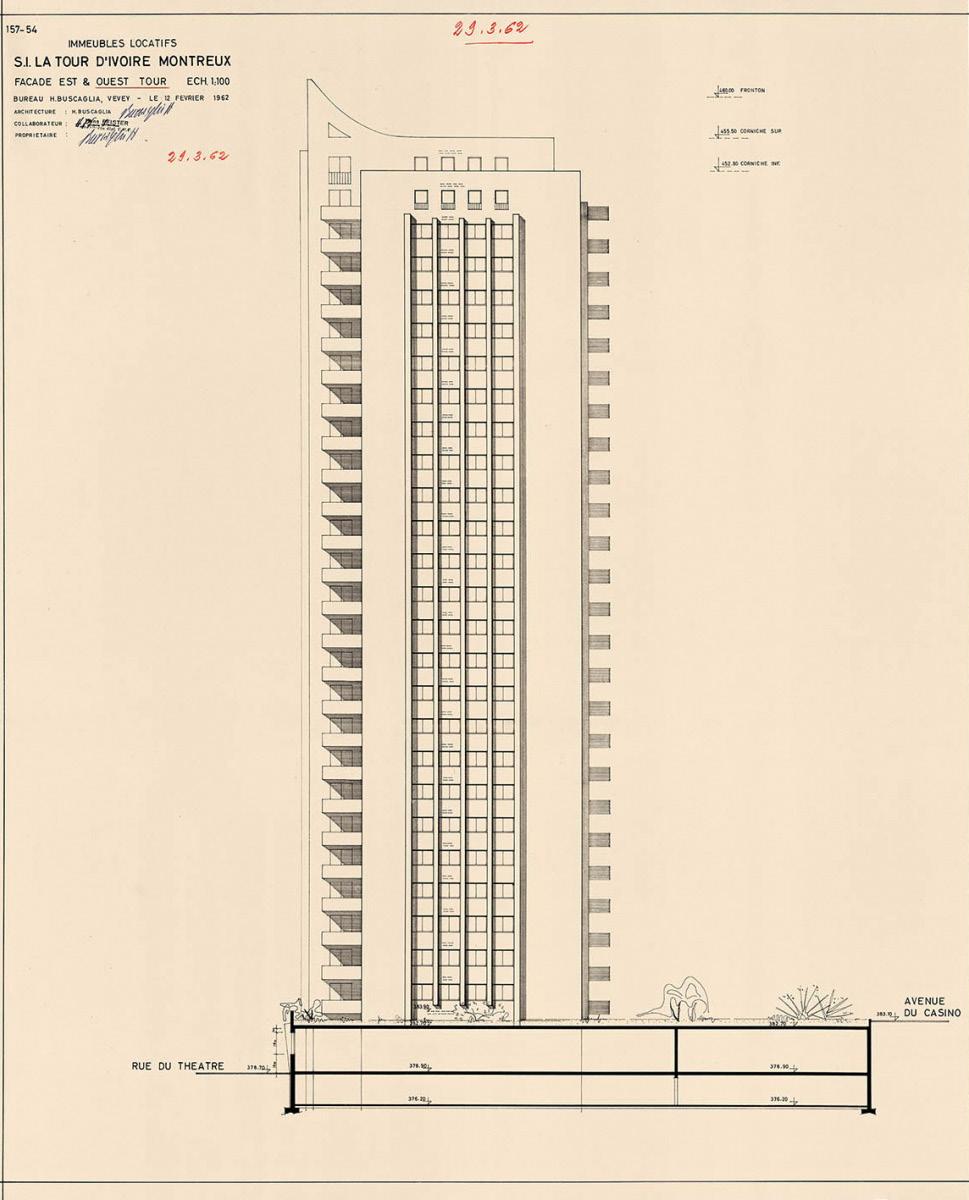
94
Socle et rapport direct à la ville
Une fois réalisée, la tour ne reçoit pas les éloges escomptés. Les montreusiens ne l’aiment pas et, lors du recensement architectural, la note de 7 lui est attribuée : «c’est la note qu’on donne par exemple à une station service construite à côté d’une église romane»1.
Le rapport à la ville est critiqué. Bien que la tour ait libéré une grande quantité d’espace public autour de sa base, cela ne semble pas suffire à configurer un espace public de qualité. En effet, l’entrée de la tour dont le programme est uniquement domestique s’effectue par une promenade et une percée sur le côté de la tour. Rien ni personne d’autre que les résidents ne sont invités à parcourir les abords de la tour. Ensuite, la façade de la tour, très linéaire et verticale semble se projeter à l’infini vers le ciel ou bien vers le sol.
Mais cette tour est aussi posée sur un socle habité fonctionnant sur deux niveaux: d’un côté, le niveau haut avec l’avenue du casino et un étage plus bas, une façade continue reprenant le front de la rue du Théâtre. Sur le socle, on retrouve les espaces de jardins qui mènent à l’entrée de la tour mentionnée précédemment.
La rue du Théâtre reste tout de même témoin d’une absence d’interactions. Les quelques commerces y résidant n’invitent pas le passant à jeter un coup d’œil et encore moins de s’y arrêter un instant.
Je dirais que le programme de la tour et sa nature fermée au rezde-chaussée supérieur a très largement contribué à la mauvaise réputation de la tour. Elle n’est finalement plus qu’un objet que l’on observe dont le rapport à la ville est limité à un rapport physique et visuel.
Un Monaco en Suisse pour relancer l’économie de la ville de Montreux? Pas si l’on a pas la chance de monter dans les premiers étages.
1Couleurs locales,La tour d’Ivoire à Montreux, 6 septembre 2022
La tour et son rapport à la ville
95
Tour d’Ivoire Montreux
Figure 25_Plan du 27ème étage

Figure 26_Plan du 25ème étage

96
Programme et typologie
Le projet ne comportait pas que la tour bien connue des montreusiens. De part et d’autres des flancs de la tour sont érigés deux autres bâtiments d’habitations de huit niveaux. Avec leurs balcons élancés adoptant un vocabulaire nautique également, ils relient idéalement les trois volumes ainsi pensés par Hugo Buscaglia.
Programme
Le programme est clair, seulement du logement, sauf dans le socle assurant le front de rue sur la rue du Théâtre et dans le dernier étage où avait ouvert un restaurant panoramique: Le Corsaire. Pour distribuer les logements, des ascenseurs sont mis en services ainsi qu’un monte-charge isolé permettant de contrôler les flux entre les habitants et les clients du restaurant. Situés dans le noyau central de l’ouvrage, ils assurent les va-et-viens de 24 étages de logements et du dernier étage de restauration.
Typologie
Aujourd’hui, la tour n’échappe pas à la règle de l’élitisme. Les plans sur la page de gauche montrent la récente rénovation d’un appartement en triplex dans la tour. Rayonnant, il bénéficie de tous les atouts que la tour peut offrir aux utilisateurs.
Le logement est né suite à la transformation du restaurant en appartement en 2006. Du même coup, la tour est surrélevée d’un étage.
La documentation des autres niveaux de la tour étant très pauvre, aucun plan d’étage type n’est communiqué.
La tour et son rapport à la ville
97
Tour
Montreux
d’Ivoire

98
Figure 27_Photographie du radier de la tour d’Ivoire pendant le chantier
Structure et environnement
Structure
La structure de la tour va être marquée dès le début du chantier et durant toute sa durée. Pendant la construction, la tour se dote d’un radier imposant pouvant supporter les 13’000 tonnes de construction verticale. La mise en place du fond de fouille et du ferraillage du radier représente déjà une immense infrastructure qui assurera la pérennité de l’ouvrage. L’autre prouesse technique est l’invention d’un nouveau type d’échafaudage qui s’élève en même temps que les étages de la tour sont bâtis. C’est le noyau central qui supporte l’échafaudage de la construction. La tour est également dotée d’une stucture antisismique, ce qui est complètement inédit dans l’architecture des années 1960 qui se contentait bien souvent du strict minimum pour construire rapidement et efficacement. D’ailleurs on dit souvent des constructions de cette époque qu’elles «vieillissent mal».
Environnement
Les matériaux de structure mis en œuvre sont exceptionnels et les travaux intérieurs sont tout autant soignés. Ce qui assure à la tour une longévité indispensable dans la construction de grande hauteur. Sa structure imposante a été réalisée en réponse aux contraintes imposées par le vent et les intempéries sur une construction de grande hateur. L’architecte s’était déjà sans doute saisi des conditions d’exemplarité dont la construction devait faire preuve pour faire face aux vives critiques qu’elle allait produire.
La tour et son rapport à la ville
99
Tour d’Ivoire Montreux
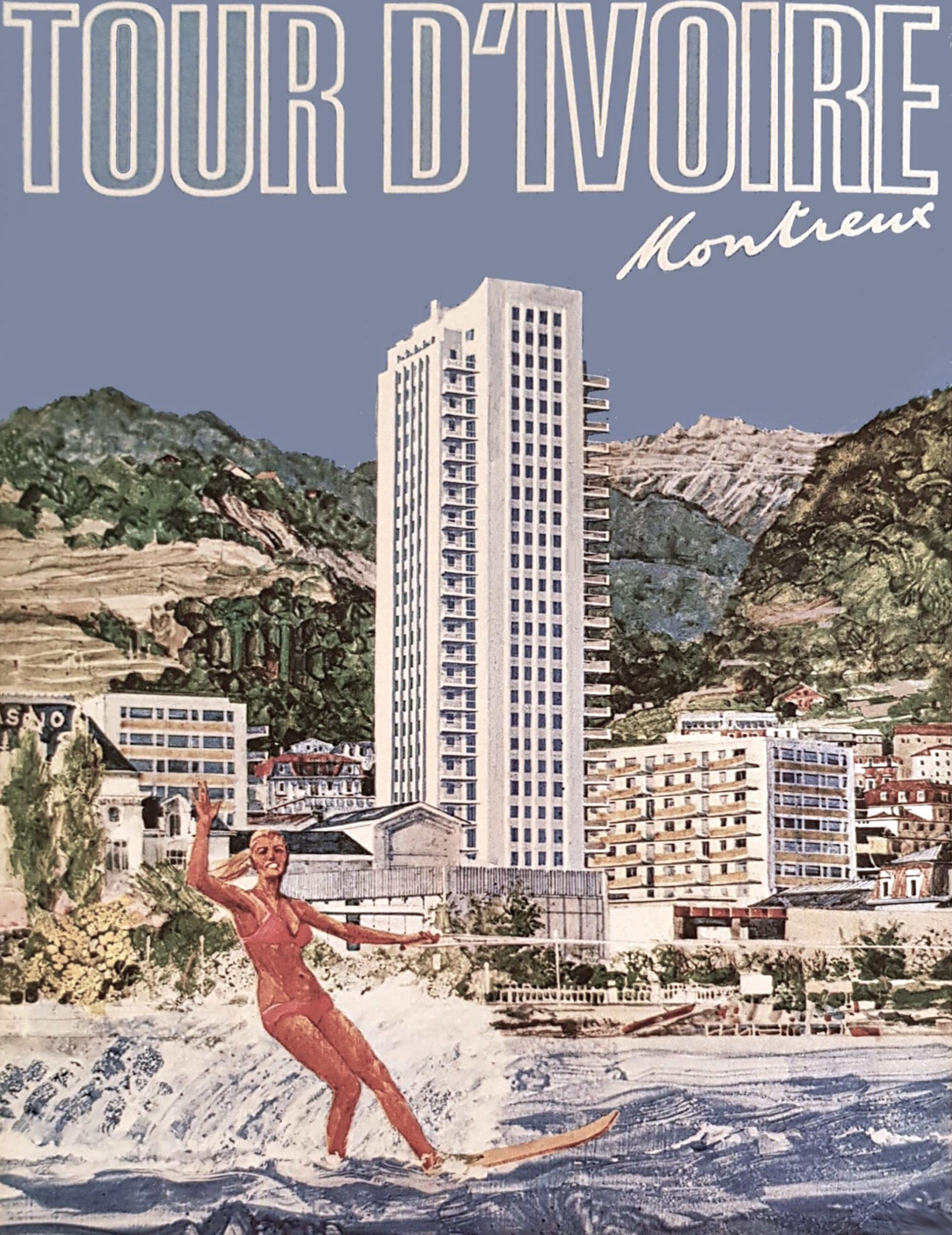
100
Figure 22_Affiche publicitaire pour la ville de Montreux
Nouveau souffle
La tour d’Ivoire est un cas particulier, elle est presque ce que l’on peut appeler un contre-exemple vis-à-vis du sujet de ce mémoire. En concevant un bâtiment qui doit être vu, Hugo Buscaglia et le plan de quartier en activité ont desservi les espaces publics directs de la ville autour de la tour. La tour occupe un rapport immédiat à la ville trop discret et presque caché, ce qui est causé par le manque de mixité, d’accessibilité et de perméabilité du rez-de-chaussée.
Tour d'Ivoire
Vision territoriale un bâtiment quoi voit et qui est vu
Socle et rapport direct à la ville un problème de programmation
Programme & Typologie une uniformité trop importante
Structure
l’ingénierie au service de l’architecture
Environnement un bâtiment qui dure dans le temps
La tour et son rapport à la ville
101
Tour d’Ivoire Montreux
0 8
Wolkenwerk Zürich
La tour et son rapport à la ville
103
Zürich
300’000
150’000
2020 1850 1930
Evolution de la population à Zürich (source: Wikipédia)
90 ans
60 ans
450’000 30 ans
Pyramide des âges à Zürich 2020 (source: Wikipédia)
106
Zürich
Contextualisation
On peut dire que la ville de Zürich a connu la croissance démographique la plus forte de toute la Suisse. Avec environ 40’000 habitants au début des années 1850, la ville croît fortement et s’étale d’autant plus avec la ville de Winterthour très proche. La ville atteint un niveau historique en 1960 avec 440’000 habitants. Nombre d’habitants qui n’est toujours pas atteint aujourd’hui avec un exode rural important dès les années 1960-1970. On compte aujourd’hui, environ 433’733 habitants dans la ville de Zürich.
On reconnaît que cette forte croissance a lourdement impacté la production architecturale de la ville avec la construction de nombreux ensembles de logements entres les années 50 et 80. Des ensembles parfois composés par des tour comme celles de Hardau en 1978. Avec la production de ces ensembles, cette partie de la suisse alémanique s’est inconsciemment dotée d’une grande culture de la construction et de la réalisation de projets d’architectures comme les tours. Ils constituent alors des atouts et s’implantent très tôt dans la culture des habitants du canton et plus largement de la Suisse alémanique.
Comme toutes les grandes villes Suisses, Zürich attire les jeunesses et une part de la population plutôt jeune. Avec des institutions comme l’ETHZ (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich) ou l’université de Zürich, la ville forme et représente une capitale économique et universitaire très importante.
Zürich est une ville très cosmopolite, on compte environ 30% d’étrangers, pourcentage élevé mais toujours très loin son homologue romande Genève (41%).
La tour et son rapport à la ville
107
Wolkenwerk Zürich

Figure 28_Ensemble Wolkenwerk

Plan de situation 1:10’000
110
Données
Date de construction Lieu de construction
Architecte Hauteur Densité
2017-2020 Zürich, Suisse
von Ballmoos Partner Architekten, Staufer & Hasler Architekten
53-71 mètres, 17-22 étages Elevée
Von Ballmoos Partner Architekten et Staufer & Hasler Architekten construisent un ensemble dans une ville où ils sont déjà beaucoup intervenus. Ils élaborent à l’aide d’un PLQ (plan de quartier) un quartier périphérique au nord de Zürich dans lequel il est décidé de planifier le développement autour d’un «couloir vert» composé notamment par le Andreas Park. Il en ressort très rapidement que dans le quartier de Leutschenbach, «on peut développer des constructions denses et hautes»1
La vocation même du nouveau quartier est celle de créer un nouvel espace public qui est un «lieu auquel les habitants de la ville peuvent s’identifier et se sentir connectés»2. En ce sens l’addition de cette proposition avec celle de l’implantation de tours est un paralèlle parfait entre le besoin de densification d’une région périphérique de Zürich et une région comme la périphérie de Genève. Cette stratégie semble pouvoir s’appliquer aux quartiers en développement à Genève comme le quartier du PAV avec des nouveaux centres composés par des îlots d’urbanité.
1Hochhäuser Wenn Türme im Team spielen 2Hochhäuser Wenn Türme im Team spielen
La tour et son rapport à la ville
111
Wolkenwerk Zürich

112
Figure 29_Vue extérieure des îlots
Vision territoriale
Le site a besoin de se développer dans un contexte urbain dont la densité apparente se doit d’être modérée. Ainsi, le contexte spatial et paysager de l’espace public est primordial.
La réponse que donnent alors les bureaux von Ballmoos Partner Architekten et von Staufer & Hasler est un ensemble de quatre tours disposées sur des grands socles. Trois de ces tours sont destinées au logement tandis que la dernière (la plus au sud de l’ensemble) est destinée aux bureaux.
«Si vous vous promenez dans le quartier, les tours sont des protagonistes à certains endroits, juste un indice à d’autres, elles n’apparaissent jamais comme des monuments mais sont toujours intégrées dans l’ensemble»1
En résulte alors, dès les premiers étages de tour un nouvel espace public se dessinant dans la ville. Plus libre et moins dense grâce à la différence de hauteur des tours, il donne un second souffle au quartier et un caractère figuratif qui lui permet à l’échelle de la ville de se forger une identité sortant de l’ordinaire.
A l’échelle de l’ensemble, les quatres tours dialoguent entre elles. Elles n’ont pas la même orientation. En effet, les quatre rectangles pivotent selon leur position et leur rapport au socle. La répétition des émergences ne crée pas de sérialité mais un tout dans lequel chaque élément possède une relation unique face au paysage et à ses voisins.
Skyline d’un quartier de la ville de Zürich Ensemble Wolkenwerk au centre
La tour et son rapport à la ville
113
Wolkenwerk Zürich
1Werk, bauen+wohnen, Hochhäuser 12-2021

114
Figure 30_Coupe longitudinale sans échelle
La tour et son rapport à la

115
ville Wolkenwerk Zürich
Figure 31_Plan du rez-de-chaussée sans échelle
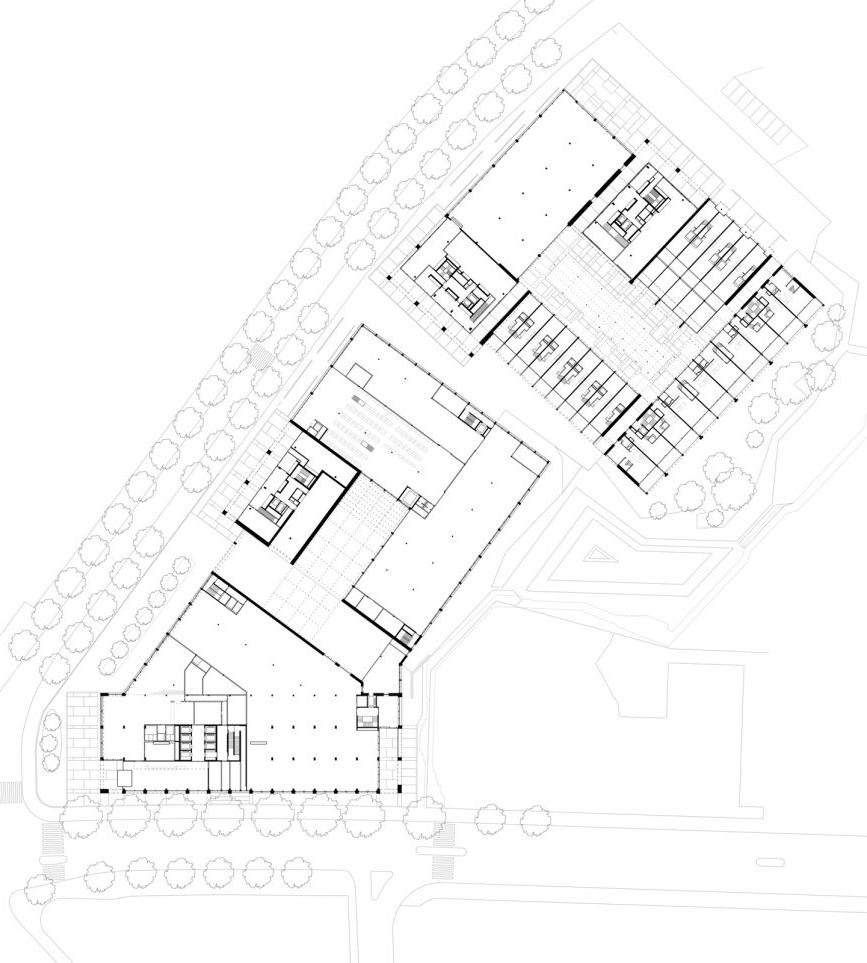
116
Socle et rapport direct à la ville
Le projet de Wolkenwerk prend à cœur de connecter ses tours à l’espace public direct. Les socles des différents bâtiments correspondent au caractère du quartier de Leutschenbach comme une zone en développement dans laquelle les besoins sont la mixité des usages.
Pour cette raison, les socles adoptent un rapport direct et font front aux rues. Il sont investis par une multitude d’acteurs différents: ateliers, studios, magasins, restaurants, commerces...
De cette manière les espaces du rez-de-chaussée sont complètement utilisés par les acteurs du quartier et les habitants de l’ensemble.
Les socles sont aussi composés de grands halls libérés de toute structure linéaire permettant de créer des grands espaces utiles intérieurs. Ces halls de grande hauteur communiquent directement avec l’espace public extérieur grâce à leurs dimensions importantes et leurs rapports d’échelles. C’est l’usine de ferrures Nyffenegger qui loge dans ces grands halls et qui joue un rôle central dans la mise en valeur des activités du lieu. Avec entrepôts, usines de fraisage et de percement de bronze et de laiton, l’entreprise avait tenu à garder un rôle prépondérant dans l’activité du lieu (lieu dans lequel elle était déjà présente avant les nouveaux projets de construction).
La matérialité des socles joue un rôle important dans le rapport de l’ensemble au quartier et au sol. Réalisé avec des passages qui mènent aux centres des îlots, les façades de ces premiers niveaux sont réalisées avec un remplissage de briques de clinker situé entre les ossatures porteuses visibles en béton. Ainsi, le projet s’installe dans l’histoire du lieu et fait référence aux bâtiments commerciaux existants dans les années 1940.
La tour et son rapport à la ville
117
Wolkenwerk Zürich
Figure 32_Plan de l’étage type sans échelle

118
Programme et typologie
La grande mixité du programme développée et pensée en même temps que l’élaboration des typologies du projet a permis au rezde-chaussée d’être un tout vivant et fortement lié à la ville. Il est du même coup fortement lié aux quatre émergences dans lesquelles on retrouve le programme de logements pour les trois tours plus au nord et de bureaux pour la tour la plus au sud.
Richesse typologique
La richesse se ressent entre les différents niveaux. Ainsi tous les types d’habitants peuvent trouver un appartement convenable dans l’ensemble des bâtiments construits: grande ou petite famille, célibataire, couple, personne aisée ou moins. On retrouve les qualités de vivre «près du sol» comme des maisonnettes avec accès à des jardins privés au cœur de l’îlot au nord et des vues directes sur les espaces verts produits par le plan de quartier, les qualités de vivre avec un balcon d’angle dans les étages intermédiaires et enfin les qualités de profiter de vues rayonnantes dans les étages les plus élevés des trois tours de logement. Cette manière de concevoir la tour et son socle permet de créer une plus petite ville dans l’enveloppe de la construction, la population y est mixte et devient alors intéressante.
Cette population est invitée à se retrouver dans les jardins communaux pensés par les architectes et les architectes paysagistes. Grâce à l’élaboration de jardins en toiture des socles, les habitants vivent et se rencontrent à l’extérieur de leur logement mais toujours dans leur propre «micro-ville» dans laquelle tout le monde peut alors se connaître ou du moins se reconnaître.
La tour et son rapport à la ville
119
Wolkenwerk Zürich


120
Figure 33_En haut, vue depuis la loggia d’un appartement de la tour Figure 34_En bas, vue d’un grand espace commun
Structure et environnement
L’ensemble du projet est réalisé avec une structure ponctuelle massive en béton armé. Des grands noyaux organisent et soutiennent les niveaux de tour et les socles sont produits avec une structure ponctuelle de grande portée. Libérant ainsi des grands halls de production et des espaces modulables réversibles pour les commerces, restaurants, bars... L’entrée des tours est aussi marquée par la structure ponctuelle avec un léger retrait de la façade au rez-de-chaussée. En revanche, on retrouve une structure linéaire et plus soutenue dans l’îlot nord composé par les logements au rez-de-chaussée.
L’environnement au service du projet
Le concept de végétation se base sur la «stratification verticale de la forêt»1. Des grands arbres se réfèrent à la dimension de la construction et ressemble dans les proportions aux grands halls proposés au rezde-chaussée tandis qu’une strate arbustive et plus diversifiée «réagit à l’échelle humaine et introduit des éléments et des mises en scène horticoles»2.
Avec cette méthode, le jeu d’échelle intervient aussi dans la conception des espaces verts extérieurs, elle met en relation la nature et la construction en intégrant des éléments de dimensions et de natures variées.
L’environnement s’invite aussi dans la structure et les espaces construits du projet. Les socles produits sont investis par des terrasses vertes irriguées par l’eau de pluie captée par les grandes surfaces de toiture des tours et des socles. Le surplus de l’eau ruisselle ensuite le long des toitures, pour se jeter dans un grand bassin d’eau du parc public.
La tour et son rapport à la ville
121
Wolkenwerk Zürich
1&2 LANDEZINE, WolkenWerk, Leutschenbach Zürich

122
Figure 35_Vue de l’ensemble Wolkenwerk, au premier plan le socle et ses logements
Le projet de Wolkenwerk tire ses forces et ses qualités des jeux d’échelles qu’il impose et crée. Composition entre le socle et la tour, composition entre le lieu de travail et le lieu de vie ou encore composition entre pièces de petite échelle ou pièces de très grande échelle. Il fonctionne de manière intelligente avec le programme mixte et éparpillé dans le quartier et fonctionne d’autant plus que les tours proposent une diversité évidente des lieux de vie et donc une grande variété d’individus.
Wolkenwerk
Vision territoriale paysage figuratif et jeux d’échelles
Socle et rapport direct à la ville mixité, diversité et jeux de volumes
Programme & Typologie quand le public rencontre le privé, il crée le commun
Structure clareté et réversibilité
Environnement intégration des ressources naturelles
La tour et son rapport à la ville
123
Wolkenwerk Zürich
Jeux d’échelles 0 8
Zölly Tower Zurich
La tour et son rapport à la ville
125

Figure 36_Zölly Tower

Plan de situation 1:10’000
130
Données
Date de construction Lieu de construction
Architecte Hauteur Densité
2009-2014 Zürich, Suisse Meili Peter Architekten 77 mètres, 23 étages Modérée
Le bureau Meili Peter Architekten propose ses services dans le domaine de l’architecture depuis 1987. Avec une œuvre orientée au début sur des expérimentations, des ponts et des décors de films, le bureau tient une base solide pour développer des projets soutenant les valeurs des liens sociaux et des relations et interfaces entre les habitants.
La Zölly tower s’inscrit dans la continuité de cette recherche de liens avec le plan de quartier et au sein même de la tour avec les recherches typologiques des appartements.
Le quartier City West de Zürich est en forte mutation depuis maintenant plusieurs années. Autrefois lieu de l’industrie avec sa proximité des voies de chemin de fer, il est aujourd’hui une composante de la stratégie de développement de la «ville à 15 minutes».
Zürich prévoit de dépasser les 500’000 habitants durant ces vingt prochaines années, et ce quartier sera l’un des nouveaux centres de la ville tout comme l’est le quartier de Leutschenbach.
La tour et son rapport à la ville
131
Tower Zürich
Zölly

132
Figure 37_Photographie de la Zölly tower au premier plan
Zölly Tower Zürich
Vision territoriale
La Zölly tower est la toisième tour du quartier à sortir de terre. Avec la Mobimo tower de Diener & Diener (2011) et la Prime tower de Gigon Guyer (2011) elle compose le nouveau quartier et borde le Am Pfingstweidpark. Les tours de hauteur similaires mais pas identiques offrent un repère depuis les voies de chemins de fer d’une part et depuis la Pfingstweidstrasse d’autre part, voies principales d’accès au centre de la ville. Elles s’inscrivent aussi avec les plus anciennes tours de Zürich Hardau de 1978 construites dans un contexte de pénurie de logements pour les familles en besoin de la ville de Zürich (au second plan de l’image sur la page de gauche).
L’objectif de l’ensemble conduit par ces architectes est «de donner au nouveau lotissement l’image d’un quartier résidentiel urbain dense, mais doté de sa propre identité»1
La Zölly Tower est la plus petite tour du trio avec ses 77 mètres contre 81 pour la Mobimo Tower et 126 pour la Prime Tower.
Les tours se font face avec des gabarits similaires et des formes polygonales, identité des bâtiments du quartier et de même langage que les barres pliées réalisées du même temps par Meili Peter Architekten. Ils sont alors rapidement qualifiés de prisme.
Skyline de la ville de Zürich à gauche City West, à droite les tours de l’ensemble Hardau
La tour et son rapport à la ville
133
Figure 38_Coupe de la Zölly tower, demi-niveaux et distribution

134
Socle et rapport direct à la ville
La tour est composée par un corps de 21 étages et un socle de 2 niveaux dépassant légèrement sur la place. Les espaces intérieurs communiquent avec la nouvelle place d’un côté et le parc de l’autre.
L’ombre portée de la tour a un impact minimal sur le quartier. Grâce à son implantion au sud du Pfingstweidpark, l’ombre portée de la tour ne dérange aucune habitation ou volume construit. En revanche, elle procure un ombrage agréable l’été sur la surface verte du parc.
Les deux niveaux de rez-de-chaussée sont légèrement extrudés du volume de la tour au sud-est. Elle n’a pas de socle à proprement parlé. Mais, ce mouvement donne une impression de volume dédié à un programme différent qui fait le lien avec l’espace public extérieur et les cheminements piétons. La tour est posée sur le sol commun et minéral du quartier, composante principale du plan de quartier, permettant de lier les bâtiments et leurs programmes entre eux.
Selon moi, le rapport direct n’est pas favorisé par la monofonctionnalité de la tour. Il existe un lien fort entre le privé et le commun mais pas vraiment avec l’aspect public. De plus, chaque espace du rez-dechaussée est intelligement compartimenté, ce qui ne favorise pas les interactions visuelles et physiques.
La tour et son rapport à la ville
135
Tower Zürich
Zölly
Figure 39_Plan étage type

Figure 40_Plan rez-de-chaussée

136
Programme et typologie
Le programme de la tour est simple: un rez-de-chaussée en double hauteur composé d’espaces communs, d’une généreuse entrée vers les logements, un important espace pour stocker les vélos et, à l’ouest les premiers logements en duplex. On note une certaine monofonctionnalité et une stratégie de mixité du quartier plutôt par juxtaposition.
Le raumplan dans la tour
Les logements sont desservis par une cage d’escalier principale composée de trois ascenseurs et d’une cage d’escalier secondaire assurant les mises aux normes de voies de fuite en cas d’incendie. Comme vu sur la coupe à la page précédente, la tour travaille la notion de l’habitat sur plusieurs niveaux. Comme le ferait le Raumplan développé par l’architecte autrichien Adolf Loos. Les pièces ont ainsi des niveaux et des hauteurs différentes selon leur fonction. C’est pourquoi les séjours sont abaissés et donnent lieu à des espaces en double hauteur de 3m60 à 4m60 de hauteur. Cette stratégie peut être répétée un grand nombre de fois (six fois) grâce à la nature évidente de la tour comme élément vertical. La façade révèle ces différences de niveaux programmatiques avec des bandeaux qui se répètent en façade. Ce sont les les bandes verticales qui font le lien entre la stucture et le choix d’expression de la typologie.
Dans les trois derniers niveaux, la typologie change et permet un brassage des types d’appartements. Le système offre donc un catalogue plus important de logements et donc une plus grande mixité.
On peut dire que le prisme formé par la tour permet d’offrir aux appartements une orientation supplémentaire, élément primordial dans l’élaboration d’une tour.
La tour et son rapport à la ville
137
Zölly Tower Zürich

138
Figure 41_Plan appartement type sans échelle
Figure 42_Plan appartement type sans échelle
 Zölly Tower Zürich
Zölly Tower Zürich
La tour et son rapport à la ville
139
Figure 43_En haut, vue du séjour en double niveau
Figure 44_En bas, vue d’une loggia d’un appartement avec vue sur l’ensemble Hardau


140
Structure et climat
La tour s’inscrit dans les modèles de constructions standards et nécessaires que nous avons l’habitude de concevoir aujourd’hui. Avec des préoccupations en terme de dépense d’énergie grise, de coûts et d’exemplarité dans l’entretien et la durée de vie des bâtiments.
Préfabrication
La tour adopte un mode de construction standard dans la réalisation de la structure porteuse intérieure.
En revanche, les éléments de façade de la tour ont été réalisés avec plus de complexité. S’agissant de panneaux sandwich composés de la structure porteuse, de l’isolation puis du parement en béton sablé, l’ensemble a donc été préfabriqué avant d’être assemblé à la construction sur site. L’élément statique fait donc l’objet de grandes réflexions autour de la transmission des charges et des vibrations qu’une tour peut subir.
Sa préfabrication lui aura permis d’exprimer des formes plus plastiques et d’exploiter la nature «malléable» du béton coulé.
La tour à la recherche de label
La tour est dotée du Label Minergie-ECO qui atteste de la réussite de son concept énergétique et environnemental. Le bâtiment est exemplaire dans les domaines de la distribution de lumière du jour, de la dépense d’énergie grise ainsi que de la modernisation des systèmes mis en place dans le bâtiment.
Elle est reliée au réseau de chauffage urbain de la ville de Zürich lui fournissant 70 à 80% de l’énergie nécessaire au chauffage des logements. Elle est aussi reliée à un réseau de chauffage par les eaux souterraines.
La tour et son rapport à la ville
141
Tower Zürich
Zölly
Figure 45_Partie basse d’un appartement

142
Repère d’entrée
La tour Zölly s’inscrit dans la stratégie de développement de Zürich. Conçue à la périphérie de la ville dans des grands quartiers proches des voies de chemin de fer, elle fait partie des éléments de repère qui marquent l’entrée de la ville.
La diversité typologique tend à augmenter la diversité et la mixité qui n’est pas catalysée par la diversité programmatique.
Les modes de construction astucieux et les soucis d’exigences environnementales élevées placent la tour dans une famille de bâtiments exemplaires.
Vision territoriale repère et point d’entrée de la ville
Socle et rapport direct à la ville un sol commun
Zölly Tower
Programme & Typologie la typologie au service de la mixité
0 8
Structure préfabrication de la façade
Environnement l’exemplarité par le label
La tour et son rapport à la ville
143
Tower Zürich
Zölly
Tour Bel-Air, Lausanne
Vision territoriale modèle
Socle et rapport direct à la ville une interface entre deux niveaux de la ville
Programme & Typologie mixité évidente mais manque de perméabilité
Structure pérennité et lien au programme
Environnement un bâtiment qui dure dans le temps Tour d'Ivoire
Tour d’Ivoire, Montreux
Vision territoriale un bâtiment quoi voit et qui est vu
Socle et rapport direct à la ville un problème de programmation
Programme & Typologie une uniformité trop importante
Structure l’ingénierie au service de l’architecture
Environnement un bâtiment qui dure dans le temps
144 Tour Bel-Air
0 0 8 8
Wolkenwerk, Zürich
Vision territoriale paysage figuratif et jeux d’échelles
Socle et rapport direct à la ville mixité, diversité et jeux de volumes
Programme & Typologie quand le public rencontre le privé, il crée le commun
Structure clareté et réversibilité
Environnement intégration des ressources naturelles
Vision territoriale repère et point d’entrée de la ville
Socle et rapport direct à la ville un sol commun
Programme & Typologie la typologie au service de la mixité
Structure préfabrication de la façade
Environnement l’exemplarité par le label
Zölly Tower
0 0
La tour et son rapport à la ville
145
Wolkenwerk
Zölly Tower, Zürich 8 8
Conclusion intermédiaire
On note que les évaluations effectuées en fin de chaque analyse ont mené à différentes conclusions. Chaque projet possède des atouts différents qui font la force des tours étudiées mais ne suffisent parfois pas à satisfaire tous les critères qu’une tour doit remplir pour justifier son implantation.
Vision territoriale
L’hypothèse que la tour, de par sa nature possède des qualités territoriales intrinsèques est validée. Il semble que les tours seules possèdent un potentiel de marqueur territorial plus important que dans le cas d’un groupe de tours. Cela est causé par la radicalité de l’intervention qui pousse une tour seule à être un message plus «fort» qu’un groupe de tours qui dialoguent déjà entre elles.
Socle et rapport direct à la ville
La première clé de résolution du rapport direct à la ville est l’ouverture physique du rez-de-chaussée à la rue. Ensuite, c’est la programmation de ses espaces qui le rendra attractif et pertinent. Une tour comme la tour d’Ivoire écoppe d’une note de 1/8 alors qu’un socle composé et programmé comme celui du Wolkenwerk écoppe d’une note de 7/8.
Programme & typologie
Le programme est la clé des interactions entre la ville et le bâti, l’espace public et l’espace privé. Il constitue l’interface des interactions et devient générateur des rencontres et donc de la vie dans la grande ville.
La variété des types d’appartements est aussi un facteur de diversification et d’intensification des rencontres.
Structure et environnement
La structure doit permettre de lire et de lier clairement les espaces. Dans les cas étudiés, elle est composée de structures ponctuelles. Enfin, les tours et leur socle ainsi que le quartier dans lequel ils s’implantent doivent fonctionner avec un modèle environnemental abouti et exemplaire. Les labels sont un bon outil d’évaluation.
La tour et son rapport à la ville
147
Choix du site d’étude
La tour et son rapport à la ville
149
Choix du site d’étude
Durant mon second stage en architecture dans le bureau Frei & Stefani SA, j’ai pu participer à l’organisation de concours pour la ville de Genève comme celui de la rade de Genève en ou celui de Bachet-de-Pesay en 2017. Depuis, j’ai toujours entretenu un intérêt particulier pour les concours d’architecture et d’urbanisme dans la ville de Genève. Ainsi, le développement des quartiers périphériques de Genève m’intéresse d’autant plus.
Le choix du site est lié à une prise de position urbanistique et à l’établissement d’une série de règles pour définir le site d’intervention. Il conviendra alors de développer la notion d’îlot d’urbanité à Genève et de comprendre le développement actuel et futur de la ville.
Les tours à Genève
Liée à la modernité une série de tours a vu le jour un peu partout dans Genève. Elles ont un rapport direct à la modernité et au développement économique de la ville (nous verrons cela dans la bibliothèque de tours dans les pages qui suivent).
De nos jours, Genève se développe comme une ville dotée de plusieurs nouveaux centres. Le projet du PAV est un exemple de ce développement urbanistique qui compose avec des nouveaux quartiers et des nouveaux centres.
Les îlots d’urbanité
En ces nouveaux centres se développent des tours qui s’affichent comme des points de repère dans la ville. Leur rôle se développe alors directement avec l’espace public de la ville.
La tour et son rapport à la ville
151
Genève
Genève
133’332
66’666
2020 1850 1930
Evolution de la population à Genève (source: Wikipédia)
90 ans
60 ans
200’000 30 ans
Pyramide des âges à Genève 2020 (source: Wikipédia)
154
Contextualisation
La ville de Genève a une histoire mouvementée qui participera à son développement particulier, international et diversifié. Avec une population déjà élevée dans les années 1850 (environ 37’000 habitants), Genève se développe grâce aux industries et au passage de routes commerciales venant de France et d’Italie. Avec un rapport au lac d’abord industriel, la rade de Genève se développe ensuite avec les nombreux hôtels de luxe quand le lac devient un objet de fascination. La ville atteint 126’000 habitants dans les années 1920 et la population se stabilise jusque dans les années 60 pour arriver au nombre de 172’000 habitants. L’exode rural fait perdre à la ville environ 20’000 habitants qui ne tarderont pas à être de retour pour arriver aujourd’hui au nombre d’environ 204’000 habitants en 2021.
La Genève internationale, comme Zürich constitue une ville où l’économie est florissante. Le coût de la vie y est très élevé et la densité de construction l’est tout autant. La pyramide des âges montre une forte présence de personnes âgées de 35 à 60 ans. Ils représentent une part élevée de la population active à Genève dont le pouvoir d’achat est relativement élevé et cherchera donc à acheter ou louer des biens immobiliers de valeur élevée.
On peut dire que Genève se caractérise aussi par sa proximité avec les villes françaises et fonctionne beaucoup avec l’économie frontalière, ce qui renforce son caractère cosmopolite et international.
Par exemple, Carouge, ville appartenant autrefois au royaume de Piémont-Sardaigne (en 1401) puis à la France (en 1792), est un témoin de cette diversité des quartiers et des habitants et de l’activité étendue du Canton romand.
La tour et son rapport à la ville
155
Tours de l’Etoile et PAV Genève
Bibliothèque de tours
La tour et son rapport à la ville
157
Tour de Rive 1935
Marc-Joseph Saugey 31 mètres Faible Plan de situation 1:10’000
158
Tours de Carouge
1958-1973
Georges Brera et Paul Waltenspühl 45 mètres Elevée
Plan de situation 1:10’000
La tour et son rapport à la ville
159
Hôtel intercontinental 1961-1967
Georges Addor 50 mètres Elevée
Plan de situation 1:10’000
160
Tour de la RTS
2018-2020 Arthur Bugnat 60 mètres Elevée
Plan de situation 1:10’000
La tour et son rapport à la ville
161
Tours du Lignon
1966-1969
Georges Addor 91 mètres Elevée
Plan de situation 1:10’000
162
Tours de Lancy
1961-1965
Jean-Marc Lamunière 45 mètres Modérée
Plan de situation 1:10’000
La tour et son rapport à la ville
163
Tours de Meyrin
2013-2019
Aeby Perneger & Associés SA | Groupe H 40 mètres Modérée
164
Plan de situation 1:10’000
Lyon 77 2016-2020
3BM3 Atelier d’architecture SA 45 mètres Modérée
Plan de situation 1:10’000
La tour et son rapport à la ville
165
Tour Opale
2018-2020
Lacaton & Vassal 60 mètres Elevée
Plan de situation 1:10’000
166
La tour et son rapport à la
167
ville
Tours de l’Etoile 2013-2015
(concours)
Pierre Alain Dupraz Architectes 175 mètres Très élevée
168
Plan de situation 1:10’000
Pointe nord 2017-2018 (concours)
DL-A, designlab-architecture, Bruno Marchand 60 mètres Très élevée
Plan de situation 1:10’000
La tour et son rapport à la ville
169
Tours de l’étoile et projet du PAV, Genève
Vers le choix d’un site de projet
La tour et son rapport à la ville
171

Figure
46_Quartier de l’Etoile


174
Figure 47_Image de synthèse pour le concours de l’Etoile, 1er prix
Stratégie de la ville de Genève Territoire et urbanisme
La ville de Genève, bien que faisant partie des plus grandes villes de Suisse comme Zürich ou Bâle adopte des stratégies de développement urbain différentes. Avec une ville comme Bâle qui produit des tours qui servent les intérêts des grands acteurs ou la ville de Zürich qui produit des tours dans des anciens quartiers industriels proche des voies de chemin de fer, Genève oriente son développement avec la ramification de ses communes alentours et la mise en valeur de sa situation avec un pays frontalier.
Plan directeur cantonal 2030
À cette échelle, le canton a mis en place une stratégie d’intervention visant à «proposer un projet de territoire qui respecte l’équilibre entre le développement des activités humaines et une gestion durable du territoire. Il s’agit d’offrir une réponse aux besoins en logements, activités, mobilité, équipements, services, loisirs et espaces publics, tout en préservant et valorisant patrimoine bâti, paysager et naturel, les terres cultivables et la qualité de vie.»1.
Les nouveaux projets à Genève
Au travers de cette vision, on retrouve des projets de quartiers comme le PAV ou encore les projets Belle-Terre à Thonex et l’écoquartier des Vergers à Meyrin en développement en ce moment même. Très identitaires comme le décident les plans localisés de quartiers associés, ils ont la capacité d’être des centres attractifs pour les habitants et travailleurs et font ainsi l’objet de connexion aux réseaux de communication et de transports de la ville.
1ge.ch, Plan directeur cantonal 2030, paragraphe 3
La tour et son rapport à la ville
175
Tours de l’Etoile et PAV Genève
SNCF - direction France
CFF - direction Lausanne
Lancy - Pont Rouge Carouge - Bachet
Gare Cornavin
Croquis du réseau de communication du CEVA
Champel - Hôpital
SNCF - direction EVIAN SNCF
Genève - Eaux-vives Chêne-Bourg Annemasse
176
Stratégie de la ville de Genève Réseaux de communication
Certains aspects et quartiers de la ville de Genève se développent de concert avec le projet de réseau de communication du CEVA. Il a pour objectif de relier les différents quartiers et gares de Genève autour desquels on retrouve des quartiers en fort développement. Appelés dans ce document les nouveaux «îlots d’urbanité». Il relie aussi des villes frontalières comme Annemasse et devient alors un projet de réseau transfrontalié.
La ville se développe aussi de manière importante à l’intérieur de ses frontières avec les réseaux de transport des TPG (transports publics genevois).
Vers une disparition de la voiture?
Le développement se base sur la raréfaction de l’usage exclusif de la voiture dans la ville de Genève. En effet le nombre des usagers se servant uniquement de la voiture à Genève est passé de 21% en 1994 à 8% en 2018. Cette stratégie vise donc une multiplication des réseaux de transports commun.
Le besoin d’appartenance
Sociologiquement, l’homme a besoin de se sentir connecté et d’appartenir à une communauté. C’est ce qui semble se passer avec la multiplication des interactions dans les quartiers d’habitat coopératif et l’utilisation des réseaux sociaux. Les nouveaux quartiers doivent donc garantir un rapport aux environs et voisins important et donc un rapport à la ville.
Il va de soi que les dispositifs architecturaux à mettre en œuvre sont à l’appréciation du projeteur et du site d’intervention.
La tour et son rapport à la ville
177
Tours de l’Etoile et PAV Genève
Plan de situation
1:10’000
178 GSEducat ona Vers on
Tours de l’Etoile Données
Date de concours Lieu de concours
Architecte Hauteur Densité
2013-2015 Genève, Suisse Pierre Alain Dupraz Architectes
175 mètres (données concours) très élevée
Les grandes tours de l’Etoile s’inscrivent comme élément majeur du développement du nouveau quartier du PAV (Praille-Acacias-Vernets) à Genève. Défini comme une «nouvelle centralité métropolitaine», le quartier se développe avec le croisement de l’Etoile et se veut devenir «un quartier fonctionnant sur un mode 24h/24h, sept jours sur sept»1
Les tours appelées «tours XL» naissent grâce à une combinaison de morphologies composant ce nouveau quartier. Les tours sont donc composées de socles, corps multiples et couronnements. Elles agissent comme des repères et dialoguent naturellement entre elles et avec leur cinq autres voisines de taille moyenne et petite (voir photographie de maquette p.186).
La tour et son rapport à la ville
179
1
Tours de l’Etoile et PAV Genève
Figure 48_Vue du croisement de l’Etoile

Figure 49_Skyline de la ville de Genève

180
Vision territoriale
La morphologie lauréate propose un premier gabarit composé de quatre îlots de 30 mètres de hauteur reprenant la géométrie des routes et des rues et au passage le PLQ (plan localisé de quartier). L’ensemble est articulé par un total de sept tours de hauteurs très différentes qui signalent les voies principales (la route des Acacias, l’avenue de la Praille et les voies ferroviaires au sud). Chaque îlot est composé au nord par une tour de 76 mètres. Cela permet d’éviter les nuisances causées par les ombrages excessifs des tours.

Les grandes tours ont été placées selon les études d’ensoleillement du quartier. Leur gabarit est si imposant qu’il est nécessaire d’étudier l’ensoleillement de chaque période.
En étant les plus grandes tours du canton, elles cherchent à établir un rapport indirect avec le jet d’eau de Genève: les derniers décrochés s’effectuent à 138m, hauteur du jet d’eau.
Le quartier devient très dense, à tel point que l’on semble pouvoir ressentir la densité depuis la pointe sud ou la pointe nord du PAV. L’ambition est claire et son impact territorial important. Ces tours marqueront un nouveau centre depuis toutes les routes qui mènent à Genève, depuis toutes les montagnes alentours. Nous les verrons tout de suite depuis le Salève et même depuis le Jura. Sont-elles trop ambitieuses?
La tour et son rapport à la ville
181
Tours de l’Etoile et PAV Genève
Figure 50_Les 7 règles d’’urbanisme



182
Socle et rapport direct à la ville
Les grandes tours de l’Etoile s’implantent avec tout un ensemble d’îlots et de plus petites tours à l’aide de règles que la ville et le lauréat ont établi.
Les 7 règles d’urbanisme
Le rapport direct au quartier de l’Etoile, à la route des Acacias et à la route des Jeunes est assuré par quatre îlots d’une hauteur de 29 mètres. Ce gabarit correspond à celui du tissu existant de la ville et assure des liaisons pratiques et visuelles. Des fronts de rue sont garantis par ces parties basses et assurent cette continuité avec laquelle les villes comme Genève se construisent.
Le quartier est ensuite rythmé par des tours de petites tailles agissant donc à une échelle intermédiaire. Avec une hauteur de 76 mètres, elles correspondent plus en proportions aux tours que l’on connaît à Genève (on peut dire qu’elles sont des intermédiaires entre la tour de la RTS de 60 mètres et les tours du Lignon de 91 mètres).
Le projet composé de ces îlots et de ces tours est lié avec les espaces publics existants de la ville par la création de la voie verte et de la remise à jour du cours d’eau de la Drize.
L’ensemble présentant une densité élevée, une place centrale est aménagée au sud de l’avenue de la Praille.
Enfin, les tours mixtes de grande hauteur (175 mètres) s’implantent de manière indépendante le long de la route des Jeunes.
La tour et son rapport à la ville
183
Tours de l’Etoile et PAV Genève
Figure 51_Plan du rez-de-chaussée sans échelle

184
Programme et typologie
Le projet lauréat a choisi de répartir les affectations par juxtaposition plus que par superposition. Ce qui selon le jury «facilite la rationalité économique et offre une souplesse programmatique, tout en assurant une bonne mixité à l’échelle de l’îlot»1 . Cette mixité par juxtaposition est tout de même composée avec une mixité par superposition. Avec des tours qui sont composées de bas en haut par des équipements publics et privés divers et variés, des logements dans les deux tiers supérieurs de la tour et enfin d’un belvédère accessible par tous dans le dernier niveau de la tour (donnée imposée par la ville de Genève).
Les logements proposés dans les socles varient du 2 pièces au 6 pièces, assurant une diversité sociologique importante. Les tours, quant à elles sont vouées à offrir des appartements plus généreux et plus onéreux accueillant une classe plus aisée mais toujours dans des configurations très différentes.
Structure et environnement
Les tours et le quartier sont pensés conjointement à la remise à jour de l’ancien cours d’eau du quartier: la Drize. Ce cordon devient alors l’élément vert principal du développement de ce quartier avec un effet positif sur l’îlot de chaleur urbain.
1Rapport du collège d’experts, mandats d’étude parallèles, Etoile, p.47
La tour et son rapport à la ville
185
Tours de l’Etoile et PAV Genève

186
Figure 52_Maquette du PAV avec l’insertion du concours de l’Etoile (3ème tour)
Le projet du quartier de l’Etoile tient ses forces des rapports d’échelles variés qu’il entretient avec la ville. Petite, moyenne et grande échelle lui donne une légitimité.
Les grandes tours de l’Etoile composent une nouvelle skyline de la ville de Genève quand les plus petites composent le nouveau quartier dans un rapport direct.
L’approche du quartier est cohérente avec le tissu de Genève et les tours marquent plusieurs niveaux de ville.
Zölly Tower
Vision territoriale un repère et une centralité
Socle et rapport direct à la ville un îlot d’urbanité
Programme & Typologie mixité et diversité
Structure simple et cohérente
Environnement réflexion globale
La tour et son rapport à la ville
187
de
et PAV Genève
8
Tours
l’Etoile
Jeu d’échelles 0
Figure 53_Plan de situation PAV sans échelle
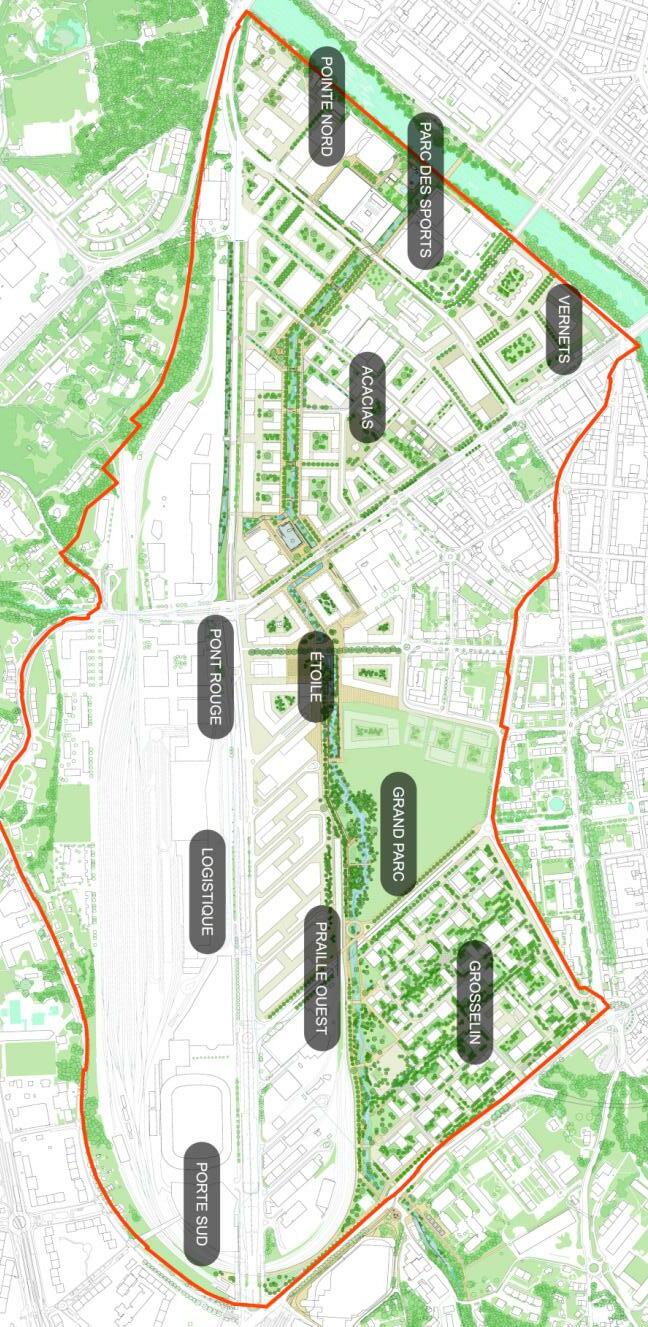
188
PAV Données
Date du concours Date du masterplan Lieu du concours Architecte Densité
2005 2007 Genève, Suissefaible à élevée
«Le projet Praille Acacias Vernets (PAV) représente le plus grand potentiel de logements du canton et une opportunité de développement unique en plein cœur de la ville.»1
Le projet se situe dans ce que l’on pourrait appeler le point de départ de la périphérie de la ville de Genève. Au delà de ce quartier se trouvent les communes de la ville de Genève comme Lancy, Onex ou Plan-les-Ouates qui représentent des parties de ville moyennement denses dont le développement et la densification sont également des sujets d’urbanisme importants.
Le projet est basé sur les anciennes activités industrielles du site et est caractérisé par des voies de communication fortes comme la route des Jeunes, la route des Acacias ou les voies de chemin de fer. Les axes de développement principaux sont la structuration des futurs quartiers par des espaces publics généreux ainsi que la conservation de la diversité et des caractéristiques des lieux de Genève. Ainsi les quartiers conserveront un caractère identitaire fort comme c’est aujourd’hui le cas pour des quartiers comme Carouge, les Acacias ou bien le nouveau quartier de la Chapelle au-delà de la pointe sud du PAV.
Les pages suivantes proposent un entretien avec Stephen Griek et permettent d’établir des liens entre les tours d’habitations et le quartier du PAV.
1ge.ch_Département du territoire (DT), le 22 septembre 2020
La tour et son rapport à la ville
189
Tours de l’Etoile et PAV Genève
discussion avec
Griek chef de projet pour le développement du PAV
Stephen Griek
Doctorat en architecture (UP8/IAUG), Master en philosophie (Sorbonne), il travaille notamment chez Rem Koolhaas à Rotterdam, fut assistant de projet à l’EPFL et à l’IAUG en urbanisme et aménagement du territoire ainsi qu’enseignant à l’ESA de Paris, l’EAV de Versailles et l’ENSA de Marseille ; depuis 2010, il est urbaniste au département du territoire du canton de Genève (Direction Praille Acacias Vernets), et enseigne depuis 2021 également la philosophie de l’architecture en bachelor à l’HEPIA1
«Pourquoi a-t-on tant de mal à construire des tours en Suisse ? Les tours ont l’air d’être mal interprétées dans l’imaginaire des habitants.»
«Je pense que cela fait partie de l’exception de la Suisse, ils ont une vision de l’économie et de la modernité. Ils tiennent beaucoup à l’exception. Ce côté de prendre plus de recul et plus de distance, de ne pas se précipiter et de voir qu’avec des moyens plus simples, plus modestes et moins tape à l’oeil. C’est peut être même mieux pour eux de créer une identité autour d’une mentalité de retenue. Ce qui diffère aussi entre les germaniques, les latins, etc... Cette idée de retenue est assez convainquante même particulièrement à Genève. Il existe aujourd’hui cette image, par exemple à Bâle avec les industries pharmaceutiques de montrer la richesse et de la symboliser, ce qui n’est pas partagé par tout le monde.
«Justement, à Bâle il existe cette stratégie un peu différente. Les tours sont des éléments privés qui sont presque des objets qui au final
ne valorisent pas le territoire comme ça pourrait être le cas à Zürich ou cela tend à le devenir à Genève».
«Il y a aussi un peu plus de confiance dans la qualité de l’aménagement du territoire. Je note que entre Genève, Bâle et Zürich, il y a une grande différence de culture de l’aménagement du territoire et de la ville. C’est beaucoup plus ouvert, discuté, montré, illustré dans la culture suisse alémanique qu’ici. Où souvent on fait un petit peu comme dans une boîte noire, c’est à dire qu’il n’y a pas une spontanéité de sortir de concerter, de montrer. Par exemple, il n’existe aucune maquette du canton, de la ville qui est exposé en permanence comme c’est le cas à Zürich avec la maquette accessible publiquement qui est toujours actualisée avec tous les projets et les aménagements. Vous avez la même chose à Bâle avec des conférences, toujours un échange aussi avec l’ETHZ, avec un échange, avec des expositions... Toute une culture autour des concours d’architecture qui ne sont valorisés que depuis
190
1biographue issue du site du JMA Joint Master of Architecture, Stephen Griek Chargé de cours
Une
Stephen
récemment à Genève. Il y avait une certaine frilosité à l’époque, ce n’était pas du tout naturel pour toutes les opérations emblématiques d’organiser des grands concours.»
«Justement, je me demande si cette aversion générale de la tour que ça soit en suisse romande ou alémanique était dû à la production des années 60-70. Avec plusieurs temps de construction des tours, années 30 quelques tours, ensuite beaucoup de tours avec la production de masse des logements puis plus grand chose et maintenant on retombe à nouveau dans la production de tours avec toujours cette image de la tour «ghetto» et de grand ensemble des années 60-70 qui a beaucoup marqué».
«Je suis complètement d’accord avec ça, c’est vraiment l’idée qu’on associe une certaine stratégie d’exclusion sociale qui est liée à ces modèles notamment en France et aux Etats-Unis. Ca a été souvent mal utilisé par la politique. Dans le sens de l’exclusion, une grande partie de la population n’a plus un droit à la ville très naturel comme le revendique Lefebvre. Ce sont des discussions sociaux-philosophiques assez importantes.
On a aussi l’impression aujourd’hui que la tour est datée. Puisque l’on est dans une phase de transition écologique, on a de la peine à voir dans la tour une
société en transition. Les tours, notamment à Genève et de manière générale devraient faire l’objet d’exemplarité losrque l’on prend en compte l’énergie grise et pas seulement une image verte.»
«Oui, ce n’est plus qu’une question d’image au final,c’est ce que la population voit. On s’arrête à la surface sans regarder vraiment le programme et en quoi elle est exemplaire. Cette exemplarité elle se formule donc au niveau de l’écologie puis j’imagine qu’elle se formule aussi avec la question programmatique ?»
«Oui, je pense qu’aujourd’hui, on devrait presque dire, en tenant compte des auteurs comme la rentabilité économiques que l’on devrait d’emblée être dans la catégorie d’exemplarité environnementale qui est la carte d’entrée qui devrait être partagée par toute opération de tour aujourd’hui et notamment à Genève. Après l’exemplarité peut se jouer et s’exprimer dans d’autres domaines, notamment programmatique. En effet, je pense qu’aujourd’hui, la programmation, l’accessibilité culturelle, publique, avoir un vrai évènement urbanistique partagé par l’ensemble de la population devrait être un prérequis. Après, elle peut être dans d’autres thématiques, au niveau de la mobilité ou de l’expression architecturale ou d’autres
La tour et son rapport à la ville
191
Tours de l’Etoile et PAV Genève
évènements. Par exemple, une tour d’habitations avec l’idée d’un village vertical avec une mixité exemplaire.»
«Dans le développement des tours du quartier de l’Etoile, comment avez-vous pensé cette liaison entre la tour et le sol? Est-ce que la question du programme était véritablement importante?»
«Oui, elle était importante dans le sens où on est parti à l’origine d’une tour monofonctionelle. Au début, on croyait que le seul moyen de les réaliser était de faire des tours d’activité et d’équipement public. Aujourd’hui on a complètement renversé le propos et on fait des tours mixtes et même à majorité de logements. On pensait notamment qu’avec les tours d’habitations, l’appropriation de cet élément architectural est plus facile parce que par définition les gens y habitent et ce ne sont pas des choses qui font seulement référence à la représentation d’un pouvoir, d’une entreprise comme à Bâle ou ailleurs. La tour de logements à une autre perception parmi la population. Ici, les classes qui vivront dans ces tours seront plus des classes aisées. Mais c’est grâce à ces tours et aux revenus économiques pour les collectivités publiques dans ce secteur que l’on pourra financer les logements sociaux dans le reste du PAV.» «Favoriser cette mixité dans la
tour, dans les mêmes volumes, ça permet de rejoindre ce que vous avez dit hier, c’est à dire de travailler avec un modèle de quartier qui fonctionne 24h/24. Donc les gens habitent, travaillent, se recontrent et se croisent. Puis j’imagine que l’espace public est pensé, qu’il n’y a pas de résidus»
«Oui, on essaie toujours de s’éloigner le plus possible des modèles de downtown comme aux Etats-Unis ou la Défense à Paris qui sont des contreexemples qu’on essaie d’éviter»
«Pensez-vous, avec du recul, qu’au carrefour de l’Etoile, les tours étaient la seule solution pour travailler avec ce tissu, ce morceau de ville ? Ou est-ce que Genève aurait pu se passer de tours ici ?»
«Oui, Genève aurait pu se passer des tours ici, parce qu’on a toujours identifié ce lieu comme un lieu emblématique et, le côté emblématique n’est pas forcément lié à la tour. Par exemple, ce que l’on veut c’est comme la thématique des gares du Léman Express. C’est clair que la configuration, le rapport modal, les interfaces entre les différents modes de transport font que c’est un lieu destiné à la densité exeptionnelle. Mais on sait que même sans les très grandes tours, on aurait pu atteindre une densité très élevée sans ces trois tours majeures. Et d’ailleurs, une des raisons
192
du choix du lauréat était dû à l’argument que le projet urbain proposé marche avec comme sans tour. On avait conscience que cette probématique de la tour allait peut être se terminer avec un référundum. Si jamais les tours étaient rejetées, il n’y a pas tout le projet qui s’écroule et cela tient quand même la route. Ce qui fait que par rapport à votre question du lien de ces éléments au quartier, on les a volontairement dissociés de la couture urbaine avec les voisins et ces éléments sont le long de la route de jeunes pour justement faire référence à une autre échelle, celle de l’agglomération. Elles limitent aussi symboliquement l’expansion de la ville dense».
«Donc on peut dire qu’il y a une première partie du quartier qui existe à une échelle un peu directe qui va venir tisser les liens avec la vie des autres quartiers et il y a un jeu a une deuxième échelle qui est celle du territoire.»
«Exactement, c’est ce jeu des deux échelles. Et si la grande échelle avec les tours ne marche pas, pour moi ça serait en quelque sorte dommage parce que je trouve que c’est un élément qui en terme d’orientation donne une compréhension de la ville qui pour moi est plutôt enrichissante. Mais si on a pas cet élément supplémentaire, c’est pas non plus une catastrophe. C’est l’idée de point de repère urbain, j’ai
toujours trouvé ça intéressant dans la perception de la ville.»
«Je trouve que c’est justement un point fort pour la ville de ne pas se passer de ces éléments hauts. J’ai l’impression qu’il existe cette stratégie de développement avec le CEVA où on a tendance à retrouver des tours près des gares.»
«Oui, quand on voit les autres gares, ce n’est pas la même densité et puis je trouve que même la tour Opale manque presque d’ambition comme repère. C’est déjà pas mal, on la voit quand même mais elle aurait, à mon avis, bien supporté 30 mètres de plus.»
«Une dernière question. Vous parlez des zones dans Genève qui sont très restrictives au niveau des gabarits et de l’élévation des tours. Pensez-vous que Genève devrait être plus ouverte à ces propositions ? Cela devrait être plus facile de construire des tours, un peu comme à Zürich ? »
«Complètement, même les zones de densité devraient être revues. On devrait travailler par projet. Projets qui remettent en question ce zoning contre-productif. Le PAV en est l’exemple suprême, même si on peut dire que c’est l’extension du centre-ville et donc il s’inscrit dans la continuité de cette zone là. Mais rien ne dervait empêcher de faire un PAV à la Zimeysa ou ailleurs si un jour
La tour et son rapport à la ville
193
Tours de l’Etoile et PAV Genève
c’est nécessaire. Pour moi, c’est vraiment une ville pensée par polarité à très grande échelle. Les plans d’aménagement devraient se faire en fonction d’une nécessité territoriale avec pas par rapport à un réglèment en vigueur. »
«J’ai l’impression que la ville de Genève est en train de développer une stratégie autour de la notion d’îlot d’urbanité. Le quartier de l’Etoile ou le quartier de la gare à Chêne-Bourg sont selon moi des îlots d’urbanités. Un quartier, ça se compose mieux avec plusieurs zones et il faudrait éviter l’uniformité.»
«Oui, ou il faudrait prévoir des possiblités plus généreuses d’introduire des exceptions. On pourrait dire qu’on veut une ville ordinaire qui s’inscrit dans une certaine continuité mais qu’elle peut être enrichie par des polarités, des centralités, des exceptions qui confirment la règle qui comme une recherche peuvent mettre en contraste la règle et l’exception. L’instrumentaliser, en faire un vrai thème. Souvent, on a l’impression que l’on ne veut pas d’exceptions, que l’on n’est pas prêt à les défendre jusqu’au bout. Ce sont des a priori qui font que le changement n’est pas à l’ordre du jour.
On a bien vu avec la thématique des surélévations à Genève, ce n’est pas toujours heureux mais souvent cela met en valeur la ville ancienne, le contraste entre
quelque chose de très moderne à l’étage et l’histoire qui est en dessous.»
«Je vois, on peut dire qu’il faut être un peu moins conservateur et porter des idées.»
«Il faut faire confiance au projet, il faut faire confiance à l’innovation, il faut la stimuler où on peut.»
Stephen Griek & Loïc Steiner, le 11 janvier 2023.
194
Résumé
On peut résumer cet échange en quelques points. D’abord que la Suisse a une relation particulière aux Tours qui n’est pas la même dans tout le territoire. Culturellement, la production architecturale de masse a joué un rôle important ainsi que le rapport à l’aménagement du territoire plus communiqué et important en suisse alémanique.
De nos jours et pour les années à venir, la tour doit se justifier et se légitimiser avec une exemplarité écologique en premier lieu puis programmatique dans un second temps.
On peut dire que le quartier du PAV et plus généralement Genève tend à un développement proche des valeurs de mixité d’usages et de programmes, tant dans les volumes bas que dans les tours. Ensuite, le rapport des quartiers entre eux et le jeu d’échelle entre les visions territoriales et directes est très important pour justifier l’implantation d’une tour.
Enfin, on peut dire qu’il faut permettre et pousser l’innovation, tant dans la recherche que dans la production architecturale des tours.
La tour et son rapport à la ville

195
Tours de l’Etoile et PAV Genève
Figure 54_Croquis d’Alison & Peter Smithson, 1960
SNCF - direction France
CFF - direction Lausanne
Lancy - Pont Rouge Carouge - Bachet
Gare Cornavin
Croquis du réseau de communication du CEVA
Champel - Hôpital
SNCF - direction EVIAN SNCF
Genève - Eaux-vives Chêne-Bourg Annemasse
196
Choix du site la grande échelle
La ville de Genève est très différente de celles des autres cantons de Suisse. Sa proximité avec la France, et son caractère international lui donnent un caractère particulier qui forge des quartiers de natures très différentes.
Les acteurs du nouveau quartier du PAV définissent Genève comme une ville en forte croissance à la population très mixte et cosmopolite. Le canton de Genève s’étendant sur une surface bien moins élevée que les autres cantons romands et suisse-allemands, ce qui donne lieu a une demande en logements de plus en plus forte. On parle même de pénurie de logement au sein de la ville de Genève.
Avec son développement urbain et démographique, la notion d’îlot d’urbanité apparaît dans le portrait de Genève qui se dessine alors une nouvelle image. Il semble que ces îlots sont des nouveaux centres dotés de tours de tailles différentes qui émergent en leur milieu.
Tous ces centres sont fortement liés aux réseaux de mobilité ferroviaire, de voiture et de mobilité douce aujourd’hui en fort développement et à l’avenir encore plus.
La tour et son rapport à la ville
197
Site de projet Genève
Plan | Détermination du site 1:15’000
198
Choix du site
la grande échelle
Le site a été défini à la pointe sud du projet du PAV. Le quartier se situe à la rencontre des axes parmi les plus empruntés de Genève. La route de Saint-Julien mène directement avec une attitude linéaire jusqu’à la France et au département de la Haute-Savoie. Elle se prolonge jusqu’à Carouge en croisant, au niveau du site d’intervention la route des Jeune et le viaduc de la voie centrale qui disparaît dans une tranchée couverte.
Le site communique fortement avec le centre de la ville et sa périphérie directe et lointaine. Les voies qui le composent sont linéaires et de dimensions importantes.
Le site veut communiquer avec les nouveaux îlots que le projet du PAV dessine. Ainsi, la/les tour(s) présentes sur le site dialogueront avec les projets lauréats de concours de la pointe nord (équipe BleuVert-Blanc) et du croisement de l’étoile mené par Pierre Alain Dupraz Architectes.
Le site s’inscrit dans un quartier à la rencontre de quasiment tous les types de tissus connus à Genève: Des grandes infrastructures comme le stade de Genève ou la prochaine patinoire aux petits quartiers pavillonaires et nouveaux ensembles de densité modérée, il présente une situation complexe dont les enjeux spatiaux et sociologiques sont importants.
La tour et son rapport à la ville
199
Site de projet Genève
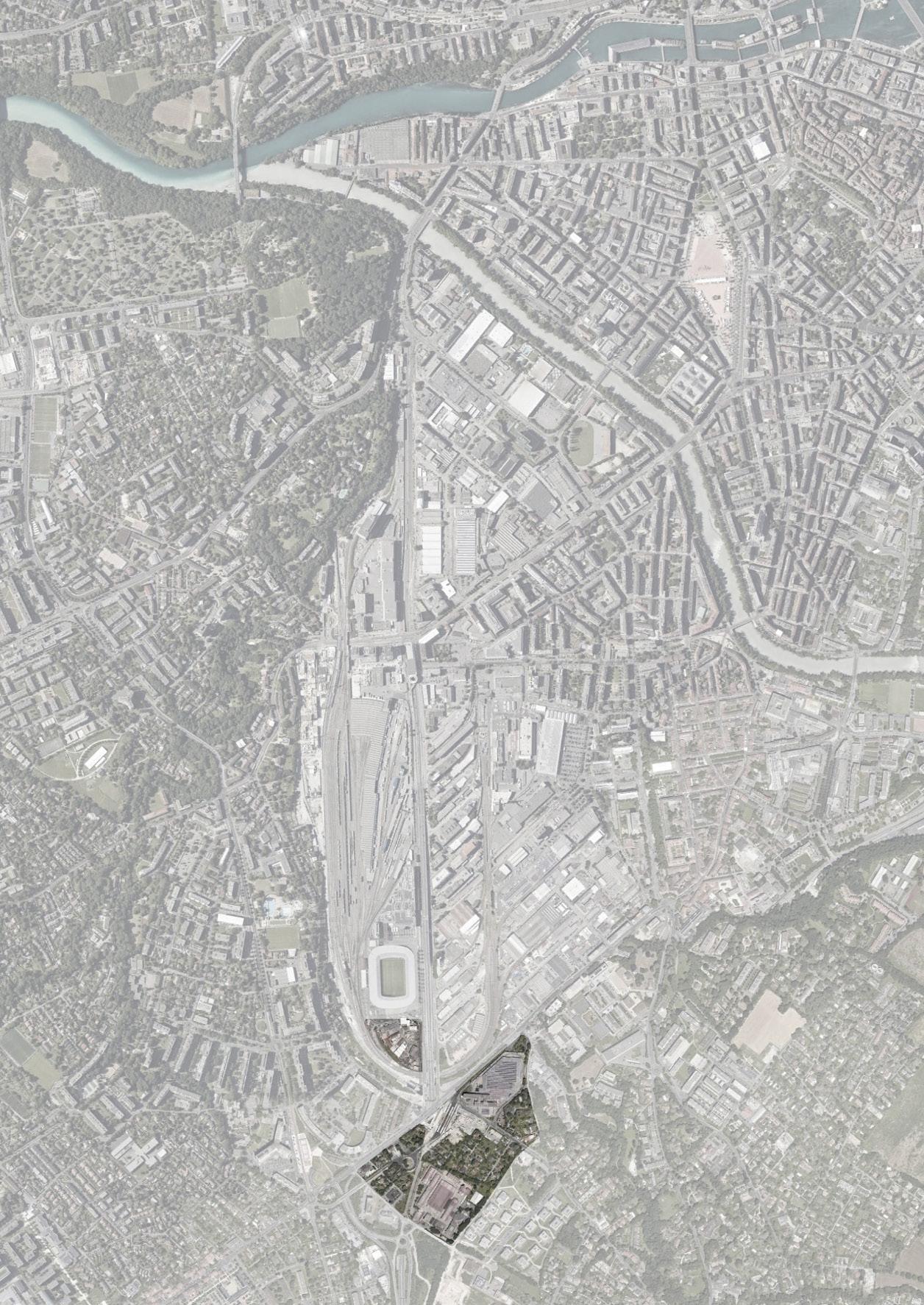
Figure 55_Orthophoto 1, Genève
Site de projet Genève
Choix du site la grande échelle
La tour et son rapport à la ville
201
202
Périmètre site 1:5’000
Choix du site
l’échelle intermédiaire
C’est un lieu déjà en très forte mutation avec des projets divers comme la nouvelle patinoire de Genève (trèfle blanc), les nouveaux logements de Jaccaud & associés ou au sud le quartier de la chapelle et bien sûr la nouvelle gare du CEVA.
Il présente une situation complexe de la ville en confrontant des tissus complètement différents de Genève qu’une simple opération urbanistique horizontale ne semble pas pouvoir régler d’un seul coup. D’une part, une relation aux voies d’entrées de la ville de Genève avec la route de Saint-Julien et d’autre part un rapport direct à la route des Jeunes.
Périmètre d’intervention
Le site définit par le périmètre en rouge est très étendu, il témoigne de l’importance de définir au mieux l’implantation de la tour et de ses sous-parties avec une analyse plus poussée de définition des besoins et des rapports aux quartiers alentours.
Le site tend à disposer avec les projets actuels d’un nombre important d’infrastructures qu’il sera intéressant de lier fortement à la ville par le biais de la création d’une ou de plusieurs tours et de nouveaux espaces publics associés.
Le belvédère
On peut questionner le rôle du belvédère nouvellement créé qui projette la vue sur les arrêts des trams des transports publics genevois. Est-ce vraiment la vocation d’un tel système ? Peut-on offrir quelque chose de plus à ce site ?
La tour et son rapport à la ville
203
Site de projet Genève

Figure 56_Orthophoto 2, Genève
Site de projet Genève
Choix du site
l’échelle intermédiaire
La tour et son rapport à la ville
205
Programme
Pour établir un programme cohérent et établir des bases pour un projet d’architecture, je vais proposer un cahier des charges comme l’on pourrait le faire dans un concours d’architecture. Le programme est aussi une manière de résumer les points importants qu’une tour doit aborder.
Le programme de la tour doit dans un premier temps répondre à un besoin démographique important qui est lié à la question de l’habitat lui-même.
Nous l’avons observé dans les analyses, il convient de contribuer à créer un quartier mixte en intégrant la possibilité à des individus, familles et couples de pouvoir loger dans les appartements de la/les tour(s). Le projet doit donc proposer une variété de types d’appartements pour catalyser la mixité sociale.
Les tours composées par un socle répondent mieux aux besoins de contact et de liaison à la ville. C’est pourquoi une composition avec des échelles différentes est préférable. Afin de rendre le socle de la/ les tour(s) actif et utilisé, il convient d’intégrer les espaces publics alentours et les projets en cours de développement dans la stratégie et le concept de conception de l’ensemble des premiers étages de la tour et des espaces publics et collectifs.
Les surfaces de plancher sont à définir selon les qualités urbanistiques et programmatiques proposées et selon les besoins analysés du quartier. Il est aussi important de tenir compte ou de proposer un discours cohérent quant aux zones de construction à Genève et plus particulièrement sur le site.
Le programme de la tour sera alors le suivant :
Espace public extérieur
-place publique avec différentes activités proposées et un concept d’urbanisme et de développement durable clair en cohésion avec les demandes futures de la ville et de la société. -liaisons directes aux réseaux de transport existants et fortement présents sur le site avec le reste de la ville, les quartiers du centre de et de la périphérie de Genève.
La tour et son rapport à la ville
207
Site de projet Genève
Programme
Espace public intérieur
-quartier comprenant une ou plusieurs tour(s) de logements avec des premiers étages publiques, communs en lien fort avec la ville (par exemple, des salles de danse, de conférence, des restaurants, bars, magasins à fort potentiel d’attraction, entreprises locales)
-les derniers étages de la/les tour(s) seront publics et accessibles aisément au public en qualité de belvédaire principalement. Certains étages intermédiaires peuvent être innovants dans leur usage. -il sera intéressant de jouer avec les échelles des pièces et des usages
Espace commun et privé
-quelques étages de bureaux dans les niveaux intermédiaires ou dans les socles -dans le reste de la tour, des logements diversifiés par leur typologie et leur nombre de pièces avec la possibilité de changer le type en fonction du niveau de l’appartement et de son orientation dans la tour -espaces communs pour améliorer les qualités de vie (ensemble) à intégrer dans des emplacements stratégiques de la/les tour(s) et des socles
Environnement
-le projet doit intégrer un concept de développement durable fort et être reconnu comme énergétiquement exemplaire. Notamment grâce aux labels Minergie, aux justificatifs de consommation de l’énergie grise.
-le projet doit proposer des espaces verts intéressants qui viseront à limiter l’îlot de chaleur urbain dans le quartier de Carouge-Bachet.
La tour et son rapport à la ville
209
Site de projet Genève
Figure 57_Croquis depuis le viaduc de la voie centrale

Conclusion
La tour est depuis toujours un objet de fascination, fantasmée ou détestée, elle loge dans l’imaginaire et le quotidien de chaque personne qui fait l’expérience de la grande ville contemporaine. Avec des projets d’ambitions et de conditions différentes, la ville existe grâce à l’espace public et l’espace public vit grâce aux diverses constructions. Lorsqu’elles se développent en hauteur, elles créent des nouveaux types d’espaces identitaires du lieu: les tours.
Grâce à son impact territorial fort, la tour met en relation les espaces de la ville entre eux. En intervenant à des échelles différentes, elle relie visuellement des centres et points d’intérêts, elle permet de s’orienter et de se repérer dans la ville et ainsi de connecter des quartiers grâce à la faculté ou le concept «d’imagibilité».
Dans des villes comme Genève ou les centres se multiplient, les tours deviennent une réponse évidente et adaptée; les tours de l’Etoile dans le quartier de Lancy - Pont Rouge, la tour Opale dans le centre de Chêne-Bourg et les nouvelles tours de ce projet de mémoire au centre de Carouge - Bachet.
Ainsi, il semble que la tour à Genève, est un élément adapté à la stratégie de développement de la ville et du canton. Elle devient parfois une clé du territoire et elle peut être un pivot, un repère, un centre... Toutes ces qualités qui orientent et créent l’identité d’une ville de manière presque naturelle.
Avec un recul important sur la construction et l’étude de tours, on peut dire qu’elle a toujours été une réponse au besoin de densification depuis que les activités se concentrent en ville. Elle permet de s’accorder aux lois en vigueur, aux normes de plus en plus restrictives et aux recommandations d’hygiène. Elle se développe en accordant et offrant de grands espaces publics à la ville mais pour être totalement justifiée, elle doit faire preuve d’une grande exemplarité écologique et programmatique.
La tour et son rapport à la ville
211
Figure 58_Vue sur Lancy Pont-rouge

212
ConclusionC’est cette exemplarité qui donne à la tour les qualités nécessaires pour exister et fonctionner: une tour ne peut pas faire l’objet d’uniformité. Elle doit être complète, elle doit dialoguer et s’ouvrir à l’espace public, notamment en réalisant un rez-de-chaussée public. Quand elle est composée et que la ville vit à l’intérieur, les liens se tissent, les habitants se connaissent, ils partagent un palier, ils se regroupent dans la salle commune. La tour composée par des dispositifs de la ville permet ainsi aux utilisateurs de se rencontrer avec des cheminements qui se croisent sans jamais s’entremêler.
Comme tout élément d’architecture, la tour est un dispositif vertueux, mais à quel égard ? Poison ou remède pour la ville, elle restera toujours un pharmakon. Il est donc du devoir de l’architecte de se munir des connaissances et des compétences nécessaires à la construction d’une ou de plusieurs tours pour en faire ressortir ses qualités intrinsèques ainsi que celles qu’il doit composer.
En conséquence, la tour domine avec évidence le tissu urbain de la ville et elle s’en détache. Le jeu d’échelle devient une composante indissociable du dispositif de la tour tout comme l’est la programmation et la configuration du socle et de ses premiers niveaux. C’est de cette manière que la tour pourra offrir à la ville des espaces publics de qualité appropriés au quartier et à la vie sociale.
Lorsque son implantation regroupe vision territoriale, repère dans la ville, lien programmatique fort avec les places publiques qu’elle crée puis attention particulière au développement durable, elle atteint son but:
Celui d’établir un rapport physique, spatial et social à la ville et de participer au développement de ses espaces publics.
La tour et son rapport à la ville
213
214
Bibliographie
Livres
MOSER Patrick, De Bel-Air à Babel Un rêve de grandeur, Call me Edouard Editeurs. Juin 2019, EAN13 9782940519507
KOOLHAAS Rem. New york délire. Editions Parenthèses. 2002, ISBN 2-86364-087-9
CECCARINI Danilo, COLLIN Didier, MARIA Eric, BAUD François, WASSER Frédéric, GIRAULT Isabel, BARTHASSAT Manuel, LACHENAL Marc, SIA, Carnet de voyage. Décembre 2022
Revues
Werk, bauen+wohnen, Hochhäuser Wenn Türme im Team spielen, 12-2021
Sites internet
Tribu Architecture, Tours : mode d’emploi, [En ligne]. Consulté le 02 novembre 2022, disponible à l’adresse: https://tribuarchitecture.ch/media/filer_public/60/a7/60a7ac82-dc6c-41df-8d06-c419514914f8/tours_mode_demploi.pdf
PELEGRIN-GENEL Elisabeth, Tours de grande hauteur ou gratte-ciel, [En ligne]. Consulté le 17 novembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.universalis.fr/encyclopedie/tours-de-grande-hauteur-gratte-ciel/#TA073500
ROSEAU Nathalie, La ville verticale, abstraction concrète, [En ligne]. Mis en ligne le 24 septembre 2018, consulté le 02 novembre 2022, disponible à l’adresse: https://journals.openedition.org/gc/5195
VIALA Laurent, La « ville-tour » : fiction et visée prospective, [En ligne]. Mis en ligne le 23 novembre 2018, consulté le 02 novembre 2022, disponible à l’adresse: https://journals.openedition.org/gc/5418
ATMANI Mehdi, Le retour des tours, [En ligne]. Mis en ligne le 15 octobre 2020, consulté le 20 décembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.immorama.ch/articles/urbanisme-tours/
ROULET Yelmarc, Apprendre à apprécier les tours: mode d’emploi, [En ligne]. Mis en ligne le 25 décembre 2012, consulté le 03 janvier 2023, disponible à l’adresse: Le temps, https://www.letemps.ch/suisse/apprendre-apprecier-tours-mode-demploi
DUNY Patrice, LA TOUR une structure architecturale symbolique, [En ligne]. Mis en ligne en mars 2013, consulté le 02 novembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.aucame.fr/web/publications/quen_savons_nous/fichiers/QSN050_ Tours.pdf
MOSCATELLI Matteo, La tour et le gratte-ciel. Brève histoire de l’immeuble de grande hauteur, [En ligne]. Mis en ligne le 10 juillet 2020, consulté le 14 novembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.espazium.ch/fr/actualites/la-tour-et-legratte-ciel-breve-histoire-de-limmeuble-de-grande-hauteur
ALTHAUS Eveline, Les tours d’habitation au fil du temps, [En ligne]. Mis en ligne le 25 juin 2020, consulté le 14 novembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.espazium.ch/fr/actualites/les-tours-dhabitation-au-fil-du-temps
PERRET Tania, L’habitat vertical, renouveau d’une forme de densification, [En ligne]. Mis en ligne le 24 juin 2020, consulté le 06 décembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.espazium.ch/fr/actualites/lhabitat-vertical-renouveau-dune-formede-densification
RTS.ch, Les plus hautes tours de Suisse, [En ligne]. Consulté le 02 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://www.rts.ch/ info/5757667-les-plus-hautes-tours-de-suisse.html
La tour et son rapport à la ville
215
D. Marco, Les tours qui hérissent la Suisse, [En ligne]. Mis en ligne le 01 octobre 2008, consulté le 12 novembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.letemps.ch/suisse/tours-herissent-suisse
FRANCEY Olivier, La Tour de Rive à Genève, reflet de la modernité d’après-guerre, [En ligne]. Mis en ligne le 29 juin 2014, consulté le 18 décembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.letemps.ch/suisse/tour-rive-geneve-reflet-modernitedapresguerre
Wikipedia, Suisse, [En ligne]. Modifié le 11 janvier 2023, consulté le 14 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://fr.wikipedia. org/wiki/Suisse
Statista, Die zwanzig höchsten Gebäude in der Schweiz im Jahr 2022 [En ligne]. Mis en ligne le 04 août 2022, consulté le 03 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/348789/umfrage/hoechste-gebaeudein-der-schweiz/
Regionaljournal Zürich Schaffhausen, Prägen bald 250 Meter hohe Türme das Zürcher Stadtbild?, [En ligne]. Mis en ligne le 07 décembre 2022, consulté le 20 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://www.srf.ch/news/schweiz/neue-hochhausrichtlinien-praegen-bald-250-meter-hohe-tuerme-das-zuercher-stadtbild
TYBALT Félix, TOMBEZ Valentin, GANI Cynthia, RTS, Contre le mitage du territoire, la densification a aussi ses limites, [En ligne]. Modifié le 22 janvier 2019, consulté le 16 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://www.rts.ch/info/suisse/10157192contre-le-mitage-du-territoire-la-densification-a-aussi-ses-limites.html
Ville de Lausanne, Portrait statistique de Lausanne 2022, [En ligne]. Mis en ligne le 09 juillet 2021, consulté le 18 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://issuu.com/villedelausanne/docs/lausanne_-_portrait_statistique_2021
Wikipédia, Lausanne, [En ligne]. Modifié le 02 janvier 2023, consulté le 05 janvier 2023, disponible à l’adresse: https:// fr.wikipedia.org/wiki/Lausanne
VALEIRAS Oscar, PIRAZZI Claudio, PERRET Jacques, Structure de la tour Bel-Air, [En ligne]. Mis en ligne le 02 septembre 2015, consulté le 28 décembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.espazium.ch/fr/actualites/structure-de-la-tour-belair
Urbaplan, Riviera future Etude d’opportunité, [En ligne]. Mis en ligne en juin 2013, consulté le 18 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://www.sai-riviera.ch/FUSIONriannexe1diagnosticdemographique.pdf
Canton de Vaud, La tour d’Ivoire de Montreux, comme en 1969, [En ligne]. Consulté le 28 décembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.vd.ch/fileadmin/user_upload/themes/culture/patrimoine_bati/56_copie_12032018/JEP/VD_08.pdf
MyMontreux.ch , Construction de la Tour d’Ivoire: un sacré chantier, [En ligne]. Mis en ligne le 03 juin 2020, consulté le 05 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://mymontreux.ch/news/construction-de-la-tour-divoire-un-sacre-chantier/
Von Ballmoos Partner AG, 180 WolkenWerk Zürich, [En ligne]. Consulté le 26 décembre 2022, disponible à l’adresse: https:// www.vonballmoospartner.ch/project/leutschenbach-kopf/
LANDEZINE | Landscape Architecture Platform, WolkenWerk, Leutschenbach Zürich by mavo Landschaften, [En ligne]. Mis en ligne le 20 janvier 2022, consulté le 10 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://landezine.com/wolkenwerkleutschenbach-zurich-by-mavo/
Architectes.ch, City West F, [En ligne]. Consulté le 07 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://www.architectes.ch/fr/ reportages/batiments-administratif-et-commerces/city-west-f-61398
MEILI & PETER Architekten AG, City West Complex Zürich - Zölly Tower, [En ligne]. Consulté le 26 décembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.meilipeterpartner.ch/portfolio/city-west-zurich-zoelly-hochha/#
216
Bibliographie
PERRET Tania, Espazium, «Construire en hauteur est une forme de développement vers l’intérieur», [En ligne]. Mis en ligne le 13 août 2020, consulté le 19 novembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.espazium.ch/fr/actualites/construireen-hauteur-est-une-forme-de-developpement-vers-linterieur
Département du territoire (DT), Plan directeur cantonal 2030, [En ligne]. Consulté le 08 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://www.ge.ch/dossier/amenager-territoire/planification-cantonale-regionale/plan-directeur-cantonal-2030
Département du territoire (DT), Vers une vision territoriale transfrontalière, [En ligne]. Consulté le 08 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://www.ge.ch/dossier/amenager-territoire/planification-cantonale-regionale/vision-territoriale-transfrontaliere
Département du territoire (DT), Programmer les tours de l’Etoile (PAV): pour qui et comment?, [En ligne]. Mis en ligne le 30 novembre 2018, consulté le 05 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://www.ge.ch/document/programmer-tours-etoilepav-qui-comment
Département du territoire (DT), MEP Etoile - Rapport d’experts, [En ligne]. Mis en ligne le 01 février 2015, consulté le 30 novembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.ge.ch/document/mep-etoile-rapport-experts
VAN DER POEL Cedric, L’Etoile du PAV Résultats de concours, [En ligne]. Mis en ligne le 26 février 2015, consulté le 28 décembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.espazium.ch/fr/actualites/letoile-du-pav
Département du territoire (DT), Praille Acacias Vernets (PAV), [En ligne]. Consulté le 05 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://www.ge.ch/dossier/praille-acacias-vernets-pav
Vidéos en ligne
MARCHAND Bruno, La Matinale RTS, «On adore New York, mais quand on revient, on refuse les tours chez nous», [En ligne]. Mis en ligne le 30 juillet 2020, consulté le 17 novembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.rts.ch/info/ suisse/11500010-on-adore-new-york-mais-quand-on-revient-on-refuse-les-tours-chez-nous.html
PERRET Tania, SANTOS Yony, Espazium, Habitat Vertical: interview #1: Antoine Hahne, [En ligne]. Mis en ligne le 26 juin 2020, consulté le 19 novembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.espazium.ch/fr/actualites/habitat-vertical-interview1-antoine-hahne
PERRET Tania, SANTOS Yony, Espazium, Habitat Vertical: interview #6 Etienne Räss, [En ligne]. Mis en ligne le 24 juillet 2020, consulté le 19 novembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.espazium.ch/fr/actualites/habitat-vertical-interview6-etienne-rass
Couleurs locales, La Tour d’Ivoire à Montreux, [En ligne]. Mis en ligne le 06 septembre 2022, consulté le 05 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://www.facebook.com/watch/?v=617641193296588
La tour et son rapport à la ville
217
Illustrations
Figure 01_Théorème de 1909, [En ligne]. Consulté le 04 janvier 2023, disponible à l’adresse : https://www.pinterest.fr/ pin/310466968038991638/
Figure 02_Seagram Building, [En ligne] consulté le 25 décembre 2022, disponible à l’adresse: https://modernism.art-zoo. com/fr/seagram-building-mies/
Figure 03_Tour de Babel, [En ligne]. Consulté le 12 octobre 2022, disponible à l’adresse : https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2021-08/mythe-tour-de-babel-ce-que-revele-archeologie
Figure 04_Représentation de la Ziggourat, [En ligne]. Consulté le 06 janvier 2023, disponible à l’adresse : https://www. pourlascience.fr/sd/archeologie/combien-a-coute-la-tour-de-babel-13115.php
Figure 05_Palazzo Vecchio, [En ligne]. Consulté le 03 janvier 2023, disponible à l’adresse : https://upload.wikimedia.org/ wikipedia/commons/thumb/c/cf/Palazzo_Vecchio_%28Firenze%29.jpg/1200px-Palazzo_Vecchio_%28Firenze%29.jpg
Figure 06_Monastère Saint-Antoine, [En ligne]. Consulté le 03 janvier 2023, disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/ wiki/Liste_des_plus_anciennes_églises_du_monde#/media/Fichier:Antonius_Kloster_BW_7.jpg
Figure 07_Tour Elisabeth | Big Ben, [En ligne]. Consulté le 06 janvier 2023, disponible à l’adresse : https://fr.wikipedia.org/ wiki/Big_Ben
Figure 08_Premier ascenseur sécurisé, [En ligne]. Consulté le 12 octobre 2022, disponible à l’adresse : https://www. ascenseurs.fr/confessions-dun-ascenseur/1857/
Figure 09_Construction de la tour Bel-Air, [En ligne] consulté le 06 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://www.lfm.ch/ loisirs/notrehistoire/le-premiers-gratte-ciel-suisse-etait-vaudois/
Figure 10 Vue de l’ensemble de tours Hardau à Zürich, [En ligne] consulté le 06 janvier 2023, disponible à l’adresse: https:// www.stadt-zuerich.ch/hbd/de/index/hochbau/bauten/bauten-realisiert/archiv-bauten/realisiert-2007/wohnsiedlung-hardau. html
Figure 11_Tour Albert, [En ligne] consulté le 09 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://www.centrepompidou.fr/en/ ressources/archive/2UBHP7B
Figure 12_432 Park Avenue, [En ligne] consulté le 06 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://www.architecturaldigest. com/story/432-park-avenue-lawsuit
Figure 13_Carte de densité de la Suisse, [En ligne] consulté le 19 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://www. theinspiration.com/2023/01/population-density-maps-by-terence-fosstodon/
Tour Bel-Air, Lausanne
Figure 14_Carte historique de Lausanne, 1934, [En ligne] consulté le 28 décembre 2022, disponible à l’adresse: https:// map.geo.admin.ch/?topic=swisstopo&X=190000.00&Y=660000.00&zoom=1&lang=fr&bgLayer=ch.swisstopo.pixelkarte-far be&catalogNodes=1392&layers=ch.swisstopo.zeitreihen&time=1864&layers_timestamp=18641231
Figure 15_Photographie de la tour Bel-Air, [En ligne] consulté le 28 décembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.lfm. ch/loisirs/notrehistoire/le-premiers-gratte-ciel-suisse-etait-vaudois/
Figures 16,19,20,21_Photographies de la tour Bel-Air, [En ligne] consulté le 28 décembre 2022, disponible à l’adresse: https://cche.ch/fr/projets/complexe-bel-air/
218
Bibliographie
Figure 17_Elévation est, [En ligne] mis en ligne le 02 septembre 2015, consulté le 28 décembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.espazium.ch/fr/actualites/structure-de-la-tour-bel-air
Figure 18 Plan des premiers étages de la tour, [En ligne] mis en ligne le 02 septembre 2015, consulté le 28 décembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.espazium.ch/fr/actualites/structure-de-la-tour-bel-air
Tour d’Ivoire, Montreux
Figure 22_Publicité pour la ville de Montreux, [En ligne] consulté le 02 octobre 2022, disponible à l’adresse: https:// mymontreux.ch/news/la-verticalite-comme-patrimoine/
Figure 23 La tour d’Ivoire et son échaffaudage mobile pendant la construction, [En ligne] consulté le 28 décembre 2022, disponible à l’adresse: ?
Figure 24_ Elévation est de la tour, [En ligne] Consulté le 25 décembre 2022, disponible à l’adresse: http://www.villalelac.ch/ en/exhibition/de-bel-air-babel
Figures 25,26_Plans de la tour, [En ligne] Consulté le 26 décembre 2022, disponible à l’adresse: https://adao.ch/017triplex-a-montreux/
Figure 27_ Photographie du radier de la tour pendant le chantier, [En ligne] Consulté le 26 décembre 2022, disponible à l’adresse: https://mymontreux.ch/news/construction-de-la-tour-divoire-un-sacre-chantier/ Wolkenwerk, Zürich
Figures 28 à 34_Photographies et plans du projet, [En ligne] consulté le 29 décembre 2022, disponible à l’adresse: https:// www.vonballmoospartner.ch/project/leutschenbach-kopf/
Figure 35_Photographie socle et tours, [En ligne] consulté le 06 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://newsroom. warema.com/en/press-releases/warema-group/presse/living-the-high-life.html
Zölly Tower
Figures 36 à 45_Photographie et plans Zölly tower, [En ligne] consulté le 30 décembre 2022, disponible à l’adresse: https:// afasiaarchzine.com/2016/01/meili-peter/meili-peter-zolly-tower-zurich-6/ Tours de l’Etoile
Figures 46 à 52_Images de concours, plans et schémas, photographie de maquette du PAV, [En ligne] consulté le 06 janvier 2023, disponible à l’adresse: https://www.espazium.ch/fr/actualites/letoile-du-pav
Figure 48_Vue du croisement de l’Etoile, [En ligne] consulté le 19 octobre 2022, disponible à l’adresse: https://www. padupraz.ch/projets/pav-etoile-geneve/ Quartier du PAV
Figure 53_Plan de situation PAV, [En ligne] consulté le 28 décembre 2022, disponible à l’adresse: https://www.ge.ch/ dossier/praille-acacias-vernets-pav
Figures 55 & 56_Orthophotos Genève, [En ligne] consulté le 19 janvcier 2023
Figures 57 & 58_Croquis et vues de Genève, CECCARINI Danilo, COLLIN Didier, MARIA Eric, BAUD François, WASSER Frédéric, GIRAULT Isabel, BARTHASSAT Manuel, LACHENAL Marc, SIA, Carnet de voyage. Décembre 2022
La tour et son rapport à la ville
219
Mémoire de thèse Loïc Steiner 2023

Loïc Steiner



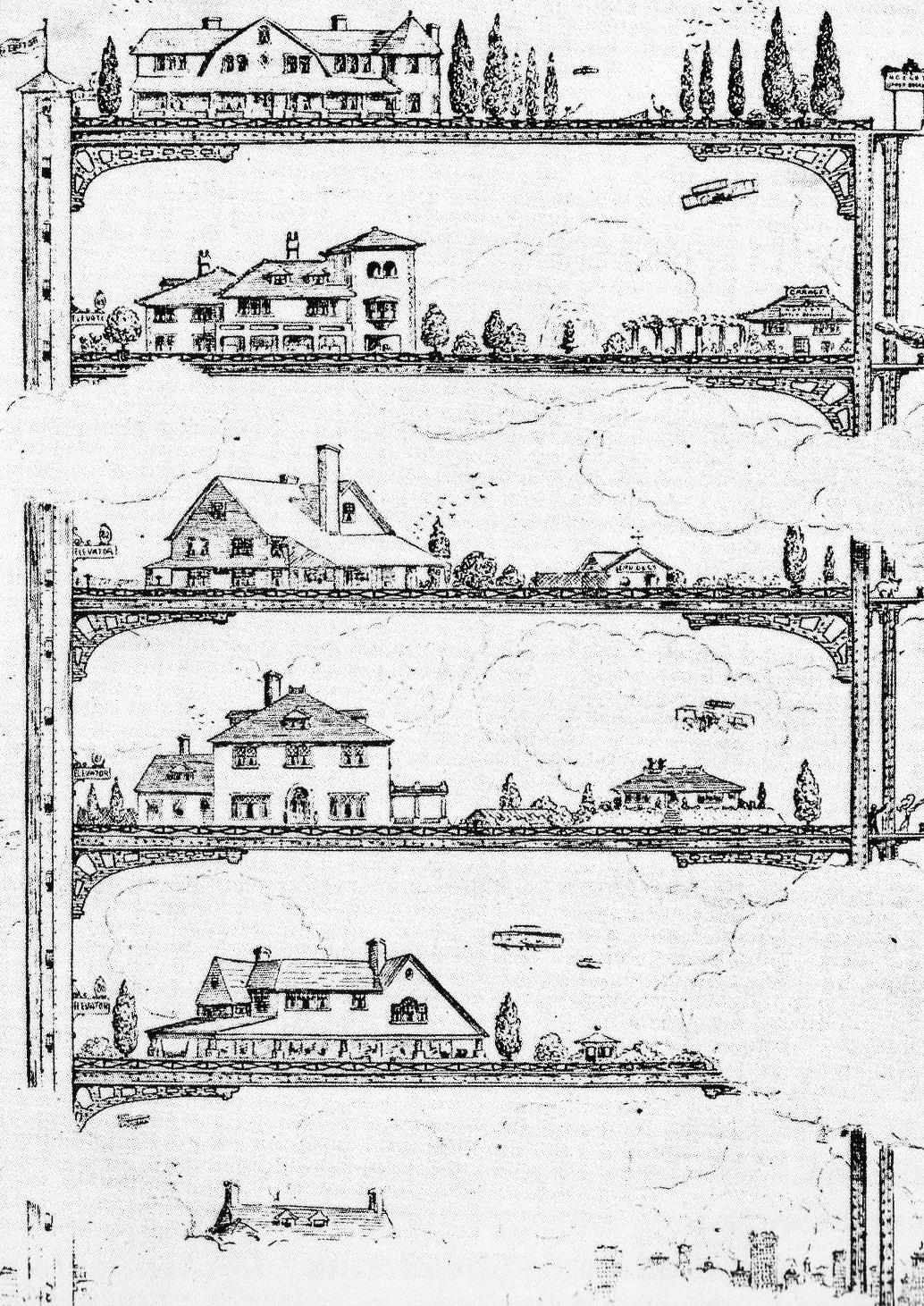



 Figure 05_Palazzo Vecchio
Figure 05_Palazzo Vecchio

 Figure 07_Tour Elisabeth | Big Ben
Figure 07_Tour Elisabeth | Big Ben












































































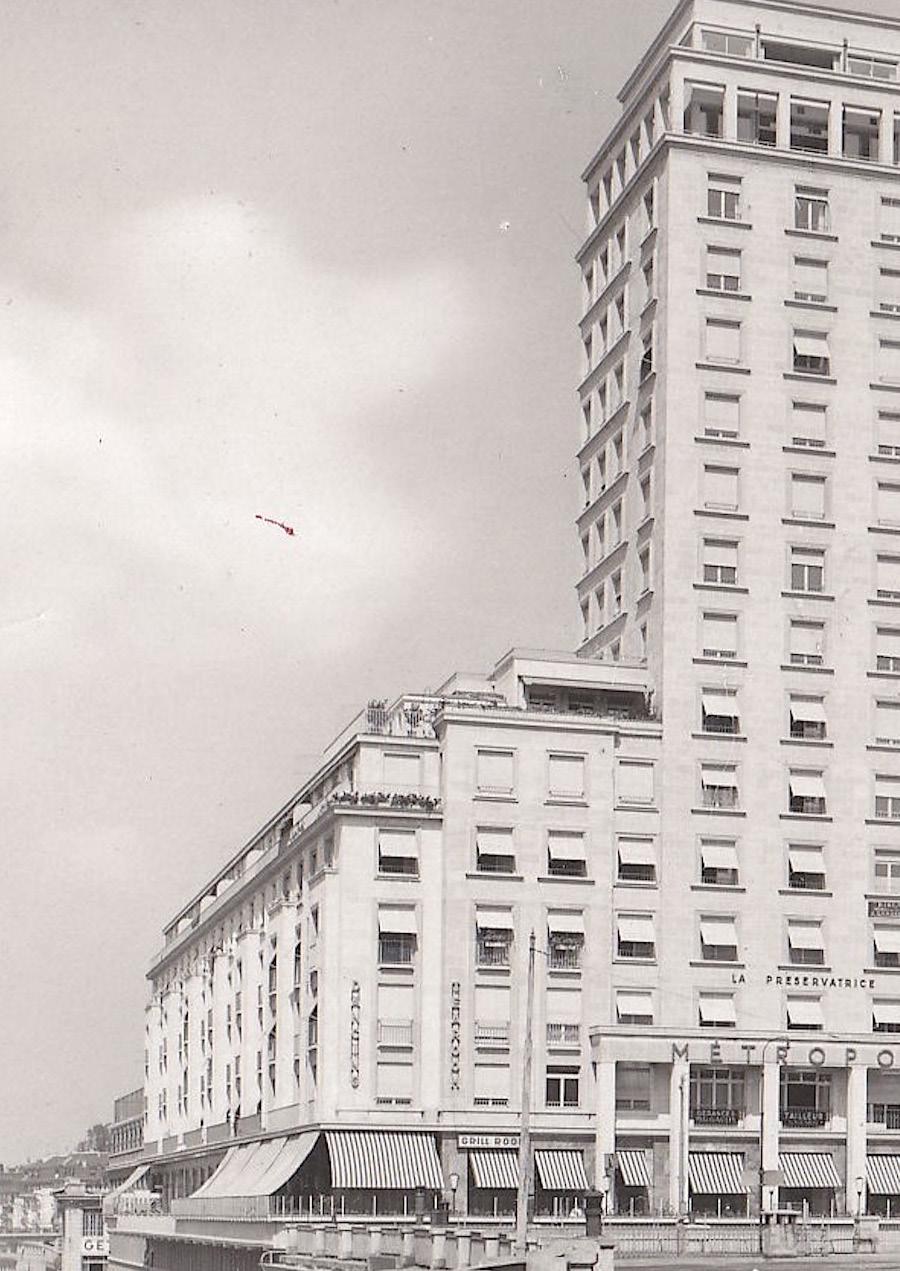










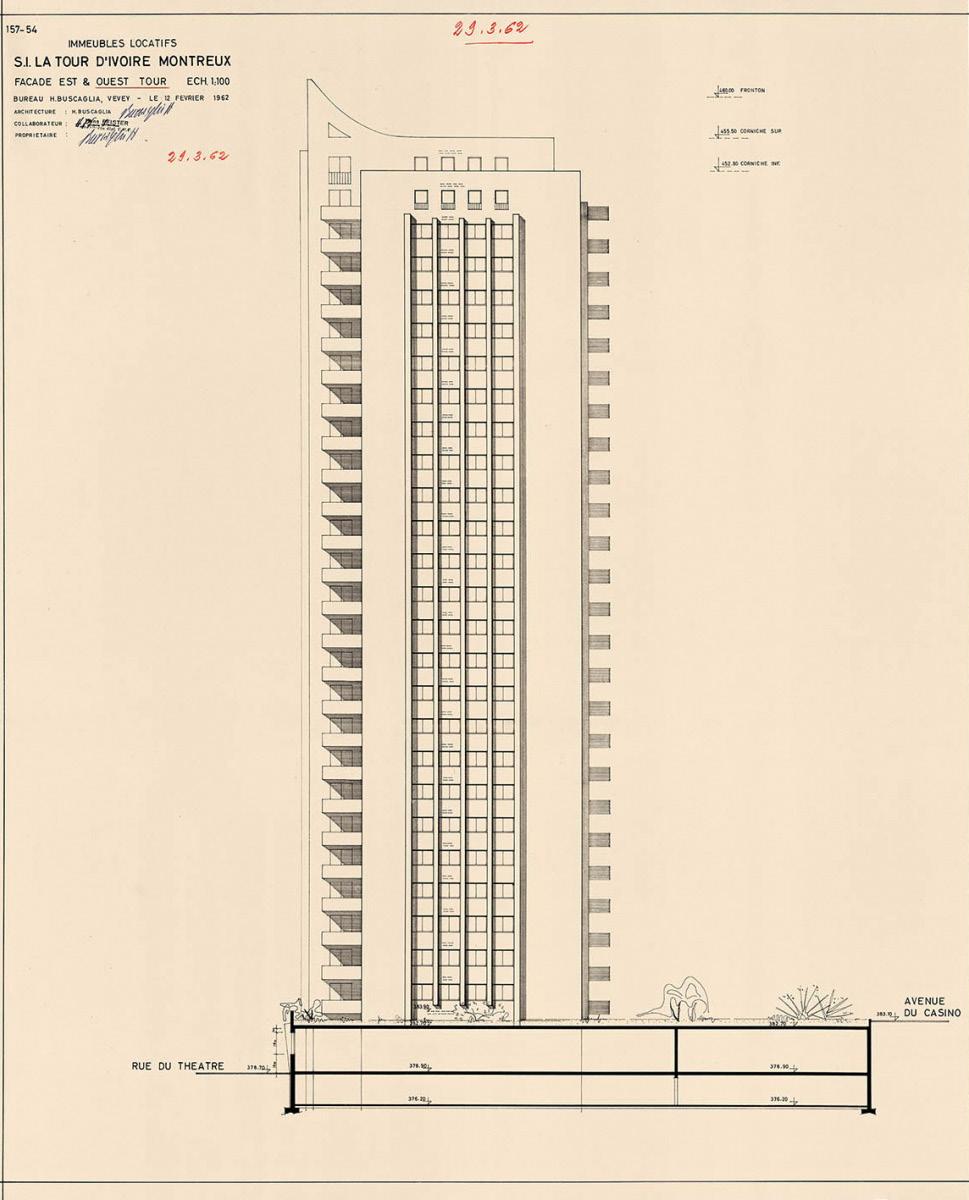



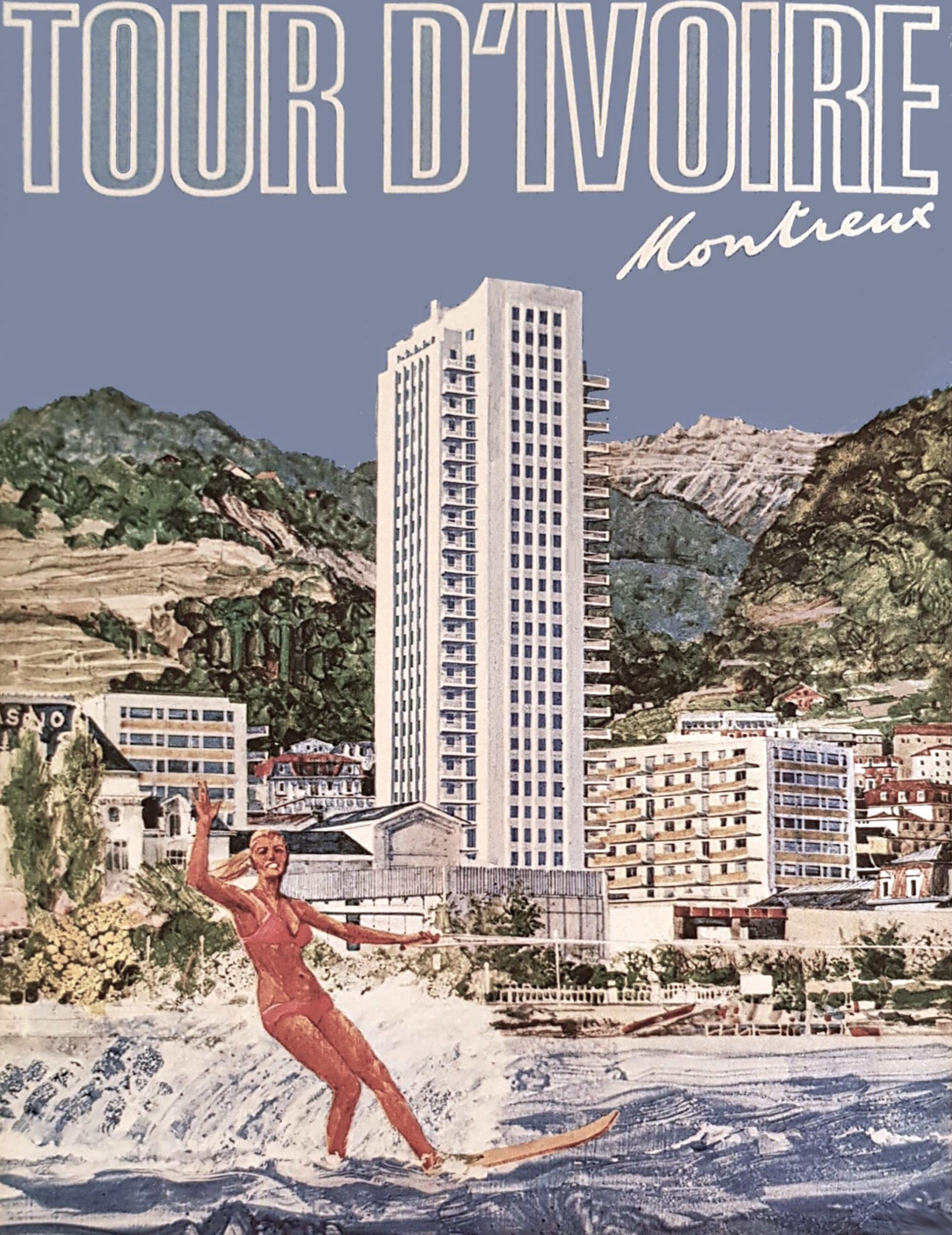





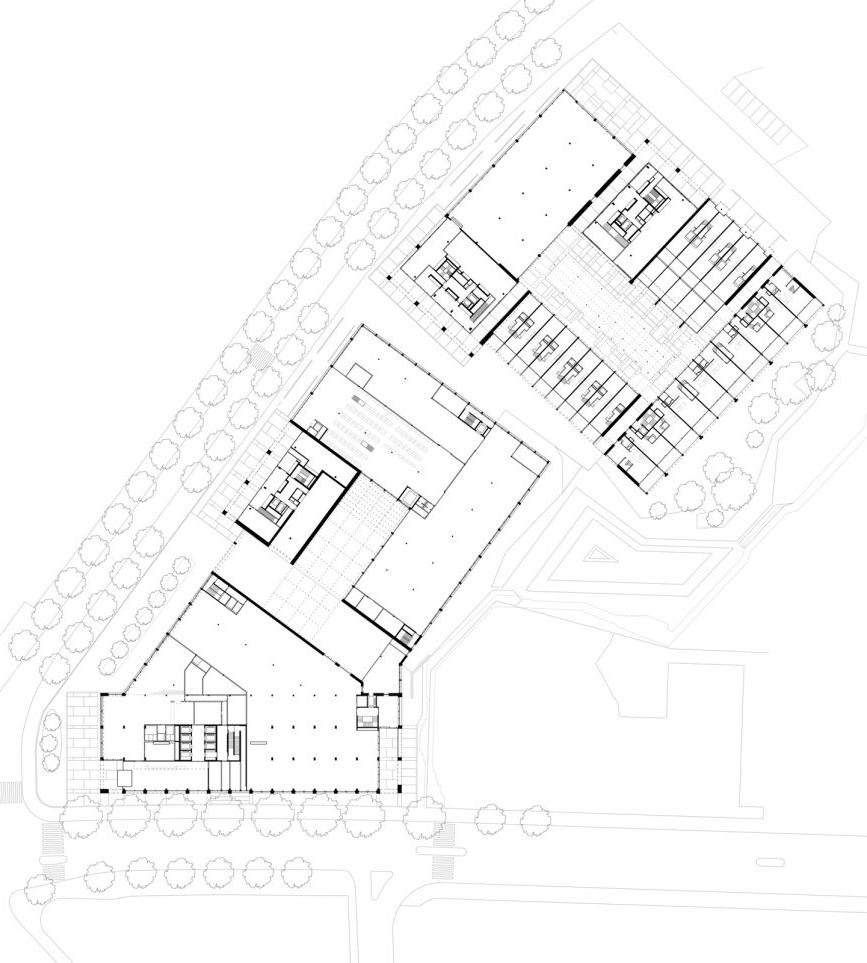











 Zölly Tower Zürich
Zölly Tower Zürich