JUSQU’OÙ SE COMPARER ?
Comment s’évaluer sans (trop) en sou rir



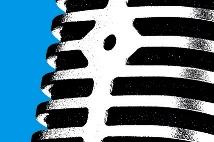
du Cerveau
Disponible sur www.cerveauetpsycho.fr/sr/braincast/ ainsi que sur toutes les plateformes de podcast

Braincast est le rendez-vous des amateurs des sciences du cerveau et de leurs derniers développements, qui transforment notre société et expliquent d’une façon nouvelle nos comportements, nos pensées, nos émotions, nos désirs…

Ce podcast emmènera l’auditeur dans une conversation avec un chercheur qui a marqué sa discipline, pour revenir sur sa vie, son parcours, ce qui l’a passionné dans le monde des neurosciences.







Ce moment privilégié, axé sur l’homme ou sur la femme dans leur dimension humaine et sur les fondements de la recherche en neurosciences, va ouvrir pour l’auditeur des fenêtres sur le fonctionnement de son propre cerveau.

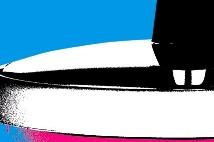


N°
p. 12-14
Diane Purper-Ouakil
Professeuse des universités et praticienne hospitalière de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, au Centre hospitalier universitaire de Montpellier, elle s’intéresse notamment aux troubles neurodéveloppementaux, comme le TDAH et l’autisme.



Rédacteur en chef
Maîtresse de conférences en physiologie et en neurosciences à Aix-Marseille Université, elle s’intéresse à la façon dont le cerveau construit le lien amoureux.


L’autre jour, j’ai appris que Bernard Arnault, le patron de LVMH, était l’homme le plus riche du monde. Apparemment, Elon Musk n’a pas apprécié. Il n’a plus que 171 milliards.
Professeur de psychologie du développement à l’université Paris-Cité, chercheur au Laboratoire de psychologie du développement et de l’éducation de l’enfant (Lapsydé), il mène des recherches sur le rôle des émotions dans la prise de décision et la créativité.
Cela vous fait sourire ? Moi, ça me console. Je ne suis pas le seul à me comparer. Même un multimilliardaire, qui n’aura pas assez de 1 000 existences pour dépenser le quart de sa fortune, peut se sentir frustré de voir son petit copain le coiffer au poteau du Nasdaq.
Je conseille donc à Elon Musk la lecture de ce numéro, où il pourra apprendre à se comparer intelligemment. Par exemple, à Jeff Bezos, qui n’a plus que 111 milliards après son coûteux divorce. Ha ! Ha ! On rigole, moins hein ?
La comparaison descendante, nous apprend le dossier central de ce numéro, n’est que la plus grossière des stratégies pour se rassurer quand l’estime de soi bat de l’aile. Les autres sont plus subtiles et plus épanouissantes, je vous laisse les découvrir.
p.
Vincent Trybou
Psychologue clinicien et psychothérapeute au Centre des troubles anxieux et de l’humeur (CTAH), à Paris, il assiste notamment les personnes sou rant d’un sentiment d’injustice dévastateur.
La vie est faite d’injustices, de toute façon. C’est pourquoi nous vous avons concocté un petit guide pour surmonter ce sentiment si douloureux de ne pas être traité avec équité. Au programme : TCC, thérapie de défusionnement, thérapie d’acceptation ou entraînement à l’assertivité. Et ça, je vous parie tous les milliards du monde que Jeff Bezos n’en a jamais entendu parler.
Moi, ça me console. £
N° 154 MAI 2023
p. 39-59
p. 6-35
p. 6 ACTUALITÉS
Quand les clowns ne font plus rire
Le doudou idéal
Mémoire de travail : des synapses modifiées
Alzheimer : le microbiote en cause ?

La vitamine D, contre le suicide

Sexe : planifié ou à l’improviste ?
p. 12 FOCUS
TDAH : un lien avec l’anxiété ?
La découverte d’un lien entre TDAH et troubles anxieux est une donnée nouvelle qui change la prise en charge.

Diane Purper-Ouakil
p. 16 CAS CLINIQUE
GRÉGORY MICHEL
Thibault est persuadé que son nez est di orme et n’ose plus aller au collège. Un trouble appelé « dysmorphophobie », qui peut se soigner.
p. 24 PSYCHOLOGIE
p. 39
ChatGPT
Le robot conversationnel ChatGPT semble attribuer des pensées aux humains…

Alex Wilkins
p. 28 NEUROBIOLOGIE
L’étude d’un rongeur monogame nous en dit long sur les bases de la fidélité.
Steven Phelps, Zoe Donaldson et Dev Manoli
p. 36
NEUROBIOLOGIE
Les liens entre sexualité et attachement durable apparaissent dans le cerveau. Entretien avec Sylvie Thirion
COMMENT S’ÉVALUER
SANS (TROP) EN SOUFFRIR
p. 40 PSYCHOLOGIE SOCIALE NÉS POUR SE COMPARER
Se comparer est indispensable pour se situer dans un groupe. Mais cette tendance a aussi des e ets indésirables…
Steve Ayan
p. 48 PSYCHOLOGIE SOCIALE
Entretien avec Mitch Prinstein

p. 52 PSYCHOLOGIE COMMENT SE COMPARER
Des méthodes simples permettent d’utiliser cette ressource sans en devenir l’esclave.
Christophe André

p. 56 DÉVELOPPEMENT DE L’ENFANT COLLABORER EST PLUS IMPORTANT QU’ÊTRE
Ce numéro comporte un encart d’abonnement Cerveau & Psycho, broché en cahier intérieur, sur toute la di usion kiosque en France métropolitaine. Il comporte également un courrier de réabonnement, posé sur le magazine, sur une sélection d’abonnés. En couverture : © fran_kie/Shutterstock
Chez les enfants, l’instinct de comparaison apparaît tôt. Il gagne être contrebalancé par une éducation à la coopération. Entretien avec Mathieu Cassotti
« LA QUÊTE DE STATUT SOCIAL EST À DOUBLE TRANCHANT »
p. 62 NEUROLOGIE
Henrik Müller
p. 64 NEUROLOGIE
« Les patients ont besoin d’une aide au quotidien »
Entretien avec Carlo Wilke

p. 68 L’ENVERS DU DÉVELOPPEMENT PERSONNEL
YVES-ALEXANDRE THALMANN
Démasquer un menteur à ses gestes ?

Une promesse mensongère !
p. 72 RAISON ET DÉRAISON
NICOLAS GAUVRIT
En modérateur des débats, ChatGPT n’a pas son pareil pour apaiser les esprits.

p. 76 PSYCHOLOGIE COGNITIVE
Le nombre d’idées originales semble baisser dans les réunions en distanciel.
Bret Stetka

p. 80 L’ÉCOLE DES CERVEAUX JEAN-PHILIPPE LACHAUX
Les interfaces de réalité virtuelle seront à l’avenir des outils d’apprentissage de plus en plus e caces.
p. 84 PSYCHOLOGIE
Voici six clés pour ne pas se laisser ronger de l’intérieur en cas de harcèlement, de licenciement abusif ou de divorce inique.

Vincent Trybou

p. 92 SÉLECTION DE LIVRES
Le Cerveau lésé
Le Juste équilibre

Le club des anxieux qui se soignent Quand les animaux font la guerre
L’Architecte invisible


La Nouvelle Peur des autres
p. 94 NEUROSCIENCES ET LITTÉRATURE
SEBASTIAN DIEGUEZ
Dans ce roman de 1941, l’écrivain Paul Morand dénonçait déjà les dangers d’une société où tout accélère.
Professeuse des universités et praticienne hospitalière de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent, au Centre hospitalier universitaire de Montpellier. FOCUS

Le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité, ou TDAH, est relativement fréquent et touche 3 à 9 % de la population. Malgré cela, il n’est pas toujours très bien diagnostiqué, notamment chez les adultes. Pourtant, les traits (ou symptômes) d’inattention, d’impulsivité et d’hyperactivité affectent sérieusement le bien-être et la qualité de vie, au quotidien et en société, ne serait-ce que pour la planifcation et l’organisation des tâches. Une nouvelle étude, parue dans la revue Scientifc Reports, vient ajouter un élément important à ce tableau : les personnes présentant des traits du TDAH ont aussi de forts risques de souffrir de symptômes d’anxiété et de dépression.
Se manifestant en général dès l’enfance, le TDAH est l’une des pathologies du développement cérébral les plus fréquentes, avec le trouble du spectre de l’autisme (TSA), que l’on sait déjà associé au risque de souffrir d’anxiété ou de dépression plus tard dans la vie, car
la recherche dans ce domaine est assez importante. Mais peu d’études se sont intéressées au TDAH et à ses conséquences sur la santé mentale. C’est donc ce qu’ont entrepris Luca Hargitai, de l’université de Bath, en Angleterre, et ses collègues en recrutant 504 participants, représentatifs en termes d’âge et de sexe des adultes vivant au Royaume-Uni, et en leur faisant remplir des autoquestionnaires permettant d’évaluer les caractéristiques du TDAH, du TSA, de l’anxiété et de la dépression.
Leurs résultats révèlent que les traits des deux troubles du développement sont fortement associés aux symptômes d’anxiété et de dépression. Mais les traits du TDAH le sont bien plus que ceux du TSA. En d’autres termes, les adultes souffrant de TDAH ont un risque encore plus élevé que les personnes autistes de développer anxiété ou
dépression, et ce d’autant plus que les symptômes neurodéveloppementaux sont marqués. Les chercheurs anglais émettent des hypothèses quant aux mécanismes en jeu. Les deux types de trouble partagent des facteurs génétiques communs, certains d’entre eux étant aussi liés à l’anxiété. Par ailleurs, les diffcultés d’inhibition comportementale dont font preuve les personnes atteintes de TDAH joueraient un rôle dans la survenue des symptômes de dépression et d’anxiété – via un défcit de contrôle des émotions –, d’autant que ces problèmes d’inhibition ont déjà été associés aux caractéristiques de la dépression dans une autre étude scientifque.
Ces nouveaux résultats ont le mérite de relier des traits associés aux deux principaux troubles du neurodéveloppement à des symptômes particulièrement fréquents chez
Le trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité semble associé à un risque accru de troubles anxieux. Une donnée à prendre en compte pour améliorer la santé mentale des jeunes comme des adultes.
l’adulte : l’anxiété et la dépression. Habituellement, ces domaines constituent des axes de recherche distincts, et les troubles du neurodéveloppement ou les caractéristiques qui leur sont associées ont tendance à être négligés dans la population adulte, tant en recherche qu’en pratique clinique. Or ces données de Luca Hargitai et de ses collègues soulignent que les traits du TDAH auraient une importance particulière dans l’apparition de symptômes dépressifs et anxieux, dont on peut supposer qu’ils se manifestent après les signes d’hyperactivité, d’impulsivité et d’inattention, habituellement présents dès l’enfance. Ces résultats rejoignent d’ailleurs les conclusions d’une métaanalyse récente qui a mis en évidence une association entre le TDAH et le trouble bipolaire, caractérisé par l’alternance d’épisodes d’euphorie et de dépression. Ainsi, le TDAH augmente le risque de trouble bipolaire et la présence de cette pathologie augmente réciproquement celui d’avoir des symptômes de TDAH.

Bien sûr, ces nouveaux travaux ont aussi leurs limites. Ils reposent sur des symptômes autodéclarés par le biais de questionnaires, sans procédure de confrmation d’un quelconque diagnostic, et le nombre de participants n’est pas très élevé pour ce type d’étude d’association. De plus, les chercheurs anglais ne font pas mention, dans leur discussion, des possibles facteurs environnementaux qui pourraient contribuer à la relation entre TDAH (ou TSA) et symptômes anxieux et dépressifs.
En effet, on sait que les traits associés à des particularités neurodéveloppementales augmentent le
Des traits comme l’hyperactivité, l’impulsivité ou l’inattention ont tendance à être négligés dans la population adulte, notamment chez les femmes, car elles font plus d’e orts que les hommes pour compenser leurs symptômes.
risque de stigmatisation sociale. D’ailleurs, dans le TDAH, les conséquences sociales, familiales ou scolaires des symptômes font ellesmêmes partie du diagnostic. Les enfants atteints de TDAH ont plus de risques d’être rejetés socialement, de subir des mauvais traitements ou d’être victimes d’accidents de la voie publique et domestiques. Ensuite, adultes, ils ont souvent des trajectoires de vie plus complexes que la population générale, marquées par de l’instabilité relationnelle et professionnelle.
Les enfants comme les adultes avec TDAH sont donc susceptibles d’être exposés à de l’adversité psychosociale ou à des événements traumatiques. Et ces facteurs environnementaux sont d’autant plus fréquents que les symptômes initiaux sont marqués, de sorte qu’ils vont à leur tour augmenter le risque de symptômes dépressifs et anxieux dans la trajectoire de vie de ces personnes.
LES FEMMES ET LES FILLES…
Par ailleurs, bien que cette étude n’ait pas mis en évidence d’effet spécifique du sexe sur l’association entre TDAH et symptômes dépressifs et anxieux, il est nécessaire de souligner un point important : la méconnaissance de ce diagnostic chez les flles et les femmes, source de reconnaissance et de traitement tardifs. En effet, chez les femmes, le trait prédominant du TDAH est l’inattention, mais elles produisent plus d’efforts dits « de compensation » pour atténuer les répercussions de leurs symptômes sur leur vie quotidienne. De sorte que l’expression clinique du TDAH chez les femmes est souvent moins bruyante et peut être masquée par d’autres troubles… Cependant, en médecine, on a clairement montré une association fréquente du TDAH avec les troubles dépressifs et l’exposition à des relations affectives insécurisantes ou à de la violence conjugale.
TDAH : UN LIEN AVEC L’ANXIÉTÉ ?
En attirant l’attention sur les relations mal connues entre traits du TDAH et symptômes d’anxiété ou de dépression, Luca Hargitai et ses collègues vont déjà nous pousser à approfondir davantage les recherches sur ce trouble chez l’adulte. L’idéal serait de mener des études de suivi de populations pour mieux comprendre la séquence temporelle des symptômes et les facteurs de risque ou de protection associés. Mais ces données, et les autres disponibles, doivent déjà nous alerter sur les caractéristiques communes à ces diffcultés, en particulier celles qui sont modifables. Car on peut agir pour améliorer la reconnaissance et le traitement du TDAH, chez les adultes et en particulier les femmes, et ainsi diminuer le retentissement des symptômes sur la vie personnelle et sociale. On peut aussi modifer les représentations négatives associées à cette pathologie et agir pour un environnement plus respectueux des besoins des personnes concernées et de leur entourage. Par ailleurs, un état dépressif ou anxieux, surtout récurrent ou ne répondant pas bien aux thérapies, devrait également faire rechercher un trouble du neurodéveloppement, en particulier un TDAH… £
Bibliographie
Luca D. Hargitai et al., Attention-deficit hyperactivity disorder traits are a more important predictor of internalizing problems than autistic traits, Scientific Reports, 2023
E. Khoury et al., Meta-analysis of personal and familial co-occurrence of attention deficit/hyperactivity disorder and bipolar disorder, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 2023
S. P. Hinshaw et al., Annual research review : Attention deficit/ hyperactivity disorder in girls and women : Underrepresentation, longitudinal processes, and key directions, Journal of Child Psychology and Psychiatry, 2022
Les di cultés d’inhibition comportementale des personnes atteintes de TDAH joueraient un rôle dans la survenue des symptômes de dépression et d’anxiété – via un déficit de contrôle des émotions.
AcademiaNet offre un service unique aux instituts de recherche, aux journalistes et aux organisateurs de conférences qui recherchent des femmes d’exception dont l’expérience et les capacités de management complètent les compétences et la culture scientifque.

La base de données qui rassemble toutes les femmes scientifques de renommée internationale
Partenaires
AcademiaNet, base de données regroupant toutes les femmes scientifques d’exception, offre:

• Le profl de plus des 2.300 femmes scientifques les plus qualifées dans chaque discipline – et distinguées par des organisations de scientifques ou des associations d’industriels renommées
• Des moteurs de recherche adaptés à des requêtes par discipline ou par domaine d’expertise

• Des reportages réguliers sur le thème »Women in Science«






Professeur de psychologie clinique et de psychopathologie à l’université de Bordeaux, chercheur à l’Institut des sciences criminelles et de la justice, psychologue et psychothérapeute en cabinet libéral, et expert auprès des tribunaux.

£ Thibault, 13 ans, s’isole de plus en plus depuis quelques mois, sans raison apparente pour ses proches et ses amis.
£ Mais en réalité, il a peur de son physique – un nez un peu gros et des seins qui poussent –, et fait tout pour se cacher.

£ On parle de dysmorphophobie ; la thérapie va lui permettre de s’accepter et de se confronter à nouveau au regard des autres.
Un mercredi en fin d’aprèsmidi, je reçois un jeune garçon, accompagné de ses deux parents, car un collègue médecin m’a demandé de le voir. Le père, avec qui j’ai eu une conversation téléphonique quelques jours auparavant, m’a informé que son fls cadet s’isolait de plus en plus et qu’il avait, depuis quelques semaines, des diffcultés à se rendre au collège, sans raison apparente…
Dans la salle d’attente, Thibault, vêtu d’un sweat à capuche noir avec un chino bleu marine et des baskets grises, est assis sur un fauteuil entre ses deux parents, en scrollant sur les réseaux sociaux. Son père, lui aussi habillé en sportswear, feuillette une revue, alors que sa mère, d’un style plus classique – robe et cardigan sombres –, semble répondre sur son smartphone à des messages professionnels.
« Bonjour Thibault. » À son prénom, le jeune adolescent tourne la tête vers moi avec un regard inquiet. Son père, crispé mais souriant, se lève aussitôt et sa mère, gênée, me demande
Lorsque Thibault refuse d’aller au collège, ses parents suspectent une phobie scolaire. Mais en consultant un psy, ils découvrent que le jeune ado sou re d’une tout autre phobie : elle concerne son nez…© Cerveau et Psycho, d’après Oleg Samoylov/Shutterstock
si elle doit également venir, visiblement encore occupée à rédiger son dernier message. Je lui réponds que, pour ce premier entretien, je souhaite recevoir tout le monde. Thibault suit son père et s’installe sur le fauteuil situé au milieu de ses parents. Visage tourné vers son père, légèrement baissé, et regard dissimulé par ses cheveux, le garçon semble attendre que son papa prenne la parole… « C’est sur les conseils de notre médecin que je vous ai contacté, car notre fls nous inquiète… Il voit de moins en moins ses amis et se plaint depuis quelques mois d’aller à l’école. »
Thibault reste silencieux. Il est très tendu, les poings serrés tremblant sur ses cuisses. Malgré ses cheveux qui cachent son visage, je note ce qu’on appelle dans notre jargon une hypomimie fagrante : ses traits sont fgés, peu expressifs, et il évite soigneusement mon regard. Sa mère, plus en retrait, acquiesce à chaque déclaration de son conjoint. « Nous ne comprenons pas ce qui se passe. Depuis quelques semaines, il a des maux de ventre et a même refusé d’aller au collège plusieurs matinées… Notamment lorsqu’il avait natation. Nous craignons que cela évolue vers une phobie scolaire. »

Alors que Thibault reste toujours muré dans son silence, sa mère ajoute : « Ce qui est compliqué, c’est que notre fls ne dit rien… On a pensé qu’il y avait eu des problèmes à l’école, qu’il avait été harcelé. Mais mon mari a rencontré sa professeuse principale et elle n’a rien remarqué. » Comme les parents semblent se focaliser sur le collège, je demande à Thibault ce qu’il en pense. Il prend beaucoup de temps pour me répondre : « L’école ne me fait pas peur… » « Alors qu’est-ce qui te fait peur ? Dis-nous. On est là pour ça, précise son papa d’un ton angoissé. Ça fait beaucoup plus longtemps que ça que tu ne vas pas bien. Tu te replies sur toi depuis l’année dernière, tu as même laissé tomber le handball. Et tu te réfugies beaucoup sur ton téléphone. » Thibault se met à haleter, ce que j’interprète comme une gêne respiratoire jusqu’au moment où je m’aperçois qu’il retient des sanglots. Il est temps que je m’entretienne seul à seul avec lui.
Ses parents sortis, le jeune adolescent reste fgé, ses tremblements aux mains s’étant même propagés légèrement au niveau du visage, où je perçois des microcontractions à la commissure des lèvres. Une dystonie – des spasmes musculaires involontaires – de la mâchoire nuit même à l’élocution de ses premiers mots. Il s’exprime diffcilement, donnant l’impression d’une dysarthrie – un
dysfonctionnement neurologique de l’exécution de la parole –, tant l’émission des sons est peu intelligible. Sa voix est basse et son ton voilé, bas et monotone lui confère une teinte dépressive certaine. Son regard, absent ou bien fuyant, donne une impression d’immobilité, voire de passivité. Les signes d’anxiété sociale sont palpables et bien trop prégnants pour s’expliquer par la seule timidité que m’ont décrite ses parents. L’angoisse est omniprésente.
Après un temps de silence, il me dit enfn : « Je ne veux pas parler de moi, je n’ai rien à dire ! » En retrait et muet depuis plus d’une heure, le voilà maintenant sur la défensive et dans l’opposition. Aurait-il un secret à cacher ? Tout au long de l’échange qui suit, il évite mon regard comme si je risquais de découvrir un secret inavouable et honteux qu’il tenterait à toute force de dissimuler. Et je ne suis pas loin du compte. Au cours de notre deuxième consultation, trois jours plus tard, il déclare : « Mes parents n’ont rien compris, ne savent rien… Ce n’est pas le collège qui me fait peur, c’est moi. C’est mon physique. »
Son corps serait-il donc la cause de son retrait social ? Pour le découvrir, faisons connaissance avec Thibault. Âgé de 13 ans, scolarisé en classe de quatrième, Thibault a un frère de 17 ans prénommé Paul, qui est en terminale. Son père est enseignant d’histoire-géographie dans le secondaire et sa mère travaille en tant que directrice des ressources humaines dans une grande entreprise. La famille semble très unie ; la mère, très impliquée dans son activité professionnelle, rentre souvent tard au domicile, donnant au père une plus large latitude dans l’éducation de leurs deux enfants.
Thibault a été très désiré, la grossesse et l’accouchement se sont parfaitement bien déroulés. Son développement psychomoteur ne présente aucune diffculté, il a été propre, a marché et parlé à des âges tout à fait normaux. Durant sa première année, il a été gardé par ses grands-parents paternels, avant de passer deux années en crèche. Son adaptation à l’école maternelle s’est déroulée de façon satisfaisante, sans aucun signe d’anxiété de séparation. Dès son entrée dans les apprentissages, il s’est situé dans les premiers de sa classe et cela a duré tant en primaire qu’au collège.
Les parents me décrivent Thibault comme étant plutôt introverti et timide, sans toutefois que cela ait nui à ses relations sociales. « C’est un enfant très sensible, très émotif, et il a toujours eu des copains dès la maternelle… Et comme il est très sentimental, il a surtout eu un meilleur ami », précise son père. Dès l’âge de 6 ans, le garçon a suivi des cours de dessin, puis s’est investi dans les sports collectifs à partir de 9 ans, notamment dans le handball, comme son frère Paul et son père. Mais depuis septembre dernier, il rechigne à continuer le sport. « Cela fait maintenant deux mois qu’il ne veut plus aller aux entraînements », précise son père.
Je m’interroge alors un peu plus sur son parcours scolaire et extrascolaire. Mais je ne découvre aucun élément d’anxiété sociale ni de performance. Il ne s’est jamais plaint de stress lié aux examens, ou aux devoirs à la maison, ou encore moins aux matchs de handball. Au contraire, le garçon aime apprendre et se dit passionné par son sport et par l’histoire. Sa période préférée est la Seconde Guerre mondiale. « Mon
grand-père, qui est né en 1942, m’a donné beaucoup d’archives et de documents sur ce sujet. Avec mon père, on les classe depuis que je suis tout petit. Ça me passionne. » Aucune brimade à signaler de la part des autres élèves ou des professeurs. Sa scolarité n’est pas source de peurs, comme le redoutaient ses parents. Thibault ne souffre d’aucune phobie scolaire.
Mais alors, d’où viennent ses angoisses ? Je reparle alors de son isolement social depuis septembre dernier, comme l’a décrit son père. L’adolescent tente d’éluder ma question. Puis il se met à minimiser les propos de ses parents : « C’est vrai, depuis quelque temps, je préfère être seul… Je lis des romans historiques, et ça me va très bien. » Thibault a toujours des copains, certes, mais il s’en est éloigné physiquement, alors qu’il reste en contact avec eux sur les réseaux sociaux. La cause de cette distanciation : lors d’une dispute « avec ses potes » à propos d’une jeune flle de sa classe, il y a plus d’un an, son meilleur ami Théo lui a dit : « T’es moche avec ton nez énorme… Il est comme une grosse patate. » Un incident mineur en apparence… Mais qui a fait écho aux propos tenus non seulement par son frère, mais aussi par sa mère. « Mon frère m’a déjà dit que j’avais un gros nez et que je ressemblais à ma grand-mère maternelle. C’est d’ailleurs en raison de mon nez que ma mère dit souvent que je tiens surtout d’elle. »
Et enfant, il se souvient qu’il entendait souvent ses parents se moquer de sa grand-mère à cause de son fort appendice nasal. Son frère avait même tendance à le comparer exagérément aux personnages d’une bande dessinée de Lucky Luke, offerte par un de leurs cousins. « C’est l’album Les Rivaux de Painful Gulch. Il m’a marqué. C’est l’histoire de deux familles qui se font la guerre ; l’une se caractérise par des gens ayant d’énormes oreilles et dans l’autre, ils ont un nez monstrueux, c’est la famille O’Timmins. » Le nez est donc l’organe d’attention de toute la famille de Thibault.
LE SYNDROME DE CYRANO
À la puberté, cet intérêt presque « pathogène » pour son nez s’est renforcé avec l’apparition, dès l’âge de 11 ans, d’une importante acné. Complexé, il a alors consulté une dermatologue et, comme beaucoup de jeunes adolescents, s’est montré hyperattentif, voire très sensible, à ce que les autres pensaient de tous ses boutons…
Progressivement, Thibault est devenu obsessionnel envers son nez, et cela continue : il passe des heures à le scruter dans le miroir, se prend en photo puis retouche l’image de son visage, et
Mes parents n’ont rien compris, ne savent rien…
Ce n’est pas le collège qui me fait peur, c’est moi. C’est mon physique.
Thibault, 13 ans
MAÎTRESSE DE CONFÉRENCES EN PHYSIOLOGIE ET EN NEUROSCIENCES À AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ ET PRÉSIDENTE DE L’ASSOCIATION VALBIOME ( VALORISATION DES SCIENCES BIOMÉDICALES)

La neurobiologie de l’amour est-elle identique chez l’homme et le campagnol ? Identique, bien sûr que non. Mais on observe de fortes similarités. En particulier, l’activation du circuit cérébral de la récompense lors d’un contact avec le partenaire, et le rôle d’hormones comme l’ocytocine et la vasopressine dans le lien amoureux.
Une étude récente a montré que des campagnols privés de récepteurs à l’ocytocine restent capables de s’attacher à leurs congénères.

Ces résultats ne vous semblent donc pas remettre en cause le rôle de l’ocytocine ?
Pas du tout ; ce que ces résultats nous disent, c’est que la situation est plus complexe qu’on ne l’a d’abord cru. Si l’ocytocine est la plus étudiée,
d’autres hormones interviennent dans le lien amoureux, en particulier la vasopressine, dont la structure chimique est très voisine, ou la dopamine. Des mécanismes compensatoires peuvent donc se mettre en place, surtout quand les gènes codant les récepteurs de l’ocytocine sont supprimés dès le stade embryonnaire, comme c’est le cas dans l’étude que vous citez. Cela ne remet nullement en cause l’infuence de l’ocytocine sur l’attachement, attestée par des dizaines d’études, aussi bien chez le campagnol que chez l’humain.
Qu’ont montré ces études, par exemple ?
Elles ont montré que plus le taux d’ocytocine est élevé chez deux partenaires amoureux, plus leur lien est fort (ce qu’on mesure par des questionnaires standardisés, où les participants doivent, par exemple, indiquer le niveau de satisfaction dans le couple ou la fréquence des activités partagées). La force du lien est également corrélée à l’activité cérébrale dans certaines zones du circuit de la récompense riches en récepteurs de l’ocytocine, comme le noyau accumbens, en présence du partenaire. On pense donc que cette neurohormone participe, via cette activation, à créer un sentiment de plaisir associé à une personne particulière, ainsi que le désir d’être avec elle.
L’ocytocine est en effet libérée lors des contacts physiques – caresses, câlins, baisers, rapports sexuels… –, mais pas avec n’importe qui. Dans une expérience, les chercheurs ont caressé avec un

pinceau le tibia de volontaires placés dans un appareil d’IRM fonctionnelle (IRMf). Rien de bien fun, a priori ! Pourtant, quand on disait aux participants que c’était leur partenaire amoureux qui tenait l’ustensile, les zones de leur cerveau riches en récepteurs de l’ocytocine s’activaient plus fortement que lorsqu’on prétendait que c’était une inconnue. Il existe donc une sorte de cercle vertueux : avoir un lien fort entraîne des comportements qui déclenchent une libération d’ocytocine, ce qui renforce le lien.
Finalement, notre espèce estelle monogame ou polygame ?
Diffcile de répondre d’un point de vue neurobiologique. La monogamie est plutôt la norme dans un certain nombre de sociétés, dont la nôtre, mais toutes les confgurations sont possibles. Et cela se traduit par des différences visibles dans le cerveau. Dans une étude, une vingtaine d’hommes devaient observer des photographies romantiques, sexuelles ou neutres, après avoir indiqué s’ils étaient en couple exclusif ou s’ils avaient des relations multiples. Or le circuit de la récompense s’est davantage activé à la vue de photos romantiques (qui ne représentaient pas leur partenaire) chez les participants monogames que chez les polygames. Aucune différence n’était observée avec les photos sexuelles ou neutres.
Certains hommes sont-ils alors biologiquement plus doués pour l’attachement ?
La difficulté dans ce genre d’étude est de distinguer l’œuf et la poule : est- ce parce que ces hommes étaient sensibles aux expériences romantiques qu’ils ont bâti un couple durable, ou est- ce parce qu’ils ont vécu des moments positifs dans leur couple qu’ils sont devenus sensibles à ces expériences ?
Les gènes ont en tout cas une infuence. Une étude très complète a été réalisée chez de jeunes époux, soumis à toute une série de mesures
au moment de leur mariage et un an plus tard : IRMf pendant qu’ils regardaient une photographie de leur partenaire, qualité de la relation évaluée par des questionnaires, analyses génétiques, prélèvements biologiques… Les résultats ont confrmé l’importance de diverses hormones (l’ocytocine, la vasopressine, la dopamine) dans la construction du lien amoureux, mais ils ont aussi montré que les porteurs de certains variants génétiques avaient une activité cérébrale plus intense dans les zones du circuit de la récompense riches en récepteurs de ces hormones. Comme si ce circuit s’activait plus facilement chez eux à l’évocation d’un partenaire amoureux.

Il est cependant trop tôt pour en conclure que certains sont plus doués biologiquement pour s’attacher, car les chercheurs n’ont encore analysé que de petites fractions isolées des circuits impliqués. Autre précision importante, il n’y a pas de fatalité : si l’on n’est pas porteur de
ces variations génétiques prédisposantes, il reste toujours possible d’activer les circuits de l’attachement de façon volontaire, en entretenant une certaine proximité physique et en ayant un comportement attentionné l’un envers l’autre. C’est un peu comme pour le sport : même quand on n’a pas des prédispositions physiques incroyables, si on s’entraîne intensément, on deviendra bien plus fort qu’un « génie naturel » qui passe ses journées dans le canapé !
Observe-t-on des di érences entre l’homme et la femme dans la neurobiologie de l’amour ?
Au niveau de l’activité cérébrale, il y a de forts recoupements entre les sexes, même si on observe en effet quelques différences : par exemple, quand la personne regarde une photo du partenaire, c’est plutôt une zone appelée « insula postérieure », spécialisée dans la perception des stimulations sensorielles (visuelles,
auditives, etc.), qui s’active chez l’homme, et plutôt l’insula antérieure, impliquée dans les ressentis émotionnels, chez la femme. En revanche, du point de vue de l’ocytocine, il n’y a aucune différence. Les concentrations sanguines sont identiques entre les deux sexes : plus élevées quand la personne est en couple, plus basse quand elle est célibataire, de façon équivalente.
Hommes et femmes sont donc tous deux dotés d’un solide appareil neurobiologique pour l’attachement. Une étude a même montré que lorsqu’un jeune père prend son nouveau-né dans ses bras, un pic d’ocytocine survient, ce qui ne se produit pas quand il étreint un bébé inconnu. Ce pic entraîne une diminution de la concentration de testostérone, très liée au désir sexuel – et donc sans doute une baisse de l’envie d’aller batifoler ailleurs. Autre conséquence, le père reste plus en lien avec la mère, plus focalisé sur son couple et sa famille. Ce qui fait sens du point de vue de l’évolution, tant les nouveau - nés humains exigent des soins parentaux.
Peut-on déduire des pistes pour renforcer son couple sur la base de ces connaissances ?
Oui, ce que ces résultats nous disent, c’est que tout ce qui contribue à maintenir un taux d’ocytocine élevé renforce le couple, en créant du lien et une certaine motivation à le faire durer : les étreintes, les baisers, l’activité sexuelle, et plus généralement toute forme d’interaction plaisante (partager des loisirs, voire simplement discuter avec son partenaire d’un flm ou d’une pièce de théâtre qu’on a aimée, active les circuits de l’ocytocine). Ces conseils sont fnalement assez classiques, mais ils prennent une force nouvelle avec la découverte de ces mécanismes neurobiologiques.
Si les activités possibles sont très variées, le contact physique garde
Bibliographie
B. P. Acevedo et al., After the honeymoon, Frontiers in Psychology, 2020
A. K. Kreuder et al., How the brain codes intimacy, Human Brain Mapping, 2017
L. D. Hamilton et C. M. Meston, Di erences in neural response to romantic stimuli in monogamous and non-monogamous men, Archives of Sexual Behavior, 2017.
S. Cacioppo et al., The common neural bases between sexual desire and love, The Journal of Sexual Medicine, 2012
I. Schneiderman et al., Oxytocin during the initial stages of romantic attachment, Psychoneuroendocrinology, 2012
un pouvoir inégalé sur les circuits de l’attachement. Une étude réalisée sur des personnes en couple depuis plus de dix ans a montré que plus elles avaient des rapports sexuels fréquents, plus les zones riches en récepteurs de l’ocytocine dans leur circuit de la récompense s’activaient fortement à la vue de leur partenaire. Même après dix ou vingt ans ensemble, l’attachement est très étroitement lié à ce circuit, et aux sentiments de plaisir et de désir – au sens de motivation à aller vers l’autre – qu’il procure. Bien sûr, ces sentiments sont souvent ressentis de façon moins « famboyante » qu’au début, mais ils sont toujours là. Et n’oubliez pas : là où l’activation spontanée des circuits de l’attachement détermine fortement le comportement amoureux des campagnols, nous gardons davantage de liberté. Nous avons en effet des capacités de planifcation et de prise de recul très supérieures, de sorte que si notre couple revêt une importance majeure dans notre vie, nous pouvons choisir de stimuler délibérément ces circuits qui façonnent le désir d’être ensemble. £
Propos
par Guillaume Jacquemont
recueillis
Contrairement aux campagnols, nous pouvons choisir de stimuler délibérément les circuits cérébraux qui façonnent le désir d’être ensemble.
p. 40
Nés pour se comparer
p. 48 Interview
« La quête de statut social est à double tranchant »
p. 52
Comment se comparer à bon escient
p. 56 Interview
« Collaborer est plus important qu’être premier »
Vous voilà arrivé à la fin de l’année, et les nouvelles sont bonnes : votre entreprise a réalisé d’importants bénéfices. Votre patron vous annonce que vous allez toucher une prime équivalente à trois mois de salaire ! Bien sûr, vous êtes tout heureux et songez déjà aux belles vacances que vous allez pouvoir vous o rir. Mais pile à ce moment votre voisin de bureau entre et vous annonce qu’il a touché l’équivalent de six mois. Une sensation de brûlure vous perfore l’estomac, tout votre plaisir est gâché. Nous ne semblons apprécier les choses que par comparaison. Et cela nous empoisonne la vie. Comment nous libérer de cette tendance qui nous colle à la peau ? Ce dossier vous donne des clés pour user des comparaisons plus intelligemment. Le but n’est pas de les éliminer – c’est impossible –, mais de les limiter au strict nécessaire et de ne surtout pas se focaliser dessus. Par exemple, en se demandant si l’on a soimême progressé à l’aune de ses propres exigences, ou en apprenant à réguler les émotions négatives qu’on ressent dans les situations de comparaison défavorable. Car à trop se comparer, on en oublie parfois de savourer.
Sébastien Bohler
Se comparer aux autres semble un véritable réflexe. Son origine serait un besoin de reconnaissance profondément enfoui en nous. Mais comment le satisfaire sans que cela tourne à la compétition et au casse-tête ?
Deux silhouettes d’allure hostile se font face. Elles se heurtent, reculent en titubant, se bousculent sans qu’aucune parvienne à s’imposer. Puis, d’un seul coup, l’une d’elles s’incline et laisse passer l’autre. Les observateurs de la scène peuvent ensuite décider avec lequel des deux personnages ils veulent jouer. Vers qui le choix se porte-t-il ? Vingt des 23 sujets préfèrent celui qui s’est imposé à l’issue de cette confrontation. Mais seulement si le perdant a cédé de luimême – si le « vainqueur » l’a bousculé, alors c’est la victime qui est la plus appréciée.
Il ne s’agit pas d’une scène tirée d’un jeu télévisé, mais d’une sorte de théâtre de marionnettes au service de la science, dont les spectateurs étaient âgés de 2 ans. Les deux adversaires étaient des petites fgurines ressemblant à des poupées. Avec leur étude de 2018, les psychologues de l’équipe de Ashley Thomas, de l’université de Californie à Irvine, ont confrmé que les enfants en bas âge ont déjà un sens aigu de ce qu’on appelle le « statut social ». Et, de façon invariable, ils se tournent vers ceux qui sont respectés. De toute évidence, la poupée évitante se soumettait à l’autre, sinon elle n’aurait pas quitté le terrain de son plein gré.

D’autres travaux de recherche, menés ces dernières années, démontrent que les enfants plus âgés recherchent également des camarades de jeu qui sont assurés de l’admiration et de la reconnaissance des autres. Les psychologues sociaux expliquent ainsi cette orientation précoce vers le statut : savoir qui est très respecté dans un groupe et lui être le plus proche ou le plus semblable possible augmente les chances de bénéfcier de son rayonnement et d’être également considéré. Alors, il faut bien comparer les différents protagonistes.
Il y a probablement derrière cela une profonde empreinte évolutionnaire chez l’homme. Dès la naissance, nous avons besoin de soins et de soutien ; sans la compétence et la bienveillance des autres membres de notre propre groupe, nous serions perdus. Par conséquent, même les plus petits s’intéressent de près aux signaux qui indiquent le statut social relatif de leurs proches.
On sait que les communautés humaines ne sont pas homogènes. Il existe en leur sein de nombreux ordres et hiérarchies, des chefs et des suiveurs ainsi que des spécialistes pour différentes tâches, de la recherche de nourriture aux soins des enfants. Dans de telles conditions, il est essentiel pour sa propre prospérité de reconnaître le rang social des uns par rapport aux autres et d’élever le sien autant que possible sur cette échelle. Comme le montre l’expérience de la poupée, le fait que le statut social repose sur la dominance d’un individu ou sur son prestige n’est pas indifférent dans cette affaire. Les dominants misent sur l’intimidation et la peur en menaçant ceux qui ne se soumettent pas à leur bon vouloir de sanctions pouvant aller jusqu’à la violence ouverte. Ils imposent leurs exigences aux autres en cherchant à briser leur résistance. Les personnes jouissant d’une grande réputation n’ont en revanche guère besoin de cela : on fait confance à leurs capacités et à leur engagement, on leur attribue donc d’offce une position de premier plan.

Les études de psychologie révèlent que, dans le registre du sport, de la beauté ou du succès, nous nous comparons volontiers à des icônes. Celles-ci nous présenteraient une sorte d’idéal à atteindre…
En 2015, une équipe dirigée par le psychologue Cameron Anderson, de l’université de Californie à Berkeley, a mis en avant l’« hypothèse du statut » dans ces processus. Selon cette hypothèse, tout part d’une quête de reconnaissance comme motif humain universel, qui guide nombre de nos pensées et de nos comportements, et nous amène à nous comparer. D’un point de vue psychologique, le statut d’un individu se compose de trois éléments : le respect et l’admiration des autres, leur subordination volontaire, et un rang élevé dans la hiérarchie du groupe. Ces dimensions permettent de distinguer le statut social de concepts apparentés, comme le statut
« Il ne su t pas d’être heureux, encore faut-il que les autres soient malheureux. »
Pierre Desproges
socioéconomique qui décrit la prospérité relative d’une personne – c’est-à-dire son revenu, son éducation et sa situation professionnelle –, parfois assez différent ; ainsi, certains peuvent avoir peu d’argent et de pouvoir matériel, mais beaucoup de prestige – c’est le cas des artistes, des érudits, voire des religieux dans de nombreuses sociétés. Cela montre également qu’il n’existe pas une forme unique de statut, et que celui-ci varie notamment en fonction du groupe de référence dans lequel évolue un individu, comme de son domaine de compétence ; ainsi, une personne peu considérée par ses collègues peut être très respectée par sa famille – ou vice versa. Et telle autre peut être très sollicitée pour ses conseils en cas de confit, mais pas pour des questions techniques ou fnancières.
Les gens attribuent généralement un certain statut à leurs semblables de manière assez rapide et automatique, tout en prenant en compte une grande variété d’indices. Le simple « test de l’échelle » offre une possibilité de mesurer cela dans le cadre d’expériences. On présente à des volontaires l’image d’une échelle à dix barreaux et on leur demande sur quel échelon ils placeraient leur propre statut. Si on ne précise pas à l’intérieur de quel groupe ils doivent se situer (leur famille, leurs collègues, la société entière, etc.), ils se basent généralement sur leur environnement privé – famille, amis ou voisins. On pourrait alors supposer que les personnes interrogées se comparent positivement et estiment régulièrement que leur propre statut est supérieur à celui des autres personnes du groupe. Étonnamment, ce n’est guère le cas : l’autoestimation correspond assez bien à celles livrées par les autres membres de la communauté. Dans une étude menée par des psychologues autour de Dacher Keltner, également de l’université de Californie à Berkeley, la corrélation, c’est-à-dire la mesure du lien statistique entre deux valeurs, était d’environ 0,5. Une valeur considérée comme élevée lorsqu’il s’agit de relier des paramètres psychologiques.
La grande congruence des jugements d’autrui et de soi-même est probablement liée au fait que les erreurs d’appréciation à propos de son propre statut sont particulièrement préjudiciables. Imaginez que vous fassiez comprendre à vos collègues, à vos camarades d’université ou à d’autres membres de votre club de sport que vous êtes bien plus respectable et plus remarquable que les autres. C’est le moyen le plus effcace de se rendre immédiatement impopulaire ! Par conséquent, si
les gens surestiment souvent leur intelligence, leur ouverture d’esprit ou leur rapidité, ils ont généralement une perception assez juste de leur rang social et en tiennent compte (à l’exception des narcissiques pathologiques).
Malgré tout, une question se pose : surévaluer ses propres capacités aiderait-il à obtenir réellement un meilleur statut aux yeux des autres ? C’est ce que les psychologues Cameron Anderson et Jessica Kennedy ont voulu savoir en 2012. Lors de leurs expériences, ils ont varié les activités : dans un premier temps, les participants devaient réaliser diverses tâches d’estimation, comme dessiner la position de grandes villes sur une carte vierge des États-Unis, déterminer la valeur moyenne d’une série de chiffres, ou encore estimer le poids de personnes vues sur des photographies. Puis, ils étaient soit informés de leurs performances réelles, soit fattés par des
Des personnes à qui on attribue une certaine note sur l’importance de leur statut social dans un groupe vont se sentir bien si le statut global de leur groupe d’appartenance est plutôt bas (à gauche), mais beaucoup moins si leur groupe possède déjà un fort statut (à droite). Les chercheurs en concluent que la recherche de statut est compétitive : nous ne désirons pas seulement un statut élevé, mais plus élevé que celui des autres.
Mitch Prinstein, la popularité dont on jouit en tant qu’adolescent, au lycée, a-t-elle des conséquences plus tard dans la vie ?
De façon tout à fait remarquable, les résultats de la recherche suggèrent que même quarante ans plus tard, il est possible de prédire le niveau de diplôme universitaire d’un individu, de réussite professionnelle, son recours à l’aide sociale, voire un certain nombre de problèmes de santé mentale ou

d’addictions, en observant à quel point il était populaire au lycée. Ce facteur permet même de prédire notre santé physique : les personnes les moins « populaires » dans l’enfance sont plus susceptibles de souffrir de maladies cardiovasculaires et métaboliques, des décennies plus tard, que celles qui étaient appréciées. Une analyse a suggéré que les risques d’une impopularité sur notre mortalité seraient aussi forts que ceux liés au tabagisme !
Le plus surprenant, cependant, est que cela joue un rôle qui ne peut être expliqué entièrement par le statut socioéconomique, le QI, les antécédents familiaux ou l’apparence physique. Il y a quelque chose dans la façon dont nous sommes considérés par les autres qui change nos trajectoires de vie de façon signifcative et substantielle.

Mais qu’entendez-vous au juste par le terme de « popularité » ?
C’est une question importante, car la plupart des gens ne savent pas que les scientifques ont identifé deux types de popularité différents, chacun associé à des résultats très différents. Dans l’enfance, on la déf-
nit comme le fait d’être plus ou moins apprécié des autres. Les enfants les plus populaires sont ceux qui ont une sorte de capacité à mener les autres avec calme sur une situation, qui les aident et coopèrent avec eux. Ce type d’infuence prédit de nombreux résultats positifs à long terme.
Un deuxième type de popularité apparaît toutefois à l’adolescence, refétant les changements dans nos circuits neuronaux déclenchés par les hormones de la puberté. C’est à cette période que la popularité commence à reféter notre statut plutôt que notre seule sympathie. Tous les marqueurs de statut – la visibilité dans un groupe, l’infuence, la domination et fnalement le pouvoir –activent les centres de récompense de notre cerveau et modifent à jamais notre relation avec ce qu’on appelle la « popularité ». En effet, tout au long de notre vie d’adulte, nous avons le choix entre rechercher une plus grande sympathie de la part de nos semblables ou un meilleur statut dans nos groupes – une décision rendue beaucoup plus diffcile par le nombre croissant de plateformes (téléréalité, médias sociaux, etc.) conçues pour nous aider à obtenir un certain rang.
En fait, l’importance que nous accordons aujourd’hui à un statut facile à obtenir est peut-être plus forte qu’elle ne l’a été à tout autre moment de l’histoire de l’humanité. Cela pose un problème. En effet, contrairement aux résultats positifs associés à une vive sympathie, les résultats de la recherche indiquent que jouir d’un statut élevé conduit plus tard à des comportements plus agressifs, un risque d’addictions plus lourd, à des émotions qui sont de l’ordre du ressentiment, et même dans certains cas à une désespérance.
Pouvez-vous m’en dire plus sur les problèmes que vous entrevoyez dans la quête de statut ? Ces diffcultés concernent d’une part les individus lancés dans cette quête, et d’autre part l’ensemble de la société qui subit les conséquences de cette dynamique. Les résultats de recherches, comme celles publiées par Joe Allen, professeur à l’université de Virginie, indiquent que les personnes qui se soucient le plus de leur statut social ont des diffcultés dans leurs relations interpersonnelles des années plus tard. Elles font une fxation sur ce domaine et même
Les personnes qui ont le plus soif de statut social sont également les plus susceptibles de sou rir plus tard d’anxiété, de dépression ou de problèmes de toxicomanie.
sur le statut des autres, plutôt que sur les attributs qui peuvent conduire à une relation humaine épanouie. D’autres recherches suggèrent que les personnes qui désirent le plus obtenir cet attribut sont les plus susceptibles de faire état plus tard d’anxiété, de dépression et de problèmes de toxicomanie.
Sur le plan sociétal, certains signes indiquent déjà que notre désir de statut occasionne aussi des dégâts. Si l’on compare la situation actuelle avec ce qu’il en était il y a seulement quelques décennies, les recherches suggèrent que les objectifs de vie affchés dans les sociétés consuméristes refètent encore davantage le souhait de posséder plus de biens, d’acquérir plus de pouvoir et de se sentir plus visible et infuent que les autres. Une grande partie de la jeunesse reçoit le message selon lequel le nombre d’adeptes de leurs médias sociaux est un accomplissement qui mérite d’être activement recherché. Pourtant, ironiquement, plus nous recherchons ces marqueurs de statut en ligne – retweets, likes, partages –, plus nous nous sentons segmentés et déconnectés les uns des autres.
Étiez-vous populaire quand vous étiez enfant ?
Pas vraiment. Avec mon mètre quatre-vingt-dix en classe de seconde, et une intransigeante assiduité en cours depuis la maternelle, j’étais plutôt un modèle de nerd ! Mais je pense que j’étais sympathique. Et il s’est avéré que c’était plus important.
Comment cela a-t-il influencé votre vie ?
Des études montrent que les personnes appréciées bénéfcient de privilèges qui se renforcent et se perpétuent. Dans l’enfance, ceux qui sont appréciés sont invités à se joindre aux autres plus souvent, et chacune de ces interactions offre des occasions supplémentaires d’acquérir des compétences qui étaient refusées à leurs pairs peu appréciables et exclus. Au fl du temps, ces compétences leur attirent une sympathie de plus en plus prononcée, mènent à des occasions d’apprentissage supplémentaires, et ainsi de suite, créant un cycle qui conduit les personnes chaleureuses à jouir non seulement d’une réputation plus positive, mais aussi d’aptitudes et de compétences plus développées.
Cela vaut aussi pour les adultes. De deux employés aussi qualifés l’un que l’autre, le plus agréable visà-vis de son entourage ira statistiquement plus loin dans sa carrière, non pas pour des questions de favoritisme, mais parce qu’il deviendra plus avantageux objectivement de travailler avec lui.
Si vous me posez la question de mon cas, je peux dire que j’ai eu de la chance et qu’un bon sens de l’humour à propos de mes différences physiques à l’adolescence m’a permis d’éviter les cas les plus fagrants d’intimidation et de nouer des amitiés avec mes pairs qui m’ont guidé vers de bonnes décisions et de nouvelles opportunités. Je n’étais pas ce qu’on pourrait appeler un individu « cool », mais j’étais capable de m’adapter à la plupart des contextes et d’acquérir des compétences dont je me sers encore aujourd’hui.
Existe-t-il des moyens de convaincre les gens de passer de la recherche du statut à celle d’une popularité socialement agréable ?
Notre besoin de considération fait littéralement partie de notre ADN. En tant qu’adultes, nous avons toutefois la possibilité de choisir le type de reconnaissance que nous recherchons. Pour certains, le simple fait de savoir qu’il existe ces deux orientations possibles sera en soi une aide pour réféchir sur leur comportement passé et poser un regard critique sur ce qui les motive parfois de façon inconsciente. Une fois que vous avez compris le lien scientifquement établi entre la quête de statut pur et ses retombées plutôt négatives, il devient beaucoup plus facile de se concentrer davantage sur la sympathie. Mais pour d’autres personnes, cela peut prendre un peu plus de temps. £
Propos recueillis par Gareth Cook, lauréat du prix Pulitzer et rédacteur en chef de la rubrique d’information en ligne Mind Matters, de la revue Scientifc American.
Tous les marqueurs de statut – la visibilité dans un groupe, l’influence, la domination et finalement le pouvoir –activent les centres de récompense de notre cerveau.
Marie-Aline verse chaque année 1% de son chiffre d’affaires à des associations agréées 1% for the Planet dont La Terre en Partage. onepercentfortheplanet.fr

En ce matin de Noël, les enfants déballent leurs cadeaux, mais Margot, 7 ans, est crispée : elle surveille du coin de l’œil son frère et sa sœur, et surtout leurs cadeaux à eux ! Les parents l’observent, un peu inquiets, car ils savent que chaque année, c’est la même chose, Margot est déçue par ses jouets : ils lui semblent toujours moins beaux que dans ses rêves ; et moins beaux aussi que ceux des autres.
Non loin de là, son cousin Lucas, 15 ans, scrolle fébrilement sur ses réseaux sociaux, et
découvre que ses amis ont l’air de passer de meilleures fêtes que lui : ils publient chaque jour des photos de beaux endroits, et d’activités passionnantes. En comparaison, ses vacances lui semblent ternes.
Plus tard dans la soirée, ses parents discuteront à voix basse des parents de Margot, qu’ils aiment bien pourtant : mais leurs visites les mettent dans l’inconfort, car ces derniers font mieux qu’eux en tout – leur maison est plus grande, leur voiture plus belle, leurs situations professionnelles plus brillantes. Pourtant, les parents de Lucas ont une vie qui leur convient, et ne sont pas à plaindre dans ces domaines.
Margot, comme Lucas et ses parents, voit sa fête de Noël gâchée par le poison des comparaisons. Ils sont loin d’être les seuls : pourquoi les comparaisons sociales nous font-elles si souvent souffrir ?
En théorie, elles devraient nous être utiles : observer ce qui arrive aux autres pourrait nous servir de source d’information pour ajuster nos comportements et nos efforts. Les chances et
Il y a de bonnes et de mauvaises comparaisons. Savoir les distinguer est essentiel pour vivre avec nos semblables sans être esclaves du miroir qu’ils nous tendent.
réussites de nos semblables devraient nous réjouir et surtout nous inspirer : car l’apprentissage par imitation de modèle est central dans l’espèce humaine, comme cela a été montré dès les années 1960 par le psychologue canadien Albert Bandura, professeur à Stanford.
Mais non, lorsque nous nous comparons aux autres, la souffrance n’est jamais loin. D’où les nombreux dictons qui le rappellent : « Comparaison égale poison », « Comparaison n’est pas raison ». C’est que nous ne sommes pas des ordinateurs, capables d’évaluer froidement et rationnellement les écarts entre nous et les autres, et de planifer les actions pour les combler. Toute pensée humaine s’accompagne d’émotion, et l’émotion de la comparaison est souvent l’envie, dont le philosophe Descartes disait : « Il n’y a aucun vice qui nuise tant à la félicité des hommes […]. »
Rien d’étonnant alors à ce que les comparaisons aient un si grand impact sur deux piliers
de cette « félicité » : nos capacités au bonheur et à l’estime de soi…
Dans le monde de la psychologie positive, un modèle explicite a été proposé pour expliquer nos diffcultés à nous satisfaire de ce que nous avons : le modèle des « trois gaps ». Pour gâcher mon bonheur actuel, je n’ai qu’à le comparer : à celui de mes semblables (comparaison avec les autres) ; à celui que j’attendais (comparaison avec mon idéal) ; à ceux que j’ai connus autrefois (comparaison avec le passé).
Insatisfaction garantie ! D’autant plus que, dans chacune de ces comparaisons, nous sommes victimes de distorsions largement documentées : pour les autres, nous voyons toujours l’herbe plus verte dans leur jardin ; pour l’idéal, le fait d’avoir des attentes quant aux bonheurs à venir les altère ; pour le passé, on l’embellit presque toujours, par le phénomène du biais de positivité, lié à l’évocation de souvenirs personnels (le fameux « c’était mieux avant »).
Globalement, les études sur les personnes qui se disent heureuses montrent qu’elles ont moins
£ Nous avons le réflexe de nous comparer, car nous sommes des animaux sociaux qui cherchons à ajuster notre position à notre statut.
£ Dans notre société hyperconnectée, les comparaisons tournent vite au supplice, car nous avons mille occasions de tomber sur des personnes plus attirantes ou populaires que nous.
£ Pour ne pas en sou rir, sachons aussi nous comparer à ceux qui réussissent moins bien, voire à nous-mêmes dans le passé, pour constater les progrès accomplis.
£ Enfin, reconnaître que les situations de véritable compétition sont rares apporte un soulagement certain.
tendance à comparer leur situation à celle des autres ; et que si elles le font, c’est plutôt « vers le bas », avec des gens moins chanceux qu’elles.
UN SUPPORT DE L’ESTIME DE SOI
Structurellement, l’estime de soi est un sociomètre nous indiquant comment nous percevons inconsciemment notre valeur sociale : comment les autres nous apprécient, nous approuvent, nous admirent. Et comment nous positionner par rapport à eux ; avec cette diffculté que les informations sur ce positionnement sont si précieuses, voire vitales pour savoir comment nous comporter et à quoi prétendre auprès des autres, qu’elles doivent être constamment mises à jour et réajustées. D’où le rôle central des comparaisons dans l’établissement et la stabilisation (ou non) de l’estime de soi.
Le fonctionnement de ces comparaisons est complexe, car, comme nous l’évoquions plus haut, elles ne sont jamais objectives. Par exemple, on a en général tendance à s’estimer légèrement supérieur à la moyenne. C’est l’effet « meilleur que la moyenne » (better than average effect), bien connu de la psychologie sociale : la plupart des gens se jugent meilleurs conducteurs, meilleurs étudiants, meilleurs enseignants, etc., que les autres. Mais ce biais ne fonctionne que si on se compare aux autres de loin et au calme !
Si on est perturbé (placé en situation de compétition ou stressé au préalable), alors les comparaisons que nous établissons avec nos semblables nous sont moins systématiquement favorables. C’est ce que l’on retrouve chez les personnes qui souffrent d’anxiété et de dépression, qui en général ne procèdent qu’à des comparaisons défavorables, c’est-à-dire avec des individus mieux lotis qu’elles.
Pourquoi le fait de se comparer nous causet-il tant de tracas et de frustration ? La réponse est simple : parce que nous sommes des animaux sociaux perturbés. Et chacun de ces trois termes compte…
« Animaux » : la comparaison est un mécanisme largement répandu dans le monde animal, à la fois pour apprendre des compétences de la part de ses semblables, mais aussi pour juger du côté acceptable ou non d’une situation sociale. Dans une étude classique, des chercheurs apprenaient à deux petits singes à accomplir une tâche simple ; ils les récompensaient alors par un morceau de concombre. Les cages étant voisines, les singes voyaient ce qui se passait chez le copain. Un jour, l’un des deux singes obtient une friandise pour le travail accompli, alors que son collègue ne reçoit que le concombre réglementaire : comparant les deux récompenses, ce dernier
s’emporte alors, et refuse la sienne, qu’il jette au visage de l’expérimentateur. Nous sommes en outre des animaux sociaux : nous l’avons évoqué, la comparaison est nécessaire chez les animaux qui vivent en groupes riches d’interactions complexes, pour ajuster notre position à notre statut :
comparer permet de jauger à quelle place prétendre. La comparaison est, sans doute, parfois douloureuse chez les animaux dotés d’émotions, comme les mammifères, mais globalement plus utile que toxique : elle évite d’entrer en compétition avec plus fort ou plus puissant que soi, et de s’en trouver puni.
DES ANIMAUX SOCIAUX PERTURBÉS
Enfn nous sommes des animaux sociaux perturbés… par la société que nous avons nousmêmes créée ! Les sociétés humaines sont parmi les plus inégalitaires du monde animal et conduisent, par conséquent, à des comparaisons vers le haut douloureuses. Elles sont très compétitives et insécurisées (qui peut prétendre aujourd’hui être sûr de garder son métier et son statut social ad vitam æternam ?), et engendrent donc des comparaisons incessantes et épuisantes. Elles sont enfn, dans leur version contemporaine, immensément mensongères : elles nous incitent à des comparaisons non seulement avec nos semblables et nos proches, mais aussi avec des humains ultracompétitifs, comme des mannequins et des stars, ultratransformés et embellis (comme cela se fait sur les réseaux sociaux). Un exemple : lorsque jadis nos ancêtres comparaient leur apparence physique avec celle des autres, ils regardaient autour d’eux, leur famille et leurs voisins, et il y avait fort peu de chance qu’un top model soit dans les parages ! Aujourd’hui, les corps que nous voyons le plus souvent ne sont plus ceux de nos proches, mais ceux de célébrités mises en avant par les médias ; comme elles sont,

Pour gâcher mon bonheur, je n’ai qu’à le comparer : à celui de mes semblables (comparaison avec les autres) ; à celui que j’attendais (comparaison avec mon idéal) ; à ceux que j’ai connus autrefois (comparaison avec le passé).Consolations, celles que l’on reçoit et celles que l’on donne, L’Iconoclaste, 2022.
au départ, favorisées par la nature, qu’elles consacrent leur temps à leur apparence, et que leurs images sont magnifées à dessein, la comparaison ne peut tourner qu’en notre défaveur !
Tout ce qui précède nous conduit donc à accepter que les comparaisons sont inévitables, et qu’il est préférable d’en avoir conscience afn d’en faire un usage lucide et mesuré. Voici quelques remarques pouvant nous guider dans cette « hygiène mentale de la comparaison ».
Tout d’abord, nous pouvons choisir avec qui nous comparer selon les situations et les besoins. Certaines comparaisons peuvent même nous remonter le moral. « Je me regarde, je me désole ; je me compare, je me console », dit le proverbe. Si nous prenons soin de ne pas seulement comparer vers le haut (avec les mieux lotis), mais aussi vers le bas (avec les moins chanceux), nous nous donnons une chance à la fois de mieux prendre conscience de notre bonheur, mais aussi de stabiliser notre estime de soi. Voilà pour l’aspect émotionnel ; d’autres travaux menés auprès d’étudiants et publiés en 2023 ont montré que la comparaison vers le haut sert plutôt nos objectifs de développement personnel, tandis que celle tournée vers le bas sert à nous valoriser.
Ensuite, l’envie qui naît souvent des comparaisons gagne à être domestiquée, voire sublimée. Il faut garder à l’esprit que l’envie est un ressenti fréquent, et souvent culpabilisant. Elle peut prendre une forme dépressive (« j’aimerais tant, moi aussi, réussir ainsi ; mais je ne suis pas capable, pas à la hauteur ») ou agressive (« pourquoi ces imbéciles sont-ils plus heureux et estimés que moi ? »). Tous nos efforts gagnent dès lors à la réorienter vers une envie dite « émulative » : « Si ce que les autres ont me fait envie, je ferais bien de mieux observer ce qui leur a permis d’en arriver là, pour m’en rapprocher moi aussi par mes efforts. »
Un autre moyen de limiter la survenue de l’envie, et de mieux vivre les comparaisons, consiste à porter un regard empreint d’admiration vers ce qui nous semble plus beau et plus haut. Les émotions sociales positives, telles qu’émerveillement, bienveillance ou compassion, non seulement nous rendent plus agréables à fréquenter, mais aussi nous permettent de nous sentir plus heureux et estimés d’autrui, comme l’ont montré d’assez nombreuses études.
À défaut, mieux vaut se comparer à soi-même qu’aux autres. En effet, dans la poursuite d’un objectif, se jauger par rapport à des personnes qui
sont en avance sur nous n’a d’utilité que pour s’inspirer de leurs stratégies, pas pour juger de nos progrès. Or il est tout aussi important de savoir si l’on est sur le bon chemin. D’où l’intérêt de se comparer avec… soi-même, en n’oubliant pas d’où nous sommes partis, quels progrès nous avons accomplis, etc.
RENONCER AUX COMPÉTITIONS INUTILES
« L’homme humble ne se croit – ou ne se veut –pas inférieur aux autres : il a cessé de se croire – ou de se vouloir – supérieur », écrit le philosophe André Comte-Sponville. Être humble, c’est se méfer des compétitions inutiles : pourquoi vouloir à tout prix être partout dans les premiers ? Parce que je le vaux bien ? Slogan publicitaire plus que source de sagesse… Il y a dans nos vies quelques situations réellement compétitives : le sport, certains concours dans nos études ou nos métiers… Pour le reste, vouloir faire toutes les courses en tête nous apportera plus de stress que de bonheur, plus d’insécurité que d’estime de soi.
Il faut en cela bien repérer le danger venu des miroirs et incitations que nous tend la société de l’hypercommunication. Le principe même des écrans (cinéma, télévision, magazines, et bien sûr réseaux sociaux) tient au fait qu’ils sont des vitrines à ego. Chacun s’y présente sous son meilleur profil, et n’y raconte que les meilleurs moments de sa vie. Une bonne hygiène de la comparaison suppose de se souvenir de ce fait à chaque fois que nous y plongeons. Et de s’y plonger le moins souvent possible !
Mais au fond, peut-on oublier la question : « Qu’est-ce que je vaux ? » Il existe des situations où elle devient en quelque sorte caduque. Ce sont toutes celles où l’on s’engage dans des mouvements associatifs ou politiques pour changer la société : militer pour l’acceptation (et non la valorisation) des différences, pour une société plus inclusive et moins compétitive… Se dédier à une cause fait souvent paraître secondaire la question de savoir si l’on est mieux ou moins bien que le voisin.
Finalement, les comparaisons, auxquelles notre esprit ne peut échapper, ne sont donc qu’un outil, une fonction, dont il nous appartient de faire bon usage, afn qu’elles ne soient pas, comme le notait le philosophe Gustave Thibon, un prétexte à « toujours se démener pour rejoindre ou pour dépasser autrui ». Et qu’au contraire, selon les mots d’un autre philosophe, Alain, « la comparaison éclaire nos pensées afn de les faire marcher du même pas que le monde » : autrement dit, comparer pour s’ajuster. On le voit, la réfexion sur l’art de bien se comparer ne date pas d’hier… £
A. Bandura et R. H. Walters, Social Learning and Personality Development, Holt, Rinehart and Winston, 1963.
S. Deri et al., Home alone : Why people believe others’social lives are richer than their own, Journal of Personality and Social Psychology, 2017
S. Lyubomirsky et L. Ross, Hedonic consequences of social comparison, Journal of Personality and Social Psychology, 1997.
M. R. Leary et R. F. Baumeister, The nature and function of self-esteem : Sociometer theory, Advances in Experimental Social Psychology, 2000
T. Du ues et al., Don’t look up ! Individual income comparisons and subjective well-being of students in Thailand, Journal of Happiness Studies, 2023.

Directeur de recherche à l’Inserm, au Centre de recherche en neurosciences de Lyon.
Imaginez apprendre l’anglais dans une version numérique de la ville de Londres, ou les mathématiques dans un monde géométrique en 3D… Les interfaces de réalité virtuelle le proposeront dans l’avenir, mais c’est déjà possible en partie en entraînant son cerveau.
Lorsque je suis allé voir le film Avatar 2, c’était dans le but d’apprécier la qualité d’illusion que la technologie est maintenant capable d’entretenir dans le cerveau des spectateurs. Et j’avoue avoir été abasourdi par cette impression de ne plus être en train de regarder les personnages d’un flm, mais de vivre une aventure à leurs côtés, au sein même de leur groupe, avec la sensation qu’à tout moment, l’un d’entre eux pouvait se tourner vers moi pour me tendre un objet ou m’adresser la parole.
Cet effet est bien connu des spécialistes de la réalité virtuelle, qui s’y intéressent à travers des concepts comme
celui de « téléprésence » (je me sentais réellement présent dans ces scènes pourtant distantes) ou bien d’« illusion de nonmédiation » et de « suspension de la noncroyance » (j’oubliais totalement que j’étais assis dans une salle en train de regarder une histoire fctive projetée sur un écran). Le neuroscientifique Olaf Blanke, spécialiste de la sensation du soi et de sa présence dans l’espace, va jusqu’à proposer avec son équipe que cette téléprésence utilise des ressorts neuronaux similaires à ceux qui sont responsables de l’illusion de « sortie du corps » : cette sensation d’occuper une région de l’espace différente de celle de son propre
corps, qui peut être déclenchée en activant des régions cérébrales bien précises. C’est dire à quel point ce flm transforme notre perception de la réalité.
Malheureusement, Avatar utilise surtout cette qualité d’immersion pour faire vivre des situations de guerre à des enfants et des adultes, en les privant de toute distance par rapport à la violence des scènes – j’ai eu une pensée émue pour les chercheurs qui attendent patiemment qu’un comité d’éthique les autorise à montrer des petits ronds et
des carrés sur un écran à des enfants à des fns expérimentales. Mais au-delà du questionnement éthique, il ne fait nul doute que la qualité d’immersion de ce flm – qui sera bientôt courante dans tous les jeux de réalité virtuelle – peut être mise à proft pour l’apprentissage. Il est envisageable d’imaginer, par exemple, d’« envoyer » un élève dans une ville d’Allemagne au sein d’un groupe de petits Allemands, avec qui il devrait trouver un moyen de communiquer pour résoudre des énigmes, et donc apprendre progressivement le vocabulaire et la grammaire nécessaires pour ce faire. À condition que l’interaction sociale soit

suffsamment réaliste et crédible – dans ce sens, on constate les progrès constants des agents conversationnels avec l’exemple de ChatGPT –, les conditions seraient idéales pour maximiser le niveau d’engagement de cet élève, qui apprendrait la langue au fur et à mesure de ses besoins, en constatant immédiatement l’intérêt de tout ce qu’il apprend.
Engagement et motivation, besoin d’apprendre pour un objectif immédiat, correction instantanée de ses erreurs, soutien et intérêt du groupe : autant
d’éléments connus pour être de grands moteurs de l’apprentissage et qui facilitent les progrès dès les premiers âges de la vie. Pour l’instant, certaines études montrent déjà un apport de la réalité virtuelle pour l’engagement des élèves et leur motivation – notamment pour apprendre les langues étrangères, mais il faut bien prendre en compte le caractère encore très peu réaliste des interactions sociales – et donc de la téléprésence – dans la génération actuelle de programmes. Avatar nous permet d’entrevoir ce qu’elle sera dans un futur proche… et avec les sommes ahurissantes investies dans la mise au point de
véritables univers virtuels (le fameux métavers), il est clair que ce type d’applications est au coin de la rue.
Pourtant, on peut aussi se demander si toute cette technologie n’est pas un peu encombrante et fnalement peu utile au vu de ce que notre cerveau est déjà capable de faire sans qu’il soit besoin de rien lui ajouter. Je vous incite à faire l’expérience suivante : regardez simplement une tasse ou un verre, en imaginant autant que possible les sensations que vous auriez au niveau des doigts en les manipulant, afn de bien faire attention à leur forme en 3D : « ressentez-vous » le contact du matériau et sa résistance ? En vous concentrant de la sorte, vous rehaussez l’activité de régions visuelles – dans le lobe pariétal – qui sont chargées d’analyser la forme tridimensionnelle des objets afn de préparer leur saisie, en lien avec le cortex moteur. En jouant simplement avec son attention, il est donc possible d’augmenter cette impression de 3D et de rendre ainsi le monde moins « plat », comme dans le flm Avatar (avouez qu’il est étrange qu’il faille utiliser son attention pour cela, sachant que le monde est vraiment tridimensionnel). Ce type d’exercice est utile pour apprendre à manipuler des objets de façon très précise (des instruments de musique, par exemple), ou bien tout simplement pour se préparer à bien se concentrer pour tracer un cercle au compas ou écrire proprement. Et j’ai déjà évoqué dans ces colonnes comment l’imagerie mentale – visuelle et somesthésique – aidait à comprendre des concepts mathématiques comme celui de bissectrice d’un angle.
Un deuxième jeu attentionnel peut faire penser à la réalité augmentée (cette technologie qui projette une image virtuelle sur une image réelle). Considérez un instant le mot tervetuloa, qui signife « bienvenue » en fnnois, puis recopiez-le sur une feuille de papier, en ayant pris
soin au préalable de le « voir écrit » sur cette feuille, à l’endroit précis où vous vous apprêtez à l’écrire. Dans une démarche de réalité augmentée, l’idée est que l’image mentale du mot – avec toutes ses lettres – apparaisse comme « projetée » sur le papier au point de vous servir de calque. En procédant ainsi, vous portez une attention particulière à ce mot et à son orthographe, qui va renforcer son empreinte dans votre mémoire…
Le cerveau humain est donc très bien équipé pour créer une impression de réalité augmentée, sans aide technologique. D’ailleurs, de nombreux sportifs de haut niveau l’utilisent au quotidien : je me souviens d’un footballeur professionnel connu pour la qualité de ses dribbles qui m’avait expliqué voir spontanément s’affcher sur la pelouse l’image mentale de la trajectoire qu’il devait suivre avec le ballon pour esquiver les défenseurs ! Par conséquent, n’hésitons pas à exploiter dès maintenant – avant l’avènement d’une réalité virtuelle et augmentée hyperréaliste – tout ce que notre cerveau est déjà capable de produire tout seul au prix d’une simple gymnastique attentionnelle : une réalité 0.0 low cost et low tech, mais bigrement effcace et sans bug informatique. £
Bibliographie
J. Garzón et al., Systematic review and meta-analysis of augmented reality in educational settings, Virtual Reality, 2019.
B. Herbelin et al., Neural mechanisms of bodily self-consciousness and the experience of presence in virtual reality, pp. 80-96, in Andrea Gaggioli (éd.), Human Computer Influence, De Gruyter, 2016.
S. V. Symonenko et al., Virtual reality in foreign language training at higher educational institutions, 2 nd International Workshop on Augmented Reality in Education, 2020
A. E. Welchman, The human brain in depth : How we see in 3D, Annual Review of Vision Science 2, 2016
La qualité d’immersion de ce film peut être mise à profit pour l’apprentissage, en maximisant l’engagement des élèves : dans l’acquisition d’une langue, par exemple, ils constateraient en temps réel et en situation l’intérêt des progrès accomplis.






































