HORS-SÉRIE
« C’est un peu grâce au Soleil que la physique quantique est née ! »
Roland Lehoucq
Astrophysicien au CEA

Les sœurs cachées du Soleil

« C’est un peu grâce au Soleil que la physique quantique est née ! »
Roland Lehoucq
Astrophysicien au CEA

Les sœurs cachées du Soleil
Les plus belles photos de notre étoile Se préparer aux tempêtes solaires
Les multiples scénarios de la fin du Soleil
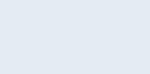

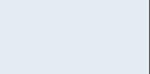
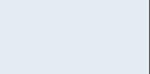
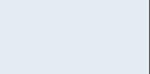
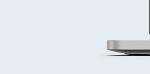
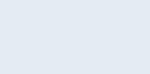
MAGAZINE / HORS-SÉRIE / DIGITAL / 25+ ANS D’ARCHIVES


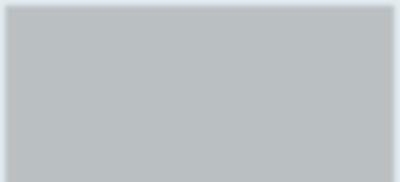


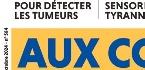







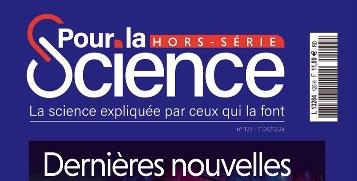
















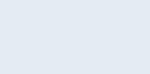




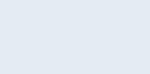




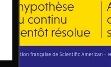


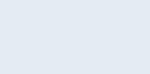
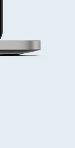







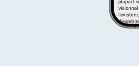
Choisissez votre formule d’abonnement pourlascience.fr/abonnements









Édition française de Scientific American








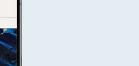
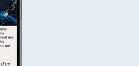






08.25/09.25
HORS-SÉRIE
Ont contribué à ce numéro
par Loïc Mangin Rédacteur en chef adjoint à Pour
la Science
On prête à Paul Valéry l’idée que « la philosophie occidentale a une dette envers la lumière de la Méditerranée », et donc envers le Soleil si généreux à l’égard des nombreuses cultures qui se sont épanouies autour de cette mer. Symbole de ce pan de l’histoire, Homère, dans L’Odyssée, décrit Hélios comme un dieu « qui porte la joie dans le cœur des hommes », y compris, sans doute, celui d’un autre Grec, Anaxagore. Moins porté sur les divinités, le philosophe fut le premier, dès le Ve siècle avant notre ère, à voir dans le Soleil une étoile comme les autres.
Héritiers de ces deux traditions, nous sommes les enfants de ce Soleil, et comme le dit le générique d’une célèbre série animée, nous parcourons « la Terre, le ciel » en quête non de « mystérieuses cités d’or », mais d’informations toujours plus précises sur notre étoile. De fait, jamais télescopes terrestres ni engins spatiaux n’ont été si nombreux à scruter le Soleil. La moisson de connaissances est riche, et ce numéro en est la preuve. C’est aussi que notre sort en dépend, car nous sommes à la merci d’une tempête solaire : il faut nous y préparer et donc, en amont, comprendre. Le même Paul Valéry a rmait en 1919 : « Nous autres, civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortelles. »
Savait-il que son cher Soleil pouvait y jouer un rôle ?




www.pourlascience.fr
Roland Lehoucq est astrophysicien à l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers (Irfu) au Commissariat à l’énergie atomique, à Saclay.
Carine Babusiaux est astronome à l’institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble. Elle est membre de la collaboration Gaia
Joe Westlake est directeur de la division héliophysique au centre des missions scientifiques de la Nasa, à Columbia, dans le Maryland, aux États-Unis.
Anna Ho est professeuse d’astronomie à l’université Cornell, à Ithaca, aux États-Unis, et spécialiste d’astrophysique des hautes énergies.
p. 18 Le turbulent passé de la Voie lactée
Ann Finkbeiner
L’histoire de notre Galaxie est plus tumultueuse qu’on ne le pensait.
p. 6 Repères
Des schémas, des chi res, des définitions… : toutes les clés pour entrer sereinement dans ce numéro.
p. 10 Grand témoin
Roland Lehoucq
p. 26 « Le Soleil s’est formé lors du premier passage de la galaxie du Sagittaire au-dessus du centre de la Voie lactée »
Entretien avec Carine Babusiaux
p. 32 La traque des sœurs perdues
Simon Portegies Zwart
Le Soleil serait né avec plusieurs autres étoiles. Où sont-elles ?
Le Soleil a été un laboratoire pour les spécialistes de la thermodynamique, de la physique quantique…
p. 42 « Il est temps de faire entrer le mot “héliophysique” dans le dictionnaire ! »
Entretien avec Joe Westlake
p. 48 Un cycle qui fait taches
Javier Barbuzano
Comment prévoir la force des cycles solaires de onze ans ?
p. 56 Une étoile sous surveillance
Jonathan O’Callaghan et Lee Billings
L’art d’anticiper et de se préparer à la prochaine tempête solaire.
p. 56 Sur le Soleil exactement
PORTFOLIO
p. 72 Quand le magnétisme sou e le chaud
Thomas Zurbuchen
Comment l’activité magnétique réchau e la couronne solaire.
p. 82 La faim du Soleil
Jonathan O’Callaghan
La Terre peut-elle survivre à la mort du Soleil ?
p. 88 Les mille et une morts des étoiles
Anna Ho
Certaines étoiles ne disparaissent pas selon le scénario établi.
p. 96 Un destin forgé dans le métal
Natalie Wolchover
Les métaux que contient le Soleil décideront de sa fin.
p. 102 Une fin nébuleuse
Bruce Balick et Adam Franck
La disparition du Soleil, un spectacle pyrotechnique.

p. 109 Rendez-vous
110 En image
112 Rebondissements
116 Infographie
118 Incontournables
Le Soleil est une étoile banale, semblable à des millions d’autres, perdue à la périphérie de la Galaxie. Mais pour en arriver là, que de péripéties ! D’abord, la vie de la Voie lactée n’est que succession d’immenses cataclysmes, en l’occurrence des collisions avec plusieurs galaxies voisines, et la dernière est toujours en cours, comme le révèle l’analyse des données du satellite Gaia. En outre, s’il semble isolé aujourd’hui, le Soleil n’est pas un « fils unique ». Il est né au milieu d’une fratrie, dispersée depuis, et dont on recherche activement les membres.
Les dernières cartes stellaires réécrivent l’histoire de notre Voie lactée, révélant une vie beaucoup plus tumultueuse, même à proximité du Soleil, que les astronomes ne le soupçonnaient.
Ann Finkbeiner

> Les astronomes ont longtemps cru que la Voie lactée était un havre de paix et de stabilité depuis sa naissance.
> Il n’en est rien : notre galaxie a été heurtée à de nombreuses reprises par d’autres galaxies et en a été transfigurée.
> Ce nouveau scénario résulte de l’analyse des formidables quantités de données de cartographie stellaire, à commencer par celles de la mission Gaia En bref
L’astronome Bob Benjamin, de l’université du Wisconsin-Madison, a passé ces vingt dernières années à comprendre à quoi ressemble la Voie lactée, une tâche délicate, car il est impossible de la voir de l’extérieur ! Mais les astronomes ont trouvé le moyen de contourner cette difficulté, et une image s’est peu à peu dessinée : une barre centrale dense noyée dans un disque de gaz et d’étoiles, dont certaines s’agencent en des bras enroulés en spirale, le tout plongé dans un halo sphérique diffus.
Obtenir cette carte fut si ardu que les astronomes recourent, pour expliquer comment elle fut obtenue, à l’histoire de l’éléphant et des aveugles : selon qu’ils touchent la trompe, l’oreille, la patte… ils décriront respectivement un serpent, un ventilateur ou un tronc d’arbre. Aucun ne perçoit l’animal dans son ensemble. Au moins, les astronomes mesuraient-ils leur ignorance Ainsi ils savaient que les étoiles des différentes parties de la galaxie n’ont pas le même âge, mais ils étaient incapables d’expliquer pourquoi. Ils avaient vu d’autres galaxies fusionner et apparaître désordonnées, mais de là à supposer que la Voie lactée avait connu un tel sort…
Les choses ont changé ces dernières années, quand les scientifiques ont pu cartographier systématiquement l’ensemble des étoiles Et les données sont désormais abondantes, notamment grâce au satellite Gaia, de l’Agence spatiale européenne (ESA), qui a recueilli des quantités stupéfiantes d’informations. En 1993, le précédent satellite de
cartographie stellaire de l’ESA, Hipparcos, avait cartographié 2,5 millions d’étoiles ; en 2022, la troisième édition du catalogue Gaia en répertoriait 1,8 milliard La mission de l’ESA a été complétée par une multitude d’autres, en particulier l’Apache point observatory galactic evolution experiment (Apogee) et le Milky Way mapper (MWM), tous deux portés par le programme Sloan digital sky survey (SDSS), aux États-Unis. Grâce à toutes ces données, les astronomes ont accès aux premières cartes exactes de la Voie lactée décrivant position et mouvement des étoiles en trois dimensions Le résultat est un film profond et à haute résolution de quelques milliards d’étoiles qui révèle non seulement la structure de la galaxie, mais aussi son histoire étonnamment tumultueuse Il s’agit de « la plus grande augmentation des connaissances astronomiques depuis une éternité », déclare Charlie Conroy, de l’université Harvard. En un mot, les cartes ne montrent pas du tout une Voie lactée en équilibre statique, comme attendu
Bien sûr, la cartographie des étoiles n’a rien de nouveau. Il y a environ 4 000 ans, les Mésopotamiens observaient le Soleil, la Lune et les planètes se déplacer par rapport aux étoiles de leurs constellations (les Hirondelles, la CarpeChèvre, l’Épi…), qui, selon eux, avaient été tracées par le grand dieu Mardouk. Pour suivre ces mouvements, les astronomes mésopotamiens mesuraient avec leurs doigts
Vers 120 avant notre ère, l’astronome grec Hipparque introduit une grille universelle de longitude et de latitude sur laquelle les étoiles sont
localisées. Puis au début du XVIIe siècle, les astronomes inventent les télescopes, ces instruments devenant dès lors toujours plus grands et donc à même de repérer des objets de moins en moins lumineux. Ils ont ensuite ajouté des caméras et des spectrographes qui recueillaient et analysaient la lumière des étoiles, et ils ont placé ces engins dans des satellites, en orbite au-dessus de l’atmosphère déformante de la Terre.
La précision est devenue stupéfiante Si les Mésopotamiens se trompaient peut-être d’un doigt à bout de bras, soit d’un degré d’arc, la marge d’erreur du satellite Gaia ne dépasse pas 24 millionièmes de seconde d’arc, soit la largeur d’un cheveu humain à une distance de 1 000 kilomètres. Avec de tels « yeux », les astronomes découvrent dans la Voie lactée des structures qui ne sont pas seulement des caractéristiques topographiques, mais aussi des instantanés de son histoire Parmi les premières découvertes, on trouve des cortèges d’étoiles, des courants stellaires, griffant le halo qui enveloppe la Voie lactée. Ce « nuage » diffus, situé aux confins de la galaxie, était connu pour être constitué de vieilles étoiles et supposé dépourvu de caractéristiques majeures, mais il est si peu lumineux que les astronomes ne savaient pas grand-chose d’autre Cependant, en 2006, le SDSS puis d’autres études ont commencé à détecter des étoiles du halo de même couleur et de même luminosité qui semblaient se déplacer ensemble formant de longs
Le turbulent passé de la Voie
courants, comme celui nommé Triangulum sur lequel Ana Bonaca, de l’observatoire Carnegie, à Pasadena, en Californie, a travaillé.
Les astronomes pensaient que ces courants provenaient de l’extérieur de la galaxie, que leurs étoiles étaient nées ensemble dans une petite galaxie voisine puis avaient été entraînées lorsque cette galaxie s’est rapprochée des marées gravitationnelles de la Voie lactée, beaucoup plus grande. Scénario plausible, mais comment le vérifier ?
D’abord, pour appuyer l’idée d’un courant stellaire, il faut s’assurer que les étoiles sont apparentées, c’est-à-dire du même âge et nées dans la même galaxie. Lorsque des étoiles naissent ensemble au sein d’un nuage de gaz, elles portent les signatures chimiques des éléments environnants En vieillissant, les étoiles transforment les éléments légers en d’autres plus lourds, que les astronomes appellent « métaux », puis meurent dans des explosions qui les dispersent dans le gaz qui les entoure Plus il y a de générations d’étoiles qui ont vécu et sont mortes dans le gaz d’une galaxie, plus les nouvelles étoiles qui y naissent sont riches en métaux ; et plus elles sont riches en métaux, plus elles sont jeunes Les étoiles d’un courant se doivent donc d’avoir une chimie similaire. Elles doivent aussi partager un mouvement semblable. Or les mesures de leurs mouvements propres à travers le ciel sont longtemps restées imprécises « Nous attendions désespérément Gaia » , avoue Amina Helmi , de l’université de Groningue, aux Pays-Bas, qui a donné son nom à un courant stellaire
Et de fait, en 2016, le satellite a commencé à publier son catalogue recensant compositions chimiques, âges, emplacements et mouvements précis, y compris les mouvements propres, pour 1 milliard d’étoiles Grâce à ces données, et à celles
la marge d’erreur de « Gaia » ne dépasse pas 24 millionièmes de seconde d’arc, soit la largeur d’un cheveu humain à une distance de 1 000 kilomètres
d’autres relevés, tel Apogee, les astronomes ont pu distinguer de manière fiable les étoiles nées en dehors de la Voie lactée et ayant migré à l’intérieur. Ils ont alors pu non seulement repérer les courants stellaires, mais aussi remonter la trajectoire de chacun jusqu’à sa propre petite galaxie originelle À ce jour, les astronomes ont détecté plus de 90 courants, dont beaucoup sont probablement nés dans des galaxies naines ou dans les amas globulaires. Au total, précise Ana Bonaca, on connaît « 10 fois plus de courants qu’avant Gaia » . Les étoiles sont généralement âgées d’environ 10 milliards d’années.
Les courants qui zèbrent le halo furent l’un des premiers signes de l’instabilité de la galaxie. Le suivant consista en des groupements d’étoiles non conformistes ! En 2017, l’astrophysicienne et ses collègues ont trouvé un lot d’étoiles dans des zones du halo pauvres en métaux et avec des orbites semblables à celles de vieilles étoiles, alors qu’elles avaient la métallicité (élevée) d’étoiles plus jeunes du disque de la Voie lactée Des étoiles égarées ?
L’année suivante, l’équipe de Vasily Belokurov, de l’université de Cambridge, a repéré dans le halo un groupe d’étoiles qui se déplaçaient à une vitesse inhabituelle et dans la direction opposée au reste du halo Ils ont baptisé Sausage (« saucisse ») cette formation en raison de l’allure que prend la distribution des vitesses des étoiles concernées. Un autre groupe, celui d’Amina Helmi, a montré que ces étoiles étaient vieilles et pauvres en métaux ; ils ont renommé Gaia-Encelade la saucisse, en référence au fils de Gaïa, la déesse de la Terre, Encelade. En 2023, Ana Bonaca et ses collègues ont découvert un courant d’étoiles présentant la même chimie ancienne (une faible métallicité) et le même mouvement erroné que la saucisse, et y ont vu le prolongement de cette dernière dans la Voie lactée. Et la communauté astronomique a finalement choisi un nom consensuel, à savoir Gaia-Saucisse-Encelade (GSE).
Entre-temps, l’équipe de Vasily Belokurov avait « redécouvert » les étoiles du disque égarées par l’équipe d’Ana Bonaca, dont on sait désormais qu’elles font partie du GSE En d’autres termes, au milieu d’une masse d’étoiles « étrangères » pauvres en métaux se trouve un groupe d’étoiles riches en métaux originaires de la Voie lactée.
Notre galaxie s’est construite par étapes tumultueuses qui se sont succédé durant 13 milliards d’années. Au fil du temps, des galaxies naines et des amas d’étoiles dits « globulaires » se sont rapprochés et ont fusionné avec la Voie lactée. Parfois, leur gaz et leurs étoiles se sont totalement intégrés. À d’autres moments, la forte gravité de notre galaxie a conduit à la formation de courants d’étoiles qui parcourent le halo de la Voie lactée. L’illustration ci-contre est basée sur un atlas de ces fusions créé par le groupe de Khyati Malhan, de l’institut Max-Planck d’astronomie, à Heidelberg, en Allemagne, à partir de données fournies par la sonde spatiale Gaia de l’Agence spatiale européenne.
De l’ensemble de ces données , les astronomes ont conclu qu’il y a 8 à 10 milliards d’années, Encelade, une galaxie naine dont la taille équivaut à environ un quart de celle de la Voie lactée, a heurté de plein fouet notre galaxie et s’y est fondue sous la forme d’une tache ( la saucisse ), projetant au passage des étoiles natives hors de leurs orbites normales dans le disque et dans le halo. Des transformations plus anciennes et moins violentes s’étaient produites non pas dans le halo, mais dans le corps de la galaxie elle-même Ainsi , en 2022, Charlie Conroy faisait partie d’une équipe qui a mesuré la chimie des étoiles dans la Voie lactée et mis en évidence deux populations : l’une était ancienne, pauvre en métaux, se déplaçait de manière chaotique et la génération de nouvelles étoiles y était lente ; l’autre était tout l’inverse. Les astronomes ont pensé que ces populations représentaient deux étapes de
Le turbulent passé de la Voie lactée


l’histoire galactique et les ont appelées respectivement « mijotage » et « ébullition ».
Pendant ce temps , l’équipe de Vasily Belokurov et une autre ont procédé à des mesures d’orbite des étoiles et ont également distingué deux groupes : un premier avec des étoiles pauvres en métaux, donc anciennes, qui allaient « dans tous les sens », et un second composé d’étoiles plus jeunes aux mouvements plus cohérents. L’astronome y voit « la transition d’une ère de désordre chaud à une autre caractérisée par un disque plus ordonné relativement froid »
Au même moment, Hans-Walter Rix, de l’institut Max-Planck pour l’astronomie, à Heidelberg, en Allemagne, et son équipe ont, sur la base de l’analyse de la chimie de 2 millions d’étoiles, détecté un groupe d’anciennes , pauvres en métaux et liées par la gravitation, au centre de la galaxie. Ils l’ont appelé « le pauvre vieux cœur » de la Voie lactée.
Les noms mis à part, les trois équipes s’accordent à dire qu’elles étudient probablement la même transformation : une protogalaxie chaotique remplie de vieilles étoiles pauvres en métaux n’allant dans aucune direction particulière, qui se transforme en une galaxie. Les étoiles ne racontent qu’une partie de l’histoire, car la Voie lactée est aussi constituée de gaz dans les nuages desquels elles évoluent. Pourtant , les communautés qui étudient les étoiles et celles qui s’intéressent aux gaz ne se chevauchent pas Bob Benjamin fait partie des deux, mais il se réclame davantage de celle des gaz. Parce que les étoiles naissent dedans et l’enrichissent ensuite avec les éléments qu’elles produisent, les pro-gaz se concentrent sur le présent de la galaxie À l’inverse , puisque les étoiles conservent les orbites et la chimie de leurs origines, l’autre communauté est plus encline à se pencher sur son passé.
╭ Grâce aux nouveaux relevés, nous pouvons voir comment
la galaxie a changé et continuera de changer╯
Les nuages de gaz en sont constitués à 99 %, le reste étant de la poussière, une fine suie si associée au gaz qu’une carte de la poussière correspond plus ou moins à celle du gaz Or les étoiles qui brillent à travers la poussière paraissent plus rouges et plus sombres. En cartographiant des étoiles présentant ces caractéristiques, on accède au contour de la poussière et donc du gaz Les nuages de gaz remplis de poussière sont également parsemés d’étoiles bien connues et localisées avec précision, et les astronomes peuvent relier ces points stellaires pour cartographier les nuages Cependant, selon João Alves, de l’université de Vienne, une mesure aussi indirecte revient à décrire l’éléphant en « touchant quelques poils de sa queue ».
L’équipe de Catherine Zucker, du centre d’astrophysique de Harvard et de l’institut Smithsonian, a découvert une bonne dizaine de nuages de gaz longs et filiformes, dispersés dans les bras spiraux de la galaxie, qui pourraient servir de lieu de naissance à la multitude de nouvelles étoiles qui peuplent ces bras. Un autre groupe a mis au jour un nuage de gaz unique, beaucoup plus grand mais tout aussi long et étroit, désormais nommé Split (« fente » en anglais). Enfin, João Alves et ses collègues ont cartographié les nuages de gaz contenant des amas d’étoiles naissantes, des « pouponnières stellaires locales » « Le choc, avoue l’astronome, a été de constater que les pouponnières, lorsqu’on les joint, s’agencent selon une vague qui ondule dans le plan de la galaxie ; les chercheurs l’ont appelée “onde de Radcliffe”, et celle-ci s’étend sur 8 000 années-lumière. » L’une des raisons pour lesquelles ces filaments de gaz sont intéressants est qu’ils coïncident probablement avec les bras spiraux de la galaxie, dont on ignore encore le nombre. De fait, jusqu’à présent, l’image que l’on se fait des bras est moins celle de structures cohérentes que des sortes de plumes ramifiées, ce qui rend leur comptage délicat. Paradoxalement, les bras spiraux sont mieux étudiés dans les galaxies où nous ne vivons pas. Plus récemment, une autre équipe dirigée par Catherine Zucker a cartographié la « bulle locale », une cavité du milieu interstellaire en forme de sablier d’environ 300 années-lumière de large, presque vide autour du Système solaire, et emplie de gaz chauds Cet espace est délimité par des groupes de jeunes étoiles, qui se déplacent toutes vers l’extérieur. Les chercheurs ont proposé que la bulle ait été créée il y a environ 14 millions d’années lorsqu’un groupe d’étoiles a explosé en supernovæ, balayant le gaz ambiant et le transportant dans une grande sphère à la surface de laquelle le gaz s’est refroidi en nuages et a commencé à former ses propres étoiles. Bob Benjamin et d’autres astronomes se demandent si toutes les structures gazeuses ne sont pas des variantes d’une même chose : de longs filaments de gaz à l’intérieur desquels de plus petits nuages se compriment pour former des étoiles Et peut-être que certains sont historiquement liés, car la bulle locale se situe entre la fente et la vague de Radcliffe. Selon João Alves et ses collègues, si nous pouvions remonter le temps, nous constaterions
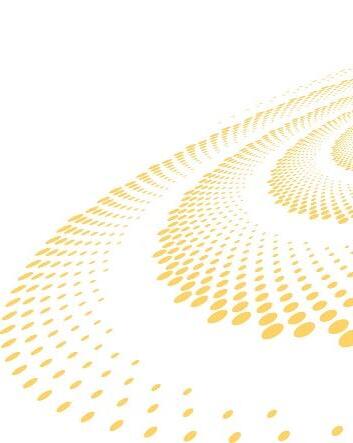

Le turbulent passé de la Voie lactée

qu’il y a 15 millions d’années la fente et l’onde de Radcliffe étaient suffisamment proches pour se croiser Et à leur intersection présumée, là où le gaz aurait été le plus dense, les astronomes observent aujourd’hui une foule animée de jeunes étoiles non gravitationnellement liées, l’association ScorpiusCentaurus (notée Sco-Cen). De plus, cette dernière se trouve être au centre de la bulle locale Aussi certains y voient-ils l’origine de la bulle.
En rassemblant tous les résultats décrits, on peut reconstituer l’éléphant. Il y a 13 milliards d’années, la Voie lactée est née sous la forme d’un nuage informe de gaz et de poussières où naissaient des étoiles pauvres en métaux et tournant de manière incohérente. Pendant le premier milliard d’années environ, des nuages plus petits et des galaxies naines se sont écrasés sur la Voie lactée naissante, projetant dans un halo des gerbes d’étoiles immigrées et natives Le gaz apporté a aussi favorisé la formation d’étoiles dans la Voie lactée. Un à deux milliards d’années plus tard, la galaxie s’est transformée en un disque où les orbites des étoiles étaient circulaires Les étoiles se formaient alors à un rythme tranquille, brûlaient rapidement et mouraient en explosant, enrichissant le gaz à partir duquel naîtraient les générations suivantes d’étoiles de plus en plus riches en métaux Il y a une dizaine de milliards d’années, la galaxie d’Encelade est entrée en collision avec la Voie lactée et, au cours des 2 milliards d’années qui ont suivi, s’y est dissoute. Les étoiles de la GSE ont
pris le contrôle du halo, accéléré les étoiles dans le disque épais de la Voie lactée et déversé du gaz qui, ajouté à celui qui était déjà présent, a augmenté la formation d’étoiles. Progressivement, au cours des 2 milliards d’années qui ont suivi, le disque s’est affiné et s’est disloqué en bras spiraux Il y a environ 6 milliards d’années, la galaxie naine Sagittarius s’est approchée de la Voie lactée autour de laquelle elle tourne. Depuis, toutes les centaines de millions d’années, elle frôle notre galaxie, entraînant à chaque fois un échappement d’étoiles dans une traînée, créant ainsi des courants enroulés dans le halo. Au cours des 5 milliards d’années qui ont suivi, d’autres objets ont fait de même, jusqu’à ce que la Voie lactée soit entièrement entourée de banderoles À ce moment, dans les bras spiraux du disque, le gaz s’était rassemblé en longs filaments le long desquels les étoiles s’allumaient en amas. Plus près du Soleil, il y a 15 millions d’années, des étoiles massives de l’association Sco-Cen se sont formées, ont vécu rapidement et ont explosé, créant la bulle locale. Les 37 amas qui forment aujourd’hui Sco-Cen ont explosé en rafales environ tous les 5 millions d’années, creusant d’autres bulles dont les surfaces plus denses forment d’autres étoiles, ce qui garantit que le voisinage galactique est rempli de nouvelles étoiles scintillantes. Depuis, nous avons renommé les constellations du dieu Mardouk, mais nous les utilisons toujours pour nous situer dans la galaxie. Grâce aux cartes des nouveaux relevés, nous pouvons voir comment les constellations se sont déformées et déplacées avec le temps et comment la galaxie a changé et continuera de changer.
L’autrice
> Ann Finkbeiner a enseigné à l’université Johns-Hopkins, à Baltimore, et est désormais journaliste scientifique. Cet article est adapté de « Our turbulent Galaxy », paru dans Scientific American en février 2024.
À lire
> A. Bonaca et A. Price-Whelan, Stellar streams in the Gaia era, New Astronomy Reviews, 2024.
> S. Lucchini et al., On the origin of high-velocity clouds in the Galaxy, The Astrophysical Journal, 2024.
> V. Chandra et al., Distant echoes of the Milky Way’s last major merger, The Astrophysical Journal, 2023.
Souvenez-vous, en mai 2024, la Terre était sous le feu d’une tempête solaire dont on aurait pu craindre le pire. Il n’en a rien été, car l’événement fut moins intense que prévu. Mais qu’en sera-t-il lors de la prochaine ? Pour s’y préparer, les agences spatiales du monde entier sont mobilisées pour surveiller de près l’astre, comprendre les mécanismes de ces tempêtes et des cycles auxquels elles sont associées, mieux saisir le fonctionnement du Soleil… En fin de compte, c’est une « météorologie de l’espace » qui se développe.
Comment prévoir la force des cycles solaires de onze ans ? Les méthodes actuelles se fondent sur l’observation des taches, mais elles montrent leurs limites.
Javier Barbuzano

> L’activité solaire suit des cycles d’environ onze ans.
En bref
> Cependant, l’intensité de l’activité reste di cile à prévoir, alors que cette information est primordiale pour protéger les infrastructures terrestres vulnérables.
Le Soleil semble immuable, une ampoule d’un céleste ennui, toujours allumée. Pourtant, cette boule de plasma alimentée par la fusion est en constante évolution et connaît des soubresauts tous les onze ans environ. Ils se traduisent par une période de turbulences marquée par des taches solaires et des éruptions solaires (voir l’entretien avec J Westlake, page 42)
En mai 2024, le Soleil connaissait comme attendu un regain d’activité, mais il ne s’est pas comporté exactement comme on le supposait. En effet, les scientifiques avaient prédit que ce cycle serait faible, comme le précédent Or le Soleil a atteint un niveau d’activité inégalé depuis plus de vingt ans. Dès juin et juillet 2023, selon les données de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), il produisait en moyenne 160 taches solaires par jour, soit plus de deux fois plus que prévu. Ce nombre était de 79 en mai 2025, après son pic, sur lequel nous reviendrons.
Déjà en juillet 2022, l’écart entre les prévisions et les observations était manifeste À cette époque, Nicola Fox, alors directrice de la division héliophysique de la Nasa, et désormais directrice de la science de l’agence depuis février 2023, alertait sur le fait que « le Soleil a été beaucoup plus actif que prévu au cours de ce cycle ».
Une prévision fiable du cycle solaire est aujourd’hui plus importante que jamais en raison de notre dépendance croissante à l’égard d’une technologie vulnérable, comme les équipements électroniques, les systèmes GPS, les réseaux électriques, les satellites… En conséquence, comme pour la plupart des prévisions – météorologiques,
> Plusieurs méthodes existent, la plus ancienne étant basée sur le comptage des taches solaires.
> D’autres ont fait plus récemment leur apparition et donnent des résultats di érents.
par exemple –, les défis liés à celles du cycle solaire sont nombreux. Pourtant, ces cycles ne suivent pas une périodicité strictement définie, car certains sont plus courts que d’autres. De plus, la physique du Soleil est encore une discipline relativement jeune. « Nous nous plaisons à dire que nous avons environ soixante ans de retard sur les météorologues », concède Robert Leamon, physicien à l’université du Maryland, à Baltimore, aux États-Unis.
Historiquement, les chercheurs traquaient des corrélations statistiques entre l’activité solaire et le nombre de taches solaires, leur surface totale et le moment de leur apparition Mais le consensus actuel est que ces méthodes, même modernisées, ne révèlent pas grand-chose sur le comportement futur du Soleil. Aujourd’hui, grâce à des techniques plus sophistiquées, les scientifiques évaluent et peaufinent des méthodes de prévision qui s’appuient cette fois sur le fonctionnement interne de l’astre. Bien que les progrès soient lents, du fait d’un long cycle (onze ans tout de même), où en est l’art de la prédiction solaire ?
Les scientifiques ont commencé à suivre le cycle solaire par inadvertance il y a plus de quatre cents ans, lorsque Galilée a observé pour la première fois des taches solaires sur le Soleil On sait désormais que ces zones sombres sont abondantes pendant le maximum de l’activité solaire et pratiquement absentes lors du minimum . Aujourd’hui, alors que les scientifiques
continuent d’améliorer leur compréhension de la physique à l’origine de cette oscillation, il est admis que les taches solaires servent toujours d’indicateur de l’activité du Soleil
En 1989, la Nasa et la NOAA ont commencé à former des équipes a ff ectées à la prévision des cycles solaires, de leur intensité et de leur déclenchement Pour ce faire, les experts réunis évaluent les données obtenues par d’autres chercheurs dans le domaine. Ces prévisions utilisent généralement comme indicateur de l’activité du Soleil une valeur notée R d’un nombre dit « de Wolf » Il dépend de la moyenne sur treize mois du nombre de taches solaires (lissée, ou pondérée, sur le mois en cours ainsi que sur les six qui ont précédé et les six qui suivent), mais aussi du nombre d’agrégats dans lesquels se répartissent les taches. L’obtention d’une valeur R pour le prochain maximum est alors considérée comme le summum de la prévision des cycles solaires.
Les scientifiques ont commencé à suivre le cycle solaire par inadvertance il y a plus de quatre cents ans, lorsque Galilée a observé pour la première fois des taches à la surface du Soleil
Les groupes d’études n’ont cependant pas de données solides. En 2006, le groupe chargé de prédire le cycle 24 (commencé en 2008, il s’est terminé début 2020) a entamé d’intenses délibérations pour en fin de compte livrer un verdict en demi-teinte : le cycle 24 serait soit très faible soit très fort… Et le cycle fut peu intense « Les participants étaient partagés », précise Lisa Upton, coprésidente du groupe de prévision du cycle 25, qui a débuté en décembre 2019 et est toujours en cours. « Il y a eu des échanges houleux », se rappelle la physicienne au Southwest Research Institute, à San Antonio, au Texas
Prédire le cycle 25 semblait plus simple En mars 2019, Lisa Upton et ses collègues ont annoncé que le cycle culminerait en juillet 2025 avec une moyenne de 115 taches solaires. Ils ont passé au crible 61 prédictions avec des valeurs de R allant de 50 à 229, mais ils ont privilégié une catégorie de données basées sur la physique solaire qui étaient largement en accord les unes avec les autres. « Nous étions tous d’accord pour dire que le cycle serait assez faible », avouait la physicienne Le Soleil n’en a eu cure…
Les méthodes modernes fondées sur la physique sont de deux types. Les premières consistent à rechercher des paramètres physiques observables, on parle de « précurseurs », qui laissent présager de la force du cycle à venir. Les autres utilisent la modélisation informatique pour recréer la physique du Soleil.
Succession des cycles depuis 1975 Fin
L’activité solaire alterne des périodes de faible et de forte intensité selon un cycle de onze ans dont la force est généralement définie selon le nombre de taches apparaissant à la surface de l’étoile.
Le cycle 25, en cours, a connu son apogée en août 2024.
Parmi les précurseurs, celui qui semble le plus performant jusqu’à présent est l’intensité du champ magnétique aux pôles du Soleil pendant le minimum solaire, sur lequel le groupe chargé des prévisions du cycle 25 a basé ses travaux. Lorsque le Soleil est en « sommeil », son champ magnétique est un dipôle, comme un barreau aimanté avec une extrémité positive et une autre négative. La force du dipôle régit un processus qui finit par inverser la polarité du champ magnétique, un phénomène qui est à la base du cycle solaire Les scientifiques ont constaté, au fil des ans, que l’intensité du champ polaire au minimum est fortement corrélée à l’intensité du cycle à venir. L’inconvénient de ce paramètre est que le champ magnétique solaire n’a été mesuré directement que pour les quatre derniers cycles, depuis 1976. Mais il existe des moyens, plus indirects, d’évaluer son intensité, comme l’indice aa : ce dernier est calculé à partir des perturbations du champ magnétique terrestre qui sont sensibles à l’intensité du champ solaire. Or ces modifications sont mesurées depuis plus de cent cinquante ans, ce qui offre un autre ensemble de données.
« Avec quatre points, la corrélation peut être une coïncidence, mais avec treize, c’est moins probable », a déclaré Robert Cameron, de l’institut Max-Planck pour la recherche sur le Système solaire, à Göttingen, en Allemagne, qui faisait partie du dernier groupe d’experts sur les prévisions
En 2021, une étude dirigée par Robert Leamon et Scott McIntosh, du Centre américain pour la recherche sur l’atmosphère, à Boulder, dans le Colorado, a mis en évidence un autre précurseur prometteur nommé « événement terminateur ». Il s’agit du moment où l’activité magnétique d’un cycle donné disparaît et est remplacée par l’activité magnétique, souvent intense, du suivant
Les deux chercheurs ont trouvé dans les données historiques des indices suggérant que la date du terminateur est corrélée à la force du nouveau cycle : un terminateur précoce se traduit par un plus grand nombre de taches solaires, et donc par un cycle plus intense. En se basant sur le dernier terminateur, qui s’est produit en décembre 2021,
les deux chercheurs ont prédit que le cycle 25 atteindrait un maximum de 185 taches solaires et culminerait en juillet 2024, soit près d’un an plus tôt que la prédiction officielle Qu’en a-t-il été ?
Selon le centre de prédiction de météo spatiale de la NOAA , le pic a bien eu lieu durant l’été 2024, mais plutôt en août, avec 216 taches solaires (contre 197 le mois précédent). Et ce nombre décline continûment depuis (voir la figure page ci-contre). De quoi conforter Robert Leamon quand il affirmait : « Je ne m’en réjouis pas, mais [le Soleil] est certainement beaucoup plus actif que ne l’imagine le groupe d’experts »
L’une des limites de la plupart des méthodes employées est qu’elles sont fondées sur le minimum solaire : impossible de faire de nouvelles prévisions tant que le cycle suivant n’est pas sur le point de commencer, ce qui advient en général un an après C’est pourquoi les scientifiques se tournent aussi vers des techniques, basées cette fois sur la physique et non sur les données, qui ne sont pas sans rappeler les modèles complexes de prévision du climat. Il s’agit de simulations informatiques qui utilisent la dynamique des fluides et l’électromagnétisme pour recréer la physique solaire. De là, ils introduisent des données d’observation pour anticiper ce à quoi le champ polaire et d’autres précurseurs pourraient ressembler quelques années plus tard
Mais de telles prévisions fondées sur la physique ne représentent que la moitié de celles analysées par le groupe d’experts du cycle 25.
Les autres, bien que moins efficaces aujourd’hui, s’amélioreront peut-être à l’avenir. Ce sont des stratégies qui pour la plupart ont recours aux cycles solaires précédents pour prédire le nombre actuel de taches solaires. Selon Víctor Sánchez Carrasco , de l’université d’Estrémadure , à Badajoz, en Espagne, ces méthodes permettent parfois d’établir de fortes corrélations entre les taches solaires et des phénomènes qui , au départ, semblent plutôt aléatoires. Ces corrélations pourraient n’être que des coïncidences, mais il est également possible qu’elles trahissent
216 taches solaires ont caractérisé le pic du cycle 25 en août 2024
Les cycles du Soleil d’environ onze ans sont intimement liés au champ magnétique de l’astre qui inverse sa polarité avec la même périodicité. Ce phénomène concerne d’autres étoiles comparables au Soleil et appartenant donc à la même classe. Cependant, la durée des cycles varie entre un an et plusieurs dizaines d’années. De quoi s’interroger : le Soleil estil vraiment représentatif de sa classe stellaire ? Pour clarifier la situation, Antoine Strugarek, du CEA ParisSaclay et de l’université de Montréal, et ses collègues ont développé des simulations numériques qui rendent compte de la dynamique interne du Soleil et expliquent son cycle. Le champ magnétique d’une étoile est engendré par le mouvement de convection turbulente du plasma extrêmement chaud au cœur de l’astre. Dans un modèle stellaire tridimensionnel, les physiciens ont reproduit les processus
magnétohydrodynamiques qui créent les écoulements de plasma et les champs magnétiques à l’intérieur des étoiles. Dans la simulation, comme dans une vraie étoile, ces phénomènes influent l’un sur l’autre, par des rétroactions essentielles. Les chercheurs ont simulé des étoiles d’âge et de masse comparables au Soleil, mais présentant des périodes de rotation comprises entre 14 et 29 jours (27 en moyenne pour le Soleil) et une luminosité proche de celle de notre étoile. La luminosité caractérise la quantité d’énergie produite au cœur de l’étoile et transportée par radiation jusqu’à environ 70 % du rayon de l’astre, puis par convection jusqu’à la surface. Les chercheurs ont ainsi montré que la durée des cycles stellaires dépend de ces deux facteurs : elle diminue quand la période de rotation ou la luminosité croît. Ces deux facteurs peuvent être combinés et représentés par un unique paramètre, le nombre
de Rossby. Celui-ci caractérise l’influence de la rotation de l’étoile sur le système et correspond au rapport des forces d’inertie et de Coriolis. Les chercheurs ont montré que la durée du cycle est inversement proportionnelle au nombre de Rossby. Grâce aux simulations, ils ont compris comment le champ magnétique altère la vitesse d’écoulement à grande échelle du plasma en rotation. Ces variations ont une amplitude faible, de l’ordre de 1 %, mais elles su sent pour provoquer l’inversion du champ magnétique. Les scientifiques ont comparé leurs résultats numériques avec les données d’une vingtaine d’étoiles de type solaire. La durée du cycle de ces étoiles paraît suivre la même formule que celle déduite des simulations. Et cela semble confirmer que le Soleil est bien une étoile de type… solaire !
Sean Bailly
« une physique sous-jacente que nous ne comprenons pas encore ».
Les physiciens continuent d’explorer de nouvelles approches, comme l’utilisation de l’intelligence artificielle ou des réseaux neuronaux pour rechercher des corrélations entre les siècles de données sur les taches solaires « Il y a une certaine mystique associée à des séries temporelles aussi longues », a déclaré l’astrophysicien Eurico Covas, de l’Institut d’astrophysique et des sciences spatiales, à Lisbonne, au Portugal.
Lisa Upton estime que les prévisions du groupe d’experts ne sont pas caduques. « La force du cycle est un peu plus importante que ce que nous avons prévu, mais pas de manière significative », a-t-elle déclaré. Selon elle, la courbe lissée, une fois toutes les données recueillies, ne s’écarte pas de façon aussi spectaculaire que les moyennes mensuelles tracées par la NOAA Sur la base de l’évolution du cycle actuel , Víctor Sánchez Carrasco, quant à lui, reconnaît que le cycle 25 est plus fort que prévu par le groupe d’experts, mais il reste plus faible que la moyenne
Malgré ces incertitudes et les écarts des différentes méthodes de prévision, Robert Leamon reste convaincu que les physiciens parviendront à établir des prévisions précises D’ici à 2030, lorsque le prochain groupe d’experts se réunira, « nous aurons une bien meilleure idée de la situation, espère-t-il. Le cycle 25 sera le dernier que nous ne comprenons pas entièrement ».
L’auteur
> Javier Barbuzano diplômé de l’université de Boston, est journaliste scientifique indépendant, basé à Barcelone, en Espagne.
Cet article est adapté de « How scientists are tackling the tricky task of solar cycle prediction » paru sur le site Quantamagazine.org, le 7 septembre 2023.
À lire
> Q. Noraz et al., Magnetochronology of solartype star dynamos, Astronomy & Astrophysics, 2024.
> D. Oliveira et al., Predicting interplanetary shock occurrence for solar cycle 25 : Opportunities and challenges in space weather research, Space Weather, 2024.
> K. Knizhnik et al., The e ects of including farside observations on in situ predictions of heliospheric models, The Astrophysical Journal, 2024.
> A. Finley et al., How well does surface magnetism represent deep Sun-like star dynamo action ?, Astronomy & Astrophysics, 2024.
> S. Mcintosh et al., Deciphering solar magnetic activity : The (solar) hale cycle terminator of 2021, Frontiers in Astronomy and Space Sciences, 2023.
Dans environ 5 milliards d’années, le Soleil mourra, c’est un fait acquis. Mais quelle forme prendra-t-il au moment de sa disparition ? Les scénarios sont multiples et dépendent de nombreux paramètres, par exemple de la quantité de métaux que l’étoile contient, sur lesquels les astronomes ont du mal à s’accorder. Une chose est sûre, ce sera un spectacle « pyrotechnique » grandiose dont on essaie d’imaginer le déroulé en observant la fin d’autres étoiles. Quant à la Terre, ses chances d’en réchapper sont minces, mais elles existent.
La plupart des étoiles meurent selon des scénarios bien connus. Du moins le pensait-on… car un nombre croissant de supernovæ inhabituelles ne se conforment pas aux schémas classiques.
Anna Ho

Vue d’artiste d’un jet de sursaut gamma émergeant d’une étoile hypermassive en train de s’e ondrer.
Le 9 septembre 2018, un télescope robotisé repéra ce qui ressemblait à une nouvelle étoile. Au fil des heures, cette « étoile » devint dix fois plus brillante C’était la nuit en Californie, mais mes collègues de l’autre côté de la Terre réagirent promptement à ce signalement. Douze heures plus tard, divers télescopes confirmèrent qu’il s’agissait d’une supernova – une explosion d’étoile – dans une galaxie lointaine. Mais cet événement n’avait rien de « banal ».
En combinant différentes mesures, nous avons constaté qu’après avoir brillé pendant des millions d’années, l’étoile s’est comportée de façon mystérieuse. Elle s’est subitement débarrassée de ses couches de gaz externes qui ont alors formé un cocon autour d’elle avant qu’elle n’explose Les débris ont ensuite heurté le cocon et ont produit un flash inhabituellement brillant et de courte durée.
J’ai par la suite observé d’autres étoiles similaires, mais aussi des astres dont le vestige du cœur est resté actif après l’effondrement de l’étoile et a émis des jets de matière se déplaçant à des vitesses hyperrelativistes (très proches de la vitesse de la lumière). Ces processus extrêmes semblent rares et ne se conforment pas au scénario classique de la mort des étoiles. Ces fins stellaires atypiques soulèvent des questions fondamentales : quels sont les facteurs qui déterminent comment un astre va mourir ? Pourquoi certaines étoiles terminent-elles leur vie avec des éruptions ou des jets violents, tandis que d’autres explosent, tout simplement ?
L’histoire de la naissance, de la vie et de la mort d’une étoile est celle d’une compétition entre différentes forces Les étoiles naissent dans de vastes nuages interstellaires d’hydrogène Le gaz s’accumule dans certaines régions sous l’effet de la gravitation au point que cette dernière devient assez intense pour s’opposer à la dispersion du gaz Lorsqu’une portion du nuage s’effondre sur elle-même, la densité augmente de 20 ordres de grandeur et sa température croît de plusieurs millions de degrés. Dans ces conditions, les atomes d’hydrogène entrent en collision avec suffisamment d’énergie pour former de l’hélium. Cette fusion libère de l’énergie : la boule de gaz chauffe et brille. Une étoile est née. L’étoile est elle-même le théâtre d’une compétition entre la gravitation, qui attire le gaz vers l’intérieur, et la pression due à la fusion nucléaire, qui le repousse vers l’extérieur. L’évolution d’une étoile est donc un équilibre entre ces forces qui dépend de la température et de la masse de l’astre Dans les étoiles de faible masse et en conditions modérées, l’hydrogène fusionne lentement en hélium : ainsi, le Soleil est né il y a plus de 4 milliards d’années et brûle encore son hydrogène. Les étoiles plus massives, où la gravitation est plus forte et la température plus élevée, consomment rapidement leur carburant et ont une vie très courte, de l’ordre de 10 millions d’années. Ces fourneaux stellaires ont cependant une chaîne de fusion nucléaire plus riche et synthétisent des éléments « lourds » (oxygène, carbone, néon, fer…).
La masse d’une étoile détermine aussi comment elle mourra. Les étoiles de moins de huit
> Le destin ultime d’une étoile est le plus souvent dicté par sa masse. Mais certains astres semblent déroger à cette règle.
> En e et, des étoiles émettent de puissants jets de plasma, tandis que d’autres expulsent une importante fraction de leur gaz quelques jours avant de mourir.
> Grâce à des instruments scrutant de grandes régions du ciel, on détecte de plus en plus de ces événements atypiques. Reste à les comprendre… ― En bref
masses solaires connaissent une fin relativement « paisible ». Une fois le combustible épuisé, s’y amorce la fusion d’éléments plus lourds Ces réactions étant plus énergétiques, l’étoile enfle et expulse ses couches externes, formant une nébuleuse planétaire. Puis, faute d’une température suffisante pour alimenter la fusion, le noyau de l’étoile se contracte en une naine blanche, un objet chaud et dense d’environ une demi-masse solaire pour une taille à peine supérieure à celle de la Terre.
Les étoiles massives, en revanche, connaissent une fin violente en raison des températures et des pressions énormes régnant dans leur cœur La chaîne de combustion nucléaire se brise quand elles commencent à produire du fer, un atome si stable qu’il ne fusionne pas Conséquence : la pression qui s’opposait à la gravité disparaît, et le cœur de l’étoile s’effondre sur lui-même jusqu’à ce qu’une nouvelle force entre en scène, l’« interaction forte ». Une forme de pression inédite rétablit un équilibre et le cœur devient une étoile à neutrons
À partir de 20 masses solaires environ, l’étoile est assez massive pour que la gravité l’emporte même sur l’interaction forte et l’étoile à neutrons s’effondre encore jusqu’à devenir un trou noir. Dans les deux cas, quand le cœur périclite, une partie de l’énergie libérée provoque une violente éjection des couches externes de l’étoile : c’est une supernova, plus brillante que l’ensemble de toutes les autres étoiles de sa galaxie
Pour qu’un tel événement soit visible à l’œil nu, il doit se produire dans la Voie lactée, comme la supernova que l’astronome danois Tycho Brahe observa en 1572, ou dans l’une de ses
Les mille et une morts des étoiles
galaxies voisines Au cours du XXe siècle, les astronomes ont mis leurs télescopes sur la trace de supernovæ au-delà de la Voie lactée avec une méthode simple : il s’agit de traquer des objets qui s’allument puis s’éteignent, des « événements astronomiques transitoires » Avec la robotisation des télescopes et le développement de caméras très performantes, nous repérons des milliers de supernovæ chaque année.
Dans les années 1960, grâce au développement de télescopes spatiaux, les astronomes ont découvert des événements astronomiques transitoires particuliers, de brèves bouffées de rayons gamma Quelque trente ans plus tard, les chercheurs ont compris que ces sursauts gamma sont associés à la mort violente de certaines étoiles massives qui s’effondrent en étoiles à neutrons ou en trous noirs L’objet compact ainsi formé engendre un jet de matière très étroit, qui se fraie un chemin depuis le cœur à travers ce qui reste de l’étoile. Et nous pouvons observer ce jet quand il est dirigé vers la Terre Or la plupart des étoiles massives ne produisent pas de sursauts gamma. Des conditions particulières semblent nécessaires à leur formation : selon certaines théories, l’objet compact central resterait actif et deviendrait une sorte de « moteur » Par exemple, le trou noir naissant se retrouverait entouré d’un disque d’accrétion contenant d’importantes quantités de gaz. Ce disque aurait une durée de vie très courte et tomberait rapidement sur le trou noir, formant un jet très rapide Autre hypothèse, l’effondrement donnerait naissance à une étoile à neutrons présentant un fort champ magnétique et une rotation rapide (on parle alors de « magnétar »). Le ralentissement d’un tel objet, freiné par son propre champ magnétique, libérerait aussi de l’énergie sous la forme d’un faisceau de plasma brûlant. Ce jet partirait du cœur de l’étoile et traverserait le reste de la matière stellaire qui n’a pas fini sa chute, et émettrait un rayonnement gamma intense dans l’axe du jet. Le passage du jet à travers l’étoile entraîne son explosion en une supernova d’un type particulier, noté Ic-BL, dix fois plus énergétique que les supernovæ classiques Ensuite, le jet percute le gaz et la poussière du milieu interstellaire au voisinage de l’étoile et produit ainsi de la lumière dans tout le spectre électromagnétique. Cette
Les scénarios de mort stellaire ont longtemps été simples : on pensait que la vie et le destin ultime d’une étoile dépendaient uniquement de sa masse. Mais la découverte de supernovæ atypiques a montré que l’histoire est beaucoup plus complexe que cela. Parfois, le cœur d’une étoile mourante devient un moteur qui propulse un jet puissant ou un vent qui fait exploser l’étoile avec un supplément d’énergie. Dans d’autres cas, les étoiles évacuent de la matière juste avant l’explosion fatale.

A Scénarios classiques
Jusqu’à présent, on pensait que la masse d’une étoile déterminait son destin. En fonction de ce paramètre, le type d’explosion en supernova varie et produit un vestige di érent. Bien que cette représentation reste en grande partie valable, le processus s’en écarte dans quelques cas et produit des issues di érentes (dans les cercles vert, orange, bleus et jaunes).
Masse de l’étoile (en masses solaires)
8–10
10–20
20–40
40–100
100–260
Plus de 260
C Mort imminente
Certaines étoiles massives se délesteraient d’une fraction importante de leur gaz dans les derniers jours de leur vie. Quand l’étoile explose finalement, les débris de l’explosion entrent en collision avec la matière récemment éjectée, ce qui produit un spectacle éclatant (voir ci-contre). Pourquoi certaines étoiles se comportent-elles ainsi ?
Est-ce le résultat d’une rotation rapide ? D’une interaction avec une autre étoile ? On l’ignore…
Supernova à capture d’électrons
Supernova à e ondrement de cœur de type II
Supernova à e ondrement de cœur de type II
Supernova à e ondrement de cœur de type Ibc
Supernova à instabilité de paires
Cadavre (rémanent) ?
Étoile à neutrons
Étoile à neutrons
Trou noir
Trou noir
Rien
Trou noir

Étoile
Enveloppe dense de gaz et de poussière constituée de carbone et d’oxygène
Les débris de l’explosion heurtent l’enveloppe

Étoile à neutrons (probable)
Parfois, l’objet compact (une étoile à neutrons ou un trou noir) créé par l’étoile en fin de vie reste actif et forme un moteur qui propulse un jet ou un vent puissant. Cela se produit probablement quand le cœur de l’étoile est en rotation extrêmement rapide au moment de l’e ondrement. Peut-être l’étoile était-elle déjà en rotation rapide, ou bien a-t-elle pris de la vitesse par le biais d’une interaction avec un compagnon binaire ? Ci-dessous, des exemples d’explosions de cœur.
Supernova superlumineuse (émission d’un vent par une étoile à neutrons)
Matière stellaire rémanente
Trou noir en rotation rapide

Matière stellaire rémanente
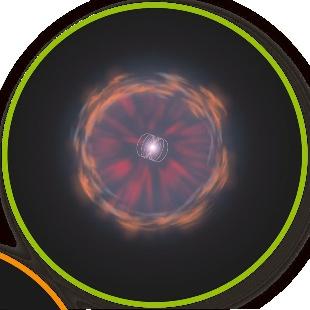
Étoile à neutrons à fort champ magnétique (magnétoile ou magnétar)
Sursaut gamma (le trou noir propulse un jet rapide) ou « boule de feu sale » (le trou noir propulse un jet lent)
Trou noir en rotation

Tore dense de gaz et de poussière qui appartenaient vraisemblablement à l’étoile et ont récemment été expulsés
Jet lent propulsé par un trou noir ou peut-être un magnétar engendrant un vent

Les jets sont étou és à l’intérieur de la matière récemment expulsée
Les
émission dite « rémanente » est quasi isotrope, ce qui donne a priori plus de chances de la voir Dans les faits, elle reste difficile à observer car, bien que mille fois plus brillante que les supernovæ typiques, elle est cent fois plus éphémère. Aussi, la stratégie mise en place pour détecter une émission rémanente consiste-t-elle d’abord à détecter un sursaut gamma, puis à diriger différents télescopes dans sa direction.
L’inconvénient est que nous manquons de nombreux événements En effet, nous ne voyons que des événements particuliers, où un jet s’est formé, a percé l’enveloppe stellaire et est orienté vers la Terre. Or, parfois, les photons gamma émis n’arrivent pas à s’échapper de l’étoile mourante
Cependant, même si le jet ne perce pas l’enveloppe stellaire, il devrait malgré tout produire des émissions rémanentes. Ce type de rayonnement devrait donc être visible sans la présence de sursaut gamma De nombreux travaux ont été menés pour observer ces émissions rémanentes sans sursaut gamma, mais avec un succès mitigé au départ.
La situation a changé en 2018, quand j’ai entrepris de dénicher de tels événements en utilisant le Zwicky Transient Facility (ZTF) , qui venait d’être inauguré. Ce télescope robotisé installé en Californie est conçu pour surveiller l’apparition de points lumineux très brillants et fugaces On m’avait alors avertie que je risquais de ne pas trouver ce que je cherchais Et c’est exactement ce qui s’est produit…
Au début de mes travaux, j’ai écrit un programme pour repérer des phénomènes célestes dont la luminosité changerait plus rapidement que celle des supernovæ ordinaires En une journée, j’isolais entre dix et cent candidats, mais aucun ne correspondait à ce que je cherchais. Et en juin 2018, quelque chose a enfin retenu mon attention. Un rapport du relevé astronomique robotisé Atlas (auquel participe le ZTF) faisait état d’un événement étrange noté AT2018cow (« cow » est une suite aléatoire de lettres d’identification, mais ici elle correspond au mot « vache », en anglais, nom que l’événement a gardé). Au début, les observations plaidaient pour un sursaut gamma, mais aucun rayonnement de ce type ne fut détecté. Était-ce une émission rémanente ? Toujours est-il qu’AT2018cow était si brillant (10 à 100 fois plus
Les astronomes sont tels des zoologistes, explorant des territoires inconnus et caractérisant les différentes espèces qu’ils rencontrent
brillant qu’une supernova ordinaire) et si proche (à 200 millions d’années-lumière) qu’il a suscité un grand intérêt Les astronomes l’ont observé dans tout le spectre électromagnétique
L’explosion présentait les caractéristiques de plusieurs types de phénomènes distincts difficiles à combiner en une vision cohérente Diverses explications ont été proposées, mais sans toujours convaincre. Finalement, mes collègues et moi avons conclu qu’il y avait deux composantes majeures. La première était un moteur central, comme dans un sursaut gamma, mais dont la longévité était bien supérieure La seconde composante était un cocon de gaz et de poussière d’environ un millième de masse solaire dont, pour une raison inconnue, l’étoile s’était entourée au moment de son explosion
La plupart du temps, l’objet compact, une étoile à neutrons ou un trou noir, est complètement enveloppé dans ce qui reste de l’étoile ; nous n’avons donc que des informations indirectes sur sa naissance Mais si notre interprétation est correcte, le cœur stellaire qui s’est effondré était relativement visible. Pour la première fois, nous avons peut-être directement observé la formation de l’objet compact. Il n’en restait pas moins de nombreuses questions dont la réponse nécessitait l’observation d’autres événements similaires que nous avons cherchés dans le relevé astronomique ZTF. Trois mois plus tard, j’ai cru en tenir un avec l’explosion brillante et rapide du 9 septembre 2018, évoquée au début de l’article Initialement, cet événement ressemblait beaucoup à AT2018cow. Mais en moins d’une semaine, il est devenu clair que nous avions là une supernova de type Ic-BL (le type
associé aux sursauts gamma), notée SN2018gep. Certes, ce n’était pas un autre « vache », sauf que nous avions néanmoins quelque chose qui s’apparentait à un sursaut gamma. En cinq jours, nous avons recueilli des observations détaillées sur tout le spectre électromagnétique. Aucune trace de jet dans les données, mais, encore une fois, cet événement était atypique : un rayonnement optique intense à évolution rapide, qui ne correspond pas à une émission rémanente et qui résulterait de la collision de débris d’explosion avec un cocon de matière
Ce scénario était surprenant. D’autres étoiles, dont les supergéantes rouges, émettent du gaz et de la poussière puis se retrouvent enveloppées dans des cocons, mais ces astres ne sont pas associés aux supernovæ à sursaut gamma. Notre découverte impliquait que davantage de types d’étoiles que nous ne le pensions sont susceptibles de larguer du gaz à la fin de leur existence. L’étude de SN2018gep a révélé que l’étoile a perdu une fraction importante de son atmosphère externe dans les derniers jours de sa vie, après avoir brillé pendant des millions, voire des dizaines de millions d’années Ce délestage serait donc un indice annonciateur de la mort de l’étoile sans que l’on sache si ce comportement est fréquent, ni par quels mécanismes il advient Dès lors, je ne m’intéressais plus seulement aux sursauts gamma, mais aussi aux signes avant-coureurs de l’explosion des étoiles massives. Peut-être ces différents phénomènes étaient-ils liés…
C’est seulement en 2020 que j’ai enfin trouvé un candidat solide pour une émission rémanente de sursaut gamma (notée AT2020blt). Le 28 janvier, alors que j’examinais les événements sélectionnés par mon programme, j’ai remarqué quelque chose de prometteur. La prudence était néanmoins de mise et ce n’est qu’après avoir sollicité des observations complémentaires que j’ai bien eu la confirmation qu’il s’agissait d’une émission rémanente de sursaut gamma. J’avais eu de la chance. La source était faible, mais il y avait une signature évidente dans la lumière de l’événement qui nous a permis de mesurer sa distance Quand cette étoile a explosé, l’Univers n’avait que 2,3 milliards d’années. Les photons de l’explosion ont mis 11,4 milliards d’années pour atteindre la Terre À une telle distance, tout autre objet transitoire qu’un sursaut gamma aurait été impossible à observer.
Quelques mois après cette première émission rémanente, nous en avons trouvé une deuxième. Aujourd’hui encore, les observations sont toujours trop rares pour espérer répondre aux nombreuses questions qui se sont accumulées sur ce sujet Il est même difficile de dire si une émission rémanente donnée est un sursaut gamma normal dont on aurait manqué le jet ou s’il a pu être produit par un autre type de phénomène
Au cours de mes travaux, nous avons découvert de nombreux types inhabituels d’explosions stellaires : AT2018cow, l’étrange supernova Ic-BL qui s’est fracassée sur un cocon de matière mais
dépourvue de jet, deux autres supernovæ Ic-BL qui avaient probablement des jets, mais moins énergétiques et plus larges que ceux des sursauts gamma ordinaires, et enfin deux émissions rémanentes , dont l’une est associée à un sursaut gamma On peut ajouter l’émission rémanente de la supernova GRB 221 009A , exceptionnellement lumineuse, détectée le 9 octobre 2022.
Les astronomes croyaient l’histoire et le destin des étoiles simples et faciles à caractériser Il n’en est rien, et la mort des astres semble suivre des chemins bien plus riches et surprenants. Pour l’instant, les astronomes sont tels des zoologistes, explorant des territoires inconnus et caractérisant les différentes espèces qu’ils rencontrent L’étape suivante consistera à repérer des motifs caractéristiques parmi les événements atypiques recensés, et elle nécessitera un catalogue d’événements bien plus étoffé. Aussi la communauté attend-elle beaucoup du satellite franco-chinois Svom lancé le 22 juin 2024, ou bien de l’observatoire VeraRubin, dont on espère la première lumière en juillet 2025. Avec de tels instruments, il sera possible de comprendre pourquoi les étoiles meurent de mille et une façons différentes
L’autrice
> Anna Ho est professeuse d’astronomie à l’université Cornell, à Ithaca, aux États-Unis.
> A. Levan et al., The first JWST spectrum of a GRB a terglow : No bright supernova in observations of the brightest GRB of all time, GRB 221 009A, The Astrophysical Journal Letters, 2023.
> A. Y. Q. Ho et al., A search for extragalactic fast blue optical transients in ZTF and the rate of AT2018cow-like transients, The Astrophysical Journal, 2023.
> O. J. Roberts et al., Rapid spectral variability of a giant flare from a magnetar in NGC 253, Nature, 2021.
> A. Y. Q. Ho et al., ZTF20aajnksq (AT 2020blt) : A fast optical transient at z ≈ 2.9 with no detected gamma-ray burst counterpart, The Astrophysical Journal, 2020. À lire
À VISITER
L’Institut océanographique de Monaco se projette en 2050 et invite à une plongée dans une Méditerranée idéale, afin d’en faire une réalité.
Présentation en quelques chi res. Elle couvre 1 % de la surface des océans du monde, mais rassemble 10 % de la biodiversité. On y compte 17 000 espèces (contre 9 000 dans la Grande Barrière de corail), soit 7,5 % de la faune et 18 % de la flore marines mondiales. Le taux d’endémisme y est de 19 %, c’est-à-dire que 1 espèce sur 5 ne se rencontre nulle part ailleurs ; c’est l’équivalent des Galápagos. La mer Méditerranée, puisque c’est elle dont il s’agit, est donc un milieu naturel particulièrement riche ! Mais les menaces qui pèsent sur elle sont à la mesure du vivant qu’elle recèle : le bassin concentre 30 % du tourisme mondial, 30 % du trafic maritime mondial y passe, 58 % des stocks halieutiques y sont surexploités, et l’on prévoit qu’il abritera 580 millions d’êtres humains d’ici à 2050 (contre 239 millions dans les années 1960). C’est dire si cette mer, qui a vu naître tant de civilisations dont nous sommes les héritiers, est menacée. L’Institut océanographique de Monaco consacre à ce sujet sa dernière exposition, qui se veut une immersion spatiotemporelle dans la Méditerranée, celle d’hier, mais aussi, et surtout, celle de demain. L’événement s’articule autour de quatre temps.
Dans l’un d’eux, le passé de la mer est retracé sous la forme de projections sur une sculpture de cachalot de 4 mètres. On y découvre notamment les mouvements géologiques qui ont présidé à sa formation, lorsque la Thétys, un ancien océan, s’est peu à peu refermée à partir du Crétacé, ne laissant comme ouverture vers l’ailleurs que le détroit de Gibraltar. Dans un autre, les visiteurs embarquent dans un submersible futuriste, l’Oceano Odyssey, pour un voyage tout en réalité virtuelle projetée sur les murs d’une immense salle, au cœur du sanctuaire Pelagos tel qu’il sera idéalement en 2050. Dans cette zone, qui s’étend de Port-Cros, dans le sud de la France, jusqu’au sud de la Toscane, en Italie, en passant par le nord de la Sardaigne, les autorités italiennes, françaises et monégasques tentent de concilier harmonieusement les activités socioéconomiques et la protection des habitats et des espèces, et particulièrement les mammifères marins. En d’autres termes, il s’agit de montrer à quoi ressemble une aire marine protégée bien gérée !
C’est que l’exposition, au moment où s’est tenue à Nice la 3e conférence de l’ONU sur les océans, est le fer de lance d’un programme bien plus vaste de la principauté visant à faire

respecter l’objectif 30 x 30, soit 30 % d’aires marines protégées (AMP) d’ici à 2030, pris lors de la COP15 de la Convention des Nations unies sur la diversité biologique. Outre la mobilisation des acteurs politiques et économiques, cela passe aussi par une série d’explorations scientifiques, avec l’ambition, selon leur directeur Xavier Prache, de « braquer les projecteurs sur l’urgence et l’importance d’un développement accéléré et d’une gestion e cace des AMP en Méditerranée. »
Et tous de compter également sur le public, qui, au sortir de l’exposition, se fera ambassadeur de la Méditerranée pour, veut croire Robert Calcagno, directeur de l’institut, « ouvrir grand les portes devant le champ des possibles et construire un nouveau récit collectif ».
Loïc Mangin
« Méditerranée 2050 », au musée océanographique de Monaco. www.oceano.org
À VISITER
À Genève, une exposition révèle la force de la musique africaine pour, entre autres, se reconnecter au monde.
Dans les peintures pariétales vieilles de plus 5 000 ans que l’on trouve dans le Tassili n’Ajjer, en Algérie, et dans le massif de l’Ennedi, au Tchad, figurent de nombreuses… harpes ! Dans d’autres régions de l’Afrique, ce sont les témoignages de lithophones, des instruments de musique à percussion en pierre que l’archéologie a mis au jour et dont elle a montré le rôle d’accompagnement de diverses cérémonies et danses associées à des rituels de fertilité, de protection ou de commémoration des ancêtres ; et c’est encore le cas aujourd’hui. Ces deux exemples illustrent la grande richesse de la dernière exposition du musée d’Ethnographie de Genève, en Suisse, dont l’ambition est d’explorer le rôle de la musique et du son dans les sociétés africaines et leurs diasporas. L’événement marque le début pour l’établissement d’un nouveau cycle, « Ré-enchanter la Terre », et ici il est question, selon la directrice Carine Ayélé Durand, de puiser dans « l’énergie de la musique et du son pour ré-enchanter la Terre, à l’heure de l’anthropocène ».
Depuis la Préhistoire, jusqu’aux créations les plus contemporaines, le public découvre en quoi la musique est importante pour se connecter avec sa propre intériorité,

avec son histoire et sa généalogie, son environnement… Ainsi peut-on voir, au prisme de liens avec ce dernier, des instruments confectionnés à partir de matériaux de récupération ou bien pris dans la nature. À chaque fois, c’est une adaptation à ce qui nous entoure. Et l’on retrouve l’idée de paysage sonore inventé en 1977 par le compositeur et écologiste canadien R. Murray Schafer. De nombreuses autres facettes de la musique en Afrique sont explorées, et toutes montrent comment, explique
Madeleine Leclair, commissaire de l’exposition avec Ntshepe Tsekere Bopape (alias Mo Laudi) « le son, sous ses multiples formes, peut devenir une puissante force d’expression, de résistance et d’échange spirituel à travers les cultures, le temps et l’espace ».
L. M.
« Afrosonica – Paysages sonores », au musée d’Ethnographie de Genève, en Suisse, jusqu’au 4 janvier 2026. www.meg.ch.
À LIRE
Si la crise climatique est plutôt bien ancrée dans les esprits, il en va tout autrement de celle, pourtant associée, de la biodiversité.
L’humanité est dépendante des deux, mais la seconde sou re d’un déficit de médiatisation ! Pour y remédier, Franck Courchamp, directeur de recherche du CNRS, à l’université Paris-Saclay, et Mathieu Ughetti, illustrateur et vulgarisateur, ont concocté une bande dessinée (on leur doit déjà La Guerre des fourmis) qui fait le point sur les enjeux et l’ampleur de la sixième extinction en cours. Les deux auteurs expliquent également les raisons profondes qui empêchent les sociétés humaines d’agir en faveur de l’environnement, notamment piégées par les stratégies de désinformation et de manipulation élaborées par certains, comme les industriels. La bande dessinée est gratuite, et bientôt disponible dans vingt-cinq langues. De quoi se remettre les idées en place !
F. Courchamp et M. Ughetti, L’Héritage du dodo, disponible ici : lheritagedudodo.com

À VISITER
En prenant pour thème le biomimétisme, une exposition établit un dialogue entre les travaux de Léonard de Vinci et ceux des chercheurs contemporains.
«Iln’y a pas d’autre modèle que la chauve-souris », déclare, péremptoire, Léonard de Vinci, lorsque à partir de 1485 le maître de la Renaissance réfléchit à la conception d’une machine volante mue par la seule force musculaire d’un être humain. Et l’on a en tête son croquis d’une aile de chiroptère, parmi bien d’autres. Cette idée le taraudera pendant plusieurs décennies, bien décidé qu’il est à voir s’envoler un de ses congénères. Il multipliera également les études sur le vol des oiseaux, qui font l’objet d’un codex à part entière rédigé en 1505, conservé à Turin où figurent quelques-uns de ses projets de machines. Cet entremêlement entre observations de la nature et ingénierie fait dire à Pascal Brioist que Léonard est « le père du biomimétisme », ce processus d’innovation inspiré des formes et du fonctionnement du vivant. Et c’est justement le thème de l’exposition qui se tient au Clos-Lucé, dernière demeure de l’artiste polymathe, à Amboise, sous le commissariat du susdit professeur d’histoire moderne à l’université de Tours, avec Andrea Bernardoni, spécialiste de l’histoire de la technologie à l’université de l’Aquila, en Italie. L’objectif est d’inviter les visiteurs à explorer les liens entre nature,
science et technique, à la lumière du regard de Léonard et des ingénieurs actuels. Et c’est un voyage au long cours tant les thèmes abordés sont nombreux. Le parcours commence par un rappel des créations iconiques que l’on doit au biomimétisme, tel le Velcro inspiré de la bardane, les vitres autonettoyantes, car reprenant les propriétés du lotus, le train rapide japonais Shinkansen dont la forme aérodynamique doit tant au bec du martin-pêcheur…
Vient ensuite une salle où est détaillé le regard biomécanique que portait Léonard de Vinci sur le corps animal. De ses études, il imagine une armure animée par un ingénieux système combinant engrenages, poulies et ressorts, et il construit même un lion automate. Une démarche identique à celle des roboticiens, dont ceux du LAASCNRS de Toulouse, qui ont prêté quelques-unes de leurs créatures. Plus loin, après avoir croisé la folle inventivité de François Delarozière, créateur des Machines de l’île, à Nantes, développées en s’inspirant du monde animal, il est question de créatures marines qui, autant que les aériennes, ont fasciné Léonard. Pour preuve, ses nombreuses esquisses sur la nage des poissons, qui se traduisent par un projet de palmes pour les mains, inspirées

des nageoires de rouget.
Aujourd’hui, ce même esprit anime les constructions et les projets de l’architecte marin Jacques Rougerie, mais aussi les créations vestimentaires d’Iris van Herpen. Dernière étape, celle des fameuses machines volantes, où l’on peut admirer le dessin d’une aile artificielle tiré du Codex Atlanticus, venu de la bibliothèque Ambrosienne, à Milan. Le message de l’exposition est clair : repenser notre relation avec la nature, non comme une ressource à exploiter, mais comme un réservoir durable de solutions techniques à comprendre et à respecter. Léonard de Vinci était vraiment un précurseur !
L. M.
« S’inspirer du vivant : de Léonard de Vinci à nos jours », au Clos-Lucé, à Amboise, jusqu’au 10 septembre 2025. www.vinci-closluce.com

Au large du cap Corse, par 120 mètres de profondeur, une plaine sablonneuse est pavée de plus de 1 400 anneaux d’une vingtaine de mètres de diamètre. Pour expliquer ces motifs, découverts en 2010, biologistes, écologues, géologues, géophysiciens ou encore paléoclimatologues y sont allés de leurs hypothèses ; mais pour trancher, il fallait aller sur place. C’est ce qu’a fait le plongeur Laurent Ballesta, accompagné d’une équipe d’une quarantaine de chercheurs. À partir d’un « caisson de vie » immergé à 100 mètres, ils ont exploré la zone, qui abrite une biodiversité insoupçonnée, et finalement résolu le mystère. Pour le découvrir, vous pouvez parcourir l’exposition que le musée des Confluences, à Lyon, consacre à cette aventure, ou bien regarder le documentaire sur Arte tourné à cette occasion. Sachez que l’origine remonte à 21 000 ans…
L. M.
« Le mystère des anneaux », au musée des Confluences, à Lyon, jusqu’au 19 avril 2026. museedesconfluences.fr
« Cap Corse, le mystère des anneaux », sur Arte.tv disponible jusqu’au 2 août 2027. www.arte.tv
À VISITER
Le château de Castelnaud s’enorgueillit de spectaculaires armes de jet médiévales, en parfait état de marche.
Connaissez-vous le couillard ? Il s’agit d’une machine de guerre, basée sur le principe de la fronde, où un balancier muni de deux contrepoids propulse un boulet de pierre. Elle dérive d’un engin de jet plus connu, le trébuchet. Ces incontournables de l’artillerie médiévale, en envoyant dans les airs des projectiles d’une centaine de kilos à environ 200 mètres, permettaient des tirs plongeant par-dessus les murailles, mais aussi l’attaque de ces dernières. Ces « armes de destruction massive » seront employées jusqu’au XVIe siècle, avant d’être remplacées par des canons.
Et ces deux chefs-d’œuvre de l’ingéniosité militaire sont visibles à quelques kilomètres de Sarlat, en Dordogne, au château de Castelnaud qui, du haut de son éperon rocheux dominant la vallée, fête les 40 ans de son musée de la Guerre au Moyen Âge, riche de plus de 300 armes, armures et, plus largements de son ouverture au public… Le trébuchet et le couillard grandeur nature exposés, qui sont le fleuron de cette collection, sont certes des reproductions, mais elles sont en parfait état de marche ! On les doit à Renaud Be eyte, ingénieur et compagnon charpentier, qui est parvenu, après quelques échecs, à les reconstituer grâce à un carnet de croquis de Villard de Honnecourt, « engignior » du XIIIe siècle, déniché

par l’historien Jacques Miquel. En déchi rant le document, un tantinet codé, il fut possible d’accéder aux bonnes proportions à donner aux di érentes pièces de bois des machines. C’est un bel exemple d’archéologie expérimentale, soutenu depuis le début par la famille Rossillon, propriétaire du château depuis 1965 ! Depuis soixante ans, elle s’attache à restaurer et à faire vivre l’endroit, édifié au Moyen Âge, brûlé en 1215, reconstruit en 1218, détruit après la Révolution… Aujourd’hui, les visiteurs y découvrent comment forger une armure, fabriquer un bouclier… avant d’admirer trébuchet, couillard et autres armes de jet en action. Ce faisant, ils savourent de l’autre côté de la Dordogne, à quelques encablures du château de Castelnaud, mais hors de portée de couillard, les spectaculaires jardins de Marqueyssac, autre étape incontournable de la région.
L. M.
castelnaud.com
Rédacteur en chef adjoint : Loïc Mangin
MENSUEL POUR LA SCIENCE
Rédacteur en chef : François Lassagne
Rédactrice en chef adjointe : Marie-Neige Cordonnier
Rédacteurs : François Savatier et Sean Bailly
Développement numérique : Philippe Ribeau-Gésippe
Conception graphique : Céline Lapert et Ingrid Leroy
Direction artistique : Céline Lapert
Maquette : Pauline Bilbault, Raphaël Queruel, Ingrid Leroy et Ingrid Lhande
Réviseuses : Anne-Rozenn Jouble, Isabelle Bouchery et Maud Bruguière
Directeur marketing et développement : Frédéric-Alexandre Talec
Chef de produit marketing et partenariats : Ferdinand Moncaut ferdinand.moncaut@pourlascience.fr
Assistante administrative : Leïla Djema
Direction des ressources humaines : Olivia Le Prévost
Fabrication : Marianne Sigogne et Stéphanie Ho
Directeur de la publication et gérant : Nicolas Bréon
WWW.POURLASCIENCE.FR
170 bis bd du Montparnasse 75014 Paris
Tél. : 01 55 42 84 00
PUBLICITÉ FRANCE
stephanie.jullien@pourlascience.fr
ABONNEMENTS
Abonnement en ligne : https://www.pourlascience.fr/abonnements/ Courriel : serviceclients@groupepourlascience.fr
Tél. : 01 86 70 01 76
Du lundi au vendredi de 9 h à 13 h
Adresse postale : Service Abonnement – Groupe Pour la Science c/o opper Services – CS 60003 31242 L’Union
Tarif d'abonnement Formule Intégrale 1 an (12 numéros du magazine + 4 numéros Hors-Série + accès au site) : 99 euros
Europe et reste du monde : consulter https://www.pourlascience.fr/abonnements/
DIFFUSION
Contact réservé aux dépositaires et di useurs de presse – TBS SERVICES
Tél : 01 40 94 22 23
SCIENTIFIC AMERICAN
Editor in chief : David Ewalt President : Kimberly Lau
2024. Scientific American, une division de Springer Nature America, Inc. Soumis aux lois et traités nationaux et internationaux sur la propriété intellectuelle. Tous droits réservés. Utilisé sous licence. Aucune partie de ce numéro ne peut être reproduite par un procédé mécanique, photographique ou électronique, ou sous la forme d’un enregistrement audio, ni stockée dans un système d’extraction, transmise ou copiée d’une autre manière pour un usage public ou privé sans l’autorisation écrite de l’éditeur. La marque et le nom commercial « Scientific American » sont la propriété de Scientific American, Inc. Licence accordée à
« Pour la Science SARL ».
© Pour la Science SARL, 170 bis bd du Montparnasse, 75014 Paris. En application de la loi du 11 mars 1957, il est interdit de reproduire intégralement ou partiellement la présente revue sans autorisation de l’éditeur ou du Centre français de l’exploitation du droit de copie (20 rue des Grands-Augustins, 75006 Paris).


Origine du papier : Finlande • Taux de fibres recyclées : 0 % • « Eutrophisation » ou « Impact sur l’eau » : Ptot 0,003 kg/t
Imprimé en France – Maury imprimeur S.A. Malesherbes – N° d’imprimeur : 285 278 – N° d’édition : M0770728-01 – Dépôt légal : juillet 2025. Commission paritaire n° 0927K82079 – Distribution : MLP – ISSN 1246-7685 – Directeur de la publication et gérant : Nicolas Bréon.














Inscrivez-vous à notre newsletter hebdomadaire





