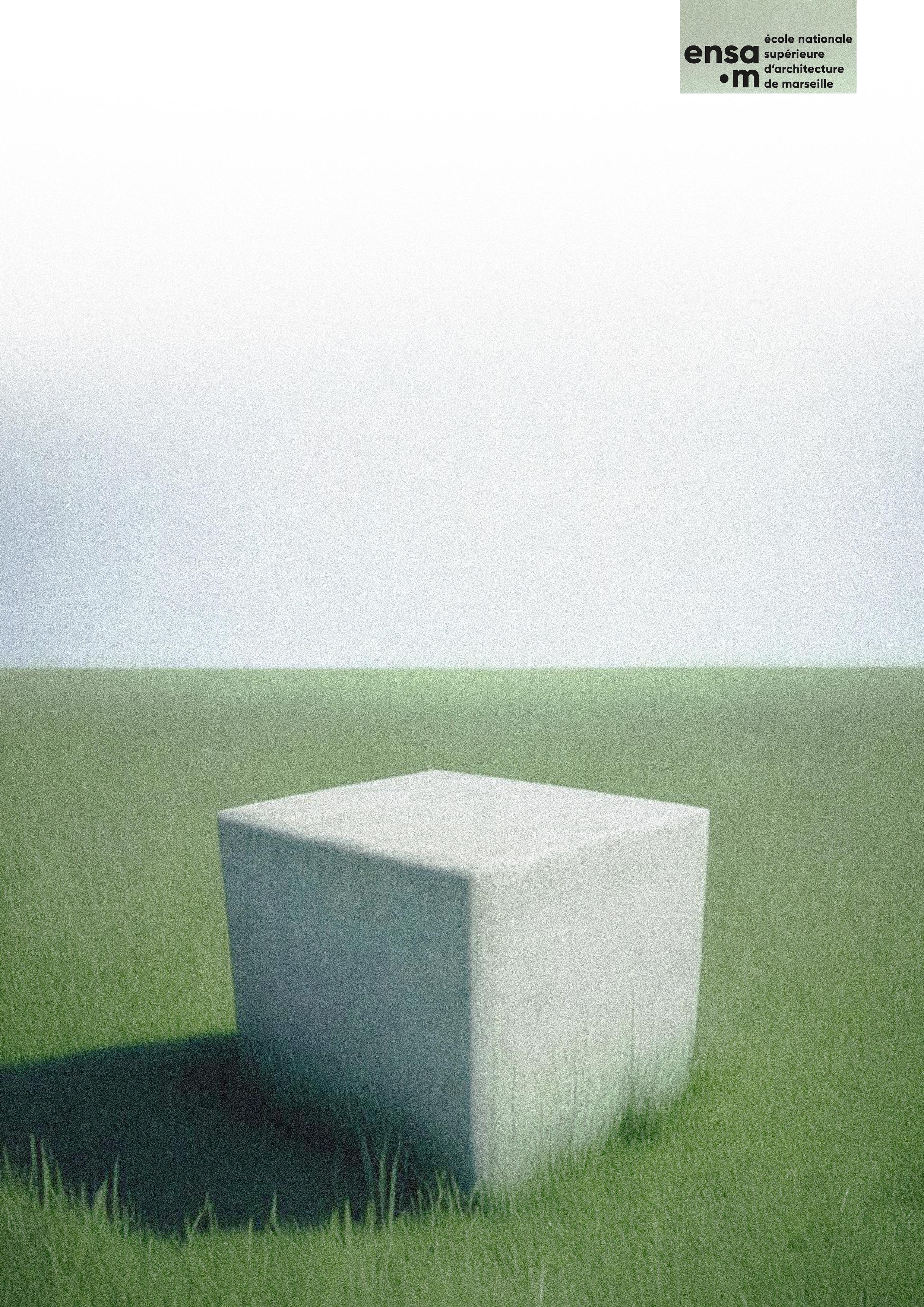

Mémoire de fin d'étude - 2022-2023
Directeur de mémoire : AZALBERT Raphaël
ENSA-MARSEILLE

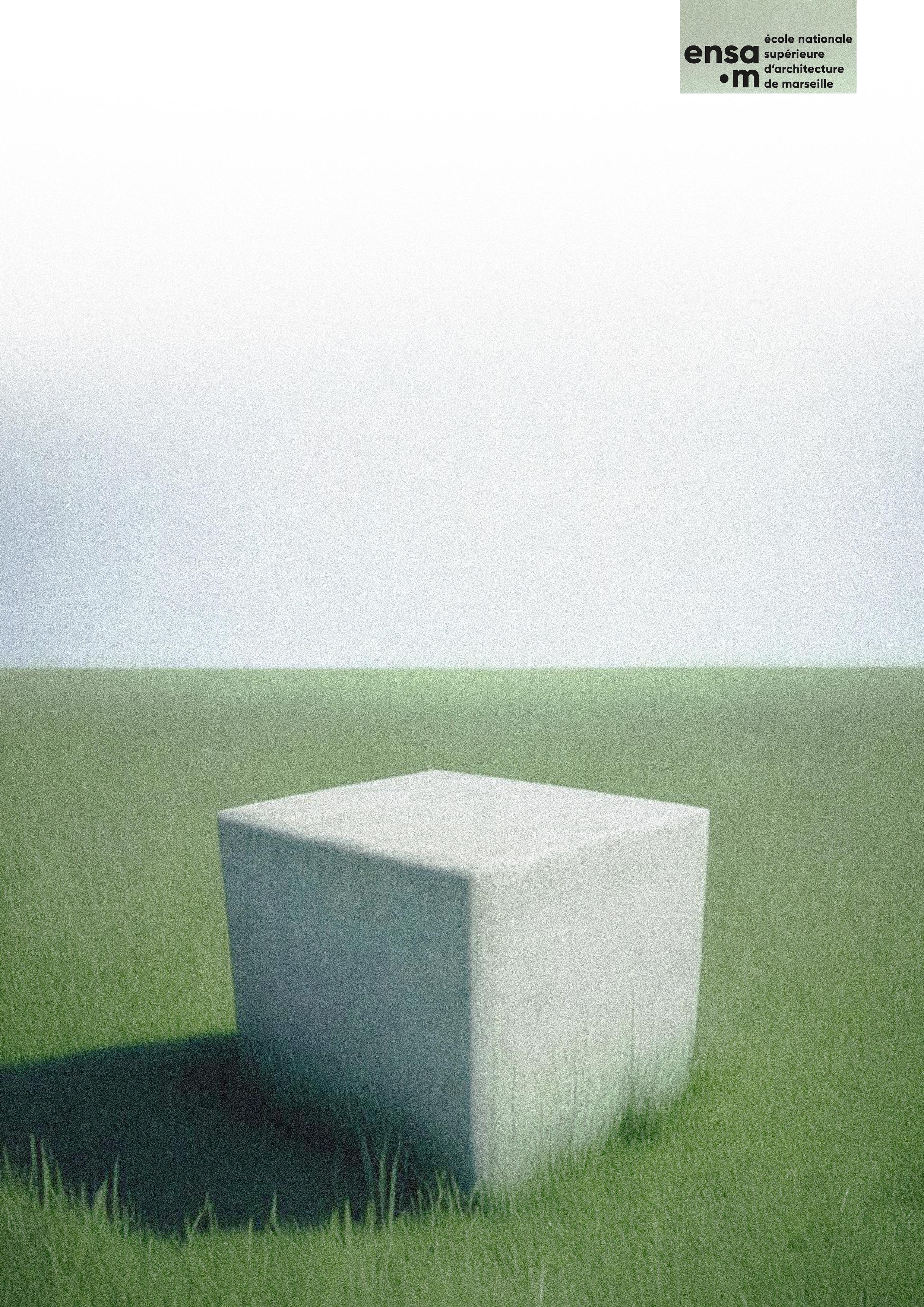

Mémoire de fin d'étude - 2022-2023
Directeur de mémoire : AZALBERT Raphaël
ENSA-MARSEILLE
Au sein de mes études d'architecture, une des choses qui m'a le plus frappée est sa pluridisciplinarité. Elle peut-être abordée de différentes façons et chaque manière de la voir aboutie à une compréhension distincte tandis qu'il s'agit de la même notion d'architecture. Quand des personnes, en dehors de cette discipline me demandent de leurs donner une définition précise, je me retrouve sans réponse.
Ma première réaction évidente est de se dire qu'il n'existe pas une définition de l'architecture, mais plusieurs. Je tente alors de retracer toutes les définitions possibles. La liste est longue. La tâche de la rendre exhaustive impossible. Et je m'affronte à une problématique : les définitions ont tendance à être contradictoires. Il existerait autant de définitions qu'il y a de personnes qui se sont penchées sur cette matière, quitte d'ailleurs à s'incliner à penser que l'on pourrait plaquer n'importe quels termes et les déclarer comme définition. Cette multitude de définitions dissout et affaiblie le concept d'architecture et anéanti toute possibilité d'avoir une compréhension concrète et actionnable.
Ma deuxième réaction est celle de prendre l'approche contraire et d'essayer de trouver tout ce qui n'est pas architecture. Je cherche alors à déconstruire les définitions pour arriver à une définition concrète. Cette approche, exécutée dans toute sa mesure, advient à être autant fructueuse que la dernière du fait qu'elle ma incitée à questionner les possibilités même d'un fondement. Comme quoi toute architecture peut être critiquée et il n'y aurait pas de règles fondamentales sur lesquelles on peut se baser.
Jusqu'à présent, plusieurs interprétations de l'architecture sont présentées: l'histoire de l'architecture, c'est longuement contentée de voir le développement de l'architecture comme une succession de catégories de styles. La théorie de l'architecture, de son côté, traite l'architecture comme un enchaînement de systèmes d'idées qui alimentent ces catégories de styles. Comme les deux dernières disciplines cités, plusieurs autres proposent leurs lectures réussites à des degrés variés. Avec la prise de conscience générale que l'architecture agît sur plusieurs sphères de nos vies, les disciplines connexes ne cessent de croître.
Pour en citer quelques-unes, on peut faire recours à l'anthropologie et la philosophie qui on rejoint l'enseignement de l'architecture que récemment. Une combinaison de ces différentes lectures serait sans doute la bonne manière pour pouvoir peindre la totalité de l'image de ce que c'est l'architecture.
Mais personnellement, cette dernière discipline me semble pouvoir être un outil intéressant pour arriver à une compréhension approfondie et mener à terme ma recherche de définition.
D'un côté, elle traite des questions fondamentales et de ce fait cherche à saisir l'essence primaire du sujet traité : dans ce cas l'architecture. Mais, il me semble aussi, que c'est la première animatrice de toutes possibilités. En ce sens, elle précède toutes architecture. Ludger Schwarte dans son livre, Philosophiede l'architecture, exprime d'une manière plus évidente l'idée que je veux faire passer : (voir ci-dessous)
Si elle est première animatrice de toutes possibilités, elle n'est pourtant pas source de toutes possibilités. Néanmoins, je m'intéresse à la philosophie du fait qu'elle précède toutes architectures et en ce sens, je mets en avant l'idée qu'elle est directrice de l'architecture. C'est elle qui poserait les premiers fondements concrets sur lesquels l'architecture vient prendre forme.
Architecturesignifielaconstruction(tektainomai)d'uncommencement,d'unfondoud'unprincipe:arché.Peut-êtreaussi lamiseàjourd'unesource.Sil'architectureinstallelecommencement,alorsellen'estpluselle-mêmelecommencement. Dansuneanalysestricte,laconstructionducommencement estelle-mêmeendehorsducommencementetn'estpasensoi, parprincipe,uncommencement.
Le choix du sujet est donc motivé par une recherche intime d'une ou plusieurs définitions(s) de l'architecture. Il en résulte un mémoire guidé par l'intuition que la philosophie tienne en elle des éléments de réponse. Mais ce mémoire est aussi une opportunité de présenter mes réflexions sur une période de l'histoire de l'architecture qui m'a marquée : celle du mouvement moderne.
C'est le contes de la passion que j'ai pour cette discipline et tous les univers qu'elle ramène à découvrir.
(...) toute la philosophie est comme un arbre, dont les racines sont la métaphysique, le tronc est la physique et les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences
(...) Or comme ce n'est pas des racines, ni du tronc des arbres, qu'on cueille les fruits, mais seulement des extrémités de leurs branches, ainsi la principale utilité de la philosophie dépend de celles de ses parties qu'on ne peut apprendre que les dernières.
INTRODUCTION:
I : LE MOUVEMENT MODERNE ET LA THÉORIE ARCHITECTURALE:
A) LE MOUVEMENT MODERNE:
1 - L'éclaircissement et l'avènement des fondement théoriques:
2 - L'éffondrement et la recherche d'une nouvelle voie:
B) LA THÉORIE DE L'ARCHITECTURE:
1 - La philosophie comme fond à la théorie:
II : LE MOUVEMENT MODERNE ET L'ONTOLOGIE:
A ) L'ARCHITECTURE ET LE LIEN À L'ONTOLOGIE:
1 - L'être comme principe de l'architecture:
B)LE MOUVEMENT MODERNE ET L'ONTOLOGIE
2 - La réduction de l'être à la raison:
III) UNE SYNÉRIGIE DE LA DICHOTOMIE?
1 - Une opposition entre deux forces ?
2 - Une synérgie de la dichotomie comme réponse ?
3 - Qu'es ce que cela incite en architecture ?
Au cours des millénaires, la définition de l'architecture a été un sujet abordé maintes fois. Néanmoins, selon différentes cultures et en fonction des différentes époques, on observe une constante impermanence de cette dernière. S'agit-il d'une question impossible, de ces questions condamnées à être éternellement posées et à rester sans réponse ? Du traité de Vitruve Da architectura datant du premier siècle avant J.C. à la Chartes d'Athène du siècle dernier, plusieurs textes présentant leurs interprétations nous ont offerts comme héritage de la longue histoire commune de l'humanité. Ceci est sans mentionner les bâtis conservés jusqu'à nos jours pour lesquels ces textes proposent des manières d'aborder cet "art de bâtir" ou auxquels ils s'avèrent à donner un sens a posteriori. Il est important de noter que ces textes sont de formes et de fonds amplement variées et surtout révélateur du caractère multidisciplinaire de l'architecture. Flouttant souvent les démarcations entre les différents domaines de connaissances de l'Homme et se présentant comme des textes généralisant qui proposent une manière d'habiter le monde.
Dans cette continuité de définition et redéfinition de l'architecture, le mouvement moderne porte son importance du fait qu'il soit une période charnière. C'est-à-dire d'une part, il représente l'avènement d'une graduelle concrétisation d'idéologies qui font leurs commencements à la Renaissance, mais d'une autre, il est aussi une période où il y a eu un tournant et ces idéologies sont remises en question. Vue dans l'ensemble : tous les mouvements après la Renaissance, en quelques sortes, alimentent le modernisme et tous les mouvements après le critiquent. Il n'y a pas eu un autre mouvement après la renaissance avec des idéologies assez fortes. De ce fait, ce mouvement peut être un élément clé pour arriver à notre but de définir ce qu'est l'architecture. Il nous sert de matière de réflexion relativement restreinte, et en ce, d’élément déclencheur de problématiques traitées autant dans leurs dimensions architecturales que philosophiques.
PHILOSOPHIE: QUEL LIEN À L'ARCHITECTURE?
Si les historiens et théoriciens de l'architecture relèvent les différentes mutations stylistiques et théoriques aux regard des époques et proposent une optique chronologique, l'architecture étant une notion d'une complexité importante qui nécessite une analyse quasiment herméneutique, leurs discours ne s'est pas pour autant éloigné d'une réflexion générale sur l'évolution culturelle de l'Homme. Comme indiqué dans le préambule, la discipline de la philosophie s'intéresse à l'architecture et vient éclairer une partie de cette réflexion culturelle. Elle relève l'évolution des pensées en soi qui alimenteraient l'architecture.
Comme indiqué auparavant, on prend la philosophie comme la première animatrice de toutes possibilités, qui précède l'architecture et la dicte. En ce sens, il sera question ici d'analyser les fondements philosophiques des théories du mouvement moderne. Pour se faire, on choisit de passer par l'histoire de l'architecture et la théorie de l'architecture pour pouvoir expliciter ces fondements.
Si la philosophie est l'outil utilisé ici pour faire notre analyse, elle reste pour autant très vaste comme discipline à appliquer sur l'architecture. Il reste alors la tâche de rétrécir notre champ et de choisir quelle branche de la philosophie à appliquer. Dans la philosophie, il existe, selon notre compréhension contemporaine, plusieurs branches qui étudient le vaste domaine des pensées. Pour schématiser, la logique, la métaphysique, l’éthique et l’esthétique sont les grandes branches de la philosophie. Tandis que les deux dernières discutent du bien et du beau respectivement, la logique et la métaphysique discutent du vrai. Ce qui nous intéresse ici est la recherche du vrai. On se contente donc des deux premiers.
Tandis que la logique s'occupe du processus de raisonnement afin d'arriver à la vérité, la métaphysique s'occupe de la connaissance du monde en tant que telle, dissociée de toute expériences sensibles. En d'autres mots, elle s'occupe des questions qui dépassent la simple physique. La métaphysique se divise davantage en deux parties : l'ontologie et l'épistémologie. Tandis que la dernière s'occupe des principes d'établissement de la connaissance, l'ontologie s'occupe des questions fondamentales. Elle cherche à connaître l'être indépendamment de toutes déterminations particulières.
Si notre but est de s'interroger sur les fondements philosophiques des théories du mouvement moderne afin de proposer une ou des définition (s) de l'architecture, l'ontologie est la branche qui nous intéresse pour notre démarche, du fait qu'elle s'occupe des questions les plus fondamentales.
En quoi l'ontologie peut nous permettre d'arriver à une ou des définition(s) de l'architecture ?
En adoptant une réflexion ontologique, il est question ici, d'analyser la période du mouvement moderne et de venir à une ou des définition (s) de l'architecture. Bien évidemment, les relations que l'on cherche à tracer entre ontologie et architecture sont loin d’être causales. Tout effort à vouloir aligner directement les faits architecturaux à une notion philosophique demeure déraisonnable ou au mieux, vrais semblable. Mais comme tous les domaines de connaissance, l'architecture n'échappe pas aux avalanches conséquentielles des réflexions philosophiques d'une époque. Il me semble alors intéressant d'aborder l'architecture par cette perspective particulière. Le traitement de ce sujet n'est, de toute évidence, pas une entreprise nouvelle. Tout du moins, ma modeste réinterprétation, et les nouvelles analogies que je tenterais de dresser me poussent à me convaincre que cette exploration est digne d’une poursuite.
Une difficulté est observée lorsque les historiens d'architecture tentent de cerner la période de genèse exacte du mouvement moderne. Plus la recherche s'approfondit, elle s'avère remonter davantage dans le temps. Une deuxième difficulté se rajoute lorsque l'on cherche à faire un bilan compréhensif de ce mouvement du fait que la période s'étend sur un laps de temps important d'autant plus que le terme d'architecture moderne est une expression chapeaux qui incluent plusieurs courants architecturaux. La complexité demeure, étant donné que ce mouvement est la conséquence de plusieurs sphères qui interagissent entre elles : allant des évolutions sociales et culturelles jusqu'aux développements d'ordre techniques et industrielles. Les historiens abordent en fonction de leurs buts plusieurs méthodologies de lecture. Faire un résumé couvrant tous les aspects de ce mouvement est donc une tâche quasiment impossible, ne serait-ce que le but de cette partie. Il s'agit ici plutôt de faire un récapitulatif de cette période, avec l'intention précise de soulever des éléments qui nous permettent de relier la pratique de l'architecture durant le mouvement moderne à la théorie de l'architecture. Pour se simplifier la tâche, on s'aide de la division du mouvement moderne proposé dans la préface de Leonardo Benevolo. En plaçant l'ouverture de l'école de Weimar par Gropius (significatif pour la mise en union des théories du mouvement moderne à la pratique) comme point centrale dans la chronologie, il place toutes les expériences du modernisme antérieures à cet événement, dont celles "de Morris, de Horta, de Wagner, de Hoffmann de Berlage, de Loos, de Perret, de Sullivan, de Wright"1 comme appartenantes à une période de croissance de ce mouvement. Les événements qui suivent ce point central, ceux de "Le Corbusier, Gropius, Mies Van der Rohe, Jacobsen, Tange, Bakema "2 appartiennent au contraire à une période de pleine maturité. (Leonardo Benevolo, 1998)3 Cette division nous permet donc d'avoir une vision schématique et de s'intéresser aux points clé du mouvement étudié. Revenons maintenant sur le point de départ de ce dernier.
Kenneth Frampton relève les problèmes exprimés auparavant et explique que le début de l'architecture moderne est généralement placé à la Renaissance ou au moins au XVIIIe siècle, lorsque les idéaux de l'architecture vitruviennes sont remis en question par les architectes à l'avenue de l'avancement dans la recherche de vestiges de l'antiquité et des transformations techniques qui ont eu lieu depuis les Lumières. (Kenneth Frampton, 2006)4. Leonardo Benevolo dans la préface de son œuvre cité plus haut, explicite de la même manière, que "les rapports entre architecture et société commencent à se transformer radicalement"5 à la moitié du XVIIIe siècle et qu'une simple étude des valeurs formelles architecturales, qui est possible pour les périodes précédentes, ne suffit plus. On peut ainsi aisément placer le début du modernisme vers le XVIIIe siècle. A titre indicatif, la Renaissance est une période qui a vu un ad fontes : terme utilisé durant cette époque pour signifier un retour général des réflexions de cette période aux sources de la culture grecque et romaine, altérées ou perdues durant le moyen-âge, jugées maintenant idéales. Dans l'architecture, ceci s'est traduit par les myriades de réinterprétation du traité de Vitruve, De Architectura.
(1Leonardo Benevolo, Histoire de l'architecture moderne, Tome 1 La révolution industrielle, 1998)
(2Ibid)
(3Ibid)
(4Kenneth Frampton, L'architecture moderne, Une histoireCritique, 2006)
(5Leonardo Benevolo, Histoire de l'architecture moderne, Tome 1 La révolution industrielle, 1998)
Ainsi, les architectes du XVIIIe siècle, par leurs réfutations du canon vitruvien nous explicitent un premier élément important qui relie l'architecture moderne à une recherche d'un nouveau fondement théorique. Cette réfutation relève de l'incapacité des canons antiques, confrontées à la possibilité d'existence d'autres modèles, à tenir leurs statues d'universalité. Les événements de recherche de nouveaux fondements qui se développent durant cette période semblent à première vue ponctuelle, mais une fois la lecture de l'ensemble faite, ils racontent l'unité du discours du mouvement moderne.


Les prémices de la nécessité d'une nouvelle théorie en architecture certes ressenties depuis le XVIIIe siècle, les premières actualisations concrètes de celles-ci ne se font qu'au XIXe siècle en Angleterre, avec John Ruskin et William Morris. Le premier, dans une série de publications, explicite un premier positionnement anticlassique clairement formulé. Le deuxième, avec l'établissement de sa Red House entreprend la conception d'œuvres qui incarnent l'esprit d'une première variante de ce mouvement. Il est important de noter que les œuvres ne sont pas seulement architecturales, mais aussi tournées vers l'artisanat et que les critiques sont davantage alimentées de questions d'ordres sociales, économiques et politiques. Ces deux personnages, qui sont les précurseurs du mouvement Arts & Crafts, incarnent ainsi les critiques faits à l'industrialisation qui a pris le dessus par sa production en masse et qui a mis la place de l'artiste, de l'artisan et par extension celle de l'architecte, en question (Kenneth Frampton, 2006)1. On peut comprendre par ceci que l'industrialisation est un processus qui s'est fait premièrement en dehors de la sphère architecturale. On constate alors que la recherche de fondements théoriques, dans ce cas, ne se fait pas seulement à l'encontre des canons antiques, mais constituent plus précisément une réponse active contre la notion de progrès (transformations techniques) telle qu'elle s'actualise à cette époque et influence les sphères sociale, économique et politique et bien évidemment architecturale. Ces idées sont ensuite reprises et renforcées par C.R Mackintosh pour œuvrer l'École d'Art de Glasgow qui est le bâtiment précurseur du mouvement Arts & Crafts.
Une deuxième réaction à la nécessité de nouveaux fondements se fait par le théoricien Eugène Viollet-le-Duc, qui dans ses discours cherche primairement à porter le regard sur l'importance de la restauration d'œuvres du moyen-âge, explicite une nouvelle manière d'appréhender l'architecture. Son rationalisme structurel va à l'encontre du rationalisme classique et se base sur une compréhension des œuvres gothiques qu'il juge être inspiré des lois de la nature. Son approche devient une inspiration directe pour une multitude d'architectes, dont Gaudi, Horta, Guimard et Berlage. Ces architectes prennent les leçons de Viollet-le-Duc et les combines à leurs aspirations propres. Pour Gaudi, ses aspirations relevaient d'un "désir de faire revivre l'architecture locale et créer des formes totalement nouvelles"2. Horta, travaille son architecture par une maîtrise savante de matériaux, en particulier le fer, utilisé expressément dans leurs vérités structurelles. Quant à Guimard, il adopte "une expression relâchée, rustique, (...), un style urbain (...) une sorte de résille composite en fer et verre"3. Il est le fameux architecte qui crée le 'style métro'. Et enfin Berlage a une "volonté de rendre explicite la construction"4 par la simplification méthodique de la structure. Il met en avant des écrits théoriques qui démontrent de ces volontés. Il faut aussi noter que chaque architecte cité ici a une ambition plus ou moins marquée de créer un style national respectivement à son pays d'origine. Cette deuxième réaction relève d'une importance mis sur la vérité structurelle et en ce, est un des premiers signes d'une volonté d'abolition des ornements dans l'architecture. Elle considère que la bonne architecture relève d'une bonne compréhension des règles physiques qui s'opèrent derrière l'édification d'un bâtiment et considère qu'elle doit être exprimée explicitement dans la forme architecturale. On peut également noter que cette réaction cherche aussi une redéfinition de styles nationaux qui est permise par l'abolition des styles vue comme appartenant à la vielle époque à savoir le style classique, néogothique ou néo roman.
(2Ibid)
Si la première réaction à la nécessité de nouveaux fondements théoriques de l'architecture va à l'encontre de la production industrielle, celle que l'on cite ci-après prend la direction contraire. Adler et Sullvian, érigent à Chicago, dans une ambiance de reconstruction, des bâtiments hauts, remarquables pour leurs ingénuités conceptuelle et technique ainsi que pour le développement d'un langage architectural qui leur son propre. Ces bâtiments se présentent alors comme l'avènement d'un mode de construction offert par l'industrie, à savoir l'ossature métallique, mais aussi comme l'expression d'une ornementation estompée qui semble émaner du matériau même. (Kenneth Frampton, 2006)1 On constate ici qu'il s'agit d'une recherche de pratiques architecturales qui fond l'usage de l'industrie tout en créant leurs propres bases esthétiques détachées de la tradition classique et développant l'idée d'une expression formelle sobre. Il en va de même pour l'architecte Frank Llyod Wright qui dans son mythe de la prairie, cherche "la transformation de la technique industrielle par l'art"2. Avec une inspiration d'architectures exotiques d'origines diverses: japonaise, précolombienne, égyptienne, assyrienne ou celte, mais aussi l'architecture neoroman qui est la norme de l'époque, Wright arrive à synthétiser et créer son style nouveau qui utilise l'avancement industriel comme moyen pour l'abstraction et la purification de ces oeuvres.


PÉRIODE DE MATURITÉ DU MOUVEMENT MODERNE à la recherche d'une objectivité architecturale:
D'un génie incomparable, Le Corbusier est une des figures importantes du zénith du mouvement moderne. Sa conception du principe de la maison "Dom-Ino" marque une de ses premières contributions remarquables pour sa rationalité structurelle. "Les cinq points de l'architecture moderne" s'expriment sur ce model "Dom-Ino". C'est à dire les pilotis ; le toit-terrasse; le plan libre; la fenêtre-bandeau et la façade libre. Ce model permet une efficacité révolutionnaire pour la conception et la mise en œuvre. Il développe entre autres sa théorie architecturale dans son livre Vers une architecture 1923 qui "articulera : d'un côté, le besoin impératif de satisfaire les exigences fonctionnelles par des formes empiriques ; de l'autre, le recours à des éléments abstraits"1. Une deuxième figure importante du modernisme est sans doute Mies Van der Rohe. Cet architecte dévellope une esthétique qui met en place une clarté formel et l'utilisation de materieaux comme le verre et l'acier. Le Pavillion de l'Allemagne en Barcelone est la synthèse des réflexions qu'il fait. Le plan libre avec les murs qui deviennent délimitant et non-porteuse et la fluidité de l'espace qui se fait grâce aux façades en verre et poteaux fin métallique sont les principales caractéristiques. On constate alors avec l'exemple des deux architectes ci-dessus que le mouvement moderne est en plein fleurissement, et que les fondements théoriques sont assez stable. Centrés sur l'importance de la fonctionnalité et de l'utilisation de formes sobres et abstraites.
On observe dans l'évolution du mouvement moderne, une recherche d'une nouvelle base théorique. Si durant la première phase, les intentions étaient celles d'un détachement des ordres classique de la Renaissance afin d'arriver à ce but, durant la maturité du mouvement, ils sont animés davantage par une recherche d'un style universelle, autodéterminé et suffisant. Durant cette maturité, le fonctionnalisme, le mode de production industrielle et une vision totalisante de la société sont mis en avant. (dépouillé de toute "poésie", même si l'intention initiale n'est pas celle-ci). On observe tout du moins, que quelques architectes relèvent, d'une manière nostalgique, l'importance d'un retour à la tradition ou l'importance de la création de nouvelles formes architecturales qui incarneraient cette "poésie" perdue. Ces derniers visons se concrétisent dans la période suivante et se manifestent par de nouvelles critiques, mais cette fois-ci, des valeurs du mouvement moderne précédentes.
2 - L'éffondrement et la recherche d'une nouvelle voie:
La Charte d'Athène est le point culminant du mouvement moderne, mais une nouvelle génération critiquant les idées mise en place apparaît et on voit déjà les signes au CIAM VI, là ou ils cherchent à "transcender la stérilité abstraite de la 'ville fonctionelle' "1 en affirmant que "le but des CIAM est d'œuvrer à la création d'un cadre bâti qui satisfera les besoins émotionnels et rationnels de l'homme"2. Advient alors la naissance du Team X. Cet intérêt à la dimension émotionelle de l'Homme est une critique à l'indifférence que le fonctionnalisme engendre. Ainsi en prenant l'idée de la cellule familiale comme base pour le développement d'une nouvelle structure d'urbanisation, des personnages comme les Smithson, Van Eyck et Shadrach Woods entreprirent la recherche d'une réponse contre les déclarations fonctionnelles de la Charte d'Athène. Les Smithson proposent "une critique ouverte de la Ville radieuse et du zoning urbain en quatre fonctions (...) opposèrent à ces dernières les catégories plus phénoménologiques de maison, rue, quartier et ville."3 dans leur projet de Golden Lane. Ce projet est ainsi une nouvelle approche qui cherche à réduire l'échelle prise en considération lors de la conception d'un projet. Pour faire appel à des dimensions davantage correspondante à l'Homme et non à un cadre fonctionnaliste qui met à l'écart ce dernier. Van Eyck de son côté, accentue encore plus cette recherche en s'intéressant sur les notions d'intemporalité de l'homme et l'importance du pluralisme, au point où il se demande s'il est même possible d'avoir des réponses concrètes aux conséquences engendrées par le mouvement moderne. Il critique "le rôle joué par l'architecture moderne dans l'éradication du style comme du lieu."4 Dans un tempérament davantage positif que ce dernier, Shadrach Woods développe un projet non construit mais qui prenait en compte le contexte immédiat et le besoin émotionnel et réfute le fonctionnalisme du modernisme. Ceci est un prototype d'une ville en miniature, qui dans sa composition spatiale met en interaction plusieurs niveaux grâce à des escalators et qui cherche à avoir une densité forte d'occupation. Cela engendrerait donc une forte probabilité d'interaction sociale spontanée dut à sa nature complexe.
Si une vision centrée prenant en compte la dimension émotionnelle dans l'architecture se développe de l'intérieur même de l'équipe du CIAM, une autre réaction au modernisme centré sur un développement de la technique est observé. L'avant-garde architecturale des années 1960 cherche à pousser la technique à ses limites et cherche à répondre aux problèmes survenus. Parmi les néofuturistes on peut citer le groupe Archigramme ou le mouvement métaboliste japonnais dont Noriaki Kurokawa, avec sa tour de capsule, en faisait partie. Néanmoins, cette tendance est, entre autres, critiquée par Schnaidt qui voit dans ce mouvement seulement une échappatoire et non un avancement de l'architecture. Il dit que "Cette confiance illimitée dans les possibilités de la technique s'accompagne (...) d'une naïveté surprenante en ce qui concerne l'avenir de l'homme" (Schnaidt, Architecture et engagement politique, 1967).
Une autre critique au mouvement moderne axé une nouvelle fois sur une dimension sociale est celui des neo-rationaliste initié par les Italiens qui voit un avènement chez les Allemands. Oswald Mathias Ungers est un parfait exemple de ce mouvement qui cherche à s'opposer à un consumérisme excessif dans la nouvelle culture. Théoricien, il explicite l'importance de la 'transformation typologique' au sein de la ville. Que ce processus est la raison même de l'architecture et que l'architecture doit découler du genuis loci. Une idée qui va à l'encontre du fonctionnalisme dictant la forme. Dans la même inclinaison le néo-structuralisme prend naissance dans l'idée de proposer avec l'architecture une opportunité pour les usagers de faire leurs "interprétation individuelle" de toutes modèles collectifs " en d'autres mots de proposer un "espace poly-
alent" aux usagers, libre d'appropriation.
D'autres réactions au modernisme avec des idéologies plus prononcées se produisent. Si avec le productivisme les architectes se replient aux demandes d'une société consumériste qui voit l'architecture comme un produit, et que le postmodernisme se bat contre le dénuement formel du modernisme avec un retour satirique à ornementation et la référence historique, c'est avec le déconstructivisme que l'on voit une rupture totale des valeurs architecturales, sociétales, historique et cetera. Une architecture qui ne cherche pas à affirmer un style, mais qui relève des questions provocantes, architecturales, sociétales ou voir même politque.
Cette période peut donc être caractérisée comme une agrégation des critiques sur les conséquences du mouvement moderne, mais aussi une recherche active de réponses. Elle est le résultat d'une nouvelle génération, qui confrontée aux productions des actions prises auparavant, quêtent, dans une version la plus agressive, de se détacher du modernisme ou dans une version plus tempérée, d'unir les idéaux du modernisme avec le sentiment toujours grandissant de l'importance de la création de lieux. Ce phénomène est toujours d'actualité et vue que l'architecture est influencée par plusieurs sphères tel que les évolution sociales, économiques, techniques, industrielles, politique et cetera, l'architecte est confronté à une prise de position incessante au sein des discours culturels qui dépassent la simple discipline. Voyons alors quel rôle joue la philosophie dans l'architecture en passant par la théorie de l'architecture.

1 - La philosophie comme fond à la théorie:
GENÈSE:
Si l'architecture a été un métier pratiqué pendant des millénaires, la théorie de l'architecture est un phénomène bien plus récent dans l'histoire. La théorie de l'architecture est apparue concrètement à la Renaissance et se développe premièrement par une analyse d'une époque antique lointaine. C'est, comme vue auparavant, les réinterprétations du traité de Vitruve qui actionnent les considérations théoriques de l'architecture. "L'image de l'architecte mute donc vers celle d'un philologue* " 1 qui fait une analyse critique de textes pour arriver à ses propres conclusions. Les traités sont les écrits principaux dans la théorie de l'architecture et le moyen de transmission des idées architecturales développées. "Le développement de l'imprimerie et en conséquence la possibilité d'illustrer les écrits, joue un rôle primordial dans le décloisonnement entre les écrits (litterae) et l'art architectural (ars meccanica) du moyen-âge.2 " Ce dernier permet à l'architecte d'approfondir ses réflexions sur son sujet mais aussi d'étendre son horizon sur d'autres sphères tel la politique, la société et la philosophie. Nous avons donc ici un premier lien possible entre théorie de l'architecture et philosophie, mais approfondissions ceci.
La genèse de la théorie de l'architecture se fait à la même époque où la philosophie traverse une régénération. Les philosophes dite modernes tel que Pétrarque et Thomas More pour la période de la Renaissance, mais aussi des personnages tel que Descartes, Spinoza et Leibniz pour la période des Lumières, avancent leurs idées Humanistes. On peut donc supposer de cette simultanéité, que les architectes théoriciens s'inspirent des méditations philosophiques de leurs temps, étant donné aussi que le développement de l'imprimerie le permet et que cela transparaisse dans leurs théories architecturales et par extension dans leurs œuvres. Mais l'on peut citer des cas concrets tels que le philosophe Leon Battista Alberti qui est aussi théoricien en architecture qui s'inspire explicitement de la philosophie pour formuler ses théories. Et il y va de même pour le polymathe Léonard de Vinci. Ceci n'est pas étonnant du fait que durant cette période plusieurs disciplines sont pratiquées par la même personne.
Néanmoins, cette interaction entre architecture et philosophie n'est pas limitée à la seule période de genèse de la théorie de l'architecture. Évidemment elle est présente dans les époques qui suivent, mais aussi comme démontrée par José Ferrater Mora, elle est présente durant le moyen-âge gothique :
" les caractères de totalité (énumération suffisante), ceux de disposition selon un système de parties homologues, subdivisées à leurs tours (articulation suffisante), enfin la distinction logique et la cohérence déductive (inter-relation suffisante), tous ces caractères qu'on trouve dans la somme, on les retrouve aussi dans l'architecture de l'époque, non certes que les constructeurs des cathédrales gothiques eussent lu Gilbert de la Porrée ou saint Thomas d'Aquin, mais parce qu'ils furent influencés par le point de vue scolastiques. 3 " .
Il y aurait donc un certain entrelacement entre l'architecture et la philosophie, qu'il soit fait en passant par la théorie ou pas. Comme si l'architecture est la révélation concrète des pensées d'une culture. On peut rajouter à ceci, des exemples extérieurs
* philologue: Spécialiste de l'étude historique (grammaticale, linguistique, etc.) des textes. Le Robert. (s.d.)
(1 BERND, EVERS, Théorie de l'architecture, 2011)
(2Ibid)
3 (José Ferrater Mora, Philosophieetarchitecture 1955)
tel que l'architecture égyptienne antique qui est révélateur d'une culture et philosophie orientées vers la religion et la vénération de la mort tel qu'il sont expressament montrées par la construction des pyramides. Ou l'on peut aussi orienter notre regard vers l'est et voir les architectures traditionnelles: japonaise, qui se base, faute de généralisation, sur le bouddhisme, chinoise sur le confucianisme ou indienne sur l'hindouisme et cetera. Les exemples sont infinis.

Il est aussi intéressant de voir que dans l'évolution de la théorie de l'architecture deux tendances prennent cours. D'une part, l'architecture est vue comme agent permettant de trouver l'ordre dans le monde. Visant par la programmation et une création d'un système autosuffisant. L'architecture vue comme " un tout fait de parties isolées 1". Cette création de système cherche à prendre en compte une myriade de paramètres (soient-ils fonctionnels, esthétiques, sociaux, économiques, politique et cetera) pour aboutir à une proposition de manière d'habiter. Dans les cas extrêmes, ce système peut s'avérer être utopique et détachés de la réalité, mais toujours dans l'intention de créer une structure fermée. D'une autre, un mouvement de l'Anti-Théorie, qui au contraire cherche à affranchir l'architecture de cette démarche d'impositions préalables déterminantes (BERND, EVERS, 2011).
Si la théorie de l'architecture prête attention aux développement stylistiques au cours des siècles, elle est comme démontrée plus haut liée à la philosophie. Son développement par ailleurs nous montre deux tendances intéressantes celle de la théorisation et de l'anti-théorie. Certes, la conscience de l'existence d'un lien entre culture et architecture n'est pas d'une grande nouveauté et elle est abondamment admise dans le discours architectural contemporain. Jean Nouvel, dit : " L’architecture est la pétrification d’un moment de culture " et il en va de même pour plusieurs autres architectes. Mais il est question ici de montrer l'existence d'une relation encore plus inhérente entre architecture et philosophie. Comme quoi la philosophie serait inévitablement dirigeante de l'architecture. Cette recherche nous incite donc à rentrer un peu plus dans le détail et à proposer des corrélations plus spécifiques. Et pour cela intéressons nous au développement de la philosophie et plus particulièrement à l'ontologie qui est la branche qui nous intéresse.
A ) L'ARCHITECTURE ET LE LIEN À L'ONTOLOGIE:
1 - L'être comme principe de l'architecture:
L'évolution des idées peut se comprendre comme un palimpseste dont les dernières écritures au lieu de disparaître dans le néant sont réinterprétées et reposées sur le parchemin du temps. Et il arrive que certaines idées soient d'une ampleur qu'elles résistent à l'effacement même. Il est évident, de la dernière partie, que l'architecture est influencée par la philosophie. Si la théorie de l'architecture consiste réellement d'un débat philosophique, l'ontologie qui traite des questions fondamentales est au cœur de ce débat. C'est ce que l'on cherche à illustrer dans cette partie.
Comme décrite dans l'introduction, l'ontologie est une branche de la philosophie qui traite des questions fondamentales. Ce terme apparu au XVIIe siècle retrace son étymologie au grec ontos qui signifie étant1*, et logos qui signifie discours. L'ontologie peut donc se comprendre comme le discours sur ce qui existe. Dans la tradition philosophique, elle traite des sujets tel que : le réel, l'existence, l'espace, le temps, la réalité empirique, la temporalité, la causalité, le déterminisme, l'émergence, les universaux, l'ultime, le néant et cetera. Et elle est considérée par la tradition comme philosophie primaire. Dans la compréhension contemporaine, elle est comprise comme traitante plus spécifiquement de la question de l'être. Voyons plus en détail l'histoire de cette discipline et le lien avec l'architecture.
L'ÊTRE COMME PRINCIPE DE L'ARCHITECTURE :
Si les périodes de genèse du mouvement moderne et de la théorie de l'architecture ont tendance à remonter dans le temps, lorsque on fait une analyse davantage rigoureuse, la genèse de l'ontologie serait, elle, confondu à l'apparition même de l'Homme, du fais que, quand ont parle de la question de l'être, nous abordons une échelle qui a à faire avec le tissu inhérent de l'expérience humaine. Inconsciemment, ou pas, ces questions sont relevées au quotidien. Au mieux, on peut retracer sa genèse en tant que recherche consciente et explicitée. L'ontologie apparaît dans la philosophie de la Grèce antique et se développe jusqu'à nos jours (faute de généralisation) en quatre périodes : l'antiquité, le moyen-âge, la renaissance et les lumières et l'époque contemporaine. On prend l'exemple de quelques philosophes qui ont fait avancer les pensées en fonctions des périodes citées ci-dessus pour faire le lien à l'architecture :
Parménide écrit « L’Être est, et le Non-être n’est pas » - de cette simple formulation, ce premier philosophe qui traite explicitement de la question, nous fais comprendre que l'être est définit par ses attributs non-contradictoires et qu'il est donc univoque. L'être relève selon lui de la logique. On saisit l'être par son intelligibilité (ce qui est compris). Si « L’Être est, et le Non-être n’est pas » il s'oppose à toutes les pensées de mouvement qui s'incarneraient dans l'être. Comme quoi il n'y a pas de changement dans l'être. Il oppose la doxa2* à la vérité (la première amenant à une connaissance fausse).
1*étant : L'être, en tant que phénomène Le Robert (s.d.)
2*doxa : (grec doksa, rumeur) Ensemble des opinions communes aux membres d'une société et qui sont relatives à un comportement social, Larousse (s.d.)
Aristote
Si Parménide pose cette question de l'être, Aristote la constitue en une vraie science. Aristote dit : "la métaphysique est la science de l'être en tant qu'être". Elle affirme ainsi que l'être peut être étudié systématiquement pour arriver à une connaissance. Pour lui " L'être est plurielle " et on peut le ranger en huit catégories : substance ou (essence), qualité, quantité, relative au lieu, moment, position, possession, action et passion. La substance dite (ousia) a une primauté sur les autres catégories et est le fondement, car c'est elle que l'on qualifie par les autres catégories. La substance est à la fois matérielle et idéelle chez Aristote. Il pose Dieu comme la substance primaire.
Platon:
Dit que « L'être est, et le non-être est », il affirme donc lui aussi que l'être est plurielle. Il tient en outre l'idée que la réalité que l'on croît connaître n'est vraiment qu'une série de phénomènes que nous percevons. C'est-à-dire qu'il y a une réalité voilée derrière, qui anime ces phénomènes. Il pense davantage que la manière d'arriver à cette réalité cachée est seulement avec notre faculté de raison. Il développe alors la maïeutique (un processus rationnel) pour pouvoir arriver à cette réalité. Il développe aussi l'idée que cette réalité fondamentale est une agrégation d'entités qu'il nomme "formes" ou "idées". Et que ces entités sont immuables.
L'ontologie de la période antique est ainsi caractérisé comme une période initiatrice. Les pensées développées sont certes, initiatrice, mais elles ont pu traverser deux millénaires sans perdre de leurs pertinences. Si l'on revient à notre objet de trouver un lien entre ontologie et architecture, on doit s'intéresser aux développements architecturaux de cette époque. L'architecture de la Grecque antique nous est connue soit dans sa considération théorique par le seul traité de Vitrue ou sinon par l'étude des édifices qui ont survécues jusqu'à nos jours. Du premier, on peut retirer entre autres l'idée que l'architecture est l'interaction parfaite entre trois qualités: l'utilité, la pérennité et la beauté. En général, on peut caractériser cette architecture par son emploi de canons, d'ordres (dorique, ionique, corinthien et cetera), de systèmes modulaires simple et facile à l'usage (pour la dimension et pour la proportion) basé sur le corps humain, de la rigoureuse symétrie et de règles de composition basé sur des conventions. José Ferrater Mora dans Philosophie et architecture, fait ce parallèle entre philosophie et architecture durant cette époque :
"(...) la philosophie grecque des formes telle qu'on la trouve chez Platon et Aristote, est en rapport étroit avec l'architecture - aux traits sculpturaux très prononcés - de l'époque classique. La tendence de ces philosophes à considérer les formes comme des modèles, à représenter les idées sous la forme concrète des images visuelles, à identifier le réel avec ce qui est parfait, ce qui parfait avec ce qui est complet, et ce qui est complet avec ce qui est limité, tout cela peut être comparé avec la propension des architectes grecs à produire des oeuvres d'art fermées sur elles-mêmes, qui étaient pourvues d'un espace propre et qui, par conséquent, avaient une place au lieu d'être simplement situées dans l'espace." 1
Il y a donc une certaine relation entre et l'ontologie et l'architecture durant l'antiquité. Mais les idées ontologiques développées dans un cadre spatio-temporel précis peuvent aussi traverser plusieurs époques et agir sur l'architecture. C'est une des idées que le philosophe Paul Guyer dans KantandthePhilosophyofArchitecture, met en évidence. En s'aidant des travaux du philosophe Christian Freiherr von Wolff, il trace des parallèles entre l'architecture du XVIIIe siècle et l'ontologie. Il met en

évidence que la philosophie de l'architecture au XVIIIème siècle se base sur un retravaille de l'ontologie antique qui revèles des concepts d'architecture antique :
" Wolff makes it clear that the intention of an architect is always to produce a structure that is both formally beautiful as well as useful and comfortable, so the perfection of the intention can only be realized through the perfection of both form and utility in the building itself." 1
Par sa propre démarche ontologique Wolff arrive donc à définir l'architecture par l'interaction des deux qualités Vitruviennes de beauté et d'utilité.
L'ONTOLOGIE AU MOYEN-ÂGE :
Au moyen-âge la question de l'être se voie être orientée vers la recherche du divin et devient une théologie. Cette tendance est d'ailleurs observable durant l'antiqué tardive. Les philosophes comme Plotin annoncent déjà l'orientation de l'ontologie vers la recherche de Dieu. En outre, on voit durant le moyen-âge le développement de la religion Chrétienne qui est à première vue incompatible avec la philosophie.
Anselme de Canterbury: (1033-1109)
Ce théologien est le premier à faire le lien entre la philosophie et la théologie par la voie de l'ontologie. Il est partisan de l'idée que la foi vient avant la raison, et que cette dernière vient renforcer la première. C'est ce que l'on nomme l'argument ontologique. De ceci l'être suprême est donc vue comme étant Dieu.
Thomas d'Aquin: (1225-1274)
De la même manière, ce théologien prend comme base les réflexions ontologiques d'Aristote et développe sa démarche pour arriver à prouver l'existence de Dieu. Il met en place cinq chemins pour y arriver : la voie par le mouvement, la cause efficiente, la contingence, les degrés des êtres et l’ordre du monde. Sa foi chrétienne évidemment lui incite à poser Dieu comme être suprême animateur du monde.
Durant le moyen-âge, l'ontologie est donc principalement pratiquée par la scolastique qui cherche à réduire l'écart entre cette dernière et la religion qui est prédominante. Ces deux derniers exemples de théologiens sont choisis pour la contribution qu'il on fait pour réunir la religion à la philosophie. Mais la lecture contemporaine, comme nous le verrons plus tard dans l'écrit, considérerons que la théologie en réalité s'occupe de la question de l'être, même si elle n'est pas considérée comme une ontologie à proprement parler. La question de l'être étant abordée par les théologiens, le rapprochement entre ontologie et architecture peut donc se faire en passant par la théologie. La principale architecture qui se développe durant cette époque est religieuse, donc symbolique et cherchant à exprimer les idéaux de la religion. Les deux grands styles sont le roman et le gothique. Comme nous avons vu dans la précédente partie José Ferrater Mora trace les parallèles entre architecture gothique et philosophie et donc à l'ontologie.
L'ONTOLOGIE À LA RENAISSANCE ET LES LUMIÈRES:
La Renaissance et les lumières sont les périodes les plus actives pour l'ontologie. Il est d'une difficulté importante de vouloir faire un résumé d'une époque qui a vu beaucoup de tournants. La relecture critique des écrits antiques sur l'ontologie sépare cette dernière de la théologie et est la redéfinit comme une science.
1(PAUL GUYER, Kant and the PhilosophyofArchitecture, 2015)René Descartes: (1596-1650)
"Je pense donc je suis", un terme très répondu dans la conscience contemporaine, qui s'agit en réalité d'une affirmation ontologique révolutionnaire. René Descartes cherche une méthode universelle pour arrivé à la vérité: le doute systématique (ou méthodique) qui consiste à questionner tous pour arriver à un fondement sans doute. Il écrit que c'est par l'enchaînement d'idées mises en mouvement par l'intuition et reliées par la raison que l'on arrive à une connaissance. Il considère que ce système, si bien exécuté peut expliquer toutes les choses dans le monde. C'est ce qu'il nomme la (mathesis universalis). Il pose comme preuve de l'existence de l'être (suprême, Dieu) : la causa sui qui est un rapport de cause à effet qui place l'être suprême comme sa propre cause. En outre, il développe sa compréhension cartésienne de l'espace: sa démonstration se base sur une compréhension du monde matériel réduit à un système de coordonnées à trois dimensions. Il instaure ainsi un model cohérent du monde pour pouvoir avancer les recherches scientifiques et il en découle qu'il soit abondamment utilisé dans les mathématiques.
Emanuel Kant: (1724-1804)
Est le philosophe qui se demande : de quel droit est-ce que j'affirme que tout phénomène dans le monde est ordonné par causalité ? Rien au-delà de l'objective ? Es-ce que la mathesis universalis peut expliquer tout ce qu'il peut être dit de l'être ? Il fait donc une distinction entre la métaphysique (le domaine du pensable) et la métaphysique dogmatique (sciences appliquées aux sujets tel que: l'être, le réel, Dieu et cetera) qui est contenue dans la dernière. Car il dit que toutes pensées n'est pas connaissance. Il juge donc la raison dogmatique qui affirme que l'on peut connaître les choses qui échapperaient à la raison, à savoir les notions : d'âme, de Dieu et cetera. Il affirme alors qu'il y a un au-delà de ce qui est connaissable par la raison. Qu'il y a une irréductibilité du sensible* à l'intellectuel (raison). Et en outre, on peut seulement porter un type de regard sur la métaphysique qui échappe au domaine du connaissable (science). Il propose alors sa méthode transcendantale. Qui ne cherchent pas de nouvelles connaissances, mais porte son regard sur les conditions de possibilités de notre connaissance - à savoir notre faculté de connaître - la raison elle-même.

On comprend donc par l'évolution de l'ontologie durant la renaissance et les lumières qu'il y a eu d'une part une tendance à se fier à une faculté spécifique qui est celle de la raison, une tendance à tenir une voie objectiviste pour pouvoir répondre à la question de l'être. On peut citer Liebniz et Spinoza à coté de Descartes. D'une autre que cette faculté connais aussi une remise en question (exemple de Kant). L'architecture durant ces périodes, de son côté, à suivie une évolution comme vue dans la dernière partie qui consiste à chercher un fondement plus rationnel. Allant du néo-classicisme avec les relectures vitruviennes, passant par les critiques de cette dernière qui aboutissent, un peu plus loin dans l'histoire, au modernisme. Paul Guyer dans son article cité plus haut, décrit comment la philosophie kantienne, plus précisément ses écrits sur l'esthétique, contribuent à un tournant dans l'histoire de l'architecture. Un passage d'une architecture qui se base sur les principes vitruviennes (ou l'architecture grecque antique en général), vers une architecture qu'il qualifie de "cognitivist or expressivist " - cognitiviste ou expressiviste qui relève donc de la raison. Il trace d'une part un parallèle entre la philosophie esthétique de Kant et l'architecture :
" Thus, Kant concludes that, in architecture, utility, or in his own terminology "objective purposivness," is always essential, but that the presentation of aesthetic ideas is also always some part of its beauty. Aesthetic ideas are in turn the expression of "rational" ideas, so Kant's position might seem to prepare the way for something closest to Hegel's position, that architecture, like other arts, always aims at the expression of metaphysical ideas (...)" 1
Guyer nous met en lumière que la philosophie de l'esthétique kantienne incite à une architecture qui exprime des idées rationelles. D'une autre, il met en évidence que cette tendance est observable dans les époques qui suivent. Il prend comme exemple la philosophie de l'esthétique de Schopenhauer et montre comment elle est basée sur l'importance de la raison :
"In other words, the conclusion that Schopenhauer draws from his complicated metaphysical end ethical argument is that works of architecture should express not their own function, but rather the nature of their own construction and the physical forces involved in and affecting that construction; by his own idiosyncratic route he reaches a conclusion that we associate with Eugène-Emmanuel Viollet-le-Duc and John Ruskin later in the nineteeth century and with classical modernists of mid-twentieth century, such as Walter Gropius and Ludwig Mies van der Rohe." 2
Schopenhauer en se basant sur sa propre démarche ontologique affirme que l'architecture doit servir d'expression d'un être détaché de toutes expériences sensibles et doit se manifester comme purement objective. Il associe cette objectivité à réalité physique du monde donc à la réalité structurelle dans l'architecture.
Cette primauté de la raison dans la question de l'être a eu d'autres échos sur l'évolution générale de la société en contribuant dans de nombreux domaines. C'est elle qui anime la notion de progrès et c'est elle qui est à la source du développement de la technique et ainsi de l'industrialisation. Néanmoins même si cette vision de l'être alignée à sa rationalité est d'actualité dans la conscience commune depuis et après la Renaissance, dans la sphère plus restreinte des philosophes la réponse de la question de l'être n'est toujours pas satisfaisante. Il y a eu plusieurs tentatives de trouver une réponse depuis et après les Lumières, mais vers la fin du XXe siècle il y a eu une stagnation.
* Phénomènes : Fait naturel constaté, susceptible d'étude scientifique, et pouvant devenir un sujet d'expérience Le Robert (s.d.)
Si au début du XXe siècle l'espoir de pouvoir développé une ontologie s'annonce être perdu, il y a eu à l'époque contemporaine une régénération.
Martin Heidegger
Parmi les philosophes de cette époque qui se penchent sur cette question, Martin Heidegger inspiré par les avancements fait par Edmund Husserl sur la phénoménologie, propose sa nouvelle façon d'aborder la question de l'être. La phénoménologie est le terme qui qualifie la démarche utilisée par Edmund Husserl dans sa tentative de faire de la philosophie une science empirique. Elle se base sur l'idée que le monde peut être compris par ses phénomènes*. Les phénomènes étant les représentations que l'on se fait d'un monde essentiel qui est caché par ces derniers et que l'on cherche à dévoiler. Ce dévoilement se fait chez Edmund Husserl par une "réduction phénoménologique", c'est-à-dire une extinction par raisonnement des représentations (phénomènes) qui couvrent le monde et font une distorsion de l'essentiel. Avec Husserl on cherche donc à aller directement à l'essence en faisant cette "réduction phénoménologique", tandis qu'avec Martin Heidegger la démarche phénoménologique est elle-même mise en valeur et s'insère dans la compréhension de l'être dans l'étendue de sa mesure.
* Ontique : Qui concerne l’étant, par opposition à Ontologique, qui se rapporte à l’être en soi. Dictionnaire de l'academie française (s.d.)
Il y va donc que Martin Heidegger, commence par démontrer que l'histoire de l'ontologie "ne s'est, en réalité jamais intéressé à l'être, c'est-à-dire à ce qui permet à tous les étants* d'apparaître en ce qu'ils sont.1" mais qu'elle, c'est intéressé seulement à l'étant en tant qu'étant. La tradition philosophique soit cherché un étant suprême (Dieu, être suprême et cetera comme chez les théologiens du moyen-âge) donc faisait une théologie ou cherchais un étant universel (le transcendantal comme chez Kant) faisait donc une fausse-ontologie, mais ne cherchait jamais l'être en soit. Il qualifie cette fausse-ontologie de "ontique*".
Ainsi, il propose une nouvelle démarche. Certes, on veut arriver à l'être telle quelle, mais on est obligé de le faire via un étant. Ainsi, on doit choisir le bon étant pour le faire, à savoir l'être humain. L'être humain, est selon lui, le seul étant qui se préoccupe de la question de l'être. Martin Heidegger utilise le terme de Dasein pour qualifier l'être humain. L'étymologie du mot Dasein est la combinaison de deux mots allemands : Da qui signifie "là" et sein qui signifie "être". On traduirait donc littéralement Dasein en "être-là". En cela, il nous montre la première chose que l'on doit comprendre de cet étant. Cet étant est dans une constante interaction avec l'être telle quelle. Et c'est l'analyse de cette interaction qui va nous permettre d'arriver à l'être telle quelle. Il donne au Dasein plusieurs modes d'existences comme : l'étant à portée de main, l'étant sous la main et cetera. Après une œuvre colossale dans l'histoire de l'ontologie, interrogeant le Dasein : Être et temps , il ne parvient néanmoins pas à résoudre la question de l'être. Il introduit donc sa conception du monde qu'il nomme le Quadriparti :
" La terre et le ciel, les divins et les mortels se tiennent, unis d'eux-mêmes les uns aux autres, à partir de la simplicité du Quadriparti uni. Chacun des quatre reflète à sa manière l'être des autres (...). Ce jeu qui fait paraître, le jeu de miroir de la simplicité de la terre et du ciel, des divins et des mortels, nous le nommons 'le monde' " 2
En outre, il suit cette même démarche d'interrogation d'un étant spécifique pour pouvoir atteindre l'être telle quelle quand il met en question l'être de l'habitation dans son essai Bâtir,habiter,penser (1951). Un livre de grand intérêt pour les architectes.
Cornelius Castoriadis:
Une deuxième vision intéressante se développe par Cornelius Castoradis. Il propose une représentation dichotomique du monde qu'il nomme (Chaos/Cosmos) ou (Création/Déterminisme) des étants. Ce philosophe nous indique qu'il y a un revers chaotique à toutes choses, ainsi à l'être. On entend par cette dimension chaotique, d'une part une force destructive, mais d'une autre une possibilité d'existence caractérisée par une force créative. C'est cet envers chaotique qui permet toutes déterminisme futur. Ainsi, il indique que l'être n'est pas systématisable, compréhensible, ordonnable et cetera dans la totalité de sa mesure. La dimension qui relève du cosmos est d'une part force créative et d'une autre force constrictive. C'est cet envers qui relève du cosmos qui permet la concrétisation de la possibilité d'existence produite par le chaos. Il complète davantage sa vision avec une nouvelle dichotomie qu'il intitule (ensidique/ magmatique). La notion de magma relève de "ce dont on peut extraire" ou "ce dans quoi on peut construire". C'est-à-dire l'élément inhérent à toutes choses, ainsi l'être dont on peut faire surgir de nouvelles organisations ensidiques.
On comprend par ces deux derniers philosophes qu'il y a eus un détachement de la conception de l'être telle qu'elle est comprise généralement depuis et après la renaissance, comme seulement atteignable par la raison et l'objectivité. Heidegger dans son développement complexe utilise l'herméneutique pour pouvoir atteindre l'être telle quelle. Il prend plusieurs chemins, entre autres le Dasein. Castoradis lui aborde une conception dichotomique du monde, il tient donc une vision subjective. Ces nouvelles approches à l'ontologie sont contemporaines donc il y a une difficulté de mettre en évidence leurs influences, tout du moins les réflexions de Martin Heidegger sont explicitement utilisées par l'architecte Peter Zumpthor dans sa conception des thermes de Vals.



(2Ibid)
Maintenant, que l'on a peint l'image générale de la tendance de l'ontologie et que l'on a compris qu'elle est derrière les développements architecturaux, il s'agit de voir les conséquences quelles a eu durant le mouvement moderne. Nous avons constaté que depuis la renaissance la conception de l'être a mutée pour s'aligner sur la faculté de la raison. De la même manière qu'on a vu dans la première partie, que l'architecture, se détachant des canons vitruviennes, cherche un fondement théorique de plus en plus rationnel depuis cette même période et à son apogée elle à aboutie à l'architecture du modernisme. Il serait donc cohérent de penser que les développements sur la question de l'être entreprit durant les Lumières, celle d'Emanuel Kant ou de René Descartes, ont eu un effet cumulatif au fils du temps pour se traduit dans le mouvement moderne. On peut prendre un exemple précis d'un architecte qui incarne l'esprit même de ce dernier mouvement pour illustrer le propos. Le Corbusier incarnait des principes qui s'alignent avec les pensées rationalistes des Lumières. Après avoir illustré comment les pensées de Le Corbusier, même si ce dernier ne se prétend pas être philosophe, peuvent être analysé pour leurs signifiances philosophique, Mickaël Labbé dans son introduction de son livre La Philosophie Architecturale de Le Corbusier nous explicite l'importante présence de la norme chez cet architecte. La norme chez le Corbusier "ce qui la singularise serait une recherche constante et explicite de normativité (...) selon son terme même, une « doctrine »"1 il y va plus loin est dit qu' "Une telle « doctrine » devra ainsi être fondée sur un « faisceau de concepts » normatifs systématiquement ordonnés de telle sorte à « découler » les uns des autres selon des règles rationnelles d’engendrement de principes à conséquences et sans contradiction interne 2". Ce "faisceau de concepts" sans contradiction interne pourrait rappeler ce que René Descartes cherchait, quand il essaye de construire ça (mathesis universalis).
Or comme vue chez Emanuel Kant cette idée de vouloir expliquer tous par la rationalité n'est pas atteignable, lorsque il s'agit des choses qui dépassent le monde sensible. Et l'architecture n'étant pas une discipline qui traite seulement du monde sensible (car elle prend en compte l'esthétique, le sociale, la symbolique et cetera) vouloir la définir par une normalisation, par la création d'un système fonctionnel et refermé saurait réduire son potentiel. Tout du moins, on reste confronté à cette question : la rationalité, n'est elle pas une bonne chose ? C'est ce que l'on cherche à répondre dans la prochaine partie.
Une tendance évidente est observable dans l'histoire de l'architecture. Celle de la nouvelle génération qui critique celle qui la précède pour pouvoir arriver à une connaissance plus juste de cet art. Depuis la Renaissance, un avant-gardisme incessant est présent dans l'histoire. Les modernes qui critiquent le canon Vitruvien, les post-modernes qui critiquent la rigidité rationnelle de ces derniers. Comme on l'a vue dans les parties précédentes, ces critiques architecturales peuvent se réduire à leurs composantes théoriques architecturales et s'interpréter encore pour être réduit à leurs composantes philosophiques et plus précisément ontologiques. On pourrait ainsi se demander : si cette tendance s'agit réellement d'une manifestation d'un fonctionnement inhérent de la nature humaine ? Tournant notre attention une fois de plus à la philosophie qui peut nous apporter des éléments de réponse.
LA DIALECTIQUE : L'ELENCHOS DE SOCRATES ET LA MAÏEUTIQUE DE PLATON:
L'elenchos ou "réfutation" ou "ironie socratique" consiste d'une méthode d'argumentation qui se base sur la mise en question de l'interlocuteur pour lui démontrer qu'il se contredit. Cette méthode permet de "purifier" la personne mise en question de toute fausses connaissances. Permettant ainsi l'avancement de la connaissance vers une vérité. Pourtant, elle ne permet seulement de montrer que l'interlocuteur a tort et ne vient pas à la recherche d'une nouvelle réponse. L'évolution de cette méthode nous mène à la maïeutique de Platon. Cette dernière est une réinterprétation davantage positive de la méthode de Socrates. Aussi connu comme "l'art d'accoucher l'esprit", elle fait un retournement de point de vue sur cette méthode. Au lieu de seulement la voir comme une manière de démontrer que l'interlocuteur a tort, elle est vue comme moyen de faire apparaître la vérité de l'esprit même de ce dernier. Cette méthode ne se réduirais donc pas seulement à la réfutation, mais elle est élever à sa nature positive et productrice de nouvelles pensées. Certes, cette méthode de nos jours, peut-être pas connu par la personne lambda, à sa dimension philosophique, est néanmoins utilisée quotidiennement et dans toutes les domaines d'études scientifiques entreprit. C'est le principe de (thèse, anti-thèse, synthèse, etc...).
Ainsi, si on aborde l'architecture par cette perspective, on peut généraliser et comprendre son histoire comme un long dialogue architecturale qui se fait au cours du temps. Les interlocuteurs qui cherchent alors à se purifier de tout faux discours pour arriver à la vérité. Ce constat n'est pas surprenant. Néanmoins, si on analyse de plus près, elle nous révèle de plusieurs réalités importantes. Premièrement, elle nous révèle de cet état de confrontation constante à l'inconnu. Qui se caractérise par l'être humain qui, cherchant à étendre sa connaissance, tends vers la vérité sans jamais pour autant l'atteindre. On pourrait supposer que l'on a trouvé la réponse, mais elle reste une hypothèse car elle peut-être à tout moment réfutée. Et deuxièmement, que cet état de confrontation relève en réalité d'un état paradoxal.
(Bruno Bérard, Conférence philosophique:qu'est-ce qu'unparadoxe?)
L'étude de cet état de paradoxe en elle-même pourrait éventuellement nous éclairer la vue sur la contradiction que l'on rencontre. L'étymologie de ce terme remonte au Grec "paradoxos", « παράδοξος » : « contraire à l'opinion commune », de para : « contre », et doxa : « opinion ») en cela, nous comprenons un premier degré de sa signification. Les paradoxes, étymologiquement, sont une réfutation des vérités communément admises. Bruno Berard, philosophe contemporain qui a fait ses recherches sur cette notion de paradoxe nous explicite davantage les caractéristiques. Il nous affirme que le paradoxe consiste en une limite aux savoirs :
(...)leschosesetlesavoirsurleschoses,s'arrêtentauxparadoxes.Lalimite dessavoirshumainn'estpasnouvelle.Onpeutrappelerqueunepreuveest unecroyance!C'estmoinsconnu.C'estmêmeunedoublecroyance.C'est la croyance subjective que le dispositif de la preuve est efficace, suivie de la reconnaissance intersubjectif du bienfondé des procédés de la preuve. Et ça c'est la distance irréductible qu'il y a entre le monde des mots et le mondedeschoses.C'estçaquifaitleparadoxe.Parailleurs,leslimitesde la connaissance scientifique sont désormais bien établies, ce n'était pas le cas au XIX éme siècle avec le scientisme florissant, mais aujourd'hui on distingue même en physique comme en mathématique, Hervé Zwirn la biensignalé,(...)enmathématiquecommeenphysique,onnoteleslimites constructives,leslimitesprédictives,leslimitesontologiques,etleslimites cognitives.Danslarecherchedelaconnaissanceilyalesfortsparadoxes delavéritéetdelaréalité,ouencoredel'objectivitéetdelasubjectivité(...)
Si les paradoxes sont les limites aux savoirs, reste à savoir alors comment on pourrait atteindre une réponse.
On peut s'intéresser à la notion de dichotomie pour nous éclairer davantage la vue. L'étymologie remonte au Grec "dikhotomia", « division en deux parties égales ». Dans le domaine de la logique c'est une méthode d'analyse qui consiste à diviser un concept en deux concepts contraires qui recouvrent toute l'extension. Bruno Bérard va plus loin dans son analyse est commente :
(...) distinguez raisons et intelligence, (...) tel que la tradition philosophique la fait de tout temps. La raison "ratio" en latin, "dianoia" en grecque, c'est la pensée discursive ou hypothético-déductive. Chez Platon, c'est le premier degré seulement de la connaissance des intelligibles. Les sciences dianoétiques sont définit positivement par le refus du recours aux sens et négativement par l'incapacité de dépasser les hypothèses pour remonter au principes ultimes. C'est pratiquement la même chose chez Aristote, la "dianoia" atteint discursivement son objet et la "noésis" le possède immédiatement par intuition. Cette intuition, c'est la fonction de l'intéligence ou de l'intellect. Le latin "inntelligentia" ou "intellegentia" de "intellegere" - comprendre - indique, un recueillir entre, comme un lire entre les lignes. Chez Platon, c'est le nous, amène de contempler les essences des choses. Ainsi on dispose de deux instances ou de deux facultés, la raison qui combine, qui arrange, qui raisonne, qui calcule. D'ailleurs un livre de raison, c'était un livre de contes. Et l'intellect, par ailleurs, qui comprend. L'une réfléchit, l'autre saisit. De la on oppose une connaissance conceptuelle et discursive à une connaissance immédiate intuitive.
(Bruno Bérard, Conférence philosophique:qu'est-ce qu'unparadoxe?)
Selon Bruno Bernard, il existe alors deux facultés humaines dont: la raison"dianoia" et l'intéligence - "noésis". Il en fait de cette réalisation un élément de réponse pour proposer à la paradoxalité des choses, une modalité paradoxale du connaître et invite l'intéligence - "noésis" ou l'intuition à prendre le dessus pour accéder aux "principes ultimes". Il y a alors là une voie pour la réponse. Laisser l'intuition faire.
Les paragraphes qui suivent sont mes réflexions personnelles face à une difficulté d'avancer que j'ai eu dans mon développement. Une impasse s'est présenté devant moi donc je partage ma propre réflexion.
Ce n'est pas seulement par l'analyse objective, dont notre faculté de raisonner nous permet, que l'on arrive à combler l'incertitude à laquelle le monde nous confronte et que l'on veut à tout prix éviter. Si le miracle de la science à bien était vécu depuis la Renaissance, il me semble que la recherche de la science du miracle demeure d'une difficulté aporétique. Certes, la posture de rationalité nous a servies à venir en réponse à des questions d'ordre pragmatiques et nous a servies de pierres d'appui pour la notion de progrès qui nous animait depuis. Mais nous nous situons aujourd'hui dans une époque ou un tournant essentiel d'attitude doit être fait.
Comme vue auparavant, dans le commentaire de Bruno Bérard, nous devons faire cette dichotomie essentielle entre la dianoia et le noésis et devons, comprendre leur complémentarité et davantage renforcer la deuxième qui est en manque. Car l'être n'est pas dogmatisable. Tout essai de rationaliser son essence tombera dans le cercle vicieux corrélationiste du dogme. Si j'annonce cette lutte absurde contre la raison, ce n'est en aucun cas pour annuler sa validité, mais seulement pour dévoiler et avertir de sa face cachée. On doit se rendre compte de cette possibilité piégeante et prendre des mesures actives pour remettre en question notre propre raisonnement. Car comme vue auparavant une attitude de construction dirigée seulement par la raison peut devenir constriction à notre intuition qui cherche à nous dévoiler un nouveau chemin.
Quant à la question de l'être en soi, je suis venu à cette conclusion ouverte à être critiquée. La recherche du fondement premier commence par un étonnement initial: qu'est-ce que l'être tel quel ? Cette recherche qui est dite "la science primaire", s'arrête, j'en suis convaincu, à son questionnement initial. Il me semble que l' "être" en tant qu'étant (humain) à sa pure essence n'est rien d'autre qu'un miracle. Un miracle parmi une infinité, qui par son caractère, même le distinguant des autres, sa rationalité, questionne son essence miraculeuse. Si le mot miracle, que l'on évite à tout prix de nos jours, est utilisé ici, ce n'est pas pour faire référence à un mysticisme antan ou guidée par une intention d'obscurantisme. Loin de là, l'étymologie du mot remonte au latin miraculum qui signifie une chose étonnante, qui est un dérivé de mirus rattaché, selon Julius Pokorny à l'indo-européen (s)mei- ("rire"). Et la signification des choses se cachant derrière le langage, c'est pour inciter à tenir une attitude, quant à la question de l'être, d'étonnement jovial. Cette attitude permet à l'être en tant qu'étant (humain) de se détacher de sa faculté de raisonner et de laisser son intuition prendre le dessus quand il est confronté à cette difficulté.
Avec chaque essai de définir l'être, on diverge de son essence premier. Mais ses quelques métaphores ci-dessous pourraient transcrire à quel degré je m'en suis personnellement rapproché :
L'être est la confluence entre une infinité de rivières de pensées.
C'est d'où émanent tous les systèmes de pensées.
C'est vers où ils convergent.
C'est le point nodal d'où l'on peut construire.
C'est vers ce même point nodal où l'on déconstruit.
C'est la vague des pensées en non les pensées en elles-mêmes.
Cette métaphore est une illustration d'un mouvement qui est présent dans l'être. Ce mouvement est une dance entre la raison qui concrétise et l'intuition qui dirige.
SYNÉRGIE DE LA DICHOTOMIE :
À l'image de la vision dichotomique Chaos/Cosmos de Cornelius Castoriadis je propose alors une méthode d'action que je nomme : synergie de la dichotomie. Cela consiste à un vas et viens entre les deux facultés citées auparavant : dianoia/noésis. Quand la raison est confrontée à un paradoxe infranchissable, l'intuition prend le relais et quand l'intuition se perd, la raison redirige. C'est un jeu sans fin.
3 - Qu'es ce que cela incite en architecture
Certes, toutes ces réflexions ontologiques sont intéressantes, mais il faut revenir à la réalité pragmatique et s'occuper de la pratique architecturale. Ces considérations ontologiques se traduiraient en architecture par une prise de conscience de l'importance de la nature à première vue "hazardeuse" du terrain auquel l'architecte est confronté. Les informations que l'architecte doit prendre en compte sont de nature variée d'une part, mais d'autre part elles peuvent être contradictoire. L'architecte est donc confronté à des prise de décision subjective qui se traduient à un fort travail de synthèse. Dans l'histoire de l'architecture, quand on est confronté au terrain, il y a eu une forte dépendance sur la création d'un modèle théorique "parfait" à appliquer sur ceci. Certes, une planification et la création d'un programme spécifique sont importantes pour le succès d'un projet, mais quand cette planification et ce programme deviennent rigide ils ne prennent plus en comptes la réalité du terrain. Les réflexions ontologiques de Martin Heidegger, et le travail de Christian Norberg-Schulz, qui révèlent l'importance du Genuis Loci peuvent être la nouvelle approche intéressante. Justement parce qu'avec l'ontologie de Martin Heidegger on peut faire phénomenologiquement varier l'architecture. C'est-à-dire donner plusieurs interprétations. Multiplier les dimensions. L'architecture ne s'agirait pas seulement d'une exploration de fonctions et de formes détachée de son environnement, mais intégrerait aussi d'autres aspects intriquement liées au site. Comme quoi l'architecture suit le site. Prendre en compte ses valeurs, sociales, symbolique, esthétique, historique, environnementale et cetera. Et faire de la phénoménologie relève d'une importance mit sur la subjectivité des choses. D'une manière intéressante, ceci va en parallèle avec les nouvelles pratiques qui sont mises en évolution depuis la fin du siècle dernier. De nouvelles pratiques de co-production (avec les habitants) et d'auto construction sont en développement. Les sciences-sociales qui relève d'une analyse subjective, gagnent de plus en plus d'importance dans l'apport qu'ils peuvent avoir dans le processus d'élaboration du projet architectural.
Personnellement, il me semble que les propositions de Martin Heidegger sont justement que le début de ce détachement qui se fait de la raison comme faculté suprême. Chaque projet à besoin d'une préoccupation objectif comme subjectif, d'un va-et-vient entre la dianoia et noésis. Chaque projet est un mouvement architectural qui relève de la particularité du site, autant dans sa dimension sensible qu'essentiel.


Dans la recherche d'une définition de l'architecture par la voie de l'ontologie, la question de l'être, étant une question aporétique demandée pendant des millénaires, la réponse se trouve dubitative. Néanmoins, les parallèles tracés entre ontologie et architecture, nous apprennent de leurs relations étroites. On voit que l'histoire de la philosophie s'est dirigée implicitement vers la faculté de la raison. De plus, on apprend que l'architecture étant influencée par ces développements elle aussi s'est dirigé vers une rationalisation. Le modernisme étant l'expression ultime de ces influences. Néanmoins, on s'aperçoit qu'en définissant l'architecture seulement par un programme fonctionnel, ordonné, qui s'inscrit dans l'application de produits industriels et cetera, on réduit son pouvoir. La bonne approche serait donc de requestionner les fondements ontologiques que l'on utilise quand on travaille un projet. L'ontologie Heideggerienne propose ce nouveau fondement. Un fondement qui prend en compte la subjectivité des choses. Il serait d'une part intéressant d'approfondir les lectures ontologiques, mais encore voir comment ces derniers pourraient être appliqués sur le processus d'élaboration du projet architectural. Par exemple, il serait intéressant de voir comment ce type d'analyse pourrait alimenter le développement des nouvelles pratiques architecturales citées plus haut. On peut aussi rajouter les processus d'élaboration de projets comme : l "advocacy planning" à la manière de Paul Davidoff et Linda Stone Davidoff ou la "permanence architecturale" de Patrick Bouchain et Loïc Julienne. Un autre développement intéressant de la fin du siècle dernier est les collectifs d’architectes qui certes, cherchent à expérimenter la co-production de l’architecture, mais s'orientent aussi vers la multiplication des professionnelles qui travaillent sur le projet. Ces démarches de projet similaire abordent toute une vision de l'architecte qui est moins autoritaire et plus inclusif, prenant en compte une multitude de paramètres avant la formulation d'un programme. Il serait aussi intéressant d'appliquer ce type d'analyse ontologique sur l'idée de l'architecture incrémentale à la manière de Yona Friedman où l'utilisateur est donné l'opportunité de construire et s'approprier à sa guise.
Je m'aligne par contre avec l'idée presque délirante que l'architecture peut fortement agir sur le monde intensément crû durant le modernisme. Je place l'architecture à la hauteur de la politique, des acteurs de l'économie, la technologie faisant sa remontée de nos jours, et cetera qui sont des principaux disciplines animateurs de notre monde actuel. Mais tandis que ces disciplines s'occupent, avec bonnes raisons d'ailleurs, d'affaires mondaines, l'architecture tient en elle le potentiel de s'intéresser à la philosophie et aux pensées qui en dégagent pour dresser un lien inhérent avec la nature propre de l'Homme.
Dans cet esprit je choisit donc pour mon parcours de Master le domaine d'étude 2 intitulé - Architecture, Processus et Partage qui traite en général des thèmes de Terrae incognitae (terre inconnue), le projet comme processus, le projet comme un manifeste, la dimension expérimentale, la confrontation au réel, la dimension locale, l'élargissement du rôle de l'architecture et cetera qui sont des thèmes qui m'intéressent dans l'idée qu'ils cherchent à trouver une nouvelle manière d'envisager le projet tout en étant ancrée dans la réalité du terrain.
Merci pour la lecture.
(Cazenove



PAUL GUYER, Kant and the Philosophy of Architecture, 2011


Iconographie:
- Pietro Fabris, Pompéi - dégagement du Temple d'Isis au xviiie siècle
URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Pietro_Fabris_-_Ausgrabung_des_Isis-Tempels_in_Pompeji.jpg
- Armand Kohl, 1845 - 1900
URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Armand_Kohl48.jpg
- Le Pavillon de la station Bastille, Cliché Charles Maidron, 1902
URL : https://www.lecercleguimard.fr/fr/wp-content/uploads/2012/11/guimard-le-metro-1.jpg
- Le Pavillon allemand de Mies van der Rohe à l'exposition de Barcelone, 1929
URL : https://www.worldfairs.info/forum/viewtopic.php?t=276-le-pavillon-allemand-de-mies-van-der-rohe-a-l-exposition-de-barcelone-1929
- Peter Cook ,The Plug-In City, Archigram, 1962-1964
URL : http://archigram.net/portfolio.html
- De architectura libri decem de Marcus Vitruvius Pollio, édité par Fra Giovanni Giocondo, 1511
URL : https://www.meisterdrucke.fr/fine-art-prints/Venetian-School/888458/Architecture-dizaines-de-Marcus-Vitruvius,-%C3%A9dit%C3%A9-par-Fra-Giovanni-Giocondo,-1511.html
- Raphaël, l'école d'athènes, fresque ,1508-1512
URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/L%27%C3%89cole_d%27Ath%C3%A8nes#/media/Fichier:%22The_School_of_ Athens%22_by_Raffaello_Sanzio_da_Urbino.jpg
- Illustration du Discours de la méthode pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences de René Descartes (1637) [Bibliothèque nationale de France, PariS
URL : https://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Ren%C3%A9_Descartes_Discours_de_la_m%C3%A9thode/1312542
- Portrait de Martin Heidegger
URL : https://www.anaminecan.com/post/filosofia-martin-heidegger
- Martin Heidegger, Étre et temps, Gallimard, 1990
URL : https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%8Atre_et_Temps
- Le Corbusier, La Villa Savoye, “machine à habiter”, 1928 - 1931
URL : https://www.harvarddesignmagazine.org/issues/15/savoye-space
- Alvar Aalto, Maison Mairea, 1938-1939
URL : https://www.alvaraalto.fi/en/architecture/villa-mairea/
- Peter Zumthor, Thermes de Vals, 2009
URL : https://www.flickr.com/photos/brunovanbesien/49187608041
-Manifeste de la permanence architecturale, 16 octobre 2015
URL : https://lapreuvepar7.fr/project/la-permanence-architecturale-hyperville/
- Cazenove Architectes & Associés, Processus de co-production, 2018
URL : https://www.cazenove-architectes.com/actualite-et-presse/juin-2018-la-conception-participative
- Yona Friedman, La Ville spatiale, s.d
URL : https://www.en-attendant-nadeau.fr/2020/12/16/faire-ville-friedman/
Bibliographie:
Livres:
- ALVARO SIZA, "Imaginer l'évidence", Marseille, Parenthèses (2019), 158.
- ANNIE FOURCAUT, "La banlieue en morceaux. La crise des lotissements défectueux en France dans l'entre-deux-guerres", Grâne, Créaphis, 2000, 339 p.
- BERND, EVERS, "Théorie de l'architecture : de la Renaissance à nos jours, Allemagne", Taschen (2011), 852 p.
- CÉLINE BONICCO-DONATO, "Heidegger et la question de l’habiter. Une philosophie de l’architecture", Marseille, Parenthèses (2019), 206 p.
- COLLINS, PETER, "L'architecture moderne : principes et mutations", 1750-1950, Marseille, Parenthèses (2009), 488 p.
- KENNETH FRAMPTON, L’architecture moderne. Une histoire critique, Paris, Thames & Hudson (2006), 400 p.
- LEONARDO, BENEVOLO, "Histoire de l'architecture moderne" : 1 : La révolution industrielle, Paris, Dunod-Bordas (1998), 281 p.
- LUDGER SCHWARTE, "Philosophie de l'architecture", Paris, Éditions La Découverte (2019), 528p.
- MARIANNE BRAUSCH ET MARC EMERY, "L'Architecture en questions. 15 entretiens avec des architectes", Moniteur (1996), 249 p.
- MICKAËL LABBÉ, " L a philosophie architecturale de Le Corbusier", Rennes, Presses universitaires de Rennes, (2021), 328 P.
- PAUL VIRILIO, "Le Futurisme de l'instant", Paris, Editions Galillé (2009), 98 p.
- SBRIGLIO, JACQUES, "L'unité d'habitation de Marseille" : Le Corbusier, Marseille, Éditions Parenthèses (2013), 186 p.
Articles:
- DIHLE, ALBRECHT, Science et philosophie à l'époque hellénistique, Comptes rendus des séances de l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 131e Année, No. 4 (1987), pp. 655-666.
- JOSÉ FERRATER MORA, Philosophie et architecture, Revue de Métaphysique et de Morale, 60e Année, No. 3 (Juillet-Septembre 1955), pp. 251-263 (13 pages)
- PAUL GUYER, "Kant and the Philosophy of Architecture", The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Vol. 69, No. 1, SPECIAL ISSUE: The Aesthetics of Architecture: Philosophical Investigations into the Art of Building (WINTER 2011), pp. 7-19
Sites internet:
- BRUNO BÉRARD, "Conférence philosophique : qu'est-ce qu'un paradoxe ?", URL : https://www.youtube.com/watch?v=uXmUlxKoFoY
L'ontologie. Une notion si éloignée de l'architecture ?

Où peut-on arriver à expliciter les fonctionnements internes de l'art de bâtir avec cette dernière ? En se basant sur une lecture chronologique d'un mouvement qui a fait sa marque dans l'histoire de l'architecture : le modernisme, c'est à la question de l'être que l'on tente de répondre. Les parallèles relevés entre ces deux disciplines, a premier abord, distinct, nous apprennent de leurs liens étroits. Alors s'il n'est pas possible de répondre à la question éternelle de l'être, elle offre néanmoins une matière de réflexion profonde à tout architecte.
Mots Clefs:
Ontologie - Mouvement ModernePhilosophie - Théorie de l'architecture
45 p.