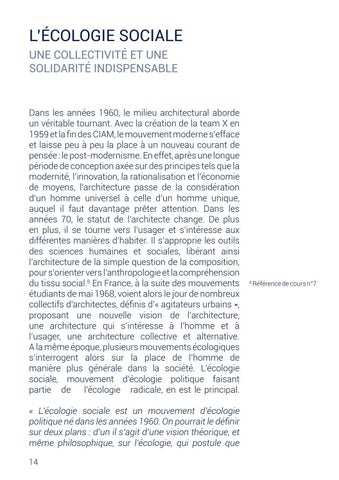L’ÉCOLOGIE SOCIALE UNE COLLECTIVITÉ ET UNE SOLIDARITÉ INDISPENSABLE
Dans les années 1960, le milieu architectural aborde un véritable tournant. Avec la création de la team X en 1959 et la fin des CIAM, le mouvement moderne s’efface et laisse peu à peu la place à un nouveau courant de pensée : le post-modernisme. En effet, après une longue période de conception axée sur des principes tels que la modernité, l’innovation, la rationalisation et l’économie de moyens, l’architecture passe de la considération d’un homme universel à celle d’un homme unique, auquel il faut davantage prêter attention. Dans les années 70, le statut de l’architecte change. De plus en plus, il se tourne vers l’usager et s’intéresse aux différentes manières d’habiter. Il s’approprie les outils des sciences humaines et sociales, libérant ainsi l’architecture de la simple question de la composition, pour s’orienter vers l’anthropologie et la compréhension du tissu social.8 En France, à la suite des mouvements étudiants de mai 1968, voient alors le jour de nombreux collectifs d’architectes, définis d’« agitateurs urbains », proposant une nouvelle vision de l’architecture, une architecture qui s’intéresse à l’homme et à l’usager, une architecture collective et alternative. A la même époque, plusieurs mouvements écologiques s’interrogent alors sur la place de l’homme de manière plus générale dans la société. L’écologie sociale, mouvement d’écologie politique faisant partie de l’écologie radicale, en est le principal. « L’écologie sociale est un mouvement d’écologie politique né dans les années 1960. On pourrait le définir sur deux plans : d’un il s’agit d’une vision théorique, et même philosophique, sur l’écologie, qui postule que 14
8
Référence de cours n°7