
9 minute read
VERS UNE ARCHITECTURE DURABLE (p
L’ÉCOLOGIE ENVIRONNEMENTALE
VERS UNE ARCHITECTURE DURABLE
Advertisement
« 3 degrés de plus dans 100 ans : disparition de l’espèce humaine de la surface du globe ». Voici l’une des premières phrases qui a résonné à mes oreilles le jour de la rentrée en première année de licence en architecture. Encore innocents face au monde de l’architecture, l’idée était de nous introduire cette aventure de manière dramatique afin de nous faire réagir. La présentation de Pascal Rollet le premier jour de la semaine intensive constitue ainsi un instant très fort de ma réflexion. Il présentait les enjeux du changement climatique de manière grave et urgente et plaçait l’architecte comme véritable acteur d’une alternative. Il démontrait que si nous n’agissions pas, si nous ne repensions pas notre manière de consommer et de produire, nous ne compromettions pas simplement notre existence, mais surtout celles des générations futures. Face à la crise environnementale que nous connaissons aujourd’hui, l’architecture se doit d’être responsable et respectueuse, dans le but de préserver son environnement. C’est alors que le mot « durable » a pris un nouveau sens pour moi. Qu’est ce qu’une architecture durable ? Comment penser une architecture qui consomme peu et qui respecte son environnement ? En quoi s’inscrit-elle dans un besoin plus global de reconsidération de nos modes de vies et de nos priorités, dans l’optique d’un monde plus viable, vers un retour à une sobriété essentielle de l’existence ?
Le développement de ma pensée sur la question d’une architecture responsable et durable est largement inspirée de celle de Pierre Rabhi développée notamment dans son dernier ouvrage « Vers la sobriété heureuse », paru en 20103. Dans cet ouvrage, Pierre Rabhi met en
3 RABHI Pierre, 2010, Vers la sobriété heureuse, Pierre Rahbi, éd. Babel essai
4 LAURENT Anna, Zero Waste France, « Le BTP, secteur champion d’Europe de la production de déchets », franceinfo.fr exergue les problèmes sociétaux actuels et leur origine, dans le but de démontrer l’absurdité du fonctionnement du monde aujourd’hui. Il y dénonce les conséquences néfastes de la société de consommation, du système capitaliste où l’argent et la rentabilité sont la base de tout, des inégalités, de la volonté utopique de croissance éternelle et la consommation immodérée non viable sur laquelle repose le monde, mais aussi de l’agriculture intensive, et de la perte de contact entre l’Homme et la Nature, à commencer par l’ignorance de l’origine de nos aliments. Il illustre ainsi le fait qu’en continuant dans cette direction et en ne tentant pas de transformer nos modes de pensées, le monde court volontairement à sa perte. Il indique alors que la solution se trouve dans ce qu’il appelle « la sobriété heureuse », qui constitue une sorte de résistance, de vertu, une nouvelle manière d’envisager la vie. Il en dégage des principes fondamentaux, basés sur la volonté de substituer le vital au superflu et la décroissance. La « sobriété heureuse » vise à remettre l’homme et la nature au centre des préoccupations générales, elle prône le partage et la solidarité, le rééquilibrage des relations masculin/féminin et l’invention d’un nouveau système d’éducation. En tant que future architecte, il me semble indispensable de m’intéresser à ces principes et de les appliquer à ma pratique. Ainsi, dans l’optique d’une sobriété nécessaire et en vue de la pollution générée par le milieu de la construction aujourd’hui, penser l’architecture de manière écologique m’apparaît comme le premier moyen de se tourner vers ce nouveau paradigme et vers une nouvelle manière d’envisager le fonctionnement de notre société.
En effet, le milieu du BTP représente aujourd’hui 40% du bilan carbone relevé en France et 33% de la production de déchets en Europe.4 Face à ces chiffres alarmants, il semble indispensable d’envisager une architecture écologique et peu polluante, autant au niveau de sa construction, de sa consommation énergétique



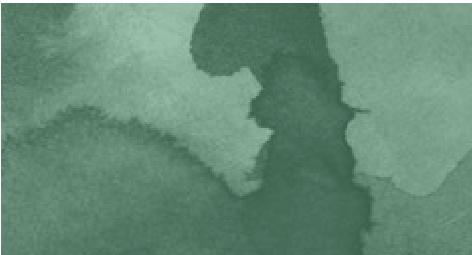


5 Références de cours n°2, n°3, n°4

6 RABHI Pierre, 2010, Vers la sobriété heureuse, Pierre Rahbi, éd. Babel essai que de son impact direct sur l’environnement dans lequel elle s’implante. Cette architecture se définit aujourd’hui sous plusieurs pratiques dont je retiens quatre éléments : elle s’inscrit dans un écosystème, elle vise à une reconnexion de l’homme à la nature, elle se base sur une écoconstruction, et elle favorise le réemploi non seulement des matériaux mais également du bâti existant par sa réhabilitation.

S’INSCRIRE DANS UN ÉCOSYSTÈME
Dans la conception d’un projet, s’implanter de manière juste passe dans un premier temps par un respect du site. Pour être pertinent, le projet doit en comprendre les caractéristiques intrinsèques, dans le but de s’inscrire dans un tout et de résonner avec les différentes parties de ce tout, en harmonie avec son environnement proche et lointain. L’architecture permet de révéler les potentialités du site dans lequel elle s’inscrit en même temps qu’elle se révèle elle même. Par le biais d’un projet urbain ou paysager, elle ne s’invente pas mais se découvre dans ce qui existe déjà, en en proposant, par le travail de l’offre et de la forme, la synthèse. En faisant écho à l’histoire, au patrimoine culturel du territoire, au paysage et à ses dynamiques, en créant un ancrage profond et en respectant son environnement, c’est alors que le projet fait sens.5 (fig.1)
(RE)CONNECTER L’HOMME À LA NATURE En tant que principal lien entre l’homme et son environnement, l’architecture peut choisir de favoriser un contact direct à la nature, à commencer par la production de notre nourriture. Elle peut ainsi faire prendre conscience à l’homme du fonctionnement essentiel de la vie et lui rappeler son origine primaire. En effet, « le rapport concret à la nature est indispensable. Tirer parti d’un principe vital sans le connaître est une lacune monumental»6 (Pierre Rabhi, 2010, p. 121). L’architecture doit inclure cette dimension, par exemple en favorisant les projets


7 Références de cours n°1 et n°2 de jardins urbains ou fermes urbaines, dans l’optique de reconnecter l’homme à la nature en lui offrant une forme d’autonomie et la possibilité de subvenir à une partie de ses besoins. (fig.2)
L’ÉCO-CONSTRUCTION La construction écologique est constituée de plusieurs principes. Elle se tourne d’abord vers l’utilisation de matériaux écologiques, souvent bio-sourcés, comme la terre, la paille, le bambou, etc... Ces techniques constructives renvoient en général à des savoirs-faire anciens issus de l’architecture vernaculaire peu à peu perdus avec la modernisation de la construction. Elles réapparaissent aujourd’hui pour leurs propriétés non seulement écologiques et respectueuses de l’environnement mais également économiques. Ces matériaux possèdent de réelles qualités constructives, architecturales et thermiques, et constituent, par leur variété d’utilisation, un véritable enjeu dans la conception architecturale contemporaine. La construction écologique s’intéresse également à la provenance des matériaux qu’elle met en œuvre. Elle favorise une construction locale, économique et moins polluante (réduction du transport, etc...), et permet ainsi la valorisation de savoir-faire locaux et la conservation d’une identité constructive. La construction écologique s’oriente également vers une faible consommation énergétique avec la création de bâtiments peu consommateurs, voire passifs. Elle favorise l’auto-production d’énergie et les techniques de ventilation et chauffage naturelles grâce à la construction bio-climatique.7 (Fig.2)
LE RÉEMPLOI, DU MATÉRIAU AU BÂTI EXISTANT Le réemploi des matériaux est une notion dont on entend largement parler dans nos études mais vers laquelle on se tourne finalement peu. La question du réemploi, dans sa dimension symbolique, écologique et économique m’intrigue d’autant plus que je ne l’ai jamais vraiment abordée personnellement. Pourquoi

toujours produire ? Pourquoi ne pas utiliser ce qui existe déjà ? En vue de la quantité de déchets produits dans le milieu de la construction et dans bien d’autres domaines, elle me semble aujourd’hui primordiale et constitue d’ailleurs une question centrale autant pour un grand nombre de collectifs, tels que Bellastock ou Encore Heureux (fig.3), que dans la construction actuelle du Grand Paris. Mais le réemploi ne concerne pas uniquement les matériaux. Reconvertir le bâti existant plutôt que de détruire systématiquement est également un des champs d’action de l’architecture écologique. En plus d’être économiques et moins consommatrices, la réhabilitation et la reconversion valorisent le patrimoine, s’inscrivant ainsi dans une logique de conservation de l’histoire de la ville tout en permettant sa transformation et sa redynamisation.
Une architecture écologique et durable consiste donc pour moi en la combinaison de ces quatre éléments. En revanche, appliquer les principes de la sobriété heureuse en architecture ne consiste pas uniquement à construire de manière écologique, locale et respectueuse, mais aussi à en transmettre les valeurs. En effet, l’architecture peut replacer l’humain au centre du fonctionnement de la société en repensant notre vie en communauté, en favorisant le partage et la solidarité, soit dans son processus de construction soit dans l’espace qu’elle propose.
L’ÉCOLOGIE ENVIRONNEMENTALE, RÉFÉRENCES DE COURS
1/ COURS DE PASCAL ROLLET ET INTERVENTIONS DE ROMAIN ANGERS (LICENCE 1, 2015/2016): Dispensés en parallèle de la partie pratique ces cours abordaient les notions d’éco-construction par l’utilisation de matériaux comme la terre et les matériaux fibrés. Ils détaillaient précisément le fonctionnement de ces matériaux, d’une échelle macro à une échelle 1, et étaient illustrés par de nombreux exemples de réalisations, les rendant beaucoup moins utopiques. Cela m’a sensibilisé à la question, devenue évidente pour moi, d’une architecture raisonnée et respectueuse de l’environnement.
2/ STUDIO PAUL-EMMANUEL LOIRET «PHÉNOMÉNOLOGIE, AMBIANCES ET MATÉRIALITÉS DE L’ARCHITECTURE» (LICENCE 2, S4AA, 2016/2017): L’exercice proposait de réaliser un lieu de culte dédié à la nature, dans un site naturel sur les hauteurs de Grenoble (Seyssinet-Pariset). Dans cette démarche, la conception architecturale s’effectue par une morphogénèse, c’est à dire que la forme du projet émerge d’une grande analyse du site et de l’usager. Elle est axée sur une économie de matériau, par une utilisation locale ou raisonnée, et sur un respect de l’environnement.
3/ STUDIO JULIE MARTIN «ÉCOSYSTÈME URBAIN» (LICENCE 3, S5AA, 2017/2018): Le contexte proposé était celui d’un environnement urbain en renouvellement, en l’occurence l’IBA de Bâle. Notre projet s’inscrit dans une vision de la ville collaborative, intelligente et verte. Par la reconversion du Silo Novartis en un programme multidirectionnel alliant public et privé (logements individuels, collectifs, théâtre, café, parc urbain), il s’inscrit dans un écosystème, car il porte une réflexion à la fois sur le fonctionnement de la ville à différentes temporalités, mais également sur les flux et les dynamiques existantes, et enfin sur la notion de cohabitation et de mixité, pour que le lieu deviennent un repère, de rassemblement intergénérationnel dans la ville.
4/ STUDIO GILLES MARTY (LICENCE 3, S6AA, 2017/2018) : Le projet proposait une réflexion sur la dynamisation des routes vertigineuses du massif du Vercors, projet directement en lien avec les acteurs locaux, sur demande du département de la Drôme. Constitué de onze routes, ce projet cherchait à valoriser les potentialités présentes sur le territoire (histoire, ressources, activités) avec la volonté d’en renforcer l’unité par un itinéraire touristique pertinent et par de petites interventions architecturales, adaptées à chaque contexte paysager. Aucun programme n’était donné à l’avance, chaque projet est né des dynamiques existantes (élan des routes, ambiances du paysage, présence de sentiers de randonnées, etc...), venant ainsi faire sens dans le territoire.
13




