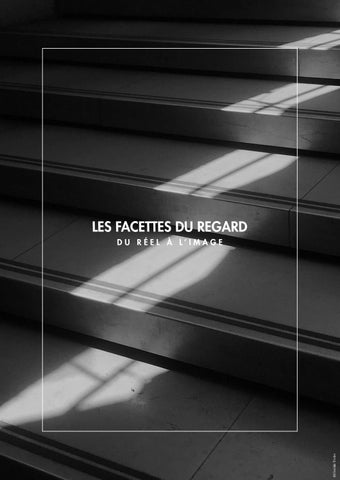4 minute read
B. Mouvement, grande échelle et détails
MOUVEMENT, GRANDE ÉCHELLE ET DÉTAILS
Maintenant que nous avons établi, ou du moins mis en exergue les points qui constituent ce que j’ai appelé les « composants universels », (c’est-à-dire les caractéristiques que l’on retrouve systématiquement lorsqu’on analyse le réel, et ce, quelque soit l’endroit où l’on se trouve ou la chose que l’on regarde), il est désormais possible d’aborder les notions de passage, de parcours, de mouvement ou encore de l’échelle.
Advertisement
En effet, il est tout aussi important, lorsque l’on regarde ce qui nous entoure, de prendre en compte les éléments fixes de manière indépendante, que de regarder les éléments dans leur ensemble, de manière successive ou encore du plus large et complet au plus infime des détails. Aussi, dans cette partie il est plutôt question de prendre du recul, ou au contraire de s’approcher tout près, de voir grand ou bien de scrutter les moindre petits détails. Il est aussi question de flaner, se balader et découvrir un enchaînement d’éléments qui ont aussi des choses à nous apprendre une fois analysés ensembe, de près comme de loin, en «zoom» fixe ou bien en mouvement.
Pour cela, imaginez-vous d’abord un mouvement de tête de l’avant vers l’arrière. Du lointain vers le plus proche. La vision se ressere et on découvre alors une multitude d’éléments qui passaient jusqu’à maintenant inaperçus. A ce moment-ci, il n’y pas plus seulement les grandes lignes et les masses qui se distinguent, on peut également voir apparaître les textures, les jonctions, les imperfections, les secrets du bâtiment et bien d’autres choses encore...
Les deux photographies situées ci-contre, bien qu’elles ne soient pas prises au même endroit, permettent de comprendre ce mécanisme. En effet, la photographie située à gauche regroupe un ensemble de constructions en strattes, plus ou moins entourées de verdures, d’espaces plantés. On distingue les grands composants du paysages tels que les façades, les toits, les murets, les fenêtres, les parties construites et les parties non construites. L’oeil voit donc à une échelle relativement large, bien qu’il soit tout à fait possible de faire abstraction des éléments majeurs pour se concentrer sur des détails. A l’inverse, sur la photographie de droite, il n’est pas possible de faire l’exercice dans l’autre sens. Cette dernière se concentre uniquement sur un détail du bâtiment et l’oeil ne voit que cela. C’est comme si notre oeil se concentrait uniquement sur un élément du réel et non pas sur un tout, comme si on faisait abstraction de l’ensemble pour ne prêter attention qu’à un détail de sa composition, qui, à grande échelle peut disparaître dans la masse.
Gordes, France ©Clotilde Trolet

Rouen, France ©Clotilde Trolet
Lorsqu’on parle du regard on pourrait tout aussi bien parler des autres sens puisqu’ils entretiennent tous une relation de causalité plus ou moins forte. Par exemple, en choisissant de parler du regard, il est impossible de ne pas évoquer le toucher - à travers les matières, les textures - mais aussi d’évoquer le corps dans sa totalité.
En effet, comme je l’évoquais sur la page précedente, regarder c’est aussi se déplacer, se mettre en mouvement dans notre environnement afin d’en prendre pleinement conscience. Dominique Spinetta1 parle de «passage d’un élément à l’autre», ce qui permet de placer notre environnement à l’échelle humaine et donc à l’échelle du corps, de la gestuelle.
Ici, contrairement à la page précédente, il s’agit plutôt de considérer un mouvement de tête horizontal de gauche à droite, voire même le mouvement du corps entier. Ce mouvement ne permet non pas d’effectuer un zoom et de passer du lointain au proche sur un seul et même élément fixe et à un seul endroit, mais plutôt de mettre en place la notion de passage, de déplacement, notions qui traîtent aussi d’échelle mais d’une autre manière. Aussi, il est plutôt question d’enchaînement, d’accumulation ou de succession d’éléments individuels, mis en relation grâce au mouvement.
Comme l’explique Brigitte Donnadieu dans son livre sur le cours de Dominique Spinetta2, « Le passage couvert est l’un des moyens de hiérarchiser […] La profondeur d’un passage couvert suscite la relation d’appartenance du proche et du lointain». Ainsi, le passage est le rapport entre « ici » et « là-bas », donc le lien entre ce qui est près et ce qui est loin (cf. profondeur de champ), entre ce qui est devant et ce qui est derrière (cf. typologie urbaine), entre ce qui est sombre et ce qui est éclairé (cf. ombre et lumière).
Le passage représente donc le mouvement mais aussi la hiérarchie, la sélection de ce qui se trouve autour de nous. On peut alors se poser plusieurs questions en ce qui concerne ce déplacement et cette sélection. Comment chemine le regard ? Comment notre esprit sélectionne et hiérarchise-t-il ce qu’il voit ? Comment assimiler le réel en mouvement ? Ce processus est-il le même pour tous ?
Ainsi, il me paraît primordial de prendre en considération cette notion du passage qui me paraît être une notion clé lorsqu’on essaie de décortiquer les capacités du regard et les caractéristiques de ce qui nous entoure. En effet, cette notion de passage est intimement liée au fait que le corps passe d’un espace à un autre de manière fluide et peut donc créer des ruptures visuelles dissociables par l’œil. Le mouvement horizontal de la tête - ou des yeux - est donc tout aussi important que le mouvement d’avant en arrière qui permet de se rapprocher de l’élément que l’on observe.
1 Brigitte Donnadieu, L’apprentissage du regard : Leçons d’architecture de Dominique Spinetta, Paris, Editions de la Villette, mars 2002 2 Ibid.
Amsterdam, Pays-Bas ©Clotilde Trolet

Porto, Portugal ©Clotilde Trolet