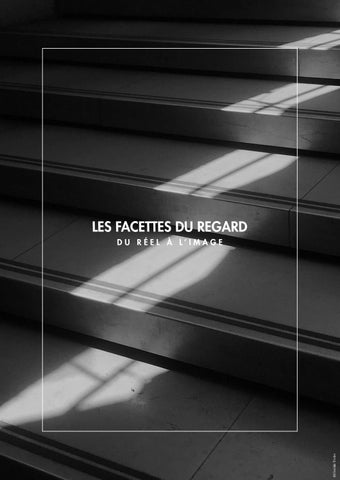2 minute read
C. L’architecture dans l’image
L’ARCHITECTURE DANS L’IMAGE
« Aujourd’hui, l’appétit d’architecture […] doit donc être en réalité l’appétit de quelque chose d’autre. Je pense que c’est un appétit de photographie. Aujourd’hui ce n’est pas du bâtiment en soi dont on veut se rassasier […]. La vraie couleur vient quand on regarde les photos […]. Tout au monde existe pour aboutir au livre ! Tout finit par un livre d’image ! […] »1
Advertisement
Comme le dit Frederic Jameson dans son ouvrage Le Postmodernisme ou la logique culturelle du capitalisme tardif, aujourd’hui et déjà depuis quelques dizaines d’années, tout mène à la création d’images, tout se transmet par le biais de l’image. L’architecture n’échappe pas à cette logique et à l’importance de la représentation, de la communication. Un projet d’architecture se traduit par une multitude de documents graphiques avant d’être réalisé, avant d’être construit. Des plans, des coupes, des perspectives... tout cela dans le but de transmettre une idée, de faire comprendre au mieux les intentions de l’architecte à son interlocuteur. Le peintre, le réalisateur, le sculpteur, l’écrivain - par les mots - fonctionnent pareil. Mais qu’en est-il du projet architectural une fois qu’il est sorti de terre ? Comment lui donne-t-on la meilleure image afin de le représenter de la meilleure manière possible ? Comment peut-on, à travers une image fixe, à travers un fragment du bâtiment, faire comprendre et montrer au spectateur la richesse d’un projet ?
Dans un article issu de la revue L’Architecture d’Aujourd’hui2, Nanni Baltzer, historienne d’art et d’architecture, évoque le lien étroit qu’entretiennent architecture et photographie. Ce qui fait écho avec le lien réel/image dans cet article est la manière de voir l’architecture mais cette fois-ci à travers une image figée. De voir quelque chose qui existe bel et bien dans le monde réel et de le retranscrire au sein d’un cadre bien défini, figé à jamais. Il s’agit donc de trouver l’équilibre parfait entre le réel et l’image.
Comme l’écrit Nanni Baltzer dans son article : « Certaines photos en disent davantage sur l’architecture que ce que l’on peut en voir in situ ». Je trouve particulièrement troublante cette frontière entre le vrai et l’image, cette barrière finalement assez subtile qui sépare ce que l’on voit à travers un objectif et ce que l’on voit à travers nos yeux et plus spécifiquement lorsqu’il s’agit d’architecture. On ne peut minimiser l’impact qu’a la photographie sur la perception, la représentation que l’on se fait de telle ou telle chose. L’image peut alors faire prendre une autre tournure au monde réel, nous en délivrer une nouvelle vision. Mais alors, qu’est-ce qui prête à intérêt ? Qu’est-ce que l’on retient ? Qu’est-ce qui marque ? Comment représenter un projet architectural à travers une seule et unique image ? Comment cette image peut-elle parfois être encore plus révélatrice que le projet lui-même ?
1 Frederic Jameson, Postmodernism or The Cultural Logic of Late Capitalism, Duke University Press, Etats-Unis, 1991, p 98-99. 2 Nanni Baltzer, « Photographie d’architecture : saisir l’impalbable», L’Architecture d’Aujourd’hui, n°354, sept-oct 2004, p.64.
©Clotilde Trolet Eames House (Case Study House n°8), Charles and Ray Eames, 1949, Los Angeles


Getty Center (ou Getty Museum), Richard Meier, 1997, Los Angeles ©Clotilde Trolet ©Clotilde Trolet

©Clotilde Trolet