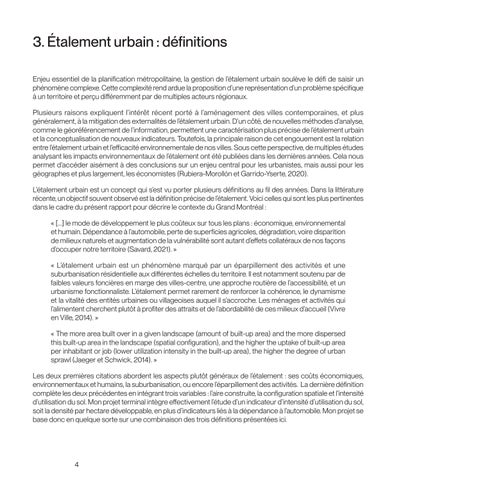Le développement périmétropolitain au pourtour de la CMM
Une étude de cas
Réalisée par Alexis Gagnon
Sous la direction de Jean-Philippe Meloche
URB3519 | Projet terminal | 2 mai 2022
Université de Montréal | Faculté de l’aménagement | École d’urbanisme et d’architecture de paysage


Sommaire
Depuis les dernières décennies, l’évolution des modes de production a entraîné l’augmentation des flux économiques et démographiques. Elle a participé à la métamorphose des villes, de laquelle résulte notamment une urbanisation rapide et une importante circulation des personnes et des biens. En surplus, dans un contexte de crise climatique, il est de plus en plus urgent de s’attaquer aux enjeux découlant de cette métropolisation, tels que la hausse des émissions de GES et la dégradation des milieux naturels.
À cette fin, ce rapport présente une analyse de données sur les externalités négatives de l’étalement urbain dans les MRC périmétropolitaines au pourtour de la Communauté métropolitaine de Montréal. Il a l’objectif de répondre à la question suivante : l’étalement urbain dans la CMM est-il réellement moins nocif que celui des MRC périmétropolitaines?
Le principal constat est le suivant : l’étalement urbain des MRC périmétropolitaines est plus nocif que celui des MRC de la CMM. Toutefois, l’analyse des résultats met en lumière une nuance : l’intensité des externalités semble plutôt dépendre du mode de vie des résidents, de la forme et la densité des centres urbains, et de l’accessibilité aux transports en commun.
Le projet terminal
La clôture du baccalauréat en urbanisme à l’Université de Montréal pour les finissants consiste en la réalisation d’un projet individuel. Ce projet prend généralement deux direction typiques : le projet d’intervention sur l’espace urbain, ou le projet de recherche théorique. Le projet terminal représente une occasion pour nous, les finissants, d’approfondir et de mettre en application les compétences acquises lors de notre parcours universitaire tout en nous intéressant à un sujet qui nous passionne. Le projet que j’ai choisi de réaliser est une recherche théorique sur l’étalement périmétropolitain au pourtour de la CMM.
Les résultats des projets terminaux des étudiants seront exposés dans le cadre de l’Exposition des finissant.e.s de la Faculté de l’aménagement, qui se tiendra du 12 au 15 mai 2022.
III
Table des matières
2.
5.
5.2.1
5.2.2
6.
7.
8.
1 3 4 5 5 5 7 9 9 11 11 13 15 17 19 21 23 27 25
1. Introduction
3. L’étalement urbain : définitions
4. Le territoire d’analyse 4.1 La CMM
5.1 Dépendance à l’automobile
5.2 Usage extensif du sol
4.2 Le territoire périmétropolitain
5.1.1 Durée des déplacements domicile-travail
5.1.3 Part modale de l’automobile
4.3 Les limites de la CMM et de la RMR de Montréal
5.1.2 Distance des déplacements domicile-travail
5.1.4 Part de travail local
Analyse des externalités
Analyse des résultats
Conclusion
Références
Densité d’utilisation du sol
Part de maisons individuelles non attenantes
Méthodologie

Liste des tableaux
Figure 1.1 - Taux de croissance projeté, CMM, MRC périmétropolitaines et reste du Québec, 2016-2031
Tableau 2.1 - Indicateurs utilisés pour mesurer les externalités de l’étalement urbain
Tableau 4.1 - Liste des MRC analysées
Tableau 5.1 - Part de déplacements domicile-travail de 60 minutes et plus, 2016
Tableau 5.2 - Part de déplacements domicile-travail de 35 km et plus, 2016
Tableau 5.3 - Part modale de l’automobile, MRC de la CMM et MRC périmétropolitaines, 2016
Tableau 5.4 - Part de travail local, MRC de la CMM et MRC périmétropolitaines, 2016
Tableau 5.5 - Densité par hectare développable, MRC de la CMM et MRC périmétropolitaines, 2016
Tableau 5.6 - Part de maisons individuelles non attenantes, MRC de la CMM et MRC périmétropolitaines, 2016
Tableau 6.1 - Synthèse des résultats, MRC de la CMM et MRC périmétropolitaines
Tableau 6.2 - Comparaison entre la MRC Les Maskoutains (Périphérie) et la MRC Vaudreuil-Soulanges (CMM)
VI
2 3 5 12 12 13 15 19 21 24 24
Liste des figures
VII
2
Figure 1.2 - Carte de la zone O-10
Figure 4.1 - Carte du territoire à l’étude
Figure 4.2 - Carte des limites de la CMM et de la RMR de Montréal
Figure 5.1 - Carte de la part modale de l’automobile, 2016
Figure 5.2 - Carte des parts de travail local, 2016
Figure 5.3 - Carte de la densité par hectare développable, 2016
6 8 14 16 20 22
Figure 5.4 : Carte des parts de maisons individuelles non attenantes, 2016

VIII
Remerciements
Je tiens à remercier principalement M. Jean-Philippe Meloche pour les précieuses recommandations qu’il m’a partagées au long de la dernière session. Aussi, je remercie les membres du comité exécutif du Regroupement des étudiant.e.s du baccalauréat en urbanisme ainsi que le comité organisateur de l’Exposition des finissant.e.s de la Faculté de l’aménagement pour les opportunités de mettre mon savoir-faire à l’œuvre au service de ma communauté étudiante. Finalement, je souhaite témoigner toute ma reconnaissance à l’ensemble du corps enseignant – chargé.e.s de formation pratique, auxiliaires, chargé.e.s de cours et professeur.e.s – grâce à qui mon baccalauréat en urbanisme s’est avéré particulièrement riche en apprentissages, autant au niveau professionnel que personnel.
IX
1. Introduction
Dès l’aube des années 1990, l’évolution des modes de production a entraîné l’augmentation des flux économiques et démographiques. Elle a participé à la métamorphose des villes, de laquelle résulte notamment une urbanisation rapide et une importante circulation des personnes et des biens. Les enjeux découlant de cette métropolisation, tels que la congestion routière et la perte des milieux naturels, ont accru la pertinence d’un débat sur l’organisation territoriale métropolitaine. Le besoin d’accorder une place prioritaire aux processus de collaboration entre les acteurs régionaux s’est rapidement fait sentir (Arcand, 2013).
C’est de cette dynamique qu’est née la CMM, un organisme supramunicipal créé en 2001 pour planifier, coordonner et financer les compétences stratégiques qui façonnent le territoire et le développement de la région de Montréal. Elle exerce sur son territoire plusieurs compétences au niveau métropolitain, par exemple en aménagement du territoire ou encore en transport en commun par la voie du PMAD, le Plan métropolitain d’aménagement et de développement (CMM, 2022).
Avec la croissance démographique des MRC périmétropolitaines, due notamment à un exode de la population des grands centres urbains vers l’extérieur de la CMM, le gouvernement de Québec a délimité une zone d’influence métropolitaine, dénommée O-10. Cette zone comprend le territoire situé entre les deux délimitations grises sur la carte, qui inclut les douze MRC limitrophes à la CMM, dont 6 qui sont en partie dans son territoire. La zone se nomme O-10 car l’orientation 10 des OGAT du gouvernement s’y applique. L’orientation 10 exige entre autres que ces MRC doivent consolider leur développement autour de leur principal pôle de services et prévoir des mesures d’urbanisation qui assurent l’utilisation durable et continue du sol (MAMH, 2021). Toutefois, cette orientation n’est pas appliquée de manière homogène par les MRC périphériques (CMM, 2020). Au cours des dernières années, plusieurs MRC limitrophes à la CMM, dans la zone O-10, ont connu une croissance démographique accélérée. Comme on le constate au tableau 1, avec un taux de croissance projeté de 12,6 % pour la période 2016-2031, ces MRC devraient connaître une croissance similaire à celle de la CMM et beaucoup plus élevée que le reste du Québec (ISQ, 2019).
Cette croissance démographique est à l’origine de plusieurs enjeux d’aménagement, et contribuera certainement à accroître l’étalement urbain dans le Grand Montréal. On peut supposer qu’une bonne part de cet étalement s’orientera vers les MRC de la zone O-10, et que les externalités générées par cet étalement y entraîneront plus de conséquences que dans les MRC situées dans les limites de la CMM. À cette fin, mon projet terminal tente de répondre à la question suivante :
1
L’étalement urbain dans la CMM est-il réellement moins nocif que celui des MRC périmétropolitaines?
Zone O-10
Zone O-10
Taux
Communauté métropolitaine de
Communauté métropolitaine de Montréal
Zone O-10
Zone O-10
Lim te CMM
Limite CMM
Source : Communauté métropolitaine de Montréal, 2020.
2
13.4%
5.5%
Source : Institut de la Statistique du Québec, 2019
12.6%
CMM MRC Périmétropolitaines Reste du Québec
de croissance projeté, 2016 2031
Figure 1.1 - Taux de croissance projeté, CMM, MRC périmétropolitaines et reste du Québec, 2016-2031
Communauté métropolitaine de Montréal
Figure 1.1 - Carte de la zone O-10
Montréal
2. Méthodologie
La réponse à cette question de recherche s’appuie sur une étude des externalités de l’étalement urbain dans toutes les MRC périmétropolitaines. Les externalités de l’étalement pertinentes à analyser ont été déterminées sur la base d’un article publié en 2000 par Jean K. Brueckner, économiste, universitaire, auteur et chercheur américain. Selon cet article, intitulé Urban Sprawl: Diagnosis and Remedies, les deux principales externalités de l’étalement urbain sont la dépendance à l’automobile et l’usage extensif du sol (Brueckner, 2000). Après une recherche approfondie, six indicateurs se sont révélés susceptibles de dégager des contrastes relatifs à ces externalités. Le tableau 2.1 présente les indicateurs étudiés : la durée et la distance des trajets domicile-travail, la part modale de l’automobile, le travail local, la densité d’utilisation du sol et la typologie des logements. Finalement, les données relatives à ces indicateurs ont été regroupées dans un tableau synthèse et comparées pour en faire ressortir des constats.
Afin de mesurer ces indicateurs, les données du profil du recensement de 2016 de Statistique Canada ont été utilisées. Ces données sont présentées sous forme de graphique et de cartes pour mettre en lumière de manière efficace les corrélations numériques et géographiques. L’organisation des colonnes de données dans les graphiques vise à illustrer les contrastes les plus évocateurs : les MRC dans la CMM sont groupées à gauche de la ligne pointillée centrale, et les MRC périmétropolitaines sont à sa droite. Les cartes sont illustrées à l’aide d’une rampe en niveaux de gris qui facilite la lecture et permet de localiser aisément les MRC les plus pertinentes pour chaque indicateur.
Indicateurs étudiés
Dépendance à l’automobile
Durée des déplacements domicile-travail
Distance des déplacements domicile-travail
Part modale de l’automobile
Part de travail local
Utilisation extensive du sol
Densité d’utilisation du sol
Part de maisons individuelles non attenantes
3
Tableau 2.1 - Indicateurs utilisés pour mesurer les externalités de l’étalement urbain
3. Étalement urbain : définitions
Enjeu essentiel de la planification métropolitaine, la gestion de l’étalement urbain soulève le défi de saisir un phénomène complexe. Cette complexité rend ardue la proposition d’une représentation d’un problème spécifique à un territoire et perçu différemment par de multiples acteurs régionaux.
Plusieurs raisons expliquent l’intérêt récent porté à l’aménagement des villes contemporaines, et plus généralement, à la mitigation des externalités de l’étalement urbain. D’un côté, de nouvelles méthodes d’analyse, comme le géoréférencement de l’information, permettent une caractérisation plus précise de l’étalement urbain et la conceptualisation de nouveaux indicateurs. Toutefois, la principale raison de cet engouement est la relation entre l’étalement urbain et l’efficacité environnementale de nos villes. Sous cette perspective, de multiples études analysant les impacts environnementaux de l’étalement ont été publiées dans les dernières années. Cela nous permet d’accéder aisément à des conclusions sur un enjeu central pour les urbanistes, mais aussi pour les géographes et plus largement, les économistes (Rubiera-Morollón et Garrido-Yserte, 2020).
L’étalement urbain est un concept qui s’est vu porter plusieurs définitions au fil des années. Dans la littérature récente, un objectif souvent observé est la définition précise de l’étalement. Voici celles qui sont les plus pertinentes dans le cadre du présent rapport pour décrire le contexte du Grand Montréal :
« […] le mode de développement le plus coûteux sur tous les plans : économique, environnemental et humain. Dépendance à l’automobile, perte de superficies agricoles, dégradation, voire disparition de milieux naturels et augmentation de la vulnérabilité sont autant d’effets collatéraux de nos façons d’occuper notre territoire (Savard, 2021). »
« L’étalement urbain est un phénomène marqué par un éparpillement des activités et une suburbanisation résidentielle aux différentes échelles du territoire. Il est notamment soutenu par de faibles valeurs foncières en marge des villes-centre, une approche routière de l’accessibilité, et un urbanisme fonctionnaliste. L’étalement permet rarement de renforcer la cohérence, le dynamisme et la vitalité des entités urbaines ou villageoises auquel il s’accroche. Les ménages et activités qui l’alimentent cherchent plutôt à profiter des attraits et de l’abordabilité de ces milieux d’accueil (Vivre en Ville, 2014). »
« The more area built over in a given landscape (amount of built-up area) and the more dispersed this built-up area in the landscape (spatial configuration), and the higher the uptake of built-up area per inhabitant or job (lower utilization intensity in the built-up area), the higher the degree of urban sprawl (Jaeger et Schwick, 2014). »
Les deux premières citations abordent les aspects plutôt généraux de l’étalement : ses coûts économiques, environnementaux et humains, la suburbanisation, ou encore l’éparpillement des activités. La dernière définition complète les deux précédentes en intégrant trois variables : l’aire construite, la configuration spatiale et l’intensité d’utilisation du sol. Mon projet terminal intègre effectivement l’étude d’un indicateur d’intensité d’utilisation du sol, soit la densité par hectare développable, en plus d’indicateurs liés à la dépendance à l’automobile. Mon projet se base donc en quelque sorte sur une combinaison des trois définitions présentées ici.
4
4. Territoire d’analyse
4.1 La CMM
La CMM, ou Communauté métropolitaine de Montréal, comporte 14 MRC et agglomérations, totalisant 82 municipalités. Son territoire s’étend une superficie de 4 374km². La population habitant son territoire s’élève à 4 099 000 en 2016, soit 48% de la population du Québec (CMM, 2022). La densité de population sur le territoire s’élève à 1 067 habitants par km².
4.2 Le territoire périmétropolitain
Le territoire périmétropolitain, aussi appelé zone O-10, regroupe les 12 MRC qui sont en périphérie de la CMM. La figure 4.1 montre le découpage territorial de ces MRC et de la CMM. Aux fins du présent rapport, certaines MRC comprises en partie dans les limites de la CMM en ont été exclues aux fins d’analyse. Ainsi, les MRC de Rouville et Beauharnois-Salaberry sont considérées hors CMM, alors que les MRC La Vallée-du-Richelieu, L’Assomption, Deux-Montagnes et Vaudreuil-Soulanges sont considérées dans la CMM. Des enjeux de calculs de données de population et la localisation des centres de population par rapport aux limites de la CMM sont à l’origine de cette classification. La classification des MRC comprises dans ce territoire apparaît au tableau 4.1. Le territoire périmétropolitain a une superficie de 9 944 km², et sa population s’élève à environ 706 190 personnes.
La densité moyenne de cette zone est d’environ 71 personnes par km².
Tableau 4.1 - Liste des MRC analysées
MRC CMM
MRC Périmétropolitaines
La Vallée-du-Richelieu (En partie) D'Autray
Marguerite-D'Youville Pierre-de-Saurel
L'Assomption (En partie) Les Maskoutains
Les Moulins Rouville (En partie)
Roussillon Le Haut-Richelieu
Vaudreuil-Soulanges (En partie) Joliette
Deux-Montagnes (En partie) Montcalm
Thérèse-de-Blainville Les Jardins-de-Napierville
Mirabel (Ville-MRC) Beauharnois-Salaberry (En partie)
La Rivière-du-Nord
Argenteuil
5
4.1 - Carte du territoire à l’étude
D'Autray
Joliette
Pierre-De Saurel
Argenteuil
MRC CMM
MRC Périmétropolitaines
Portion de MRC dans la CMM
Limite CMM
Territoire non-analysé
La Rivière-du-Nord
Montcalm Mirabel
Les Moulins
Thérèse-De Blainville
L'Assomption
Marguerite-D'Youville
Les Maskoutains
La Vallée-du-Richelieu
Communauté métropolitaine de Montréal
Deux-Montagnes
Vaudreuil-Soulanges Roussillon
Beauharnois-Salaberry
Rouville
Le Haut-Richelieu
Les Jardins-de-Napierville
Source : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, découpages administratifs, 2022.
6
Figure
Les limites de la CMM et de la RMR de Montréal
Avec l’accélération du processus d’urbanisation et de suburbanisation, les grandes villes d’aujourd’hui sont au centre de régions métropolitaines à forte densité de population, dans lesquelles le développement d’infrastructures de transport a engendré l’intensification des échanges et la hausse des distances effectuées pour les déplacements domicile-travail.
Compte tenu du contexte économique, social, environnemental et culturel des aires métropolitaines, plusieurs agences statistiques délimitent géographiquement les grandes régions métropolitaines de leur pays respectif. Ces régions servent alors de territoire de référence pour la compilation de données de recensement, mais aussi pour la mise en place de certains programmes et pour la mise en place d’organismes de gestion métropolitaine.
Au Canada, Statistique Canada délimite depuis 1941 les régions métropolitaines de recensement. Les RMR regroupent un centre urbain important et densément peuplé auquel s’intègrent des municipalités adjacentes, fortement intégrées au centre de la région sur le plan socioéconomique. Selon les critères établis par Statistique Canada, une RMR doit avoir une population d’au moins 100 000 habitants et son noyau doit compter au minimum 50 000 habitants (CMM, 2020).
Les limites de la RMR de Montréal et du territoire de la CMM ne sont pas exactement les mêmes, tel qu’illustré par la figure 4.2. Les limites du territoire de la CMM, contrairement à celles de la RMR de Montréal, sont relativement fixes. Toutefois, l’article 270 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal prévoit que la Communauté doit statuer sur la nécessité de modifier les limites de son territoire pour en assurer la concordance avec les recensements de Statistique Canada. La modification des limites de son territoire serait un exercice exigeant au niveau de la législation en place. Également, l’intégration de certaines MRC les mènerait à mettre en place un chantier de modification de leurs outils de planification et de gouvernance. Ce serait un processus ardu s’échelonnant sur plusieurs années, au terme desquelles les municipalités visées exerceraient enfin leurs fonctions de manière optimale. Certains suggèrent que des ententes devraient être conclues avec les MRC périmétropolitaines au lieu de modifier les limites de la CMM. C’est la CMM qui a le pouvoir décisionnel d’agrandir ses limites ou non, alors que les limites des RMR sont définies par Statistique Canada (CMM, 2020).
La RMR de Montréal, quant à elle, voit ses limites évoluer périodiquement. Les dernières modification à ses frontières ont eu lieu en 1990 et en 2002. Elle a l’occasion de modifier le tracé de ses limites à chaque recensement effectué par Statistique Canada (CMM, 2020). Il serait donc pertinent d’évaluer l’étalement hors de ses limites pour statuer si, oui ou non, la CMM devrait incorporer des MRC qui lui sont adjacentes à son territoire.
7
Territoire de la RMR de Montréal
Territoire de la RMR de Montréal
Limite CMM
Source : Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, découpages administratifs, 2022.
8
Figure 4.2 - Carte des limites de la CMM et de la RMR de Montréal
5. Analyse des externalités
5.1 Dépendance à l’automobile
Dans le contexte actuel de crise climatique, nos efforts de réduction des émissions de GES doivent être orientés vers le secteur du transport de personnes par automobile ou camion léger, qui représente 22% des émissions générées dans la province. La dépendance à l’automobile, qui induit des déplacements en auto solo dans des véhicules de plus en plus imposants, est un défi d’envergure auquel nous devons nous attaquer.
Au Québec comme dans plusieurs sociétés occidentales, la dépendance à l’automobile repose sur une combinaison de facteurs : l’aménagement favorisant l’automobile réalisé au fil des années, le maintien d’une symbolique positive à la voiture et au mode de vie qui s’y rattache, et la culture populaire puis la publicité qui y sont destinées. À cet effet, une certaine idée de succès est présente dans l’imaginaire collectif : un propriétaire d’une vaste maison unifamiliale détachée ayant plusieurs garages habitant dans un territoire suburbain accessible essentiellement en automobile. Un attachement psychologique, difficile à contrecarrer, découle de cette image ancrée au cœur de notre mode de vie nord-américain (Laviolette, 2018).
Cela dit, plusieurs MRC limitrophes à la CMM ont connu une importante croissance démographique au cours des dernières décennies. Cette croissance aux limites de la CMM l’a menée à une forte intégration socioéconomique avec son territoire périphérique. Un indicateur clé qui permet d’apprécier cette intégration est l’augmentation du navettage domicile-travail de la population demeurant dans les MRC limitrophes. En effet, en 2016, 28 % de la population active occupée résidant dans les MRC périmétropolitaines navettait vers un lieu de travail situé sur le territoire de la CMM, ce qui représente une augmentation de trois points de pourcentage comparativement aux données de 2006 (CMM, 2020).
La faible accessibilité aux infrastructures de transport en commun sur le territoire périmétropolitain incite les navetteurs ayant un lieu de travail dans la CMM à utiliser presque exclusivement l’automobile pour s’y déplacer. Le principe d’accessibilité, soit la facilité à atteindre des destinations, est une mesure clé d’usage du sol et d’interaction entre différents territoires. Plusieurs études démontrent qu’une plus grande accessibilité aux emplois par transport collectif est associée à une plus grande proportion d’utilisateurs de transport en commun et une utilisation diminuée de l’automobile (Lussier-Tomaszewski et Boisjoly, 2021). Également, l’environnement bâti a une grande influence sur les choix de modes de transport de la population. Il est hautement probable que des milieux denses, ayant un haut niveau de marchabilité et une forte mixité d’usages favorisent l’utilisation des infrastructures de transport collectif par rapport à l’utilisation de l’automobile (Cervero, 2002).
9

La durée et la distance des trajets domicile-travail permettent d’avoir un bon aperçu de la mobilité dans un territoire donné. L’analyse des distance parcourues et de temps de déplacement nous donne des indications sur les propriété de l’espace urbain, mais surtout sur les habitudes de mobilité de la population. L’analyse de ces indicateurs prend tout son sens dans la mesure où « les lieux ne sont pas différenciés par leur contenu propre, mais par la distance qui les sépare, c’est-à-dire par les coûts à supporter pour aller de l’un à l’autre » (Aydalot, 1980). Relativement aux trajets domicile-travail, j’ai choisi de présenter, par les tableaux 5.1 et 5.2, les trajets de 35 km et plus, et de 60 minutes et plus, car ce sont ces données qui illustrent mieux les plus contrastes en regard à l’utilisation de l’automobile pour le territoire d’analyse.
5.1.1 Durée des trajets domicile-travail
Au premier coup d’œil, on constate que les déplacements domicile-travail ayant pour origine les MRC dans la CMM sont généralement plus courts en distance, mais de plus longue durée. Par exemple, 14 % des trajets provenant de la MRC de Deux-Montagnes ont une durée de 60 minutes et plus, mais seulement 3 % atteignent 35 km ou plus. Cela pourrait s’expliquer par le fait que la congestion fréquente augmente la durée de déplacement même pour de courts trajets dans les territoires de la CMM. Également, on peut supposer que dans ces MRC, l’utilisation plus élevée de transports en commun pour se rendre au travail donne lieu a des trajets légèrement plus longs qu’en automobile.
5.1.2 Distance des trajets domicile-travail
Parallèlement, des MRC hors du périmètre métropolitain ont des durées et distances de trajet très raisonnables. Les trajets dans la MRC Les Maskoutains atteignent ou dépassent 35 km dans un part de 11%, mais seulement 4 % durent 60 minutes ou plus. Cela pourrait s’expliquer par le fait que cette MRC relativement dense a un taux de travail local élevé, et son principal centre urbain, Saint-Hyacinthe, est riche en activités économiques accessibles dans un rayon restreint, et ce, possiblement à pied et en transport en commun.
Dans la CMM, la moyenne des temps de déplacement en automobile est de 29 minutes, contre 25 minutes pour les MRC périmétropolitaines. La moyenne des temps de déplacement en transport en commun, elle, s’élève à 60 minutes pour les MRC de la CMM, et à 58 minutes pour les MRC périmétropolitaines (Statistique Canada, 2011). On peut conclure que l’usage de l’automobile est favorisé par les temps de déplacement nettement supérieurs du transport en commun, et qu’il l’est encore plus dans les MRC périmétropolitaines.
11
Part de déplacements domicile/travail, 60 min et +, 2016 Tableau 5.1 - Part de déplacements domicile-travail de 60 minutes et plus, 2016
Marguerite-D'YouvilleMirabel(Ville-MRC)RoussillonVaudreuil-SoulangesLaVallée-du-RichelieuThérèse-de-BlainvilleLesMoulins Deux-MontagnesL'AssomptionLesMaskoutains Beauharnois-SalaberryJoliette
LesJardins-de-NapiervilleRouvillePierre-de-Saurel
LeHaut-RichelieuD'AutrayLaRivière-du-NordArgenteuilMontcalm
Source : Statistique Canada, profil du recensement de 2016.
Part de déplacements domicile/travail de 35km et +, 2016 Tableau 5.2 - Part de déplacements domicile-travail de 35 km et plus, 2016
Thérèse-de-BlainvilleLesMoulinsRoussillonDeux-Montagnes
LaVallée-du-RichelieuMarguerite-D'Youville
Mirabel(Ville-MRC)L'AssomptionVaudreuil-SoulangesRouville
Source : Statistique Canada, profil du recensement de 2016.
LeHaut-Richelieu
Beauharnois-Salaberry
LesMaskoutainsJoliette
LesJardins-de-NapiervillePierre-de-SaurelLaRivière-du-NordMontcalmArgenteuilD'Autray
12 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
5.1.3 Part modale de l’automobile
La part modale de l’automobile est un indicateur direct des choix de mode de déplacement d’une population pour ses déplacements quotidiens. Malgré tout, cela n’indique pas directement le mode de transport des individus, mais représente plutôt les options de mobilité auxquelles les gens ont accès. Comme établi précédemment, l’automobile est aujourd’hui perçue comme un outil indispensable à la participation à la vie économique et sociale pour une grande majorité de la population, à l’exception peut-être des résidents des quartiers urbains plus denses. Même dans ces milieux urbains où les lieux d’activités sont plus rapprochés et les solutions de mobilité alternatives sont multiples, la voiture est largement retenue comme un besoin essentiel (Laviolette, 2020).
À la vue de la figure 5.1 et du tableau 5.3, on constate que la part modale de l’automobile est généralement plus élevée hors de la CMM qu’à l’intérieur de ses limites. En effet, la part modale moyenne de l’automobile s’établit à 87 % pour les MRC de la CMM, et à 91 % pour les MRC périmétropolitaines. Le transport en commun plus accessible dans les MRC adjacentes aux grands centres urbains, les modes de vie et l’aménagement des milieux des différentes MRC étudiées pourraient expliquer cette différence. On constate également que la part modale de l’automobile des MRC de la couronne Nord est plus élevée que dans les MRC de la couronne Sud.
Part modale de l'automobile, 2016
Tableau 5.3 - Part modale de l’automobile, MRC de la CMM et MRC périmétropolitaines, 2016
Deux-MontagnesRoussillon
LaVallée-du-RichelieuThérèse-de-BlainvilleMarguerite-D'YouvilleL'Assomption
LesMoulins Vaudreuil-SoulangesMirabel(Ville-MRC)LeHaut-Richelieu
LesMaskoutainsRouvilleJoliettePierre-de-Saurel
LesJardins-de-NapiervilleBeauharnois-SalaberryD'AutrayLaRivière-du-NordArgenteuilMontcalm
Source : Statistique Canada, profil du recensement de 2016.
13
78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% 92% 94% 96%
- 94%
- 92%
- 90%
- 88%
- 86%
Limite CMM
Territoire non-analysé
Source : Statistique Canada, profil du recensement de 2016.
14
Argenteuil
Montcalm Mirabel
modale
l'automobile
91%
89%
87%
La Rivière-du-Nord
Part
de
93%
83%
Figure 5.1 - Carte de la part modale de l’automobile, 2016
5.1.4 Part de travail local
Le travail local est une donnée qui représente la part de travailleurs qui ont un emploi dans la MRC où ils sont résidents. La prise en compte de cet indicateur est pertinente car elle permet d’évaluer la localisation approximative des lieux de travail d’une population. On suppose ici que des travailleurs qui travaillent dans leurs MRC font un usage moindre de l’automobile que quelqu’un qui se déplacerait dans des MRC adjacentes ou vers les grands centres urbains.
La figure 5.2 et le tableau 5.4 présentent la part de travail local pour les territoires analysés. On peut y voir que les MRC périmétropolitaines ont des taux de travail local plus élevés que les MRC de la CMM. En effet, les MRC qui ont les plus haut taux de travail local sont celles de Joliette, Pierre-de-Saurel et Les Maskoutains, toutes à l’extérieur de la CMM. Ces résultats pourraient s’expliquer par le dynamisme de certains pôles d’emploi en région périmétropolitaine mais par une certaine densité due à une grande part de territoire à vocation agricole. Aussi, on constate que les MRC de la CMM on un taux de travail local généralement faible, probablement causé par la proximité avec les grands centres urbains. La MRC Mirabel, par exemple affiche un taux de travail local de 21 %. L’automobile, mode de déplacement largement majoritaire, y est probablement utilisée pour les trajets domicile-travail en grande partie à destination hors de la MRC.
Tableau
15
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%
LaVallée-du-RichelieuMarguerite-D'Youville
Thérèse-de-BlainvilleDeux-MontagnesL'AssomptionRoussillonVaudreuil-SoulangesMontcalmRouvilleD'AutrayLesJardins-de-NapiervilleLaRivière-du-NordArgenteuilBeauharnois-Salaberry
Mirabel(Ville-MRC)
LesMoulins
LeHaut-RichelieuJoliettePierre-de-SaurelLesMaskoutains
Part de travail local, 2016
5.4 - Part de travail local, MRC de la CMM et MRC périmétropolitaines, 2016
Source : Statistique Canada, profil du recensement de 2016.
5.2 - Carte des parts de travail local, 2016
- 59%
- 48%
- 39% 21% - 30%
Limite CMM
Territoire non-analysé
Source : Statistique Canada, profil du recensement de 2016.
16
Les Maskoutains
49%
Joliette Pierre-De Saurel
Part de travail local 60% - 75%
40%
31%
Figure
Mirabel
5.2 Utilisation extensive du sol
Pour qu’une ville se développe spatialement, les promoteurs doivent être en mesure d’acquérir des terrains supplémentaires auprès des utilisateurs agricoles. Lorsqu’un terrain passe d’un usage agricole à un usage résidentiel, en théorie, cela signifie que ledit terrain a une meilleure valeur sous un usage résidentiel qu’agricole et aura une plus grande contribution économique une fois développé.
Cela dit, un accès à des espaces ouverts contribue fortement au bien-être de la société. Les espaces ouverts offrent à la population une évasion de la scène urbaine parfois chaotique et une possibilité de profiter de la nature. Ces avantages de l’espace ouvert, cependant, ne sont pas pris en compte lors de la conversion des terres agricoles à l’usage urbain. Comme indiqué ci-dessus, la conversion dépend du rendement économique du sol en usage urbain par rapport à la productivité agricole de la terre. Le problème est que puisque les avantages intangibles des espaces ouverts ne font pas partie des revenus tirés de la terre lorsqu’elle est à usage agricole ou protégée, la disparition de ces avantages n’apparaît pas comme une perte monétaire lorsque la terre est vendue à un promoteur immobilier (Brueckner, 2000).
Le mode développement de terrains périphériques aux centres urbains, basé les principes de l’urbanisme fonctionnaliste, entraîne la planification de vastes zones homogènes, la ségrégation et l’étalement des activités, le déclin des centres et la déstructuration l’affaiblissement des centres et la déstructuration de la ville et des terres agricoles (Vivre en ville, 2014). En ce sens, il est judicieux d’étudier l’usage du sol qui est fait dans les MRC étudiées pour évaluer la perte de milieux naturels due à l’étalement urbain dans le Grand Montréal.
17

18
5.2.1 Densité d’utilisation du sol
Pour mesurer la densité par hectare développable, j’ai considéré que les terrains disponibles hors de la zone agricole permanente et du Registre des aires protégées du Québec seraient potentiellement développés dans les prochaines années. La figure 5.3 et le tableau 5.5 montrent que certaines MRC ont des densités d’utilisation du sol très faibles dans la couronne Nord : Argenteuil, D’Autray, Montcalm, et La Rivière-du-Nord. Cela est probablement du à leur topographie montagneuse qui rend de vastes surfaces très difficiles à développer. Cependant, on observe des MRC où la densité est élevée malgré un territoire presque exclusivement agricole, comme les MRC Les Maskoutains et Rouville. La MRC des Maskoutains, qui comprend la ville de Saint-Hyacinthe, a des centres urbains assez denses en raison de la petite surface disponible au développement. Cela pourrait être lié au fait que les villes entourées de terres agricoles fertiles sont plus denses que celles qui sont localisées dans des régions où les terres agricoles sont improductives, et donc plus vulnérables au développement (Brueckner, 2000).
19
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 Vaudreuil-SoulangesMirabel(Ville-MRC)Marguerite-D'YouvilleRoussillonDeux-MontagnesLesMoulins Thérèse-de-BlainvilleLaVallée-du-RichelieuL'AssomptionArgenteuilD'AutrayMontcalmLaRivière-du-Nord Beauharnois-SalaberryPierre-de-SaurelJolietteLeHaut-Richelieu LesJardins-de-NapiervilleRouvilleLesMaskoutains
de
5.5 - Densité
hectare développable,
Densité
population par hectare développable, 2016 Tableau
par
MRC de la CMM et MRC périmétropolitaines, 2016 Source : Statistique Canada, profil du recensement de 2016.
Densité (pop./ha développable)
15 08 - 19 37
10 96 - 15 07
7 44 - 10 95
3 27 - 7 43
0.37 - 3.26
Limite CMM
Territoire non-analysé
Source : Statistique Canada, profil du recensement de 2016.
20
Les Maskoutains
Rouville
L'Assomption
Figure 5.3 - Carte de la densité par hectare développable, 2016
5.2.2 Part de maisons individuelles non attenantes
Plutôt que de densifier les espaces voués à l’urbanisation, les maisons individuelles non attenantes consomment plus d’espace et contribuent ainsi à l’agrandissement des périmètres d’urbanisation et à la disparition de terres agricoles ou de milieux naturels. À l’échelle des grandes villes, les impacts économiques de l’urbanisation sur la demande en infrastructures collectives et en réseaux de transport ont été très documentés. On accole également au modèle résidentiel dominant de la maison individuelle de nombreuses critiques : consommateur d’espace, générateur d’infrastructures difficiles à rentabiliser, génération de secteurs totalement homogènes et adaptabilité faible aux changements économiques ou sociaux (Marchand, 2015).
La figure 5.4 et le tableau 5.6 illustrent que les MRC où la part de maisons individuelles non attenantes est la plus élevée sont généralement à l’extérieur de la CMM : ce sont les MRC d’Argenteuil et du Haut-Richelieu. On observe toutefois que le contraste n’est pas particulièrement frappant entre les deux catégories de MRC. Cela est probablement du à des facteurs historiques : les bâtiments construits dans les années 1960 et ensuite sont en grande majorité des maisons individuelles non attenantes.
Part de maisons individuelles non attenantes, 2016
Tableau 5.6 - Part de maisons individuelles non attenantes, MRC de la CMM et MRC périmétropolitaines, 2016
Mirabel(Ville-MRC)RoussillonThérèse-de-BlainvilleRouville
Source : Statistique Canada, profil du recensement de 2016.
21
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
LaVallée-du-RichelieuVaudreuil-SoulangesL'AssomptionLesMoulins Marguerite-D'YouvilleDeux-Montagnes
LaRivière-du-NordPierre-de-SaurelD'AutrayJoliette
LesMaskoutains Beauharnois-SalaberryMontcalm
LesJardins-de-NapiervilleLeHaut-RichelieuArgenteuil
Part de maisons individuelles non attenantes 74% - 80% 68% - 73%
- 67%
- 61%
- 54%
Limite CMM
maisons individuelles non attenantes, 2016
Territoire non-analysé
Source : Statistique Canada, profil du recensement de 2016.
22
Argenteuil
Le Haut-Richelieu
62%
55%
50%
Figure 5.4 : Carte des parts de
6. Analyse des résultats
À la lumière des résultats obtenus, j’ai constaté que la nocivité de l’étalement urbain ne semble pas nécessairement liée à la localisation des MRC par rapport aux limites de la CMM. D’une part, l’étalement dans les MRC périmétropolitaines génère la plupart de temps plus d’externalités négatives que dans celles de la CMM. Toutefois, l’intensité des externalités semble plutôt dépendre du mode de vie des résidents, de la forme et la densité des centres urbains, et de l’accessibilité aux transports en commun.
Le tableau 6.1 illustre plusieurs contrastes relatifs aux indicateurs analysés. Premièrement, on remarque que les MRC de la CMM présentent des trajets domicile-travail de courte distance, mais de longue durée. Aussi, c’est dans ces MRC que l’on retrouve les plus faibles parts modales de l’automobile. La part de travail local est généralement plus élevée dans les MRC périmétropolitaines que dans celles de la CMM. On constate également une forte corrélation entre la part modale de l’automobile et la densité des territoires : la part modale de l’automobile est effectivement moins élevée dans les territoires les plus denses. La part de maisons individuelles non attenantes n’illustre pas un fort contraste entre les deux catégories de MRC : la moyenne pour chaque catégorie se situe à 63 %. Finalement, les MRC dans la CMM sont présentent pour la plupart une plus forte densité d’utilisation du sol que les MRC périmétropolitaines. Ces dernières ont effectivement plus d’espaces agricoles ou protégés qui limitent le développement.
Cela dit, certaines MRC périmétropolitaines présentent de meilleures performances en termes d’étalement urbain que les MRC de la CMM. À titre d’exemple, la MRC périmétropolitaine Les Maskoutains surpasse Vaudreuil-Soulanges, une MRC de la CMM, sur plusieurs plans. Tel que constaté au tableau 6.2, les habitudes de mobilité de la population de la MRC Les Maskoutains semble plus durable : la durée et la distance de ses trajets domicile-travail sont inférieurs à ceux de Vaudreuil-Soulanges. De plus, elle utilise l’automobile dans une moindre mesure, et une grande part travaille dans cette même MRC. La MRC des Maskoutains est aussi relativement dense : les vastes espaces occupés par les usages agricoles limitent l’étalement spatial des noyaux urbains et les mène à se densifier. Le seul indicateur où la MRC Vaudreuil-Soulanges performe mieux que sa consœur périmétropolitaine est la part de maisons individuelles non attenantes.
23


24
Tableau 6.1 - Synthèse des résultats, MRC de la CMM et MRC périmétropolitaines
Tableau 6.2 - Comparaison entre la MRC Les Maskoutains (Périphérie) et la MRC Vaudreuil-Soulanges (CMM)
7. Conclusion
L’analyse de l’étalement des MRC périmétropolitaines sur la base de plusieurs indicateurs a démontré les contrastes entre celles-ci et les MRC qui font partie de la CMM. Mon hypothèse de départ, selon laquelle l’étalement des MRC périmétropolitaines est plus nocif que celles de la CMM, s’est avérée juste dans une certaine mesure. En effet, la réponse à la question de recherche est nuancée : sur le plan des indicateurs analysés, les MRC de la CMM ne se classent pas nécessairement mieux que leurs homologues périphériques en matière d’étalement.
L’étude de cas réalisée comporte bien entendu certaines limites. Premièrement, des indicateurs supplémentaires auraient pu être pris en compte pour étoffer le projet, comme la part de mises en chantier de maisons individuelles non attenantes ou le nombre de voitures par ménage. Ensuite, il aurait pu être avantageux de bonifier le choix du mode de découpage par MRC, donc par division de recensement, en réalisant certaines analyses à l’échelles des municipalités. De surcroît, une analyse portant sur les nouveaux développements aurait été pertinente pour évaluer la mesure de leurs impacts sur l’étalement urbain dans les territoires analysées.
Bien que le présent rapport ne vise pas à proposer un plan d’action pour mitiger les externalités de l’étalement dans la région de Montréal, certaines pistes de solution se doivent d’être évoquées. Relativement à la dépendance à l’automobile, améliorer l’offre de transport en commun dans les couronnes et installer des postes de péage sur les grandes artères permettraient d’amorcer une transition vers un système de mobilité plus durable. En ce qui concerne l’utilisation extensive du sol, forcer les développeurs à financer les nouvelles infrastructures publiques sous forme de somme forfaitaire ou imposer une taxe spéciale sur les nouveaux développements favoriserait une utilisation plus optimale de l’espace (Brueckner, 2000).
En définitive, il est nécessaire de s’attaquer aux principales externalités produites partout sur le territoire d’analyse, mais surtout dans les MRC périmétropolitaines, car elles présentent l’étalement le plus nocif et accueilleront une bonne part de la croissance démographique projetée dans les prochaines décennies.
25

26
8. Références
Arcand, M.-È. (2013). Une nouvelle collaboration entre les organismes d’aménagement du territoire et des transports collectifs ? Université du Québec. Repéré à https://espace.inrs.ca/id/eprint/2445/
Aydalot, P. (1980). Dynamique spatiale et développement inégal. Paris: Economica. Repéré à https://www. cairn.info/dynamique-spatiale-et-developpement-inegal--9782717800593.htm
Brueckner, J. K. (2000). Urban Sprawl: Diagnosis and Remedies. International Regional Science Review, 23(2), 160-171. https://doi.org/10.1177/016001700761012710
Cervero, R. (2002). Built environments and mode choice: toward a normative framework. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 7(4), 265-284. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/ S1361-9209(01)00024-4
Commission de protection du territoire agricole du Québec. (2022). Zone agricole numérique (2017-09-08). Repéré à http://www.cptaq.gouv.qc.ca/index.php?id=175&file=zonage.zip
Communauté métropolitaine de Montréal. (2020). La CMM et les MRC métropolitaines: Statu quo pour les limites du territoire et proposition d’ententes pluriannuelles pour le transport collectif. Repéré à https:// cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2020/02/RAP_20200130_Limites_CMM_dv.pdf
Communauté métropolitaine de Montréal. (2021). Mémoire de la Communauté Métropolitaine de Montréal sur le document de consultation «pour une stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires». Repéré à https://cmm.qc.ca/wp-content/uploads/2021/09/20210831_DI_SNUAT_ Memoire_Final.pdf
Communauté Métropolitaine de Montréal. (2022). À propos. Repéré à https://cmm.qc.ca/a-propos/
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. (2022). Découpages administratifs. Repéré à https:// diffusion.mern.gouv.qc.ca/Diffusion/RGQ/Vectoriel/Theme/Local/SDA_20k/SHP/SHP.zip
Institut de la statistique du Québec. (2019). Perspectives démographiques du Québec et des régions, 2016-2066, édition 2019. Québec Repéré à https://statistique.quebec.ca/fr/fichier/perspectivesdemographiques-du-quebec-et-des-regions-2016-2066-edition-2019.pdf
Jaeger, J. A. G. et Schwick, C. (2014). Improving the measurement of urban sprawl: Weighted Urban Proliferation (WUP) and its application to Switzerland. Ecological Indicators, 38, 294-308. https://doi. org/https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2013.11.022
Laviolette, J. (2020). L’état de l’automobile au Québec : constats, tendances et conséquences. Fondation David Suzuki. https://jalonmtl.org/wp-content/uploads/2020/04/Rapport_Fondation-David-SuzukiFinal-Part1-Dependance-auto-10.2020.pdf
Lussier-Tomaszewski, P. et Boisjoly, G. (2021). Thinking regional and acting local: Assessing the joint influence of local and regional accessibility on commute mode in Montreal, Canada. Journal of Transport Geography, 90. https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2020.102917
27
Marchand, J.-F. (2015). Y a-t-il densification résidentielle dans la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)? https://www.mamh. gouv.qc.ca/fileadmin/publications/SRM/densification_residentielle.pdf
Ministère des affaires municipales et de l’habitation. (2001). Cadre d’aménagement et orientations gouvernementales. Repéré à https://www.mamh.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/amenagement_territoire/orientations_gouvernementales/cmm_cadre_ amenagement.pdf
Rondier, P. (2012). Comment structurer le problème de l’étalement urbain https://corpus.ulaval.ca/jspui/bitstr eam/20.500.11794/23375/1/28897.pdf
Rubiera-Morollón, F. et Garrido-Yserte, R. (2020). Recent Literature about Urban Sprawl: A Renewed Relevance of the Phenomenon from the Perspective of Environmental Sustainability. Sustainability, 12(16). https://doi.org/10.3390/su12166551
Statistique Canada. (2011). Enquête nationale auprès des ménages de 2011, produit numéro 99-012-X2011050 au catalogue de Statistique Canada. (Moyenne temps-modes). Repéré à https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/dp-pd/dt-td/Rp-fra.
cfm?TABID=2&LANG=F&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GK=0&GRP=1&PID=105623&PRID=0&PTYPE=105277&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2013&THEME=96&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=
Statistique Canada. (2016a). Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016222 au catalogue de Statistique Canada. (Logement). Repéré à https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dt-td/Rp-fra.
cfm?TABID=2&LANG=F&A=R&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=01&GL=-1&GID=1257309&GK=1&GRP=1&O=D&PID=111830&PRID=10&PTYPE=109445&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2017&THEME=121&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0
Statistique Canada. (2016b). Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016328 au catalogue de Statistique Canada. (Durée-distance). Repéré à https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dt-td/ Rp-fra.cfm?TABID=2&Lang=F&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=1258491&GK=0&GRP=1&PID=111334&PRID=10&PTYPE=109445&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2017&THEME=125&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0
Statistique Canada. (2016c). Recensement de la population de 2016, produit numéro 98-400-X2016391 au catalogue de Statistique Canada. (Destinations). Repéré à https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/dp-pd/dt-td/ Rp-fra.cfm?TABID=2&Lang=F&APATH=3&DETAIL=0&DIM=0&FL=A&FREE=0&GC=0&GID=1355241&GK=0&GRP=1&PID=113344&PRID=10&PTYPE=109445&S=0&SHOWALL=0&SUB=0&Temporal=2017&THEME=125&VID=0&VNAMEE=&VNAMEF=&D1=0&D2=0&D3=0&D4=0&D5=0&D6=0
Vivre en Ville. (2014). Étalement urbain. Repéré à https://collectivitesviables.org/articles/etalement-urbain.aspx#:~:text=L’%C3%A9talement%20urbain%20est%20un,accessibilit%C3%A9%2C%20et%20un%20urbanisme%20fonctionnaliste.
28
Illustrations et photographie de couverture : © Alexis Gagnon