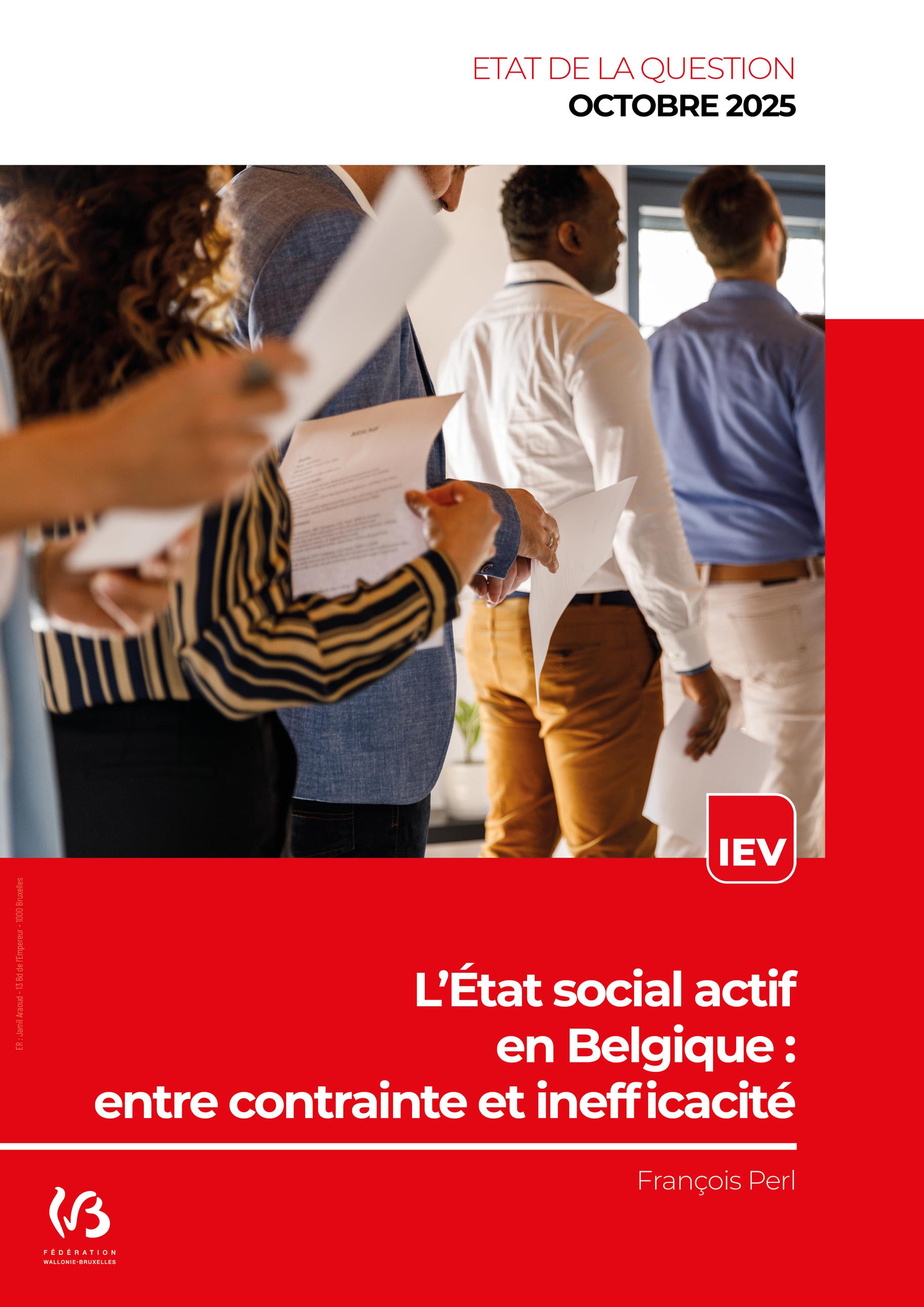
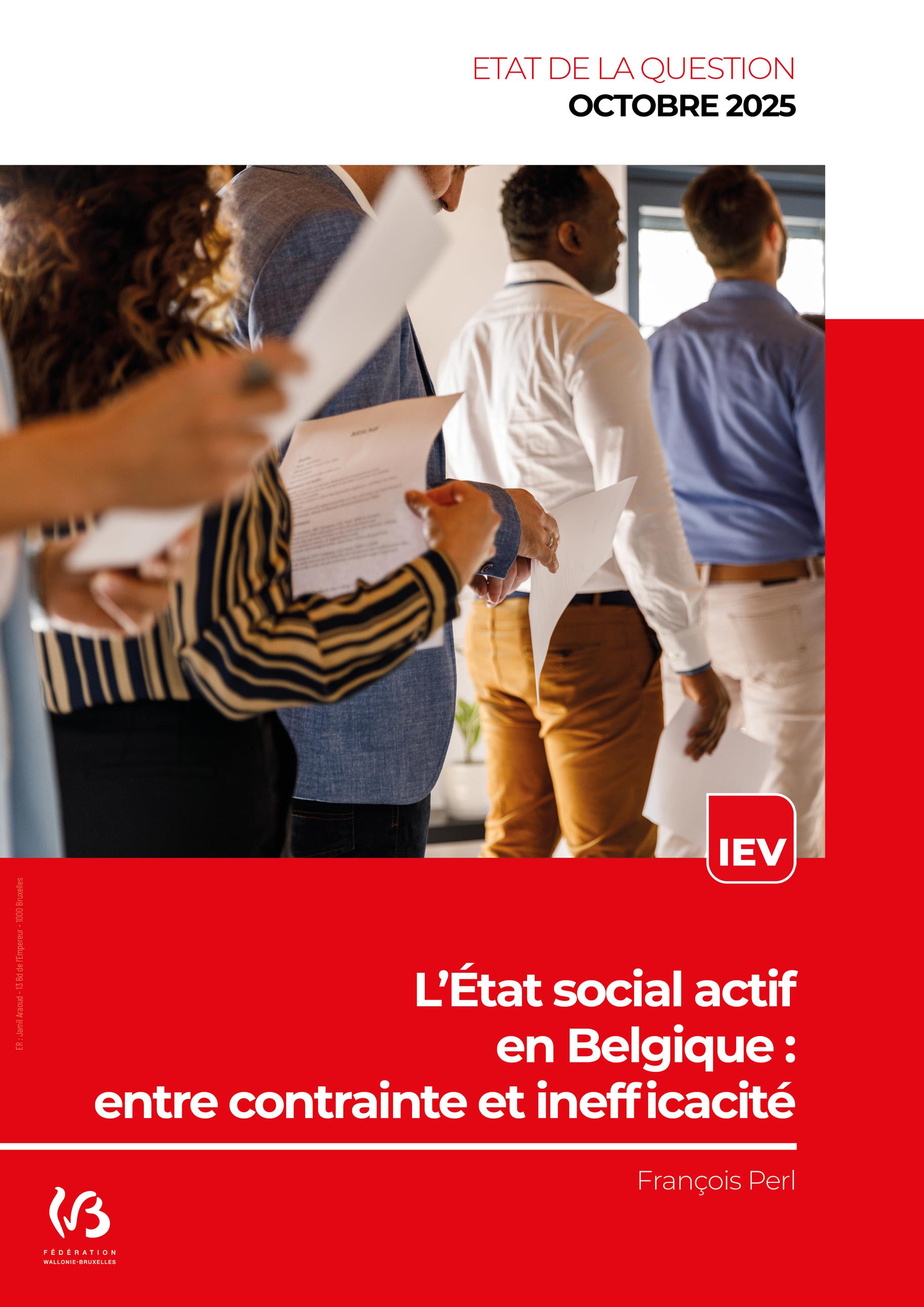
1
À l’origine de l’État social actif
La notion d’activation renvoie, dans le lexique du champ social, à une transformation profonde de notre État-providence. Cette mutation s’amorce avec les tournants austéritaires des pays industrialisés à partir des années 1970. Elle correspond à une recomposition de l’équilibre entre droits sociaux et responsabilités individuelles.
L’État-providence s’est construit autour d’une double représentation sociale : 1°/ La nécessité d’assurer les citoyens contre les aléas et risques sociaux. 2°/ La socialisation d’une partie des gains de production, au travers des cotisations sociales, redistribués sous forme de revenus de remplacement (chômage, pensions, invalidité) ou d’assurances sociales (soins de santé, accidents du travail, maladies professionnelles).
L’activation ajoute une troisième dimension à ce « diptyque » : la conditionnalité des droits sociaux. C’est un basculement fondamental, notamment pour les systèmes de sécurité sociale dits « bismarckiens ». Dans leur paradigme originel, ceux-ci reposent sur un principe assurantiel : le droit découle automatiquement de la survenance d’un risque social (perte d’emploi, maladie, accident, retraite). L’ajout de conditions vient fragiliser ce principe en liant le maintien du droit à des obligations supplémentaires.
La transformation de l’État-providence en État social actif s’opère d’abord dans le monde anglo-saxon, avec le concept de workfare importé des États-Unis et diffusé en Europe à travers la révolution conservatrice de Margaret Thatcher. L’octroi des droits sociaux y est progressivement lié à une obligation pour leurs bénéficiaires de travailler ou de se rendre « actifs » sur le marché de l’emploi.
Si la paternité idéologique du workfare revient à la droite conservatrice, son application en Europe continentale sera régulièrement portée par des partis de gauche ou de centre-gauche. La conversion idéologique à l’activation date de la fin des années 1990 et marque un moment charnière de la socialdémocratie européenne. Celle-ci rompt alors avec une de ses « fondamentaux » (concertation sociale, régulation économique, primauté du droit du travail) pour se rallier à certains principes néolibéraux. Le concept de « troisième voie », popularisé par Anthony Giddens et mis en œuvre par Tony Blair dès 1997, symbolise ce tournant.
En Belgique, les premières intégrations de l’État social actif apparaissent dès la loi organique du 8 juillet 1976 sur les CPAS, ou avec des dispositifs d’activation du chômage (ACS, ALE, programmes de transition professionnelle). Mais c’est Frank Vandenbroucke, l’actuel ministre des Affaires sociales et de la Santé, qui en devient le principal inspirateur au tournant des années 2000.
Pour Vandenbroucke, l’État-providence « passif » n’intervient qu’après la survenance du risque. L’État social actif se veut « proactif » : il investit dans les personnes et mise sur leur responsabilité individuelle. Cette logique s’étend à l’ensemble des intervenants sociaux, y compris les corps intermédiaires, désormais comptables d’obligations de moyens et parfois de résultats.
Au centre de ce modèle se trouve la notion de « piège à l’emploi » : les allocations sociales du modèle « passif » constitueraient des freins au retour vers le marché du travail. C’est pour y remédier que plusieurs réformes majeures sont introduites, notamment dans les accords de gouvernement de 1999 et 2003 :
1°/ L’activation du comportement de recherche d’emploi, la dégressivité des allocations de chômage et la réforme des allocations d’insertion.
2°/ Le parcours individuel d’intégration sociale (PIIS), encadrant strictement l’octroi du revenu d’intégration sociale.
3°/ La réforme de la réadaptation socioprofessionnelle des bénéficiaires d’indemnités d’incapacité, d’invalidité, d’accident du travail ou de maladie professionnelle (aujourd’hui connue sous le vocable du « retour au travail » des malades de longue durée).
2 L’État social actif en Belgique : un bilan
Nous l’avons vu, l’État social actif a été considéré, tant sur le plan théorique que politique, comme une manière de « sauver » les États-providence de la crise dans laquelle la fin brutale de l’essor économique des Trente Glorieuses les a plongés. Il s’agit là d’une énième application du slogan TINA (There Is No Alternative). Selon cette idée, la fin d’un État social financé par la croissance des gains de productivité implique, par définition, des réformes structurelles qui font peser les efforts de leur sauvetage sur ses usagers (et subsidiairement sur les corps intermédiaires qui ont pour mission de les mettre en œuvre sur le terrain).
Ces réformes structurelles reposent sur deux postulats et un raisonnement contestables :
1°/ La fin du « plein emploi » serait la principale cause de la crise financière de l’État social traditionnel. Sa seule voie de (re)financement reposerait sur une hausse du taux d’emploi et, par conséquent, des cotisations sociales.
2°/ Les revenus de remplacement, sans le corollaire de l’activation, décourageraient leurs bénéficiaires de retourner vers le marché du travail.
Le raisonnement sous-jacent à ces deux postulats est relativement limpide : conditionner les revenus de remplacement (allocations de chômage, d’invalidité, revenu d’intégration sociale) à des obligations de recherche d’emploi (voire même de travail) est le principal levier de « remise » à l’emploi de leurs bénéficiaires.
S’agissant du taux d’emploi, le raisonnement utilisé est simple, voire simpliste. La faiblesse récurrente de ce taux en Belgique (inférieure à la moyenne de l’UE) est utilisée comme principal indicateur justifiant toutes les politiques contraignantes en matière de remise au travail.
Cet indicateur ne donne pourtant qu’une vision statique de l’évolution de l’emploi et fausse les comparaisons internationales en ne distinguant pas emploi à temps plein et à temps partiel (dont le taux est, par exemple, notoirement plus élevé aux Pays-Bas qu’en Belgique), ou en incluant, dans d’autres pays comme l’Allemagne, des emplois sous-payés, soumis à une dérégulation complète du marché de l’emploi.
Le taux d’emploi, en Belgique, s’élevait fin 2024 à 72,3 % de la population. C’est une hausse conséquente par rapport à son niveau de 2000 (65,8 %). On pourrait en conclure que cette augmentation est le fruit des politiques d’activation mises en œuvre depuis cette date. Cette affirmation est cependant purement performative. En réalité, l’augmentation de ce taux d’emploi répond à une autre réalité : la progression de la participation des femmes au marché du travail. En effet, si le taux d’emploi des hommes est resté remarquablement stable, passant de 75,5 % en 2000 à 76,3 % en 2024, celui des femmes a augmenté de manière spectaculaire, passant sur la même période de 56 % à 68,3 %. Rien ne permet donc de conclure que l’évolution favorable du taux d’emploi en Belgique soit imputable
aux différentes réformes structurelles inspirées par l’État social actif et intervenues dans l’assurance chômage depuis 2000. Aucune évaluation de ces réformes n’a permis de conclure à leur efficacité. C’est même à des conclusions inverses qu’est arrivé l’ONEM, qui a considéré, après dix ans, que la dégressivité des allocations de chômage n’avait eu aucune conséquence notable sur le retour au travail des demandeurs d’emploi.
On peut donc tirer, à ce stade, une première conclusion : la mise en place progressive de l’État social actif n’a eu aucune incidence sur l’augmentation du taux d’emploi en Belgique et a donc essentiellement démontré son inefficacité.
Loin de décourager les partisans du workfare, ce constat ne fait qu’amplifier leur appétit pour la contrainte et la sanction des personnes sans emploi. La coalition Arizona s’est en effet lancée dans une réforme, encore plus dure que les précédentes, des allocations de chômage, en procédant, à peine installée, à leur limitation à deux années. On peut parier que, pas plus que les précédentes, cette réforme n’aura une incidence favorable sur le taux d’emploi.
À rebours de ces arguments purement idéologiques qui accompagnent le déploiement de l’État social actif, une approche rationnelle et scientifique de celui-ci tend à démontrer qu’il est non seulement globalement inefficace, en ce qu’il n’a pas eu d’impact sur l’évolution du taux d’emploi en Belgique, mais qu’il est, de surcroît, nuisible pour les bénéficiaires de la protection sociale. Ce constat, étayé depuis très longtemps par la littérature scientifique, est alimenté de manière globale par le lien entre la précarisation générée par des politiques basées sur la sanction, la dégressivité des allocations voire même l’exclusion pure et simple des dispositifs de protection sociale, et la dégradation de la santé des personnes exposées à cette précarisation.
Concernant le cas particulier des réformes menées en Belgique dans l’assurance chômage, un lien direct et causal a même été établi, par une étude scientifique très robuste, entre les politiques d’activation (principalement les contrôles du comportement actif de recherche d’emploi et les sanctions afférentes) et le basculement vers les indemnités d’incapacité de travail ou d’invalidité d’une partie des demandeurs ainsi « activés ».
3 Conclusions
L’importance du travail comme facteur d’émancipation sociale ne fait pas débat. Le droit au travail est reconnu comme un droit humain fondamental par des instruments juridiques internationaux. Mais il est urgent de mettre en question le dogme de l’État social actif. Alors qu’il inspire de nouvelles réformes plus dures encore, son inefficacité et ses effets délétères sur le bien-être et la santé des bénéficiaires sont désormais établis scientifiquement. Les politiques de sanction et de dégressivité fragilisent davantage qu’elles n’émancipent. Loin de sauver l’État-providence, elles risquent de miner sa légitimité sociale.
4 Bibliographie
Pierre Rosanvallon, La crise de l’État-providence, Paris, Seuil, 1981.
Robert Castel, Les métamorphoses de la question sociale, Paris, Fayard, 1995.
Gøsta Esping-Andersen, The Three Worlds of Welfare Capitalism, Princeton University Press, 1990.
Lawrence Mead, Beyond Entitlement: The Social Obligations of Citizenship, New York, Free Press, 1986.
Bruno Palier, Gouverner la sécurité sociale, Paris, PUF, 2002.
Anthony Giddens, The Third Way. The Renewal of Social Democracy, Cambridge, Polity Press, 1998.
Loi organique des CPAS du 8 juillet 1976, Moniteur belge, 5 août 1976.
Frank Vandenbroucke, « L’État social actif », discours au Centre Jean Gol, 2000.
Frank Vandenbroucke, Social Justice and Individual Ethics in an Open Society, Springer, 2001.
Gouvernement fédéral belge, Accords de gouvernement, 1999 et 2003.
Pierre Rosanvallon, La nouvelle question sociale, Paris, Seuil, 1995.
Margaret Thatcher, discours à la Conservative Party Conference, 1980.
Bruno Palier et Claude Martin, Réformer les systèmes de protection sociale, Paris, PUF, 2007.
Eurostat, Employment and activity by sex and age – annual data, 2024.
Bea Cantillon, « The Paradox of the Social Investment State », Journal of European Social Policy, 2011.
ONEM, Évaluation de la dégressivité des allocations de chômage, Rapport interne, 2013.
Kristof De Witte et al., « Activation Policies and Disability Insurance Inflows: Evidence from Belgium », Labour Economics, vol. 65, 2020.
Organisation internationale du Travail, Convention n°122 sur la politique de l’emploi, 1964.
David Garland, The Culture of Control, Oxford University Press, 2001.
