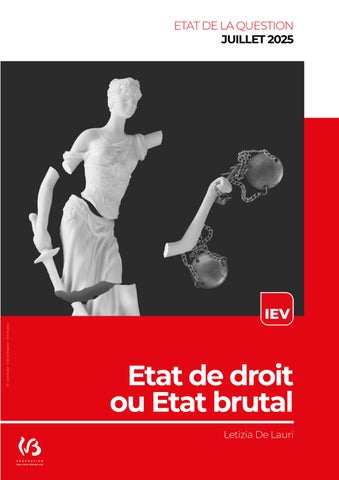DANS LA MÊME COLLECTION / ETAT DE LA QUESTION IEV
www.iev.be
L’offre équilibrée d’enseignement supérieur : agir pour un meilleur accès
Bérenger AMELOOT
Salles de consommation à moindre risque : une vraie bonne idée !
Martin JOACHIM
Le P.O.B. et le service militaire - Des origines jusque 1928
Samuel VAN CROMBRUGGE
L’immersion linguistique : pour qui et pourquoi ?
Bérenger AMELOOT
Vers un impôt européen sur la grande fortune : fondements et modalités
Juliette DELACROIX
Interdire TikTok, bonne ou mauvaise idée ?
Gauthier HANSEL
Désinformation : comment la Russie mène la guerre à nos démocraties ?
Gauthier HANSEL
Jean De Nooze (1923-2023), « L’homme du syndicat »
Joffrey LIÉNART
Inégalités sociales et politiques de mobilités : le cas de la taxe kilométrique Smartmove à Bruxelles
François PERL
Climat et santé : une urgence partagée
Wissal SELMI
Paysage institutionnel intra-francophone et perspectives de réforme
Letizia DE LAURI
Les enjeux actuels de du budget de l’assurance-maladie
François PERL
Travail et santé : le cas de l’invalidité en Belgique
François PERL
La Belgique, actrice de l’autonomie stratégique européenne ?
Maxime Leclercq-Hannon
Institut Emile Vandervelde Boulevard de l’Empereur 13 1000 Bruxelles www.iev.be
SOMMAIRE
1. Introduction 1
2. L’État de droit : notion et contours 3
2.1 L’État de droit : définition 3
2.2 Pas d'État de droit sans justice indépendante et impartiale 4
3. Les critiques de l’État de droit formulées par les courants réactionnaires 6
3.1 L’exemple des États-Unis. 6
3.2 L’actualité en France (condamnation de Marine Le Pen) 7
3.3 Le cas de l’Italie. 8
3.4 L’exemple de la Belgique 10
3.5 La lettre du 22 mai 2025 signée par neuf États et adressée à la Cour européenne des droits de l’homme 12 4. Conclusion 13
Biographie de l’auteure
Letizia De Lauri est juriste expert notamment des questions constitutionnelles et des droits fondamentaux auprès de l’Institut Emile Vandervelde
1. Introduction
Nos démocraties représentatives occidentales sont aujourd’hui à un moment charnière. Les valeurs de la démocratie sont remises en cause et, au lieu de défendre l’ensemble des composantes de la société, différents courants propagent un sentiment de rejet en vue d’exclure certaines catégories de la population.
Dans ce contexte, la défense de l’État de droit revêt une importance fondamentale. L’État de droit se fonde sur la primauté du droit sur le pouvoir politique. Une fois les institutions politiques établies, le respect de l’ordre juridique devient un impératif pour garantir la cohérence d’un État, et le respect des droits et libertés fondamentaux et de la démocratie.
L’État de droit repose ainsi sur une volonté de contenir le pouvoir étatique. À ses origines, ce concept s’inscrit dans la perspective suivante : l’État est conçu comme un garant des libertés, dont l’intervention doit rester limitée. Deux instruments principaux assurent cette limitation : la reconnaissance des droits fondamentaux et l’adhésion aux principes démocratiques. La première vise à protéger l’individu contre l’arbitraire ; la seconde repose sur l’idée que l’État tire sa légitimité de la volonté générale, ce qui le soumet à la nation.
Un pays démocratique ne peut exister sans être un État de droit. Dans un tel système1 :
• Les responsables politiques sont élus lors d'élections libres et transparentes ;
• Les pouvoirs judiciaire, exécutif et législatif sont indépendants les uns des autres ;
• Tous les individus, qu’ils soient personnes physiques ou morales (comme les associations ou les entreprises), sont égaux devant la loi ;
• L’État lui-même respecte les règles de droit ;
• Parfois, ces règles imposent à l’État de garantir certaines libertés fondamentales, souvent appelées droits humains ;
• Les gouvernants sont tenus responsables de leurs actions.
La justice est l'un des piliers de l'État de droit. Son rôle est de veiller à ce que les lois sont respectées et appliquées. Cela se fait à travers des procès, au terme desquels des jugements peuvent condamner les personnes qu'elles soient des citoyens ou des institutions de l'État pour manquement aux règles juridiques. Un ministre, par exemple, peut être jugé et sanctionné s’il agit en dehors des limites fixées par la loi.
Mais la justice a également une autre fonction primordiale : elle veille à ce que les lois ellesmêmes respectent les principes fondamentaux de l’État de droit, comme l'égalité devant la loi et la garantie des libertés publiques.
Dans des entretiens accordés au journal Le Monde, de hauts magistrats du Conseil d’État et de la Cour de cassation français témoignent de leurs inquiétudes face aux attaques dont sont victimes les principes juridiques mis en place en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils dénoncent la remise en cause de la culture démocratique, qui a été construite depuis lors
1 Jean De Munck « Les juges et l’État de droit », 10 février 2023 (Presse La Libre) et disponible sur https://www.questionsjustice.be/Les-juges-et-l-Etat-de-droit
autour de l’idée que les parlementaires et les gouvernements devaient respecter des valeurs et des principes supérieurs aux lois nationales – une des leçons tirées de la montée du fascisme durant la première moitié du xxe siècle.
Le professeur de droit constitutionnel français Dominique Rousseau2 souligne la gravité de l’époque : « Nous sommes dans un moment historique où il y a une tension entre deux formes d’État : l’État de droit, où être élu par le peuple ne suffit pas ; l’État brutal, comme on le voit avec Trump, où l’élection est censée donner tous les droits. »
Face à l’incrédulité et aux inquiétudes qui saisissent le monde occidental depuis l’entrée en fonction de Donald Trump aux États-Unis ; face aux attaques, qui pleuvent de tous côtés, l’État de droit, ce principe fondamental, essentiel et pourtant si fragile, est devenu une cible dans un grand nombre de démocraties, y compris en Europe.
La présente analyse s’ancre dans l’actualité. Elle a pour objet d’étudier la notion d’État de droit et d’examiner la nécessité d’une justice indépendante et impartiale pour en assurer le bon fonctionnement (I). Elle s’intéressera aux différentes remises en cause de ce principe, observées dans plusieurs pays dont la Belgique (II). Elle se conclura par une analyse critique des enjeux contemporains, soulignant les risques que représente l'affaiblissement de l’État de droit dans un contexte où les valeurs démocratiques sont de plus en plus fragilisées (III).
2 « Il ne faudrait pas découvrir la valeur de l’Etat de droit une fois perdu » : l’alerte de hauts magistrats français, Propos recueillis par Luc Bronner Publié le 7 mars 2025 dans le journal Le Monde disponible sur https://www.lemonde.fr/politique/article/2025/03/07/il-ne-faudrait-pas-decouvrir-la-valeur-de-l-etat-de-droit-une-fois-perdu-lalerte-de-hauts-magistrats-francais_6576867_823448.html
2. L’État de droit : notion et contours
2.1 L’État de droit : définition 3
L’application du système de l'État de droit est souvent considérée comme un principe incontesté, indissociable de l’organisation politique des sociétés démocratiques. L’État de droit implique que les gouvernants n’ont pas une autorité absolue mais exercent une fonction encadrée par la loi. Il repose à la fois sur une dimension formelle, à travers un ordre juridique hiérarchisé et le contrôle d’un juge indépendant, et sur une dimension substantielle, reposant sur la reconnaissance de droits fondamentaux et les fondements de la démocratie.
Au fil de son évolution, l'État de droit a connu un processus d’élargissement et d’approfondissement. D’un côté, le renforcement du contrôle juridictionnel, notamment sur le respect des constitutions, a perfectionné son architecture formelle. De l’autre, l’intégration de normes internationales et régionales dans la hiérarchie juridique a élargi son champ d'application, en parallèle avec un développement continu des droits fondamentaux protégés par des garanties juridiques accrues. À partir des années 1980, le concept de l'État de droit a acquis une portée mondiale, devenant un standard international auquel les États sont invités à se conformer. Dès lors, l'État de droit semblait inébranlable et universel, à l’abri de toute remise en cause.
L’État de droit, la démocratie et la souveraineté sont intimement liés, notamment en ce qui concerne la souveraineté populaire. Les enseignements de la philosophie politique et de l’histoire convergent pour démontrer qu’il ne peut y avoir de véritable démocratie ni de souveraineté populaire sans un État de droit respectant une séparation des pouvoirs4
3 Maxim Smets, International Rule of Law through the lens of the United Nations, 2019 disponible sur https://law.kuleuven.be/ltjb/international-rule-of-law-through-the-lens-of-the-united-nations/?utm_source=chatgpt.com
4 Jean-Marc Sauvé, « L’État de droit aujourd’hui », RDLF 2024, chron. n°62 disponible sur https://revuedlf.com/droitfondamentaux/letat-de-droit-aujourdhui/
2.2 Pas d'État de droit sans justice indépendante et impartiale5
Les progrès de l’État de droit sont non seulement liés aux avancées politiques et aux libertés publiques, telles que le suffrage universel et la liberté individuelle, mais dépendent également de la capacité du système judiciaire à jouer pleinement son rôle.
Juger n’est pas un acte mécanique. Ce n'est pas une simple application de règles, ni une exécution aveugle d'ordres. Juger, c'est intervenir chaque jour dans la vie des individus, afin de résoudre les conflits qui surgissent dans des domaines variés. C'est un acte d'apaisement, d'équilibre, de protection. C’est aussi l’effort de restaurer une justice parfois mise à mal et de réparer ce qui peut l'être. C’est veiller au respect des droits et des libertés de chacun, soutenir les plus vulnérables, et se dresser face aux injustices et aux déséquilibres dans une société en constante mutation. Face à ce tumulte, le juge rétablit un peu d'ordre, sans bruit, mais avec rigueur, discernement et dévouement6 .
Lors d’un colloque de Réf-Lex tenu le 20 mai 2025 au Parlement de la Fédération WallonieBruxelles et intitulé : « La démocratie, l'État de droit et le juge, des alliés inséparables7 ». Françoise Tulkens, ancienne juge belge à la Cour européenne des droits de l’homme, a mis en avant le fait que la démocratie ne se résume pas au suffrage universel. Elle exige aussi le respect du droit. Le droit, en effet, limite l’exercice du pouvoir et c’est dans cette capacité à encadrer le politique que réside la force de l’État de droit. Françoise Tulkens a souligné que les juges sont les gardiens des promesses inscrites dans la loi. Leur légitimité ne s’oppose pas à celle des élus, mais la complète. Ils sont les protecteurs des droits fondamentaux, veillant à ce que la démocratie demeure vivante et juste.
Elle a également insisté sur la nécessité d’une législation de qualité : générale, claire, stable, cohérente, non rétroactive et appliquée avec rigueur. Enfin, elle a mis en avant l’importance d’articuler l’État de droit avec la justice sociale. Sans équité ni inclusion, le droit perd sa légitimité, et la démocratie se voit dévitalisée.
Dans un article intitulé « Justice et démocratie : un binôme inséparable », Maria-Rosaria Guglielmi8 explore la relation intrinsèque entre justice et démocratie, et souligne que cette articulation constitue une clé de lecture essentielle pour comprendre les défis contemporains auxquels sont confrontés les systèmes judiciaires. La justice, en tant que pilier de la démocratie, est à la fois garante des droits fondamentaux et actrice de transformation sociale.
Elle est appelée à répondre à des attentes croissantes en matière de légalité, d’impartialité et de protection contre l’arbitraire, tout en étant confrontée à des contextes de régression démocratique, de conflits armés et de résurgence de régimes autoritaires.
5 Julie Allard, « La justice, pouvoir et contre-pouvoir démocratique », in e-legal, Revue de droit et de criminologie de l’ULB, Volume 7, février 2023.
6 Thierry Weerts, « Dans cette chasse aux juges, c'est l'État de droit qu'on blesse en plein cœur », 19 mai 2025, disponible sur https://www.lalibre.be/debats/opinions/2025/05/19/dans-cette-chasse-aux-juges-cest-letat-de-droit-quon-blesse-en-plein-coeurTTZGCF4EXBDNLADJ75BWQ6QLRQ/
7 https://www.pfwb.be/actualites/ref-lex-14-democratie-etat-de-droit-et-role-du-juge-des-piliers-indissociables
8 Mariarosaria Guglielmi « Justice et démocratie : un binôme inséparable », revue TraHs (2023)
L’auteure insiste sur le fait que la justice ne peut être dissociée des principes démocratiques, notamment en ce qui concerne l’indépendance des juges, leur responsabilité, l’accès équitable à la justice et la transparence de son fonctionnement. Toutefois, cette fonction de garantie des droits place la justice dans une position délicate : elle est perçue tantôt comme un rempart contre les abus du pouvoir, tantôt comme un obstacle à la souveraineté populaire, notamment dans les discours populistes qui exigent des juges qu’ils se conforment à la volonté majoritaire.
3. Les critiques de l’État de droit formulées par les courants réactionnaires
La montée en puissance des juges, initialement garants du respect du droit, suscite des critiques sévères de plusieurs dirigeants conservateurs et de droite, tant au niveau national qu'international. Pour ces courants politiques, l’extension de la compétence des juridictions internationales, comme la Cour européenne des droits de l'homme, limite la souveraineté des États. Parallèlement, ces courants politiques de droite considèrent que le pouvoir des juges s’est accru et qu’il exerce une trop grande influence sur le processus législatif, se rapprochant du spectre d’un « gouvernement des juges »
La vision de ces partis politiques entre aussi en collision avec la consécration des droits fondamentaux qui sont souvent interprétés et étendus par les juges. Pour eux, les droits de l'homme, dont l’extension a été renforcée, deviennent un carcan pour l’État, l’empêchant de prendre des « décisions efficaces en matière de sécurité ou d’immigration ».
3.1 L’exemple des États-Unis9 .
Depuis son retour à la présidence, le 20 janvier 2025, Donald Trump multiplie les décisions controversées, souvent en rupture avec les principes fondamentaux de la Constitution américaine. En quelques mois, il a signé plus de 110 décrets, dont plusieurs ont été jugés illégaux ou anticonstitutionnels. Parmi eux, des mesures telles que le licenciement massif de fonctionnaires, le gel de financements publics, ou encore la tentative de suppression du droit du sol sans passer par un amendement constitutionnel. Ces décisions ont immédiatement suscité une vague de recours en justice, invoquant un « préjudice irréparable » pour justifier une intervention judiciaire rapide.
Face à ces attaques contre l’ordre juridique, une soixantaine de juges ont déjà annulé certaines mesures, ordonnant notamment la réintégration de fonctionnaires injustement évincés et la levée du gel de fonds destinés à des agences publiques. Ces décisions ont déclenché une campagne de dénigrement virulente orchestrée par l’administration Trump et ses soutiens, visant à discréditer les magistrats, y compris ceux nommés par des présidents républicains. Les attaques se sont intensifiées sur les réseaux sociaux, dans les médias conservateurs et sur des plateformes d’extrême droite, transformant les juges en cibles politiques.
Le cas du juge Engelmayer illustre cette dérive : faussement accusé de tentative de « coup d’État » pour avoir limité l’accès d’Elon Musk à des données sensibles, il a été violemment pris à partie, y compris par Musk lui-même. Cette stratégie de délégitimation du pouvoir judiciaire s’inscrit dans une logique autoritaire, où toute opposition est perçue comme une trahison. Le vice-président J.D. Vance a même invoqué Andrew Jackson pour justifier une forme de désobéissance aux décisions de justice, une posture dangereuse dans un État de droit.
9 Anne E. Deysine, « Les excès de pouvoir de Donald Trump : la justice peut-elle être la solution ? », 14 avril 2025, disponible sur https://www.justice-en-ligne.be/Les-exces-de-pouvoir-de-Donald
Trump et ses alliés cherchent à retourner la logique démocratique : ce ne serait plus l’exécutif qui bafoue la Constitution, mais la justice qui serait accusée d’entraver la « volonté du peuple », bien que Trump ait été élu avec moins de 50 % des suffrages. Cette rhétorique vise à affaiblir les contre-pouvoirs, en s’appuyant sur une base militante radicalisée et des canaux d’information biaisés. Elle rappelle les tentatives historiques de contournement du pouvoir judiciaire, comme celle de Roosevelt face à une Cour hostile au New Deal, mais sans les gardefous institutionnels qui avaient alors prévalu.
Les menaces de destitution proférées contre des juges, comme Curiel en 2017 ou Engoron en 2023, sont particulièrement alarmantes. La procédure de destitution est censée être réservée à des cas extrêmes, tels que la trahison ou la corruption, et non utilisée comme arme politique contre des décisions judiciaires défavorables. Le président de la Cour suprême, John Roberts, a rappelé que les désaccords doivent être tranchés par le droit, non par l’intimidation ou la violence verbale. Il a souligné que les juges ne sont pas les représentants d’un camp politique, mais les garants impartiaux de la loi.
Cette crise révèle une faiblesse structurelle du pouvoir judiciaire, que les Pères fondateurs avaient déjà identifiée : dépourvu de moyens coercitifs et de budget propre, il dépend du respect volontaire de ses décisions par l’exécutif. Si ce dernier choisit de les ignorer, les marges de manœuvre sont limitées. La Cour suprême, prudente, a parfois validé les décisions de Trump sur des bases procédurales, ce que l’administration a présenté comme des victoires politiques. Quant au Congrès, largement dominé par les alliés de Trump, il commence à réagir non par souci constitutionnel, mais sous la pression d’un électorat inquiet des conséquences économiques : inflation, chute des marchés, disparition de services publics.
3.2 L’actualité en France (condamnation de Marine Le Pen) 10
Le 31 mars 2025, Marine Le Pen a été condamnée par le tribunal correctionnel de Paris à quatre ans d’emprisonnement, dont deux ans ferme aménageables, ainsi qu’à cinq ans d’inéligibilité avec exécution provisoire, pour détournement de fonds publics dans l’affaire dite des assistants parlementaires européens du Rassemblement national. L’ancienne candidate à la présidentielle a immédiatement dénoncé une « tyrannie des juges », contestant la légitimité du verdict et relayant, avec le soutien d’une grande partie de la presse d’extrême droite, un discours complotiste assimilant la justice à un instrument de persécution politique.
Cette posture illustre une stratégie bien connue des mouvements populistes contemporains : la remise en cause systématique des faits, la délégitimation des institutions judiciaires, et la production d’une vérité « alternative » détachée du droit. À la manière de figures comme Donald Trump ou Jair Bolsonaro, Marine Le Pen tente de déplacer le débat du terrain judiciaire vers celui de la victimisation politique. Une telle rhétorique, largement médiatisée, tend à affaiblir la perception publique de l’indépendance de la justice et à miner les fondements mêmes de l’État de droit.
10 A. Levade, « L'État de droit-cadre juridique de la démocratie », Interview sur France Inter du 31 mars 2025 disponible sur https://www.radiofrance.fr/franceinter/podcasts/zoom-zoom-zen/zoom-zoom-zen-du-lundi-07-avril-2025-6180080
Le discours tenu par les responsables du Rassemblement national à la suite du jugement manifeste une radicalisation inquiétante. Loin de la stratégie de « dédiabolisation » longtemps revendiquée, le parti d’extrême droite a réactivé des discours conspirationnistes sur un prétendu « système » visant à exclure ses représentants de la compétition électorale. Les menaces verbales contre les magistrats, les accusations de manipulation judiciaire, ainsi que l’invocation récurrente d’un « coup d’État institutionnel » constituent une atteinte directe aux principes de la démocratie constitutionnelle.
Or, cette condamnation ne procède en rien d’une justice d’exception. Elle illustre au contraire l’application du principe constitutionnel d’égalité devant la loi, fondement de toute démocratie libérale. L’État de droit repose sur la soumission de tous gouvernés comme gouvernants à la loi, et sur le respect des décisions juridictionnelles, même lorsqu’elles visent des figures de premier plan. Depuis les années 1990, la moralisation de la vie publique en France a renforcé les exigences d’exemplarité à l’égard des élus. À ce titre, la sanction prononcée ne saurait être interprétée comme une attaque politique, mais bien comme la conséquence d’une infraction grave, établie à l’issue d’un long processus judiciaire ouvert et contradictoire.
Cette affaire dépasse la seule responsabilité pénale d’une élue. Elle met en lumière les tensions entre le respect des garanties fondamentales du procès pénal et les exigences démocratiques de probité, dans un contexte où le pouvoir judiciaire est de plus en plus pris pour cible par les forces populistes. La réaction des institutions, fondée sur l’indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs, constitue la meilleure réponse à cette tentative de déstabilisation de l’État de droit.
3.3 Le cas de l’Italie11 .
Depuis plus de trente ans, l’Italie connaît une confrontation chronique entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, mais ce conflit semble avoir atteint un nouveau seuil d’intensité sous le gouvernement de Giorgia Meloni. Ce dernier a récemment adopté, en Conseil des ministres, une réforme constitutionnelle portée par le ministre de la Justice Carlo Nordio, présentée comme une avancée en faveur d’un meilleur équilibre entre les droits de la défense et ceux de l’accusation. Cette réforme, encensée par les milieux conservateurs comme une réponse au prétendu « pouvoir excessif » des juges, s’inscrit en réalité dans une longue tradition d’hostilité politique envers la magistrature, remontant aux attaques orchestrées par Silvio Berlusconi contre les « juges rouges » dans les années 1990.
Derrière le vernis d’une rationalisation du système judiciaire, c’est bien une entreprise de marginalisation du pouvoir judiciaire qui se dessine. La tentative de redéfinir les équilibres institutionnels prend ici la forme d’une réforme de structure, qui vise à soumettre davantage les magistrats au contrôle de l’exécutif sous couvert de restaurer la « neutralité » du juge. Ce discours de réforme est d’autant plus inquiétant qu’il s’accompagne, dans les faits, de décisions qui piétinent les garanties fondamentales du droit.
L’expulsion récente d’Osama Almasri Najim, chef de la police libyenne soupçonné de crimes contre l’humanité, illustre de manière flagrante cette dérive. En procédant à cette expulsion avant même qu’une décision judiciaire ne soit rendue, le gouvernement italien a bafoué non
11 https://www.lesechos.fr/monde/europe/en-italie-giorgia-meloni-en-guerre-ouverte-contre-les-juges-2145418
seulement le principe du contradictoire et du droit au recours, mais aussi les obligations internationales de l’Italie en matière de justice pénale internationale. Le fait que Najim ait été accueilli en héros en Libye ne fait que souligner l’ampleur du scandale. Cette affaire n’est pas un simple dysfonctionnement administratif : elle signale une volonté politique de contournement du pouvoir judiciaire dès lors qu’il gêne les objectifs de l’exécutif.
Plus préoccupant encore est le ton utilisé par les autorités à l’égard des magistrats. Les accusations de « chantage » lancées contre certains juges, ainsi que la tentative de discréditer toute voix critique venue du corps judiciaire, traduisent une volonté d’intimidation et de délégitimation inacceptable dans une démocratie. Cette stratégie de polarisation, calquée sur les méthodes populistes d’autres dirigeants européens ou américains, participe d’un rétrécissement inquiétant de l’espace démocratique.
Dans ce climat de confrontation permanente, la magistrature italienne est de plus en plus décrite par les dirigeants politiques comme un obstacle à la souveraineté populaire, réduite à un corps corporatiste défendant ses privilèges. Cette vision simplificatrice nie la fonction fondamentale du juge dans un État de droit : garantir les libertés publiques et faire respecter les règles communes, y compris – et surtout – contre les abus de pouvoir. Lorsque les magistrats deviennent les cibles de campagnes de dénigrement orchestrées par l’exécutif, c’est l’équilibre des pouvoirs lui-même qui vacille.
L’Italie se trouve ainsi à la croisée des chemins. D’un côté, une logique autoritaire qui cherche à soumettre l’appareil judiciaire à la volonté de l’exécutif, au nom d’une légitimité électorale brandie comme supérieure à toute autre forme de légitimité. De l’autre, une tradition juridique enracinée dans la séparation des pouvoirs et le respect des engagements internationaux, notamment en matière de droits fondamentaux et de coopération avec les juridictions supranationales.
3.4 L’exemple de la Belgique
Au cours de la dernière décennie, la Belgique a été à plusieurs reprises condamnée pour des violations des droits humains, mettant en lumière des défaillances structurelles persistantes dans le respect de l’État de droit. Parmi les problématiques les plus préoccupantes figurent la surpopulation carcérale, l’arriéré judiciaire chronique, la crise de l’accueil des demandeurs d’asile, ainsi que le non-respect récurrent des décisions de justice dans divers domaines.
La Belgique affiche un retard notable dans l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), avec un délai moyen de mise en conformité de trois ans et cinq mois. Les condamnations pour durée excessive des procédures civiles (2008) et pénales (2019), ainsi que pour la surpopulation carcérale (2014), illustrent l’ampleur du problème. Ces retards compromettent le droit à un procès équitable et les conditions de détention dignes.
Depuis plus de deux ans, des milliers de demandeurs d’asile se retrouvent sans solution d’hébergement, en violation de leurs droits. En juillet 2023, la CEDH a condamné la Belgique pour son incapacité systémique à exécuter les décisions judiciaires relatives à l’accueil des demandeurs de protection internationale. Le Conseil d’État a également suspendu une décision politique discriminatoire à l’égard des hommes seuls, sans que cela n’entraîne de changement de politique12 Les manquements de l’État belge s’étendent à d’autres secteurs. Le gouvernement wallon a poursuivi l’exportation d’armes vers l’Arabie Saoudite malgré plusieurs décisions judiciaires contraires.
Le 24 juillet 2024, la Commission européenne a publié son rapport annuel sur l’État de droit dans chaque pays de l’Union européenne13. Ce rapport évalue les progrès réalisés, les défis persistants et formule des recommandations.
La Commission européenne exprime de vives inquiétudes concernant le non-respect systématique des décisions de justice en Belgique, y compris celles de la Cour européenne des droits de l’homme14 L’accueil des demandeurs d’asile constitue un point de tension majeur : malgré plusieurs condamnations du tribunal du travail de Bruxelles, de nombreuses décisions restent inappliquées, aggravant ainsi la situation. La Commission européenne enjoint la Belgique à garantir l'exécution de toutes les décisions de justice, condition indispensable au respect de l’État de droit.
En janvier 2025, la directrice de l’Institut fédéral des droits humains (IFDH), Martien Schotsmans, a exprimé devant la commission Justice de la Chambre des représentants ses préoccupations concernant le respect de l’État de droit en Belgique. Elle a rappelé que le respect des droits humains et des principes démocratiques fondamentaux, comme l’indépendance du
12 Institut Fédéral pour les Droits Humains, « État de droit : le double standard de la Belgique », 2 février 2024, disponible sur https://federaalinstituutmensenrechten.be/fr/etat-de-droit-le-double-standard-de-la-belgique
13 https://commission.europa.eu/document/download/27db4143-58b4-4b61-a021a215940e19d0_en?filename=1_1_58120_communication_rol_en.pdf
14 Commission européenne, Rapport 2024 sur l’État de droit dans les pays de l’Union européenne - chapitre spécifique concernant la situation en Belgique, 24 juillet 2024, disponible sur https://commission.europa.eu/document/download/ac09a9ad63c4-4c65-bf36-d032b605a015_en?filename=7_1_58050_coun_chap_belgium_en.pdf
pouvoir judiciaire, est essentiel pour garantir l’égalité des chances et la protection de toutes et tous. Or, ces principes sont souvent remis en question dans notre pays15 .
L’IFDH a notamment dénoncé le non-respect répété de décisions judiciaires par les autorités publiques. Le cas le plus emblématique est celui du refus persistant de l’État belge de fournir un hébergement aux demandeurs d’asile, malgré plus de 10 000 condamnations judiciaires.
L’IFDH a épinglé que le système judiciaire belge souffre par ailleurs d’un sous-financement chronique. Le budget alloué à la justice et le nombre de magistrats par habitant restent inférieurs à la moyenne européenne. Cette situation entraîne des retards importants dans le traitement des affaires, en particulier dans les tribunaux de la famille, où les délais peuvent atteindre plusieurs années.
L’IFDH alerte également sur la réduction de l’espace civique en Belgique. Une enquête menée auprès de 159 organisations de défense des droits humains révèle que 55 % d’entre elles ont déjà été victimes d’intimidation ou de menaces. Les organisations travaillant sur le racisme, les migrations ou les droits des personnes LGBTQIA+ sont particulièrement ciblées.
Face à ces constats, l’IFDH a appelé les parlementaires à agir. Il recommande notamment d’organiser une audition sur le non-respect des décisions judiciaires, d’augmenter les moyens alloués à la justice, et de garantir un espace sûr et libre pour les organisations de la société civile.
L’accord de gouvernement Arizona a également mis en avant une volonté de revoir le statut des magistrats et leur régime de retraire. Cela s’ajoute à un déficit structurel de financement de la Justice dans notre pays. Or, remettre en cause le statut des juges et le financement de la Justice, c’est alimenter aussi la volonté d’absence de contrôle et de contre-pouvoir face aux décisions politiques et cela génère des dérives contre la démocratie.
Le respect de l’État de droit est un pilier fondamental de la démocratie, et il est urgent que les autorités belges prennent leurs responsabilités pour assurer la protection effective des droits humains.
15 https://www.institutfederaldroitshumains.be/fr/lifdh-preoccupe-par-le-respect-de-letat-de-droit-en-belgique
3.5 La lettre du 22 mai 2025 signée par neuf États et adressée à la Cour européenne des droits de l’homme 16
Dans une lettre ouverte rendue publique récemment, la Belgique et huit autres pays européens, principalement dirigés par des partis conservateurs ou d’extrême droite, ont exprimé leur volonté de revoir l’interprétation actuelle de la Convention européenne des droits de l’homme, qu’ils jugent trop contraignante en matière de politique migratoire. Cette lettre a été signée par les chefs de gouvernement de l’Italie, de l’Autriche, du Danemark, de l’Estonie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la République tchèque, ainsi que par le Premier ministre belge, Bart De Wever (N-VA).
Ces dirigeants estiment que la Cour européenne des droits de l’homme, chargée d’interpréter et de faire respecter la Convention de 1953, va aujourd’hui au-delà de son mandat initial. Ils dénoncent ce qu’ils perçoivent comme un déséquilibre entre la protection des droits fondamentaux des individus – y compris des migrants en situation irrégulière – et la capacité des États à faire appliquer leurs propres décisions politiques, notamment en matière d’expulsion des personnes étrangères condamnées pour des délits graves.
Bien que les entrées irrégulières dans l’Union européenne soient en baisse, les signataires de la lettre mettent en avant la nécessité de disposer d’une plus grande « marge de manœuvre » nationale pour expulser les ressortissants étrangers auteurs de crimes, en particulier les faits de violence ou de trafic de drogue. Ils accusent certaines décisions de la CEDH d’entraver leur action et affirment que l’interprétation actuelle de la Convention ne correspond plus aux réalités contemporaines de la migration dans un monde globalisé.
La Cour, pourtant, a rappelé à plusieurs reprises que ses arrêts s’imposent aux 46 États signataires de la Convention et que ses juges, bien que désignés par les États, agissent en toute indépendance.
La contestation n’est pas nouvelle. Ces dernières années, la Cour européenne des droits de l’homme s’est penchée sur plusieurs dossiers sensibles liés au traitement des migrants : conditions de détention, pratiques illégales aux frontières, restrictions au regroupement familial. En réponse, certains États, comme l’Italie, ont tenté d’élaborer des dispositifs contournant le cadre conventionnel. Le cas le plus emblématique est celui des centres de détention de migrants installés en Albanie, issus d’un accord entre Rome et Tirana en novembre 2023. Opérationnels depuis octobre 2024, ces centres ont fait l’objet de décisions judiciaires contraignantes : des juges italiens ont refusé de valider la détention des premiers transferts, les renvoyant vers l’Italie, en invoquant notamment la jurisprudence européenne.
La démarche des neuf pays s’apparente donc à une tentative de pression politique sur une juridiction indépendante. Certains observateurs, dont la Ligue des droits humains (LDH), y voient une atteinte grave à l’État de droit. « Cette lettre ouverte engage la Belgique dans une voie dangereuse, celle d’une remise en cause de la primauté des droits humains dans nos démocraties », alerte Sibylle Gioe, présidente de la LDH. Elle rappelle que même les personnes ayant commis des crimes doivent bénéficier des garanties fondamentales, et que toute tentative de les en priver constitue une régression majeure.
16 https://www.rtbf.be/article/migration-et-expulsions-bart-de-wever-a-l-abordage-de-la-cour-europeenne-des-droits-de-l-homme11551303
4. Conclusion
La justice s’impose aujourd’hui comme un pilier central et structurant de la démocratie libérale, bien au-delà de son rôle traditionnel d’arbitre des litiges. À l’intersection du droit et du politique, elle incarne un pouvoir à part entière, qui s’est affirmé au fil des décennies comme garant des normes fondamentales, notamment grâce au développement du contrôle de constitutionnalité, à la reconnaissance de la primauté du droit international, et à l’instauration d’un dialogue transnational entre juridictions nationales et européennes. Cette montée en puissance du pouvoir judiciaire, bien qu’elle suscite parfois des critiques dénonçant un « gouvernement des juges », constitue une réponse institutionnelle essentielle aux risques de dérives autoritaires et de concentration excessive des pouvoirs.
Le juge n’est pas seulement un acteur institutionnel, il est aussi devenu un recours pour les citoyens, les minorités et les mouvements sociaux dans des contextes où les mécanismes de représentation politique peinent à répondre aux exigences de justice sociale, climatique ou encore de transparence démocratique. Le phénomène de judiciarisation des enjeux politiques, s’il peut susciter des interrogations sur la légitimité démocratique des décisions judiciaires, est également le reflet d’une exigence croissante de justiciabilité des droits. Par le biais du contentieux stratégique ou encore des actions collectives, la justice devient un espace de reconnaissance, de réparation et parfois même d’émancipation. Elle permet d’imposer à l’agenda public des thématiques que le politique tente d’écarter, forçant l’État à respecter ses engagements, notamment en matière de droits sociaux, environnementaux ou migratoires.
Dans ce cadre, les juges eux-mêmes voient leur fonction évoluer. La tradition du devoir de réserve, fondée sur l’exigence d’impartialité, est aujourd’hui réinterprétée à la lumière d’un contexte où la défense de l’État de droit impose parfois une prise de parole publique, notamment face aux attaques politiques visant l’indépendance de la magistrature. L’engagement croissant de certains juges dans le débat public, à travers des instances syndicales, des tribunes ou des positions institutionnelles, témoigne de cette transformation de leur rôle, sans pour autant constituer une dérive, dès lors qu’il s’inscrit dans la défense des garanties constitutionnelles et internationales.
Dans le contexte européen, la Cour européenne des droits de l’homme occupe une place fondamentale. Loin d’être un organe supranational imposant arbitrairement ses vues, elle agit selon un principe de subsidiarité : elle n’intervient que lorsque les juridictions nationales ont failli à protéger les droits garantis par la Convention. Son rôle est double : assurer une protection effective des droits humains, tout en accompagnant les États dans le renforcement de leurs institutions judiciaires. En ce sens, la Cour contribue à la consolidation d’un espace juridique commun fondé sur l’indépendance des juges, la prééminence du droit et la dignité humaine. Sa jurisprudence, en constante évolution, reflète sa capacité à adapter l’interprétation des droits aux mutations sociales, culturelles et technologiques du xxie siècle.
Dans un contexte de polarisation politique, de montée des souverainismes et de contestation de l’autorité judiciaire dans plusieurs États membres de l’Union européenne, la défense de l’indépendance judiciaire devient un enjeu démocratique majeur. Cette tension entre légitimité électorale et primauté du droit met à l’épreuve le socle même des démocraties européennes. Face aux dérives actuelles, la vigilance des institutions européennes, des acteurs de la société civile, des syndicats et des citoyens est impérative. La démocratie ne saurait survivre sans une justice forte, respectée et indépendante.
L’analyse de la situation belge met également en lumière une tension croissante entre les principes fondamentaux de l’État de droit et certaines pratiques politiques contemporaines. Si la Belgique reste formellement une démocratie, des violations répétées du droit – notamment dans les domaines de l’accueil des demandeurs d’asile, de la surpopulation carcérale ou encore de la politique climatique – révèlent une prise de distance préoccupante vis-à-vis des obligations juridiques de l’État. Le refus d’exécuter des décisions judiciaires, y compris celles émanant des plus hautes juridictions nationales et internationales, ne relève plus d’exceptions isolées mais d’un phénomène structurel. Ces entorses, souvent dirigées contre des groupes vulnérables, affaiblissent la légitimité des institutions et sapent les fondements mêmes de la démocratie constitutionnelle17
Dans ce contexte, il est essentiel de rappeler que l’État de droit ne se réduit pas à un simple cadre procédural : il incarne une exigence substantielle de justice, d’égalité et de protection des droits fondamentaux. Sa remise en cause ne peut être banalisée ni justifiée par des considérations d’opportunité politique. Chaque manquement à ce principe contribue à l’érosion d’un équilibre démocratique déjà fragilisé, et appelle une réponse ferme et cohérente des pouvoirs publics. Réaffirmer la primauté du droit, garantir l’indépendance de la justice et assurer l’effectivité des droits humains ne sont pas des options, mais des conditions indispensables à la pérennité de l’ordre démocratique.
17 Vincent Lefebve, « L’État de droit : une notion à géométrie variable ? », in Les @nalyses du CRISP en ligne, 11 février 2025.