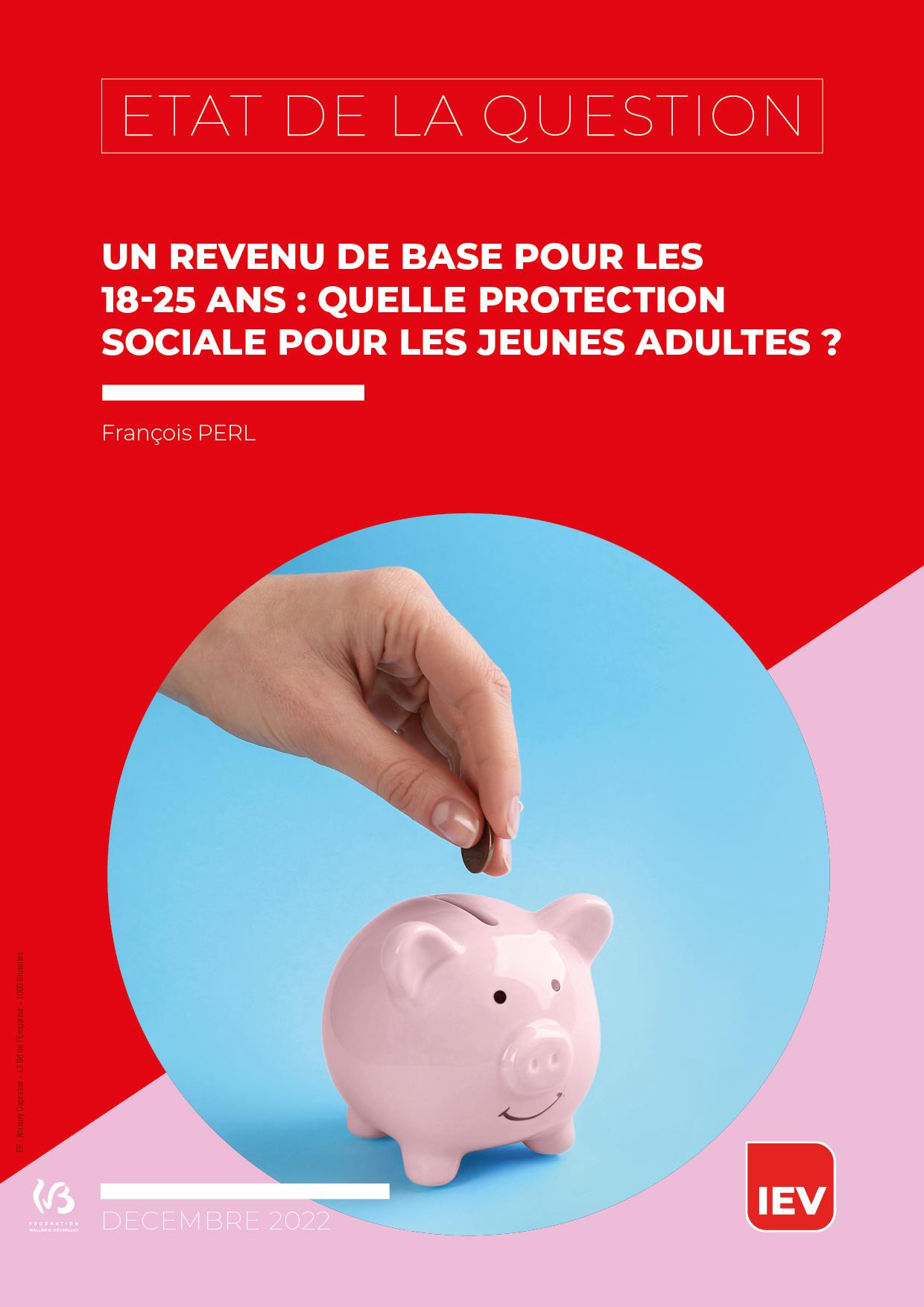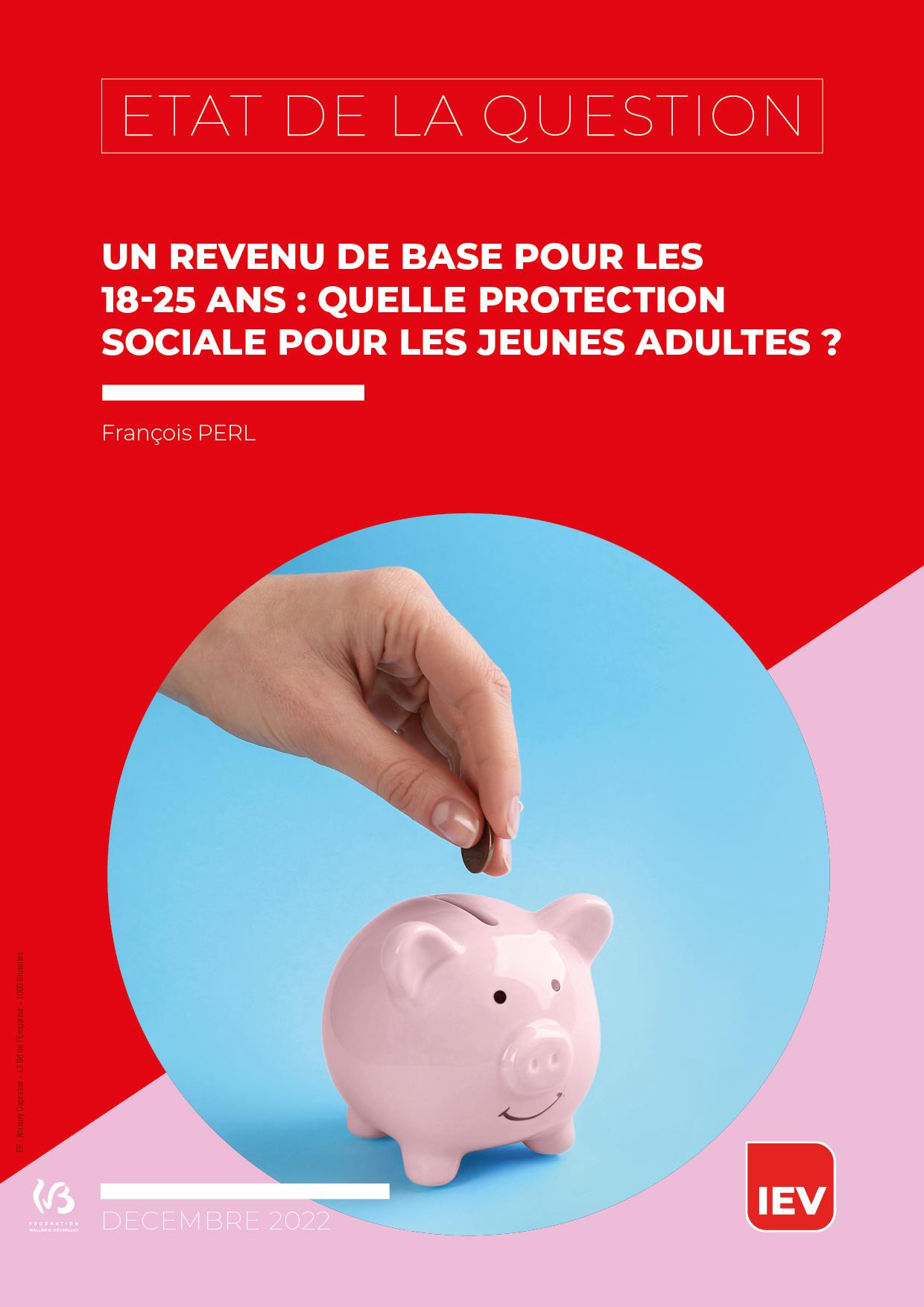
DANS LA MÊME COLLECTION / ETAT DE LA QUESTION IEV
www.iev.be
Un monde à 2,7°C : une analyse du dernier rapport du GIEC
Wissal SELMI
L’épidémie de COVID-19, un accélérateur d’inégalités
Florent LEGRAND
Le centième anniversaire de la loi des « huit heures »
Jean LEFEVRE
Rendons le féminin à la langue française
Sophie PISSART
Assurer le respect des droits humains et environnementaux dans le commerce international ?
C’est possible !
Anne LAMBELIN
Le cordon sanitaire : un outil de lutte contre l’extrême droite
Rim BEN ACHOUR
Quels fondements historiques à l’écosocialisme ?
Sophie PISSART
Arthur Jauniaux (1883-1949), artisan oublié de la mutualité socialiste
Joffrey LIENART
Opérations à l’étranger et pratiques parlementaires actuelles
Maxime LECLERCQ-HANNON
Coupe du monde au Qatar : regards croisés sur le sport et la géopolitique
Sophie PISSART
La démographie comme clé de compréhension de l’immigration
Anna-Maria LIVOLSI
Le taux d’emploi en Belgique : derrière les clichés, une réalité complexe
Damien VIROUX
150ème anniversaire de la première Maison du Peuple de Belgique
Joffrey LIENART
Drogues : le modèle portugais est-il parfait ?
Martin JOACHIM
Protection de la diversité des semences et développement des circuits alternatifs
Gloria Soton
SOMMAIRE 1 La protection sociale actuelle des jeunes en Belgique 2 1.1 L’allocation d’insertion 2 1.2 Le revenu d’intégration social (RIS) 2 1.3 Les allocations familiales 3 2 Les propositions de revenu de base pour les jeunes 3 3 Comment faire évoluer les dispositifs existant de protection sociale en revenu de base pour les 18-25 ans 4 3.1 Première piste : ancrer ce revenu de base dans la sécurité sociale en réformant l’allocation d’insertion 4 3.2 Deuxième piste : réformer le revenu d’intégration sociale 5 3.3 Vers un « revenu de base jeunes » : modalités pratiques 5 3.3.1 La forfaitarisation 6 3.3.2 L’individualisation 6 3.3.3 L’automatisation 7 4 Conclusions 8
Introduction
La question de l’octroi d’un revenu de base pour les jeunes revient, depuis quelques années, à échéance régulière dans les propositions de différents partis politiques. Ce projet est, d’ailleurs, loin de concerner la Belgique et on le retrouve dans l’agenda politique de nombreux pays européens. Il s’inscrit dans un mouvement plus général d’universalisation de la sécurité sociale dont le débat plus général autour de l’allocation universelle/revenu est une des principales manifestations.
La création d’un revenu de base pour les jeunes part d’un double postulat établi par de nombreux observateurs de la vie sociale :
1°/ Les jeunes adultes sont une des catégories les moins bien couvertes par les dispositifs existants de protection sociale1
2°/ La précarisation des jeunes adultes représenterait un des principaux dégâts collatéraux des crises économiques, sociales et climatiques qui ont marqué ces dernières années.
Ces postulats sont un mélange d’éléments factuels et de perception subjective qui font suite, notamment, à l’impact de la pandémie de Covid 19 sur la jeunesse actuelle que certains assimilent à une « génération sacrifiée »2
Même s’il serait utile de pouvoir mieux documenter ces constats, il n’en reste pas moins que deux indicateurs, parmi d’autres, sont particulièrement interpellant :
- Le part du nombre de bénéficiaires3 du revenu d’intégration par 1000 habitants de moins de 25 ans s’élève, au mois de juillet 2022, à
• 36,67% pour Bruxelles
• 21,64% pour la Wallonie
• 5,73 pour la Flandre
- L’ampleur du phénomène des NEET (Not in Education, Employment and Training) pour les 18-244 :
• 18,4% en Wallonie
• 18,1% à Bruxelles
Les enjeux sont importants. Il s’agit de renforcer la citoyenneté sociale des jeunes au travers d’une consolidation de leur participation à la protection sociale5. Celle-ci existe, nous le verrons, dans notre système de protection sociale mais son inefficacité doit être questionnée sous l’angle des chiffres que nous venons de citer. L’enjeu est alors de définir vers quel type de nouvelle « citoyenneté sociale » évoluer pour les jeunes de 18-25 ans et le débat sur le revenu de base offre un prisme d’analyse intéressant.
1 « Les jeunes sont le trou noir de la sécurité sociale », Philippe Defeyt, interview sur le site www.rtbf.be , 2 juillet 2020
2 « Les diplômés Covid, une génération sacrifiée », analyse de Nathalie Bamps dans l’Echo, 21 août 2020
3 Source : https://stat.mi-is.be/fr/dashboard/ris_moins_25?menu=drilldown
4 https://www.iweps.be/indicateur-statistique/18-24-ans-situation-de-neet-a-lemploi-enseignement-formation/
5 Par convention, nous utiliserons dans cette analyse le terme « protection sociale » pour désigner l’ensemble des prestations sociales monétaires octroyées dans le cadre des législations fédérales, communautaires et régionales qu’elles relèvent de la sécurité sociale ou de l’assistance sociale
État de la question 2022 - IEV • 1
1 La protection sociale actuelle des jeunes en Belgique
1.1 L’allocation d’insertion
L’octroi d’allocations de chômage aux jeunes de 18 à 25 ans n’ayant jamais travaillé (et donc ouvert des droits à ces allocations par leur activité professionnelle) a toujours été une exception dans la logique bismarckienne de la sécurité sociale belge. Exception souvent critiquée car elle ouvrirait le droit à une sorte de « chômage à vie ».
En 2012, le Gouvernement de l’époque a réformé l’ancien « stage d’attente » (la période de 9 mois qui permettait d’avoir accès aux allocations de chômage) par une allocation d’insertion dont l’octroi répond aux conditions suivantes :
- Ne plus être en situation d’obligation scolaire
- Avoir moins de 25 ans
- Avoir réussi des études secondaires (les formations en alternance sont apparentées). Pour les jeunes n’ayant pas terminé d’études (mais ayant suivi une scolarité et n’étant plus en obligation scolaire), le droit aux allocations d’insertion n’est ouvert qu’à partir de 21 ans.
- L’accomplissement d’un stage d’insertion professionnelle de 310 jours ouvrables (soit +/- 12 mois calendrier)
- Avoir obtenu durant ce stage, 2 évaluations positives de l’organisme régional d’emploi compétent. Durant toute la durée de l’octroi des allocations d’insertion, la disponibilité sur le marché de l’emploi est contrôlée de la même manière que pour les allocations de chômage « classique ». Une dispense de disponibilité peut être accordée aux jeunes souhaitant suivre des études tout en percevant l’allocation d’insertion. Cette dispense n’est cependant octroyée qu’à certaines conditions (formation professionnelle reconnue ou études de plein exercice).
Le Gouvernement suivant a réformé, en 2015, l’allocation d’insertion en la supprimant pour deux catégories de jeunes :
- Les moins de 21 ans qui n’ont pas de diplôme de l’enseignement
- Les plus de 25 ans.
Cette réforme a eu des effets néfastes sur la précarité de ces groupes sociaux sans apporter la preuve de son efficacité sur leur accès au marché de l’emploi, comme une étude récente de l’UCL l’a démontré6
1.2 Le revenu d’intégration social (RIS)
Pour les 18-25 ans, le revenu d’intégration social est ouvert aux mêmes conditions que pour les autres catégories d’âge :
- 18 ans minimum (possibilité d’octroi sous certaines conditions aux mineurs)
- Ne pas avoir ouvert de droit à des prestations de sécurité sociale (chômage ou invalidité) : tous les droits sociaux doivent avoir être épuisés
- Résidence en Belgique
- Nationalité (Belge, résident UE, étranger inscrit au registre, réfugié reconnu, apatride).
- Disponibilité sur le marché de l’emploi
- Absence d’autres ressources financières.
Le RIS fonctionne comme un droit résiduaire pour les situations qui ne sont pas couvertes par l’allocation d’insertion.
6 https://uclouvain.be/en/research-institutes/lidam/ires/news/priver-les-jeunes-d-allocations-d-insertion-est-il-un-remedeefficace-pour-lutter-contre-l-abandon-scolaire-et-le-chomage.html
État de la question 2022 - IEV • 2
1.3 Les allocations familiales
Le droit aux allocations familiales peut se prolonger jusqu’à 25 ans pour les jeunes qui poursuivent leurs études supérieures aux conditions suivantes :
• Être inscrit en cours pour 27 crédits au minimum dans formation de type bachelor ou master
• Effectuer un stage en vue d'être nommé à une charge
• Rédiger un mémoire de fin d'études supérieures (sous certaines conditions et jusqu’à la date de dépôt du mémoire)
• Suivre une ou plusieurs formations (en étant inscrit auprès d’un organisme régional comme demandeur d’emploi)
• Suivre une formation de doctorat pour au moins 27 crédits (les crédits pour la rédaction d'une thèse de doctorat ne comptent pas)
Ces allocations sont versées directement aux jeunes lorsque ceux-ci ne sont plus domiciliés chez leurs parents.
2 Les propositions de revenu de base pour les jeunes
Au sein du débat plus général sur la création d’un revenu de base, l’idée d’octroyer un revenu de base pour les jeunes « vit » depuis quelques années en Belgique. Plusieurs partis politiques ont émis des propositions allant dans ce sens, même si celles-ci restent peu détaillées.
Ecolo, dans son programme pour les élections fédérales de 2019, propose créer un revenu inconditionnel de base pour les jeunes de 18 à 26 ans. Son montant mensuel serait compris entre 460 et 600 euros. Cette proposition est vue comme un premier pas pour la création d’un revenu de base généralisé au sein d’une 6ème branche de la sécurité sociale7
Récemment, le Mouvement Réformateur, a proposé une refonde complète du système de sécurité sociale qui se muerait en revenu universel de base inconditionnel pour tous les Belges de plus de 18 ans. D’un montant de 1000 euros par mois, cette nouvelle allocation, partie intégrante du projet « 2030 : un nouveau contrat social et fiscal », remplacerait l’ensemble des autres dispositifs de protection social. Le caractère inconditionnel de ce revenu universel de base n’apparaît pas clairement et entre parfois en contradiction avec d’autres propositions de ce parti comme la limitation des allocations de chômage dans le temps.
Dans le cadre de leur projet « régénération du pacte social », Les Engagés proposent quant à eux la création d’un revenu de participation de 600 euros pour l’ensemble des plus de 18 ans8. Cette proposition s’éloigne cependant de l’idée de revenu de base dans la mesure où cette aide serait conditionnée à un travail, une formation, l’engagement dans une action associative ou les soins apportés à une personne dépendante.
Le PTB n’émet aucune proposition spécifique sur ce plan et renvoie la problématique de la protection sociale à ses propositions plus générales sur l’individualisation des droits sociaux et l’octroi automatique des allocations de chômage ou d’invalidité9
Le Parti Socialiste se positionne, par l’entremise de son Président Paul Magnette dans son ouvrage
« La vie large », pour la création un tel revenu pour les 18-25 ans qui serait équivalent à la moitié du salaire minimum et qui serait cumulable avec d’autres sources de revenus. Ce revenu ne remplacerait donc pas les dispositifs existants mais serait cumulable avec eux10
7 https://ecolo.be/idees/changer-de-modele-economique/emploi-travail-et-revenus/
8 https://www.lesengages.be/notre-projet-de-societe/regeneration-du-pacte-social/un-revenu-de-participation-de-600-eurospour-chaque-citoyen-2/
9 Consultation du site www.ptb.be le 4 décembre 2022
10 Paul Magnette, « La vie large », Editions de la découverte, Paris, 2022, p.202
État de la question 2022 - IEV • 3
3 Comment faire évoluer les dispositifs existant de protection sociale en revenu de base pour
les 18-25 ans
Partant de l’existence d’un consensus politique sur la nécessité de transformer la protection sociale des 18-25 ans, il nous a semblé intéressant d’établir une esquisse de ce que pourrait être ce un revenu de base « jeunes »
Malgré le foisonnement de propositions qui ont émergé ces dernières années, il nous a paru intéressant de débuter cette analyse par celle des dispositifs existants et de voir l’instauration d’un revenu de base « jeunes » au travers de ceux-ci. L’analyse sera complétée par une confrontation entre les protections existantes et une synthèse des différentes propositions émises par les différents partis politiques.
Pour ce faire, il nous faut partir d’un double postulat :
- Si des propositions alternatives existent, c’est que les dispositifs existants ne remplissent pas suffisamment leur rôle
- Sans pour autant instaurer un revenu de base complètement inconditionnel, il y a (au moins dans le chef du PS et d’ECOLO) une volonté de rendre la protection sociale à la fois plus lisible et plus accessibles pour les jeunes de 18 à 25 ans.
L’hypothèse d’une réforme des dispositifs existants postule deux options :
- Une réforme de l’allocation d’insertion
- Une réforme du revenu d’intégration sociale
Il n’est pas question ici d’opérer un choix entre ces deux pistes mais bien d’en exposer les tenants et aboutissants. Il n’y a pas vraiment un choix présentant plus d’avantages que l’autres, en dehors de considérations de simplifications administratives que nous n’aborderons pas dans cette analyse et de choix stratégiques qui tiennent aux conceptions mêmes de la structure de l’Etat social.
Ces deux pistes nécessitent cependant une lecture critique de ces deux prestations de protection sociale dès lors que leurs conditions actuelles d’octroi s’écartent de l’idée qu’on pourrait se faire d’un revenu de base « jeunes »
3.1 Première piste : ancrer ce revenu de base dans la sécurité sociale en réformant l’allocation d’insertion
Une première piste reviendrait à ancrer un revenu de base pour les jeunes dans la sécurité sociale en assouplissant les conditions d’octroi de l’allocation d’insertion. Celles-ci ont été considérablement resserrées au fil des ans et ses différentes réformes ont fait l’objet de nombreux recours devant les tribunaux
Le point est important et dépasse l’aspect symbolique :
- L’allocation d’insertion dans sa forme actuelle est un dispositif contraignant, peu lisible, qui peut entraîner un taux important de non-recours. La transformer s’inscrit dans un projet plus général qui consiste à faire évoluer notre protection sociale vers un modèle plus universel.
- L’aide sociale (le RIS) est considérée comme résiduaire et ne vise que les situations qui ne sont pas couvertes par la sécurité sociale.
- La sécurité sociale est un puissant intégrateur social. Les causes de la désaffiliation de nombreux jeunes sont évidemment complexes mais le sentiment d’exclusion des dispositifs sociaux en est une assez évidente.
Historiquement, la sécurité sociale belge ne s’est pas construite comme une sécurité sociale universelle. L’universalisation de l’allocation d’insertion entraînerait dès lors des questions, légitimes, sur celle des autres revenus de remplacement comme les allocations de chômage ou les pensions. A
État de la question 2022 - IEV • 4
contrario, cet élargissement des conditions d’octroi de l’allocation d’insertion pourrait, justement, être un point de départ pour un élargissement de la couverture de la sécurité sociale dont les « trous dans la raquette » font régulièrement l’objet de critiques Sachant que notre système de sécurité sociale s’est déjà, par le passé, universalisé ce qui tend à le rendre plus hybride que strictement bismarckien11
Comme le RIS, les conditionnalités actuelles de l’allocation d’insertion sont fortement liées au principe de workfare. Ce principe renvoie à la notion de réciprocité. Les prestations de protection sociale ne sont plus seulement assistancielles ou assurancielles mais réciproques. La prestation devient subordonnée à une démarche d’intégration par le travail12
Toute réforme de l’allocation d’insertion allant dans le sens de la création d’un revenu de base pour les jeunes passe donc par une sortie de la logique de workfare et d’une certaine forme de découplage entre l’ouverture du droit à l’allocation d’insertion et les obligations de recherche d’emploi. Cela permettrait, en outre, d’ouvrir cette prestation aux jeunes adultes qui ne sont pas actifs sur le marché de l’emploi et de réduire, via un octroi plus automatique, le non-recours aux allocations d’insertion que leur complexité réglementaire et administrative est susceptible de générer.
3.2 Deuxième piste : réformer le revenu d’intégration sociale
Cette réforme fonctionnerait en miroir de la réforme de l’allocation d’insertion. Il ne s’agit pas ici de considérer l’universalisation du revenu d’intégration puisqu’il l’est déjà mais bien de reconsidérer son rôle résiduaire pour le « généraliser ». Le caractère résiduaire du revenu d’intégration sociale est inhérent à la notion même d’aide sociale dans notre pays. Celle-ci est conditionnée à l’épuisement de tous les autres droits sociaux avant d’être octroyé.
A l’inverse des prestations de sécurité sociale comme l’allocation d’insertion, l’octroi du RIS est lié à l’absence de ressources suffisantes. Les ressources sont calculées par le Centre Public d’Aide Social auprès duquel la demande est adressée et celui-ci est obligé, pour octroyer le RIS, de tenir compte de l’ensemble des revenus du demandeur (professionnels, immobiliers, mobiliers, avantages en nature ou revenus générés par la cohabitation). Le principe général étant la prise en considération de tous les revenus pour le calcul de la situation sociale, une série d’exceptions limitatives sont fixées sous la forme d’exonération13
Cette piste supposerait à tout le moins, une « révolution » dans la fonction du revenu d’intégration sociale qui perdrait, pour le public visé, son caractère résiduaire et se rapprocherait d’avantage d’une prestation universelle de sécurité sociale Cela qui reviendrait, de facto, à créer un nouveau dispositif spécifique aux 18-25 ans qui ferait plus partie de l’assistance sociale
3.3 Vers un « revenu de base jeunes » : modalités pratiques
A ce stade, nous pouvons constater que la tendance générale au niveau des partis politiques consiste à privilégier la piste d’une nouvelle prestation. Pour le PS, les Engagés et Ecolo, elle viendrait s’ajouter aux prestations existantes. Pour le MR, elle remplacerait les prestations existantes. Nous pensons, cependant, que si cette piste est retenue, on ne pourra pas faire l’économie d’une réflexion sur la refonte de l’allocation d’insertion et du revenu d’intégration sociale, ne serait-ce qu’en terme d’interaction avec la nouvelle prestation.
Que ce soit au travers de la réforme de dispositions existantes ou via la création d’un nouveau dispositif, la création d’un revenu de base entraîne une série de questions que nous nous contenterons, à ce stade, de dénombrer sans pouvoir apporter de réponses définitives.
11 Par « opposition » aux systèmes universels dits beveridgiens, les systèmes bismarckiens sont des systèmes d’assurance sociale liées à l’exercice d’une activité professionnelle et financées par des cotisations sociales
12 MOREL Sylvie, « Les antécédents généalogiques du workfare et de l'insertion », dans : , Leslogiquesdelaréciprocité. Les transformationsdelarelationd'assistanceauxÉtats-Unis et en France, Presses Universitaires de France, « Le Lien social », 2000, p. 85-121
13 Pour la liste de ces exonérations, on se reportera au site du SPP intégration sociale : https://primabook.mi-is.be/fr/droitlintegration-sociale/le-calcul-des-ressources#0_h3_18
État de la question 2022 - IEV • 5
Nous nous référons, pour analyser les contours de ce que serait un revenu de base « jeunes » à la définition donnée par Daniel Dumont dans son ouvrage « Le revenu de base : avenir de la sécurité sociale belge ? »14 : L’idée est très simple dans son expression, et cette simplicité contribue à renforcer la force de séduction dont elle bénéficie. Elle consiste à octroyer un revenu minimum incompressibleàtoutcitoyen – àtoutlemoinslorsqu’ilestmajeuretdisposed’unstatutderésident en séjour régulier -, quelle que soit sa situation privée et familiale, peu importe le niveau de ses ressourcespersonnellesetsanslamoindreexigencedecontrepartie »
Il s’agit donc d’examiner ce revenu de base sous l’angle de trois grands enjeux du revenu de base « classique » :
- La forfaitarisation
- L’individualisation
- L’automaticité
3.3.1 La forfaitarisation
Suivant l’idée émise par Paul Magnette15, le revenu de base jeunes s’élèverait à 958 euros soit 50% du revenu minimum mensuel moyen garanti16 17 Il s’agit de la proposition la plus haute, celles des Engagés et d’Ecolo se situant, elles, entre 460 euros et 600 euros.
Ces propositions se situant en dessous du seuil de pauvreté qui se situe, au 19 septembre 2022, à 1293 euros par mois pour un isolé18 mais le cumul, au moins partiel, avec soit une prestation sociale (allocation d’insertion ou revenu d’intégration sociale) soit un revenu professionnel serait autorisé dans les propositions du PS et d’Ecolo. La question, qui n’est pas tranchée à ce stade, est de savoir si ces prestations peuvent se cumuler intégralement ou bien si ce cumul est plafonné. Si la deuxième option est retenue, il faudrait à tout le moins que ce cumul permette de relever le total des allocations perçues par les bénéficiaires au-dessus du seuil de pauvreté pour les situations où le bénéficiaire est soit isolé, soit en cohabitation en dehors du domicile familial.
Notons que ce cumul n’est, en revanche, pas autorisé dans la proposition du MR qui revient, donc, à situer toutes les allocations sociales en dessous du seuil de pauvreté.
La question de la forfaitarisation des montants ne se pose pas vraiment dès lors que le revenu de base « jeunes » ne remplace pas des protections existantes mais viendrait les compléter. La tendance dominante (à l’exception de la proposition du MR) est donc d’aller vers une forme hybride de prestation sociale associant un montant forfaitaire et des montants modulés en fonction de la situation familiale et/ou sociale des bénéficiaires.
3.3.2 L’individualisation
L’individualisation des droits à un revenu de base « jeunes » suscite une double question :
- Le lien entre ce droit à la situation familiale et le considérer au regard de la « décohabitation » de l’unité familiale. En d’autres termes, est-ce que ce droit est également ouvert aux jeunes résidant avec leurs parents ?
- La contextualisation de ce nouveau droit dans la problématique plus générale de l’individualisation de l’ensemble des droits sociaux sachant que la cohabitation est une des formes de vie très répandues chez les bénéficiaires potentiels du revenu de base « jeunes ».
14 D. Dumont, Lerevenudebaseuniversel,avenirlasécuritésociale, collection « Droit et criminologie », Editions de l’Université Libre de Bruxelles, 2021
15 Voir supra
16 Au 1er octobre 2022
17 Il n’existe pas, en Belgique, de salaire minimum généralisé. Chaque secteur est libre de fixer un salaire minimum mais celuici doit être supérieur à un salaire « plancher », le revenu minimum mensuel moyen garanti (RMMMG) fixé par une convention collective conclue au sein de Conseil National du Travail
18 Source : www.statbel.be
État de la question 2022 - IEV • 6
La réponse à la seconde question est assez simple. Au regard du débat actuel sur l’individualisation générale des droits sociaux, toute nouvelle prestation devrait être complétement individualisée, au même titre que les prestations existantes.
La question du lien entre la « décohabitation » de l’unité familiale s’avère, elle, plus complexe. La protection sociale belge est moins marquée par « familiarisation » des prestations pour les jeunes adultes qui cohabitent avec leurs parents qu’elle ne l’est, par exemple, en France19 Si les allocations familiales leur sont octroyées sur base de certaines conditions20 et versées à leurs parents quand ils cohabitent ensemble, le droit à l’allocation d’insertion est ouvert pour un jeune cohabitant avec ses parents et, sans enquêtes de ressources, dans les conditions fixées par la réglementation. Le droit au revenu d’intégration sociale leur est également ouvert, moyennant enquête de ressources cette fois-ci.
La défamiliarisation d’un revenu de base « jeunes » pourrait donc être envisagée mais elle n’est pas sans poser de questions notamment au regard des effets d’aubaine qu’elle pourrait entraîner au-delà des familles socialement défavorisées Ce risque est d’ailleurs une critique générale adressée au revenu de base21 Il faudrait, à tout le moins, déduire d’un revenu de base « jeunes », les allocations familiales (comme c’est le cas dans l’octroi du revenu d’intégration sociale) ou tout simplement en interdire le cumul (comme c’est le cas pour l’allocation d’insertion).
3.3.3 L’automatisation
L’octroi automatique de ce revenu de base « jeunes » est probablement la question préalable à sa création qui suppose le plus de questionnements. Nous avons envisagé deux hypothèses, qui ne s’excluent pas mutuellement, à savoir une évolution des prestations existantes qui supposerait la suppression d’une série de conditions d’octroi :
- Les conditions de réussite au niveau des études (allocation d’insertion)
- Le stage d’insertion (allocation d’insertion)
- Les sanctions en dehors des cas de fausse déclaration
Dans ce cadre, la création d’une nouvelle prestation qui servirait en quelques sortes de « socle » aux prestations existantes de protection sociale. Dans ce cas de figure, les conditions d’octroi de cellesci n’évolueraient pas ou de manière assez marginale.
Cela étant dit, même dans l’hypothèse de la création de ce nouveau revenu de base « jeunes », l’ouverture d’un tel droit inconditionnel et automatique est de nature à soulever une série de questions :
- Le cumul avec des revenus professionnels : celui-ci pourrait être rendu possible soit en fonction d’un plafond d’heure (comme le plafond de 600 heures existants pour les job étudiants) ou par une interdiction de cumul fixé au seuil du RMMN22).
- Le cumul avec les bourses d’études
- Le lien entre l’octroi du revenu et un accompagnement socioprofessionnel par un organisme régional d’emploi et d’insertion socioprofessionnel
19 CHEVALIER Tom, « Les enjeux d’un revenu pour les jeunes », Regards, 2021/1 (N° 59), p. 139-149. DOI : 10.3917/regar.059.0139. URL : https://www.cairn.info/revue-regards-2021-1-page-139.htm
20 Voir supra
21 Thomas Chevandier, Jérôme Héricourt, “le revenu de base : de l’utopie à la réalité », Fondation Jean Jaurès, mai 2016
22 Voir supra pour la définition
État de la question 2022 - IEV • 7