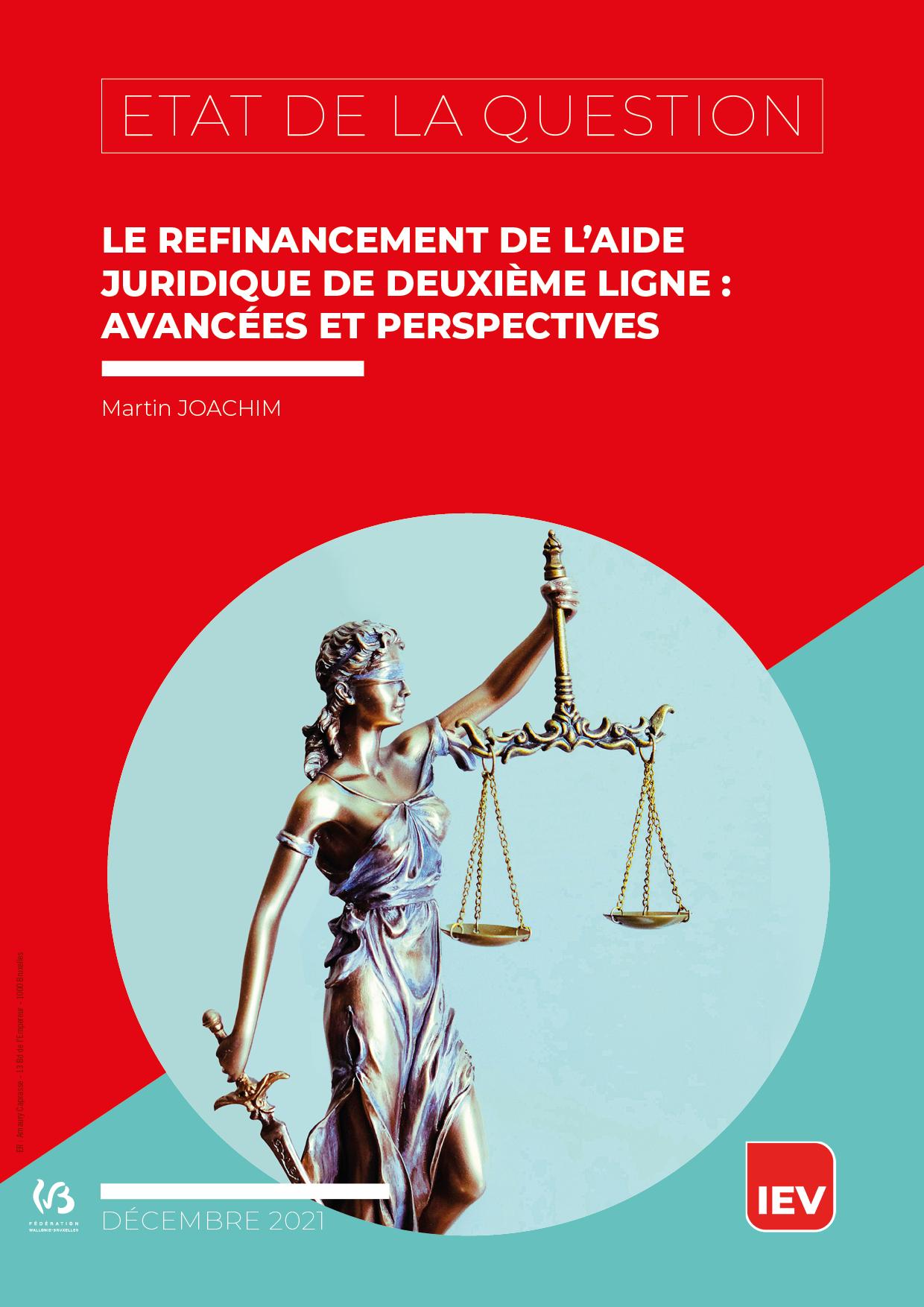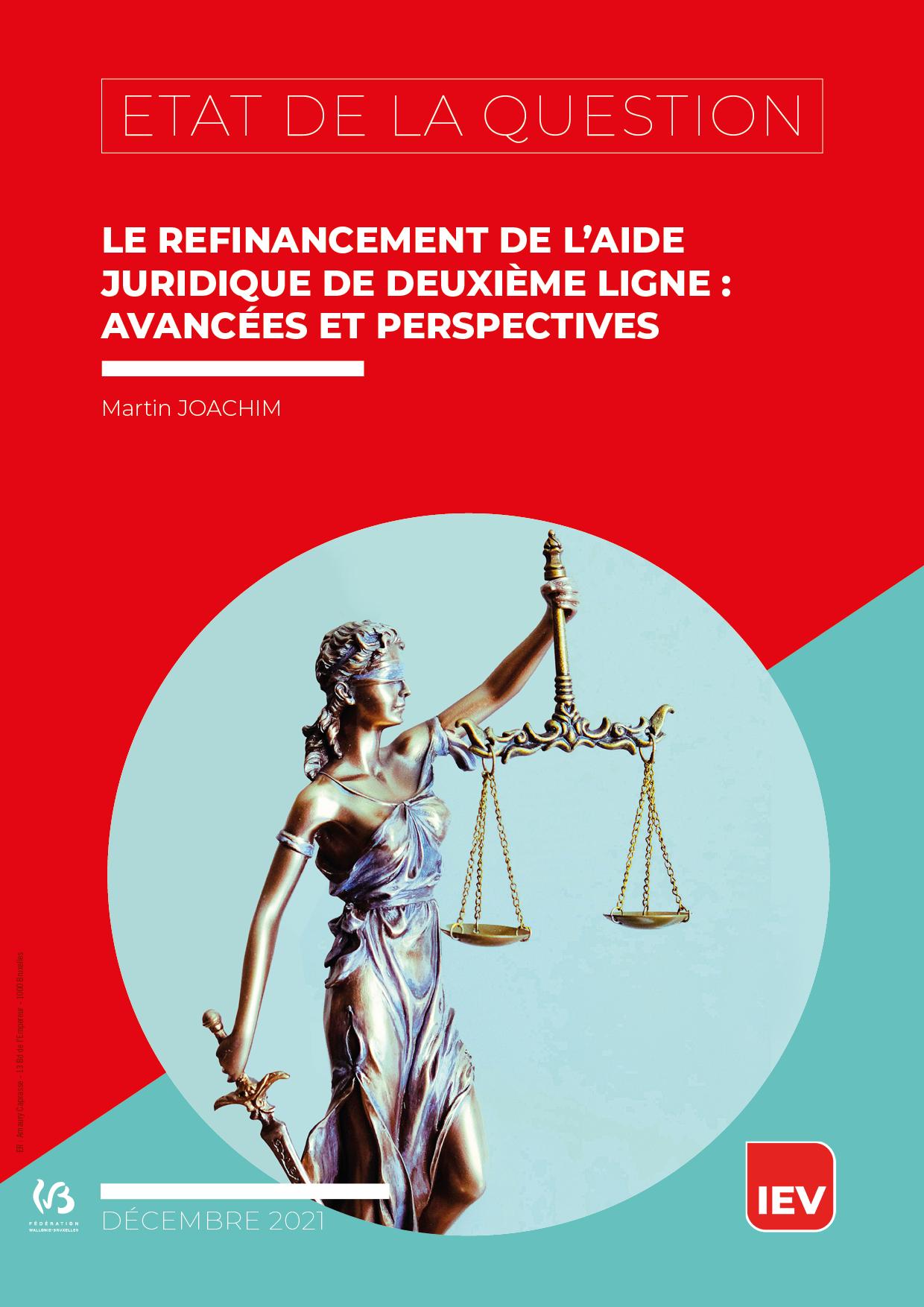
Introduction 4 1. L’aide juridique : présentation 4 2. La loi du 30 juillet 2020 : une revalorisation financière et une meilleure garantie du droit à l’aide juridique 5 2.1. Un contexte politique particulier 5 2.2. L’augmentation des seuils de revenus 6 2.2.1. L’état du droit avant la réforme 6 2.2.2. L’augmentation des seuils de revenus avec la loi du 30 juillet 2020 6 2.3. Une meilleure protection du droit à l’accès à l’aide juridique 9 3. Un refinancement bienvenu mais des réformes « qualitatives » de l’aide juridique qui se font attendre 10 3.1. L’aide juridique inadaptée pour le public le plus vulnérable 10 3.2. La rémunération des avocats qui pratiquent l’aide juridique et l’enveloppe fermée 12 3.2.1. Le délai de paiement des indemnités BAJ 12 3.2.2. L’enveloppe fermée et l’indexation du point 12 Conclusions 13 SOMMAIRE
Introduction
En décembre 2019, un « Etat de laquestion » de l’IEV concluait que le manque de moyens dédiés à l’aide juridique de seconde ligne, qui permet aux personnes avec des moyens financiers limités de bénéficier de l’assistance gratuite ou quasiment gratuite d’un avocat, dès lors qu’il limite considérablement le champ d’application de cette mesure, constituait « une brèche dans l’Etat de droit »1
Depuis lors la situation a évolué. La loi du 30 juillet 2020 modifiant le code judiciaire afin d'améliorer l'accès à l'aide juridique de deuxième ligne et à l'assistance judiciaire par l'augmentation des plafonds de revenus applicables en la matière, en effet relevé les seuils de revenus qui conditionne l’accès à ce mécanisme. Un nombre beaucoup important de personne pourra bénéficier de ce mécanisme Ceci nous pousse à dresser un nouvel « étatdelaquestion ».
Dans un premier temps, nous procéderons à bref rappel de ce qu’est l’aide juridique de seconde ligne (I)
Ensuite, nous décrirons les évolutions apportées par la loi du 30 juillet 2020 précitée (II)
Si cette réforme doit être vivement saluée, de nouvelles perspectives doivent s’ouvrir pour que l’aide juridique de seconde ligne garantisse pleinement le droit à l’accès à la Justice (III).
1. L’aide juridique : présentation
Il existe deux catégories d’aide juridique : l’aide juridique de première ligne et l’aide juridique de seconde ligne.
L’article 508/1, 1°, du Code judiciaire, définit l’aide juridique de première ligne comme étant l’aide « accordéesouslaformederenseignementspratiques,d'informationjuridique,d'unpremieravisjuridique oud'unrenvoiversuneinstanceouuneorganisationspécialisées ». Elle permet à tout le monde – c’est-àdire sans que des conditions de revenus soient exigées - d’obtenir un premier conseil d’un avocat2 au cours de permanences physiques ou téléphoniques avec ou sans rendez-vous3. Il s’agit avant tout d’orienter le demandeur d’aide juridique.
Ce premier conseil peut conduire à la désignation d’un avocat dans le cadre de l’aide juridique de deuxième ligne. Il ne s’agit toutefois pas du seul accès à cette mesure L’aide juridique de deuxième ligne permet aux justiciables d’obtenir un avis juridique plus complet, par exemple, sur les chances de succès d’une action en Justice, ou l’assistance d’un avocat dans le cadre d’une procédure juridique quelconque, ou d’un procès4
C’est ce qu’on appelait auparavant le pro deo Contrairement à la première ligne, la seconde ligne n’est pas ouverte à tous. Des conditions strictes sont prévues. Principalement, il s’agit de seuils de revenu qu’il ne faut pas dépasser pour bénéficier de l’aide. Certaines personnes sont présumées se trouver dans cette situation et ne doivent pas prouver leur indigence : c’est le cas des personnes qui bénéficient du revenu d’intégration sociale par exemple5
1 « L’inaccessibilité de la justice pour raisons financières, une brèche dans l’Etat de droit » , Etatdelaquestiondel’IEV, décembre 2019, disponible ici.
2 En théorie, la législation de la Communauté française permet que l’aide juridique de première ligne soit donnée par des juristes non-inscrits au Barreau. Dans la pratique, seules les Commissions d’aide juridique sont subventionnées à ce titre L’aide juridique de 1ere ligne est aussi organisées en dehors du cadre de la législation de la Communauté française par les CPAS, les syndicats, certaines associations (E.DERMINE, E. DEBOUVERIE, Etudesociojuridique etdedroitcomparéconcernantunprojetpilotedecabinetsdédiésàl’aidejuridique, janvier 2019, p. 9-10, disponible ici )
3 http://www.maisonsdejustice.be/index.php?id=6207
4 L’article 508/1, 2° du Code judiciaire indique : « aidejuridiquededeuxièmeligne:l'aidejuridiqueaccordéeàunepersonnephysiquesouslaformed'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentationausensdel'article728 ».
5 Il s’agit de présomptions non irréfragables. En d’autres termes, le bureau d’aide juridique peut démontrer que la personne ne remplit pas les conditions de revenu.
4 Etat de la Question 2021 • IEV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
A côté de l’aide juridique, il existe l’assistance judiciaire. Si l’aide juridique permet d’obtenir le soutien d’un avocat notamment dans le cadre d’une procédure judiciaire, l’assistance judiciaire permet d’obtenir une dispense de paiement des autres frais inhérents à une procédure judiciaire6. L’assistance judiciaire est octroyée par les bureaux d’assistance judiciaire, composée de magistrats, ou parfois par la juridiction ellemême. Elle est d’office octroyée aux bénéficiaires de l’aide juridique
Depuis 2014, l’aide juridique de première ligne relève de la compétence des Communautés. L’aide juridique de deuxième ligne et l’assistance judiciaire relèvent de la compétence de l’Etat fédéral.
Les avocats qui pratiquent l’aide juridique de deuxième ligne sont rémunérés par l’Etat (par le biais des Bureaux d’aide juridique gérés par les barreaux), via un système de point. En fin d’année judiciaire (juin), pour un dossier clôturé donné, ils déclarent l’ensemble des prestations réalisées. Chacune de ces prestations est reprise dans une nomenclature fixée par un arrêté ministériel7 qui les fait correspondre à un certain nombre de point. Chaque année la valeur du point est déterminée en fonction du budget et du nombre de points accordés à l’ensemble des avocats Avec ce système d’enveloppe fermée, un avocat ne connaît, en principe, pas à l’avance quelle sera le montant de son indemnisation BAJ8
2. La loi du 30 juillet 2020 : une revalorisation financière et une meilleure garantie du droit à l’aide juridique
2.1. Un contexte politique particulier
La loi du 30 juillet 2020 a été adoptée dans un contexte politique particulier. En effet, le Gouvernement minoritaire regroupant le Cd&V, l’Open VLD et le MR9 était démissionnaires à la suite des élections de juin 2019.
Cette situation a permis l’émergence d’une majorité « alternative » autour d’un refinancement considérable de l’aide juridique. Deux propositions étaient sur la table. La première provenait du Groupe PS, en particulier du député Khalil Aouasti, et la seconde du Groupe Ecolo-Groen et de ses députés Stefaan Van Hecke et Zakia Khattabi. Leurs convergences a permis de se rejoindre autour d’une proposition commune et de plusieurs amendements nécessaires 10 afin d’aboutir au texte de loi décrit ci-dessous.
Finalement, les groupes PS, Ecolo-Groen, CDH, Défi, PTB-PVDA, VB ont soutenu le projet. Le CD&V s’est abstenu alors que la NVa, l’Open VLD et le MR se sont opposés au texte. Cette opposition à cette proposition était justifiée par eux par l’impact budgétaire de la mesure, jugé excessif11
6 Droits de mise au rôle (taxe due au moment de l’introduction d’une action en Justice), honoraires des huissiers, frais d’expertise..
7 Arrêté ministériel du 16 juillet 2016 fixant la nomenclature des points pour les prestations effectuées par les avocats chargés de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou complètement gratuite
8 Voir le point 3.2.
9 La Nva avait retiré sa confiance dans ce gouvernement en décembre 2018.
10Proposition de loi améliorant l’accès à l’aide juridique de deuxième ligne par l’augmentation des seuils financiers d’accessibilité, Amendements n°4 et suivants, Ch. Doc. parl., 2019-2020, 0175/004, p.5 et s.
11 Proposition de loi améliorant l’accès à l’aide juridique de deuxième ligne par l’augmentation des seuils financiers d’accessibilité, discussion générale, C.R.I., Ch., 2019-2020, séance du 15 juillet 2020, n°55-PLEN-52, p. 45 et s
5 Etat de la Question 2021 • IEV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2.2.
L’augmentation des seuils de revenus
2.2.1. L’état du droit avant la réforme
En 2019, selon l'arrêté royal du 18 décembre 2003 désormais abrogé par la loi du 30 juillet 2020 précité, l’aide juridique de deuxième ligne, gratuite ou partiellement gratuite, était accessible selon les conditions de moyens d’existence suivantes :
Personne isolée Personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage (-15% du revenu d’intégration par personne à charge, soit actuellement 188, 22 euros)
Aide juridique gratuite Revenus nets inférieurs à 1 026 euros Revenus nets du ménage inférieurs à 1.317 euros
Aide juridique partiellement gratuite Revenus nets entre 1 026 euros et 1 317 euros Revenus nets du ménage entre 1 317 euros et 1 607 euros
Certains justiciables sont présumés comme n’étant pas des personnes bénéficiant de moyens d’existence suffisants. Ils ne doivent pas, en conséquence, démontrer qu’ils se trouvent dans les conditions de moyens d’existence précités12. C’est par exemple le cas de la personne qui bénéfice du revenu d’intégration sociale ou encore de la personne détenue.
La personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l’avocat une contribution propre dans les frais d’aide juridique. Le montant de cette contribution équivaut à la différence entre ses moyens d’existence et les montants des seuils de revenus pour l’accès à l’aide juridique totalement gratuite. Ce montant ne peut excéder 125 euros.
Ex:Pascalineestune«personneisolée»etdisposedemoyensd’existenceévaluésà1.100euros. Elle nepourrapasbénéficierdel’aidejuridiquetotalementgratuite(moyensd’existence>à1.026 euros)maisbiendel’aidejuridiquepartiellementgratuite(moyensd’existence<à1.317euros).
Elle devra s’acquitter d’une contribution forfaitaire de 74 euros ce qui correspond à la différence entre sesmoyensd’existenceetlalimitede1.026euros
2.2.2. L’augmentation des seuils de revenus avec la loi du 30 juillet 2020
a Les nouveaux seuils de revenus
La loi du 30 juillet 2020 précitée a augmenté les seuils de revenu de 200 euros. Elle prévoit une augmentation annuelle de 100 euros jusqu’en 2023 de sorte que l’augmentation totale de de ces seuils atteindra 500 euros.
La loi prévoit une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge. Cette déduction augmente de 5 points de pourcentage par rapport à ce que prévoyait l’arrêté royal du 18 décembre 2003.
6 Etat de la Question 2021 • IEV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Il s’agit d’une présomption qui peut être renversée. Par conséquent, le bureau de l’aide juridique peut refuser d’octroyer l’aide juridique s’il démontre que les conditions de revenu ne sont pas remplies.
Les tableaux suivants rendent compte de l’augmentation prévue.
Septembre 2020 Personne isolée
Personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage (-20% (+5 points de %) du revenu d’intégration par personne à charge, soit +/- 200 euros)
Aide juridique gratuite
Aide juridique partiellement gratuite
Revenus nets inférieurs à 1226 euros (+200 euros)
Revenus nets entre 1226 euros et 1517 euros (+200 euros)
2021 Personne isolée
Revenus nets du ménage inférieurs à 1.517 euros (+200euros)
Revenus nets du ménage entre 1517 euros et 1807 euros (+200 euros)
Personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage (-20% (+5 points) du revenu d’intégration par personne à charge, soit actuellement 200 euros)
Aide juridique gratuite
Aide juridique partiellement gratuite
Revenus nets inférieurs à 1326 euros (+300 euros)
Revenus nets entre 1326 euros et 1617 euros (+300 euros)
2022 Personne isolée
Revenus nets du ménage inférieurs à 1.617 euros (+300euros)
Revenus nets du ménage entre 1617 euros et 1907 euros (+300 euros)
Personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage (-20% (+5 points) du revenu d’intégration par personne à charge, soit actuellement 200 euros)
Aide juridique gratuite Revenus nets inférieurs à 1426 euros (+400 euros)
Aide juridique partiellement gratuite
Revenus nets entre 1426 euros et 1717 euros
Revenus nets du ménage inférieurs à 1.717 euros (+400euros)
Revenus nets du ménage entre 1717 euros et 2007 euros (+400 euros)
7 Etat de la Question 2021 • IEV
2023
Personne isolée Personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage (-20% (+5 points) du revenu d’intégration par personne à charge, soit actuellement 200 euros)
Aide juridique gratuite Revenus nets inférieurs à 1526 euros (+500 euros)
Aide juridique partiellement gratuite Revenus nets entre 1526 euros et 1817 euros (+500 euros)
On peut donner l’exemple suivant pour 2023 :
Revenus nets du ménage inférieurs à 1.817 euros (+500euros)
Revenus nets du ménage entre 1817 euros et 2107 euros (+500 euros)
Ex.1 : Isaline est infirmière. Elle touche 2000eurospar mois. Elle vit seule avec ses deux enfants en bas âge. Son bailleur refuse de faire les réparations nécessaires alors que des traces d’humidité apparaissentsurlesmursdelachambredesesenfants.Ellesouhaiteagirenjustice.Lerevenupris en compte pour vérifier si elle peut bénéficier de l’aide juridique sera de 1600 euros (2000-400 euros) Entantqu’isoléeavecpersonnesàcharge, ellepourrabénéficierdel’aidejuridiquetotalement gratuitepuisquesesrevenusnetsinférieursprisencomptesont inférieurs à 1 817 euros.
Ex.2 : ThierryetJean-Michelviventencouple Thierryaunerémunérationmensuellede1 600euros. Jean-Michel touche le revenu d’intégration sociale (+/- 669 euros pouruncohabitant) Ils ont à leur charge l’enfant de Jean-Michel.UnSoir,Thierryaététabassé en rue en sortant d’un bar. Il souhaite être accompagné par un avocat dans le cadre de la procédure pénale visant son agresseur. Pour déterminersiThierrypeutbénéficierdel’aidejuridiqueetêtreaccompagnégratuitementd’unavocat, on va prendre en compte les revenus du ménage qui s’élèvent à 2 069 euros (2269-200 euros) Thierrypourrabénéficierdel’aidejuridiquepartiellementgratuite(paiementdemaximum125euros)
La loi du 30 juillet 2020 maintien, par ailleurs, les présomptions prévues par l’arrêté royal du 18 décembre 2003
Les règles relatives au montant dû en cas de gratuité partielle, qui varie entre 25 et 125 euros, sont également maintenues.
Le lien entre l’octroi de l’aide juridique de deuxième ligne et l’assistance judiciaire est également préservé.
b. L’impact de la réforme en termes d’extension du nombre de bénéficiaires de l’aide juridique de seconde ligne et en termes budgétaires
L’augmentation des seuils de revenus pris en compte pour l’octroi de l’aide juridique de deuxième ligne a conduit et conduira inévitablement à augmenter considérablement le nombre de bénéficiaires de l’aide juridique.
8 Etat de la Question 2021 • IEV
Dans le cadre des travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption de la loi du 30 juillet 2020, un avis de la Cour des comptes a été sollicité13. Il offre un précieux aperçu de l’évolution en termes de personnes touchées par la mesure14
En 2023, la mesure permettra à 2.773.000 personnes de bénéficier de l’aide juridique totalement ou quasiment gratuite. En 2019, il s’agissait de 1.520.000 personnes. La loi permettra donc de toucher 1.253.000 personnes en plus, soit une augmentation de +82%. La proposition de loi permettrait de toucher près de 25% de la population belge.
D’un point de vue budgétaire, l’augmentation des seuils de revenu en 2023 aura un coût estimé de 177.260.816 euros, ce qui comprend l’augmentation des coûts de fonctionnement du bureau d’aide juridique et celui de l’assistance judiciaire. Le montant total du budget de l’aide juridique sera de 286.736.673 euros15 Pour obtenir un ordre de grandeur, le budget de la Justice au sens le plus large (Cours et tribunaux, prisons, sûreté de l’Etat, SPF justice, cultes et laïcité,…) est fixé en 2022 à +/2,3 milliards d’euros.
2.3. Une meilleure protection du droit à l’accès à l’aide juridique
Une autre avancée qu’apporte la loi du 30 juillet 2020 est la consécration légale du droit à l’aide juridique.
En effet, l’article 23 de la Constitution prescrit que :
« Chacun a le droit de mener une vie conforme à ladignitéhumaine. A cette fin, la loi, le décret ou la règle visée à l’article 134 garantissent, en tenant compte des obligations correspondantes,lesdroitséconomiques,sociauxetculturels,etdéterminentlesconditionsdeleurexercice.
Cesdroitscomprennent notamment :
[…]
2°ledroitàlasécuritésociale,àlaprotectiondelasantéet à l’aide sociale,médicaleetjuridique; »
[…] »
On déduit de cette disposition un principe de légalité renforcée : la fixation des éléments essentiels des droits visés par cette disposition revient au législateur et non au pouvoir exécutif16 17 Le principe de légalité renforcé a pour objectif de protéger au mieux ces droits en soumettant l’adoption des textes qui les garantissent, mais aussi évidemment, la modification de ces textes, au processus législatif, ce qui implique au premier chef un débat démocratique.
Ceci ne veut pas dire que le législateur ne peut rien confier au Roi afin d’exécuter les lois qui mettent en œuvre ces droits. Il doit, en toute hypothèse, fixer les « élémentsessentiels » de ces droits, ce qui comprend « laportée,lesconditionsd’octroietlechampd’applicationpersonnel » du bénéfice de ce droit18
Or, comme on l’a vu ci-dessus, jusqu’à l’entrée en vigueur de cette loi, le législateur confiait au Roi le soin de fixer les conditions pour le bénéfice de l’aide juridique19, ce qui avait donné lieu à l’arrêté royal du 18
13 Proposition de loi tendant à garantir par une disposition légale le droit à l'aide juridique de deuxième ligne et à faciliter l'accès à celle-ci en augmentant les seuils d'accès, Avis de la Cour des comptes, Ch., Doc. parl., 2019-2020, 0463/004
14 Ces estimations ont été réalisées avant la crise sanitaire, il se pourrait qu’elles doivent être revues à la hausse, en tout cas temporairement.
15 L’impact budgétaire s’est fait ressentir pour la première fois dans le cadre de l’adoption du Budget des dépenses 2022. En effet, le système de rétributions des avocats pour leurs prestations pour l’aide juridique conduit à ce que ces derniers soient payés longtemps après les prestations…Ce qui, par ailleurs, n’est pas sans susciter certaines critiques (voir infra.)
16 S.L.C.E, avis 64.809/4 du 23 janvier 2019 sur un avant-projet de décret de la Région wallonne relatif à l’assurance autonomie portant modification du Code wallon de l’action sociale et de la santé, p. 12-17.
17 Voir sur cette question l’article très étayé de D. DUMONT, « Le « droit à la sécurité sociale » consacré par l’article 23 de la Constitution : quelle signification et quelle justiciabilité ? », in D. DUMONT (Dir.), Questions transversales en matière sécurité sociale, Bruxelles, Larcier, 2017, p. 30 à 42.
18 Ibidem, p.17.
19 Le législateur chargeait le roi de définir ce qu’étaient « des moyens d’existence insuffisants » (Article 508/13, alinéa du C.J. ancien)
9 Etat de la Question 2021 • IEV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
décembre 2003. Cette situation n’était pas conforme au principe de légalité renforcée précitée. Jusque-là, le Roi pouvait facilement réduire à peau de chagrin l’aide juridique sans aucun contrôle démocratique a priori.
Avec la loi du 30 juillet 2020, le législateur a fixé lui-même ces conditions et abrogé l’article 508/13 du Code judiciaire. Ceci constitue une meilleure protection du droit à l’aide juridique20, conformément à notre constitution.
3. Un refinancement bienvenu mais des réformes « qualitatives » de l’aide juridique qui se font attendre
3.1. L’aide juridique de deuxième ligne reste inadaptée pour le public le plus vulnérable
Le refinancement substantiel de l’aide juridique de deuxième ligne doit être salué. Cette mesure permettra à davantage de personnes de bénéficier de l’assistance d’un avocat gratuitement ou moyennant le paiement d’une faible contribution. Ceci conduira inévitablement à améliorer l’accès à la justice et par conséquent l’Etat de droit.
L’aide juridique de deuxième ligne offre une solution pour un grand nombre de citoyens ayant peu de moyens. Toutefois, telle qu’elle est conçue actuellement, elle peine à répondre à un public qui en a particulièrement besoin : les personnes les plus vulnérables, c’est-à-dire « les personnes qui font face à plusieursproblèmessociojuridiquesrisquantdelesmeneroudelesmaintenirdansunesituationd’exclusion sociale »21
Ce constat a été étayé par E. DERMINE et E. DEBOUVERIE du Centre de droit public de l’ULB dans leur « Etude sociojuridique et de droit comparé concernant un projet pilote de cabinets dédiés à l’aide juridique »22
Ces deux chercheuses ont identifié une série de causes qui rendent les services de l’aide juridique de deuxième ligne soit inaccessibles, soit inadaptés pour les personnes les plus vulnérables qui se trouvent dans des situations sociojuridiques complexes23
En ce qui concerne l’inadaptation de l’aide juridique de seconde ligne, elles constatent que la distance culturelle de l’avocat et de son client, personne vulnérable, rend difficile la prise en charge adéquate des dossiers de ces derniers : une personne dans la grande précarité, en situation de crise, demande une approche particulière en termes de communication et de compréhension des mécanismes sociopsychologiques liés à la grande vulnérabilité et donc de la situation concrète de leur client
Également, ces deux chercheuses soulèvent que la segmentation du traitement des problèmes sociojuridiques due par la désignation d’un avocat par affaire qui ne se trouve pas nécessairement en contact avec son confrère désigné pour la même personne dans un autre dossier, ne permet pas une vision globale pour la défense des intérêts du client qui fait face à de nombreux problèmes sociojuridiques. De même, ces personnes sont la plupart du temps également suivis par des assistants sociaux qui, en l’absence de point de contact institutionnalisé, ont peu de relations avec les avocats désignés, alors que leur approche sociale
20 Notons que dans la proposition initiale du groupe Ecolo, il était envisagé de conserver une habilitation au Roi afin de modifier, abroger ou remplacer les dispositions légales proposées qui encadre l’aide juridique. Cette habilitation s’éloignait évidemment de la rigueur constitutionnelle. Fort heureusement, cette option n’a pas été retenue.
21 E. DERMINE, E. DEBOUVERIE, Etude sociojuridique et de droit comparé concernant un projet pilote de cabinets dédiés à l’aide juridique, janvier 2019, p.13
22 E. DERMINE, E. DEBOUVERIE,Etudesociojuridiqueetdedroitcomparéconcernantunprojetpilotedecabinetsdédiésàl’aidejuridique, janvier 2019, disponible ici
23 Ibidem, p. 29 et s.
10 Etat de la Question 2021 • IEV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
pourrait être très utile pour une compréhension globale de la situation du client et donc une meilleure défense de ses intérêts.
Enfin elles soulignent que l’aide juridique de deuxième ligne telle qu’elle est conçue semble pousser à recourir davantage à la procédure judiciaire, et à négliger ainsi les modes alternatifs de règlements des conflits, comme la transaction ou la médiation, souvent plus aptes à offrir des solutions efficaces pour ce public
En résumé, il apparaît que le public le plus vulnérable présente des besoins complexes et chronophages auxquels l’aide juridique de seconde ligne telle qu’elle est conçue actuellement ne permet pas de répondre.
Elise Dermine et Emmanuelle Debouverie offrent une solution à ces difficultés, en parallèle avec l’aide juridique actuelle : la mise en place de cabinets multidisciplinaires composées d’avocats salariés par les pouvoirs publics, spécialisés dans différentes matières du droit, d’assistants sociaux et d’assistant administratifs, dédiés uniquement à l’aide juridique de deuxième ligne.
La composition multidisciplinaire (Avocats dans différentes matières et intervenants psycho-sociaux) de ces cabinets offre aux bénéficiaires de l’aide juridique une « approche holistique », qui permet « d’aborder la personnedanssaglobalitéenvued’apporteruneréponsecomplèteauxdifférentsproblèmessociojuridiques qu’ellerencontre »24
Le fait que les avocats soient salariés les libère du système de nomenclature et de leur permet de « passer letempsnécessaireaudéveloppementd’unecommunicationclaireetaccessibleauxjusticiablesainsiqu’au décodagedeleursdemandes.L’avocatnesebornepasàrésoudreunproblèmepourlequelilaétédésigné mais cherche à avoir une photographie complète des problèmes sociojuridiques rencontrés par les personnes.Letempspasséàrencontrerlesclientsetàbâtirunerelationdeconfiancemutuellepermetaux avocats et assistants sociaux de détecter en amont des situations problématiques avant qu’elles ne s’aggravent. L’offre de services s’élargit par là-même au-delà des services contentieux et s’ouvre aux prestationspréventivesetprécontentieuses »25 .
Cette solution, qui s’inspire de ce qui est pratiqué en Ecosse et au Québec, n’a pas encore reçu beaucoup d’écho politique.
L’accord de Gouvernement d’octobre 2020 ouvre toutefois une porte puisqu’il indique :
« Le Gouvernement évaluera également les possibilités d’améliorer l’accès et la qualité de l’aide juridique offerte aux publics vulnérables qui font face à une multitude de problèmes juridiques et sociaux. Dans ce cadre,uneapprochetransversaleetmultidisciplinaireseraenvisagée.Desprojetspilotesserontégalement possibles.
Laréformedel'aidejuridique,enconcertationaveclesbarreaux,serafinalisée. Le Gouvernement assurera une rémunération stable et correcte des avocats »26
A ce stade, il ne semble pas que le ministre de la Justice ait avancé à ce sujet. La note de politique générale pour 2022, c’est-à-dire le document qui en début de session parlementaire annonce les intentions d’un Ministre dans le cadre de ses compétences, est muette sur ce point27
11 Etat de la Question 2021 • IEV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -24 Ibidem, p. 46. 25 Ibidem, p.72.
26 Rapport des formateurs Paul Magnette et Alexander De Croo du 30 septembre 2020, p.48. 27 Note de politique générale « Justice et Mer du Nord », Ch., Doc. Parl., 2021-2022, 2294/016, p.24.
La société civile n’a toutefois pas attendu le monde politique. Très récemment, dans le cadre d’une initiative privée, un cabinet d’avocats a été créé selon la forme sociale de l’ASBL : Casa legal28 Cette structure qui cherche à offrir à ses clients la même approche globalisante décrite plus haut, emploie des avocates salariées et une intervenante psychosociale. Il semble également que ce cabinet dispose de relations étroites avec le tissu associatif qui met à sa disposition également des assistants sociaux29
Cette initiative innovante et courageuse – le statut de d’« avocat salarié » est généralement vu de manière négative par les ordres des barreaux30 – doit être vivement saluée31. Elle ne parviendra évidemment pas à solutionner, à elle seule, les difficultés soulevées plus haut en ce qui concerne l’inadaptation de l’aide juridique de seconde ligne au public le plus vulnérable. Un soutien des pouvoirs publics par la mise en place d’un cadre légal et l’institutionnalisation des contacts entre les différents prestataires de l’aide juridique nouvellement pensée, s’impose
3.2. La rémunération des avocats qui pratiquent l’aide juridique et l’enveloppe fermée
On ne peut imaginer une aide juridique de seconde ligne de qualité si ses acteurs principaux, les avocats, ne bénéficient pas de conditions de rémunérations correctes.
A deux égards, cet aspect doit être amélioré : le délai de paiement des indemnités de l’aide juridique (3.2.2) et la suppression de l’enveloppe fermée et l’indexation du point (3.2.2.).
3.2.1. Le délai de paiement des indemnités BAJ
Une autre problématique de l’aide juridique telle qu’elle est actuellement conçue réside dans les modalités de rémunération des avocats qui pratiquent l’aide juridique.
En effet, le système actuel implique une rétribution de l’avocat des mois, voire des années après les prestations
Les prestations réalisées au cours d’une année judiciaire doivent, en effet, être encodées uniquement lorsque le dossier est clôturé, au plus tard, le 30 juin Il s’en suit un long processus de contrôles croisés des déclarations des avocats concernant les prestations de l’aide juridique Les barreaux flamands contrôlent les prestations de l’aide juridique des avocats des barreaux francophones et vice et versa32 Ce contrôle a en principe lieu jusqu’à la fin de l’année33 L’indemnité est ensuite versée au cours de l’année suivante, potentiellement donc plusieurs années après la réalisation de la prestation34
Il va de soi que ce système n’encourage pas les avocats à pratiquer le « pro deo ». Une aide juridique de deuxième ligne de qualité passe nécessairement par une rémunération correcte à bref délai des avocats35
3.2.2. L’enveloppe fermée et l’indexation du point
Le budget de l’aide juridique est une enveloppe fermée : quelque soit le nombre de points de l’aide juridique pour une année considérée, le budget de l’aide juridique est le même. Si le nombre de prestation augmente (ce qui semble être la tendance), la valeur du point baissera.
28 https://casalegal.be/accueil/domaines-dactivite/
29 Interview de Casa Legal par Quentin Rey, administrateur d’Avocats.be, paru dans la Tribune n°205, disponible ici
30 Le salariat de l’avocat est vu par certains avocats comme portant atteinte à l’indépendance de l’avocat (E. DERMINE et E. DEBOUVERIE, Op.cit., p.75)
31 Le cabinet Casa Legal est lauréat du prix de l’économie sociale : https://prixdeleconomiesociale.be/actualites/laureats-2021
32 Avocats.be, Compendium de l’aide juridique 2017, p. 67-68
33 Ibidem, p. 67-68.
34 Avocats.be, Mémorandum pour la Justice – Mémorandum pour les élections fédérales 2019, p. 9-10, disponible ici
35 Plateforme « Justice pour tous », Le livre noir de l’aide juridique de 2e ligne : un jeu d’échec, 2017, p. 31.
12 Etat de la Question 2021 • IEV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Il est vrai que le Gouvernement est systématiquement intervenu d’un point de vue budgétaire afin d’éviter la réduction de la valeur du point due à l’augmentation du nombre de prestation de l’aide juridique36
Il n’y a toutefois aucune certitude à cet égard, il conviendrait donc de mettre fin à ce système de l’enveloppe fermée et de prévoir un montant fixe pour le point, qu’il y’aurait lieu de soumettre à l’indexation, comme le réclame Avocats.be.
Sur ce point seulement, le Ministre de la Justice a annoncé son intention d’agir dans le cadre de sa note de politique générale pour 2022 : « Dans l’année à venir, nous améliorerons les procédures internes afin que les honoraires puissent être versés plus rapidement. En concertation avec les partenaires, nous examinons comment simplifier les procédures et les formalités administratives requisespoursoumettreunedemanded’aidejuridiquededeuxièmeligne ».
Conclusions
L’accès à la justice pour tous est un droit essentiel pour le respect de l’Etat de droit.
Le sous-financement de l’aide juridique ces dernières années mettait sérieusement à mal cette garantie essentielle
La loi du 30 juillet 2020 apporte une partie de la solution en augmentant le budget de l’aide juridique et en consacrant légalement ses conditions d’accès.
Cette augmentation importante, permise par un contexte politique particulier, doit être vivement saluée. Il n’en reste pas moins que cette réforme n’apporte pas de solution à certains dysfonctionnements de l’aide juridique qui ont trait soit aux bénéficiaires de l’aide juridique, soit à ses prestataires.
Premièrement, il faut constater que l’aide juridique actuelle n’est pas adaptée pour les personnes les plus vulnérables, dans une situation d’exclusion sociale. La solution des cabinets d’avocats dédiés visant une approche holistique semble être la solution idéale.
Ensuite, le sort des « prestataires de l’aide juridique » doit également nous interpeller : une aide juridique de deuxième de ligne de qualité passe nécessairement par une rémunération correcte, stable et rapide des avocats. Le système actuel ne répond pas à cette exigence.
L’accord de Gouvernement d’octobre 2020 et la note de politique générale du Ministre de la Justice pour 2022 ouvre certaines perspectives… La suite dans un prochain « Etatdelaquestion » ?
13 Etat de la Question 2021 • IEV
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
36 E. DERMINE et E. DEBOUVERIE, Op.cit., p. 10-11 ; INCC, Recherche relative au système de rémunération de l’aide juridique de deuxième ligne, 2012, p. 16, disponible ici