






Emmy Lapointe (elle) redaction@impactcampus.ca
Cheffe de pupitre actualités
Jade Talbot (elle) actualites@impactcampus.ca
Cheffe de pupitre aux arts
Frédérik Dompierre-Beaulieu (elle) arts@impactcampus.ca
Chef.fes de pupitre société
Ludovic Dufour (il) et Joyce Shabani (elle) societe@impactcampus.ca
William Pépin (il) multimedias1@impactcampus.ca
Journaliste multimédia
Sabrina Boulanger (elle) photos@impactcampus.ca
Directeur général
Gabriel Tremblay dg@comeul.ca
Représentante publicitaire
Kim Létourneau publicite@chyz.ca
Journalistes collaborateur.rice.s
Julianne Campeau, Malika Netchenawoe, Camille Desjardins, Marie Tremblay Rosemarie Roy et Gaëlle Sweeney
Conseil d’administration
François Pouliot, Émilie Rioux, Daniel Fradette, Ludovic Dufour, Antoine Chrétien, Sara Lucia Pena, Félix Etienne, Alex Baillargeon et Kevin Michaud
Réviseures linguistiques
Maxence Desmeules et Érika Hagen-Veilleux
Impression
Publications Lysar inc.
Tirage : 2000 exemplaires
Dépôt légal : BAnQ et BAC
Impact Campus ne se tient pas responsable de la page CADEUL et de la page ÆLIÉS dont le contenu relève entièrement de la CADEUL et de l’ÆLIÉS. La publicité contenue dans Impact Campus est régie par le code d’éthique publicitaire du journal, qui est disponible pour consultation au : impactcampus. qc.ca/code-dethique-publicitaire
Impact Campus est publié par une corporation sans but lucratif constituée sous la dénomination sociale Corporation des Médias Étudiants de l’Université Laval.
1244, pavillon Maurice-Pollack, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6
Téléphone : 418 656-5079
ISSN : 0820-5116
Découvrez nos réseaux sociaux !
Paula Casillas (elle) production@impactcampus.ca @impactcampus
LE MAGAZINE DES ÉTUDIANT.ES DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
COLLABORATEUR.RICES RECHERCHÉ.ES

6 ACTUALITÉS
6 Le campus : en bref par Jade Talbot
8
ÉDITORIAL
8 Édito par Emmy Lapointe
10
DOSSIER
10 Salades et tisanes : saveurs et médecines hors des commerces par Sabrina Boulanger
16 Protéger le chant des oiseaux par Jade Talbot
22 Les saisons comme outil pour concevoir notre rapport au temps par William Pépin
66
LUDIQUE
66 Les jeux à surveiller pour avril par Ludovic Dufour
68 Régal auditif par l'équipe d'Impact Campus
70 Jeux Printaniers par l'équipe d'Impact Campus
32
32 Système scolaire à trois vitesses ou le gâchis des grandes personnes par Emmy Lapointe
38 Première fois : témoignages et autres fables menstruelles par Frédérik Dompierre-Beaulieu
46 Harry : serait-il le suppléant de Lady Diana ? par Joyce Shabani
50 L’arbre des sens par Jade Talbot
52 L’autisme au quotidien, témoignage d’une personne atteinte d’un TSA par Julianne Campeau
54 Origine et impact de la pelouse par Ludovic Dufour
58 L’annihilation des ouvrières par Marianne Richer
62 Équation printanière par Rosemarie Roy
ARTS - LITTÉRATURE
72 CHYZ 94.3 par l'équipe de Chyz
74 Sorties littéraires par Frédérik Dompierre-Beaulieu
76 Lumière sur l’Acadie littéraire par Gaëlle Sweeney
78 Nouvelle voix sur la scène québécoise : Cunnila par Joyce Shabani
80 La débâcle par Malika Netchenawoe
82 Simulation fleurie par Camille Desjardins
Le mois de mars a évidemment été marqué par le conflit entre l’Université Laval et le Syndicat des professeurs et professeures de l’Université Laval (SPUL). Les professeur.es, qui négocient leur convention collective, ont déclenché une grève de deux semaines le 20 février dernier, puis annoncé une grève générale illimitée le 13 mars. Et si la grève a beaucoup retenu l’attention ces dernières semaines, plusieurs nouvelles sont passées un peu sous le radar. Voici un bref retour sur les nouvelles du campus et les performances de nos étudiant. es-athlètes du Rouge et Or.

Recherches : feuilles d’érable, partenariat et microbiote
Un stagiaire postdoctoral de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation, Maxime Delisle-Houde, a découvert avec son équipe que les extraits de feuilles d’érable auraient le potentiel de lutter contre les maladies bactériennes chez les végétaux. Dans le cadre de cette recherche, l’extrait d’érable a été utilisé pour lutter contre les bactéries touchant les fraises et les tomates. Cette méthode a l’avantage d’être moins toxique que les produits sur le marché et pourrait permettre une valorisation des feuilles d’érable qui tombent des arbres, soit celles dans les érablières ou celles récoltées par les municipalités à l’automne (ULaval nouvelles, 2023).
Le Centre de recherche du CHU de Québec – Université Laval et l’Association québécoise autochtone en science et en ingénierie viennent de créer un partenariat de cinq ans dans le but de promouvoir la recherche scientifique auprès des jeunes Autochtones. Cette entente « s’inscrit dans une volonté commune des deux organisations d’encourager la créativité, la persévérance et la curiosité chez les jeunes Autochtones, notamment par la tenue de l’Expo-Sciences Autochtone Québec » (Robert, 2023).
Une équipe de l'École de nutrition, du Centre NUTRISS et de l’Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels a constaté que la composition du microbiote intestinal, qui comprend l’ensemble des organismes vivant dans notre intestin, change dans les deux jours où des modifications à notre diète ont été apportées et que « l’abondance de certains acides gras produits par le microbiote réagit rapidement aux changements dans l’alimentation » (Hamann, 2023). Finalement, l’équipe a découvert que « lorsque le microbiote est diversifié au départ, il demeure plus résilient face aux changements dans l'alimentation » (Ibid.).
Rouge et Or : la fin de la saison
Au moment d’écrire ces lignes, nous sommes vers la fin de la saison du Rouge et Or. Plusieurs équipes ont terminé la leur alors que d’autres n’ont plus que quelques rencontres au calendrier. Nos équipes de basketball sont de celles qui ont fini. Après une saison où elles ont tout donné, étant deuxième au classement de saison avec une fiche de 9 victoires et 7 défaites, les Lavalloises se sont inclinées face à l’UQAM lors des éliminatoires. Le scénario est sensiblement le même chez les hommes, qui ont perdu 86
à 100 contre Bishop’s lors des éliminatoires. On se rappelle que, en milieu de saison, ces derniers avaient réussi une série de 6 victoires de suite, ce qui leur avait permis d’atteindre la deuxième place au classement.
Les 10 et 11 mars derniers avait lieu le championnat canadien d’athlétisme (U SPORTS) à Saskatoon, en Saskatchewan. Le Rouge et Or a remporté pour l’occasion 2 médailles d’or (course 600 mètres chez les femmes et saut en longueur féminin) et 4 de bronze, soit pour les 1000 et 1500 mètres chez les femmes, le lancer du poids masculin et le relais masculin 4x200 mètres. Après une quatrième place lors d’une compétition à Trois-Rivières, l’équipe de cheerleading s’est rendue à Lévis, le dimanche 19 mars, afin de participer au championnat provincial du Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). Au terme de cette compétition, l’équipe du Rouge et Or a obtenu la troisième position sur le podium. Il s’agit de la troisième saison de suite où l’équipe remporte le bronze au championnat du RSEQ.
La saison de soccer intérieur tire à sa fin, il ne reste que quelques rencontres au calendrier. En date du 20 mars, l’équipe féminine se positionne première au classement du RSEQ avec une fiche de 6 victoires et de 1 défaite. Chez les hommes, l’équipe est présentement troisième au classement avec une fiche de 2 victoires et de 1 défaite.
Hamann, J. (2023). Le microbiote intestinal réagit rapidement aux changements dans l’alimentation. ULaval nouvelles . https://nouvelles.ulaval.ca/2023/03/08/lemicrobiote-intestinal-reagit-rapidement-aux-changementsdans-lalimentation-a:4cf27479-daa7-4c5a-bcad89280de1232f
Robert, M.-C. (2023). Entente pour la promotion de la recherche scientifique auprès des jeunes Autochtones. ULaval nouvelles. https://nouvelles.ulaval.ca/2023/03/16/ entente-pour-la-promotion-de-la-recherche-scientifiqueaupres-des-jeunes-autochtones-a:56837847-3891-47fb91e4-a9d5a98c1f6e
ULaval Nouvelles (2023). Les extraits de feuilles d’érable pour protéger les cultures des bactéries. ULaval nouvelles. https://nouvelles.ulaval.ca/2023/03/16/les-extraits-defeuilles-derable-pour-proteger-les-cultures-des-bacteriesa:3923b3b9-74d1-4949-8db3-b9d11568b5a3
J’écris ces lignes au lendemain de l’annonce des négociations rompues entre le Syndicat des professeurs et des professeures de l’Université Laval (SPUL) et l’administration. Les négociations ne pourront être reprises avant le 24 mars. L’AELIÉS a annoncé son appui au SPUL et mène présentement un référendum de grève. Au moment où vous lisez ces lignes, on est peut-être dans la première semaine d’avril ou en plein mois de juillet. Dans le premier cas, j’espère que les cours ont repris et que la session n’est plus menacée, et surtout, qu’une entente pérenne a été conclue. Dans le second cas, j’ose imaginer que le conflit SPULadministration de l’université aura pris fin et paraîtra même loin, et que ce que j’écris ici ne semblera donc pas intéressant.
Par Emmy Lapointe, rédactrice en chefLa photo des professeur.es qui manifestent au centre-ville ne semble pas périmée, pourtant, la phrase tirée du même article que la photo, « Ce matin, 2 mars, avait lieu une Assemblée générale spéciale du SPUL. Après avoir présenté aux membres l’état de la situation, un vote pour une grève générale illimitée devant débuter le 13 mars a été proposé, puis adopté par près de 94,5 % des membres présents », l’est. C’est un peu le truc magique des photos: dès qu’elles existent, elles semblent appartenir à un passé toujours un peu lointain.

Les photos du chalet de la fin de semaine dernière, celles de ma mère en cinquième secondaire, celles du mariage d’Olivette et de Magella semblent toutes vieilles. Alors que le réel, pour être écrit ou pour être lu plutôt, doit vieillir. De combien de temps, je ne sais pas, mais il doit vieillir. Et je dis réel, mais je pense que c’est plutôt le réel qui appartient au collectif qui prend du temps à redevenir digeste, parce que le réel de l’intime semble toujours appartenir à l’autre, alors on le découvre tandis que le nôtre doit d’abord s’éloigner pour qu’on s’y approche de nouveau.
C’est qu’il faudrait que les choses deviennent un peu étrangères pour qu’on s’y intéresse à nouveau, et la photo, contrairement aux mots sans doute, nous est toujours étrangère.

Pourtant, dans l’étrangeté initiale, on finit toujours par retrouver ce que l’on connaissait, les choses se rappellent à nous. Ma directrice de maîtrise a écrit, dans Chasse à l’homme, « que la joie prend la forme du retour. La joie nous est connue : elle est ce qu’on connaît, qui réapparait.» ma directrice de maîtrise.
C’est une chose que l’on doit faire alors, s’éloigner un peu, laisser le temps aux choses, au vécu de vieillir, comme le levain. Mais comme le levain (ou comme un cahier des charges remis en mai 2022), il ne faut pas attendre qu’il coule de partout et envahisse nos armoires et qu’il faille en venir aux grands moyens.

Le printemps défait le sol de son manteau blanc et l’innonde d’un soleil généreux, c’est la meilleure des grasses matinées. Dans la forêt, c’est la saison où le sol est le plus exposé à la lumière, avant que les arbres gourmands ne la retiennent dans leur feuillage. Par le temps que les géants verdissent, le sol grouille déjà de petits végétaux qui dressent l’échine, pressés de vivre, premières taches éclatantes dans le monochrome de bruns. Pour le.a cueilleur.euse, le printemps annonce le retour de l’abondance.
Par Sabrina Boulanger, journaliste multimédia
Le.a cueilleur.euse ira récolter les têtes de violon, les racines de bardane, la sève du bouleau, le tussilage, les pousses de sapin. Bien que l’épicerie donne accès à tout le nécessaire pour se nourrir, on peut avoir envie de sortir des allées aux produits qui semblent exempts de saisonnalité pour moult raisons. Pour moi, la cueillette est une façon de se déposer, de prendre le temps d’observer et de suivre un rythme plus grand que soi. Généralement, on considère cette pratique comme un complément à l’alimentation : c’est le pourpier qui met du croquant au sandwich, la gelée de cèdre qui accompagne le fromage, le poivre des dunes qui goûte l’ici plutôt que l’ailleurs. La forêt est aussi une pharmacie naturelle dont le savoir n’est plus aussi commun qu’il l’a déjà été – il y a de quoi soigner beaucoup de maux, herboristes et aîné.es en savent quelque chose. La cueillette m’apparaît comme un acte engagé – c’est s’attacher à un lieu et le respecter pour faire partie de celleux qui assurent sa pérennité. Pérennité des paysages, des écosystèmes, de la biodiversité, des sols… de la santé globale de l’endroit.
De la ville à la forêt, il y a trésors à dénicher. Il faut simplement garder en tête les contaminants potentiels des endroits où l’on cueille. Ainsi, il vaut mieux ne pas cueillir la quenouille qui pousse près d’un rejet d’eaux usées, étant une plante filtrante.

le printemps citadin guetter la débâcle des toitures en marchant sur les trottoirs où les souliers crissent sur la garnotte d’une carrière entière
les visages-tournesols s’ouvrent après les carences, heureux du retour du chant des rivières canalisées dans les gouttières
On peut associer les changements dans les habitudes de cueillette à la configuration sociale actuelle; le modèle agricole qui s’impose à la moitié du 20e siècle fait passer l’agriculture de subsistance (familiale, pour la consommation personnelle) à l’agriculture productiviste (industrielle et marchande) (Doucet, 2020). Ces gens qui cueillaient complémentairement à l’agriculture délaissent la pratique, puisque c’est désormais incompatible avec leur profession. Pinton, Julliand et Lescure (2015) s’intéressent à cette pratique devenue plus marginale, et observent un changement chez les cueilleur.euses : ce sont maintenant beaucoup de néo-ruraux.ales qui revisitent ce patrimoine culturel ayant un pied dans les oubliettes, attiré.es par l’usage populaire des végétaux. Le portrait français diffère certainement de celui du Québec, mais je lis dans leurs propos beaucoup de similitudes avec ce que j’observe ici. Les plantes sauvages ont eu un regain de popularité, mais la cueillette se trouve dans un flou de gestion. En effet, l’offre en produits sauvages a augmenté dans les dernières années, et il y a lieu de se questionner quant à l’éthique de travail.
En France, l’encadrement a partiellement été assumé par l'Association Française des professionnels de la Cueillette de plantes sauvages (AFC), qui a créé un guide des bonnes pratiques. Ce qui est intéressant, c’est que l’association est composée de cueilleur.euses et que le guide combine leur savoir d’usage et leur sensibilité à l’environnement. Ladite sensibilité étant pour certain.es strictement liée à la durabilité de leur travail, qui est directement impactée par une mauvaise gestion des ressources, mais pour d’autres

elle incarne littéralement la cueillette. Dans tous les cas, cette approche est tout le contraire du modèle qui a été adopté en agriculture, soit une gestion étatique top-down productiviste dont nous avons hérité, et qui a mis à mal les pratiques agricoles traditionnelles. L’initiative de l’AFC est ainsi d’une grande pertinence pour la préservation des savoirs : « il s’agit pour les cueilleurs de retrouver (ou ne pas perdre) ce dont a été privé l’agriculteur en se professionnalisant, c’est-à-dire une proximité avec les processus naturels au profit d’un savoir savant et technique venu d’en haut. » (Pinton et al., 2019, p. 9).
Cueillette au Québec
Antoine Taillon, qui a étudié en agronomie à l’Université Laval et qui pratique actuellement en agroforesterie, me décrit les trois types de cueilleur.euses professionnel.les au Québec. Il y a d’abord celleux qui cueillent sur les terres publiques. Leur terrain de jeu est immense; iels peuvent y circuler et y cueillir librement, et c’est cette liberté qu’iels recherchent.
Il y a ensuite les cueilleur.euses paysan.nes, qui créent de bonnes relations avec des propriétaires de terres privées de leur région afin de cueillir et entretenir les talles qui s’y trouvent et qui ne sont pas utilisées. Le milieu en bénéficie puisqu’il est sous l’œil attentif de quelqu’un qui a à cœur sa santé, et les ententes entre voisin.nes solidifient des liens de confiance.
Enfin, Antoine nomme les fermier.ères forestier.ères, bien qu’iels débordent de la seule cueillette sauvage. En effet, ces dernier.ères portent une attention particulière à leur
forêt afin de bien la comprendre et d’en optimiser l’abondance. Iels y feront donc des aménagements particuliers pour développer la croissance d’espèces adaptées à l’écosystème, qu’iels cueillent pour la consommation humaine. Antoine affirme que la clef pour développer le potentiel unique de chaque forêt repose sur l’harmonie entre le savoir-faire du.de la fermier.ère forestier.ère ainsi que sa sensibilité aux caractéristiques de cet espace. En grand mycophage, Antoine voit un intérêt à faire pousser dans les forêts qui l’entourent une sélection de champignons comestibles qui y sont appropriés. Les champignons sont des vivants qui, souvent, fructifient très rapidement et vieillissent tout aussi vite, il s’avère donc utile d’avoir des talles près de chez soi afin de les cueillir à leur meilleur. Pour celleux qui ne sont pas des cueilleur.euses de profession, cette pratique permet par ailleurs d’augmenter le volume de la récolte pour en faire un revenu d’appoint (ou pour en faire don à des ami.es!).

Premiers pas
S’enthousiasmer à l’idée de croiser des chanterelles lors d’une marche, ce n’est pas forcément naturel pour chacun.e d’entre nous. Moi, on m’a enseigné une nature dangereuse
et indigeste hors des vergers et des fraisières. On m’a fait jouer à arracher toutes les « mauvaises herbes » d’une pelouse pour que celle-ci rayonne par son uniformité. Et surtout, on m’a fait promettre de ne jamais au grand jamais toucher à un champignon, sans quoi je risquerais une mort brutale.
Je me souviens de la première fois que j’ai mangé une fleur. Je devais avoir 7 ou 8 ans, c’était chez mes deuxièmes voisin.es. Je n’y croyais pas, que ça se mangeait, et j’ai regardé les autres faire avant de timidement mettre la mienne sous la dent. Est-ce que je vais m’empoisonner ? Ni décès ni indigestion n’ont été déclarés sur ma rue ce jour-là, la violette est bien comestible. (Note : ceci n’est pas une invitation à croquer n’importe quelle fleur.)
J’ai vieilli et je me suis mise à aimer le plein-air. J’ai aimé monter des montagnes pour les grands paysages verts d’arbres et bleus de lacs. Puis la montée est devenue moins une course au point de vue qu’une expérience entière : j’ai aimé toucher la mousse moelleuse, observer les dessins des lichens, être surprise de trouver des framboises, et être fière de distinguer l’aulne crispé de
l’aulne rugueux. J’ai aimé trouver le grandiose dans le minuscule.
Apprendre à reconnaître les plantes, apprendre leurs propriétés, apprendre quelles parties sont intéressantes à consommer et comment, apprendre à les conserver. Le chemin est long avant d’avoir un répertoire mental fourni, mais il en vaut la peine. On y va une plante à la fois, on s’assure d’être certain.e de ce qu’on identifie, on s’outille et on fait valider nos hypothèses, on se fie à tous ses sens. La cueillette demande de distinguer les essences d’arbres, les sols compacts par rapport aux sols meubles, bref, elle demande d’être attentif.ve à un milieu dans son ensemble, car c’est tout ce milieu qui fait partie de l’identification d’une plante, qui elle-même comprend des sections à délimiter. Feuilles, boutons floraux, tiges, fleurs, tubercules, fruits, racines, chatons, graines : les plantes peuvent présenter de l’intérêt de la tête au pied, parfois à l’année longue, parfois à des moments précis dans lesquels on doit les attraper. C’est un monde qui peut sembler intimidant et infini, mais il se laisse amadouer lorsqu’on s’arme de patience.



Amours et devoirs
L’humain qui cueille doit penser aux animaux qui prisent les mêmes délices. Après avoir réfléchi à sa propre consommation pour limiter sa récolte au nécessaire, on m’a enseigné la règle des tiers : un pour moi, un pour le prochain (vraisemblablement animal) et un pour la régénération de la plante. Ce n’est cependant pas un absolu – plusieurs plantes requièrent de plus grandes précautions. C’est donc dire que si certaines espèces, comme le pissenlit, sont abondantes, d’autres ont un statut plus précaire et font l’objet d’une protection totale ou partielle. Le ginseng à cinq folioles ou l’ail des bois, par exemple, ont un historique de cueillette intense, en plus d’avoir un cycle de reproduction particulièrement long, ce qui les a placés en situation de précarité aujourd’hui. Le.a cueilleur.euse, qu’iel soit amateur.rice ou professionnel.le, se doit ainsi de consulter et de respecter le Règlement sur les espèces floristiques menacées ou vulnérables et leurs habitats. Si ce n’est pas par respect du caractère sacré du territoire, ce sera à tout le moins pour profiter longuement des merveilles qu’offre la forêt qu’il est du devoir du.de la cueilleur.euse d’appliquer les dispositions nécessaires à son bien-être.
Les cueilleur.euses que je connais aiment sortir cueillir pour mille et une raisons. Le sentiment de proximité avec l’environnement, l’émerveillement devant la diversité de saveurs, la curiosité pour le territoire et ce qu’il recèle, la satisfaction de manger et de partager des choses que l’on a soi-même cueillies, le temps passé en forêt seul.e ou accompagné.e, l’excitation liée à ne pas savoir sur quoi on va tomber, le désir d’autonomisation, la connexion avec sa culture… Ces personnes cueillent toutes dans des contextes différents, mais l’affection pour la pratique est

C’est sous les tilleuls qu’on fait les rêves les plus doux
convergente dans les discours. Chez moi, j’adore offrir des tisanes de plantes que j’ai moi-même cueillies – pour le sommeil, pour les crampes menstruelles, pour la digestion, pour le rhume… il y en a pour tout, ne serait-ce qu’un bon breuvage chaud à partager. D’autres affectionnent les grandes tablées qui rassemblent autour des cueillettes pour en faire des festins. Mais attention : entre le partage des connaissances et des aliments et le partage de la localisation des talles, il y a un grand pas ! N’a pas accès à ces secrets bien gardés n’importe qui !
Si tu tombes sur une morille, c’est parce que c’est elle qui t’a trouvé.e
Le plantain a suivi les pas des blanc.hes, la plante s’enracinant partout où iels posaient les pieds ici
Tant de dictons qui rappellent que l’usage des plantes appartient à notre patrimoine culturel depuis fort longtemps, et qui donnent envie d’en cultiver la mémoire. La cueillette, professionnelle ou pas, permet une belle proximité avec la
nature et lui révèle un nouveau visage. L’ortie ne semble plus malicieuse, les hémérocalles paraissent plus intéressantes, et le désir de les soigner, elles et toutes les autres, s’en trouve grandi.

Doucet, C. (2020). Le modèle agricole territorial. Nouveaux rapports entre agriculture, société et territoire. Presses de l’Université du Québec, 152 p.
Julliand, C., Pinton, F., Garreta, R., Lescure, J.-P. (2019) Normaliser le sauvage : l’expérience française des cueilleurs professionnels. EchoGéo, 47. DOI : https://doi. org/10.4000/echogeo.16987
Pinton, F., Julliand, C., Lescure, J.-P. (2015). Le producteurcueilleur, un acteur de l’interstice ? Anthropology of Food, 11. DOI: https://doi.org/10.4000/aof.7902
Peut-être que je me lève plus tôt ces temps-ci, peut-être que certains oiseaux sont de retour au Québec, peut-être que j’y porte plus attention, mais une chose est certaine, depuis quelques semaines, j’entends les oiseaux chanter à ma fenêtre avec un air qui m’annonce que les beaux jours s’en viennent. C’est dans un contexte similaire, mais avec beaucoup plus d’initiative, qu’est né le projet For the Birds: The Birdsong Project mené par Randall Poster et Rebecca Reagan. Visant à célébrer la joie que nous apportent les oiseaux et à nous sensibiliser aux dangers qui les menacent, le projet m’a donné envie d’explorer un peu plus l’univers des oiseaux, notamment de ceux que l’on pourrait croiser entre deux pavillons. Pour m’aider, j’ai rencontré Pierre Legagneux, professeur adjoint au département de biologie de la Faculté des sciences et génie. Il m’a parlé des oiseaux du campus, de ce qui menace la survie des oiseaux, mais aussi de la science et du beau.
Par Jade Talbot, cheffe de pupitre actualités
For the Birds: The Birdsong Project C’est complètement par hasard, en écoutant la radio, que j’ai découvert une musique qui me transportait sur une île paradisiaque. Il s’agissait de Rare Birds, d’Andrew Bird. La pièce fait partie du quatrième volume de l’album For the Birds qui regroupe des pièces originales de plus de 220 artistes. Des musicien.nes, poète.sses, acteur.rices, artistes littéraires et visuel.les uni.es par la vision de Randall Poster et de Rebecca Reagan nous offrent une mosaïque musicale hors de l’ordinaire. Au moment où la population était forcée à s’isoler, Randall est devenu beaucoup plus conscient des oiseaux qui l’entouraient. Passant de plus en plus de temps à les écouter, il a redécouvert la joie et les mystères de leur chant. Il s’agissait pour lui d’une distraction magique et d’une inspiration (Poster, 2022).
Un an plus tard, ce sont 172 pièces uniques qui ont été créées et qui nous rappellent la beauté des oiseaux et l’importance de cueillir leur chant lorsqu’il passe entre nos oreilles. L’œuvre vise aussi à nous sensibiliser aux menaces que subissent les oiseaux, de la déforestation en passant par les changements climatiques. Mais plus encore, les sommes amassées par la vente des albums ainsi que des produits dérivés sont remis à la National Adubon Society, qui « protège les oiseaux et les habitats dont ils ont besoin, aujourd’hui et demain, en Amérique à travers la science, les plaidoyers, l’éducation et d’action sur le terrain » (Adubon, 2022).
De l’ABP au Desjardins, les oiseaux chantent En tendant l’oreille, vous pourrez certainement entendre les oiseaux qui peuplent le campus. Résidents à l’année longue ou encore de passage au gré des saisons, ils investissent les boisés, les haies denses, les grands espaces verts et même les stationnements (Service des immeubles, 2013). Dans un rapport sur la biodiversité du campus, on apprend qu’entre 1971 et 2013, 127 espèces d’oiseaux ont été observées au moins une fois dans l’enceinte de l’université. Il s’agit d’un nombre impressionnant lorsqu’on le compare au nombre d’espèces observables dans la région (176) (Ibid.).
Lors de notre rencontre, Pierre Legagneux m’a expliqué que de façon générale, les espèces sédentaires du sud du Québec sont observables sur le campus. Cela n’empêche pas, à l’occasion, de retrouver certaines espèces surprenantes, dont le chevalier solitaire, un oiseau que l’on retrouve généralement dans les milieux humides et côtiers. D’autres espèces, dont le bruant chanteur, le jaseur d’Amérique, les parulines ainsi que le merle d’Amérique seront de passage sur le campus avant de migrer vers le sud pour l’hiver. Comme elles sont adaptées aux milieux urbains, vous risquez de croiser des espèces telles que la corneille d’Amérique ou encore d’autres, invasives, comme le moineau domestique et l’étourneau sansonnet. Certains rapaces habitent également le campus : il s’agit entre autres d’éperviers, de faucons et de crécerelles. Finalement, plusieurs espèces peuvent vivre sur le campus à l’année longue.

C’est le cas des geais bleus et des mésanges à tête noire, des chardonnerets, des sittelles, des pics bois et des cardinaux rouges.
Outre le climat, auquel certaines espèces ne sont pas adaptées, ce sont surtout les ressources qui détermineront leur capacité à habiter le campus. Certaines espèces, dont le geai bleu et la mésange à tête noire, ont d’ailleurs développé des stratégies afin de passer l’hiver ici. Un peu à la façon des écureuils, ces oiseaux se font des caches, en plaçant des graines dans les arbres, qui leur permettent un accès à la nourriture tout au long de la saison. Cependant, afin de survivre à certains événements empêchant l’accès à ces ressources, comme une tempête de neige, ils utilisent leur réserve de gras. Cette stratégie leur permet de survivre environ deux à trois jours sans nouvel apport de nourriture. Finalement, il arrive que ces stratégies ne soient pas utilisées, si les ressources sont toujours disponibles. Ils peuvent alors se déplacer de ressources en ressources afin d’obtenir la nourriture nécessaire à leur survie. Toute espèce a besoin d’un lieu pour se nourrir, s’abriter et se reproduire. C’est son habitat. Ainsi, si plusieurs espèces habitent le campus, c’est qu’elles ont trouvé un milieu qui répond à leurs besoins.
Parfois les oiseaux tombent
Différents événements peuvent menacer les habitats et, par le fait même, la capacité des espèces à subvenir à leurs besoins. Toutefois, d’un milieu à l’autre, ces menaces sont plus ou moins grandes. Plusieurs facteurs doivent être pris en compte afin d’analyser les effets de ces événements sur les habitats. Pierre Legagneux me donne l’exemple d’une coupe forestière. D’abord, s’il s’agit d’une coupe légère, elle entraînera la régénération de la parcelle coupée. Les arbres, matures, laisseront place aux arbustes et aux jeunes arbres. Cette transition, qui entraîne un changement des ressources disponibles, peut être bénéfique pour certaines espèces. Parfois, aussi, la coupe apporte un changement dans l’utilisation de la parcelle. Par exemple, dans les années 1800, de petites terres agricoles émergeaient des coupes forestières et plusieurs oiseaux en ont ressenti des effets bénéfiques. C’est le cas de l’hirondelle bicolore, qui a vu son nombre d’individus augmenter. Un paysage hétérogène, composé d’une multitude de parcelles aux fonctions et ressources différentes, augmente généralement la biodiversité. Ces parcelles créent une mosaïque d’habitats; chaque boisé, champ, haie, cours d’eau est une occasion d’accueillir une multitude d’espèces.
À l’inverse, la coupe forestière peut également avoir des effets très dommageables pour la biodiversité. Ils se font
surtout ressentir lorsqu’il s’agit de coupe à blanc sur de grandes superficies. Témoins et victimes de l’évolution de nos pratiques agricoles, de l’introduction du tracteur à celle des pesticides, les oiseaux subissent une perte d’habitat au profit de grandes superficies agricoles. Cette nouvelle façon de faire transforme le paysage en masse homogène, dommageable pour la biodiversité. Mais il n’y a pas que la coupe forestière qui transforme les milieux.
Outre les forêts, les zones humides sont également convoitées, moins pour leurs ressources que pour la superficie qu’elles occupent, et la future utilisation que l’on pourrait en faire. Partout sur la planète, donc, nous asséchons les zones humides, endroits riches en biodiversité. Aujourd’hui, notre hirondelle bicolore se retrouve menacée. Pour elle, ces transformations signifient une diminution de la capacité d’accueil du milieu, tout comme une diminution des ressources, notamment des insectes dont elle se nourrit. De plus, elle se retrouve en compétition avec le moineau domestique. Pour éviter son déclin, certaines actions peuvent être posées. En plus de la conservation des zones humides, la pose de nichoirs permet à ces milieux d’augmenter leur capacité d’accueil pour les oiseaux.
Bien qu’on entende beaucoup parler de la crise climatique, ses effets ne sont pas la plus grande menace pour la survie des oiseaux. Selon le professeur Legagneux, de toutes les causes du déclin des oiseaux, environ 7 % serait attribuable aux changements climatiques. Le réchauffement de certains milieux mènerait à une modification de l’aire de répartition de plusieurs espèces. Certaines verraient même leur niche climatique – la répartition de l’espèce en fonction des conditions climatiques – diminuer. Ce changement est attribuable au climat qui modifie les habitats, une forêt de pins accueille désormais une érablière, par exemple.
Si la perte d’habitat est une des principales menaces pour les oiseaux, certaines espèces le sont également. Ici, on parle surtout des rats et des chats. En 2013, une étude sur l’impact des chats domestiques sur la faune des États-Unis a estimé que ces félins tuaient entre 1,3 et 4 milliards d’oiseaux par an (Loss et al ., 2013). Il s’agirait de la principale cause de mortalité des oiseaux, surtout en milieu agricole. En ce qui concerne les rats, leur introduction sur les îles, généralement riches en biodiversité, menace la survie des oiseaux. Les rats, se déplaçant facilement n’importe où, se rendent dans les terriers de certaines espèces afin de manger les œufs, menaçant ainsi la reproduction des espèces. Enfin, certaines maladies peuvent également être transmises aux oiseaux par quelques mammifères.

Finalement, certaines actions humaines menacent directement les oiseaux. C’est le cas de la chasse. Un peu comme l’agriculture, une chasse de subsistance, avec de petites populations isolées, ne menacerait pas les oiseaux. Cependant, dans un passé pas si lointain, alors qu’on ne se souciait guère de la surexploitation, plusieurs espèces ont été chassées jusqu’à extinction. C’est le cas notamment du grand pingouin. Ce dernier ne volait pas, faute de prédateurs terrestres, et fut chassé massivement par les Européens jusqu’à disparaître complètement vers la fin du 19e siècle. Ainsi, les menaces à la survie des oiseaux sont multiples, de la perte de ressources et d’habitats aux prédateurs et à la surexploitation. Préserver ces espèces demandera des actions concrètes. Au-delà des organismes comme le National Adubon Society , d’autres acteurs peuvent jouer un rôle dans la protection de la biodiversité et des oiseaux.
Du scientifique à l’artiste Vers la fin de ma rencontre avec Pierre Legagneux, nous avons parlé de science et des différent.es acteur.rices qui permettent de passer de la découverte à la pratique. Dans le cas, par exemple, de la découverte d’un phénomène qui nuit à la biodiversité, le.a scientifique se doit d’acheminer l’information aux personnes qui pourront mettre en place des mesures pour protéger la biodiversité. Ces personnes sont généralement nos politicien.es, les décideur.euses politiques, celleux qui possèdent les leviers les plus importants pour éventuellement changer la façon dont la société fonctionne. Pour alerter les décideur.euses, les scientifiques passent plus souvent qu’autrement par les médias. Selon Legagneux, « le journaliste doit se nourrir du scientifique et inversement pour aller jouer sur les décideurs ». Il identifie également un quatrième acteur, l’industrie. Ce « gros joueur » devra, lui aussi, faire partie des solutions afin de protéger la biodiversité. Toustes ces acteur.rices devront travailler de concert afin de protéger notre planète.
Mais les artistes, est-ce qu’iels ont un rôle? Certainement. Selon Pierre Legagneux, « le scientifique est là pour documenter les faits, pour comprendre les choses. Un artiste va à peu près avoir la même démarche créative pour comprendre, pour interpréter, mais sa façon de rendre l’information va être complètement différente et ne va pas toucher au rationnel, elle va toucher à l’émotif ». Les artistes joueraient donc plus un rôle au niveau de la sensibilisation. Par leur art, iels nous transmettent des messages et nous touchent, nous incitent à créer un monde plus beau. Comme le fait The Birdsong Project.
En général, [les scientifiques et les artistes] sont touchés par la même chose. Si moi je travaille sur les oiseaux, c’est parce que ça m’a touché depuis tout petit, les oiseaux de ferme, peu importe, au départ peu importe où tu commences, mais ça touche dès l’enfance, ça touche la corde sensible et l’artiste c’est pareil, c’est cette corde sensible qui est touchée. Et après on développe différentes habilités puis peu importe comment, mais on veut protéger ça. En général, l’artiste va être très touché par la beauté, mais le scientifique pareil. Je veux dire, si je travaille en Arctique, dans un lieu magnifique, oui il y a des intérêts scientifiques, je ne m’en cacherais pas, il y a beaucoup de choses à documenter, mais c’est surtout parce que c’est beau. Et je pense que si on est un peu honnête, la principale raison, elle est là. C’est beau, la nature, les oiseaux… puis je pense que c’est ça qui fait qu’on est touché. – Pierre Legagneux
Denis, M.-P. et Tremblay, C. (2013). La biodiversité sur le campus universitaire : portrait des connaissances. Université Laval, Service des immeubles . https://www. ulaval.ca/sites/default/files/DD/PDF/Guides_rapports_ politiques/Rapport-biodiversite-SI-2013.pdf
Loss, S. R., Will, T. et Marra, P. P. (2013). The impact of free-ranging domestic cats on wildlife of the United States. Nature communication, 4, 1396. https://www.nature.com/ articles/ncomms2380
National Adubon Society. (2022). For The Birds: The Bidsong Project. National Adubon Society. https://www. audubon.org/birdsong-project
Poster, R. et Reagan, R. (2022) Bidsongs! For The Birds: The Birdsong Project. https://www.thebirdsongproject.com/ our-story
https://www.audubon.org/sites/default/files/boa_plates/ plate-98-white-bellied-swallow.jpg hirondelle bicolore ADUBON

Tous les jours, qu’il fasse chaud ou froid, que l’on soit en été ou en hiver, j’aime me promener le long de la rivière Saint-Charles. Entre deux séances d’étude ou entre deux cours, ce petit rituel m’aide tantôt à me vider l’esprit, tantôt à y mettre de l’ordre. Depuis quelques années, en marchant sur la piste cyclable, à deux doigts de me faire happer par un.e cycliste (parce que je marche sur la mauvaise voie), je prends de plus en plus le temps d’observer les changements de saison et leurs impacts sur cette bulle naturelle qui entoure mon écosystème urbain (et poussiéreux). Plus les années passent, plus je considère le relais des saisons comme la manifestation du temps qui avance et les phénomènes météorologiques et climatiques qui en découlent comme les traces des années qui s’écoulent inéluctablement, avec ou sans mon accord. Ce mois-ci, j’ai aussi voulu étendre cette réflexion hors de mon petit monde d’habitant de l’hémisphère nord pour me demander (bien naïvement, je le reconnais) de quelles manières les saisons sont perçues ailleurs sur le globe, notamment à travers certaines célébrations saisonnières.
Par William Pépin, journaliste multimédia
Ça y est : le printemps est là. Si la saison évoque l’arrivée de la chaleur, la fonte des tas de neige charbonneux et le célèbre dicton « en avril, ne te découvre pas d’un fil », le printemps est aussi, pour moi, révélateur de l’empressement d’enfin congédier l’hiver. Aussitôt que la température avoisine le zéro, on sort sur les terrasses avec nos manteaux et nos gants, on promène les chiens pour la plupart encabanés depuis des semaines et on se dénude presque entièrement sous un froid de plus en plus relatif. Il faut dire qu’au Québec particulièrement, nos modes de vie, à petite et à grande échelle, sont souvent interdépendants du cycle des saisons — et à raison. Nos conversations également : rares sont les pays où la météo se métamorphose en fonction phatique, où l’on remplace les « bonjour » et les « tu vas bien ? » par « y fait pas chaud » ou « j’ai mis ma ’tite laine ».
D’emblée, il convient peut-être de définir ce qu’est une saison, mais aussi ce qui la détermine. Grossièrement, une saison est une période de l’année qui se distingue par une condition climatique propre à elle. Cette période de l’année correspond d’ailleurs à l’intervalle de temps dans lequel la Terre progresse dans sa révolution autour du Soleil (National Geographic, 2011). Les saisons entre l’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud s’opposent, puisque
cette révolution est conjuguée au fait que notre planète effectue une rotation sur un axe incliné à 23,5 o . Par exemple, dans l’hémisphère Nord, l’automne et l’hiver ont lieu de septembre à mars, puisqu’au cours de cette période, l’hémisphère en question n’est pas incliné vers le Soleil. Durant la même période, ce sera le printemps et l’été dans l’hémisphère Sud, ce dernier recevant plus de soleil et donc davantage de chaleur (National Geographic, 2011).
Dans l’hémisphère Nord, l’hiver commence le 21 ou le 22 décembre, soit lors du solstice d’hiver, qui correspond au moment où le Soleil est le plus éloigné du pôle Nord. C’est aussi la journée la plus courte de l’année. L’été commence lors du solstice d’été, soit le 20 ou le 21 juin. Cette journée correspond à la plus longue de l’année et au moment où, tout comme lors du solstice d’hiver, le Soleil est le plus éloigné de l’équateur terrestre. Quant à l’équinoxe d’automne, celui-ci a lieu le 22 ou 23 septembre, tandis que l’équinoxe de printemps (ou vernal) a lieu le 20 ou 21 mars. Ces deux dernières périodes correspondent au moment où le jour et la nuit sont de même durée. Ce sont aussi des moments de transition, puisque le l’équinoxe d’automne consiste précisément au basculement de l’hémisphère Nord à l’hémisphère Sud — et inversement pour l’équinoxe vernal (National Geographic, 2011). Il
convient de rappeler qu’en Australie, par exemple, l’hiver ne commence pas en décembre, mais en juin. Statistiquement et contrairement à notre calendrier saisonnier, le mois de juillet y est le plus froid alors que janvier y est le mois le plus chaud.
De plus, notre conception d’une année composée de quatre saisons n’est viable que pour les zones à la fois éloignées de l’équateur terrestre et des pôles. Plus on s’éloigne de ces zones, plus les différences sont grandes (National Geographic, 2021). À titre d’exemple, l’Équateur (le pays) connaît de faibles variations saisonnières. En fait, on peut y diviser l’année en deux saisons, soit la saison des pluies de décembre à mai et la saison sèche de juin à novembre. Si ces informations ne nous amènent pas à revoir notre propre rapport au temps, ils permettent néanmoins de mieux comprendre celui d’autres horizons.
En ce sens, j’ai une anecdote empruntée à une amie à vous proposer. Lorsque je discutais avec elle de mon idée d’article sur les saisons, elle m’a interrompue pour me raconter son expérience de voyage au Panama, qui, je le rappelle, est un pays d’Amérique centrale et donc une région géographique proche de l’équateur terrestre. Mon amie m’a expliqué qu’à chaque fois qu’elle montait dans un taxi, son réflexe était de discuter de météo avec le
chauffeur. On peut la comprendre : qui, ici, n’a jamais évoqué la météo pour entretenir une conversation, aussi superficielle soit-elle ? Au bout d’un certain temps, à force de parler de la température, un chauffeur a fini par s’impatienter, affirmant « qu’ici, madame, la température change pas, c’est toujours la même chose. Il y a la saison sèche et la saison humide ! » Cette petite histoire nous ramène, à mon sens, à deux points essentiels de ce texte: d’une part, la conception des saisons ne se limite pas à quatre moments égaux divisés à partir d’une période de 365 jours et, d’autre part, les températures saisonnières n’engagent pas les individus de la même manière en fonction de leur position géographique.
Hiver et dépression saisonnière : un cas exclusif au Québec ?
Comme on vient de le voir, les saisons fluctuent d’un bout à l’autre du globe ou, plus exactement, d’une zone terrestre à l’autre en fonction de la latitude. Dès lors, qu’en est-il de nos perceptions saisonnières collectives ? Est-ce que les Québécois.es vivent leurs hivers de la même manière que les Suédois.es, par exemple ? Une partie de la réponse est à chercher du côté des fêtes calendaires, qui « en disent long sur l’espérance des beaux jours et sur la dévalorisation, la stigmatisation de la mauvaise saison (PhelouzatPerriquet et Soudière de la, 2007). » J’y reviendrai plus

loin. Pour l’instant, j’aimerais me concentrer sur la dimension dépressive de l’hiver, principalement connue sous le nom de « dépression saisonnière », qui n’est pas exclusive au Québec. Par exemple, en Finlande, la « mélancolie finlandaise » désigne une déprime inextricable aux conditions météorologiques. D’ailleurs, dans de nombreux cas, la langue est porteuse de telles significations:
« La langue finnoise possède d’ailleurs plusieurs mots pour parler de l’hiver : talvi et skabma, qui signifient littéralement “temps où il n’y a pas de soleil”, et kaamos qui désigne les prémisses de cette saison, lorsque la neige n’est pas encore définitivement installée (novembre/début décembre). Kaamos a un deuxième sens, psychologique, qui indique un état d’âme, une humeur, faite de tristesse sans objet, de langueur […] Quant aux Inuits de l’Arctique canadien, pour eux, l’hiver se dit ukioq ; la nuit polaire
udluitoq, “sans jour”, et le jour le plus sombre, morketiden, “le jour des ténèbres” (Phelouzat-Perriquet et Soudière de la, 2007). »
De notre côté du globe, il convient de considérer ceux et celles que l’on appelle les snowbirds , ces oiseaux mythologiques allergiques à l’hiver qui s’expatrient le temps d’une saison pour éviter les désagréments hivernaux. Ce phénomène n’est toutefois pas exclusif au Québec, puisque certain.es Suédois.es et Finlandais.es ont également l’habitude de s’exiler temporairement, non pas en Floride, mais plutôt en Espagne, au Maroc, en Égypte, aux Canaries ou encore à Madère (Phelouzat-Perriquet et Soudière de la, 2007). Quoi qu’il en soit, inutile d’ajouter que les saisons les plus dures peuvent avoir un impact non seulement sur notre humeur, mais aussi sur notre mode de vie, qui, dans les cas présents, reprend celui des oiseaux migrateurs.



Fêtes calendaires : entre remèdes et repères À propos des fêtes et des traditions, il faut noter que certaines d’entre elles sont directement liées aux changements de saison, dont l’équinoxe et le solstice, que j’ai abordés (un peu froidement, j’en conviens) et que l’on peut mettre dans la catégorie des fêtes païennes. Ces célébrations existent dans plusieurs pays et sont pratiquées dans différentes cultures. Par exemple, l’équinoxe du printemps a des racines traditionnelles en France, en Suisse ou encore en Kabylie, dans le nord de l’Algérie. Si ces fêtes ne se célèbrent pas de la même manière d’une région à l’autre et si la plupart ne sont plus du tout célébrées, il n’en demeure pas moins qu’elles se fondent sur une base commune, soit la fin de l’hiver et l’arrivée de la lumière. Ces fêtes existent sous plusieurs noms, dont Schieweschlawe (que l’on souligne principalement en Alsace, au printemps), Midsummer (ou Saint Jean-Baptiste,


fête d’Europe du Nord ayant lieu lors du solstice d’été), les récoltes (à l’automne) ou encore Kōyō, une fête japonaise célébrant le changement de couleur des feuilles en automne.

Avec cet aperçu, on retient la fonction cathartique de la plupart de ces fêtes, souvent en lien avec la lumière, ses apparitions et ses changements (Phelouzat-Perriquet et Soudière de la, 2007). De plus, si la plupart soulignent la fin d’une saison difficile, d’autres, comme Kōyō, célèbrent plutôt la transition et le changement, à l’instar de hanami, d’ailleurs, qui a lieu au printemps et qui concerne non pas les feuilles d’érable, mais les fleurs de cerisier.
Au-delà du symbolisme derrière le calendrier saisonnier,
les changements climatiques nous montrent que nous sommes interdépendant.es non seulement des cycles de la nature, mais aussi des différents éléments qui la composent. Roberto Silvestro, doctorant en biologie à l’UQAC et Sergio Rossi, professeur au département des sciences fondamentales à l’UQAC, nous mettent en garde quant aux conséquences naturelles et économiques que les bouleversements saisonniers peuvent avoir sur les plantes, les espèces et, par extension, sur notre économie. Ils tablent leurs travaux sur la phénologie : « Au printemps, les fleurs éclosent. À l’été, les fruits mûrissent. À l’automne, les feuilles changent de couleur et tombent. Et, l’hiver, les plantes se reposent. Cela constitue la phénologie — l’étude de la chronologie des phénomènes périodiques du cycle de vie (Silvestro et Rossi, 2011). » Bien plus que symbolique,
donc, l’impact du climat sur la faune et la flore est tangible et peut s’exprimer à partir de phénomènes observables, dont les changements de température précoces :
« La phénologie est l’un des indicateurs biologiques les plus sensibles aux changements climatiques. Sous l’effet de l’augmentation progressive des températures du dernier siècle et des variations de la répartition saisonnière des précipitations, les déclencheurs environnementaux surviennent généralement de plus en plus tôt. C’est pourquoi des décalages phénologiques ont été observés dans le monde entier, et il semble que les événements phénologiques tendent à se produire plus tôt d’année en année (Silvestro et Rossi, 2011). »

L’une des nombreuses conséquences des changements climatiques est donc le bouleversement du calendrier phénologique. En effet, ces événements tendent à survenir de plus en plus tôt, comme la saison des fleurs de cerisier (ou Sakura), au Japon, dont le festival qui la célèbre se voit devancé depuis le siècle précédent (Silvestro et Rossi, 2011). Cet exemple montre bien que le calendrier saisonnier est sujet à changer, ne serait-ce que sur le plan des célébrations, ce qui risque d’avoir un impact sur notre manière de concevoir les saisons et d’envisager notre rapport au temps, et ce, sans compter les conséquences écologiques qu’occasionnent de tels changements, comme des « synchronismes ou des asynchronismes phénologiques potentiellement dangereux. (Silvestro et

Rossi, 2011) ». À titre d’exemple, ce phénomène pourrait notamment créer un déséquilibre entre les plantes et les abeilles.
Selon Environnement et changements climatiques Canada (ECCC), les températures saisonnières moyennes ont augmenté entre 1948 et 2021, et ce, pour les quatre saisons (ECCC, 2022). Pour l’hiver, on constate une augmentation de 3,5oC, de 1,6oC pour le printemps, de 1,5 oC en été et de 1,8 oC en automne. Des températures records ont été enregistrées en 2010 pour l’hiver et le printemps, en 2012 pour l’été et en 2021 pour l’automne (ECCC, 2022).

Ainsi, en moins de soixante-quinze ans, des changements de température considérables se sont fait ressentir. Si ces augmentations ne sont pas forcément perceptibles dans l’immédiat, elles indiquent néanmoins qu’une tendance à la hausse se dessine et nous donnent à penser que notre rapport aux saisons, par le prisme de la température, est susceptible de changer sur le long terme. Si les années comptent toujours 365 jours, les quatre saisons, elles (toujours dans une perspective occidentale) tendront de plus en plus à se décaler.

Notre rapport au temps Évidemment, avec ce court survol, il était impossible pour moi de présenter tous les calendriers et toutes les célébrations saisonnières qui existent ou existaient. J’aurais notamment pu aborder la conception du temps du
peuple inuit en fonction du calendrier lunaire ou encore le symbolisme saisonnier dans le contexte de la Chine traditionnelle. Comme vous l’avez remarqué, je me suis plutôt concentré sur le Québec et certaines régions européennes, et ce, dans un souci de ne pas m’épancher outre mesure sur des cultures et des traditions que je ne connais pas au point d’y consacrer des pages entières. D’ailleurs, mon objectif n’était pas tant de présenter ces cultures que de présenter une manière de concevoir notre rapport au temps, souvent bien intriqué à nos modes de vie saisonniers, du moins, dans un contexte nord-américain (et occidental). Un détour sur les changements climatiques était à mon sens nécessaire, puisqu’il ne s’agit pas de voir les phénomènes saisonniers comme des manifestations climatiques immuables et intangibles.

Buitekant, E. (2021, 16 juillet). Quelles différences entre un équinoxe et un solstice ?. Geo . https://www.geo.fr/ environnement/quelles-differences-entre-un-equinoxe-etun-solstice-204527
Environnement et changements climatiques Canada. (2022). Changements de la température au Canada. Indicateurs canadiens de durabilité de l’environnement. https://www.canada.ca/fr/environnement-changementclimatique/services/indicateurs-environnementaux/ changements-temperature.html


Phelouzat-Perriquet, N. et Soudière de la, M. (2007). Approche sociologique de la dépression saisonnière
hivernale (2e partie). Hiver d’ailleurs, hiver d’antan. Psychiatr Sci Hum Neurosci, 5, 204-211.
National Geographic. (2011, 21 janvier). Season. https:// education.nationalgeographic.org/resource/season/.
Silvestro, R. et Rossi, S. (2022, 1er mai). Les changements climatiques modifient le rythme saisonnier du cycle de vie des plantes. Le Soleil. https://www.lesoleil.com/2022/05/01/ les-changements-climatiques-modifient-le-rythmesaisonnier-du-cycle-de-vie-des-plantes-764bd568040386 00760ee4b4e3df7193
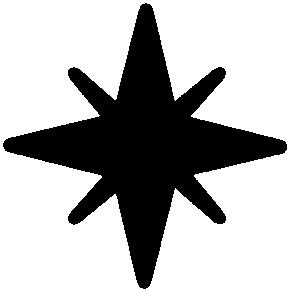



vous croyez être victime d’une erreur ou d’un traitement inéquitable, vous pouvez procéder à une demande de révision de notes.
NOUS RESTONS OUVERT TOUT L’ÉTÉ, VIENS NOUS VOIR !
L’été 2020 est bien avancé. Lili saura demain quelle tâche l’attend pour la prochaine année. Lili enseigne depuis plus de 10 ans le français. Moi je l’ai eue en cinquième secondaire, dans la deuxième moitié de l’année. Je me rappelle qu’au premier jour, une pomme nous attendait sur le coin de chacun de nos bureaux. Elle nous avait lu, avant même de se présenter, les premières pages de Madame Bovary. Quelques années plus tard, nous voici, elle et moi, sous le soleil tapant de la saison des lions tout près du stationnement du camp de jour où je travaille et où ses enfants vont. Elle me confie sa stratégie pour obtenir son poste à Perrault, là où nous nous sommes rencontrées. Quelques courriels, un congé de maladie interminable sur lequel elle doit compter aveuglément pour être prolongée toute l’année. Tout pour retourner à l’école jadis des malaimé.es, mais qui maintenant, dit-on, serait très dynamique.
Il y a quelques semaines, une amie de Montréal avec qui j’ai fait mon secondaire, était de passage à Québec. Au fil des discussions qu’on avait plutôt que de travailler, elle m’a entre autres suggéré l’écoute du balado Chacun sa classe.
« Ça parle du système scolaire à trois vitesses, le privé, les programmes à vocation comme ce qu’on a fait nous par exemple et le régulier au public, je pense que tu vas vraiment aimer ça. »
Les quelques mots de Juliette ont suffi à ce que je dédie mes deux prochaines séances au gym à l’écoute du balado.
Et si j’ai soufflé plus fort que d’habitude sur mon tapis roulant en pente, ce n’est pas qu’à cause de mon cardio qui laisse à désirer, c’est aussi
parce que j’étais sidérée tout au long de mon écoute.
Mené par Karine Dubois et réalisé par Christine Chevarie, Chacun sa classe aborde plusieurs questions qui sous-tendent son thème principal: le système scolaire à trois vitesses au secondaire. Des classes de régulier au processus d’admission des écoles privées et des programmes à vocation en passant par des témoignages souvent déconcertants, le balado en cinq épisodes m’a semblé brosser un bon portrait d’ensemble. Mais quelques témoignages et faits rapportés ici et là m’ont atteinte plus que d’autres, et j’ai eu envie de creuser un peu.
7 mars 2023, j’écris à Lili pour savoir si elle aurait du temps pour qu’on jase du contenu du balado et qu’elle me parle de ce qu’elle vit à la fois comme enseignante du système scolaire public qui a fait une tonne d’écoles, de programmes et comme mère. Elle me dit qu’on peut se voir le jeudi après-midi suivant, c’est sa seule disponibilité, je sais que c’est sans doute le moment qu’elle aurait pris pour rattraper son retard, mais elle accepte de prendre un café avec moi pour discuter. Le jeudi suivant, on se retrouve à la Maison Smith. Trois heures et des tonnes de notes plus tard, j’ai une dizaine de pistes à explorer. « Guy Rocher […] Commission Parent […] Décentralisation […] Double ouverture des valves […] Abolition des commissions scolaires […] Mouvements parentaux […] exode vers le privé […] et les enfants dans tout ça […] »
Tout a commencé au temps des mammouths laineux
En 1963, à l’époque où les gens voyaient en noir et blanc, est publié le rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec, aussi appelé le rapport Parent. Véritablement porteur d’une mission éducative pour le Québec, le rapport Parent fait état d’un système scolaire fragmenté, largement inégalitaire qui freine l’émancipation du peuple québécois. La commission présidée par Mgr Alphonse-Marie Parent propose, dans son rapport, « une structure administrative unifiée » afin « d’assurer l’égalité des chances pour tous dans l’exercice du droit à l’éducation » (Commission royale, 1963, vol. 5, par. 463). Ce sont aussi les membres de la commission qui ont dû statuer à savoir si le privé – qui à l’époque était près de disparaître pour des raisons financières – bénéficierait ou non d’un quelconque financement, mais sur cet aspect, je reviendrai.

25 ans après le rapport Parent, le Conseil supérieur de l’éducation levait un drapeau rouge sur des « inégalités persistantes » et des « écarts dans l’accès aux études selon l’origine géographique […] selon l’origine socioéconomique […] et disparités entre les groupes linguistiques » (Conseil supérieur, 1988, p. 38-40).
Au tournant du nouveau millénaire, le système de bassin scolaire a été aboli; en d’autres mots, il n’était plus nécessaire d’obtenir une dérogation pour aller ailleurs qu’à l’école secondaire près de chez soi. Puis, dans un autre rapport de 2002 du Conseil supérieur, on apprend que bien que la scolarisation de la population québécoise ait augmenté au cours des dernières décennies, on ne parvient toujours pas à rattraper la moyenne canadienne (Rocher, 2004).
Et dans un désir de combler cet écart, mais aussi et surtout pour pallier l’exode vers le privé, s’en est suivi ce qu’on pourrait appeler « la double ouverture des valves ». Alors que les écoles étaient maintenant autorisées, voire encouragées, à créer des projets éducatifs (des programmes à vocation), on a simultanément fermé la plupart des classes des élèves à défis particuliers (TSA, TDAH, troubles du langage, troubles de comportement, etc.) sous prétexte qu’il s’agissait de ségrégation scolaire. On prétendait qu’en fermant ces classes et qu’en
« intégrant » leurs élèves aux classes régulières, les « effets de pairs » seraient bénéfiques pour les élèves les plus faibles sans nuire à celleux qui réussissent le mieux.
Or, ces classes à ratios réduits pouvaient compter sur l’appui régulier de technicien.nes en éducation spécialisée, d’orthopédagogues, etc. en plus de celui de l’enseignant.e formé.e en adaptation scolaire. On a également mis fin au présecondaire – des classes composées d’élèves sortants du primaire, mais qui n’avaient pas les acquis nécessaires pour entamer leurs études secondaires – comme on a de beaucoup réduit les classes de formation à un métier semispécialisé (FMS) et celles de formation préparatoire au travail (FPT). « Le soutien et la baisse des ratios suivront » a-t-on dit. Vingt ans plus tard, ni le soutien ni les ratios n’ont suivi, puisqu’il y a, selon le niveau, entre 26 et 32 élèves par classe et qu’on peut souvent y compter jusqu’à un tiers d’élèves aux prises avec des besoins particuliers (Conseil supérieur de l’éducation, 2016). « On a noyé leurs besoins dans une multitude de besoins » me confie-t-on.
En 2016, le Conseil supérieur de l’éducation (CSE) dépose un rapport, Remettre le cap sur l’équité, qui révèle l’état désastreux dans lequel se trouve le système d’éducation québécois. Le constat est clair et ne laisse aucun doute : le Québec est la province au système scolaire le plus inéquitable au pays. On y lit que « malgré le soutien accordé aux milieux défavorisés pour essayer de donner les mêmes chances à tous, et en dépit du travail remarquable qui se fait sur le terrain, l’école n’offre pas à tous les enfants la même possibilité de développer leur potentiel. Notamment parce que la multiplication des programmes sélectifs et le libre-choix parental – l’approche client – favorisent des inégalités de traitement qui sont au désavantage des plus vulnérables, donc contraires aux principes de justice sociale et de juste égalité de chances » (Conseil supérieur de l’éducation, 2016, p.82).
L’année suivante, une étude de l’Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) confirme qu’en effet, la ségrégation selon les résultats scolaires et le milieu socioéconomique contribue grandement à maintenir en place le système scolaire le plus inégalitaire au Canada (Duclos et Hurteau, 2017).
C’est à l’automne 2008, en septembre ou peut-être en octobre, j’entre par les grandes portes avec mes parents. Il me semble que je ne suis pas si impressionnée par l’établissement qui est moins imposant que son nombre de portes le laissait présager. Des adultes que je devine être des enseignant.es ou des intervenant.es de l’école nous parlent – je ne sais d’ailleurs pas à qui iels s’adressent le plus entre mes parents et moi. On nous dit que « ce qui est le fun avec ce programme-là, c’est que ça leur ouvre plein de portes par la suite pour les emplois et le Cégep. » À ce moment-là, j’ai 11 ans et mon heure de couchée est à 20h15, heureusement qu’on pense déjà à mon placement sur le marché du travail.
La ségrégation scolaire peut prendre plusieurs formes; elle peut être de nature raciale, genrée, socioéconomique ou mise en place en fonction du rendement scolaire des élèves. On associe souvent la première à celle perpétrée à l’encontre des personnes noires aux États-Unis, mais qu’on ne s’y trompe pas, le Québec n’a pas fait mieux avec les communautés autochtones et d’autres groupes racisés tout comme il a longtemps œuvré à la ségrégation genrée en éduquant les filles et les garçons en des manières et des lieux différents. Et s’il ne semble persister du système actuel dit à trois vitesses que la ségrégation en fonction des résultats scolaires et la ségrégation économique, il n’en est rien puisque les composantes socioculturelles y demeurent étroitement liées (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2011). Les raisons sont nombreuses, mais au sommet de celles-ci peut-être : les processus d’admission qui réintroduisent des logiques de domination culturelle et économique (Commission supérieure sur l’éducation, 2016).
Dans le balado Chacun sa classe, Karine Dubois rencontre des parents et leurs enfants de sixième année pour en apprendre plus sur les programmes d’admission qui
comportent un processus sélectif. Ce qu’on y entend est atterrant. On raconte que pour entrer dans un programme « d’arts et médias » d’une école publique du quartier Villeray, il faut les résultats scolaires de quatrième et cinquième année, deux lettres de recommandation – une de l’enseignant.e principal.e et une autre d’un.e enseignant.e d’un domaine artistique – et une vidéo de trois minutes dans laquelle le.la postulant.e doit répondre à une série de questions dont une concernant le logiciel de montage qu’iel utilise dans ses projets multimédias. Deux lettres de recommandation, c’est ce que j’ai dû fournir pour mes demandes de bourse au doctorat. Et que dire de la vidéo de présentation ? Une étape dans le processus immensément classiste et qui évince complètement le fait que la personne qui fait le processus d’admission est un.e enfant de onze ans. On entend aussi, dans le balado, des enfants qui disent étudier pendant les récréations pour les examens d’entrée de certains programmes, certaines écoles ainsi que le témoignage d’une mère qui dit être anxieuse à l’idée de devoir annoncer à sa fille qu’elle n’a pas été admise là où elle le souhaitait et qu’elle devra aller au régulier.
C’est l’automne rendu froid. Nous sommes dans ce qu’iels appellent la Salle des nations. Je suis avec mes deux amies de ma classe. Des listes sont affichées sur les portes, on y cherche nos noms pour connaître notre local d’examen. Je suis dans le 104. J’y entre, c’est silencieux, 30 enfants de 11 ans complètement silencieux. ses. Un adulte nous explique qu’il y a quatre sections à l’examen : français, mathématiques, culture générale et logique. Il nous dit de faire attention à ne pas décaler nos réponses. On dispose de trois heures pour répondre à tout ça. Qui considère-t-on comme le père de la gravité ? Tracez un point à la coordonnée (4,2) dans le plan cartésien. Qui est le premier ministre du Québec ? Si le noir est au gris, le rouge est au _______ ? Trois semaines plus tard, je rentre de l’école, mon père est dans la cuisine, il tient dans ses mains une enveloppe. Il ne l’a pas ouverte encore. Il me la tend. Je vais dans la salle de bain. La lettre ne m’est pas adressée, je me reconnais à la formule « votre enfant ». Je suis acceptée. Je suis soulagée comme on ne devrait pas avoir à être soulagée de cette façon-là à cet âge-là. Le lendemain dans la cour d’école, Marianne me dit qu’elle est loin sur la liste d’attente, que ce sera sûrement le régulier, Camille me dit qu’elle a été acceptée, mais que si elle est acceptée à Rochebelle, c’est là qu’elle ira. Je plains Marianne, je ne voudrais pas avoir à aller au régulier à cause de ce qu’on en dit, parce que jusqu’ici, le secondaire me semble plutôt flou, tout ce que j’en sais, c’est ce que les grand.es m’ont dit.

En 2020, c’est la fin des commissions scolaires; et si on a peine nous, les néophytes du système scolaire public, à voir la transformation des commissions scolaires autrement que comme un changement de nom, il faut savoir que dans les faits, c’est un peu plus complexe. C’est beaucoup dans les processus décisionnels que les nuances de la nouvelle administration en place s’inscrivent. Par exemple, au sein des conseils d’établissement (CÉ), le nombre de parents siégeant est maintenant supérieur à celui des membres du personnel. Or, quel type de parent intègre les conseils d’établissement ? Poser la question, c’est y répondre; les CA, les CÉ sont, le plus souvent, occupés, à moins que des quotas ne s’y opposent, par des gens détenant déjà un certain pouvoir qu’il soit culturel ou socioéconomique. Cette nouvelle prépondérance des parents sur les CÉ n’a fait qu’accentuer la notion de clientélisme déjà grandement instaurée par le système scolaire à trois vitesses, en fait, elles s’alimentent l’une et l’autre. Personne ne niera que les parents sont les expert.es de leurs enfants, mais pas de pédagogie comme le sont les gens du terrain et peutêtre oublions-nous ici que l’école, c’est aussi fait pour être confronté.e.
À l’année scolaire 2020-2021, 24% des élèves de Québec fréquentaient le privé et 34 % dans la métropole. Plus intéressant encore, la baisse d’effectifs étudiants qui affectait jusqu’à il y a encore quelques années les écoles secondaires publiques est causée à 82% par l’exode vers les écoles privées alors que seulement 18% sont attribuables à la baisse de natalité. Évidemment, ce sont

des constats qui s’appliquent davantage aux zones urbaines, mais toutes zones confondues, c’est environ 44% des élèves qui sont sorti.es des classes régulières au public (Plourde, 2022).
Comment à partir du rapport Parent, on en est arrivé.es là ? Pour Guy Rocher, seul survivant de la commission, tout s’est joué sur l’enjeu du financement des écoles privées. « Je trouvais que subventionner le privé, c’était aller à l’encontre de ce qu’on était en train de faire, tout était basé sur le fait qu’on voulait un système unifié, et on était déjà là à faire un premier accroc », confie-t-il (Rocher dans Gruda, 2020). Les membres de la commission étaient divisés, et c’est un compromis qu’ils ont décidé de faire en finançant partiellement les écoles privées, un compromis qu’il dit regretter : « nous avons laissé une petite porte, mais le privé a forcé pour l’ouvrir de plus en plus » (Ibid.). Rocher conclut en soulignant que c’est « l’élite québécoise qui sauve l’élite québécoise aux dépens d’une partie de la population » (Ibid.). Des mots à peine voilés de Rocher, on comprend que « si le financement des écoles privées est aussi intouchable, ce n’est pas sorcier : c’est que les décideurs envoient majoritairement leurs enfants dans des écoles privées » (Gruda, 2020). À ce jour, selon la Fédération des établissements d'enseignement privés (FEEP), le financement de leurs institutions ne dépasserait pas les 40%, une statistique contestée par le ministère de l’Éducation (MEQ) qui considère que le financement public atteindrait plutôt 75% (MEQ, 2014).
Dans Chacun sa classe, Karine Dubois questionne David Bowles, directeur du Collège Charles-Lemoyne et représentant pour la FEEP, au sujet du financement des écoles privées et des obligations qui en découlent. Pour lui, le financement public permet de réduire les frais de scolarité et de rendre plus accessible l’enseignement privé. Il ajoute même que plus il y a de financement, plus les écoles sont en mesure d’offrir des bourses afin de couvrir les frais pour des élèves qui n’en auraient pas les moyens autrement. Quand Karine Dubois demande à David Bowles le nombre d’élèves bénéficiant de bourses couvrant la totalité des frais de scolarité, il répond que dans son établissement, il y en a six, six sur plus de 2500 élèves, ce qui représente environ 0,25% de l’effectif étudiant.
La journaliste le questionne ensuite à propos des réglementations quant à l’obligation de scolariser les élèves qui encadrent les écoles de la FEEP, celui-ci confirme ce dont nous nous doutions déjà : chaque école est libre de faire ses propres politiques de recrutement, d’admission et de maintien de la scolarité. En d’autres mots, les écoles privées bénéficient d’un financement public que l’on peut estimer à 60% (Plourde, 2022) tout ayant un pouvoir quasi total sur qui elles admettent et qui elles gardent jusqu’à la
diplomation; parce que non, les établissements privés ne sont pas tenus de garder entre leurs murs les élèves qui n’atteignent pas le rendement scolaire attendu (souvent le seuil de passation) ou qui contreviennent à des règlements internes, tout ça dans le but de préserver leur réputation.
Si évidemment l’accessibilité à laquelle prétend la FEEP n’existe pas, il n’en demeure pas moins qu’il est en partie vrai que l’éducation privée a été rendue, grâce au financement public, plus accessible à une certaine classe moyenne qui voit souvent dans l’enseignement privé un outil de mobilité sociale, ce qui a contribué à ce qu’un bon nombre d’élèves et leurs parents ne fassent pas le choix du public. Et comme mentionné précédemment, cet exode vers le privé a grandement participé à l’éruption de la deuxième vitesse de notre système scolaire : les programmes à vocation que l’on surnomme également « le privé du public ». Il s’agit d’un surnom qui semble adéquat quand on considère que 76% de ces programmes engagent des frais supplémentaires pour les parents qui s’élèvent en moyenne à 1220$ annuellement, mais qui peuvent atteindre, dans certains cas, jusqu’à 14 000$ (Direction des encadrements pédagogiques et scolaires, 2020).
Je gradue dans quelques mois, c’est le temps de choisir si je ferai ou non le voyage scolaire à Washington. L’affaire, c’est que presque personne de ma classe n’ira, parce qu’iels iront au Costa Rica, le voyage du PEI. Il y aura juste des élèves du régulier, et à part Florent qui n’y va pas de toute façon, je ne connais personne. Je regrette un peu de ne pas m’être inscrite au voyage au Costa Rica, mais avec les autres comités, les évaluations critériées, le projet personnel, je trouvais que ça faisait beaucoup et que ça faisait cher aussi, surtout que je n’aime pas vraiment le chaud, mais il faut que je me décide vite, parce que les élèves du régulier s’inscrivent en masse au voyage à Washington, c’est leur activité de l’année.
Tous ces frais servent à financer en partie des activités qui sont, le plus souvent, réservées aux élèves des programmes particuliers; achat de matériel informatique, sorties culturelles, contributions aux clubs sportifs, voyages, simulations politiques : bref, des opportunités qui permettent à la fois aux élèves de prendre goût à l’école et de développer une foule de compétences dans de nombreux domaines. Et ce n’est pas que des opportunités comme ça au régulier, il n’y en a pas, mais il y en a moins, beaucoup moins, parce que les ressources de toutes sortes manquent.
On a donc fermé les classes à cheminement particulier
sous prétexte qu’elles participaient à la ségrégation scolaire et que les effets de pair étaient souhaitables, mais il semblerait que ce soit une logique à deux poids, deux mesures, puisqu’en « écrémant » – le terme est un peu ignoble, mais c’est celui que j’ai sans cesse rencontré durant mes recherches – les classes régulières de presque la moitié des élèves qui étaient favorisé.es soit sur le plan économique, scolaire ou les deux, on a contredit nos propres principes. Notre système scolaire actuel ne rend pas compte de notre mixité sociale puisque tout se fait en silo et participe à reproduire, voire à accentuer les inégalités qui devaient à la base être résorbées.
Et quand on parle de classes à part, de plusieurs de mes recherches, la question des élèves allophones semblait simplement avoir été évincée. En essayant de m’avancer sur ce terrain, je me suis rendu compte que c’était une question difficile à appréhender, parce qu’extrêmement fragmentée. Si les classes de francisation à proprement parler, bien qu’elles manquent de ressources, semblent être des environnements propices aux apprentissages grâce aux différent.es intervenant.es internes et externes à l’école. Or, ce n’est pas tous les établissements qui ont des classes de francisation et les classes de francisation ne sont pas éternelles, et c’est l’entre-deux qui semble poser problème alors que tout le monde se renvoie la balle pour combler les besoins de ces élèves (Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, 2011).
Dans le balado Chacun sa classe, Karine Dubois rencontre beaucoup de parents qui se retrouvent ou se sont retrouvés devant la « fameuse question » : Pour mon enfant, je fais quoi ? Les parents qu’elle a interrogés semblent être aux faits de plusieurs enjeux entourant le système scolaire à trois vitesses tout comme ils semblent comprendre que le choix qu’ils feront pour leur enfant aura un impact sur ce système-là. Par leur décision, ils y participeront ou non, donneront ou non leur accord. Évidemment, les parents qu’on entend appartiennent à une certaine classe privilégiée et ont, pour la plupart, une autre option que le régulier. Alors qu’est-ce qu’ils font, le choix collectif qui serait de ne pas participer au système à trois vitesses ou le choix individuel d’envoyer leur enfant « au meilleur endroit » ?
Les parents interrogés par Karine Dubois répondent des phrases du genre « mais c’est certain que je veux le meilleur pour mes enfants », « mon enfant a besoin de stimulations intellectuelles », des phrases qui, de prime abord, semblent aller de soi. Mais je ne peux m’empêcher d’entendre derrière ces affirmations : « mon enfant est spécial ». Et si, plutôt, on partait de l’idée que tous les enfants sont spéciaux, que tous les enfants ont besoin de stimulations, mais surtout, que tous les enfants ont besoin de relations, de rapports sociaux sains et variés, et qu’au final, cette décision ne devrait pas être entre les mains des parents, qu’en fait, les seules décisions à prendre devraient être prises par des expert.es qui nous lèvent des drapeaux rouges depuis des décennies sur l’état de notre système scolaire.
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. (2011). Profilage racial et discrimination systémique des jeunes racisés : Rapport de la consultation sur le profilage racial et ses conséquences.
Commission royale d'enquête sur l'enseignement dans la province de Québec. (1963-1966). Rapport de la Commission royale d’enquête sur l’enseignement dans la province de Québec.
Conseil supérieur de l’éducation. (2016). Remettre le cap sur l’équité : Rapport sur l’état et les besoins de l’éducation 2014-2016. Gouvernement du Québec.
Conseil supérieur de l’éducation. (1988). Rapport annuel 1987-1988 sur l’état et les besoins de l’éducation : Le rapport Parent, vingt-cinq ans après. Les Publications du Québec.
Direction des encadrements pédagogiques et scolaires. (2020). Collecte de données sur l’inventaire des projets pédagogiques particuliers. MEQ.
Duclos, A-M. et Hurteau, P. (2017). Inégalité scolaire : le Québec dernier de classe ?. IRIS.
Gruda, A. (2020). L’école à trois vitesses a causé un « gâchis humain ». La Presse.
Ministère de l’Éducation (MEQ). (2014). Rapport du comité d’experts sur le financement, l’administration, la gestion et la gouvernance des commissions scolaires.
Plourde, A. (2022). Où en est l’école à trois vitesses au Québec ?. IRIS.
Rocher, G. (2004). Un bilan du Rapport Parent : vers la démocratisation. Bulletin d'histoire politique, 12(2), 117–128.
Par Frédérik Dompierre-Beaulieu, cheffe de pupitre aux arts
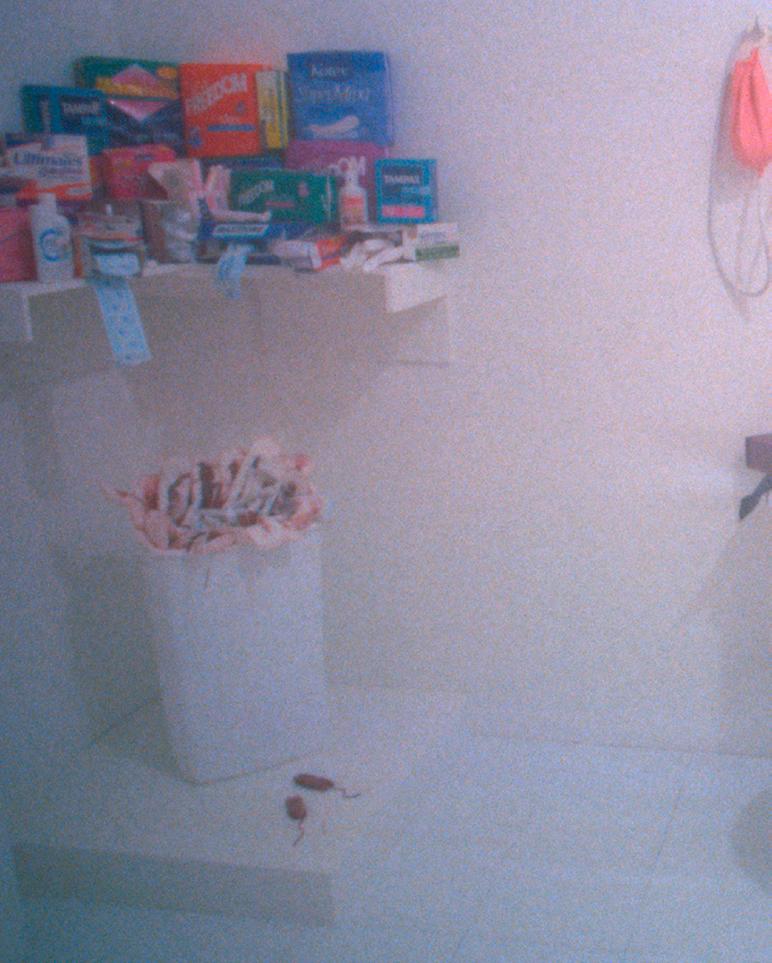
[J’ai eu mes premières menstruations à] 14 ans et je me suis sentie jugée énormément. La première fois, c’était à l'école. J’étais paniquée et surprise. Je suis allée chercher une surveillante et elle m’a sévèrement jugée. Ma mère ne m’a pas crue tout de suite quand je lui ai annoncé la nouvelle.
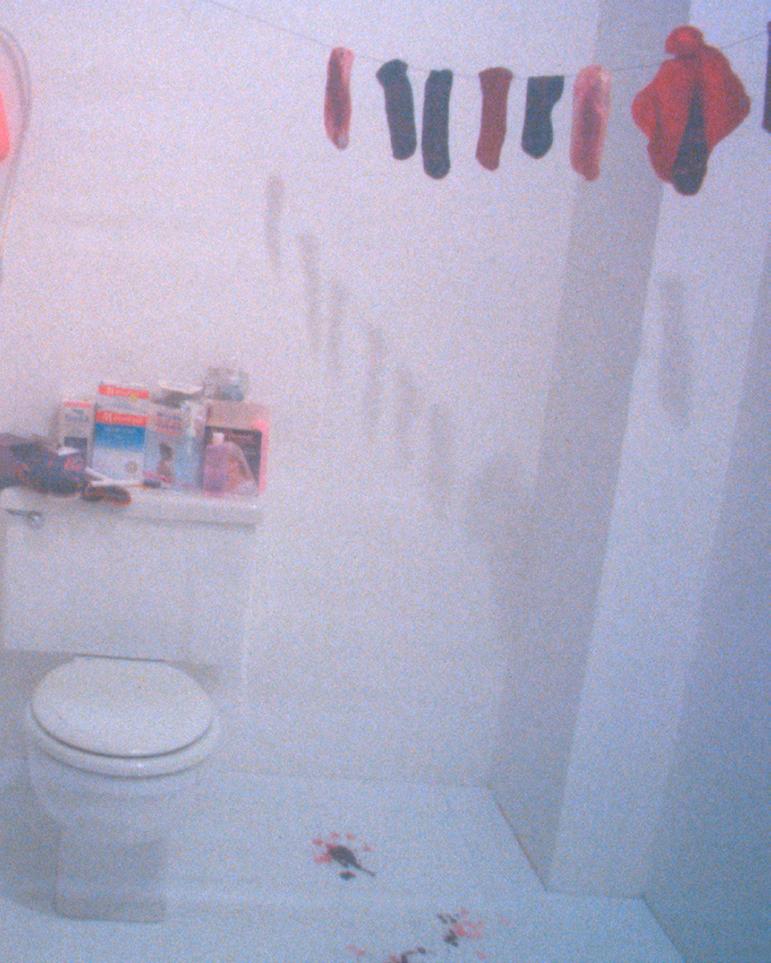
J’avais 11 ans. C’était la veille de l’Halloween. Quelque temps avant, ma grande sœur m’avait dit que si je commençais à saigner, de me mettre une serviette sanitaire. Lorsque j’ai eu mes premières règles, je me suis trompée et j’ai mis un protège dessous. Le jour de l’Halloween, j’ai donc tâché mon costume dès la première période de ma journée. Une amie avait reçu de ses parents un « kit » de survie : des culottes propres, des shorts propres, des serviettes sanitaires… J’ai donc pris son kit et j’ai passé le reste de ma journée avec des shorts de soccer et le reste de mon costume. C’était laid. Arrivée à la maison plus tard, ma mère m’a demandé pourquoi j’étais soudainement en shorts et j’ai dû lui dire que j’avais eu mes règles. Elle m’a donc montré comment mettre une serviette sanitaire. Je ne me suis pas sentie soutenue sur le coup puisque j’avais gardé le secret. J’aurais aimé avoir des explications avant d’avoir mes règles.
J’ai eu mes premières menstruations à l’âge de 10 ans. J’ai eu des saignements au service de garde à mon école primaire. Drôlement, ce sont les éducatrices à l’époque qui m’ont accompagnée et appris comment mettre une serviette sanitaire ! Bien évidemment, ma maman a fait son rôle de mère par la suite et c’est plus à ce moment-là que je me suis sentie comprise et accompagnée !
J’ai eu mes premières règles en secondaire 4. Ça devait être en 2016. J’étais dans un cours de dessin et je me souviens avoir senti un liquide tiède couler au fond de mes pantalons. Assise à côté de mon crush, j’hésitais entre deux hypothèses concernant la cause de cette situation. J’attendais, sans vraiment m’en inquiéter, mes premières règles depuis un moment, puisque mes amies les avaient depuis quelques mois ou années. Finalement, j’ai regardé discrètement entre mes cuisses, sous la table, et j’ai vu qu’il y avait une petite tache rouge, brunâtre. J’étais anxieuse qu’on voit cette tache, et demander à la professeure la permission pour aller aux toilettes était trop compromettant.
Après mon cours, je me suis rendue à la salle de bain pour mettre du papier de toilette au fond de mes pantalons – du papier de toilette qualité école secondaire classée aux derniers rangs des autres écoles secondaires de la province, un papier de toilette mince et rugueux. Arrivée chez moi, j’ai pris quelques tampons dans la boîte de tampons de ma mère. Juste quelques-uns, pas assez pour qu’elle s’en rende compte. Assise sur la toilette, j’essayais de comprendre le mécanisme de l’applicateur : réussite modérée. On ne nous avait jamais montré à insérer des tampons dans nos cours de sexualité (qui, évidemment, étaient axés sur l’application du condom, le pénis et la pénétration). Je me souviens d’avoir eu mal, un peu, lors de cette première insertion du tampon. Je me sentais en contrôle et capable de gérer par moi-même, mais je ne voulais pas en parler à mes parents.
[ J’ai eu mes premières menstruations à]10 ans, ça a été un peu traumatisant pour moi puisque personne ne m’avait parlé des douleurs reliées aux menstruations.
[L’arrivée des menstruations] signifiait enfin que j’allais entrer en puberté. Avoir des seins. Avoir l’air sexy. Grandir. Finalement, je suis restée avec des petits seins et je suis également petite. Maintenant, avec le temps, j’ai dû arrêter ma pilule contraceptive, à cause de mes migraines avec aura (concomitance entre migraine avec aura et acv/ thrombose si je continuais la pilule avec oestrogène). Avant, les menstruations étaient peu abondantes et non douloureuses. Maintenant, je saigne quasi toujours un peu, sinon abondamment et j’ai très mal. J’ai l’impression qu’elles gâchent ma vie tout juste à l’aube de mes 25 ans.
J’en avais discuté avec personne avant que mes parents soient au courant. Je n’étais pas la première de mes amies mais on n’en parlait peu. Je ne me souviens pas d’avoir eu des perceptions avant de les avoir. Je me souviens à quel point il était difficile de mettre un tampon et je ne trouvais pas les serviettes sanitaires confortables. J’ai beaucoup plus tard découvert les coupes menstruelles.
C’était un sujet assez tabou à l’époque. En 5e année du primaire, personne ne parlait vraiment de menstruations… C’était plutôt rendu en 6e année, lorsque l’infirmière venait dire les grandes lignes sur le sujet. Je n’en avais donc jamais vraiment discuté avec quiconque. J’avais lu le Dico des filles (vieux livre dans le temps qui était une belle référence pour les jeunes filles et jeunes garçons). Pour moi, c’était une grosse étape à franchir, sans être positive ou négative. À bien y repenser, l’idée que je me faisais au sujet des menstruations était bien pire que la réalité !
Les menstruations n’étaient pas un sujet très discuté, tant du côté des ami.es que de la famille. Quand ma mère parlait de « menstruations », je me souviens que ça me dégoûtait. Moins pour la chose elle-même, que pour le
simple fait que c’était ma mère qui en parlait. Je détestais sa façon de dire le mot « menstruations », en appuyant sur chaque syllabe et en forçant la sonorité dure du R et des T. Le mot sonnait vulgaire dans sa bouche et elle en parlait toujours devant mon père et mon frère, comme s’il s’agissait de quelque chose que seules les femmes pouvaient comprendre mais qui constituait un objet de fascination, d’étrangeté et de dégoût pour les hommes. J’avais l’impression que, pour ma mère, avoir ses menstruations signifiaient devenir femme. Ça voulait dire sexe, bébé, procréation. Je détestais cette pensée.

Je me sentais femme et fille, et j’en retirais un certain bienêtre, mais étonnement je ressentais une honte à être menstruée. Encore aujourd’hui, je peine à cerner la source de cette honte, à comprendre quelles étaient ses racines et comment elle s’était construite. Aujourd’hui, c’est différent. Aujourd’hui, j’accueille mes menstruations comme une vieille amie qui s’invite chez moi sans prévenir et de manière très irrégulière. Aujourd’hui, les menstruations sont pour moi réconfortantes, rassurantes : elles riment avec moments pour soi, moments d’encabanée. Avec le temps, de l’amour, des discussions et la découverte du féminisme, les menstruations sont devenues symbole de fierté et de luttes.
Chose certaine, à l’époque, je ne voulais pas que les autres sachent que j’étais « dans ma semaine ». C’était quelque chose qui m’appartenait. C’était à moi seule. C’était intime et pour ça il ne fallait pas en parler.
Quand j’ai eu mes premières règles, je croyais que c’était un peu honteux. J’avais peur lorsque j’ai vu le sang dans la toilette. J’étais en cinquième année du primaire. Bien sûr, c’était très tabou. Ma mère est venue m’expliquer
comment les serviettes sanitaires fonctionnaient, j’étais alors plus rassurée. En revanche, je ne comprenais pas encore vraiment ce que cela signifiait.

menstruations, d’autant plus qu’une grande partie des appellations créées autour de ce thème cherchent à maintenir une forme de secret, ou à éviter un malaise ou l’embarras. Un peu ironique, quand même, sachant que ces termes traduisent eux-mêmes le malaise autour des menstruations.
Bien que presque toutes les personnes ayant accepté de témoigner dans le cadre de cet article emploient et s’entendent sur l’utilisation du terme « menstruation(s) », il semblerait pourtant que les langues du quotidien portent toujours avec elles le malaise et le tabou autour des menstruations. Selon Karine Bertrand dans son mémoire de maîtrise en psychologie La représentation sociale des menstruations : étude exploratoire d’un fragment du corps, celles-ci auraient été associées « à des maladies ("la maladie féminine", "la maladie des grandes filles"), à la douleur ou à l’inconfort ("mauvais moment du mois", "une indisposition"), à la régularité ("les périodes", "les époques", "les époques douloureuses", "avoir son époque", "ce moment du mois"), comme si c’était un visiteur ("Tante Tilly est là", "je reçois mon ami") comme un signe de nondisponibilité sexuelle ("le drapeau rouge est levé"), ou de ne pas être enceinte ("je suis encore protégée"), comme symbole de féminité ("l’amie des femmes", "un cadeau de Mère Nature"), relié à des problèmes économiques ("je suis dans le rouge") à l’accoutrement menstruel ("c’est la semaine du cylindre blanc", "je suis patchée") ou à l’imposition régulière et prévisible qu’elles sous-tendent ("avoir ses règles") », en ajoutant que « bien que plusieurs de ces expressions soient désuètes, certaines sont encore fréquemment utilisées, dont "avoir ses règles" et "être patchée" » (p.20). Toutes ces expressions ont constitué au fil du temps un lexique menstruel comme autant de stratégies linguistiques et de stéréotypes, qui témoignent de la difficulté persistante à nommer adéquatement les
Et même si les femmes ne sont pas les seules à pouvoir être menstruées et que toutes les femmes n’ont pas de menstruations, il est difficile de dissocier la connotation négative qui les poursuivent de son lien aux femmes, et ce, selon des perspectives sociales et discursives patriarcales. On parle alors de gendered blood ou de sang genré, concept développé en 1993 par Mary Jane Lupton dans son ouvrage Menstruation and Psychoanalysis. Si depuis les années 1960 et 1970 les mouvements féministes et artistiques se réapproprient progressivement – ou radicalement, dans certains cas – les menstruations et se battent encore pour procéder d’une revalorisation de ces manifestations physiologiques, les personnes menstruées apprennent très tôt qu’on doit les dissimuler. Plus important encore, les femmes ne sont pas les seules impliquées dans ce phénomène d’omerta, au contraire, le discours dominant fait insidieusement des menstruations un symbole de dégoût et d’insalubrité, voire d’impureté. On ne veut ni les voir, ni en entendre parler ; ni d’elles directement, ni de tout ce qui peut les entourer. Alors les menstruations ne sont plus seulement souillure, mais également synonyme de honte. Ce sentiment n’est pas impossible à déconstruire, certes, mais il finit par peser lourd et laisser des traces, en plus de potentiellement placer les personnes concernées en situation de précarité et de stigmatisation pour une panoplie de raisons. Non merci.
[Les menstruations étaient dépeintes] comme quelque chose de naturel et de non tabou. Ma mère et moi nous le disions ouvertement que nous étions menstruées, notre flux, nos douleurs, nos symptômes de SPM. Sinon ma meilleure amie à l'époque haïssait ses règles. Dans mes amis c'était souvent vu comme un handicap.
Dans la culture de masse, on représente souvent les menstruations comme quelque chose qu'il faut surmonter. Les filles des pubs sont présentées comme des grandes sportives que le sang n'empêche pas de faire leur sport. Je trouve que des fois oui, la douleur nous empêche d'être à notre meilleur.
C’était pas vraiment un sujet très discuté dans mon entourage. Je m’attendais à ce que ce soit comme dans les films lorsque la maman pleure de joie en s’exclamant ; ma fille est maintenant une FEMME! Mais non, j’ai seulement eu le droit à ; voici comment on met une serviette sanitaire et un jour, je t’expliquerai comment mettre un tampon.
Je ne me souviens plus très bien. Je ne me rappelle pas d’avoir entendu de remarques négatives verbales et explicites de la part des personnes de mon entourage (ou peut-être que je ne les remarquais pas systématiquement, puisqu’elles constituaient une norme, une généralité impensée dans le quotidien).
Il y avait toutefois l’idée que les menstruations étaient dégoûtantes aux yeux des hommes et des garçons. Que dans leur regard, notre sang ou la simple vue d’un produit hygiénique était une faute fatale : assez pour leur enlever
tous désirs pour nous, nous qui avions saigné alors que nous devions à tout instant demeurer disponibles, désirables, baisables.
C’était très tabou. Malheureusement, ce l’est encore aujourd’hui.
Les pubs de tampons donnent la fausse impression que tout est beau, alors que plusieurs d'entre nous ont des symptômes physiques importants lors des menstruations.
Au-delà des représentations dans les publicités et au sein du discours social, les menstruations, bien qu’on en entende peu parler, sont également un thème et même un médium positivement exploité en art, principalement par les femmes, représentations qui tendent notamment à suivre l’arrivée et la montée des mouvements féministes au cours du 20ème siècle et que j’ai tenté de réinvestir ici. On parle alors d’arts menstruels, qu’il soit question de littérature, d’arts visuels, d’arts plastiques, d’arts de la scène, de performances, de publications sur les réseaux sociaux ou de happening, qui désignent aussi l’art créé à partir du sang des menstruations (eh oui!), les détournant ainsi elles et le corps du contrôle et des restrictions qu’on tente incessamment de leur imposer : « La dissimulation continue du corps reproducteur de la société (par exemple, la pratique de l'étiquette menstruelle, les femmes enceintes confinées à la maison et les seins sexualisés) a créé une pensée erronée selon laquelle un corps qui fuit/coule n'est pas naturel et que ce n'est que lorsqu'il est dissimulé qu'il est normal. Par conséquent, le corps est considéré comme
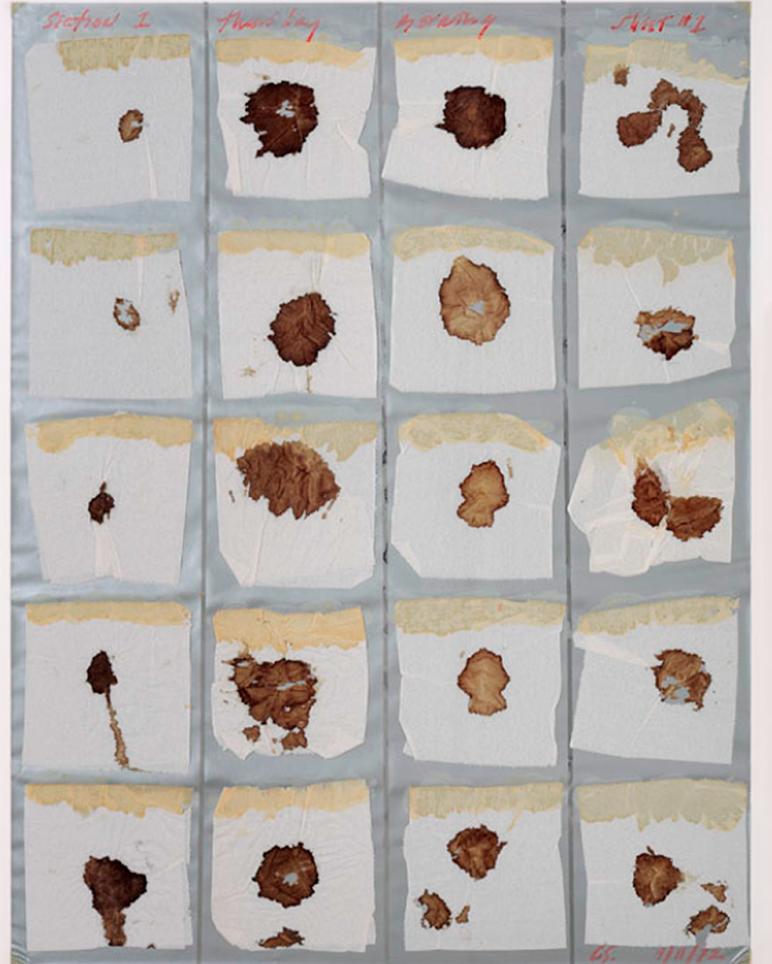
quelque chose qui devrait être contrôlé pour permettre une représentation prescrite de l’identité du sujet et de son corps. Les menstruations, en particulier, ont été codifiées comme quelque chose d'incontrôlable qui doit être organisé, géré et contenu » (Green-Cole, 2020, p. 788) (Traduction libre). En ce sens, « rendre visible le sang menstruel dans l’art est ainsi un acte à la fois esthétique et politique » (Klimpe, 2022, par. 2). L’approche artistique des menstruations permet de déconstruire le rapport normatif aux menstruations en les déchargeant des connotations négatives habituelles, même si les domaines profondément patriarcaux énumérés ci-haut les ont longtemps laissées en marge.

« Elles interrogent de manière critique l'autorité esthétique et le décorum, remettant en question les croyances ignorantes et populaires sur les fonctions de l'art, tout en créant une visibilité et un espace au sein de l'art et du domaine public pour les valeurs contestées associées au sang. Ces œuvres peuvent ne pas être faciles à regarder ou décentes et agréables, car elles refusent l'exigence selon laquelle l'art ne peut être qu'une affaire de beauté traditionnelle et de chaste féminité. Les œuvres d'art qui traitent des menstruations de différentes manières sont importantes parce qu'elles vont à l'encontre des stéréotypes
négatifs et revalorisent activement le sang genré, en le montrant sous un jour positif, provocateur ou ambigu.
Une lecture féministe de la phénoménologie de Maurice Merleau-Ponty, en conversation avec les travaux de la théoricienne du genre Judith Butler, fournit un cadre pour comprendre la performativité de genre. Butler explique que le genre se construit par la "sédimentation" "d'actes performatifs" qui, progressivement et par itération et reconnaissance mutuelle, assemblent collectivement l'identité de genre. Lire les menstruations comme du "sang genré", c'est reconnaître la ritualisation de la différence à travers les pratiques de nettoyage, la classification psychanalytique et d'autres constructions qui, en fin de compte, affectent la position des femmes. Par conséquent, la visualisation des menstruations remet en question et expose des comportements et des catégories psychologiques enracinées, parce qu'elle remet en question la valorisation, dans de nombreuses cultures, du corps classique, masculin et hermétique. […] Les artistes féministes ont joué un rôle important dans la remise en question de ces types de représentations des femmes et dans la création d'un espace dans l'art et l'histoire de l'art pour faire entendre leur voix » (Green-Cole, 2020, p. 787) (Traduction libre).
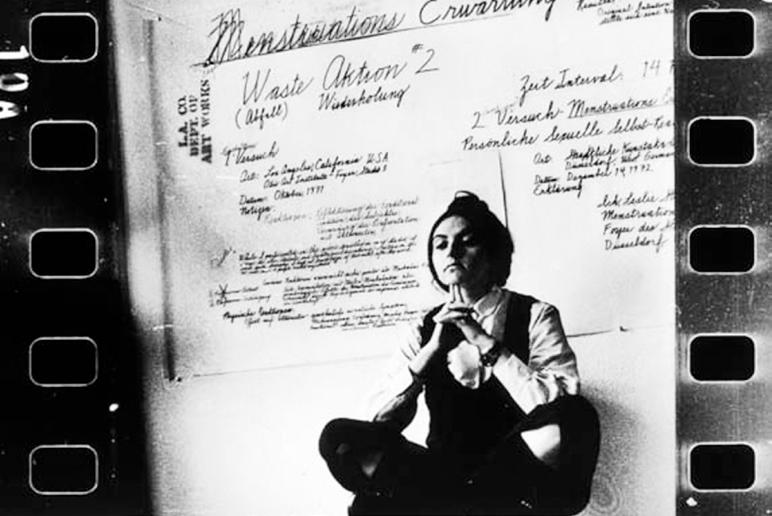
[Aujourd’hui, ma relation aux menstruations] est moyenne. Je ne suis pas gênée et je peux même avoir des rapports sexuels pendant mes règles, mais leur fréquence et leur impact sur ma vie…m’énervent.
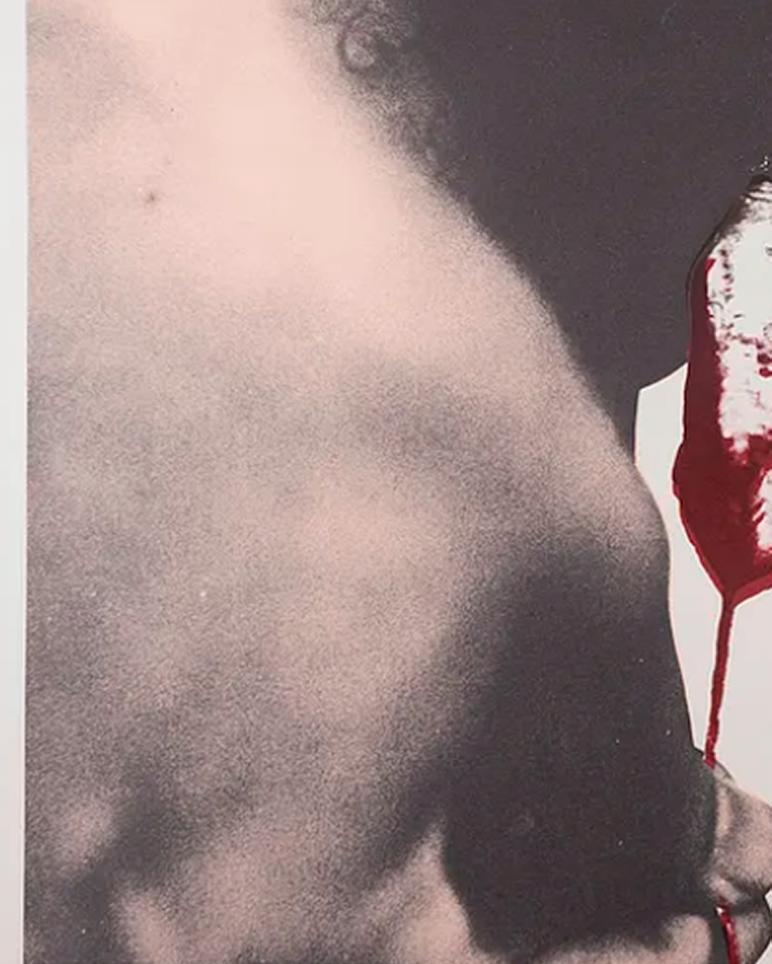
Depuis quelques mois, je n’ai plus mes règles grâce à ma contraception. C’est fantastique. J’aurais aimé découvrir cette contraception avant.
Étant maintenant une maman, mon rapport aux menstruations est rendu tout autre. Je vois les menstruations comme un cadeau. C’est ce qui fait la beauté de la femme. C’est ce qui nous permet de porter la vie. C’est magique. (Mais aussi douloureux quand j’y pense bien !!!). Au final, pour une femme qui désire fonder une famille, c’est beau. C’est le prix à payer pour avoir un petit bout d’humain à nos côtés (prendre en compte ici que je comprends parfaitement qu’il y a d’autres moyens d’avoir un enfant et que c’est vraiment correct de pas en désirer, c’est seulement mon expérience personnelle) !
J’ai toujours très mal lorsque je suis à mon deuxième jour, tellement que cela m’empêche de faire mes activités du quotidien. Malheureusement, nous vivons dans une société qui ne comprend pas le mal que les femmes endurent le jour de leurs menstruations ; nous devrions être aussi actives et souriantes le jour venu. J’ai dû conscientiser mon copain sur ce sujet. Maintenant, il comprend que j’ai besoin de repos, et ce, à chaque mois. Aussi, j’ai remarqué que le sang de menstruations est encore BEAUCOUP considéré comme étant sale. Ça me fâche beaucoup, car il s’agit bien évidemment d’une mentalité patriarcale dégradante pour la femme.
J'ai appris à comprendre mon corps et ses réactions lors de mes règles, j'ai aussi trouvé des produits plus adaptés à mes besoins (comme les serviettes réutilisables et les bobettes de menstrue).
Références
Bertrand, K. (2003). La représentation sociale des menstruations : étude exploratoire d’un fragment du corps. [mémoire de maîtrise, Université Laval]. CorpusUL. https:// corpus.ulaval.ca/entities/publication/cb96f583-8d32-4301b638-af0af4cb5144
Green-Cole, R. (2020). Painting Blood: Visualizing Menstrual Blood in Art. Dans Bobel, C., Winkler, I.T., Fahs, B., Hasson, K.A., Kissling, E.A., Roberts, TA., The Palgrave Handbook of Critical Menstruation Studies . Palgrave Macmillan.

Klime, H. (2022).
Lupton, M.- J. (1993). Menstruation and Psychoanalysis. University of Illinois Press
Un doux sourire, une belle chevelure rousse et une belle énergie sont les qualités que l’on rattache au prince Harry. Plonge dans son regard le souvenir énigmatique de Diana Spencer, qui nous traverse et nous submerge soudainement. Ne serait-ce donc pas l’ombre de la princesse du peuple qui plane sur son fils ?

Le nouvel ouvrage du prince Harry bat des records de vente à travers le monde entier en narrant sa propre vérité, et celle de sa mère. Diana Spencer, dite Lady Di, nourrit jusqu’à aujourd’hui un grand mythe. Ce personnage si particulier et si effacé en même temps a su marquer les esprits lors de son temps. S’il y a 25 ans, Lady Di est décédée en fuyant les paparazzis, son fils en est désormais la risée. Loin de vouloir se résigner, Harry donne un récit émouvant de ce que sa vie semble être depuis le départ de sa tendre mère.
Par Joyce Shabani, cheffe de pupitre société
Le prince Harry est sans doute devenu une personnalité emblématique de la famille royale grâce à sa particularité. Tant physique que dans le caractère, le jeune homme s’est avéré être assez différent des autres personnalités de la famille royale très tôt. Décrit comme un adolescent téméraire par la presse britannique, Harry éveille un sentiment équivoque auprès du grand public. Dans sa jeunesse, il est souvent qualifié comme étant le sale gosse de la famille royale à force de scandales. Et pour cause, les mauvais clichés sur Harry se succèdent au fil des années. Il est photographié avec le logo nazi, il enchaîne les apparitions en sortie de boîte de nuit avec différentes compagnes mais est aussi surpris à violenter un paparazzi. Toutes ces apparitions médisantes à son égard n’empêchent pas l’émancipation du prince Harry, qui redore son image peu à peu. En devenant vétéran de guerre d’abord, mais aussi acteur dans l’humanitaire tout comme l’était sa mère, Lady Di.


La princesse des cœurs, comme on la surnommait, fut une femme très appréciée par le grand public, car contrairement aux autres membres de la famille royale, elle savait se rendre accessible et agir simplement. Elle doit sans aucun doute sa popularité à ses engagements et ses actions, même les plus simples. Oser câliner des personnes atteintes du sida devant une caméra était improbable dans les années 90, cependant, elle l’a fait. Imaginer un membre de la famille royale marcher sur un camp de mine angolais était également impensable… mais elle l’a fait. Ce détachement de ce qu’on a l’habitude de voir avec la famille royale fait l’authenticité de Lady Diana. Aujourd’hui, on transfère cette énergie à Harry qui ne fait que se démarquer notamment de son frère, le prince William, héritier de la couronne. Malencontreusement, ça vaut plus de critiques que de salutations positives au prince Harry, plus particulièrement dans la presse britannique. Les tabloïds ne cessent de s’en prendre à lui de différentes façons et pour différentes raisons. Une nouvelle coiffure ? Une

chemise mal repassée ? Toutes apparitions lui doivent un déferlement médiatique. L’air de rien, c’est exactement le même cheminement qui est reproduit. D’où le fait que l’on attribue à Harry les maux de sa mère, auxquels la sphère médiatique jouerait un grand rôle. Le prince lui-même évoque ce transfert, en soutenant que les médias ont fait de lui la nouvelle proie à qui s’en prendre. Les mêmes courses poursuivies avec les paparazzis, les mêmes altercations, les mêmes articles à scandales que sa mère. Jusqu'à l’ultime clash. Ce fut la mort pour Lady Diana puisque « les médias l’ont tué », dit-on. L’intrusion permanente des tabloïds a eu raison d’elle à seulement 36 ans. Serait-ce le tour d’Harry ?
L’aller, sans retour
Harry a toujours été victime du ramdam médiatique. Le prince étant une personnalité de la famille royale, considérons cela normal. Cela dit, les très nombreuses rumeurs à son encontre ont pris un autre tournant lors de la présentation de Meghan Markle, fiancée du jeune prince. « Les paparazzis grouillaient à nouveau autour d’elle » dès le retour de l’heureuse élue à Toronto rapporte Harry. Tandis que de son côté, le prince est dorénavant attaqué pour sa rupture avec la tradition royale, qui est de s’unir avec une femme aristocratique. Meghan incarne bien trop de légèreté pour l’institution qu’était la Couronne : elle est métisse, divorcée, actrice et californienne. Victime de

racisme, d’injures et même de diverses menaces de mort, elle a été l’objet de grandes intimidations. Ce qui a valu à Harry de choisir sa vie amoureuse au détriment de la famille royale, il justifie ses décisions au nom de l’amour tout au long de son ouvrage. Il perd ainsi ses titres lorsqu’il décide de s’enfuir avec sa famille sous le bras, en juillet 2020. Bien qu’elle émane du cœur, cette décision provoque une grande indignation auprès des Britanniques, qui sont très attaché.es à l’image de la Couronne. Le prince Harry assume et revendique son choix, qu’il plaise ou non.

Le Suppléant est un récit intime mais bruyant. Initialement intime, c’est désormais l’affaire de tous. La vie du prince
Harry mêle ressentiment, mélancolie et sensibilité tout comme celle de Lady Di. Sa mère est justement décédée en se battant contre ces sentiments-là. On voit bien qu’Harry a hérité de cette sensibilité bien qu’il soit très brave. Là est toute la question d’ailleurs. C’est sans doute cette bravoure qui lui vaut tant d’adversité, même quand il n’y a pas lieu d’être.
Référence
Prince Harry – Le suppléant
L’automne dernier, mes ami.es et moi sommes allé.es faire une randonnée dans le Vermont. En gagnant de l’altitude, la température a chuté et un tapis de neige soutenait désormais nos pas. Voilà, c’était l’hiver et nous avions traversé une porte quelque part comme dans les chroniques de Narnia. Et puis nous avons atteint un petit plateau où le soleil traversait le couvert des arbres. Je me suis instinctivement retournée vers les rayons pour qu’ils happent mon visage. Cette fois-là, en plein milieu du mois d’octobre, entre la neige, les conifères et les feuilles orangées, j’étais persuadée de faire de la photosynthèse.
Je sais que c’est biologiquement impossible et que ça a probablement plus à voir avec ma carence en vitamine D… Ce que je veux exprimer avec cet exemple, c’est que, malgré les années qui filent, ma capacité d’émerveillement ne m’a jamais laissée tomber. Je dois avouer que je lui dois beaucoup parce que je suis de nature plutôt défaitiste. Ma vie est parsemée d’instants qui arrivent à percer la neige qui recouvre mon cœur de jeune adulte tourmentée et j’apprécie chacun d’entre eux.
Aussi quétaine que cela puisse sonner, il m’est impossible de rester de marbre devant la beauté des paysages. Il n’y a pas de honte à s’émerveiller devant les couchers de soleil et les arcs-en-ciel, parce que c’est réellement fascinant que l’univers nous offre ces genres de phénomènes sensationnels. Je suis une biophile assumée qui trippe sur le son des chutes d’eau, sur la couleur naturelle des fleurs et sur les matins brumeux au bord d’un lac. L’amour de la nature court dans la famille, du côté paternel jusqu’au côté maternel. Entre mon grand-père qui a construit son chalet sur un lac isolé (qui frôle le paradis, selon moi), ma grandmère qui regarde fleurir ses crocus avec extase chaque printemps depuis 75 ans et ma mère qui se fait griller au soleil à travers la porte patio comme un lézard, nous sommes toustes guidé.es par le même motif.
J’ai parcouru une partie montagneuse de l’Europe en train. Chaque trajet, mes yeux étaient vissés à la fenêtre. C’est que les montagnes détenaient la totalité de mon attention.
C’est majestueux de se retrouver à flanc d’une montagne couronnée d’un château construit en 1300. Voyager avec moi devient épuisant juste par le fait que je répète wow! avec trop d’intonation beaucoup trop de fois par jour.
Je n’ai bien sûr pas besoin d’aller à l’autre bout du monde pour retrouver les brises fraîches d’été qui font papilloter les feuilles des grands arbres. Je peux rester plusieurs heures, couchée dans l’herbe à écouter le concert reposant qui en résulte. Parfois, un vent chaud arrive discrètement et je sais qu’il va pleuvoir. L’odeur de la pluie de juillet me réconcilie avec les journées grises qui me rendent maussade le reste de l’année.
Je pense que ces moments sont apaisants, car ils engourdissent ma petite voix intérieure crieuse et radoteuse. Ce sont des refuges qui me permettent de respirer et de me replacer les idées dans ce monde qui avance en troisième vitesse. Ils ralentissent le temps, ou plutôt lui redonne son allure originale pour que je puisse réémerger dans le présent. Un peu comme lorsque que je plonge ma tête dans l’eau à la piscine pour engloutir tous les bruits qui s’entrechoquent et qui m’étourdissent.
Au quotidien, j’ai besoin d’un refuge plus accessible. C’est le rôle de la musique dans ma vie. Écouteurs ou hautparleurs, les chansons s'enchaînent presque sans répit, peu importe l’activité ou l’endroit. Je peine à comprendre la satisfaction que me procure certains sons. Les accords peuvent transporter tant d’émotions que je ne peux m’empêcher de les ressentir. C’est comme si les ondes sonores massaient l’intérieur de mon cerveau pour ensuite affecter le reste de mon corps. Des doigts aux orteils, le rythme se répand et m’immerge dans un tout autre monde. La musique est comme un ami auquel on peut se confier. Et je lui dis tout, pour me sentir légère, comprise, pour qu’il me réponde ce que j’ai besoin d’entendre, pour qu’il ressente et qu’il crie à ma place.
Les spectacles constituent l’exutoire suprême. Je ne supporte pas les foules, mais les concerts sont l’exception
qui confirme la règle. Pour moi il n’y a pas beaucoup de sentiments qui surpassent le synchronisme d’une salle avec un.e artiste. Une centaine de personnes qui vibrent en chantant les mêmes paroles. Je pense que ce qui défoule, c’est que dans une masse, il n’y a plus d’individualité. Je ne parle pas des concerts où les gens filment avec leur cellulaire pour montrer qu’iels étaient là, je parle de ceux où les gens se permettent d’être dans le présent. Autrement dit, que la tête et le corps se retrouvent au même endroit.
La musique ouvre tellement plus de dimensions que le son lui-même. Il y a quelque chose de presque miraculeux lorsque je ferme les yeux et que la chanson me transporte dans le moment auquel elle est associée. La trame sonore de ma vie. La musique est un dossier dans ma tête qui garde en mémoire des personnes, des odeurs, des émotions, des livres, des films, et le plus beau de tout, des passages de ma vie. Tout ça est imprégné dans les
mélodies et les paroles. Je leur rends visite lorsque le cœur m’en dit, je n’ai qu’à écouter pour retrouver mes souvenirs. J’ai vu une vidéo sur Internet, celle de l’ancienne ballerine atteinte d’Alzheimer. On la voit qui écoute Le lac des cygnes. Les yeux fermés, elle revit le ballet jusque dans les gestes et les émotions.
Je pense qu’il n’y a pas seulement la musique qui réveille les souvenirs. Ils se trouvent aussi dans un goût particulier ou encore dans un parfum. Dans la foulée du quotidien, il peut être facile d’oublier l’importance majeure des sens. Ils me permettent d’assimiler la délicatesse du quotidien dans sa grandeur pour compenser les peines et les doutes qui grimpent sur mes épaules. Je crois qu’être à l’écoute de nos sens est une porte vers l’émerveillement, car il s’agit de ne pas banaliser les choses auxquelles nous sommes habitué.es. Ce sont des capteurs hypersensibles qui ont une tonne de choses à nous raconter, il suffit de leur laisser le temps de nous parler.

Ce texte-là, je crois que ça fait longtemps que je veux l’écrire. En tout cas, ça fait longtemps que je veux écrire sur ce sujet-là, mais j’avoue que l’autisme, c’est quelque chose de quand même assez difficile à décrire. Ça ne me tentait pas de produire un article froid listant les symptômes de l’autisme et ses causes potentielles dont on est loin d’être sûr.es de toute façon. Non, j’avais plutôt envie de vous parler de ce que je connais, de mon expérience personnelle avec le trouble du spectre de l’autisme (TSA).
Par Julianne Campeau, journaliste collaboratriceD’abord, je dois le mentionner : mon expérience personnelle n’est pas nécessairement représentative de celle de toustes les autistes. En effet, contrairement à ce que certain.es semblent croire, les autistes ne sont pas toustes atteint.es de la même manière (je me suis souvent fait dire que je n’avais pas l’air autiste) et n’ont pas toustes la même personnalité. Deux personnes atteintes peuvent avoir des personnalités opposées et avoir mené des vies très différentes l’une de l’autre. En tout cas, c’est ce qu’on m’a dit.
Il est aussi possible que certains défis que je mentionnerai ne soient pas reliés à l’autisme. En effet, il m’est encore difficile parfois de démêler lesquels de mes comportements ont pour cause le TSA et lesquels ont pour cause le fait que je suis une personne un peu weird (sans que ce soit nécessairement lié à l’autisme).
Bon, voilà, vous êtes averti.es. Maintenant, passons aux choses sérieuses.
Certains de mes comportements étranges dans mon quotidien.
J’ai un horaire assez strict pour mes repas. Je dois déjeuner entre 5h et 10h, sinon, je ne dîne pas. Le dîner, quant à lui, doit avoir lieu entre 11h et 14h. Finalement, le souper doit avoir lieu après 17h. Je ne peux pas souper à 16h59, sinon je panique.
Cet horaire des repas est un exemple parmi tant d’autres des règles qui codifient ma journée.
Autre exemple, ma routine matinale lorsque j’ai un cours le matin : brossage de cheveux, déjeuner devant la télé (j’ai également un ordre pour débarrasser le salon après), brossage de dents, soins de la peau, habillage, encore un brossage de cheveux, maquillage, parfum, collier (s’il y a lieu), crème à main, bijoux qui ne sont pas des colliers (s’il y a lieu), faire le lit, vérifier trois fois que tout est dans mon sac, partir. J’ai besoin d’au moins une heure et demie le matin pour bien commencer la journée.
J’ai également ma routine d’avant-dodo : faire de la tisane, lecture (et pas question d’arrêter avant de finir mon chapitre), vaisselle, brossage de dents, soins de la peau, boire de l’eau, vérification des portes et du four, baume à lèvres, crème à mains, dodo. Enfin, il m’arrive souvent de sortir du lit à plusieurs reprises pour aller revérifier les portes et le four.
J’ai constamment la hantise d’oublier quelque chose. Des fois, quand je marche avec quelqu’un, je m’arrête subitement pour vérifier que j’ai tout dans ma sacoche même si j’ai déjà fait cette vérification avant de partir. Il peut m’arriver de le faire à plusieurs reprises pendant une même promenade.
Un « mur » entre moi et autrui Souvent, même quand j’ai eu un peu de temps pour réfléchir à la question, j’ai du mal à produire une réponse développée. Souvent, mes réponses se constituent d’un ramassis de balbutiements et de morceaux de réponses mal ordonnés qui se terminent par : « Pis euh… Ouain… C’est pas mal ça… ». En général, pourtant, je la connais,
la réponse. J’ai juste de la misère à ordonner et à sélectionner les bons mots de manière cohérente. Ou encore, je sais que j’ai la réponse quelque part dans ma tête, mais je ne sais pas où. C’est comme chercher un document précis dans une bibliothèque alors qu’on n’a pas la référence. J’ai l’impression d’avoir l’air idiote quand je parle, c’est plus facile à l’écrit.
Je ne comprends rien aux codes sociaux. J’ai cette peur constante de briser un code social sans le savoir. Ça m’obsède à chaque seconde de ma vie. J’ai toujours cette impression que les gens me regardent et me trouvent bizarre, parce que j’ai enfreint un code dont j’ignore l’existence.
J’ai du mal à cerner les gens. Je n’ai aucun moyen de savoir si j’ennuie mes interlocuteur.rices ou non. Si quelqu’un me hait en secret, je n’arrive pas à le savoir. Comment faites-vous pour lire les autres? Peut-être que le secret, c’est d’être capable de soutenir le regard de l’autre, ce dont je suis partiellement incapable.
J’ai l’impression qu’il existe un mur entre moi et autrui. Vous m’êtes inaccessibles, j’ai peur de vous approcher et je n’arrive pas à entretenir des relations. Je n’arrive pas à faire durer mes amitiés. Je n’ai jamais été en couple. Ça me rend triste de ne pas être capable de vous rejoindre. J’ai peur de ne jamais en être capable.
« Mais tu n’as pas l’air autiste! »
C’est quoi, avoir l’air autiste? Ça ne veut rien dire, le TSA peut toucher des personnes qui n’ont en apparence rien en commun.
Toujours cette peur que les gens ne me croient pas.
Toujours cette peur que les gens prennent mes comportements pour des caprices d’enfant gâtée.

Quand j’étais petite, même si je faisais du « hand-flapping », même si je faisais des crises, on a cru que je n’étais pas autiste, parce que j’étais trop bonne à l’école. Mes comportements ont donc continué à être perçus comme des caprices d’enfant gâtée. Des caprices d’enfant mal élevée. Pendant un temps, je les ai crus. Je me haïssais. J’avais 15 ans quand on m’a finalement diagnostiqué un TSA.
Mais j’ai encore cette peur qu’on ne me croie pas. Qu’on me prenne pour une personne capricieuse. Ou pour une drama queen. Cette peur ne me quittera jamais j’ai l’impression.
Ne pas se laisser abattre : tâche souvent difficile Je ne me considère pas comme une personne malheureuse. Je crois même être plutôt satisfaite de ma vie en ce moment. En revanche, je dois bien l’admettre, l’expérience de vivre s’avère souvent fort frustrante.
Je fournis énormément d’efforts à essayer d’être « seminormale », mais on dirait que ce n’est jamais assez. C’est épuisant. J’ai constamment l’impression de jouer à un jeu de Just Dance à un niveau trop élevé pour moi. Je n’arrive pas à reproduire les gestes aussi fluidement que le coach à l’écran. Je sais que la société ne pardonne pas à celleux qui ne savent pas suivre son rythme, peu importe la raison. C’est une leçon que j’ai apprise enfant.
Bon, mes derniers paragraphes vous ont peut-être paru un peu fatalistes, mais comme je l’ai dit plus haut, je suis tout de même heureuse la plupart du temps. J’aime juste chialer un peu, ça défoule. Ma vie est-elle plus difficile que pour une personne neurotypique? Aucune idée. J’imagine que ça dépend. Qu’est-ce que j’en sais? De la vie des autres individus, je ne vois que ce qu’iels veulent bien me montrer.
Alors que le printemps fait timidement son retour, les heureux.euses propriétaires de grands terrains doivent commencer leur ménage annuel. Racler les feuilles mortes, tailler la haie et arracher les mauvaises herbes font traditionnellement partie du rituel suivant la fonte de la neige afin de se préparer une belle cour. L’élément le plus important et le plus commun de l’esthétique d’extérieur reste le gazon. Cette passion pour l’herbe va si loin que les deux paliers de gouvernements donnent leur recommandation sur son entretien. Dans la section Sécurité à la maison et dans le jardin du site web du gouvernement canadien, on retrouve pas moins de 5 articles dédiés à la pelouse sur 21. Mais derrière ce désir du parterre vert, parfait et uniforme se cachent de graves conséquences pour la santé des sols et la biodiversité. Certain.es vont pousser cette obsession à l'utilisation de pesticides ou simplement remplacer l’herbe par une pelouse synthétique. La culture du gazon idéal transforme un espace qui pourrait être utilisé pour lutter contre l’extinction d’espèce par un inutile, mais esthétique, tapis. Nous reviendrons ici sur les principaux effets négatifs de l’entretien de la pelouse et de certaines pratiques ainsi que sur les alternatives possibles pour avoir un sol écoresponsable.
Par Ludovic Dufour, Chef de pupitre société et science d’entretien et plus on la souhaite parfaite, plus elle demande de ressources. Un exemple : l’eau voit sa consommation doubler lors de la saison estivale au Québec, notamment à la suite de l’arrosage du jardin et du gazon (Ministère de l’Environnement, 2017). Selon des statistiques de 2015, 43% des ménages canadiens arrosent leur pelouse. Le Québec se tient sous la moyenne avec seulement 27% des ménages (Statistique Canada, 2017). En moyenne, les Canadien.nes consomment 215 litres d’eau quotidiennement, mais cette statistique, déjà élevée, ne prend en compte que la consommation résidentielle. En prenant en compte le secteur industriel, commercial et administratif, ce serait 411 litres par habitant.e (Le Québec économique, 2021). Cette consommation place le Canada parmi les pays qui utilisent le plus d’eau potable par habitant.e, avec les États-Unis, le Japon et l’Australie, alors qu’on estime qu’il suffit de 50 litres d’eau pour vivre décemment et 100 litres pour être confortable (Macé).
L’esthétique que l’on associe généralement au terrain parfait, c’est à dire le gazon bien coupé, la pelouse bien entretenue et bien droite, sans pissenlits, semblable à un circuit de golf, nous viendrait en fait de la monarchie française. Comme l’explique le regretté Larry Hodgson, alias Jardinier paresseux, c’est à Versailles qu’André Le Nôtre inclut l’une des premières pelouses d’apparat de l’histoire pour compléter les jardins de son roi, Louis XIV. Le vaste tapis vert attire la curiosité des nobles d’Europe de passage qui, imitant le légendaire Roi-Soleil, commencent à planter du gazon près de leur palais (Hodgson, 2020). La mode de la pelouse passa ensuite à l’Angleterre où elle quitta les géométries parfaites pour prendre des aspects plus naturels. Les jardins étaient maintenant ornementés de ruisseaux et de collines, la pelouse servait à complimenter et relier une végétation aux allures moins rigides. Cette nouvelle forme permettait également d’étaler sa richesse en utilisant le plus de terre possible pour une culture inutile (Hodgson, 2020). Cette tradition s’est par la suite rendue en Amérique, où l’on étendait le plus possible son gazon, toujours pour démontrer son opulence, en construisant sa maison loin de la rue pour bien mettre de l’avant le parterre. Quand la classe ouvrière en a eu les moyens et a rejoint la banlieue, elle a, à son tour, imité les mieux nantis (Hodgson, 2020).
Or, répliquer cette pelouse demande un minimum
Vu ces chiffres colossaux, nous pourrions croire qu’arroser son terrain n’est finalement qu’une utilisation minime et anecdotique de l’eau, mais selon l’Environmental Protection Agency, près du tiers de la consommation d’eau résidentielle américaine va vers la pelouse (EPA, 2017). Il suffit d’un temps minime d’arrosage pour augmenter sensiblement sa consommation. Comme le rappelle le ministère de l’Environnement du Québec, le débit d’un boyau d’arrosage
utilisé à pleine capacité atteint les 1 000 litres par heure, ce équivaut à plus de 4 fois la consommation résidentielle des Canadien.nes moyen.nes en une heure. De plus, l’eau est largement surutilisée, car plutôt qu’être absorbée par le sol, près de la moitié se perd par évaporation et ruissellement (EPA, 2017, Ministère de l' Environnement, 2017).
Au-delà de l’eau, l'entretien de la pelouse demande parfois, du moins pour les plus ardent.es passionné.es de celle-ci, d'utiliser des pesticides qui, a-t-on besoin de le rappeler, menacent les populations d’insectes pollinisateurs. D’ailleurs, le gouvernement canadien, bien qu’il suggère d’autres approches préventives et nous prévienne contre ses dangers, recommande l'usage de pesticides en cas de problème grave et avance qu’ils peuvent « constituer la première étape vers l'aménagement d'une pelouse saine » (Gouvernement du Canada, 2019). Le Québec se fait plus prudent et ne suggère de les utiliser qu’en dernier recours. Malgré ces avertissements, 20 % des ménages canadiens qui ont un jardin utilisent des pesticides. Au Québec, ce n’est que 12 % des ménages, ce qui s’explique par les lois de la province entourant son usage (Environnement et Changement climatique Canada, 2021).
Notons cependant que le glyphosate reste disponible en vente au Québec alors que cet herbicide est considéré
comme un cancérigène probable. Certains pays, dont la France, ont interdit son utilisation dans les lieux publics et certaines villes en ont interdit la vente (Remongin, 2019).
L’engrais chimique est une autre source de polluant utilisé dans le jardin et la cour. C’est cette fois 28 % des ménages canadiens ayant un jardin qui utilisent de l’engrais chimique et 20% des ménages québécois. Ces engrais sont susceptibles de polluer le sol, mais aussi les lacs et les rivières qui, en plus d’héberger la vie marine, peuvent être utilisés comme source d’eau potable (Environnement et Changement climatique Canada, 2021). Aux États-Unis, ce serait entre 40 et 60 % du nitrogène contenu dans les fertilisants qui se retrouveraient dans l’eau (Son, 2020). Ce genre de fertilisant est l’un des aspects les plus polluants liés au jardinage et demande beaucoup d’énergie. Pour une tonne de nitrogène, entre 4 et 6 tonnes de CO2 sont produites (Wolf dans Marinelli, 2019).
Finalement, la tonte de la pelouse et l’utilisation d’outil de jardin à essence apportent son lot de problèmes. À première vue négligeables, ces émissions sont au contraire lourdes de conséquences. Une tondeuse fonctionnant une heure émet de manière équivalente à 11 voitures fonctionnant aussi longtemps. Le résultat est clair, aux États-Unis, 5% de la pollution atmosphérique vient directement de l’utilisation des tondeuses (Osborne, 2021).

Les moteurs à deux temps sont particulièrement polluants, car n’ayant pas de système de lubrification séparé, l’huile et l’essence se mélangent. Le résultat est qu’une partie du carburant se consomme mal et rejette des gaz toxiques pour l’humain et dangereux pour la planète (Son, 2020). De plus, une tonte qui se fait très tôt dans la saison peut éliminer certaines fleurs importantes pour les pollinisateurs qui sortent de leur hibernation, comme les abeilles.
Face à ces problèmes, certain.es optent pour la pelouse synthétique. Elle n’a ni besoin d’être tondue, fertilisée ou arrosée et on garde tout l’aspect esthétique du gazon naturel. La réalité est cependant plus complexe. Tout ce tapis où évidemment plus rien ne pousse devient un sol complètement stérile et se vide de matière vivante. Les insectes et microorganismes décomposeurs vivant dans le sol sont donc privés de nourriture. Ensuite, en surface, les insectes pollinisateurs sont poussés à partir, car il n’y a encore une fois aucune nourriture intéressante. Ce seront ensuite les oiseaux en quête de proies qui devront partir en trouver ailleurs ou alors s’ils trouvent des graines ou d’autres nourritures sur cet espace ils risquent d’ingérer du plastique par la même occasion. Le cas est pareil pour les rongeurs qui courent les mêmes dangers en cherchant de la nourriture ou en creusant leur terrier (Durand, 2022). Ensuite, la pelouse synthétique, contrairement aux naturelles, n’absorbe pas la chaleur, elle la renvoie dans l’atmosphère et risque au passage de brûler les animaux qui y passent. La température de ces tapis de plastique peut atteindre 60 degrés lors de journée particulièrement chaude. Finalement, le gazon synthétique risque aussi de rejeter des microplastiques dans la terre et dans l’eau (Durand, 2022).
Alors que faire pour avoir une cour écoresponsable? L’écopelouse est une des solutions assez simples. Il suffit d’arrêter de traiter tout ce qui ne pousse et qui n’est pas un brin d’herbe parfaitement droit comme nuisible et de tondre occasionnellement. Ainsi, seules les plantes étant capables de survivre à une tonte régulière s’installeront et on offrira déjà bien plus de biodiversité tout en évitant plusieurs produits toxiques. Si les conditions sont propices, cet aménagement peut même faire pousser quelques fleurs pour ajouter un peu de couleur (Hodgson, 2016). Pour éviter la pollution liée à la tonte, on peut également investir dans une tondeuse électrique.
L’OBNL Écohabitation propose comme alternative de remplacer le gazon par des fleurs des champs. En plus d’offrir un beau mélange de couleur, cette approche présente l’avantage de demander peu d’entretien, de s’adapter à toutes sortes de conditions, d’éloigner les insectes nuisibles tout en attirant les papillons, abeilles et oiseaux. Autre piste envisageable, changez le gazon pour un autre couvre-sol comme le thym ou le trèfle. Les avantages changent selon le type choisi, la plupart ne nécessitent pas ou peu de tonte, améliorent la qualité du sol et préviennent la pousse de mauvaises herbes et l’érosion.
En plus de ces idées, on peut également se passer du ramassage des feuilles mortes. Alors que plusieurs le préconisent, car les feuilles priveraient le gazon de soleil et d'oxygène, on propose de plus en plus de les conserver. Celles-ci se décomposent et enrichissent le sol en plus d’offrir une protection aux plantes contre les périodes successives de gel et dégel. Pour les insectes passant l’hiver ici, ce qui est notamment le cas des abeilles et bourdons, ces feuilles pourront servir d’abris contre le froid quand ils nichent aux sols (Simon, 2021).
Évidemment, qui dit gazon dit banlieue et région, mais on se permet un petit aparté pour que les quartiers les plus bétonnés aient l’occasion de mettre la main à la pâte. L’organisation Espace pour la vie, qui regroupe le Biodôme, la Biosphère, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium à Montréal, encourage la pousse de verdure urbaine intéressante pour la biodiversité au travers son programme Mon Jardin Espace pour la vie. On retrouve sur leur site web un blogue contenant toutes les informations et conseils essentiels pour avoir son petit jardin urbain donnant un coup de pouce à la nature.
En résumé, la pelouse est devenue à la mode chez les aristocrates pour bien impressionner ses voisin.es et dévoiler notre grande richesse. Aujourd’hui, on n’associe certes plus le gazon et la fortune, mais c’est encore souvent le jugement des voisin.es qui nous pousse à nous débarrasser des pissenlits et à garder notre herbe courte. Le Washington Post révèle d’ailleurs des études qui démontrent qu’une pression sociale entoure et influence l’entretien du parterre. Il est plus que temps de se débarrasser de ces habitudes polluantes et coûteuses.
Pour le bien des insectes, des oiseaux, des rongeurs, du sol, de l’eau, de l’air et donc indirectement du nôtre, il faut opter pour des alternatives qui laissent une place aux plantes natives. Non seulement les solutions écoresponsables existent, mais elles nous économisent du temps. Au lieu de montrer toute notre avarice, ces nouveaux parterres montreront notre écoresponsabilité.
Références
Application de pesticides sur votre pelouse. (2019). Gouvernement du Canada. Application de pesticides sur votre pelouse - Canada.ca
Consommation d’eau municipale en 2019, par province. (2021). Le Québec économique. Consommation d’eau municipale en 2019, par province | Le Québec économique (cirano.qc.ca)
Durand, K. Les pelouses artificielles sont une catastrophe pour la biodiversité. (2022). Futura. Les pelouses artificielles sont une catastrophe pour la biodiversité (futura-sciences. com)
Entretien des pelouses résidentielles. (2017). Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs. Entretien des pelouses résidentielles (gouv.qc.ca)
Hodgson, L. La fascinante histoire de la pelouse. (2020). Jardinier paresseux. La fascinante histoire de la pelouse - Jardinier paresseux
Hodgson, L. L’écopelouse: le gazon à son plus simple. (2016). Jardinier paresseux. L'écopelouse: le gazon à son plus simple - Jardinier paresseux
Indicateurs canadiens de durabilité de l'environnement : Utilisation de pesticides et d'engrais chimiques par les ménages. (2021). Environnement et Changement climatique Canada. Utilisation de pesticides et d’engrais chimiques par les ménages - Canada.ca
La pelouse écologique : Remplacer le gazon. (2021). Écohabitation. https://www.ecohabitation.com/guides/2498/ non-au-gazon-conventionnel/
L’utilisation de l’eau à l’extérieur, 2015. (2017). Statistique Canada. L’utilisation de l’eau à l’extérieur, 2015 (statcan. gc.ca)
Macé, M. (non daté). La consommation d’eau domestique est-elle la même à travers le monde ? Centre d’information sur l’eau. La consommation d’eau domestique est-elle la même à travers le monde ? | Centre d'information sur l'eau (cieau.com)
Marinelli, J. Your Yard Is a Stealthy Fossil Fuel Guzzler— Give It a Climate Makeover. (2019). Audubon. https://www. audubon.org/news/your-yard-stealthy-fossil-fuel-guzzlergive-it-climate-makeover
Mooney, Chris. Americans are judging their neighbors’ lawns — with surprising environmental consequences. (2015). The Washington Post. https://www.washingtonpost. com/news/energy-environment/wp/2015/03/11/forgetwhat-your-neighbors-think-stop-dousing-your-lawn-withso-much-fertilizer/
Osborne, C. NoMowDays and Other Ways to Trim Your Grass and Your Emissions. (2021). Utah Department of Environmental Quality. https://deq.utah.gov/communication/ news/no-mow-days-trim-grass-emissions
Outdoor Water Use in the United States. (2017). United States Environmental Protection Agency. US Outdoor Water Use | WaterSense | US EPA
Remongin, X. Qu'est-ce que le glyphosate ? (2019). Ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire. Qu'est-ce que le glyphosate ? | Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire
Son, J. Lawn Maintenance and Climate Change. (2020). Princeton Student Climate Initiative. https://psci.princeton. edu/tips/2020/5/11/law-maintenance-and-climate-change
Simon, A. Quatre raisons de laisser les feuilles mortes au sol . (2021). Radio-Canada. https://ici.radio-canada.ca/ nouvelle/1833813/automne-ramasser-feuilles-mortesecologie-ecosysteme
Les premiers bourgeons percent enfin leur coquille, se laissant caresser par les rayons d’un soleil fluet. Le chant des hirondelles ne tarde pour sa part pas à résonner entre les branches des cerisiers en fleurs. Mais alors que le printemps se présente comme synonyme d’espoir et de renouveau, il annonce également le retour appréhendé des insectes de toutes sortes. Souvent mal aimés, voire détestés, ces derniers sont pourtant essentiels au bon fonctionnement des écosystèmes. C’est donc pourquoi l’essoufflement progressif des colonies d’abeilles constitue un phénomène environnemental des plus déplorables.
Par Marianne Richer, journaliste collaboratrice
Reconnues pour leur contribution quant à la pollinisation des fleurs, les abeilles mellifères sont essentielles à la production d’une grande variété de cultures et jouent par le fait même un rôle clé dans la cause écologique. Il va donc sans dire que le déclin des colonies d’abeilles domestiques suscite présentement une inquiétude généralisée auprès de la communauté scientifique à l’échelle internationale.
En l’espace d’un an, environ 43% des ruches d’abeilles mellifères se sont éteintes aux États-Unis, selon ce qu’en conclut une récente étude menée par des chercheur.euses de la Penn State University (Fisher, 2023). Les changements climatiques, les acariens parasites ainsi que les pesticides se trouvent au premier plan de l’analyse exhaustive des multiples facteurs entraînant la disparition des populations d’abeilles domestiques, affectant par le fait même les écosystèmes environnants. Le département américain de l’Agriculture rapporte par ailleurs que le nombre de ruches d’abeilles établies sur le sol américain est passé de 6 millions à 2,5 millions depuis les années 1940 (ibid). La perte massive des populations d’insectes se trouve présentement parmi les extinctions les plus alarmantes, dans la mesure où elle est pratiquement invisible et donc souvent ignorée.
« Les abeilles mellifères sont des pollinisateurs vitaux pour plus de 100 espèces de cultures aux États-Unis, et la perte généralisée de colonies d'abeilles mellifères est de plus en plus préoccupante », signale Luca Insolia, apiculteur et chercheur postdoctoral à l’Université de Genève. (traduction libre, dans Fisher, 2023)
Au milieu des années 2000, les entomologistes ont tiré la sonnette d’alarme sur un phénomène de mortalité anormale et récurrente chez les colonies d’abeilles domestiques. Plus connue sous l’appellation du « syndrome d’effondrement des ruches », cette crise mondiale a pris racine dans le contexte de la diffusion massive des acariens varroa au cours des années 1980-1990. À cette variable s’ajoute également le facteur de stress issu de la transportation des ruches sur de longues distances afin de procéder à la pollinisation commerciale. Dans l’optique de limiter les dommages causés, des études portant sur une variété d’abeilles dites « hygiéniques » sont présentement réalisées à l’Université de Sussex. Selon ces dernières, l’évolution chez les insectes favoriserait naturellement les abeilles qui sont aptes à résister aux acariens varroa. La reproduction en laboratoire de cette caractéristique particulière permettrait donc d’augmenter considérablement un comportement hygiénique chez les abeilles domestiques et, par le fait même, d’assurer partiellement leur protection.
Un article récemment paru dans le journal Ecological Monographs révèle l’ampleur de la menace que représentent les changements climatiques pour les insectes. Un consortium international composé de plus de 70 scientifiques expose notamment les nombreux risques liés à l’augmentation rapide des températures moyennes aux quatre coins de la planète en plus de l’augmentation fulgurante des phénomènes climatiques extrêmes.
Les constats émis par ces chercheur.euses permettent d’affirmer que le réchauffement climatique dépasse
actuellement les seuils de tolérance de plusieurs variétés de plantes et d’animaux, engendrant ainsi la disparition de certaines populations. Incapable de réguler la température corporelle de leur corps, les abeilles domestiques se trouvent ainsi en position de vulnérabilité vis-à-vis les perturbations climatiques liées à la température et l’humidité. Or, leur disparition serait catastrophique pour l’environnement.
En effet, les abeilles mellifères agissent comme pilier de la régulation des écosystèmes, si bien que leur extinction conduirait à des changements majeurs dans la structure des interactions entre différentes espèces. Et c’est sans compter les effets désastreux qui découleraient directement de la pollinisation. Selon l’Organisation des Nations Unies (ONU), 90% des plantes sauvages, 75% des cultures vivrières et 35% des terres agricoles dépendent du travail des insectes.

L’apport économique des insectes à l’échelle planétaire est indéniable. En termes de chiffres, 75% des 115 principales cultures agricoles dépendent de ces pollinisateurs. Des chercheur.euses ont d’ailleurs évalué la valeur économique des abeilles pollinisatrices à 153 G$ (USD).
La popularité des abeilles ne fait pas exception au Québec, alors que le secteur apicole comptait 440 producteurs en 2019. Ces derniers ont produit 1,8 tonne métrique de miel, générant par la même occasion 25,2 millions de dollars uniquement pour la vente de miel non transformé. C’est donc sans surprise que la disparition croissante des populations d’abeilles domestiques suscite une certaine préoccupation, non seulement dans une vision environnementale, mais également économique.
Les défis auxquels les insectes font face présentement, notamment en raison de l’utilisation massive de pesticides et des conséquences intrinsèquement liées aux changements climatiques, se répercutent sur la production alimentaire et entraînent davantage de maladies graves. On note parmi celles-ci le cancer de la prostate ainsi que les problèmes de consommation.
Selon une étude menée par le département de santé environnementale du Harvard T.H. Chan School of Public Health, les procédures de pollinisation inadéquates causent environ 427 000 décès supplémentaires par an en raison de divers troubles de santé tels que les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux et le diabète. « Cette étude montre que faire trop peu pour aider les pollinisateurs ne nuit pas seulement à la nature, mais
aussi à la santé humaine », souligne Matthew Smith, chercheur principal en santé planétaire. (traduction libre)
Vers des pistes de solutions
À l’approche du jour de la Terre, qui se tiendra le 22 avril prochain, la prise de conscience des lacunes en termes de protection des colonies d’abeilles mellifères s’impose, de même que la proposition d’initiatives visant à poser des actions concrètes en termes de développement durable. À grande échelle, celles-ci passent avant tout par les politiques publiques, telle que la COP 27, qui a eu lieu en novembre dernier. Bien que prometteuses, ces conférences internationales demeurent toutefois insuffisantes.
Trois éléments principaux sont essentiels à la survie des abeilles face à la crise climatique, soit les refuges microclimatiques appropriés, l’accès à une source d’eau et l’accès à une source nutritive sans pesticides. La
préservation de la biodiversité repose donc sur un revirement idéologique complet, notamment par une restructuration de l’industrie agricole, en insistant sur la protection d’habitats naturels déjà existants.
À plus petite échelle, les actions individuelles peuvent elles aussi contribuer considérablement à la conservation des abeilles domestiques. Comme solution peu coûteuse, le jardinage effectué dans le respect des insectes favorise la réduction de l’empreinte carbone en plus de générer des produits comestibles faisant le bonheur des cultivateur. rices. Marika D’Eschambeault, responsable du programme « Mon jardin Espace pour la vie », estime que « jardiner pour la biodiversité, c’est jardiner de façon écologique. » À cet effet, l’arrivée de la saison estivale se présente comme l’occasion parfaite de développer son pouce vert. Pour savoir par où débuter, de nombreux conseils se trouvent sur le site internet Mon Jardin.


Références
Udemnouvelles. (2022, 15 novembre). Conséquences du dérèglement climatique sur les insectes : des scientifiques lancent l’alerte. Udemnouvelles . https://nouvelles. umontreal.ca/article/2022/11/15/effets-du-dereglementclimatique-sur-les-insectes-des-scientifiques-lancent-lalerte/
UPA. (2022, 29 avril). Mortalité des abeilles : un enjeu majeur pour la société. Union des producteurs agricoles. https://www.upa.qc.ca/citoyen/centre-des-communications/ nouvelles/toutes-les-nouvelles/mortalite-des-abeilles-unenjeu-majeur-pour-la-societe
Fisher, J. (2023, 30 janvier). Parasites, pesticides, climate change linked to loss of honey bee colonies. United Press International . https://www.upi.com/Science_ News/2023/01/30/honey-bee-colony-loss-varroamite/1611675108636/
Murez, C. (2022, 14 décembre). Loss of bees linked to adverse health effects for people. United Press International. https://www.upi.com/Health_News/2022/12/14/loss-beeshealth-people/9051671032499/
Heuzebroc, J. Disparition des abeilles : hécatombe involontaire? National Geographic. https://www. nationalgeographic.fr/environnement/disparition-desabeilles-hecatombe-involontaire
WWF. (2018, 5 septembre). L’apiculture urbaine, ça aide la biodiversité ou pas? WWF .https://wwf.ca/fr/stories/ lapiculture-urbaine-ca-aide-biodiversite/

Alors que les torrents de la fonte des glaciers urbains coulent sous nos semelles de trois pouces, la nature chante son hymne et fait revivre les jolies couleurs qui dormaient sous la neige. Il y a de ces moments où la nature nous rappelle significativement que nous sommes les habitant.es de ses dérives plutôt que l’inverse. Au moment où la rivière Chaudière gonfle son torse, certain.es se souviennent d’avril 2019. Ce printemps où le cycle impératif de la nature a emporté une partie de leurs souvenirs, de leur vie.
À Sainte-Marie de Beauce, plusieurs centaines de résident.es ont dû quitter leur maison et partir avec seulement leurs inquiétudes en main. Il est facile, lorsque submergé par le flot de notre travail, de nos études ou de nos préoccupations d’oublier que la nature ne change pas selon nos 9 à 5 ou nos 5 à 7. Aujourd’hui, autour de la pâtisserie trône un mur qui témoigne de la montée des eaux, mais surtout de la peur d’un prochain débordement. Il est difficile d’en dire autre chose qu’il est imposant.
Un imposant rempart de métal. Plusieurs terrains entourent ce même bâtiment. C’est un quartier peuplé de maisons membres fantômes. Ces maisons qui seront toujours belles, mais qui feront toujours un peu mal par leur absence. Pousseront bientôt des champs de fleurs sur le cimetière des souvenirs. Ils n’effaceront jamais la sensation qu’il y manque tout de même quelque chose. Ces absences ont été synonymes de décisions difficiles. Il faut démolir. Il faut partir.
Ma grand-mère a vécu près de Sainte-Marie toute sa vie. Elle traversait la rivière Chaudière pour aller faire ses emplettes sur la rue Notre-Dame. Plus qu’une artère, elle faisait battre la ville au complet. Théâtre de l’intégralité des événements importants, elle abritait son histoire, son début, sa fondation. Aujourd’hui, le centre de la ville a migré quelques centaines de mètres plus loin. Le printemps a fait pousser un boulevard.

Ma grand-mère ne magasine plus sur la rue NotreDame.
Les villes et villages aux alentours voient défiler, d’année en année, d’imposants morceaux de glace. Ils finissent par échouer sur les berges du boulevard ou par reposer dans le stationnement du Tim Hortons, lui aussi barricadé derrière son mur gris. Lorsque la ville est calme, il est parfois possible d’entendre la glace sur la rivière pousser des cris d’avertissement.
Elle nous notifie de sa présence, nous rappelle que nous habitons ses terres. Il faut dire que le soleil finit chaque année par vaincre les glaces. Elles cèdent leur place à la renaissance et le torrent nous chante l’arrivée du printemps. Cette année encore elle gonflera. En espérant qu’elle reste dans son lit. Que le réveille-matin climatique soit ralenti. Qu’il la laisse dormir, lui laisse 100 ans avant de venir chercher d’autres souvenirs. La rivière s’est toujours
éveillée au printemps. Il ne faut pas lui donner de quoi faire de l’insomnie.
Malgré tout, les inondations et les débâcles sont partie intégrante des paysages qui peuplent la nature. Ce n’est pas une erreur d’équation printanière. L’eau est toujours montée à la fonte des neiges. Les débordements habitent ces villes et villages, mais surtout les mémoires. Les habitant.es des rives construiront des digues coulées dans la résilience. L’eau montera toujours à la fonte des neiges.
Lavoie, M-A. (2019). Les inondations historiques ont rendu les Beaucerons « plus forts ». Radio-Canada.https://ici. radio-canada.ca/nouvelle/1694672/inondations-

Savais-tu que l’ÆLIÉS a un service dédié à t’accompagner pour faire respecter tes droits étudiants?
Service d’accompagnement aux droits étudiants
EST:
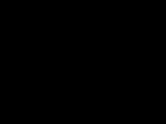
Est responsable des dossiers relatifs aux droits des membres sur le campus
Encadre et accompagne les membres en ces matières et ce, dans la confidentialité et le respect.
Peut vous conseiller sur les manières de régler un conflit d’encadrement ou une situation problématique freinant l’atteinte de vos objectifs académiques.
N’EST PAS:
Les employés de ce service ne sont pas des avocats et ne peuvent pas exercer un acte légal réservé aux membres du Barreau du Québec.
Disponible en présentiel à la MMS ou par courriel: aide.droits@aelies.ulaval.ca
Tous les membres de l’ÆLIÉS peuvent contacter le service d’accompagnement aux droits étudiants pour obtenir des conseils et de l’accompagnement dans la résolution de problèmes.
Pour plus d’informations écris à: aide.droits@aelies.ulaval.ca
Connaissez-vous votre association et ses services ?
Aujourd’hui, nous allons vous parler de notre émission Question de savoir et du service d’accompagnement en droit étudiant de l’AELIÉS !
L’émission Question de savoir, c’est votre demi-heure d’actualité sur l’éducation supérieure présentée par l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures (ÆLIÉS). Enjeux politiques, vie universitaire, recherche scientifique, perspectives d’avenir et bien plus sont à l’honneur dans ce rendez-vous hebdomadaire mettant en vedette les étudiant.es membres de l’AELIÉS.
L’émission se déroule chaque mercredi à partir de 11 h sur les ondes de CHYZ 94,3. Si vous voulez participer, écrivez-nous directement à l’adresse suivante : communications@aelies.ulaval.ca
En ce qui concerne le service d’accompagnement en droits étudiants de l’AELIÉS, celui-ci comprend : -un accompagnement et des conseils en matière de droits étudiants par courriel ou lors de rencontres;
-une aide lors d’exclusion de programme;
-une aide lors d’accusation de plagiat (explication des procédures et aide au besoin, participation en tant qu’observateur. trice au Comité de discipline si l'étudiant.e le souhaite);
-de l’information et une aide concernant les révisions de note;
-une aide lors de situations de conflit avec des professeur.es, notamment lors d’encadrement à la recherche;
-une possibilité d’aide lors de la recherche d’informations relatives à un service de l’Université Laval.
Pour accéder à ces services, voici les horaires :
-à l’AELIÉS : le mardi et le jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 17 h ainsi que le mercredi de 9 h à 12 h;
-à distance : le lundi de 10 h à 14 h ainsi que le mercredi de 13 h à 17 h.

Meet your maker

Par Ludovic Dufour, chef de pupitre société

Il y a des jeux qui aiment se faire attendre. Année après année, leur sortie est continuellement repoussée à un point où plusieurs ne dépassent jamais le stade de projet. Pour Dead Island 2, le dénouement est heureux, car le jeu va finalement voir le jour en avril quelque 8 ans après sa date de sortie initiale. Dans cette aventure de Dambuster Studios, les survivant.es d’une apocalypse de zombies doivent faire face aux morts qui rôdent dans Los Angeles. Cette action RPG d'horreur peut s'aborder seule ou en coop avec deux autres camarades afin d'accomplir des quêtes aux quatre coins de la ville. Le studio promet des personnages plus grands que nature, une grande variété d’armes et une aventure over the top sanglante. Espérons que l’attente en ait valu la peine.
Meet your maker
Éloignons-nous quelques instants de toute cette violence, cette action et ce stress pour se relaxer avec Roots Of Pacha. L’équipe du studio Soda Den nous propose un instant de calme en nous emmenant dans une préhistoire aux accents d’Animal Crossing ou de Stardew Valley. La vie bien remplie d’hommes ou de femmes des cavernes nous amènera à dresser des animaux, bâtir des fermes, braver des souterrains et découvrir de nouvelles technologies et idées. Notre tribu déborde de personnages colorés à rencontrer avec lesquels nous pourrons tisser des liens, voire même tomber amoureux.euse, le tout dans un environnement personnalisable à aménager à son goût. Ajoutons à tout cela un mode coopératif et l’on se retrouve avec une belle expérience de détente à partager, ce qui tombe à pic avec cette fin de session.

Meet your maker met de l’avant un mélange de styles des plus originaux et intrigants en combinant jeu d’action à la première personne et construction de niveaux. Dans un premier temps, le jeu de Behaviour Interactive Inc nous permet de nous créer une base dans un monde postapocalyptique. Il ne s’agira pas ici de gestion, mais plutôt de concevoir un labyrinthe mortel, tapissé de pièges et de monstrueux gardiens. Dans un second temps, la partie action nous amène à faire face à ces créations. À nous de déjouer les embûches, combattre les ennemis et trouver notre chemin au centre de ces dédales élaborés par d’autres joueur.euses. La communauté crée donc ellemême ses propres niveaux et même ses propres ennemis. Les concepteur.rices sont récompensé.es à chaque fois qu’un.e joueur.euse est vaincu.e dans son labyrinthe, et de même, celleux en atteignant la fin reçoivent des ressources pouvant être utilisées pour améliorer leur équipement ou mettre au point des créations plus létales. Meet your maker promet donc de satisfaire à la fois les passionné.es de création et d’innovation, tout comme celleux avides d’action dans un monde en perpétuelle évolution, puisque créé par la communauté même.

Ça y est, on voit la fin de la session lorsqu’on plisse les yeux. Pour donner un petit coup de pouce de motivation, Impact Campus a préparé 5 playlists en 5 moods, qui goûtent toutes le soleil.
Bécyk-rouliplanche-roller : le vent mêle les cheveux pis le soleil rougit la nuque par Sabrina
- Y tu te vas – La Femme
- Instant zéro – Laurence-Anne


- Les gens – Robert Robert
- QUATRE-QUARTS – Hubert Lenoir
- All Night – Romare
- Lazuli – Beach House
- Feel Good Inc. – Gorillaz
- Electric Feel – MGMT
- Pakomifo – Renard Tortue
- Cowboy Groove – Jean Leclerc
Là-haut perchée par Frédérik
- Shida – Khruangbin
- Cherchez La Ghost – Orions Belte
- Endless Dave – L’éclair
- Le soleil dans le monde – Domenique Dumont
- Lost My Mind – Will Van Horn
- Mumbo Sugar – Arc de Soleil
- Idol Eyes – Common Saints
- Raspberry Jam – Allah-Las
- Charmed – Σtella, Redinho
- Queens Highway – Menahan Street Band
Canyon et alfalfa par Jade
- Dandelion Wine – Gregory Alan Isakov
- Highway Vagabond – Miranda Lambert
- Talladega – Eric Church
- Walkin’ After Midnight – Pasty Cline
- Amarillo by Morning – George Strait
- Early Morning Breeze – Dolly Parton
- Sun to me – Zach Bryan
- Jersey Giant – Elle King
- Huckleberry – Toby Keith
- The Best Day – Taylor Swift
Prendre du soleil jusqu’à presque s’endormir par Emmy
- Frisbee et marmelade – Thierry Larose
- La rivière – Pomme
- Le vent se lève – Étienne Coppé
- Tu pars – Ariane Roy
- Toutes les femmes sont belles – Gab Bouchard
- Ton vieux nom – Elisapie
- Dormir dans l’auto – Daniel Bélanger
- L’amitié – Françoise Hardy
- Été 90 – Therapie Taxi
- Trop beau – Emma Peters
photosynthèse.la.nuit par Gabriel
- Looks Just Like the Sun – Broken Social Scene
- Fleur de violence – Loïc April
- saltspring – Ada Lea



- Hey Lumière – Caltâr-Bateau
- Sun in the Sky – Destroyer
- Arboretum – Duu
- Birds & Bees – Weaves
- Botanique – Laurence-Anne
- Solar Eclipse – Thus Owls
- Je tombe avec la pluie – Forêt




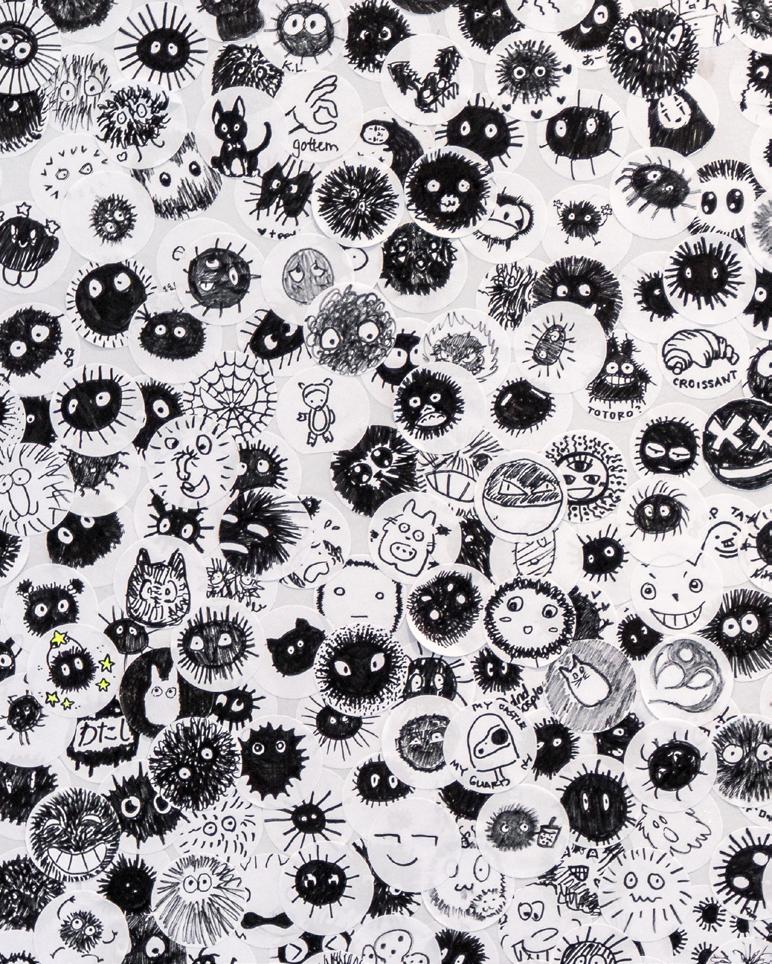
Pour se reposer entre deux examens ou pour s’étirer un peu le cerveau pendant une séance de balcon, remplissez notre sudoku et découvrez notre mot caché !
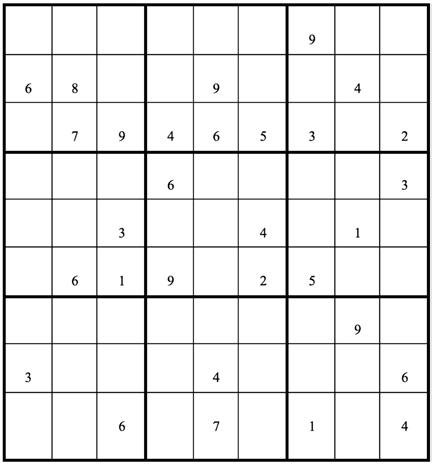






ÉCOUTE LOCAL




L’émission mythique Club critique est de retour une semaine sur deux de 13 h 30 à 14 h avec Mémo Gauthier, Gabriel Tremblay et Émilie Rioux.


Après une pause bien méritée, Radio Futura est de retour sur nos ondes les samedi et dimanche de chaque semaine.
















Par Frédérik Dompierre-Beaulieu, cheffe de pupitre aux arts
Les pins – Lisen Adbådge – Éditions Cambourakis
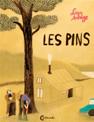
Quatrième de couverture : Une famille pense avoir trouvé l'endroit parfait pour construire sa maison. Mais une fois installés dans leur nouveau foyer, les habitants de la maisonnée font face à des situations étranges, entre la sève qui suinte à travers les murs et les aiguilles de pin qui se multiplient, jusqu'à se transformer euxmêmes en arbres. Une fable écologique sur la cohabitation entre l'homme et la nature.
Ce qu’il est advenu de ma mort – Vicky Bernard – Éditions Conifère
Quatrième de couverture : Ce qu’il est advenu de ma mort est l’histoire d’une parenthèse trop longtemps ouverte, d’une fin foudroyante – ou plutôt d’un début. Un texte qui raconte nos visages qui se détachent, nos corps qui nous quittent et les mots retrouvés. Une poésie qui, à coup de crazy glue, tente de rapiécer les morceaux de la vie dans une langue du quotidien, entre lit défait et bord de lac.
Encore – Marie Darsigny – Éditions du Remue-

Quatrième de couverture : Et s’il était possible de raconter autrement la toxicomanie que selon le traditionnel schéma qui va de la chute à la rédemption ? Hors de cette trame, le panorama semble brouillé, tant par la médicalisation que par la marchandisation du rétablissement. Entre essai, récit et autofiction, Marie Darsigny, autrice de Trente et de Filles , creuse ici sa propre histoire de dépendance à l’alcool et aux drogues.
Quatrième de couverture : Le récit parallèle de quatre femmes, blanches et innues, que rien ne semble relier. Pourtant, entre tragédies et espoirs, traditions et apprentissages, leurs destins respectifs se révèlent emmêlés. Parfois pour le meilleur… mais surtout pour le pire.

La
Quatrième de couverture : Olga et Olaf vivent dans une maison plantée au sommet d'un pic montagneux. Dès qu'un oiseau se pose dessus, elle penche, et il faut rapidement se positionner pour maintenir l'équilibre. Leur vie s'organise de cette façon avec leurs jumeaux, Gina et Tino. Un jour, une dispute éclate, entraînant un déséquilibre et la chute de la maison.
Quand le ciel rougira – Camille Lapierre-StMichel – Éditions Poètes de brousse

Quatrième de couverture : On entend souvent dire que le deuil se vit par étapes, comme un douloureux chemin linéaire vers l’assentiment de la disparition. Et s’il n’en était rien ? Et si, confrontés au vide laissé par la personne aimée, nous étions simultanément avec et sans elle, déchirés entre les souvenirs et la peur d’oublier, perdus dans l’attente que l’autre « redevienne un souvenir heureux » ? Articulé autour du deuil de la mère, Quand le ciel rougira embrasse et nomme avec une bouleversante acuité le grand chaos dans lequel la maladie et la mort nous propulsent avant, pendant et après l’irrémédiable absence..

Écrire l’oralité. Je t’entends parler, avec ton accent et la rondeur de certains de tes mots. Sometimes empruntés à l’anglais, parfois empruntés à une France ancienne. Je t’écoute parler et je vois les paysages qui s’ouvrent entre chacun de tes mots. La mer et les vents qui balancent le linge qui sèche sur la ligne à harde. Ton dialecte bien à toi, tu parles le chiac.
L’Acadie. Pays aux frontières les plus floues. Dispersé.es des côtes de l’Atlantique à la Louisiane, les Acadien.nes sont symbole de résistance, de résilience. L’est aussi leur littérature : imprégnée par la quête identitaire de celleux qui se nomment elleux-mêmes Acadien.nes. Car l’Acadie n’est pas géographique, elle suit celleux qui s’identifient comme tel.les.
Perce-Neige. Une culture tout entière qui perce la neige de notre francophonie. En 1980, l’Association des écrivains acadiens fonde les éditions Perce-Neige à Moncton dans l’objectif de donner – ou redonner – la voix aux auteur.rices acadien.nes. Serge Patrice Thibodeau en est le directeur général depuis 2009. La maison d’édition a pour mission de privilégier les voix émergentes et publie toutes les formes littéraires : pièces de théâtre, essais, romans et surtout, recueils de poèmes.
Survol de quelques œuvres marquantes
Antonine Maillet, Pélagie-la-Charrette (1979)
Un peuple qui n'a pas oublié la France après un siècle de silence et d'isolement n'oubliera pas au bout de quinze ans d'exil ses rêves d'Acadie. Il se souvenait de sa frayère comme les saumons, et comme les saumons, il entreprit de remonter le courant.
- Antonine Maillet, Pélagie-la-Charrette (1979)
Probablement la voix acadienne la plus connue, Antonine Maillet fait briller l’Acadie sur la scène internationale avec l’obtention du prix Goncourt en 1980 pour son roman Pélagie-la-Charrette. Elle devient la première autrice étrangère à remporter le prestigieux prix de littérature française. Son récit illustre à la fois l’importance de la tradition orale du peuple acadien et sa quête identitaire, conséquence du Grand Dérangement de 1755. Pélagie entreprend, avec sa charrette, de retrouver la Terre perdue, emportant avec elle tous ceux qu’elle trouve sur son passage. Antonine Maillet y dément le mythe « qu’un peuple qui ne sait lire ne saurait pas avoir d’Histoire » (Maillet, 1979, p.14).
Gérald Leblanc, Éloge du chiac (1995)
De jouer dans la langue et d’en rire d’en rêver quand on find out qu’on communique même si le voisin fait mine de ne rien comprendre too bad de se priver.
- Gérald Leblanc, Éloge du chiac (1995)
Gérald Leblanc est un fervent défenseur de l’Acadie et surtout, un grand poète. Il participe à la fondation des éditions Perce-Neige et en sera le directeur littéraire de 1997 jusqu’à son décès, en 2005. Résident de Moncton, il raconte Moncton. Son recueil s’offre comme une réflexion sur la langue. Il écrit sur le quotidien, ancrant chacun de ses vers dans une acadianité omniprésente. Il a la volonté d’effacer la vision folklorique de l’Acadie tout en rendant accessible la poésie.
Herménégilde Chiasson, Mourir à Scoudouc (1974)
Comment arriver à dire que nous ne voulons plus être folkloriques, que nous ne voulons plus être des cobayes d’Acadie Acadie, que nous ne voulons plus qu’on aie [sic] pitié de nous, […] Comment arriver à dire que nous n’avons peut-être rien à dire que nous sommes en train de couler comme si nous étions encore sur les bateaux pourris du colonel Monkton. - Herménégilde Chiasson, Quand je deviens patriote dans Mourir à Scoudouc (1974)
Herménégilde Chiasson, reconnu comme un père du modernisme acadien, est un artiste multidisciplinaire dont l’œuvre tout entière se consacre à la défense de la culture et des arts acadiens. Il utilise sa voix dans l’objectif de démentir l’idée d’une Acadie-tradition et de la transposer dans la modernité avec ses auteur.rices et ses poètes. Lui forger une place, lui tirer une bûche autour de la table de la francophonie canadienne, c’est ce à quoi aspirent les écrits d’Herménégilde Chiasson. Son recueil de poèmes Mourir à Scoudouc, publié en 1974, est empreint d’une volonté rageuse de s’affirmer dans la rupture avec la tradition. Son titre, par ailleurs, projette l’idée de renaissance, par la mort d’une Acadie ancienne, vers une Acadie florissante, tournée vers l’avenir.
Sa voix résonne dans les soirées, voitures et boîtes de nuit de la ville : pleine de vie, Cunnila est une chanteuse guadeloupéenne qui a commencé la musique tout récemment à Québec. C’est une artiste qui trouve enfin sa voie et s’affirme de plus en plus sur le devant de la scène québécoise. À l’occasion de sa dernière sortie musicale Jaloux, Cunnila se livre à Impact Campus et nous retrace son chemin en exclusivité.
Par Joyce Shabani, cheffe de pupitre société
Impact Campus: Cunnila, je pense que de nombreuses personnes se demandent comment a commencé la musique pour toi. Dis-nous tout !
Cunilla: C’est l’écriture qui m’a vraiment portée vers la musique. Dans un mémo, je mettais absolument tout ce que j’écrivais durant mon adolescence. Après quelques années, j’ai découvert les types beats sur YouTube et c’est comme ça que j’ai commencé à passer des heures à chanter.
I.C: Comment es-tu passée de chanter dans ta chambre à enregistrer des titres ?
C: Comme je n’assumais pas ma passion et mon talent, je m’arrangeais pour être seule lors de mes sessions de chant à la maison, jusqu’au jour où mon colocataire m’a surprise en train de chanter. Je n’avais pas entendu la porte. C’est lui qui m’a motivée à démarrer une carrière musicale.
I.C: De quelle façon peux-tu expliquer les différentes directions artistiques sur tes chansons ? Butterfly, ton premier titre, sonne plutôt mélodieux tandis que Tequila, par exemple, est beaucoup plus dansant. On sent que tu t’affirmes sur le second titre. On aimerait comprendre pourquoi.
C: Butterfly est le plus doux de mes titres, c’était un choix réfléchi. Comme c’était le premier, il fallait que je me présente simplement et sans trop de prises de risque pour que ça plaise. Tequila me ressemble bien plus, mais ça aurait été un risque, que je n’étais pas prête à prendre.
I.C: Tes premiers titres connaissent un succès relativement bon localement, mais as-tu pensé à élargir tes horizons musicaux ? Ou peut-être même à entreprendre une carrière tournée vers l’international?
C: Pour être honnête, je considère tellement la musique comme une passion que je n’ai jamais vu mes œuvres comme la constitution d’une carrière. Rien ne prévoyait que je me lance dans la musique, je ne connaissais rien à l’industrie. J’ignorais même l’utilité d’une maison de disques (rires). Étant étudiante, je me laisse juste porter par ma passion sans me mettre de pression pour quoi que ce soit. Je suis dans le mood « si ça prend, ça prend, sinon ce n’est pas grave ». Disons que je kiffe juste l’instant présent.
I.C: Penses-tu que la scène québécoise met suffisamment de moyens à disposition pour développer une carrière musicale ?
C: Pas vraiment. J’ai tenté les envois de titres à la radio, en vain. J’ai aussi essayé de paraître à des festivals locaux, sans suite. Mes principales opportunités m’ont été données par des étrangers comme moi. N’empêche, les artistes québécois sont très talentueux et sont vraiment dans le partage de l’art.
I.C: Serais-tu capable d’expliquer pourquoi il y a ce décalage dans la sphère musicale québécoise ?
C: Selon moi, le Québec n’est pas prêt pour cet exotisme musical. Bien qu’il existe des personnes qui apprécient vraiment ma musique, j’ai toujours senti qu’il y avait un
enjeu. Sûrement aussi parce que Québec est une ville conservatrice, non pas en termes de politique mais en termes d’habitudes. J’ai dû chanter en français, par exemple, pour rendre ma musique accessible. C’est probablement le fait que je ne sois pas suffisamment représentative pour tous et toutes.

I.C: Considères-tu que ce soit un problème pour avancer dans ta carrière ?
C: Non, pour la simple et bonne raison que j’apporte mon propre truc. J’aime vraiment ce que je fais, donc je le ferai jusqu’à ce que ça plaise. Je n’adapterai pas ma musique pour plaire. De toute façon, j’enchaîne les showcases et ça cartonne. Les gens dansent, chantent, prennent des photos et gardent de très bons souvenirs. C’est l’essence de ma musique, ce partage. Si ça plaît à certain.es, c’est que c’est du bon taf !
I.C: Pour finir, Cunnila, est-ce que tu considères avoir une responsabilité en termes de représentation dans ta musique ?
C: Étant donné que je fais de la musique qui me ressemble, je pense que ça va de soi. Que ce soient mes titres comme Whine Up , Jaloux ou même OnlyFans, ils ont tous une sonorité dansante qui reflète les Antilles. Ce pont entre la musique urbaine, dont je m’inspire, et les sonorités caribéennes m’a permis de saisir de belles occasions. J’ai pu chanter pour un salon d’exposition à l’occasion du Black History Month par exemple. Je chante aussi lors de soirées spéciales caraïbes en club. L’effort de représentation est sûrement un pari réussi pour l’instant !




D’habitude, je vais au travail à pied, j’ai toujours aimé marcher, mais ce matin, ma collègue me propose de passer me prendre en voiture. La température hivernale a raison de mon courage et je finis sur le siège passager. La radio nous donne une excuse pour ne pas parler. J’essaye d’abord de suivre les paroles de ces êtres sans visage, mais je dois me rendre à l’évidence ; le sujet me reste étranger. Les minutes passent et les mots des animateur. rices se heurtent à mon incapacité d’écouter.
Les termes restent simples, pourtant les phrases formées me paraissent des énigmes que je n’ai pas le courage de résoudre, ni la curiosité.
Ma curiosité est demeurée coincée à l’intérieur de mes cahiers d’école, entre les pages perdues de mes débuts créatifs. Elle n’a pas su faire face à l’anxiété, à la survivance et au besoin de ne plus penser à rien. Mon esprit, depuis l’adolescence, ingère des sons du matin au soir, la plupart
du temps jusque dans la nuit. Je suis incapable depuis bientôt sept ans de dormir en silence. Des vidéos YouTube se succèdent sur mon téléphone, tandis que je m’endors; mais aussi lors de mes tâches ménagères ou de la rédaction de mon mémoire.
Tout se construit dans ma vie pour me refuser de pousser ma compréhension du monde plus loin qu’un bruit de fond.
Pourtant, mon esprit repère un mot qui revient à plusieurs reprises dans le sujet du jour. Ma collègue monte le son : Débâcle.
Le mot se glisse jusque sous ma peau. Le sens d’abord abstrait me semble familier, intime. Des termes se bousculent dans ma tête.
L’effondrement, la catastrophe, la chute.
La nature, l’humain, la précipitation de ce qui aurait dû être évité.
L’Arctique, les rivières, les glaciers.
La sensation de se noyer sous le regard d’étrangers, de proches aussi.
La certitude de ne pas être assez pour soi, pour les autres, pour le monde. ****
Ma journée de travail passe comme un coup de vent, je me retrouve à marcher sur le bord de l’avenue Maguire.
J’utilise les derniers pourcentages de mon téléphone pour chercher les définitions du Robert de ce mot qui tourne encore et encore dans mon esprit.
Rupture subite de la couche de glace (d’un cours d’eau) dont les morceaux sont emportés par le courant.
Fuite soudaine (d’une armée).
Effondrement soudain.
Mon téléphone s’éteint.
Ma colocataire me demande la soirée même si je ressens l’écoanxiété. Je lui demande si elle arrive à dormir dans le silence, si elle réussit à faire taire ses pensées sans devoir les noyer.
« Noyer mes pensées, ce serait me tuer. »
À coups de pelle, mi-frustrée, mi-brûlée, j’appelle le printemps. Si la moquette blanche est belle pendant le temps des fêtes, elle passe de mode le 6 janvier. Les opérations déneigement vibrent, leurs notifications sonnent d’amour et de haine à mes yeux. Amour pour l’impression de sociabilité, haine pour le « Déneigement SFSCR ».
Par Camille Desjardins, journaliste collaboratrice
Bonjour Québec, je passerai mon hiver en relation avec le 64123.
Blague à part, janvier est un mois gris et sans beauté.
« Oui, mais on peut faire du ski » – Oui, mais je suis partie. À la première heure, j’ai pris l’avion et j’ai fui, croyant me sauver de la typique dépression hivernale. Du froid au chaud, du chaud au froid, j’aurais dû me faire une réserve de vitamines, question de survivre à la descente en carpette qui m’attendait à mon retour. Rapidement, je suis redevenue blanche comme un pétale de fleur.
Pour tenter d’ensoleiller les journées froides au ciel monochrome, sur la patinoire du quartier, je me suis mise à compiler les axels, coupant de mes carres la glace durcie et infracassable, comme mon cœur congelé depuis le 21 janvier. L’hiver s’annonce ardu pour vrai ; les étourdissements résultant de ces rotations d’un tour et demi dans l’espace me font chuter. Le sel dans les crevasses de glace, mes mains sur le sol, le sel irritant mes plaies. Douleur insupportable, mes doigts gercés prendront l’hiver à guérir. J’aurais dû rester sur la plage à camper en bordure de mer. Autant bien en profiter pour lever son verre avant le mois de la sobriété : février. Xylographie sur glace, je range mes patins, mes doigts se gelant, se fissurant. Enfin, l’axe imaginaire de mes peurs rencontre l’axe réel de cet hiver redoutablement frileux. Les jours romantiques de février sauront peut-être prouver leur valeur dans cet hiver sans chaleur. L’amoureux du 64123 m’écrit toujours, je me sens hautaine et forte de ne jamais lui répondre, même lui me fait chanter « I know I’m not the only one ». Entendre les sérénades des tourtereaux de façon illimitée
aurait été plus plaisant que d’entendre le piquetage des enseignant.es dépassé.es en ce mois de février. Mais où allons-nous, en vacances ou en rattrapage ? Les fleurs d’hiver se plaignent avec ardeur, les bancs de neige massifs les empêchent de fleurir. Février ne devait-il pas être un séjour de 28 jours émoustillant d’amour et de bonheur ? Couche par couche, je m’enveloppe pour marcher, en me disant que j’aurais dû faire le plein de vitamine.
- La vitamine C sera pour mon immunité, question de survivre à toute éventualité.
- La vitamine B sera pour réchauffer mon corps brisé, mes organes vitaux s’arrangeront du mieux qu’ils pourront.
- La vitamine D, sera pour détendre mes muscles contractés, durcis par le froid glacial ainsi que pour combattre l’asthénie due à mes nuits angoissées.
Bonjour Québec, peux-tu commencer à faire place au beau temps stp.
Mars sera la dernière course avant ce renouveau de couleur et de beau temps. Mine de rien, je crains le départ de mon amant 64123. Nos rendez-vous nocturnes au coin de la rue vont peut-être me manquer finalement. Il tient à ma santé, me fait marcher, happée par le froid, la toxicité de notre amour me comble, quelle ironie. « 64123 : je t’écrirai jusqu’en avril, et telle une relation toxique, je m’infiltrerai à nouveau dans tes messages le prochain hiver venu ».
Les nuages gris se mouvant, le soleil sort tranquillement de son hibernation. Comme les nuages, les jours fades de janvier délaissent de leur omniprésence, délaissent de leur pesanteur sur mon moral. Les jours, libres de cours, ont besoin de distraction, je les comble de rédaction. Les rayons qui traversent ma fenêtre dégèlent mes artères et ravivent ma joie de cœur. Peut-être que d’ici avril je survivrai aux engelures du début d’année, mes doigts guériront peut-être de ces blessures qui durent et perdurent. «These kind of wounds they last and they last ».

En attendant la floraison du changement de saison, je m’amuse à planter des métaphores de fleurs ici et là.
Fausse impression de l’arrivée du printemps, les quelques beaux jours de mars implorent le retour du beau temps. Pour les quelques jours de neige qui restent, je prendrai le 64123 en bouche-trou de mes désolations, à son départ en avril, tels les fils de mon lainage favori, je me découvrirai de mes couches superflues, utiles à la protection immunitaire de ma santé mentale. Décorée d’or plaqué, je rayonnerai comme les éclaircies qui se pointent le nez. Resplendissante de force, je percerai à mon tour les couches de glace de mon cœur, résultant de tes mensonges blancs. Au travers des fissures, je me faufile pour me reconstruire, pour fleurir. Cet hiver, j’étais perce-neige, au printemps, je serai narcisse.
Le Réseau international étudiant pour le climat – UniC est une communauté de pratique où les étudiantes et étudiants universitaires du monde convergent pour partager, apprendre, collaborer et agir ensemble pour le climat. Développez vos compétences et renforcez votre pouvoir d’agir sur le climat en devenant membre de ce réseau international.
Pour en savoir plus unic.ulaval.ca
