

NOUS SOMMES
Rédactrice en chef
Emmy Lapointe (elle) redaction@impactcampus.ca
Chef de pupitre actualités
Antoine Morin-Racine (il) actualites@impactcampus.ca
Cheffe de pupitre aux arts
Frédérik Dompierre-Beaulieu (elle) arts@impactcampus.ca
Journaliste multiplateforme
Camille Sainson (elle) societe@impactcampus.ca
Journaliste multiplateforme
Florence Bordeleau-Gagné (elle) multimedias1@impactcampus.ca
Journaliste édimestre
Mégan Harvey (elle) photos@impactcampus.ca
Directrice de production
Paula Casillas Sánchez (elle) production@impactcampus.ca
Directeur général
Stéphane Paradis dg@comeul.ca
Représentante publicitaire
Kim Létourneau publicite@chyz.ca
Journalistes collaborateur.rices
Lucie Bricka, François-Xavier Alarie, Julianne Campeau, Jérémie Saint-Pierre, Henri Paquette et Émilien Côté.
Conseil d’administration
AGA 22 Novembre
Réviseures linguistiques
Sabrina Boulanger et Érika Hagen-Veilleux
Impression
Publications Lysar inc.
Tirage : 5000 exemplaires Dépôt légal : BAnQ et BAC
Impact Campus ne se tient pas responsable de la page CADEUL et de la page ÆLIÉS dont le contenu relève entièrement de la CADEUL et de l’ÆLIÉS. La publicité contenue dans Impact Campus est régie par le code d’éthique publicitaire du journal, qui est disponible pour consultation au : impactcampus. qc.ca/code-dethique-publicitaire
Impact Campus est publié par une corporation sans but lucratif constituée sous la dénomination sociale Corporation des Médias Étudiants de l’Université Laval.
1244, pavillon Maurice-Pollack, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6
Téléphone : 418 656-5079
ISSN : 0820-5116
Découvrez nos réseaux sociaux !
@impactcampus

LE
6
ÉDITO
6 Résistons par Stéphane Paradis
18 Les traversées par Emmy Lapointe
8
ACTUALITÉ
SOMMAIRE 20
8 Sodexo, cible de la grogne des étudiant.es : enquête sur les cafétérias de l’Université Laval par Camille Sainson et Florence Bordeleau
SOCIÉTÉ ET SCIENCES
20 De l’Imago Mundi à Google Earth : un voyage à travers l’histoire de la cartographie par Lucie Bricka
24 Sur la piste du parc national Assinica : une chasse aux couleurs administratives pour les Cri.es d’Oujé-Bougoumou par Florence Bordeleau et Gabrielle Côté
28 Les paysages de l’Insoutenable par Antoine Morin-Racine
38 Médias: notre société en pleine dissonance cognitive par Jérémie Saint-Pierre
40 Faire le tour du monde depuis son salon par Julianne Campeau
44 DOSSIER - DEHORS
44 Cartographier l’histoire d’un pays, une île à la fois par François-Xavier Alarie
46 En photos - El Salvador par Mégan Harvey
50 Toute aventure débute par une carte ! par Henri Paquette
54 Vagues et courants par Florence Bordeleau
62 LUDIQUE
62 Interlude par l'équipe d'Impact Campus
64 La carte de Québec par l'équipe d'Impact Campus
66 L'horoscope par l'équipe d'Impact Campus
70
ARTS ET LITTÉRATURE
70 Le Palmarès de Chyz 94.3 par l'équipe de Chyz 94.3
72 Suggestions littéraires par Frédérik Dompierre-Beaulieu
74 Suggestions cinématographiques par l'équipe d'Impact Campus
76 HMS Wager – une sombre histoire de survie par Camille Sainson
78 Ces lieux qui nous habitent par Emmy Lapointe
82 Pour en finir avec l’opacité : ce qui se cache dans et derrière vos livres par Frédérik Dompierre-Beaulieu
92 Quand nature et écologie s’invitent sur les tablettes de nos libraires par Florence Bordeleau
94 Cloud Atlas – pour une cartographie des nuages par Camille Sainson
96 Une journée dans l’esprit d’un étudiant
Ou le « moi » dans toute sa beauté par Émilien Côté
ÉDITORIAL
Que faire ?
La question est légitime : qu’est-ce qu’un contre-pouvoir efficace pour la communauté étudiante ?
Manifestement, le secteur des médias est en crise.
Les défis sont multiples et nous contraignent à parer au plus pressant.
Malgré les tentatives timorées des gouvernements pour encadrer cette industrie, force est d’admettre que les géants que sont les GAFAM monopolisent beaucoup de pouvoirs entre leurs pattes.
Pour eux, ça représente un pactole de milliers de milliards de dollars…
Conséquemment, la disponibilité d’une information pertinente, indépendante et de qualité est limitée. Les lois du marché devraient-elles dicter les règles d’une réelle liberté d’expression ?
Le néolibéralisme et ses effets délétères sur la société (et la planète !) doivent être remis en question afin d’offrir une tribune aux personnes évoluant au sein de nos diverses communautés. Or, dans ce contexte, le contre-pouvoir que constituent les médias au sens large est, pour le moins, sous influence.
Nous pouvons, toustes ensemble, incarner un rempart face aux assauts répétés du capital; la résignation n’est pas une option.
En passant, je suis le p’tit nouveau à la barre de la CoMÉUL; salut !
Sincèrement, disais-je, je crois qu’un service d’information intègre est vital pour la collectivité universitaire et son progrès. La tentation de devenir une machine à clics, dépendante de revenus publicitaires ou lançant des « nouvelles » selon l’humeur du moment, non validées professionnellement, n’est pas une solution viable… ni souhaitable.
« I’ll tell you what real freedom is to me; no fear ! »Nina Simone
Nous faisons toustes partie de la Cité-Universitaire, une ville en soi. Est-ce que des débats, un libre échange d’idées et la diffusion d’une culture émergente ne sont pas autant d’arguments en faveur de médias étudiants dignes de ce nom ?
L’équipe de CHYZ 94,3 & d’Impact Campus et ses bénévoles s’acharnent à vous présenter une actualité stimulante ainsi qu’une vitrine culturelle locale.
Cette culture, cette couleur… parfois négligée, mais toujours digne et vibrante. Elle clame ouvertement qu’un autre monde est possible.
Nous cheminerons donc avec vous pour soulever, observer, scruter et bousculer (s’il le faut) les enjeux qui vous concernent. Des embûches se dresseront peut-être, mais avec votre appui, nous accomplirons cette tâche, qui est, somme toute, cruciale.
Résistons.
Stéphane Paradis, directeur général



5 pièces à venir hiver/printemps
Tarif 30 ans et moins
L’abonnement le plus souple en ville!
INFOS ET BILLETS premieracte.ca

Sodexo, cible de la grogne des étudiant.es : enquête sur les cafétérias de l’Université
Laval
Qui suit la page Facebook de Spotted : Université Laval sait que les cafétérias ne font pas l’unanimité sur le campus : le prix des plats, leur qualité et leur fournisseur sont tour à tour pointés du doigt par la communauté étudiante. Bien que les muffins du Vachon ne répondent pas toujours aux attentes des plus fins palais, dans la dernière année, ce sont surtout les cafétérias gérées par la multinationale française Sodexo qui ont été vivement critiquées. Sodexo sème la controverse à cause de sa ligne entrepreneuriale générale et de ses différents investissements à l’étranger. Plusieurs se questionnent sur sa place au sein d’une institution universitaire. Impact Campus s’est saisi de l’affaire pour clarifier le fonctionnement de nos cafétérias, les comparer entre elles et avec celles d’autres universités à travers le monde, puis faire le point sur l’opinion générale de la communauté universitaire sur le sujet.
Par Camille Sainson et Florence Bordeleau, journalistes multiplateformes






Sodexo sème la controverse à cause de sa ligne entrepreneuriale générale et de ses différents investissements à l’étranger.
Enquête sur les cafétérias de l’Université Laval : une démarche de longue haleine
Note : nous avons pu parler directement à toustes les responsables des cafétérias, sauf avec Sodexo : pour obtenir une entrevue avec sa directrice, nous avons dû passer par les relations de presse de l’Université Laval.
Quelques rapides recherches dans les archives de l’UL et de la BAnQ nous ont fait réaliser que le partenariat avec des groupes privés étrangers ne date pas d’hier à l’Université Laval. Dès 1990, Marriott, un groupe américain, s’est installé à l’UL non sans soulever quelques inquiétudes. Quelques années plus tard, Sodexho (ancienne graphie de Sodexo) fusionne avec Marriott, et la grogne des étudiant.es ne fait qu’augmenter. En 2005, de véritables manifestations étudiantes ont eu lieu sur le campus, menant à l’arrestation de plusieurs personnes par la police.
Qu’en est-il aujourd’hui ? Des plaintes circulent sur Spotted — page Facebook dédiée à l’expression anonyme des étudiant.es, allant des courriers du cœur aux demandes d’informations, en passant par les insatisfactions alimentaires —, et des affiches portant le message « Acheter au Sodexo, c’est financer ses prisons d’Europe. Sodexo, pas qu’une cafétéria… » sont parfois visibles au De Koninck. Cette frustration, est-elle partagée ? Est-ce seulement une question de valeurs, ou d’un rapport décevant entre la qualité et le prix ? En d’autres mots : y a-t-il beaucoup d’étudiant.es qui n’aiment pas Sodexo ? Les autres cafétérias du campus sont-elles plus appréciées ?
Acheter au Sodexo, c’est financer ses prisons d’Europe. Sodexo, pas qu’une cafétéria…
En entrevue, la responsable de Services campus, Annie Turner, nous parle d’un sondage mené récemment auprès de la communauté étudiante au sujet de ses habitudes alimentaires et de son appréciation générale des services offerts à l’Université. À la suite de l’entrevue, nous avons demandé à Mme Turner de nous faire parvenir les résultats détaillés dudit sondage, mais ces derniers ayant été fournis tardivement, Impact a fait circuler son propre questionnaire via la page Spotted . Lancé le 21 décembre 2023, 185 personnes y ont répondu. Les statistiques exposées dans cette enquête en sont issues. En comparant nos résultats à ceux de Services campus, nous constatons que leurs quelque 2 000 répondant.es témoignent de manière générale des mêmes opinions.

Y a-t-il beaucoup d’étudiant.es qui n’aiment pas Sodexo ?
Les autres cafétérias du campus sont-elles plus appréciées ?
L’Université Laval est en déficit budgétaire quant à ses cafétérias. Solution ? L’appel à une compagnie privée, étrangère de surcroît : « La société de gestion de services alimentaires Sogsabec est établie au Québec depuis 1975. [...] Elle est reliée au géant américain Marriott par des ententes de services techniques. »
1990
1995 - 1998
Novembre 1995, ouverture de la Halte-Bouffe (groupe Laliberté) au pavillon Desjardins. Ouverture de la cafétéria du Vachon par une branche de l’ADVE. 1995 ou 1998, selon les sources, Sodexho fait l’acquisition de Marriott, et donc de Sogsabec. À partir de là, c’est le nom de Sodexho qui est affiché à l’Université. Selon Simon-Pierre Beaudet, ancien étudiant de l’UL et essayiste, c’est en 1995 que l’Université Laval octroie à Sodexho le contrat d’exclusivité de gestion des cafétérias.
Le Collectif de Minuit distribue gratuitement des plats végétaliens au pavillon De Koninck (DKN). Cette initiative a un double objectif : contester la présence de Sodexho sur le campus et obtenir de la visibilité pour les étudiant.es. Invoquant des normes de salubrité, l’Université Laval rejette fermement la présence du collectif. Les étudiant.es continuent malgré tout à servir leurs plats une fois par semaine.
2003
Février 2005
Des affrontements ont lieu au DKN à la suite de la distribution d’un tract anonyme qui incitait les étudiant.es à s’en prendre aux installations et à la nourriture servie par Sodexho. « Selon le porte-parole de l’UL, l’attroupement de plusieurs étudiants a incité le service de sécurité à faire appel aux policiers. Les étudiants ont encerclé un agent de sécurité. Il aurait été frappé, selon la version policière.» François Fecteau affirme que cet encerclement a eu lieu après que deux agents s’en soient pris à un étudiant. Cinq étudiants ont été arrêtés, écopant d'une contravention de 200 $ pour désordre.
Comment ça marche, les cafétérias à l’UL ?
Tous les pavillons de l’Université Laval sont dotés d’au moins un café étudiant. Ces petits racoins sympas sont rarement l’objet de critiques : les prix sont souvent plus qu’abordables et le service agréable. Pensons à La Dissidence ou Chez Pol (De Koninck), au Café Labyrinthe (Casault), au P’tit CAAF (Abitibi-Price), etc. Ces cafés servent des boissons, des sandwichs et des viennoiseries, mais aucun repas chaud : seules les cafétérias ont le droit d’en vendre. Ainsi, si nous voulons avoir un repas complet et différent de jour en jour, nous devons nous tourner vers les offres de trois organismes implantés un peu partout sur le campus : Sodexo, la CADEUL, et l’ADVE. Ils sont surveillés de près par Services campus. Les contrats d’exploitation sont obtenus par appels d’offres — ou pas. Sodexo renouvelle sans peine son contrat depuis plus d’une vingtaine d’années. Il est prolongé à chaque cinq
ans, en suivant toujours les nouvelles exigences de l’Université en matière de qualité, de prix et de durabilité. Il en est de même pour la CADEUL depuis 2014.
Sodexo, à éviter ?
Nous ne pouvons pas le nier, Sodexo est vraiment le point de mire de plusieurs étudiant.es qui contestent vivement encore aujourd’hui la place de cette multinationale à l’UL. La grande majorité du temps, ses succursales sont en des lieux où la clientèle est « captive » (universités, hôpitaux, prisons), c’est-à-dire qu’elle n’a pas accès à autre chose, et qu’il n’y a donc pas de compétition. Faisons fi, le temps de cet article, de ce modèle d’affaires qui, pour certain.es, peut soulever des enjeux éthiques. Comment est le travail de Sodexo sur notre campus ? Outre les enjeux idéologiques, la qualité du service est-elle au rendez-vous?
Un appel d’offres est en cours. La CADEUL fait partie des soumissionnaires. Son offre est rejetée, au profit de Sodexho. Antoine Houde, alors président de la CADEUL, affirme en entrevue que « c’est un geste inconscient de redonner le contrat à une firme qui fait déjà l’objet d’un boycott [sic], alors que notre proposition était un exemple parfait d’initiative étudiante. Ça faisait deux ans qu’on travaillait là-dessus. » Sodhexo a obtenu 87,3 % lors de l’évaluation de l’Université Laval, contre 78,4 % pour la CADEUL.
Les mois suivants, les manifestations se poursuivent. Le boycottage est « musclé ». D’autres amendes seront distribuées, la plus sévère s’élève à 1177 $, soit « le coût de la nourriture gaspillée après que l’étudiant eut lancé des confettis devant un ventilateur qui faisait vents sur les mets préparés par Sodexho. »
Avril 2005
2007
Le Collectif de Minuit poursuit ses luttes, en invoquant le droit à l’alimentation : « Ces luttes s’inscrivent dans un contexte où l’entreprise privée acquiert de plus en plus de pouvoir à l’intérieur des établissements d’enseignement. Il y a un enjeu clair concernant l’autonomie des universités et des étudiant.es face à ces entreprises [...]. »
2008
Sodexho devient Sodexo, afin de faciliter la prononciation du nom à travers le monde.
La directrice générale, Mme Lafrenière, indique en entrevue avoir le développement durable comme valeur fondamentale. Non seulement elle affirme être « zéro déchet » (bien que subsiste l’option d’acheter des contenants jetables et d’acheter des boissons embouteillées dans leurs cafétérias), mais elle mentionne aussi participer à l’initiative « Frigo partage ». Tous les vendredis, leurs invendus de la semaine se retrouvent dans ces quelques frigos destinés aux étudiant.es en situation de précarité financière.
Du côté de la qualité, tout est standardisé avec le chef régional de l’entreprise. Ce standard rejoint les normes de l’Université Laval. Mme Lafrenière affirme que tout est fait sur place, sauf les galettes du casse-croûte et les viennoiseries, qui proviennent de la maison-mère québécoise. Selon la directrice générale, le chef cuisinier
2014
La CADEUL se voit attribuer la cafétéria du Desjardins de gré à gré (donc sans appel d’offres).
Le perdant ? Le groupe Laliberté, entreprise québécoise de services alimentaires qui œuvrait jusque-là dans ce pavillon. Le groupe se dit très étonné d’être ainsi mis au rencart, plutôt que Sodexo.
Tous les vendredis, leurs invendus de la semaine se retrouvent dans ces quelques frigos destinés aux étudiant.es en situation de précaritéfinancière.
est excellent, il connaît bien ses prix et sait innover dans ses recettes. Après, on aime ou on n’aime pas, à nous de juger.
Et le prix élevé ? Cette qualité, tant vantée par ses responsables, le justifie-t-elle vraiment? Mme Lafrenière affirme être environ 1 $ sous le prix maximal imposé par Services campus. Elle se dit par ailleurs très à l’écoute des étudiant.es et suit le groupe Spotted : Université Laval de près. Ça a toutefois pris un an pour que le prix de la poutine
du DKN, qui avait anormalement grimpé, redescende. Le prix de la petite poutine est ainsi récemment passé de 11,50 $ à 8,99 $. La directrice de Sodexo indique que le prix de 11,50 $ était dû à une erreur de comptabilité de la part du chef cuisinier, car en règle générale leur objectif à l’Université n’est pas de faire du profit sur le dos des étudiant.es, mais de s’offrir une « vitrine » de qualité dans cette institution académique. Malgré tout, la compagnie a un vaste projet collaboratif avec l’Université Laval pour améliorer la cafétéria du DKN dont le budget est estimé à 600 000 $. Cet investissement d’une entreprise privée dans le milieu universitaire est un peu étonnant, considérant la supposée indépendance financière de ce dernier. Nos recherches dans les archives nous ont appris que dès son implantation à l’UL, Sodexo faisait déjà de tels investissements : pas moins de 800 000 $ ont été injectés aux installations alimentaires du campus lors de la signature du premier contrat.
Notons que Sodexo offre un salaire compétitif à ses employé.es sur le campus : leur taux horaire oscille entre 18,70 $/h et 27,92 $/h.
Alternatives étudiantes : vraiment meilleures ? Alors que Sodexo représente 80 % de l’offre alimentaire sur le campus, quelles sont les alternatives ? Si nous nous fions à notre sondage, les étudiant.es sont exaspéré.es par l’augmentation des prix et affirment être prêt.es à changer de pavillon pour obtenir une meilleure offre alimentaire. Mais alors, où la population étudiante pourraitelle trouver son bonheur ?
Face au géant Sodexo, nous l’avons vu, il y a deux options : les cafétérias de Saveurs Campus et celle de l’ADVE. Présentes aux pavillons Desjardins, Vandry et Vachon, elles proposent des tarifs légèrement en dessous de ceux de la multinationale.
La CADEUL que l’ADVE font face aux mêmes défis, soit

Le prix de la petite poutine est ainsi récemment passé de 11,50 $ à 8,99 $

maintenir des prix attractifs malgré l’inflation, éviter de vendre à perte sans pour autant faire du profit sur le dos des étudiant.es, proposer des alternatives végétariennes et des plats du jour « santé ». En bref, ces trois cafétérias doivent composer avec un budget serré tout en restant attractives.
Commençons avec Saveur Campus. Nous rencontrons Aurélien Gauthier, (chef cuisinier jusqu'en décembre 2023), au milieu du réfectoire du pavillon Desjardins. Il nous explique que tous les plats sont cuisinés sur place et que les ingrédients sont choisis avec soin (même s’il reconnaît la difficulté — voire l’impossibilité — de se fournir au niveau local). Une pâtissière travaille à temps plein pour offrir des desserts faits maison, préparés avec du beurre et non de l’huile ou de la margarine. Le menu est pensé pour offrir des alternatives végétariennes, végétaliennes ou encore sans gluten. Au niveau des prix, Saveur Campus a dû augmenter les tarifs des pokés et sautés qui, jusque-là, étaient vendus à perte. Le menu du jour n’a, quant à lui, connu que 40 cents d’augmentation en trois ans. Vous pouvez donc trouver un combo « entrée, plat, dessert ET boisson » pour 12,90 $, soit 2 $ de moins que chez Sodexo. Les prix sont identiques au Vandry, mais le menu diffère puisque chaque chef est libre de diriger sa cuisine comme il l’entend. Nous interrogeons Aurélien Gauthier sur la possibilité de proposer des menus un peu moins chers,

mais il nous explique à regret : « je ne peux pas faire moins bien, pour moins cher : j’ai un standard à tenir, je fais au mieux avec les ressources que j’ai ». L’entreprise est déjà dans une dynamique « pas de gain, pas de perte » et, si l’Université Laval ne lui a pas facturé de loyer pendant la pandémie, elle n’a toutefois droit à aucune subvention ou aide supplémentaire de sa part. La CADEUL donne un coup de main à Saveurs Campus grâce aux cotisations étudiantes, mais ce n’est pas suffisant pour parvenir à proposer des offres vraiment moins chères.

Saveurs Campus offre un menu du jour entrée-plat-dessert-boisson pour 12,90$, l’ADVE pour 14,22$, et Sodexo pour 14,92$.
Et qu’en est-il du côté de l’ADVE ?
Implantée au cœur du Vachon, la cafétéria est plus modeste que ses concurrentes en termes de taille et d’offre. Le plat du jour, accompagné seulement d’un dessert (formule duo), est à 12,44 $ — le prix est donc plus élevé qu’à Saveurs Campus. Toutefois, il faut souligner qu’elle est, elle aussi, gérée par une association étudiante et qu’elle doit faire face à l’inflation. Si un prix plafond à ne pas dépasser est imposé par Services campus, l’ADVE a fait le choix de ne pas augmenter ses tarifs pour encourager les étudiant.es à prendre le menu du jour, menu dit « santé » par rapport au casse-croûte. L’association prend garde à ne pas être déficitaire, sans pour autant chercher à réaliser un profit sur ses ventes.
Malheureusement, le jour où nous sommes allées tester leur offre alimentaire, le plat du jour se composait de semoule (couscous), saupoudrée de quelques légumes en canne et accompagnée de saucisses. Pour les végétarien. nes, il ne fallait pas avoir faim : il s’agissait du même plat,

mais sans saucisses. Les 12,44 $ pour une assiette de semoule et un carré aux dattes sont difficilement justifiables…
Lors de notre rencontre avec Louis Bélanger Sansoucy, directeur de la cafétéria l’Intégrale, il explique que l’Université leur impose d’être ouverts durant l’été. Or, il s’agit d’une période creuse en termes de fréquentation estudiantine, ce qui nuit à leur bilan final. Difficile donc de parvenir à maintenir la tête hors de l’eau face à tous ces impératifs; c’est peut-être ce qui justifie leur léger retard quant au développement durable (tous les repas du cassecroûte sont servis dans des plats jetables).
En avril 2023 le comptoir alimentaire Le Toast Café, tenu par l’association en génie alimentaire AGÉTAAC, a fait faillite. Si Sodexo s’est empressé de le reprendre, cette situation souligne la difficulté pour les associations, qui sont des structures beaucoup plus fragiles, de réagir face aux difficultés économiques, surtout dans cette période post-pandémie.


Gérée de manière directe par un conseil d’administration étudiant, la cafétéria de l’ADVE est au service de sa communauté et doit surmonter de nombreux défis pour continuer à exister.
Saveurs Campus et l’ADVE sont deux entités proches de la communauté étudiante qui offrent des alternatives à Sodexo. Nous ne pouvons donc que souligner leurs efforts pour servir des plats « sains » dans un contexte économique défavorable, avec leur seul et unique objectif : servir la communauté étudiante, intérêts pécuniaires exclus.
Et ailleurs dans le monde ?
En France, les restaurants universitaires sont gérés par le CROUS (Centre régional des œuvres universitaires et scolaires), un établissement public sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur. Grâce aux subventions de l’État, les restaurants sont capables de proposer des repas à 3,30 € (l’équivalent de 4,82 $). Si ces efforts ne permettent pas d’enrayer la précarité financière des étudiant.es, ils leur permettent toutefois de manger correctement à moindres frais, et ce, à tous les jours de la semaine.
À défaut d’obtenir un soutien financier du Québec ou du Canada, les cafétérias gérées par des associations étudiantes pourraient être épaulées par les universités.
En France, les restaurants universitaires sont gérés par le CROUS.
parle de « concurrence » entre ces trois entités, puisqu’elles ne jouent absolument pas dans la même cour.
Grâce aux subventions de l’État,
les
restaurants
sont
capables de proposer des repas à 3,30 €
Qu’il s’agisse d’un local mis gratuitement à leur disposition ou d’une aide financière, l’UL pourrait ainsi leur permettre de baisser leurs tarifs, ce qui augmenterait, de facto, leur attractivité auprès de la communauté.
À l’Université de Lausanne (UNIL), ce sont aussi des entrepreneurs privés qui gèrent l’offre alimentaire, allant du kebabier à la compagnie de traiteur SV Restaurant, filiale de la compagnie hôtelière suisse SV Group. Bien que les prix de la cafétéria du pavillon Géopolis de l’UNIL ne soient que légèrement inférieurs à ceux des cafétérias de l’Université Laval (le repas le moins cher, en formule combo, est à 7,30 francs suisses taxes incluses — 11,39 $), la qualité est franchement supérieure, et les plats sont plus variés. Nous n’avons pas pu déterminer à quel point l’UNIL agit financièrement avec SV pour offrir ce bon rapport qualité prix. L’accès aux procès-verbaux de la Commission de l’alimentation de l’UNIL (équivalent, semble-t-il, de Services campus) ne laisse pas entendre de financement gouvernemental — plutôt, un prix plafond très contrôlé et des normes de qualité extrêmement élevées.
Tu es ce que tu manges : mais as-tu vraiment le choix sur le campus ?
Quand prendre une décision revient à choisir le moins pire…
Sodexo et Saveurs Campus affirment servir en moyenne entre 100 et 150 repas du jour aux pavillons De Koninck et Desjardins, et ce, chaque jour. L’ADVE n’est pas loin derrière avec ses 70 à 85 repas. Nous observons donc une certaine homogénéité dans la répartition des client.es entre les différentes cafétérias. Malheureusement, celle du Desjardins, faite par et pour les étudiant.es, et qui est la moins chère du campus, sert majoritairement des employé.es travaillant dans ce même bâtiment (seulement 8,6 % des étudiant.es de notre sondage affirment y manger). Rappelons également que Sodexo ne compte pas moins de quatre cafétérias à son actif; l’ADVE et Saveurs Campus n’en gèrent que trois. Leur présence est certes plus réduite, mais nécessaire pour éviter le monopole. Il est d’ailleurs bien normal que personne ne
Selon notre sondage, plus de 58 % des étudiant.es pensent qu’un repas ne devrait pas coûter plus de 10 $ (avant taxes) et, lorsque nous leur donnons la parole, ils et elles nous font bien comprendre leur opinion : « Tout est tellement cher ! Je sais qu’il y a une inflation jusqu’à la récession, mais nous sommes des étudiants et un café et muffin pour 10 $ est insensé », « il faudrait soit baisser les prix soit augmenter la qualité, car nous avons seulement accès à des produits de mauvaise qualité et hors de prix », « les prix sont ridiculement hauts, et la qualité n’est pas au rendez-vous pour le prix payé. Je préfère souvent sauter mon repas et avoir faim dans un cours plutôt que de dépenser 15 $ pour un sandwich et quelques frites », « trop cher pour si peu, TROP CHER POUR SI PEU », « baissez les prix !! », etc.
Il faudrait soit baisser les prix soit augmenter la qualité, car nous avons seulement accès à des produits de mauvaise qualité et hors de prix .
Si Saveurs Campus et l’ADVE ne peuvent, dans les circonstances actuelles, baisser leurs tarifs, nous savons que Sodexo peut se permettre d’investir 600 000 $ pour rénover la cafétéria du De Koninck et la rendre plus alléchante pour sa clientèle. Rappelons que, dès son installation, cette compagnie a investi un montant significatif (800 000 $) pour ses aires de travail.
À vous de juger donc, parce qu’après tout, vous pouvez manger (à peu près) où vous voulez…!
Références
Beaudet, S.-P. (2016). Fuck le monde, Moult Éditions. Archives d’Impact Campus à la Bibliothèque de l’UL : 27 février 1990, 20 mars 1990, 5 septembre 1990, 12 février 1991, 19 février 1991, 19 mars 1991, 21 novembre 1995. Archives du quotidien Le Soleil conservées à la BAnQ : 22 février 1990, 3 décembre 2003, 25 février 2005, 8 septembre 2005, 16 septembre 2005, 4 novembre 2005, 20 mars 2014.
Revue Possibles, hiver-printemps 2007.



valorisons l’implication des femmes et de la diversité sur le campus





Les traversées
Par Emmy Lapointe, rédactrice en chef
J’apprends très jeune que le varech ne sent jamais la même chose selon l’endroit où on se trouve. Ça dépend des sédiments des différents milieux. Comme le reste, le premier varech que l’on sent servira de point de comparaison pour tous ceux à venir. Mon varech-compas, c’est celui de Pointe-au-Père, l’un des districts les plus à l’est de Rimouski. J’ai du mal à décrire son odeur et j’ai peur qu’en utilisant les qualificatifs qui me viennent en tête, ça vous dégoûte. Ditesvous seulement que l’odeur du varech de Pointe-au-Père a la même odeur que votre première visite à la mer.

L’Empress of Ireland, un paquebot transatlantique de la Canadian Pacific Steamship Company, est mis en service en juin 1906. Il est construit par la Fairfield Shipbuilding and Engineering Company, une compagnie navale du Royaume-Uni basée à Glasgow, également chargée de construire l’Empress of Britain, le bateau jumeau de l’Empress of Ireland. Dès leurs premiers voyages transatlantiques, les deux navires battent des records de vitesse. Ils sont les plus majestueux, les plus performants de la flotte canadienne.
Mes vacances d’été, quand j’étais jeune, ressemblaient à beaucoup d’autres. Quelques semaines au camp de jour, deux semaines avec mon père, deux semaines avec ma mère et souvent une semaine avec mes grands-parents. Avec ma mère, on faisait beaucoup d’activités à Québec ces semaines-là. Avec mon père, c’était la Gaspésie, le Bas-dufleuve, le Maine, Boston une fois ou deux, mais toujours en camping. Pour celleux qui connaissent un peu le coin du Bas-Saint-Laurent, de la Vallée de la Matapédia, de la Gaspésie, vous savez que Rimouski, c’est comme une capitale, un point de repère. On dit : « c’est à une heure de Rimouski, mais plus vers les terres. », « c’est deux heures passé Rimouski, genre après Matane. »
L’Empress of Ireland fait régulièrement le trajet entre Québec et Liverpool. De 1906 à 1914, il fait 191 traversées de l’Atlantique. Le 28 mai 1914, il quitte le port de Québec vers 16h30. Il y a 1477 passager.ères et membres de l’équipage. À la barre du navire, Henry George Kendall, capitaine récemment nommé.
Je passe par Rimouski plusieurs fois par année et au moins une fois par été. Presque chaque fois, on s’arrête au Musée de la mer de Pointe-au-Père. Aujourd’hui, l’endroit porte plutôt le nom de Site historique maritime de la Pointe-au-Père. Je comprends, c’est sans doute plus juste de l’appeler comme ça, mais je ne sais pas, je trouve que ça sonne très gouvernemental. À l’époque où je le visite annuellement, le sous-marin n’est pas encore là, il n’arrive qu’autour de 2010, avant ça, il n’y a que le phare et le Musée de l’Empress of Ireland.
Après un court arrêt dans les premières heures du 29 mai à Pointe-au-Père, le navire reprend la direction de Liverpool. Au même moment, le Storstad, un charbonnier norvégien, avance vers Montréal en suivant le fleuve. Les deux bateaux sont près de la rive droite. Peu avant 2h du matin, le capitaine aperçoit le charbonnier à une distance qu’il estime de 8 milles, puis le perd de vue. Les deux navires sont absorbés par la brume.
La première fois que je vois l’exposition sur l’Empress of Ireland, j’ai sept ans. Je sors de ma première année, je sais lire, je lis beaucoup, tout ce que je vois tout le temps, ça doit être insupportable pour mes parents. En entrant dans le musée, je ne sais pas vraiment ce qu’est l’Empress of Ireland. Il y a une dizaine de vitrines avec des objets très vieux, des téléphones à un seul sens, desquels on ne peut qu’écouter. Il y a aussi, sur les murs à plusieurs endroits, les dessins d’un petit chat roux et à côté de chacun d’entre eux, un petit haut-parleur qu’on peut activer avec un bouton.
Peu de temps après, le capitaine aperçoit les feux du Storstad qui s’extirpe du noir sur tribord. Il est déjà trop tard, mais l’Empress of Ireland tente tout même d’atténuer les dommages en manœuvrant à tribord. Le Storstad percute le côté droit de l’Empress entre ses deux cheminées.
J’appuie sur le premier bouton, et on se met à me parler. C’est le chat qui me parle. Il se présente à moi, il dit qu’il est le chat du navire, qu’il s’appelle Emmy. Je ne comprends pas trop sur le moment, le fait d’entendre mon nom me distrait et je dois réécouter son message. Il me répète qu’il s’appelle Emmy, qu’il est le chat du navire, qu’à bord, il chasse les souris et se prélasse sur les ponts. À 7 ans, on ne comprend pas vraiment le hasard, les coïncidences, les choses semblent exister pour une raison et s’expliquer. Je m’éloigne du premier chat, mais je ne vais pas tout de suite au second, je lis et j’écoute la partie des grands. À ce moment-là, je ne comprends pas qu’il s’agit de deux parcours, pour moi, le musée est un chemin et on doit s’arrêter à chaque point. À la deuxième ou troisième station féline, Emmy me dit que le 28 mai 1914, il n’a pas voulu embarquer sur le bateau au port de Québec, qu’il est resté sur le quai. L’équipage a tenté de le convaincre, mais il n’a pas voulu. Il me dit qu’il pensait qu’en restant sur le quai, tout le monde descendrait du bateau, parce que lui le sentait qu’il allait se passer quelque chose.

Le Storstad ayant commencé une manœuvre arrière avant même de s’enfoncer dans la coquille de l’Empress, il n’arrive pas à rester en place et à colmater la brèche une fois la collision advenue. L’eau pénètre dans le bateau rapidement et on ne parvient pas à fermer ses portes étanches.
Chaque téléphone du parcours adulte raconte une histoire narrée par un.e passager.ère du bateau. Au début, je les entends me parler de l’élégance du navire, des repas, des différentes classes. Puis, à mesure que j’avance dans le parcours, les choses s’assombrissent. On me parle de la nuit noire, de la brume, puis de la collision qu’iels sentent partout. Le téléphone qui me marque le plus est dans les derniers, juste après qu’on ait tourné à gauche. C’est un homme qui dit que très vite, la seule façon de s’éclairer, c’était de craquer des allumettes. Il craque la dernière près du grand escalier et on perd sa trace.
Le bateau coule en 14 minutes. Plus tard, on comparera la durée à celle d’une récréation. Seulement cinq ou six bateaux sont en mesure d’être utilisés. Le fleuve Saint-Laurent avoisine les 0 à 4 degrés Celsius. Sur 1 477 personnes à bord, seulement 465 s’en sortent. Plus de la moitié d’entre elles sont des membres de l’équipage. Dans les jours après le naufrage, on ramène à terre les corps des naufragé.es. La Canadian Pacific envisage de renflouer le bateau, mais la tâche semble impossible. On parle du naufrage et de l’enquête quelque temps dans les journaux, mais la nouvelle est rapidement éclipsée par la Première Guerre mondiale qui éclate le même été.
Avant de sortir du musée, je vais à la boutique souvenir avec mon père. Il m’achète Emmy en peluche. Il y a quelque chose d’étrange, on dirait qu’il est moi, que ça dépasse le fait qu’on a le même nom. J’ai l’impression qu’il se met à ma place ou que je me mets à la sienne et que je trace, qu’il trace, qu’on retrace une histoire qui a déjà eu lieu et qui est advenue une fois de plus cet après-midi-là de juillet 2004. Je connais les traits du bateau dans le musée, comme j’imagine et connais les lignes qu’il a tracées 191 fois entre Québec et Liverpool, et chaque fois que je traverse le fleuve que ce soit entre Lévis et Québec, Trois-Pistoles et Les Escoumins, Matane et Baie-Comeau, je sais qu’il y a quelque chose comme un point au-dessus de l’eau qui marque ces chemins-là.


SOCIÉTÉ ET SCIENCES

De l’Imago Mundi à Google Earth : un voyage à travers l’histoire de la cartographie
« Voyager, c’est découvrir que tout le monde se trompe sur les autres pays. » C’est en ces termes que l’écrivain Aldous Huxley présente les voyages. C’est grâce à eux que les Européen. nes ont appris à dessiner les contours du monde. En effet, si le domaine géographique a des répercussions politiques, sociales ou encore économiques, il est, à la base, nourri par l’étude de la cartographie. Impact Campus vous propose de revenir ainsi à ces concepts plus littéraux et à son histoire pour ouvrir ce numéro.
Par Lucie Bricka, journaliste collaboratrice
Les premières cartes de l’Histoire : des traces babyloniennes à l’émergence du monde sphérique Il faut attendre le VIIIe siècle pour voir émerger les premières cartes. En effet, la toute première carte de l’Histoire qui nous est parvenue daterait de 500 à 700 ans avant notre ère. Gravée sur une tablette d’argile, cette carte babylonienne, retrouvée en Mésopotamie, a été nommée Imago Mundi. Avec un nord orienté vers le haut, la carte est centrée sur l’Euphrate qui s’écoule du nord vers le sud. Au centre du fleuve se trouve la ville de Babylone. D’autres villes de Mésopotamie sont également représentées. Un cercle entoure la carte et symbolise l’océan. Au-delà de l’étendue d’eau, huit régions sont représentées par des triangles. Un texte incomplet (en langue akkadienne) qui raconte la création du monde par le dieu babylonien Marduk accompagne cette carte. Elle traduit donc une vision du monde centrée sur la Mésopotamie. Elle montre également que les Babylonien·nes considéraient la Terre comme plate.

L’idée d’une Terre ronde émerge bien plus rapidement que ce l’on pourrait penser, à partir du VIIe siècle avant notre ère, avec Thalès de Milet, en Grèce Antique. Cette théorie perdure durant les siècles suivants, notamment avec Aristote. C’est au IIIe siècle avant notre ère seulement que l’on parvient enfin à démontrer la sphéricité de notre planète. C’est le Grec Ératosthène qui prouve que la Terre est ronde en comparant les ombres d’objets à différents endroits, estimant sa circonférence à 39 000 km, proche des calculs modernes de 40 000 km.
Cette démonstration joue un rôle majeur dans la représentation des cartes. En effet, au IIe siècle avant notre ère, à Alexandrie, Ptolémée met en place un système qui permet de projeter une sphère sur une surface plane.
Sa carte montre que le monde hellénique connaissait trois continents, l’Europe, l’Asie et l’Afrique, et très bien la mer Méditerranée. Si les deux derniers restent approximatifs,
 Anonyme (700-500 a.n.e.). Imago Mundi [Carte en argile]
Hugues Commineau de Mézières et Pietro del Massaio (vers 1475-1480). Copie de la carte mondiale de Ptolémée [Carte]
Anonyme (700-500 a.n.e.). Imago Mundi [Carte en argile]
Hugues Commineau de Mézières et Pietro del Massaio (vers 1475-1480). Copie de la carte mondiale de Ptolémée [Carte]

on remarque que les contours de l’Europe et du MoyenOrient sont proches des contours actuels. Cela montre que les Européen·nes avaient déjà une connaissance précise de leur propre monde, mais une méconnaissance des autres continents. Cette tendance se poursuit jusqu’au début du Moyen Âge.
Les cartes au Moyen Âge, reflet d’une connaissance géographique qui stagne La fin de l’Antiquité et le début du Moyen Âge ont été marqués par des changements sociétaux importants, dont l’expansion du christianisme. De plus, les fœdis, des traités passés entre l’Empire romain et un groupe étranger qualifié de « barbares » ont permis de gérer et de défendre des territoires romains. Au début du Moyen Âge, ces territoires s’autonomisent pour former des royaumes, tandis que les arabo-musulmans s’installent en Al-Andalus, actuels Espagne et Portugal. Ces bouleversements majeurs se sont répercutés sur les représentations cartographiques.
Le premier gros changement réside dans l’invention des cartes dites « en TO ». Il s’agit d’une simplification de la réalité connue par les contemporain·nes. On peut voir que leurs connaissances du monde restent restreintes à l’Europe, à l’Afrique et à l’Asie. Ces trois continents sont entourés par un O, symbolisant l’océan clôturant le monde, et séparés par un T, d’où le nom de ce type de carte. La barre verticale représente la mer Méditerranée, tandis que la barre horizontale, le fleuve russe Don. Avec l’orientation du nord, on peut déceler l’influence du christianisme dans cette représentation. En effet, il est placé à gauche, symbole du mal et du chaos. Cette association s’explique par le fait que le nord était considéré comme la région d’où provenait le danger. Les cartes TO se diffusent en grand nombre durant tout le Moyen Âge, et deviennent l’un des types de cartes les plus répandus en Europe.

D’autres cartes cohabitent avec les cartes TO. En effet, la cartographie de cette époque cherche à montrer les différents climats présents sur Terre. Et les cartographes visent juste ! Sur ces cartes climatiques, on dénote la présence des cinq zones connues actuellement : la zone tropicale au centre, les deux zones tempérées et les deux zones polaires. D’autres cartes sont si travaillées que l’on peut les considérer comme des œuvres d’art.
À la fin du Moyen Âge, la vision européenne du monde n’a pas beaucoup évolué. On peut le voir en consultant la Mappa Mundi de 1474. Cette carte nous montre que les Européen·nes pensaient que l’Eurasie était un gigantesque continent qui faisait presque le tour de la Terre. Dès lors, à leurs yeux, l’océan Atlantique n’est pas une étendue marine si vaste que cela. Cela explique pourquoi Christophe Colomb a décidé de se rendre en Inde via cet océan.

Un bond en avant avec l’arrivée européenne de l’Amérique et de l’Océanie
Le début de l’époque moderne est marqué par la multiplication des grandes expéditions maritimes, ouvertes par Colomb en 1492, et par la mise au point de l’imprimerie européenne, par Gutenberg. Ces deux facteurs révolutionnent la cartographie. Désormais, les cartes deviennent de plus en plus justes. Dès 1507, l’Afrique est dessinée avec la forme qu’on lui connaît actuellement grâce aux expéditions de Vasco de Gama, et l’Amérique apparaît. C’est ainsi que l’idée de « Nouveau Monde » se diffuse en Europe.
En 1543 est diffusée une nouvelle mappemonde. D’origine vénitienne, elle provient de l’atlas nautique de Battista Agnese. Cette carte est particulièrement intéressante, car elle montre que les connaissances cartographiques sur l’Amérique ont beaucoup progressé en trente ans. En effet,


le tour du monde de Magellan et de Juan Sebastián El Cano, de 1519 à 1522, a montré la présence d’une pointe au sud du continent, et permis aux colons de comprendre que l’océan Pacifique, alors considéré comme une mer, est une immense étendue marine. De plus, les différentes explorations portugaises et espagnoles autour de la région ont permis de préciser les contours de ce continent. On peut donc voir que les limites de l’Amérique du Sud ressemblent dès lors à ce que l’on connaît actuellement. De plus, même si la représentation de l’Amérique du Nord présente encore des erreurs, on note la présence de la Californie. C’est la première fois que cette région apparaît sur une carte européenne. Avec l’apparition des latitudes et des longitudes, on peut voir que les Occidentaux commencent à avoir une vision juste de l’emplacement des continents. L’Eurasie et l’Afrique restent, toutefois, aplaties.
Pendant le règne de Louis XIV, carte et faste se tiennent main dans la main. En 1683, le souverain reçoit un globe terrestre. Cet objet est réalisé par le Vénitien Vincenzo Coronelli à partir d’un certain nombre de cartes hollandaises, des cartes du Français Sanson et des comptes-rendus d’exploration. Très imposant et d’une grande beauté, il pèse deux tonnes et mesure quatre mètres de diamètre. Le luxe ne se voit pas seulement dans les matériaux choisis et dans la façon dont il est surmonté, mais se révèle également à travers les dessins des expéditions commerciales et les personnages qui y sont représentés . En effet, à la place du pôle Sud, on peut voir la présence d’un buste de Louis XIV, entouré d’anges et d’artistes.
Ce globe fait également état des connaissances géographiques de la fin du XVIIe siècle. D’emblée, on note la présence des lignes des tropiques du Cancer, dans


l’hémisphère Nord, et du Capricorne, dans l’hémisphère Sud, ainsi que l’équateur. Globalement, les délimitations des différents continents concordent avec l’emplacement des différentes latitudes. La connaissance de l’Asie a progressé : le continent a des délimitations proches de ce que l’on connaît actuellement. Les Terres australes restent cependant floues pour les cartographes. Grande nouveauté par rapport aux cartes déjà vues : l’Australie est présente sur le globe ! Ses frontières sont même assez ressemblantes à celles réelles.
Des cartes contemporaines cherchant à représenter les phénomènes géologiques L’époque contemporaine voit le domaine de la cartographie se perfectionner. En effet, si la Terre est bien connue, ses phénomènes géologiques ne le sont pas. C’est au cours de cette période (1789-2000) que ces connaissances vont s’affiner au fur et à mesure des avancées technologiques. Une fois de plus, ce sont les voies maritimes qui vont permettre aux cartographes d’affiner les connaissances cartographiques. En effet, dans un souci d’efficacité navale, on se met à étudier les vents et les courants marins dès la fin du XVIIIe siècle, avec les voyages de Lapérouse. Durant le XIXe siècle, l’océanographe George Aimé invente le courantomètre. C’est ainsi qu’en 1902 sort, en Allemagne, une carte des courants marins. La première chose frappante est de constater que presque tous les continents sont dessinés; seul l’Antarctique manque à l’appel. Néanmoins, leurs contours correspondent aux contours actuels. La seconde est le degré de connaissance des


courants et des gyres marins, soit les cellules formées par un courant marin chaud de température relativement constante. Tous sont répertoriés grâce aux travaux de différents océanographes comme Charles Philippe de Kerhallet pour l’océan Pacifique.
À la fin du XIXe siècle, la dorsale médio-atlantique est observée pour la première fois. Il s’agit d’une structure correspondant à des sortes de montagnes sous-marines. Au début du XXe siècle, les scientifiques découvrent les autres dorsales terrestres et se rendent compte de la présence de grandes lignes de fracture perpendiculaires aux dorsales qui les décalent de plusieurs centaines de kilomètres. À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, iels mettent à jour l’existence des fosses océaniques, mais les géologues ne connaissent pas encore le rôle de ces structures.
En cherchant à comprendre le rôle de ces structures, des géologues développent la théorie de la tectonique des plaques à la fin des années 1960 : iels considèrent la Terre comme étant composée de plaques rigides, dont la formation se fait au niveau des dorsales, alors que leur recyclage a lieu au niveau des fosses océaniques. La cartographie a donc permis d’améliorer les connaissances géologiques !
Aujourd’hui : une cartographie numérique à portée de main
La cartographie continue de se perfectionner. De nos jours, grâce au développement des satellites, des GPS et de l’informatique, la cartographie se précise année après année. Des outils numériques comme Google Earth permettent d’avoir toutes les informations géographiques


et géologiques au même endroit. On peut à la fois avoir un aperçu global de la surface de la Terre, mais également des zooms très précis de certaines régions plus spécifiques. On note également le recensement des routes, du volcanisme, des séismes, de la topographie…
Si la géographie de la planète Terre est actuellement bien connue, c’est maintenant apprendre à connaître les autres planètes du système solaire qui intéresse les scientifiques. Depuis 2021, deux nouvelles missions sont prévues afin d’explorer Vénus et Mars respectivement en 2029 et 2026.
Bibliographie :
Renard, M. Lagabrielle, Y. Martin, E. De Rafelis, M. (2018) Éléments de géologie. Dunod.
Robert, C. Bousquet R. (2013) Géosciences - la dynamique du système terre. Belin.
Geistdoerffer, P. (2015) Histoire de l’océanographie - de la surface aux abysses. Nouveau monde éditions.
Sitographie :
Bibliothèque nationale de France. (Date non renseignée). Histoire de la cartographie. BnF - Histoire de la cartographie Bibliothèque nationale de France. (Date non renseignée). Les Globes du Roi-Soleil. http://expositions.bnf.fr/globes/ Tuzo Wilson, J Monger, J.w.h. (2024) Tectonique des plaques. L’encyclopédie canadienne . https://www. thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/tectonique-desplaque

Sur la piste du parc national Assinica : une chasse aux couleurs
administratives
pour les Cri.es d’Oujé-Bougoumou
On connaît bien, à Québec, le parc national de la Jacques-Cartier, administré par la Sépaq. Randonnée, raquette, canot, vélo : nombreuses sont les activités qu’on peut y pratiquer. Le mot d’ordre de conservation pour ce territoire protégé est, pour ses utilisateur.rices, de rester sur les sentiers balisés. Et si le concept de conservation de la nature pouvait prendre un autre visage ? C’est sur cette piste que s’est lancée Gabrielle Côté, membre de la Chaire de leadership en enseignement en foresterie autochtone, en s’intéressant au cas du projet du parc national Assinica. Ce projet est mené par les Cri.es d’Oujé-Bougoumou, communauté située dans le Nord-du-Québec, proche de Chibougamau.


Par Florence Bordeleau, journaliste multiplateforme Avec la collaboration de Gabrielle Côté, finissante à la maîtrise en foresterie









On rouspète souvent contre la centralisation des organes décisionnels au Québec ou au Canada; si certain.es ont pu se plaindre des délais de livraison des passeports en 2021 ou des listes d’attente actuellement impressionnantes pour obtenir des rendez-vous médicaux dans le système public, les Cri.es d’Oujé-Bougoumou offrent un modèle de persévérance patiente impressionnant à ce niveau. Forcé.es de déménager à sept reprises à cause de l’exploitation minière sur leur territoire ancestral (Eeyou Istchee, en cri) et lésé.es — comme toustes les Cri.es d’Eeyou Istchee — par le non-respect de certaines dispositions de la Convention de la Baie-James et du Nord-


Les Cri.es d’Oujé-Bougoumou offrent un modèle de persévérance patiente impressionnant à ce niveau.
du-Québec, ils et elles ont, en 2002, négocié un accord d’importance : la Paix des Braves. Cet accord a permis à la communauté d’Oujé-Bougoumou de mettre en branle un projet de conservation d’une partie de leur territoire ancestral qui vise à l’épargner de l’exploitation forestière ou minière. Les quelque 400 000 km2 de la zone choisie regroupent 300 territoires de trappe, chacun surveillé par un.e maître de trappe désigné.e par la communauté associée.
Accueil Rupert
Halte routière
Chalets Waconichi
Site de camping aménagé
Route principale
Route Assinica
AMW



Bien que l’initiateur du projet, Abel Bosum (alors chef de la communauté d’Oujé-Bougoumou), avait d’abord en tête la création non pas d’un parc national, mais d’un parc cri à proprement parler, c’est plutôt sur la première option que s’est finalement aligné le projet afin de faciliter les démarches, qui s’annonçaient déjà, d’un point de vue législatif, compliquées.
C'est un projet de conservation d’une partie de leur territoire ancestral qui vise à l’épargner de l’exploitation forestière ou minière.
Mais Abel Bosum a bien su négocier : ce parc, qui portera le nom d’Assinica (« là où il y a beaucoup de roches »), devra intégrer la vision qu’ont les Cri.es de l’idée de conservation de la nature. La gestion du parc sera d’ailleurs confiée à la communauté d’Oujé-Bougoumou (elle remplira le rôle que la Sépaq exerce sur les parcs comme celui de

la Jacques-Cartier). L’étudiante Gabrielle Côté est allée sur le terrain pour appuyer les Cris dans la clarification de leur vision de ce que devrait être le futur parc Assinica, et pour faire le point : depuis 2002, le gouvernement du Québec participe-t-il véritablement à instaurer un climat collaboratif de qualité entre ses fonctionnaires et les membres de la nation crie ?
Pour la Sépaq, l’idée de conservation de milieux naturels est souvent liée à une préservation quasi absolue de la faune et de la flore, notamment par la création de sentiers
Ce parc, qui portera le nom d’Assinica (« là où il y a beaucoup de roches »), devra intégrer la vision qu’ont les Cri.es de l’idée de conservation de la nature. La gestion du parc sera d’ailleurs confiée à la communauté d’Oujé-Bougoumou.

desquels le ou la randonneur.euse ne peut, sous aucun prétexte, s’écarter. Les Cri.es accordent quant à eux une importance accrue à une cohabitation équilibrée entre l’être humain et son environnement naturel, ce qui passe par des activités traditionnelles comme la chasse et la pêche, mais dans des limites responsables qui assurent la perpétuité prospère des écosystèmes protégés, et — cela va de soi — dans le rejet des activités d’exploitation industrielle.
Ces conceptions de ce que devrait être un parc national ne sont pas incompatibles, mais résolument différentes en raison de leur philosophie profonde. Elles sont à la source de difficultés et d’incompréhensions dans le processus de création du parc Assinica, où la vision québécoise blanche reste surreprésentée. Plusieurs personnes ayant participé aux entrevues menées par Gabrielle ont mentionné qu’elles n’étaient pas toujours consultées à toutes les étapes, alors qu’elles possèdent des connaissances de terrain,

contrairement aux fonctionnaires de Québec : « he would like for everybody to work together to make it a success. Because the people making these plans, they're not on the land, they don't see it. We see it [il aimerait que tout le monde travaille ensemble pour que ce soit un succès. Parce que les gens qui font ces plans, ils ne sont pas sur le territoire, ils ne le voient pas. Nous, on le voit] », traduiton à Gabrielle lors d’un échange avec un maître de trappe cri. En d’autres mots, les participant.es souhaitent que leurs savoirs soient compris et considérés d’égal à égal avec ceux des scientifiques ou fonctionnaires, ces dernier.ères étant moins ancré.es dans Eeyou Istchee, tant physiquement que culturellement.
Selon Gabrielle, le parc national Assinica devrait voir le jour en 2027, soit 25 ans après le début des procédures. L’étudiante souligne qu’elle ne serait pas étonnée de voir ce délai dépassé.

Les paysages de l’Insoutenable
Par Antoine Morin-Racine, chef de pupitre aux actualités
Histoire, banalyse et phénoménologie de ces lieux qui ne sauront plus être et des gens qui les habitent Une rue déserte. La nuit se pose sur un cul-de-sac sans trottoirs ni grand intérêt entre Saint-Augustin et Boischatel. La neige tombe avec une vigueur naïve. Seul signe de vie à la ronde, la lumière chaude dans les fenêtres de quelques bungalows. Le souper est prêt. Ça se sent. Une vague odeur de pâté au saumon. Le Tricheur ou le téléjournal joue à la télévision. On annonce une soixantaine de centimètres en 24 heures. Puis peut-être de la pluie… en plein mois de janvier.
Un VUS a été oublié dehors et conquis par les éléments pendant qu’il était attaché à sa borne de recharge. À quelques pas de là, le jus noir d’un petit tas oublié de sacs de compost forme un delta dans la poudreuse intouchée de la rue. La neige est rouge. Spectacle de lumière des décorations de la maison d’en face. Un arrangement fier de parures pour le Noël vert de cette année. Un bonhomme de neige gonflable aux yeux vides monte docilement la garde sur ce petit pan du triomphe post-industriel.
Puis tout s’éteint. L’éclairage orange des quelques lampadaires est remplacé par une noirceur de puits de mine et un calme encore plus plat. Hydro avait bien averti de la possibilité de pannes avec le redoux. Probablement une ligne qui a cédé dans le Parc des Laurentides. On nous rassure que la coupure ne sera que de courte durée.
Le vent tente de se lever, mais la neige a ralenti. Le bonhomme a encore sa forme, mais montre déjà des signes d’affaissement.

Au loin, une génératrice peine à démarrer.
Un chercheur dont l’Histoire a oublié le nom a déjà décrit Québec comme une « ville américaine moyenne, unique en son genre » (Fortin, 1981). Fidèle à cet adage qui nous déplaît selon lequel nous ne serions que des Américains. es qui parlent français, il est vrai que l’arrangement urbanistique de notre capitale se définit aujourd’hui par ses suburbs états-uniens presque plus que par sa vieille ville historique.
Autant sinon plus que Montréal et ses couronnes, ou que le dortoir de fonctionnaires fédéraux qu’est devenu Gatineau, Québec est une ville-banlieue. La vie d’une presque majorité de ses habitant.es bat au rythme du trafic, de l’hypothèque d’une maison unifamiliale et des besoins de leurs 1.6 enfants. C’est un fait qui est cher à certain.es, qui déplait à d’autres, mais qui n’en reste pas moins indéniable. Comme beaucoup d’autres villes nordaméricaines, Québec se définit par son centre, mais n’existe que dans son contour.
À y chercher une quelconque forme de « communauté », on découvre que les banlieues qui tiennent Québec en étaux sont loin d’en faire le « gros village » qu’on lui reproche parfois d’être. On n’y trouve rien du passage de farine, de la cohésion paroissiale ou même des commérages de parvis d’églises; tout de la méfiance envers l’extérieur et des chicanes de terrains, par contre.
Les collines au nord de Québec ont pourtant été jadis de jolies petites bourgades canadiennes-françaises. En témoigne la disposition villageoise de quelques rues aux


maisons ancestrales fières, mais définitivement démodées que l’on trouve encore dans le coin du Trait-Carré ou à L’Ancienne-Lorette et toutes ces églises dont le pôle central transparaît encore dans la géographie.
On les a depuis noyées, à perte de vue, dans un amas de développements unifamiliaux aléatoires, des faisceaux de cul-de-sacs fractionnés en quartiers à l’aide d’autorues par le rayon d’opération de quelques powercenters. On se plait à y revenir après le travail, à y jouir de tous les vices et luxures banals que l’homme et la femme de l’Ère de la Croissance peuvent bien vouloir se faire vendre, et à savoir que là-bas, sur notre parcelle à nous, se trouve toutes les possessions qui nous appartiennent de droit.
Les gens respectables qui regardent le paysage du haut du parc des Braves ou les post-hipsters qui déambulent embourgeoisement dans la basse-ville ont peut-être tendance à l’oublier, mais l’existence de la plupart de leurs concitoyen.nes est d’une différence presque ontologique avec la leur. De la banlieue émane une culture, un habitus, une manière d’être au monde héritée de l’ordre social qui l’a construite et vendue. La distillation la plus pure de la vie qu’est censé mener le récipiendaire d’une planète aux ressources qui seraient infinies. On n’habite pas la banlieue, on l’incarne; quand on y vit, on y existe.
Cependant, pour parler de la banlieue, et surtout pour en parler différemment de toustes celleux qui en ont parlé avant, il faut se rendre à l’évidence que sa critique est surannée; qu’elle est devenue l’une des cibles favorites de tout ce qui passe pour un discours « socialement conscient » depuis les 3-4 dernières décennies. Vous



savez, ce genre d’admonestations faciles et peu originales des conditions d’existence de la Fin de l’Histoire. On a toustes vu et entendu ce genre de divagations bancales sur la « société de consommation » dans la revue Addbuster, sur des aires des Vulgaires Machins ou dans les refrains de groupes millionnaires qui chantent à propos des « maisons toutes pareilles ». Les accusations innocentes de l’apogée d’une époque d’abondance. Le chignage un peu effronté des générations qui ont grandi avec tous ses luxes.
Qui plus est, on semble au crépuscule de l’heure de gloire des banlieues. Il existe encore certainement des milliers de développements unifamiliaux pour gruger un nombre toujours plus grand de terres cultivables, mais les prophètes du Nouvel Urbanisme commencent peu à peu à convaincre les gouvernements de l’obsolescence du modèle banlieusard, et à en proposer une panoplie d’alternatives densifiantesTM, toutes moins abordables les unes que les autres. Et bien qu'elle ait commencé comme culte de l'unifamilial et de l'individuel, et qu'elle se reproduise en grande partie encore comme ça, la banlieue ne manque pas pour autant de variété. On le voit au saupoudrement de ces nouveaux blocs à condos épurés et inachetables que l’on fait pousser pour faire croire que l’on « crée du logement ».
Comment donc traiter de la banlieue en allant au-delà de sa caricature ? Comment l’analyser d’une manière qui, au moins, tente d’être nouvelle, à la lumière tant de son déclin que de son avenir insoutenable ?
Tenter de voir la banlieue de l'intérieur, pas pour ce qu'on




pense qu'elle est, ou ce que l'on voudrait qu'elle soit du haut de quelques idéations qui ne sont peut-être pas injustement méprisantes, mais qui seraient inutiles à une analyse qui en serait neuve. La voir pour comment elle se vit, dans tous ses stéréotypes et sa diversité; tenter de l'analyser dans sa banalité, déterrer son histoire et explorer la manière dont on en fait l'expérience quand on y existe.
Un royaume vous attend
On comprend la banlieue nord-américaine en la considérant comme l’Occident incarné dans l’aménagement d’un territoire.
On s'aventure dans ses rues comme dans un labyrinthe tranquille, mais dont l’idée de s’y perdre ne conforte pas du tout. La bus s’y rend sur la même autoroute que les autos. Tous ses recoins sont excentriques et mystérieux pour une âme du centre-ville. Quelques regards perplexes, suspicieux, même. C’est pourtant là que la plupart des gens vivent (Gouv. du Canada, 2021). Les lumières des perrons sont chaudes et accueillantes, mais aussi bizarrement glauques parce qu'on sait qu’elles ne sont allumées que pour celleux à qui elles appartiennent. L'immensité de comment elle s’étend vous frappe quand on l'aperçoit momentanément du haut d’une colline d’asphalte. La même idée reproduite à perte de vue, mais toujours avec une individualité étonnante. Étendue, elle n’a pas de centre, car celui-ci se trouve que dans chaque unité qui la compose. Dès qu'on y vit, on devient ce autour de quoi elle tourne.
À chaque homme son royaume. C’est par cette promesse de la Modernité que la banlieue devient une réalité;



l’aboutissement du rêve libéral originel de démocratiser la richesse des monarques pour l’avènement d’un monde où toustes sont propriétaires et où tout peut être propriété, où on ne peut être élevé.e ou condamné.e à une caste que par la hardiesse de son travail ou sa propre fainéantise. Un monde où aucunes possessions n’est tenue comme inaccessible à personne et où l’unique condition pour leur obtention est d’avoir assez trimé.
On comprend la banlieue nord-américaine en la considérant comme l’Occident incarné dans l’aménagement d’un territoire.
Ici, les hivers sont de moins en moins longs et, mis à part les adeptes de pentes et autres fans de skidoo, ça ne semble pas déplaire à grand monde. Pères souffleurs et mères pelleteuses raclent l’asphalte avec intermittence en un samedi doucement gris et anormalement chaud du mois de janvier. Les petit.es savourent leurs premiers moments de liberté en glissant dans le corridor des pylônes. Leurs frères profitent de l’après-midi pour jouer à Fifa sans que le moindre souci du monde ne les ait encore atteints. Le thermomètre indique deux degrés Celsius.
Le temps du scorbut est loin derrière nous, mais celui des sacs de sable frappe à la porte. C’est entre les deux que se déroule toute l’action de l’histoire qui nous concerne.
Quelques sociologues arrogants diraient sûrement que c’est dans « l’idéal colonialiste du pionnier » que se déterre « l’archéologie » de la banlieue et que c’est de la « mythique individualiste de la Frontière » d’où part l’impulsion initiale des classes moyennes à quitter la ville (Veracini, 2012).



Iels sauraient nous expliquer la banlieue comme l’enclosure capitaliste s’immisçant jusque dans la sphère de l’habitation: la mise en propriété du territoire et l’étape finale de son individualisation.
Iels ne manqueraient certainement pas non plus de mentionner les origines orientalistes de sa forme de logis la plus commune : le bungalow, qui, en s’inspirant des maisons traditionnelles bengalies, sera exporté de l’Inde britannique partout dans le Nord global (Morriset & Noppen, 2004, p.12) (Gupta, 1996).
Iels diraient probablement aussi que la vie de banlieue rejoue et reprend les codes presque inconscients du colonialisme de peuplement. L’automobile comme le wagon pionnier du quotidien (Veracini, 2012, p.4). La maison unifamiliale : un héritage de l’idéal du yeomen farmer jeffersonien où l’on fait pousser de futurs membres productifs de la société (Veracini, 2012, p.4). Le jardin et l’entretien de la pelouse qui imitent les origines fermières de la maisonnée de l’arrière-pays colonial.
Mais que savent-iels, ces intellectuel.les à pédales patenteux.ses de théories ésotériques, de l’amour-propre qui vient avec la certitude d’être en possession de ce que l’on sait qui est à nous ?
Le.a banlieusard.e est après tout le.a plus fidèle héritier.ère de ses ancêtres. Fièr.e de la même fierté que celle du colon qui a su dessoucher les arbres avec lesquels il a construit sa demeure. La tête haute de la même hauteur que celle qui a recousu les vêtements de 15 enfants sans se plaindre. Content du même contentement quant aux

quelques humbles possessions qu’iel peut vanter comme gage de tout son travail : sa demeure, son champ, ses outils, ses bêtes, sa famille, son camion et/ou sa petite berline, son perron, sa piscine.
Que savent-iels, ces prétendu.es « scientifiques du social », de l’accomplissement qu’on ressent à signer sa première mise de fonds, de pouvoir enfin dire « cette maison-là, la rouge avec les dalles à l’entrée, c’est la MIENNE » ? Que savent-iels du bonheur de continuellement découvrir les technicalités toutes uniques de SON petit carré d’herbes à Charlesbourg; de la joie de dire à SES jumelles qu’elles auront enfin LEUR propre chambre ? Ont-iels même une idée du calme; du silence d’un aprèsmidi de congé où l’on entend, dans la tranquillité de SA propre cour, que le doux vrombissement des tondeuses ? Comme iels seraient désemparé.es à tenter de saisir la Sainte-Paix qu’on vient y chercher s’iels pouvaient seulement être capables d’en ressentir une once ! La quiétude des années qui passent au-dessus d’une existence stable dans un monde en immuable croissance.
On se fait très bien à la banalité de la place si cela implique qu’on y est « souverain.es », c’est-à-dire libres de régner sur ce que l’on possède.
On y est souverain.es, l’un.e à côté de l’autre.
« Ce n'est plus un pays que mon pays. C'est une grande banlieue dispersée, stupide et sans défense... » -
Jacques Ferron

On comprend la banlieue nord-américaine en la considérant comme l’Occident incarné dans l’aménagement d’un territoire.
À défaut de faire de l’étymologie de bas étage, l’origine du mot banlieue recèle tout de même une histoire qui n’est pas sans intérêt. Le mot aurait désigné, à l’origine, ces petits parages à l’extérieur des murs d’une cité qui étaient encore sous l’égide du seigneur, le contrôle de son ban (Sciara, 2011, p.23). Les deux premières syllabes du mot seraient ainsi de la même origine lexicale que celle du verbe « bannir ».
Là où les Français.es ont banni les familles ouvrières dissidentes puis les étranger.ères qu’iels n’ont que temporairement désiré.es (Fourcaut, 2007), les néoFrançais.es s’y sont banni.es elleux-mêmes. Après l’exil des campagnes aux quartiers ouvriers, la classe travaillante s’évadera de la misère vers les environs de la ville au moment où le capitalisme leur consentira une vie décente. Certes, la petite bourgeoisie avait déjà commencé à quitter les centres-villes nord-américains depuis le début du 20e siècle dans des quartiers périphériques aux allures de Montcalm, Saint-Sacrement ou Sillery. Avec leurs appartements de bohèmes arrivistes, leurs maisons de notables à proximité encore acceptables de la ville et leurs petites rues commerçantes à la Cartier, Myrand, Maguire, éparpillées à distance de marche, les Américains désigneront ce genre de quartier de streetcar-suburb de par l’accessibilité en tramway à partir de laquelle elles se sont construites.
La véritable essence de la Banlieue avec un grand B doit

cependant être saisie non pas en analysant les demeures de la petite-bourgeoisie de la Belle Époque, mais en partant de ces endroits où se sont installées les classes moyennes d’après-guerre.
La banlieue qui ne coûte que 7500$, qui sort fraîchement d’une usine à dos de camion et qui vient avec le sous-sol en prélart, la cuisinière et le lave-vaisselle (RadioCanada, 1968). Celle des bungalows beiges et humbles, de nos grands-parents qui sentent immanquablement le lilas, les vieux cartons du garage et le pâté chinois.

À la manière de bien des choses au Québec, cette imitation tout américaine aura quand même ici une genèse particulièrement canadienne-française. Dans une unanimité qui faisait probablement rougir les corporatistes ultramontains, autant le grand que le petit capital, les syndicats, l’ensemble des paliers de gouvernement et même l’Église s’exprimeront en faveur d’un développement urbanistique excentré et unifamilial (Parent, 2011).
On dit même d’un certain « bungalow québécois » qu’il tient une unicité particulière. C’est que, voyez-vous, la construction sur la longueur qui fut privilégiée pour les maisons banlieusardes au Québec durant les années 50 et 60, viendra à différencier ce « monument vernaculaire » tant des bungalows des banlieues canadiennes que de ceux du reste du Nord global (Morriset & Luppen, 2004, p.20).
Les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux trouvent dans le modèle banlieusard un moyen bien



efficace de se départir d’une potentielle crise du logement au retour de la guerre tout en stimulant une économie qui sort tout juste de la Dépression (Parent, 2011). Les clercs, eux, sont enthousiastes à l’idée qu’on loge leurs fidèles en dehors des vices de la ville, mais surtout à l’idée de sortir la femme des usines en la bénissant du travail de ménagère des familles nucléaires qu’elles doivent faire pousser dans les palais préfabriqués de leurs maris (Séguin, 1989). Même les syndicats y voient les logis abordables et spacieux qu’on doit à l’ouvrier pour la société qu’il construit (Parent, 2011).
À chaque salaire, sa famille et à chaque famille, sa maison (Choko, 1987). Après les périls de la Dépression puis de la guerre, le travail d’un honnête homme pour l’Ère de la Croissance ne vaut-il pas la peine d’être enfin récompensé à sa juste valeur ? Ne devrait-il pas être capable de voir de ses yeux le prix de sa sueur dans le confort de sa famille ?
Ce ne sont pas là les tons d’un discours anticapitaliste, mais bien, au contraire, la manière la plus efficace qu’on ait trouvée de sauver le modèle économique du « monde libre ».
Avec sa genèse aussi américaine que la tarte aux pommes, il serait inconscient de ne pas considérer le suburb, avant tout, comme le front urbanistique de la guerre idéologique totale que les États-Unis ont menée, dès 1945, à cette quelconque idée chimérique qu’ils se faisaient du « communisme ». On comprend ainsi mieux l’enthousiasme du régime duplessiste et de toute sa coterie pour son implantation au Québec.

On a ainsi, dans la maison unifamiliale et son mode de vie, l’expression d’un des compromis de classe les plus judicieusement implémentés de l’Histoire.
« … les projets de peuplement sont régulièrement conçus comme des alternatives aux révolutions »
- Lorenzo VeraciniOn comprend la banlieue nord-américaine en la considérant comme l’Occident incarné dans l’aménagement d’un territoire.

Le repaire des classes médianes
La banlieue doit également se comprendre comme le lieu d’où émane et dont dépend le concept de « classe moyenne ». Elle est la forme urbanistique à cette époque du capitalisme qui a bien voulu se concilier pour mieux survivre; l’espace où ce que l’on a appelé le « compromis fordiste » a entassé avec soin tous ces gens qu’il n’a rendus ni pauvres ni riches pour mieux les unir dans une catégorie politique qui a pour fonction de ne pas l’être.
Une classe que l’on devrait plutôt désigner de « médiane » qui se déploie des deux côtés d’un.e consommateur.trice modèle dont le standard de vie est calculé par un panier de besoins de base toujours plus cher.
Cette classe et l’habitat qu’on a construit pour elle sont peuplés en grande partie « d’ancien.nes ouvrier.ères », qui le sont toujours quand on les examine en marxistes, mais dont on a pu très efficacement gommer la conscience de classe à grands coups de marge de crédit et d’hypothèques



autrefois abordables. Celleux-ci vivent souvent aux côtés de leur foreman et du reste de la classe managériale, parfois même à quelques pâtés de maisons de chez leurs patron.nes !
Nous sommes devant l'habitat de ces gens qui ont « réussi ». À qui on a permis de réussir, et dont la réussite ne peut se vivre que par l'épandage d'une allure d'avoir réussi.

Cependant, toutes les banlieues ne naissent pas pour autant libres et égales en droits ! (Morin et al. 2000). Libres, oui, ça elles le sont certainement, leur développement chaotique étant le résultat de la plus irresponsable des libertés des promoteurs immobiliers et de l’incompréhensible laisser-faire des urbanistes, mais on peut concéder qu’on ne vit pas exactement de la même manière à Giffard qu’à Lebourgneuf, ou à Vanier qu’à Sillery.
Quoique ! Même au sein de ces quartiers que l’on taxerait rapidement de banlieues « riches » ou « pauvres », des anomalies à cette homogénéité supposée y sont visibles de pâté en pâté, de rue en rue et même de maison en maison. Sillery possède son lot de blocs appartements un peu miteux. Beauport s’enrichit plus on va vers le nord, sauf bien sûr quand nous reviennent en tête les maisons mobiles de Sainte-Thérèse. Quand on pense à Lévis, on ne pense pas souvent au faubourg de Lauzon, bâti pour les ouvrier.ères du chantier naval, mais bien aux châteaux qu’on continue à édifier à Pintendre.
Les maisons d’ancien.nes Canadien.nes aux toits escarpés se mêlent aux nouvelles constructions grisonnantes, aux petites chaumières d’après-guerre et aux bungalows « vernaculaires ». Quelques rues plus loin, on tombe sur une rangée de ces maisons humbles, mais esthétiquement repoussantes aux tonalités de tôles bourgogne ou bleugris. Une rue circulaire perce l’horizon de ses duplex haut de gamme en pierres beiges avec de fausses clôtures sur les toits.
qu’on ne pourrait le penser. Celles-ci viennent d’adopter leur deuxième. Ceux-là, on pourrait les appeler des « néobanlieusards ». Iels se plaignaient du stationnement dans Saint-Jean-Baptiste, mais se rendent au travail en vélo et raffolent encore de microbrasseries. À Sainte-Foy, on s’est récemment constitué en petit Maghreb autour du Centre Culturel Islamique. Après tout, si elle est synonyme de réussite dans le Nord Global, la banlieue constitue aussi la vie pour laquelle on migre ici.


Il semble que la banlieue ait été conçue, ou du moins qu’elle se soit construite, dans le but ou avec pour effet, d’amalgamer la différenciation de classe. De là la difficulté d’aborder qui y vit, car elle abrite à la fois toustes et personne.

Même si l’accès à la vie de banlieue a toujours été économiquement et racialement ségrégée, certains des personnages qui y vivent (pas toustes blanc.hes, quoiqu'uniformément ennuyeux.ses du même apaisement qu’iels tentent de venir y chercher) sont plus hétéroclites
Il serait pourtant d’une certaine naïveté de croire que tout ceci représente de quelconque manière une sorte d’aboutissement; que ce compromis judicieusement conservateur qui a donné naissance à la banlieue nordaméricaine soit l’achèvement logique et durable d’un capitalisme dont on aurait trouvé l’équilibre. Il serait d’une docilité idéologique mignonne de penser qu'on tolèrerait que la croissance soit distribuée ne serait-ce qu’un pouce au-delà de ce qui maintient la paix sociale. Car les bonnes grâces économiques qui ont autorisé la naissance de cette classe médiane ont commencé à être révoquées des pays de l’Ouest dès les premiers signaux de faiblesses de l’Union soviétique.
Depuis une quarantaine d’années déjà, à l’intérieur de ces blocs un peu défraîchis en bordure d’autoroute, au travers des fenêtres de ces condos qu’on construit au-dessus des épiceries, et peut-être même autour des comptoirs de quartz de ces nouvelles maisons de ville aux teintes de plastique argenté et de faux bois, celles qui sont mal construites et dont on apprend trop tard que les marches de l’entrée ne sont pas incluses dans le prix la construction, à l’intérieur de ces pastiches d’une vie paisible, on s’appauvrit (Lajoie & Delorme, 2023, p. 27). Pour certain. es, c’est imperceptible; d’autres finissent par en abandonner leur maison.
Même si leurs lamentations sonnent souvent fausses par le mépris qu’on voue à la mère aux mèches roses qui demande à voir le gérant ou le bonhomme qui n’a aucun savoir-vivre en chauffant son panier Costco, leurs plaintes sont un présage dont on redoute les implications.

À la source de leurs tirades sur l’augmentation exorbitante du prix des légumes à l’épicerie, les nombres impensables sur les panneaux de station-service, la hausse de leurs hypothèques, il y a l’anxiété de la fin d’une Abondance dont il nous était difficile de même saisir les contours.
Et c’est là que semble apparaître le vrai drame de la banlieue: ce qu’elle perd en ce moment, elle ne devrait ni ne pourra le ravoir.


Les dangers du déni, envers et contre le « monde d’après»
Parce que la quantité de terres arables de la planète est étonnamment limitée (Taylor and Rising, 2021), que le sol fertile est une ressource non renouvelable (FAO, 2015), et que l’on ne se gêne toujours pas pour construire le confort de certain.es par-dessus.
Parce qu’il faut qu’un véhicule électrique tienne jusqu’à 300 000 km pour compenser les gaz à effet de serre de sa production (CIRAIG, 2016), que l’idée même de décarboner la production de ciment relève de l’utopie (Borensetein, 2022), et que l’on milite pourtant encore, du haut des postes de radio, pour une voie de plus sur Henri IV.
Parce que l’entêtement à un mode de vie impassiblement énergivore pour un nombre croissant d’habitant.es ne fera qu’une bouchée de la capacité de stockage d’HydroQuébec même avec tous les barrages colonialistes et autres projets éoliens sur les montagnes à flanc de mer de la Gaspésie que l’on peut bien vouloir construire.
Parce que le maintien de toute l’infrastructure nécessaire à un habitat basé sur une croissance exponentielle est une bombe à retardement (Marohn Jr., 2013).
Parce qu’on se rend compte en ce moment que les modèles de prédiction du changement climatique ont peut-être grandement sous-estimé la rapidité et l’intensité du réchauffement à venir (Palmer, 2020; Hansen et al., 2023).
Parce qu’au risque d’en faire une platitude comme c’est maintenant le cas pour bien des slogans écologistes, il est impératif de faire comprendre qu’une croissance infinie est impossible sur une planète aux ressources qui ne le sont pas, mais aussi qu’elle condamne celleux qui vivront lors de son point culminant à devoir accepter la réalité de son déclin.
menace assez sérieusement, nous serions devant la fâcheuse réalisation qu’elle devrait leur être confisquée.
Avec un peu d’espoir, il est permis de supposer qu’un pressentiment sourd vit néanmoins dans la tête de plusieurs et qu’il fait dissonner leurs certitudes. À cette appréhension voilée d’un péril que l’on se définit vaguement en esquivant les nouvelles des trois « années les plus chaudes jamais enregistrées », des multiples « crus qui n’arrivent qu’une fois aux 1000 ans » et autres « feux de forêt d’une taille sans précédent », on peut réagir de différentes façons. La plupart la laissent passer et se leurrent en se disant que le désastre ne leur donne pas encore sa pleine attention. Quelques-un.es, peut-être, l’acceptent. Iels sont loin de se sortir d’affaires pour autant, mais ont au moins la chance de savoir la chance qu’iels ont. Certain.es, cependant; un nombre déconcertant sans pourtant représenter la majorité; décide de le nier.
C’est à la colère de leur déni qu’on les remarque : les rébarbatif.ves; celleux qui iront jusqu’à mourir en martyrs pour la banlieue; peu importe qu’on leur enlève ou (plus plausiblement) qu’elle s’effrite dans leurs mains.
Comment se fait-il qu’on doive leur dérober ce qu’iels ont conquis de bon droit ? Comment est-ce possible que ce qu’iels arrivent à peine à se payer doive coûter toujours plus cher ? Pourquoi s’en prend-on à elleux, qui sont si travaillant.es et qui ne demandent qu’à ce qu’on les laisse vivre ? « Cela ne se peut pas ! Ce sont les wokes, les globalistes, les juifs ! La Terre s’est toujours réchauffée et on n’a jamais vu autant de glace en Antarctique qu’aujourd’hui (OSI-SAF, 2022) », s’écrient-iels, avec une fausse assurance qui cache mal leur panique.

Tous ces gens, toustes ces promeneur.euse du samedi qui tentent tant bien que mal de faire marcher leur chiot au pied, ces vieux couples sur le point de se faire escroquer leur demeure, cette jeune fille qui s’en va déjà acheter sa robe de bal en apprenant comment conduire l’immense camion de son père, cette femme qui a fui la guerre pour arriver dans le quartier, celleux qui sont la fière incarnation du stéréotype banlieusard et celleux qui nous forcent à le remettre en question, aucun.es d’entre elleux ne semble saisir que ce pourquoi iels vivent est insoutenable; que lentement, sans peut-être même qu’iels s’en rendent compte, la vie pour laquelle iels triment deviendra de moins en moins envisageable, et même que si l’on considérait la
La grogne boue dans les banlieues. Elle est invisible, se cache derrière les carports et les mines monotones éclairées de lumière bleue. Mais elle est bien présente, et l’impulsion réactionnaire de sa base sociale se bande tranquillement. Est-ce que l’ensemble de ses résident.es répondra présent.es au combat pour sa sauvegarde ? C’est très peu probable. On ne mobilise pas aussi facilement une population qui a été désocialisée avec une telle intensité.

On peut cependant être sûr.es que celleux qui se porteront volontaire le feront avec un zèle imprévisible. On les a croisé.es en camion sur la rue Wellington et en train de se battre avec la police autour des comptoirs de Tim Hortons ces dernières années. Leur mouvement s’est depuis recyclé dans la contestation virulente de ces « villes 15 minutes » que les Nouveaux Urbanistes aiment tant.
Sont-iels dangereux, ces moudjahidines d’une abondance qui les a chéries, mais qui s’est toujours étiolée ? À leur manière, oui. Sont-ils « récupérables » ? Certain.es, sans doute. Cependant, on laissera à celleux qui s’en sentent l’altruisme assez fort le plaisir d’essayer de les raisonner.
Iels sont prêt.es à mourir pour la banlieue parce qu’iels ont résolu qu’iels ne voudraient ni ne sauraient comment vivre autrement.
Elle est un rêve qui doit nous être interdit et une réalité qui nous mène vers la ruine.
Et toute institution qui doit être renversée reposera toujours aux côtés des dépouilles de celleux qui ne pouvaient pas supporter de la voir tomber.
Qu’à cela ne tiennent, c’est peut-être avec les autres que l’on fera advenir le « monde d’après », envers et contre tout ce qui tentera toujours de survivre de celui d’avant.
Références
Choko, M. H., Collin, J.-P., & Germain, A. (1987). Le logement et les enjeux de la transformation de l’espace urbain : Montréal, 1940-1960. Deuxième partie. Urban History Review, 15(3), 243 - 253. https://doi. org/10.7202/1018018ar
CIRAIG. (2016). Comparaison des véhicules électriques et des véhicules conventionnels en contexte québécois [Rapport Technique]. CIRAIG. https://ciraig.org/index.php/ fr/project/comparaison-des-vehicules-electriques-et-desvehicules-conventionnels-en-contexte-quebecois/

FAO (Food and Agriculture Organization), (2015). Soil is a non-renewable resource. UN. https://www.fao.org/3/i4373e/ i4373e.pdf
Ferron, Jacques, la Charrette, Montréal, HMH (l'Arbre, n° 14), 1968
Fortin, G. (2005). Une ville américaine moyenne, unique en son genre. Recherches sociographiques, 22(2), 187-203. https://doi.org/10.7202/055929ar
Fourcaut, A. (2007). Les banlieues populaires ont aussi une histoire . Revue Projet, 299, 7-15. https://doi. org/10.3917/pro.299.0007
Gouvernement du Canada, S. C. (2022, février 9). Proportion de la population selon la proximité par rapport au centre-ville, régions métropolitaines de recensement, 2021. https://www150.statcan.gc.ca/n1/dailyquotidien/220209/t008b-fra.htm
Guo, R., Wang, J., Bing, L., Tong, D., Ciais, P., Davis, S. J., Andrew, R. M., Xi, F., & Liu, Z. (2021). Global CO2 uptake by cement from 1930 to 2019. Earth System Science Data, 13(4), 1791-1805. https://doi.org/10.5194/ essd-13-1791-2021
Gupta, S. (1996). The Colonial Bungalow—ProQuest. Architecture Plus Design, 13(2). https://www.proquest.com/ openview/beb0da99a78da3a48f91163a8fa7d208/1?pqorigsite=gscholar&cbl=1816889
Hansen, J. E., Sato, M., Simons, L., Nazarenko, L. S.,
Sangha, I., Kharecha, P., Zachos, J. C., von Schuckmann, K., Loeb, N. G., Osman, M. B., Jin, Q., Tselioudis, G., Jeong, E., Lacis, A., Ruedy, R., Russell, G., Cao, J., & Li, J. (2023). Global warming in the pipeline. Oxford Open Climate Change , 3(1).
https://doi.org/10.1093/oxfclm/ kgad008
ICI.Radio-Canada.ca, Z. S.-. (s. d.). Choisir la banlieue dans les années 1960. Radio-Canada; Radio-Canada.ca. Consulté 1 février 2024, à l’adresse https://ici.radio-canada. ca/nouvelle/1738324/banlieue-banlieusard-rive-sud-nordlaval-beloeil-etalement-urbain-archives
Marohn, C. L. (2013). Suburban Ponzi Scheme. Leadership and Management in Engineering, 13(3), 181-189. https:// doi.org/10.1061/(ASCE)LM.1943-5630.0000234
Morin, D., Fortin, A., & Després, C. (2004). À des lieues du stéréotype banlieusard : Les banlieues de Québec construites dans les années 1950 et 1960. Cahiers québécois de démographie , 29(2), 335-356. https://doi. org/10.7202/010291ar
Morisset, L. K., & Noppen, L. (2004). Le bungalow québécois, monument vernaculaire : La naissance d’un nouveau type. Cahiers de géographie du Québec, 48(133), 7-32. https://doi.org/10.7202/009760ar
OSI SAF. (2022, octobre 19). Debunking false claims about sea ice | OSI SAF. https://osi-saf.eumetsat.int/community/ stories/debunking-false-claims-about-sea-ice
Palmer, T. (2020). Short-term tests validate long-term
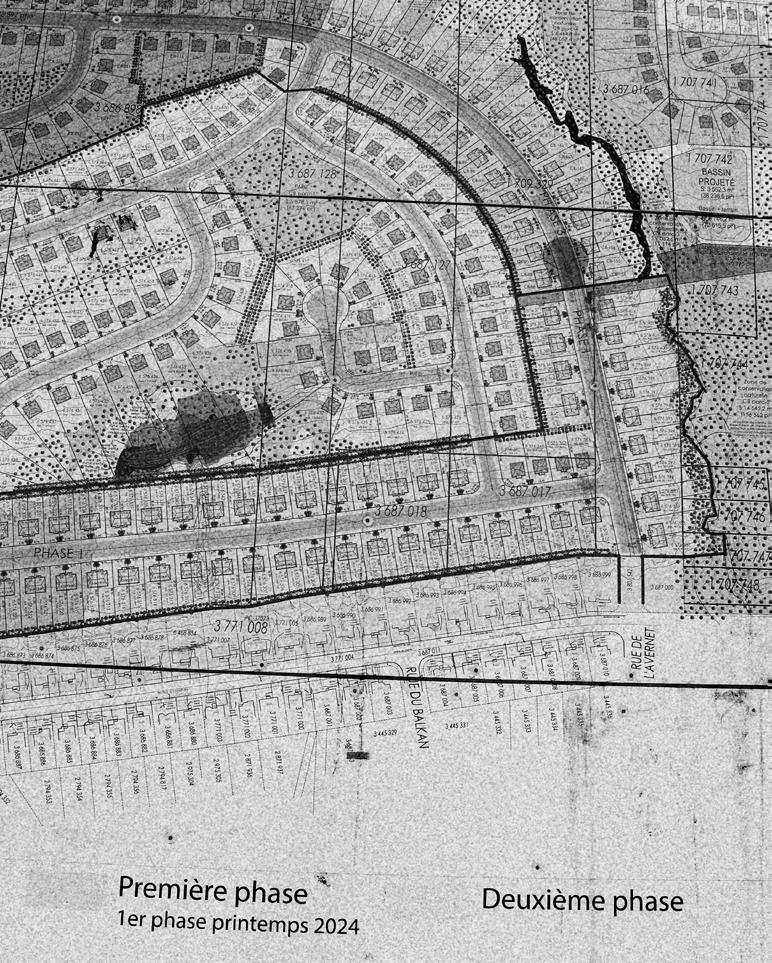
estimates of climate change. Nature, 582(7811), 185-186. https://doi.org/10.1038/d41586-020-01484-5
Parent, M. (2011). De la spécificité de la banlieue québécoise (1). Suburbia: L’Amérique des banlieues. https://oic.uqam.ca/publications/article/de-la-specificite-dela-banlieue-quebecoise-1
Sciara, L. (2011). Banlieues, vous avez dit ban-lieux ? dans Banlieues (p. 23 - 43). Érès. https://www.cairn.info/ banlieues--9782749213910-p-23.htm
Séguin, A.-M. (2005). Madame Ford et l’espace : Lecture féministe de la suburbanisation. Recherches féministes, 2(1), 51-68. https://doi.org/10.7202/057534ar
Seth, B. (2022, juin 22). Cement carbon dioxide emissions quietly double in 20 years. AP News. https://apnews.com/ article/climate-science-china-pollution-3d97642acbb07fca 7540edca38448266
Taylor, C. A., & Rising, J. (2021). Tipping point dynamics in global land use. Environmental Research Letters, 16(12), 125012. https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac3c6d
Veracini, L. (2012). Suburbia, Settler Colonialism and the World Turned Inside Out. Housing, Theory and Society, 29(4), 339-357. https://doi.org/10.1080/14036096.2011.6 38316
Médias: notre société en pleine dissonance cognitive
Par Jérémie St-Pierre, journaliste collaborateur
Chaque mois, une mauvaise nouvelle tombe pour le monde des médias. Compressions chez TVA, fin de l’édition du dimanche au Journal de Montréal, fin des journaux papier aux Coops de l’information, compressions à Ici RadioCanada… Tout ça, rien qu’en 2023. C’est plus de 1 100 emplois qui ont été supprimés l’an passé, sur un total de 20 000 (Carbasse, 2023).
Il faut prendre la mesure de la situation. En ce moment, ce ne sont pas seulement les journaux écrits qui sont menacés, mais toute l’architecture médiatique québécoise, des petits hebdos régionaux aux grands conglomérats télévisuels en passant par les médias étudiants et communautaires.
Bien sûr, il est normal de voir des secteurs d’activité économique décroître, pendant que d’autres croissent. Après tout, les choses changent et les goûts aussi. Le problème, ce n’est donc pas les pertes d’emplois ou d’entreprise. Le problème, c’est la perte d’un système essentiel au bon fonctionnement de la démocratie. C’est un problème politique au sens fondamental du terme.
Et là-dessus, je crois que l’on s’entend à peu près toustes : le manque de sources d’information fiables et la radicalisation liée aux chambres d’écho formées par les algorithmes en ligne sont directement liés au manque de confiance envers les médias. Il faut évidemment ajouter à cela les pertes en revenus et en opportunités pour le secteur de la culture. Bref, je n’ai pas entendu beaucoup de gens se réjouir de l’état des médias récemment.
En réponse à cette crise des médias, François Legault parle d’un « devoir à trouver des solutions ». Gabriel Nadeau-Dubois a répondu, sur X, à l’annonce du licenciement de 550 employé.es de TVA l’automne dernier, en parlant d’une « lourde perte pour l’information régionale ». Sur Facebook, on trouve ça « dommage », « navrant », « désolant » …
Tout le monde s’attriste. Et pourtant, les revenus d’abonnements des journaux écrits sont en baisse
continuelle depuis une décennie (Centre d’Étude sur les médias, 2023, p. 85). Les consommateur.rices sortent moitié moins d’argent de leurs poches qu’il y a 10 ans pour le mettre dans les journaux. Évidemment, l’apparition des différentes plateformes numériques (Facebook, Instagram, X, etc.) a amené une compétition supplémentaire au niveau des contrats publicitaires et, comme les gens sont présents en bien plus grand nombre sur ces plateformes, c’est là qu’investissent maintenant en priorité les publicitaires (Raymond, 2023). Perte de revenu d’abonnement, perte de revenu publicitaire… Un double piège duquel il est complexe de sortir.
Tout le monde s’indigne, tout le monde regrette. Étrangement, nos comportements économiques pointent vers le contraire. Nous courons vers les plateformes numériques, nous nous enthousiasmons pour l’instantanéité de ces modèles.
La population québécoise manque cruellement de cohérence sur cette question. Entre leur fuite vers les plateformes numériques et les mines déconfites lorsqu’on annonce la fermeture d’un journal, nous sommes en pleine dissonance cognitive.
C’est facile de blâmer les changements dans la technologie pour expliquer la décrépitude d’un marché. Les progrès de la technologie font toujours des perdant.es et il est vrai que les grandes plateformes ont des avantages compétitifs importants vis-à-vis les médias traditionnels. Après tout, le monde est à la globalisation, c’est bien plus intéressant de suivre le outfit de Taylor Swift que l’évolution du zonage dans notre municipalité. Et je ne dis pas ça avec un ton ironique, C’EST plus intéressant. Et pourtant, les questions de zonage ne sont-elles pas essentielles? Que se passet-il si plus personne ne s’en préoccupe ?
Mais il n’existe pas de monopole rendant l’accès aux médias traditionnels impossible aux Québécois.es. La mondialisation, l’américanisation, ce sont des faits, mais elles ne sont imposées à personne. Nous choisissons, par


nos dépenses, de l’embrasser ou pas. Il y a quelques mois de cela, le groupe Méta (Facebook, Instagram) a décidé de bloquer les nouvelles des médias canadiens sur ses plateformes. Le résultat est sans appel, peu de différence dans la fréquentation des plateformes numériques, mais une baisse significative sur les sites des médias. (Caillou, 2023)
Nous disons vouloir promouvoir nos médias, mais nous ne sommes pas prêt.es à en payer le prix. Même au niveau des séries télévisuelles, un domaine où le Québec a longtemps été une exception dans le monde, les cotes d’écoute sont désastreuses chez les plus jeunes générations (Brousseau-Pouliot, 2022). Netflix prend le pas sur TVA.
Et il faut en appeler à l’initiative individuelle. Car demander au gouvernement d’adopter des mesures fiscales en soutien aux médias n’est pas une option (Giroux, 2022). Un crédit d’impôt par ici, une subvention par là… On demanderait aux contribuables de payer pour ce qu’iels ne sont pas prêt.es à payer en tant que consommateur.rices. Fantastique. Nous allons produire des coquilles vides sous perfusion de programmes de l’État et complètement détachées des intérêts des citoyen.nes.
Et je ne vous parle pas des problématiques au niveau de l’indépendance et de l’impartialité, car il est difficile de mordre la main qui nous nourrit. Le point ici n'est pas de dénigrer le travail sérieux de Radio-Canada, mais plutôt de souligner l’importance de la diversité des modèles, sociétés d’État, entreprises, coopératives…
Cette solution n’en est pas une, c’est une manière de maintenir une situation contre nature par l’injection permanente d’argent public, c’est une manière de balayer la poussière sous le tapis. Nous devons nous en remettre au courage de chacun.e. La meilleure manière de s’assurer que nos médias cessent de dépérir, c’est de leur témoigner notre amour en leur prouvant qu’ils méritent 10 à 20$ par mois.
Si l’on veut être digne de l’amour qu’on leur témoigne à chaque fermeture ou chaque nouvelle ronde de coupure, faisons l’effort collectif nécessaire pour maintenir nos médias à flot au lieu de nous désoler. S’abonner, suivre les infolettres, prendre le temps d’écouter davantage de contenu québécois, voilà ce qui redonnerait de la vigueur à notre tissu médiatique. Ayons le courage d’un petit sacrifice pour se « payer » un tissu médiatique en forme. C'est ce que nous ferions si nous étions dignes des aspirations desquelles nous nous réclamons.
Références
Caillou, A. (2023, août 25). Des médias internationaux affectés par le blocage des nouvelles par Meta. Le Devoir. https://www.ledevoir.com/culture/medias/796848/geantsdu-web-loi-sur-les-nouvelles-en-ligne-des-mediasinternationaux-affectes-par-le-blocage-des-nouvelles-parmeta
Carbasse, M. (2023). Crise des médias: tous les postes supprimés au Québec en 2023 dans un graphique, 24 heures Montréal , https://www.24heures.ca/2023/12/04/ crise-des-medias-tous-les-postes-supprimes-au-quebecen-2023-dans-un-graphique
Giroux, D. (2022). État des lieux, Centre d’Étude sur les Médias , 128 p. https://www.cem.ulaval.ca/wp-content/ uploads/2020/10/cem-etatdeslieux-2022.pdf.
Raymond, P.-R. (2023). Publicitaires et médias québécois s’unissent pour endiguer la fuite des revenus publicitaires, Le Soleil, https://www.lesoleil.com/2020/05/14/publicitaireset-medias-quebecois-sunissent-pour-endiguer-la-fuite-desrevenus-publicitaires-53cda62fe755a37d177c073a0a018 1b1/
Brousseau-Pouliot, V. (2022). Il ne faut pas échapper à la génération Netflix, La Presse , https://www.lapresse.ca/ contexte/editoriaux/2022-10-02/culture/il-ne-faut-pasechapper-la-generation-netflix.php
Faire le tour du monde depuis son salon
Partez à l’aventure sans quitter le confort de votre foyer. Faites le tour du monde sans avoir à briser votre tirelire.
Empreinte carbone (kg/pers.) : 0
Distance (km) : 0 ou des milliers (selon comment vous voyez ça)
Budget : $
Quand partir : toute l’année
Par Julianne Campeau, journaliste collaboratrice

Ah! Les vacances! Finis les travaux, l’étude, le stress… La belle vie, quoi! Pour celleux qui le peuvent, c’est le moment de partir en voyage, d’aller au bord de la mer, de visiter de nouvelles villes, d’admirer de nouveaux paysages… Par contre, on va se le dire, ce n’est qu’une minorité qui a les moyens de parcourir le monde sans devoir économiser pendant des années. N’ayant pas la chance d’appartenir à cette classe de privilégié.es, je dois me contenter de voir du pays depuis mon salon, grâce au canal Évasion, ou en consultant des sites d’informations pour les touristes, m’imaginant en train de planifier une escapade.
Certes, j’ai voyagé un peu dans ma vie. Mais je n’ai jamais quitté le nord-est de l’Amérique du Nord, faute de moyens. New York demeure, à ce jour, ma destination la plus lointaine. J’ai détesté la majorité de mes voyages, lors desquels j’ai presque toujours dû partager ma chambre, ou pire, dormir dans une tente. Oui, je suis un peu princesse. Je suis attachée à mon petit confort, j’ai besoin de mon intimité et d’être proche des commodités de la grande ville, en particulier des musées, des cafés et des services de transport en commun. Malheureusement pour moi, cela veut dire économiser des années pour une escapade de quelques jours.
Il m’arrive aussi de regarder des émissions de voyage sur des endroits qui ne m’intéressent pas vraiment. Par exemple, j’ai écouté et réécouté tous les épisodes d’Avec ou sans cash, même ceux traitant de lieux où je ne compte pas aller (qu’est-ce que moi, une citadine pure et dure, j'irais faire à Tofino ou en Patagonie?). Mais le canal Évasion ne me sert pas uniquement à visualiser de potentiels futurs voyages. Il me permet également d'apprécier, dans le confort de mon foyer, la beauté d'endroits qui m’ennuieraient, « en vrai », au bout d’une journée.
Je le sais, vivre quelque chose en rêve n’équivaut pas à l’expérience réelle, mais ça me met de bonne humeur, donc pourquoi je m’en priverais?

Réservez







Ne laissez pas votre note au hasard
Si vous croyez être victime d’une erreur ou d’un traitement inéquitable, vous pouvez procéder à une demande de révision de notes.
DOSSIERDEHORS
Cartographier l’histoire d’un pays, une île à la fois

Si, à plusieurs égards, Montréal représente l’épicentre du développement laurentien, les autres zones insulaires de la province sont-elles dénuées d’histoire pour autant ? Pas du tout. Coup d'oeil sur une poignée d'îles québécoises et sur leurs particularités historiques.
Par François-Xavier Alarie, journaliste collaborateur
L’île d’Orléans
Tout juste en aval de Québec se trouve l’île d’Orléans. Bon nombre d’amateur.rices de généalogie peuvent identifier au moins un.e ancêtre y ayant vécu dans les débuts de la Nouvelle-France. En effet, la richesse du sol, l’abondance de bois sur l’île et la proximité avec Québec en ont favorisé la colonisation par les Français.es. Lors de la guerre de Conquête, les troupes britanniques ont occupé l’île et ont pillé la vaste majorité des habitations. L’île tout entière est aujourd’hui enregistrée comme site patrimonial du ministère de la Culture et des Communications (MCC), ce qui favorise la conservation des habitations, mais pas toujours pour le plus grand bonheur des citoyens: les rénovations s’avèrent dispendieuses et un non-respect des normes patrimoniales peut mener à des amendes salées.
Le charme intemporel de l’île d’Orléans a d’ailleurs inspiré de nombreux artistes. Horatio Walker, originaire de l’Ontario, a migré sur l’île pour y peindre le mode de vie traditionnel des Canadiens français vivant de l’agropastoralisme.
Îles-de-la-Madeleine
Au pied des falaises colorées de l’archipel des Îles-de-laMadeleine se cache l’un des plus grands cimetières d’épaves en Amérique! Parmi les centaines de naufrages, quelques dizaines seulement ont été retrouvées, laissant croire que des trésors s’y cachent encore. À ce propos, les archéologues font face à divers dangers quant à la protection des sites archéologiques dans l’archipel, le plus grand venant de l’érosion: « on est vraiment vulnérable aux intempéries, aux tempêtes et aux vagues, ce qui fait qu’on perd beaucoup de terrain annuellement », dit AnneSophie Lapierre, candidate à la maîtrise en archéologie, spécifiant que la majorité des sites connus se trouvent en bordure de mer. Ses recherches visent à identifier les sites les plus à risque de disparaître afin d’en prioriser les fouilles, un processus « de longue haleine, mais qui nécessite d’être fait » pour préserver le patrimoine archéologique local. Les ressources archéologiques locales sont également mises à mal par l’afflux de touristes venant pratiquer le détectorisme amateur sur les plages des îles, une pratique qui sépare les artéfacts de leur
 Walker, H. (1893). L'Arc-en-ciel [aquarelle sur papier]. MNBAQ, Québec.
Walker, H. (1893). L'Arc-en-ciel [aquarelle sur papier]. MNBAQ, Québec.

contexte et réduit les informations qui peuvent en être extraites.
Anticosti
Aucune habitation permanente ne se trouve sur la plus grande île de la province avant le début des années 1870, où Henri Meunier, chocolatier français, acquiert l’île à des fins privées et y développe les premières routes et villages. À la veille de la Deuxième Guerre mondiale, l’Allemagne souhaite acheter l’île, proposition qui galvanise le pays tout entier, mais Maurice Duplessis est ferme : « tant que je serai Premier Ministre, [la vente] ne se fera pas! » (Théorêt 2017, p.138). Si des travaux d’exploitation pétrolière ont pris place au début du 21e siècle, il n’en est plus rien depuis 2017.
Depuis quelques mois, Anticosti est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Pourquoi cette désignation culturelle ? Les rives regorgent de fossiles illustrant la première extinction de vie animale, datée de 447 à 437 millions d’années avant notre ère, un moment charnière de l’évolution de la vie sur Terre.
Grosse-Île

Les guerres napoléoniennes, les famines et les épidémies en Europe lancent un mouvement migratoire important vers le Canada. Afin de limiter la propagation de maladies comme le choléra et le typhus dans la vallée laurentienne, principale porte d’entrée du pays avec en moyenne 30 000 migrant.es annuel.les, dont la majorité est d’origine
irlandaise, une station de quarantaine est construite sur la Grosse-Île. L'afflux le plus important est en 1847, où 90 150 immigrant.es arrivent au Canada via Grosse-Île (Guay, 2011, p.80). Cette quantité importante d’Irlandais.es s’installant au Bas-Canada contribue à l’identité québécoise et se ressent encore aujourd’hui, notamment avec les célébrations associées à la fête de la Saint-Patrick.
Aujourd’hui devenue un parc historique national, il est possible de visiter la Grosse-Île. Y sont exposés les drames et difficultés de la vie sur l’île, mais aussi les progrès de la médecine et, , les premiers plans de gestion de l’immigration post-confédération. Si l’île a longtemps été associée à un moment sombre de l’histoire, elle témoigne aussi de la victoire de la science sur les épidémies et d’un nouveau départ en Amérique pour plusieurs de nos ancêtres.
Dissocier les régions insulaires de l’histoire du Québec représenterait une bête erreur. Bien que parfois d’apparences anecdotiques, les évènements qui y ont pris place font partie de notre mémoire collective, et à cet égard un devoir de mémoire doit s’imposer pour ne pas en oublier les fondements.
Références
Théorêt, H. (2017). L’expédition allemande à Anticosti. Septentrion, 190 p.
Butel, P. (2018). Histoire de l’Atlantique. Tempus. 591 p. Guay, H. (2011). Le Québec des îles. Presses de l’Université Laval. 192 p.

EN PHOTOS – LE SALVADOR
Situé en Amérique centrale, entre le Honduras et le Guatemala, le Salvador est le plus petit pays de la région avec une superficie d’environ 21000 km 2. Entre océan, montagne et volcan, visite en images de ce pays parfois méconnu.
Par Mégan Harvey, journaliste-édimestre

Avec ses 307 kilomètres de côtes qui longent l’océan Pacifique, le Salvador est une destination idéale pour tous les amateurs.rices de surf. Avec de longues vagues droites, réputées mondialement, le surf est possible 365 jours par année grâce à son climat tropical.

La Ruta de las flores, une route d’environ 30 kilomètres, traverse quelques villages dont Juayúa, Salcoatitán, Nahuizalco, Apaneca et Concepción de Ataco. Fleurs, maisons colorées, marchés locaux d’artisanat et nourriture typique font tous partie du paysage et de l’expérience.




L’artisanat est riche au Salvador se composant notamment de textiles, poteries et bois travaillé. La production de café y est aussi importante, le Salvador se classant parmi les plus grands producteurs au monde.



Avec plus d’une centaine de volcans sur le territoire, certains encore actifs, le Salvador est surnommé Land of volcanoes. Le volcan de Santa Ana est le plus haut du pays, culminant à 2381 m d’altitude. Les locaux l’appellent Ilamatepec, dans la langue indigène nahuatl, ou Mother Mountain.





Les paysages dans l’œuvre de Saint-Exupéry ont été, en partie, influencés par ceux du Salvador puisque la femme de l’auteur, Consuelo Suncín Sandoval, était salvadorienne. Elle le mentionne, entre autres, dans son autobiographie, Mémoire de la rose, publiée en 2000.



À Santa Tecla, près de la capitale San Salvador, un parc municipal rend hommage au Petit Prince. On y retrouve des représentations de différents personnages de l’œuvre.
Toute aventure débute par une carte !
Impossible de penser que les sports de plein air puissent échapper à l’informatisation de notre société. Les randonneur.euses utilisent désormais bon nombre d’applications mobiles qui cartographient des centaines de sentiers. Dans ce contexte, la bonne vieille carte papier estelle rendue désuète ? Permettez-moi d’en douter! Que l’on me comprenne bien : je suis loin de penser qu’il faut totalement se défaire de ces applications mobiles qui sont, certes, pertinentes, mais il faudrait aussi apprendre quelquefois à se déconnecter quand on va en nature. À ce sujet, je vous propose une petite chronique à propos de ces technologies après quoi, je vous invite à m'accompagner dans une de mes randonnées préférées.
Henri Paquette, journaliste collaborateur

Un devoir de mémoire
Je vous dirais qu’à chaque fois que je le peux, je me procure une carte « papier » sur le sentier que je m’apprête à découvrir. Je considère cet acte comme un effort de réappropriation de notre Histoire, comme une occasion d’aller aux origines de la découverte de notre fabuleux territoire. Une carte papier permet en effet d’établir « une représentation de l’espace et du territoire en résonance avec [sa] culture d’appartenance » (Dufour-Lapperière, 2019, p. 25). Alors qu’à l’époque coloniale, les coureurs des bois arpentaient les grandes forêts à la recherche de fourrures et que, bien avant eux, plusieurs nations autochtones occupaient ces terres à des fins de subsistance, aujourd’hui, ces mêmes territoires sont convoités par des randonneur.euses, des skieur.euses ou encore des campeur.euses.
Pour moi, c’est ainsi que se développe cette « culture d’appartenance » entre les contemporain.es et leurs ancêtres. Ces deux groupes, à des moments différents dans l’histoire, ont été en relation avec le même territoire qui est, par la force des choses, porteur d’une même histoire. À mon avis, cette « culture d’appartenance » s’est transmise de génération en génération grâce à l’existence de documents manuscrits, parmi lesquels se trouvent des cartes papier. C’est en ce sens que je vois ce type de cartes comme un outil porteur d’une histoire, cette dernière méritant d’être remémorée afin que l’on se souvienne des courageux.euses qui nous ont précédé.es et qui sont à l’origine de la (re)découverte du territoire. Ces cartes nous permettent d’entretenir un vrai devoir de mémoire envers nos ancêtres, de leur rendre en quelque sorte un hommage et de se rappeler l’importance de protéger nos trésors naturels québécois. Malheureusement, les nouvelles technologies numériques ne prennent pas en compte cette sensibilité historique et territoriale si essentielle.
La démocratisation des technologies de l’information géographique (TIG) : avancée ou menace ?
Malgré tous ces bienfaits, je dois admettre que je suis inquiet pour l’avenir de la randonnée pédestre. Le développement et la démocratisation des TIG ont pour conséquence de rationaliser ce qui se veut une activité avant tout méditative. Nous dénaturons ce qu’est l’essence même de la randonnée : une activité que l’on fait pour être seul.e avec soi-même dans une nature qui nous amène bien souvent à l’introspection. Les TIG cartographient de manière à diviser le territoire en des thématiques (ex. : tourisme, événements, loisirs, etc.) pensées dans le seul but de capter l’attention des usager.ères. (Mericskay et Roche, 2011, paragr. 10). Ces « applications cartographiques 2.0 » dictent des points d’intérêts et « [désignent] un endroit, un lieu, une place » comme « potentiellement intéressante » à l’aide de marqueurs géographiques (Mericskay et Roche, 2011, paragr. 10).
Je vois ici un phénomène de marchandisation de la randonnée pédestre. En devenant peu à peu les maîtres de la cartographie numérique de nos territoires, les entreprises privées vont jusqu’à proposer aux potentiel.les randonneur.euses de découvrir un sentier à proximité d’un certain commerce qui a peut être payé pour être mis en valeur dans l’application. Triste de voir la randonnée devenir de plus en plus une histoire d'argent! Je trouve que le privé exploite négativement cette activité en s’introduisant d'une manière sournoise dans le processus de cartographie du territoire en vue de satisfaire ses intérêts pécuniaires d’abord et avant tout.
La carte papier au service de la volonté des randonneurs
Vous me trouvez peut-être intense, mais je ne suis pas le seul à penser ainsi! Dans un article de La Presse+ intitulé


« La carte papier résiste au GPS. » (Tison, 2017), on apprenait que la carte papier était encore très prisée par les randonneur.euses. La Chaire de tourisme Transat de l’UQAM a publié une étude dans laquelle 84 % de ses 3 011 répondant.es disaient ne jamais ou pratiquement jamais utiliser d’applications mobiles pour effectuer leurs randonnées (Tison, 2017, paragr. 4). Qui plus est, seulement 37 % souhaitaient avoir une connexion cellulaire pendant leur randonnée ou au départ de celle-ci (Tison, 2017, paragr. 6). Bien qu’ils aient sûrement évolué depuis, ces chiffres montrent que, même à l’ère numérique, les pratiquant.es de ce sport souhaitent en majorité se rattacher à la carte papier. On en dénote un comportement qui traduit une volonté bien présente dans la population de se détacher des gadgets électroniques lorsque nous allons en nature.
Ma randonnée préférée !
Pour détendre l’atmosphère, laissons de côté cette série d’arguments et découvrons ensemble ma randonnée préférée.
Pendant les vacances des fêtes, je suis retourné dans mon coin de pays pour profiter du temps avec mes proches. Je suis originaire du nord de Lanaudière, plus précisément d’un petit village situé à environ 20 kilomètres au nord de Joliette qui porte le nom de Saint-Félix-de-Valois. Par une journée ensoleillée, je me suis dit que ce serait une excellente idée d’aller redécouvrir une randonnée que j’avais faite il y a trois ans. Ces sentiers se trouvent autour du lac Kaël, un peu plus au nord de mon village natal, dans la petite localité de Sainte-Émélie-de-l’Énergie.
Une fois arrivé sur les lieux, je débute l’aventure en portant

attention à un grand panneau qui affiche une carte. Elle m’oriente et me permet de choisir lequel des nombreux sentiers je compte faire. Elle me révèle aussi des informations sur les jolis points de vue que je pourrais atteindre. Mais mon attention se dirige soudainement sur le sentier « Côte à Monette » (numéro 3), à proximité duquel semble se trouver une paroi d’escalade. Intéressant! Mon objectif est alors fixé : je veux aller découvrir ce mur d’escalade! Je commence donc la randonnée. Les deux premiers kilomètres me font traverser une grande forêt de feuillus (évidemment dépourvus de leurs feuilles) qui monte très tranquillement en altitude. Plus je m’éloigne du stationnement, plus le bruit des voitures de la grande route se fait distant. Au fur et à mesure que le temps passe, je me sens véritablement plongé en forêt. Cette partie de la randonnée est néanmoins quelque peu décourageante : elle ne fait que monter sans cesse et pour être honnête, il ne s’agit pas de mon type de forêt préféré. Pas grave! Le meilleur reste à voir! Après ces deux kilomètres, le sentier se met à tourner et, à ce moment, je tombe face à face avec l’une des plus belles choses que l’on peut trouver en hiver : un mur de glace. Je suis alors essoufflé. Cela fait deux kilomètres que je monte en altitude, mais ce mur, ce miroir reflétant la beauté des bois, m’a tout simplement rafraîchi tellement sa couleur bleue était prononcée et reluisante. Je m’arrête quelques instants pour reprendre mon souffle et pour prendre une gorgée d’eau. Je m’apprête ensuite à contourner cette paroi pour atteindre le plateau (le sommet) de cette colline dont elle fait partie, relief typique du Bouclier canadien qui caractérise le nord de Lanaudière. Rendu en haut, une intersection se pointe à l’horizon et indique un point de vue à 500 mètres. Je n’hésite point. Je m’y rends et profite du paysage qui se dresse devant moi. La météo est très clairement de mon côté cette journée-là !
Carte topographique de Sainte-Émélie-De-L'Énergie réalisée par le Ministère des Ressources naturelles Canada.
Je contemple ces paysages pendant de nombreuses minutes. Ici, on voit des petits vallons et des collines à perte de vue! Le gris et le vert des arbres en montagnes font ressortir les rayons de soleil d’une manière éclatante et contrastée, surtout avec la couleur bleue très assumée du ciel. De retour au sentier principal, je remarque un changement de paysage au sommet de la colline. La végétation présente y est surtout composée de petits conifères trapus sur lesquels du lichen a poussé à la hauteur des branches. Puisqu’il n’y avait pas beaucoup de neige, je constate que le sol est fait de grosses plaques de roc. Un petit îlot de taïga bien en deçà du 45e parallèle.
Ces forêts ont une croissance particulièrement lente : il faut un siècle pour qu’un arbre y atteigne 6 mètres, alors qu’un épicéa en France arrive dans le même temps à environ 35 mètres. La faiblesse de la production de biomasse […] s’explique par la maigreur des sols [roc] où


la décomposition est difficile. (Loïzzo et Tiano, 2019, paragr. 24).
Je remarque aussi le changement de température. Le vent du sommet rend la poursuite de l’aventure nettement plus froide. Une chance que j’avais mon cache-cou! Je continue mon escapade à travers cette magnifique forêt de conifères donnant des allures du Grand Nord. Après une demi-heure de marche, j’arrive à une nouvelle intersection où cette fois j’admire le lac Kaël recouvert d'une légère couche de glace. On y trouve aussi un petit pont de bois à proximité construit dans un style que je considère « bûcheron ». Un décor typiquement canadien-français qui rappelle certains vieux films d’époque, comme les « Belles Histoires des pays d’en haut ».
En bifurquant vers la gauche sur le sentier « Côte à Monette» , il ne me restait que 500 mètres à marcher pour



atteindre le grand mur d’escalade. Ce sentier est toutefois plus étroit et parsemé d’embûches. Il y a beaucoup de racines et de roches pointues qui dépassent de la surface du sol. Il me fallait être un peu plus sur mes gardes! Je prends une petite descente et j’arrive finalement au mur d’escalade. Quel endroit majestueux! Les rayons de soleil de la fin d’après-midi créent des jeux de lumière et de couleur mystérieux. Je trouve fabuleux que l’on ait pu découvrir des lieux comme ceux-ci qui permettent à plusieurs passionné.es d’escalade d’exercer leur sport préféré dans un lieu naturel si époustouflant.
J’ai profité de cet endroit au maximum. Dans ce ravin, je me sentais comme dans un genre de cocon, à l’abri des bruits de la civilisation. Je pouvais enfin contempler la nature à fond. Une évidence m’est rapidement venue à l’esprit, cependant. En montagne, il commence à faire sombre assez rapidement. Il fallait donc que je parte rapidement puisqu’il me restait à faire tout le chemin inverse. Une chose est sûre : j’ai passé un merveilleux après-midi dans l’un des endroits que j’aime le plus dans ma région.
Je veux terminer cette petite aventure en mentionnant la chose suivante : sans la cartographie de sentiers, ce merveilleux rapport au territoire que je viens de vous décrire n'aurait été possible. Sans cartes, nous serions privé.es de ces espaces naturels qui nous ramènent si souvent à l’essentiel. La cartographie nous permet de

découvrir de nouveaux endroits comme ceux-là, mais aussi de les répertorier pour qu’ils puissent servir aux générations futures. Et ces dernières les redécouvriront dans leurs nombreuses aventures qui auront débuté par une carte.
Bibliographie
Dufour-Laperrière, N. (2019). La carte, l’histoire et le territoire : cartographie et mémoires dans une pratique photographique de paysages québécois. [Mémoire de maîtrise, Université du Québec à Montréal]. Archipel UQÀM. https://archipel.uqam.ca/13855/1/M16470.pdf
Loïzzo, C. & Tiano, C. (2019). Chapitre 1. Des environnements arctiques extrêmes aux équilibres fragiles. Dans : C. Loïzzo & C. Tiano (Dir.), L'Arctique: À l'épreuve de la mondialisation et du réchauffement climatique (pp. 21-33). Paris: Armand Colin. https://www-cairn-info.acces. bibl.ulaval.ca/l-arctique--9782200627652-page-21.htm
Mericskay, B. & Roche, S. (2011). Cartographie 2.0 : le grand public, producteur de contenus et de savoirs géographiques avec le web 2.0. Cybergeo: European Journal of Geography, science et toiles . Document 552. https://doi.org/10.4000/cybergeo.24710
Tison, M. (2017, 29 novembre). La carte papier résiste au GPS. La Presse +. https://plus.lapresse.ca/screens/ f74eca60-2d1e-490c-a6de-6c7f09d224e2__7C___0.html
Vagues et courants
Ces textes sont issus d’un journal tenu durant l’année 2023.
Par Florence Bordeleau, journaliste multiplateforme
1er janvier 2023 - Innsbruck C’était une pièce très belle dans laquelle Paul était parfaitement à sa place, assis, comme ça, le dos droit et les jambes croisées, sous sa robe de chambre grise en peluche. Ses yeux mi-clos, encore tout empâtés de sommeil, disaient bonjour malgré la fatigue. Les plafonds étaient très hauts, le découpage de la peinture, à la jonction entre ces derniers et les murs, mal fait ou vieux. Ces mètres de plâtre étaient habillés par des dizaines et des dizaines de tableaux hétéroclites tant par le thème que la forme, le médium, les couleurs. Ce bazar créait ici l’unité propre aux maisons vivantes. Paul était assis sur une chaise en cannage nid d’abeille style mid-century, ses coudes reposaient sur la table de bois massif, qui elle, se tenait sur un plancher de bois franc qui craquait au moindre mouvement de l’air. Sur la table avec les coudes il y avait un panettone importé d’Italie, encore tout emballé dans un papier de soie bleu profond tenu par une petite ficelle de jute naturelle – question de bien tenir le tout en place. Il y avait aussi nos cafés Nespresso, ceux que l’on fait avec les capsules, et des beignets autrichiens raffinés à l’abricot.

Ceux-là étaient entamés. Leur cœur de confiture orangée se répandait sur le carton d’emballage. Nous avions du sucre en poudre sur les doigts. À la télévision : le concert du Nouvel An de Vienne, diffusé partout à travers l’Europe. « Il est écouté par plus de cinquante millions de foyers », nous a chuchoté Paul (il fallait chuchoter pendant que les musiciens jouaient). Amélie est venue nous rejoindre après un moment. Cornelia dormait encore, comme plusieurs autres, mais ça me semble plus important de mentionner Cornelia, parce que c’est elle qui avait insisté la veille pour que l’on vienne écouter le concert au réveil, et finalement elle ne s’est pas levée à temps. C’est dommage, mais la vérité c’est que cela concorde très bien avec l’idée que je m’étais rapidement faite de cette femme, la maîtresse de cette maison, grande et pleine de choses, mais vide de gens, du père, mort, je crois, et des fils, ailleurs la plupart du temps. J’intitule cette entrée de journal, sans originalité : « Le Nouvel An à Innsbruck ».
2 janvier 2023 – Pully
En bas de chez moi, il y a un lac, un très grand lac, et de l’autre côté, il y a des montagnes d’où coule une source d’eau pure qu’on embouteille. C’est la fameuse eau de la source Cachat, qui se crachote dans l’auge en céramique de la petite ville d’Évian-les-Bains. En bas de chez moi donc le lac est là, très-bleu et très-limpide, il s’agite parfois quand il fait mauvais (il devient alors beau comme une mer, le petit chemin de dalles inégales qui le borde s’inonde au bruit des vagues immenses qui se fracassent, et des grèbes huppés qui s’amusent). Souvent, à cette saison, l’humidité produite par le lac crée une zone de brouillard épais qui bouche les yeux. Il y a quand même dans ces moments-là une beauté certaine, qui ne se fatigue pas de nous laisser lui ramer après.
Aujourd’hui, la température est clémente, c’est-à-dire que l’on peut voir les contours des montagnes qui accouchent continuellement l’eau de la source Cachat. Ces montagnes expliquent silencieusement, par leur simple présence, ce qu’est la notion esthétique de « sublime ». Le soleil permet de remarquer que les montagnes sont redevenues noires, leur bonnet blanc a fondu, nous sommes en janvier et il fait trop chaud, inutile de porter de la laine de mérinos, de cachemire ou de neige. Cette nudité donne aux sommets un air terrible qui devait réjouir des écrivains comme Hugo et ses amis. Je pense à Emma Bovary et je me demande si cette vision lui aurait plu. Je pense aussi à la petite et la

grande Pauline Quenu (parce que la réponse change quand on vieillit) et me demande si cette vision lui aurait plu. Aujourd’hui, je regarde le Léman et je me dis que je pourrais, tiens, pourquoi pas, briser mon ennui en allant le photographier, en allant me promener et regarder à travers une lentille les montagnes et l’eau transparente et me dire : « Je pense qu’Emma Bovary aurait aimé cet endroit si et seulement si elle était avec Rodolphe Boulanger. Je pense que la petite Pauline Quenu aurait aimé cet endroit si elle pouvait galoper sur ces berges de galets avec Lazare, et la grande si Lazare pouvait y faire une invention qui lui permettrait d’arrêter de penser à la mort. » Ces conclusions me déplaisent.
La vraie vérité, de toute façon, c’est simplement que je veux voir les cygnes, les centaines de cygnes qui habitent ce lac de leurs plumes blanches et de leur méchanceté de grand oiseau, et ne plus penser à rien d’autre qu’à leur vie sauvage, dangereuse et certaine.
4 janvier – Pully
« Cuba coule en flammes au milieu du lac Léman pendant que je descends au fond des choses », voilà une phrase d’Aquin que j’avais étrangement oubliée jusqu’à hier, peu après que nous soyions revenu.es de notre immersion linguistique d’une semaine, qui a occupé notre temps des fêtes européen. Suisse allemande, Bavière, Autriche :

assez pour réviser la maigre grammaire et le petit lexique appris dans le cours que nous avons suivi cet automne.
Je reviens à Aquin : c’est la nostalgie du Québec qui m’a saisie, en arrivant « chez moi » à Lausanne après ce petit périple. Chez soi peut-il se résumer à un point de départ auquel on retourne ? Je me suis d’abord sentie soulagée (ah, je reviens dans mes affaires!) et très rapidement assez triste (ah, mais ce ne sont pas toutes mes affaires, ma famille, mes ami.es). Mon Cuba à moi, c’est ma petite révolution personnelle, mon désir d’aventure qui peu à peu est avalé par cet immense lac qui me regarde de son œil cyclope tous les jours et me fait comprendre que tout exotisme s’essouffle. Et je descends, je cherche un petit quelque chose, en acceptant avec résignation ce que le Léman me prend. Je vois les cygnes. Ils peuplent les berges du lac avec leurs masques graciles qu’on associe sans erreur au ballet classique : une grande rigueur, un athlétisme et une beauté à couper le souffle. Les cygnes sont maîtres de leurs eaux. Il est impossible d’y plonger s’ils ne l’acceptent pas. Leurs heures d’ouverture sont arbitraires et cruelles. Je me suis souvent baignée avec eux ; j’ai aussi été chassée par eux. Ils habitent.
En hiver, les plumes des cygnes sont jaunes. Probablement parce qu’ils dorment dans des trous de bouette ou sur des nids vaseux.
17 janvier – Pully
Depuis quelques jours, je fais de l’insomnie. J’aimerais dire « je suis insomniaque » parce que ça sonne, je trouve, assez joliment comme mot : c’est un mélange d’insoumission et de démon (intérieur), joint par le son étrange que produisent ces deux consonnes occasionnellement jointes, celui du « mn ». On se demande si c’est le démon qui est insoumis ou si c’est nous qui tentons, dans les vapes d’un sommeil impossible, à nous débarrasser de lui, à refuser de nous soumettre à celui qui nous refuse ce besoin tendrement vital de dormir. Mais je ne pense pas que les vrai.es insomniaques seraient prêt.es à m’octroyer le titre, car c’est juste trois mauvaises nuits juxtaposées que je viens de passer.


Heureusement, au moment où j’écris ces lignes, il neige. Je dis ça, parce que la cause de ce spleen qui va et vient sans cesse depuis mon arrivée ici est peut-être mon sentiment d’être étrangère sur ce sol helvétique qui devrait pourtant me faire sentir chez moi, qui fait beaucoup pour me faire sentir chez moi, ou du moins pour m’émerveiller. Les paysages sont splendides, la culture très agréable à découvrir, les rencontres que j’ai faites très précieuses.
Je repense souvent à ma visite, en septembre, dans cette vieille boutique de broderie. Pour me désennuyer (les journées passent parfois lentement), j’avais décidé de commencer ce hobby (qui ne m’a finalement pas accrochée). À la caisse, la dame remarque mon accent, demande d’où je viens. Je réponds, et demande d’où elle vient, elle, car son français, bien que très bon, la trahissait. « Je suis Russe. Mais n’allez pas croire que j’adhère à ce qui se passe là-bas, je suis partie il y a quinze ans déjà, quinze ans que je tiens boutique, que j’apprends le français, que je cherche à me détacher de ce vaste pays. » Et j’ai vu dans cette femme une partie de moi, de ce sentiment que j’avais à ce moment-là déjà. Le malaise de ne pas tellement aimer ce pays d’accueil qui pourtant fait tout pour qu’on l’aime. La certitude – vicieuse – que ce lieu ne remplacera jamais celui d’où l’on vient. J’expérimentais, pour la première fois de ma vie, le vague sentiment
d’appartenir à la communauté des expatrié.es (tout en ayant la chance inouïe de l’être par choix). Cette femme, bien que russe (je mesure l’écart immense entre cette culture, unique, et la nôtre, occidentale au possible), me semblait soudainement plus sympathique qu’un.e Suisse, dont la culture est bien plus similaire à la mienne (il neige tellement! C’est très étrange, car les flocons sont énormes, mais tellement gonflés d’eau qu’ils disparaissent dès qu’ils entrent en contact avec quoique ce soit : toit, pelouse, oiseau. Mais vraiment, c’est une quantité folle de points blancs qui me masque la vue du Léman à la fenêtre). Bref, je fais l’expérience de l’altérité et du déracinement, voilà ce que je fais, et voilà ce qui, je pense, perturbe mon humeur au point de me faire passer de longues nuits à me tourner d’un côté et de l’autre sous les couvertures. Je suis néanmoins heureuse de le vivre : je comprends un tout petit peu mieux les auteurs et autrices comme Maryse Condé, qui ne se sent chez elle nulle part, ou Socrate, qui a choisi la mort par-dessus l’exil. C’est un sentiment difficile qui vaut cependant la peine d’être vécu, je crois, parce qu’il nous fait comprendre ce que c’est que la maison, ce que sont vraiment ces ami.es cher.ères qui nous entourent.
21 mars 2023 – Au sentier du bord du lac, quelque part vers Vidy
En passant par ici (parce que je ne fais que passer), je me dis souvent deux choses : (1) une piste cyclable partagée avec les piéton.nes (ou un trottoir partagé avec les cyclistes), c’est très énervant ; (2) une chance que ça existe.
du fleuve pour s’installer au lac de façon permanente. Comment envisager vivre dans un tel endroit, résolument circulaire, loin de tout, opaque, en d’autres mots divertissant pour quelques périodes ponctuelles, mais ennuyeux pour le reste ?

Ce chemin constitue un accès tellement privilégié à la nature, à ce lac que j’ai mal aimé en arrivant, alors qu’à présent l’idée de m’en éloigner dans quelques mois me brise le cœur. À l’Université Laval, on nous apprend par la lecture du Survenant (1945) de Germaine Guèvremont que les lacs au Québec sont des endroits clos sur eux-mêmes, stériles et niais, par opposition au fleuve, large, salé dès Tadoussac, ouvrant vers le monde, vers l’Europe, la mer, la connaissance. J’ai grandi sur le bord du Saint-Laurent, dans une maison verte. J’ai passé mes étés sur le bord d’un lac, dans un chalet jaune. Ces quelques mois de vacances me sont toujours apparus comme une bulle hors du temps, durant laquelle mes joies étaient liées strictement à l’univers du lac. J’oubliais, à tous les étés, l’idée même de ville, à laquelle je ne retournais sous aucun prétexte. Je ne voyais jamais les clématites mauves en fleurs grimpant sur la façade verte. Mes ami.es d’été étaient différent.es, mes passe-temps, mes lectures. Je jouais avec Isabelle, les têtards, les BD de mon grand frère.
J’en ai voulu à mes parents quand ils ont vendu la maison
Le Léman m’est d’abord apparu ainsi : il est grand, oui, mais ça reste un lac. Il est superbe, oui, mais ses eaux sont captives de montagnes magnifiques, il ne s’agit pas vraiment d’une voie navigable, où est la vraie mer ? Je me sentais claustrophobe, prise dans ces terres vaudoises qui n’étaient pas les miennes. Mais à passer sur ce chemin parfois bétonné, parfois sablonneux, parfois pavé, parfois vide et parfois bondé, j’ai appris à aimer ce lac, et plus largement le concept de lac. J’ai réfléchi.
Dans Bâtons à messages / Tshissinuashtakana (2009), Joséphine Bacon explique à ses lecteur.ices le réseau que constituent les lacs, et les voies de communication qu’ils représentaient pour les membres des Premières Nations du Québec. En hiver, on les traversait en raquettes comme une clairière, et on y plantait des bouts de bois suivant certains angles, pour donner aux prochain.es à y passer des nouvelles: « nous traversons une famine / nous avons tué et pouvons partager / l’un des nôtres est malade / les Innus arrivent ». Je réalise que c’est une idée héritée tout droit du colonialisme que de valoriser le fleuve au détriment du lac. Le lac permet tout autant le transport de connaissances. Il est plus local, se fait confiance à lui-même. Il n’a pas tellement besoin du lointain étranger, mais sait parfaitement lui parler.
C’est l’eau qui est la clé : en autant que j’habite proche de l’eau. Toujours différente, elle est calme ou agitée, elle incarne un paysage actif qui n’est jamais pareil et qui permet de faire voyager le son, loin.
À chaque jour ou presque, je passe ici et je m’émeus devant cette capacité que le lac a de n’être jamais le même, d’être infiniment nouveau.
8 avril 2023 – Pully Lessivée par une journée de ski de randonnée vers Siviez. Plan initial : Rosablanche. Finalement, on a bifurqué dans la combe du Ferret, au-dessus de la cabane Saint-Laurent (qu’on n’a pas vue). Conditions incroyables.
Fondue moitié-moitié devant la petite chapelle SaintBarthélémy, en face du lac de Cleuson. Un vrai délice cuisiné dans les casseroles de l’armée suisse (Robin les a gardées à la suite de son service militaire obligatoire, il y a quelques années).
Avec, aussi, Fabia et Alexi.

22 mai 2023 – Cannes
Je suis au Festival international du film de Cannes avec Ermance, Julie, Lliana, Abel, Emma. Les logements sont hors de prix, on dort au camping et on mange des pâtes dégueulasses (vêtues de nos robes de soirée et assises sur un poncho judicieusement posé dans la boue). Il pleut sans cesse. Simple comme Sylvain nous a fait pleurer comme des malheureuses hier. Ce matin, en ville, une femme boiteuse se promenait dignement en sandales et avait l’arrière du pied en sang : c’est qu’il faut souffrir pour être belle, vous auriez dû la voir hier soir sur le tapis rouge avec ses escarpins à quatre mille euros. J’espère pouvoir me baigner demain.
25 mai 2023 – Forêt communale de Tende (la journée de l’agneau)
C’est l’entre-saison : les sentiers ne sont pas tout à fait praticables, la neige subsiste par endroits. J’ai atteint hier le plus haut point, en altitude, de ma randonnée s’échelonnant sur quelques jours, et la face nord du col était tout enneigée. J’ai eu un peu peur, je devais traverser les plaques de neige sans réfléchir, rapidement, en espérant qu’on ne retrouve pas ma dépouille sous des restes d’avalanche à la fin du printemps. Arrivée à mon point de campement, dans la plus grande solitude et son

silence, j’ai rapidement été détrompée par un bouquetin. Il était perché sur des rochers lisses et me regardait, immobile.
Aujourd’hui, après une longue montée sous la brume, j’ai entendu un bêlement, si étrange en ces circonstances, si étonnant. En m’avançant, j’ai vu le mouton jusque-là égaré. Alors il (nous) ne l’était (ne l’étions) plus. Nous avons parcouru un bout de chemin ensemble, il avait les oreilles penchées vers sa nuque et trottait en avant de moi. Parfois, il s’arrêtait pour me regarder et bêler. Je lui parlais moi aussi :
« Es-tu le gardien du Monte del Agnello, mouton, es-tu un fantôme de ce château enfoui sous le roc de cette montagne anciennement italienne ? Est-ce toi ou moi qui est le guide de l’autre ? Me comprends-tu, me comprends-tu ? »
25 août 2023 – Ouasiemsca
Ces feux qui consument notre province sont invisibles ici, sur la Ouasiemsca, ce qui est assez bon signe, car il y a quelques semaines, un mois sans doute, on les ressentait sur sa rivière jumelle, l’Ashuapmushuan. Jeanne y était et en a rapporté des photos d’un sépia naturel, étonnant. Comme il paraissait changé, ce décor de plages et
d’épinettes, sous cette lentille de fumée incandescente ! Depuis notre arrivée ici, nous avons été plus que bénies par une météo fraîche, mais pas froide, oscillant entre un soleil d’automne et des nuages d’un bleu merle qui donnent au ciel cette menaçante profondeur qui me plaît tant.
C’est un très étrange sentiment que de revenir « chez soi» après avoir passé une année complète à tout mettre en œuvre pour se sentir chez soi ailleurs – et y être fort heureusement, en bonne partie, parvenue. Je me suis intégrée à quelques cercles, ai profité des bienfaits de la culture helvétique, ai exploré le territoire par tous les moyens possibles comme la marche, le ski, le train, le vélo, l’auto ; j’ai essayé de me détacher de mes parents et ami.es pour pouvoir profiter pleinement de ma vie nouvelle (car comment profiter d’un temps et d’un lieu si notre cœur nous retient sans cesse ailleurs ?). Ainsi maintenant je dois revenir vers toutes ces choses très précieuses, mais qui, sous l’effet de ma persévérante volonté, avaient

progressivement pris une place secondaire dans ma vie, cédant le pas à la nouveauté ambiante. Et pourtant mon retour à Québec n’a rien de terne : ces visages connus m’amènent du Témiscouata à Gaspé, au Lac Saint-Joseph, à Ottawa, ici. Mais aucune excitation, outre les premiers jours. Un énervement, plutôt. Une grande agitation étourdissante, presque paralysante. Je ne pensais pas que le retour aurait ce goût étrange, que les douces courbes de nos rivières, que l’étude de leurs cartes connues aurait cet effet un peu décevant. Je me ferai un devoir de réapprendre à lire les lignes qui nous permettent de les descendre en canot, à naviguer leurs rapides jaunes et bruns.
Il y a par ici une odeur de bois qui brûle et de ramen au kimchi.

ÉLECTIONS GÉNÉRALES ANNUELLES
IMPLIQUE- TOI !
COLLÈGE ÉLECTORAL
Snacks Café Billets de bus Chargeurs...
LUDIQUE
Interlude
Jaune Banane par Fred
Douce rencontre entre la noix de coco antillaise, la nostalgie de l'analogique, la banlieue des années 60 et 70, le crépitement des œufs dans la poêle, des vibes space age et l’odeur du tabac. Préparez-vous pour ces fous sons ultras perchés.
Drinks by the Sea - The Mauskovic Dance Band
Sunset Sound - Pachyman
White Sands Pt 1 - The Fabulous Three
Endless Dave - L’éclair
Mi Malphino 82’ - Malphino
Taxi to Baltimore Dub - Scientist
Bam Bam - Sister Nancy
Brown Line - Roger Rivas
Sapato Mole - Quarteto Em Cy
Return of the Super Ape - Lee “Scratch” Perry, The Upsetters
On pourrait presque manger dehors par Emmy


En quatrième secondaire, je rencontre le fragment littéraire. Mon enseignante nous fait lire un extrait de Première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerm. On lit « Le couteau de poche » et « Le pull d’automne ». C’est à cause de ça, qu’aujourd’hui, j’ai un opinel dans un étui de cuir, dans mon sac. Quelques années plus tard, au début de mon bac, je défilais les rayons d’une bouquinerie de la rue Saint-Jean à la recherche de rien du tout. Et je suis tombée sur le livre. Ça m’a fait une grande joie; je retrouvais quelque chose que j’avais oublié. Je l’ai lu la journée même. J’ai accroché sur « On pourrait presque manger dehors ». Delerm y écrit : « "On pourrait presque manger dehors." La phrase vient toujours au même instant. Juste avant de passer à table, quand il semble qu’il est trop tard pour bousculer le temps, quand les crudités sont déjà posées sur la nappe. [...] C’est bon, la vie au conditionnel, comme autrefois, dans les jeux enfantins [...] Une vie inventée, qui prend à contre-pied les certitudes. »
L’amour c’est comme un jour - Charles Aznavour
Coucher de soleil - Yves Duteil
Mon amie la rose - Françoise Hardy
Il y a - Vanessa Paradis
Une histoire de plage - Brigitte Bardot
Elle est d’ailleurs - Pierre Bachelet
C’est toute une musique - Monique Leyrac
Tous les bateaux, tous les oiseaux - Michel Polnareff


LE IMPACTBALADOCAMPUS

Pour toutes les saisons - Par Mégan
Vivre au rythme des saisons ou prendre le rythme de la saison ? Cette playlist peut s’écouter été, comme hiver, comme printemps, comme automne. Parce qu’ici, il y a bien quatre saisons distinctes, mais la musique s’écoute à longueur d’année.
Libre - Météo Mirage
Glyphes - Perséide
Pauline à la ferme - Philippe B
Nos saisons - Maude-Cyr Deschênes
Air de plastique - Bon Enfant
L’Habitude - Rau_Ze
Avant Elle - Aliocha Schneider
Il n’y a rien que je ne suis pas - Arielle Soucy
Envie d’être - Etienne Dufresne
Julie-Anne - FilliE
Heureux d’un printemps - Par Antoine


Tout pour faire fondre la neige. Un mélange éclectique pour bien commencer les matins de plus en plus ensoleillés et apprécier les premières chaleurs de l'année. (Tout sauf du criss de Paul Piché.)
Lighten up - Parcels
Silmät kiini ja kädet ristiin - Teksti-TV 666
Take it Easy - Eagles
Don’t stop - Foster the People
Mountain at My Gate - Foals
My Alone - Virgin Kids
Kool Aid - Royel Otis
Emerald - Astrachan
Pretty Pimpin - Kurt Vile
Under the Pressure - The War On Drugs


Il y a mille façons de vivre Québec. Il y a tout autant d’expériences de la ville que de gens qui la traversent ou y habitent. Parmi nous, dans l’équipe d’Impact Campus, certain.es y sont né.es, d’autres sont arrivé.es à l’âge adulte et certain.es ont dû quitter Québec pour pouvoir mieux y revenir, mais nous sommes toustes habité.es par certains lieux. Ces lieux ne sont pas forcément liés entre eux, on ne les fréquente peut-être pas toujours beaucoup, mais ils racontent un peu tous quelque chose.
Par l’équipe d’Impact Campus
Retrouvez les endroits préférés de l'équipe Impact Campus !




Horoscope Printemps2024
Béliers
Il serait temps de vous réveiller, Béliers ! La vie est un train qui passe devant vous sans s’arrêter ! En ce printemps 2024, ouvrez grand les yeux et osez avancer, vous êtes capables de tout ! Puisez votre force dans les astres et alignez vos chakras sur vos rythmes cosmiques, vous serez vite ragaillardi.es. Et puis, si d’aventure vous rencontrez un problème, étudiez bien la situation et contournez-le; il n’y a jamais de ravin sans pont !
Balances
L’arrivée du printemps vous apporte son lot d’énergie. Vous vous sentez en forme, c’est le moment de saisir les opportunités. Toute cette nouvelle énergie s’accompagne de réussite. Une attitude positive attire le positif, c’est la loi de l’attraction. Mais ne laissez pas tout ce carburant vous épuiser ! Sortez, allez en nature, profitez du grand air pour vous ressourcer, méditer, rêver. C’est le temps de prendre le temps de réfléchir.
Taureaux
Vous savez ce qu’il y a de mieux pour vous. Les décisions qu’il faut prendre, il faut juste les prendre. Rassurez-vous, personne ne vous laissera dans l’embarras, vous êtes entouré.es. Étonnamment, le travail pourrait être un refuge agréable. Le printemps vous apportera de nouvelles expériences, tentez-les avec quelqu’un, vous vous sentirez plus en confiance.
Gémeaux
Le printemps-été 2024 sera le moment pour vous, chèr.es Gémeaux, d’habiter votre tête et votre corps, parce que finalement, ils ne font qu’un. Ça vous aidera à être là quand vous êtes là plutôt qu’être là-bas quand vous êtes là. Soyez indulgent.es avec les autres, la plupart des choses découlent de bonnes intentions. Respectez vos engagements, vous vous sentirez gratifié.es.
Scorpions
L’hiver est fini : les insectes endormis émergent des tendres sous-sols tempérés pour regagner la surface de la Terre, avec toute sa bienfaisante lumière, mais aussi ses imprévisibilités. Cette saison vous appartient, ô seigneur.es des insectes : elle signe l’arrivée du renouveau après la léthargie habituelle des mois plus froids. Le printemps 2024 vous amènera, avec les positions favorables du Soleil et d’Uranus dans les premières semaines d’avril, un regain d’énergie du point de vue professionnel. N’hésitez pas à montrer le dard et à adopter une position offensive au travail. S’il y a bien un.e leader positif.ve dans l’équipe, c’est vous ! Proposez l’innovation, qu’il s’agisse de l’ajout d’un code de couleur à vos post-its collectifs, ou de l’achat d’une nouvelle machine turbolaser pour vos expériences sur la fibre optique — on vous suivra.
Sagittaires
Ah le printemps ! La saison des amours, du soleil et de la fonte des neiges ! Sagittaires, vous allez vous régaler; entre rencontres amicales (et plus, qui sait ?), nouveaux projets, et préparation de votre futur road trip pour la semaine de lecture, vous papillonnez dans tous les sens ! N’hésitez pas à prendre votre courage à deux mains pour vous lancer pleinement dans ces nouvelles expériences et n’écoutez que d’une oreille celleux qui vous disent de rester dans votre zone de confort. Sagittaires, n’ayez pas peur et laissez-vous porter, aucun tsunami à l’horizon, vous pouvez surfer sur la vague en toute confiance.
Cancers
Vous avez un goût de liberté et vous essayez d’être partout, tout le temps, avec tout le monde. Votre trop-plein d’énergie pourrait s’avérer dangereux. Prenez un moment de recul, reposez-vous, pour mieux repartir du bon pied pour tous vos projets en cours pour la saison. Revenez à l’essentiel, repensez vos relations avec vos proches, repensez votre carrière. Est-ce que cela vous procure du bonheur ? Si la réponse est négative, faites le ménage dans votre vie. Vous allez être plus zen après, promis.
Lions
Ah ! Majestueux.euses Lions… Relâchez la pression d’un cran ! Permettez-vous de profiter et de vous laisser aller… mais pas trop ! Vous devrez aussi établir vos limites, mettre de l’ordre dans votre entourage, mettre les choses au clair pour raviver ces liens qui n’en seront que plus forts. Dégourdissez-vous, flirtez avec le jour et la nuit, et retrouvez votre joie d’autrefois. La bienveillance vous permettra, ultimement, de retrouver votre éclat.
Vierges
Concentrez-vous sur le bien-être et la détente ! Lâchez prise sur la perfection, car la vie est pleine de petits défauts charmants. Prenez soin de vous-même, que ce soit à travers une routine de bien-être, des escapades spontanées ou simplement en appréciant les petits plaisirs du quotidien. N’oubliez pas que, parfois, la meilleure façon de trouver l’ordre dans le chaos est de laisser un peu de place à l’imprévu. Profitez de la saison pour vous épanouir dans la simplicité !

Capricornes
S’excuser, ce n’est pas reconnaître qu’on a tort, c’est reconnaître qu’on a blessé quelqu’un. Gardez ça en tête quand vous franchirez les jours de dégel; la rancune ne ferait que ternir votre printemps. Une fois la tête plus légère, vous aurez envie d’essayer de nouvelles choses, et allez-y ! Inscrivez-vous au cours qui vous fait envie, partez seul.es un week-end, lisez cette très grosse brique. Appelez les gens que vous ne voyez pas souvent, l’amitié et la famille pourraient vous donner beaucoup de joie; et c’est peut-être juste ça le printemps.
Verseaux
Ce printemps sera l’occasion de vous mettre à la tâche et de vous émanciper, cher.ères Verseaux, d’enfin vous faire papillons et de déployer vos ailes. Il faudra vous retrousser les manches et vous salir les mains. Bousculer l’ordre établi vous paraîtra nécessaire, même si cela pourrait exiger quelques sacrifices. Ce ne sera pas chose facile, mais rassurez-vous, vous n’êtes pas aussi fragiles que vous le croyez. Faites-vous confiance, gravissez la montagne un pas à la fois, puisez dans la douce et chaude magie du printemps pour vous hisser au sommet, sentez son étreinte, la montée n’en sera que plus palpitante. Finis, le doute et la monotonie : l’heure est au dépassement et à l’exaltation. Allez hop ! Verseaux !
Poissons
Ce printemps, les étoiles vont vous pousser à plonger dans de nouvelles aventures. Laissezvous emporter par le courant de la créativité. Que ce soit dans l’art, la musique ou même simplement en explorant de nouveaux endroits, c’est le moment idéal pour laisser libre cours à votre imagination. N’ayez pas peur de vous aventurer hors de votre zone de confort — qui sait quel trésor vous pourriez découvrir au fond de l’océan des possibilités !


PLUS DE 25 ANS DE VULGARISATION SCIENTIFIQUE
Créée en automne 1997 par le Comité Exécutif de l'ÆLIÉS, la Chaire Publique contribue à mettre en valeur l’avancée des connaissances des divers domaines d’enseignement et de recherche de l’Université Laval
Une fenêtre ouverte sur le savoir
L a C h a i r e p u b l i q u e c o n s t i t u e l a p r e m i è r e b r a n c h e c u l t u r e l l e d e l ’ A E L I É S E l l e o r g a n i s e u n e s é r i e d ’ é v é n e m e n t s d o n t d e s c o n f é r e n c e s t h é m a t i q u e s p o u r l e b é n é f i c e d e s m e m b r e s d e l ’ A E L I É S e t d e l a c o m m u n a u t é u n i v e r s i t a i r e e n g é n é r a l e . E l l e v i s e a i n s i à m e t t r e e n v a l e u r l ’ a v a n c é e d e s c o n n a i s s a n c e s d e s d i v e r s d o m a i n e s d ’ e n s e i g n e m e n t e t d e r e c h e r c h e à l ’ U n i v e r s i t é L a v a l
Une véritable tribune sociétale
D e p u i s p l u s d e 2 5 a n s , l e c a l i b r e d e s é v é n e m e n t s o r g a n i s é s f o n t d e l a C h a i r e p u b l i q u e A E L I É S u n e v é r i t a b l e t r i b u n e s o c i é t a l e , a v e c e n t ê t e d ’ a f f i c h e , d ’ é m i n e n t s p e n s e u r s d e n o t r e t e m p s C e s g r a n d s d é b a t s e t p a r t a g e s a v e c l e s é t u d i a n t s d e 2 e t d e 3 c y c l e d e l ’ U n i v e r s i t é L a v a l s o n t a u c œ u r d e s p r é o c c u p a t i o n s c o n s t a n t e s q u e c o n n a i s s e n t n o s s o c i é t é s
e e
JOINDRE LA CHAIRE PUBLIQUE
Maison Marie Sirois 2320, rue de l'Université Université Laval Québec (Québec) G1V 0A6
Les activités de la Chaire publique
Événements scientifiques & culturels
D e s c o n f é r e n c e s t h é m a t i q u e s e t d e s o c c a s i o n s d e r e n c o n t r e s s u r l e s g r a n d s e n j e u x s o c i é t a u x a c t u e l s
Accompagnement en matière de vulgarisation scientifique
R e n f o r c e m e n t d e s c o m p é t e n c e s d e l a c o m m u n a u t é é t u d i a n t e d e l ’ U n i v e r s i t é L a v a l e n m a t i è r e d e v u l g a r i s a t i o n s c i e n t i f i q u e .
Appui aux associations et structures de l’Université Laval
A p p u i e t p a r t e n a r i a t s t r a t é g i q u e e n m a t i è r e d ’ o r g a n i s a t i o n d ’ é v e n e m e n t c u l t u r e l e t s c i e n t i f i q u e
chaire.publique@aelies.ulaval.ca www.chairepublique.com
+1 (418) 656 7190
/chairepubliqueneo
/Chaire Publique

ARTS ET LITTÉRATURE
Quotidiennes
ÉCOUTE LOCAL 25 ans de CHYZ
- Chéri.e J'arrive, 16h à 17h30
- Les Arshitechs du Son, 17h30 à 18h30
- Conduite Antisportive, 15h à 16h
- Les Affamé.es, 12h à 13h30
- Palmarès CHYZ (vendredi au dimanche),10h à 11h
Mardi
- L'art des Histoires, 10h à 11h30
- La Caméra Brisée, 11h30 à 12h
- Club Critique, 14h à 15h
- Punk Détente, 18h30 à 19h30
- Boisvert Radio, 21h à 22h
- Palmarès CHYZ (Vendredi au dimanche),10h à 11h
Jeudi
- La Lanterne, 13h30 à 14h
- Chilule Pilule, 21h30 à 23h
Samedi
- Sons de Cloches, 8h à 10h
- Le Ré-Show : Deuxième service, 11h à 12h
- Radio Futura, 13h à 16h
Diffusion sportive
- Hockey des Remparts de Québec
- Football du Rouge et Or
Lundi
- Cabaret du Crachoir, 11h à 12h
- Dans la Mire Climatique, 13h30 à 14h
- Écoute Local, 14h à 15h
- Têtes de Hockey, 18h30 à 19h30
- 10 Entre-nous, 20h30 à 21h30
- Fou de Sports, 21h30 à 22h30
Mercredi
- APRIORI, 10h à 11h
- On en Parle, 11h à 11h30
- Afrofuturiste, 13h30 à 14h
- La Tribune pour le Peuple, 14h à 15h
- 3600 Secondes d'histoire, 18h30 à 19h30
- Funk Connection, 19h30 à 21h30
- Fou de Sports, 21h30 à 22h30
Vendredi
- Balados d'Impact Campus, 11h à 12h
- Points de Vue, 13h30 à 14h
- Droit de Parole, 14h à 15h
Dimanche
- Le Ré-Show : Deuxième service, 11h à 12h
- An Mukeù Sits, 12h à 13h
- Radio Futura, 13h à 16h
- Le Monde d'Erik Arsenault, 19h à 20h
- LSDJ! Set, 21h à 23h
PALMARÈS 2024
Etienne Dufresne fait des efforts
Etienne Dufresne


à contrecoeur
Vincent Paul


Albédo
Totalement Sublime
Feux de joie
Marie Céleste
Moyen
jacob d'amour


À demain peut-être
Galaxie
À pied ou en char
Anaïs Constantin




Mea Silva
Émilie Laforest
Monstre
Douance
Épilogue
San James
Sorties et sélections
Par Frédérik Dompierre-Beaulieu, cheffe de pupitre aux arts




Broderie
– Marjane Satrapi - L’Association Quatrième de couverture : Chez les Satrapi, lors des fêtes de famille, lorsque le ventre est bien rempli et que les hommes font la sieste, les femmes se réunissent autour d'un samovar et pratiquent la ventilation du cœur, c'est-à-dire qu'elles échangent des anecdotes sur des thèmes comme l'amour, le mariage ou le sexe. Une vision de la place des femmes dans la société iranienne.
Noir deux tons
- Michel Lemieux et Sébastien Gagnon - Québec Amérique
Quatrième de couverture : Dans un quartier chic d’une petite ville au Lac-Saint-Jean, deux couvreurs de toitures s’immiscent un peu trop dans la vie de ses résidents semi-bourgeois. Une lutte des classes se met en place et ça pourrait mal finir. l'engagement.
Le marché aux fleurs coupées
– Sarah-Louise Pelletier-Morin – La Peuplade
Quatrième de couverture : Au détour d’un cheminement délicat et immatériel, Sarah-Louise Pelletier-Morin part à la recherche de l’essence de la fleur et confectionne un herbier poétiquement précis aux facettes multiples, tant intimes, biologiques, économiques, historiques que spirituelles. Déconstruisant la métaphore traditionnelle qui associe fleur et femme, elle fait le pari d’une façon autre d’être au monde, esquisse une poésie de soi et de la finitude du vivant. Entre l’humus de nos racines et l’haleine de vie qui nous porte, ce livre impose une écriture qui s’élève dans l’affirmation de sa force fragile.
Lait cru
– Steve Poutré – Alto
Quatrième de couverture : La ferme québécoise n’est ni verdoyante, ni paisible; elle est hantée. Par les disparus, les histoires de peur, les secrets de famille et les poussins morts dans leur coquille.
Parmi ces ombres, un garçon marche à la lisière des champs et des bois pour finalement franchir cette fine frontière, rejoignant corps flottants, acouphènes et cauchemars. Mais même hospitalisé, il continue d’arpenter le rang, de chercher ce qui, entre la servitude des humains et des bêtes, n’est peut-être pas perdu. Injectant une bonne dose de gothique dans le terroir québécois, Lait cru se boit d’une traite.
sélections littéraires



Tout le monde aime danser
– Cécile Gariépy et Chloé Rochette – Québec Amérique
Quatrième de couverture : Soumis aux règles de la performance et aux idéaux inatteignables, le mouvement, bien qu’il soit inné, a perdu depuis longtemps son caractère enfantin. Dans cet essai très personnel, Chloé Rochette entreprend de nous convaincre que bouger est d’abord un acte d’amour, instinctif et magique. Et que le corps en mouvement est une histoire qu’il faut apprendre à raconter autrement.
Culbuter le malheur
– Beata Umubyeyi Mairesse – Mémoire d’encrier
Quatrième de couverture : Un million de morts en trois mois. Des silences et des silences. Adolescente à l’époque, Beata Umubyeyi Mairesse a échappé au génocide. Elle offre dans ce double recueil les mots justes pour faire mémoire par une énonciation radicale de ce qui fut un désir puissant de vivre à présent, au présent. L’autrice fait danser les mots-pagaille, les mots-bataille, entre ici et là-bas, entre hier et demain pour inventer un imaginaire décolonisé pour les enfants du jour d’après.
Hors jeu
– Florence-Agathe Dubé-Moreau et Kim Kielhofner – Remue-Ménage
Quatrième de couverture : De plus en plus de femmes sont visibles dans le sport professionnel masculin. De spectatrices, cheerleaders ou conjointes d’athlètes, elles atteignent désormais les rangs de coachs, d’arbitres et même de directrices d’équipe. Est-ce un mirage ? Qu’en est-il exactement ? À partir d’une posture d’exception, celle de partenaire d’un joueur célèbre, mais aussi d’intellectuelle engagée parachutée sur un terrain de football à Kansas City, Florence-Agathe DubéMoreau déconstruit un à un les mythes entourant les femmes dans l’industrie. Haut lieu de reproduction des pires stéréotypes de classe, de race et de genre mais aussi lieu de résistance.

Nommer le vivant
– Mélilot De Repentigny – Leméac
Quatrième de couverture : En proie à des pensées suicidaires et à un mal-être récurrents, Myrique fait quelques séjours en psychiatrie. Iel en vient à porter attention aux autres patient·es, à écouter leurs vécus singuliers, puis à en tirer des portraits aussi lucides que bienveillants. Inspiré·e par la Flore laurentienne du frère Marie-Victorin et par ses propres explorations forestières dans le Basdu-Fleuve, iel développe le projet d’apprendre à nommer le vivant, avec toutes ses forces et ses failles, ses beautés et ses détresses, dans l’espoir d’éclairer les siennes.
SUGGESTIONS



Le règne animal – Thomas Cailley
Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce phénomène mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d'un nouveau genre, il embarque Émile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence...
Moi Capitaine – Matteo Garrone
Seydou et Moussa, deux jeunes sénégalais de 16 ans, décident de quitter leur terre natale pour rejoindre l’Europe. Mais sur leur chemin les rêves et les espoirs d’une vie meilleure sont très vite anéantis par les dangers de ce périple. Leur seule arme dans cette odyssée restera leur humanité...
Poor Things – Yórgos Lánthimos
Bella est une jeune femme ramenée à la vie par le brillant et peu orthodoxe Docteur Godwin Baxter. Sous sa protection, elle a soif d’apprendre. Avide de découvrir le monde dont elle ignore tout, elle s'enfuit avec Duncan Wedderburn, un avocat habile et débauché, et embarque pour une odyssée étourdissante à travers les continents. Imperméable aux préjugés de son époque, Bella est résolue à ne rien céder sur les principes d’égalité et de libération...

Zone of Interest
– Jonathan Glazer
Le commandant d’Auschwitz, Rudolf Höss, et sa femme Hedwig s’efforcent de construire une vie de rêve pour leur famille dans une maison avec jardin à côté du camp...
CINÉ 2024



Dune Deuxième Partie – Denis Villeneuve
Cette suite de Dune explorera le périple mythique de Paul Atreides alors qu’il s’unit avec Chani et les Fremen tout en préparant sa revanche contre les conspirateurs qui ont détruit sa famille. Devant choisir entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers connu, il s’efforce d’empêcher un terrible futur que lui seul peut prédire.
Iron claw – Sean Durkin
Les inséparables frères Von Erich ont marqué l’histoire du catch professionnel du début des années 80. Entrainés de main de fer par un père tyrannique, ils vont devoir se battre sur le ring et dans leur vie....

Furiosa, Une saga Mad Max
– George MillerCivil War – Alex Garland
Dans un futur proche où les États-Unis sont au bord de l'effondrement et où des journalistes embarqués courent pour raconter la plus grande histoire de leur vie : La fin de l'Amérique telle que nous la connaissons..
Alors que le monde s'écroule, la jeune Furiosa est arrachée de la Terre Verte des Vuvalini et tombe entre les mains d'une grande horde de motards dirigée par le seigneur de la guerre Dementus. En parcourant le Wasteland, ils tombent sur la Citadelle présidée par Immortan Joe. Alors que les deux tyrans se font la guerre pour la domination, Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves pour trouver le moyen de rentrer chez elle.
HMS Wager – une sombre histoire
de survie
Les noms des îles Wager, Byron, Smith, Hertford ou encore Crosslet, parsèment nos cartes modernes et, pourtant, très peu de navigateurs connaissent encore, à ce jour, leur signification. Elles furent baptisées à la mémoire du navire et de ses marins, victimes d’une tragédie au XVIIIe siècle. Soufflés par le vent glacial de la Patagonie, entourés par des eaux aux vagues monstrueuses, éloignés de toute civilisation, ces bouts de terres où rien ne pousse sont loin d’être paradisiaques. Si dans l’espace personne ne peut vous entendre crier, il en est de même sur ces rivages du bout du monde.
Par Camille Sainson, journaliste multiplateforme
David Grann, auteur de The Lost City of Z et Killers of the Flower Moon, tous deux adaptés au cinéma, vient récemment de publier un nouvel ouvrage : The Wager. L’auteur retrace méthodiquement le périple du HMS Wager, navire britannique qui fit naufrage en 1741 au large du Chili. Journaliste de profession, David Grann fait dans la précision historique — en atteste l’immense bibliographie à la fin de son ouvrage. Loin de vouloir s’inscrire dans le genre romanesque, il nous embarque au plus près de ces personnages oubliés par la postérité.
En 2019, afin de s’imprégner de l’histoire de ces malheureux naufragés, David Grann s’est rendu sur l’île Wager où il a pu observer les vestiges du navire. Encore aujourd’hui, elle respire la solitude, perdue à plus de 150 km des premières habitations chiliennes. C’est donc avec un souci du détail que l’auteur fait revivre le HMS Wager à travers les pages de son roman, sans pour autant se mettre lui-même en scène, mais en respectant un ton neutre et un point de vue extérieur - pour le coup journalistique.
« Je n'écris pas sur mon propre voyage, parce que je sentais que cela aurait été une intrusion. Pour autant, ce voyage a été essentiel dans toutes mes descriptions, et pour y insuffler de la vie ». (David Grann à l'Agence FrancePresse)
La tragédie du Wager est rythmée par tout un tas de péripéties : entre typhus et scorbut qui déciment rapidement l’équipage, le cinquantième hurlant du Cap Horn et ses vagues scélérates de trente mètres de haut, le naufrage, le cannibalisme et les mutineries, les évènements sont dignes d’un film hollywoodien !
« S'ils trouvent la bonne histoire, les gens aiment prendre des libertés. Je me dis, non !... Pourquoi prendrais-je des libertés ? C'est monstrueux, il y a tellement de choses qui se passent. Le plus dur, c'est de faire en sorte que le factuel ait l'air plausible ». (David Grann à l'AFP)
Le 14 mai 1741 à 4h30, le Wager heurte des rochers et commence à prendre l’eau. Le navire tente de se rapprocher de la terre et finit par s’échouer. 140 matelots s’installent à bord de canots et rejoignent l’île. Une fois à terre, leurs malheurs continuent : l’équipage doit faire face à un manque cruel de nourriture et au froid de cette région polaire. Un mois après la catastrophe, plusieurs hommes sont déjà morts de faim, de noyade, d'hypothermie et de blessures. Il faut donc trouver une solution pour s’échapper. Les marins s’accordent pour construire un radeau de fortune, mais pas sur la destination. Deux camps vont alors s’opposer ; celui du capitaine Cheap — qui veut à tout prix rejoindre Chiloé pour accomplir sa mission initiale (et sauver son honneur)—, et celui du canonnier John Bulkley qui souhaite rentrer en Angleterre. Alors que les actes de cannibalisme deviennent monnaie courante et que la tension monte, un coup de pistolet est tiré ; le capitaine s’est emporté contre un membre de l’équipage. Désormais coupable de meurtre, il se met à dos ce qui lui restait de partisans. John Bulkley profite de la situation pour fomenter une mutinerie : avec quatre-vingt-un matelots, il s’empare ainsi du radeau pour faire voile vers l’Angleterre le treize octobre. S’ils ne parviennent pas à traverser l’Atlantique, ils finissent malgré tout par rejoindre Rio Grande trois mois plus tard.





Pendant ce temps-là, les onze hommes restés sur l’île sont finalement secourus par un autochtone de la région. Trois d’entre eux, le capitaine David Cheap, John Byron et Alexander Campbell atteignent Chiloé en juin 1743.
Finalement, ce sont moins d’une quarantaine d’hommes qui parviendront à rejoindre l’Angleterre. Ils devront désormais confronter leurs versions des faits et s’accorder sur le récit de leurs aventures afin de sauver leurs honneurs et leurs vies face à l’Amirauté.
Digne d’un film hollywoodien, on vous disait ! Eh bien, il faudra attendre 2025 pour voir cette histoire adaptée sur grand écran par Martin Scorsese et son acteur fétiche, Leonardo DiCaprio !
On vous laisse sur les derniers mots du roman pour vous donner envie de le découvrir :

« À quelques pas de distance, vers l'intérieur des terres, plusieurs planches vermoulues, rejetées sur l'île par la mer voici plus de deux siècles, restent partiellement immergées dans un ruisseau gelé. Longues de cinq mètres et hérissées de gournables, elles proviennent de la carcasse squelettique d'une coque du XVIIIe siècle - celle du Wager ; navire de Sa Majesté. Rien d'autre ne subsiste de la lutte farouche qui eut lieu jadis à cet endroit, et rien non plus des rêves destructeurs des empires. » (Grann, 2023, p. 414.)
Références : Grann, D. (2023). Les naufragés du Wager, Les éditions du Sous-Sol.
France Info, Les Naufragés du Wager, l'incroyable histoire par David Grann, l'écrivain qui rend le factuel plausible, https://www.francetvinfo.fr/culture/livres/roman/lesnaufrages-du-wager-l-incroyable-histoire-par-david-grannl-ecrivain-qui-rend-le-factuel-plausible_6058047.html
Ces lieux qui nous habitent
Les lieux et les espaces influencent le cinéma, la littérature autant dans ce qu’ils racontent que dans la manière dont ils le font. La littérature scandinave ne serait pas ce qu’elle est sans les territoires qui la façonnent, Le seigneur des anneaux n’aurait rien de si emballant si ce n’était de la Terre du Milieu. Petite incursion dans l’étude des lieux et des espaces en littérature et au cinéma.
Par Emmy Lapointe, rédactrice en chef

La prémisse
Dans une conférence au Cercle d’études architecturales de 1967, Michel Foucault dit que si la hantise du 19e siècle était celle de l’histoire, celle du 20e siècle serait plutôt l’espace. « Nous sommes », dit-il, « à l’époque du simultané, nous sommes à l’époque de la juxtaposition, à l’époque du proche et du lointain, du côte à côte, du dispersé. Nous sommes à un moment où le monde s’éprouve, je crois, moins comme une grande vie qui se développerait à travers le temps que comme un réseau qui relie des points et qui entrecroise son écheveau » (Foucault, 2009, p. 23). Les penseur.ses du tournant spatial, desquel.les Foucault fait partie, s’interrogent sur les relations entre les espaces et les phénomènes sociaux, culturels et historiques, afin de tenter de répondre à ce sentiment postmoderne « de désorientation et de perte de repère » (Deschênes-Pradet, 2019, p. 13).
La suite du texte de Foucault s’attarde sur la notion d’hétérotopie, c’est-à-dire des espaces où les configurations spatiales habituelles sont suspendues ou inversées. On pourrait penser, par exemple, aux prisons, aux jardins, aux musées ou aux maisons de vacances. Ce sont des lieux qui, de par leur configuration spatiale particulière, viennent modifier les normes sociales ainsi que notre rapport au temps. Pas étonnant alors de voir la littérature et le cinéma s’emparer de ces lieux-là pour y ancrer leurs récits.
Parmi les autres travaux du tournant spatial, on retrouve ceux d’Edward Soja sur le Thirdspace (Soja, 1989). Soja a introduit cette idée dans son ouvrage Thirdspace : Journeys to Los Angeles and Other Real-and-Imagined Places (1996), où il cherche à transcender et à combiner les approches traditionnelles de l'espace (perçu comme physique et matériel) et de l'espace conçu (comme imaginé et planifié) avec une troisième dimension : l'espace vécu. Ce thirdspace est à la fois réel et imaginé, un espace où la réalité physique ainsi que celles des constructions sociales ou mentales se rencontrent et interagissent.
Pour Soja, le thirdspace est un espace de contestation, de conflit, mais aussi de potentiel et de possibilité. Il s'agit d'un lieu où les hiérarchies et les dichotomies peuvent être remises en question et où de nouvelles perspectives et expériences peuvent émerger. Le thirdspace est en constante évolution. Il reflète les complexités des sociétés urbaines contemporaines en offrant un terrain pour de nouvelles formes de résistance et d'émancipation. La notion de thirdspace, bien que pensée en dehors de la littérature et du cinéma, demeure au centre de plusieurs pratiques artistiques notamment celles des communautés racialisées, queer et féministes.
La géocritique
Il s'agit d'une méthode d'analyse littéraire qui met en avant l'étude des espaces géographiques en relation avec la littérature. Les premiers travaux présentés comme géocritiques ont émergé à la suite d'un colloque organisé par Bertrand Westphal à l'Université de Limoges, où il a introduit l'idée d'une « approche géocritique des textes ». Selon lui, cette approche permet d'examiner le rapport que les individus entretiennent avec les espaces dans lesquels ils vivent et se meuvent. Il propose un décentrement des analyses spatiales souvent égocentrées autour du point de vue des personnages ou de l'auteur.rice.
D'un point de vue méthodologique, la géocritique se caractérise par son double aspect géocentré et interdisciplinaire, s'ouvrant ainsi à d'autres disciplines s'intéressant à la question de l'espace, comme la géographie ou la philosophie. Le terme géocritique résonne avec l'idée de géophilosophie de Gilles Deleuze et engage diverses formations disciplinaires et discours culturels, incluant l'architecture, les études urbaines, le cinéma, la philosophie, la sociologie, la théorie postcoloniale, les études de genre, la géographie et la critique littéraire. La géocritique adopte une approche interdisciplinaire et géocentrée, en se connectant à d'autres disciplines et formes d'art qui s'intéressent à la question de l'espace.


Voici quelques éléments clés de la géocritique.
La multifocalisation
La géocritique nécessite l’examen de l’espace littéraire à partir de multiples points de vue. Cela peut inclure des perspectives endogènes (celles des Autochtones), exogènes (celles des voyageur.euses) ou allogènes (celles de celleux qui se sont installé.es dans un nouvel espace).
La polysensorialité
La perception de l’espace ne se fait pas uniquement par la vision, mais également par d’autres sens.
Stratigraphie
L'examen de l'impact du temps et de ses différentes strates sur la perception d'un espace est crucial en géocritique. Cela peut inclure l'exploration de la façon dont les événements historiques, les changements culturels, ou les transformations physiques affectent la représentation et la perception de l'espace.

Référentialité
Elle explore la relation entre le monde fictionnel et le monde réel. Elle s'interroge sur la manière dont l'espace représenté dans la littérature se rapporte au monde réel et comment ces interactions contribuent à la construction de l'espace littéraire.
Transgressivité
La géocritique examine la dynamique et le mouvement transgressif dans la représentation de l'espace, souvent marquée par des mouvements entre les espaces fictionnels ou réels ainsi qu’entre différentes représentations et perceptions de l'espace.
Intertextualité
La perception de l'espace est souvent médiatisée par d'autres textes et œuvres. L'intertextualité reconnaît que l'espace littéraire interagit avec d'autres espaces, qu’ils soient littéraires ou réels. La géocritique explore ces relations intertextuelles pour comprendre la représentation et la compréhension de l'espace.

Cartographies
La notion de cartographie littéraire est centrale en géocritique. L'auteur.rice fait la carte du monde, combinant la représentation de lieux réels et imaginaires. Cette cartographie peut servir à représenter un espace bien connu ou entièrement imaginaire.
La neutralité des lieux
Dans les études sémiotiques (l’étude des signes), plusieurs travaux, dont ceux d’Algirdas Julien Greimas, affirment que les espaces seraient neutres et que leur valeur serait donnée par l’intrigue. Des penseurs comme Henri Mitterand (Mitterand, 1986) et Jean Weisgerber (Weisgerber, 1978) considèrent pour leur part que bien que l'univers diégétique insuffle un sens aux espaces, ceux-ci traduisent toujours une topologie sociale. Dans son ouvrage L’espace romanesque, Jean Weisgerber écrit que l’espace fictionnel « n'est jamais que le reflet, le produit d’une expérience individuelle et, dans bien des cas, d’une tentative d’agir sur le monde » (Deschênes-Pradet, 2019, p. 29-30). Ces propos ne sont pas sans rappeler les idées de MerleauPonty pour qui les « espaces vécus, issus d’une spatialité subjective, précèdent les espaces objectifs, scientifiques, dans la compréhension intuitive de l’humain » (DeschênesPradet, 2019, p. 34), ou celles de Yi-Fu Tuan pour qui « un espace quelconque devient un lieu dès que nous le connaissons mieux et que nous lui accordons une valeur» (Tuan, 2006, p. 39).
Le cas du lieu-refuge
En 1957, un peu avant le tournant spatial, Gaston Bachelard fait paraître La poétique de l’espace, un essai philosophique et littéraire. Dans son ouvrage, il s’intéresse particulièrement aux espaces intimes et à leur capacité à évoquer des images poétiques et des rêveries. Pour Bachelard, l’espace intime est un espace vital. Il défend l’idée selon laquelle les lieux comme la maison, la chambre ou le grenier sont chargés de significations personnelles et collectives.
Quelle image de concentration d’être que cette maison qui se « serre » contre son habitant, qui devient la cellule d’un corps avec ses murs proches. Le refuge s’est contracté. Et davantage protecteur, il est devenu extérieurement plus fort. De refuge, il est devenu château fort du courage […] (Bachelard, 2020, p. 72).
Bien que l’ouvrage soit chargé en théories psychanalytiques, il n’en demeure pas moins que Bachelard, dans La poétique de l’espace, trace à l’encre pâle les contours du concept de lieu-refuge.
De son côté, Marc Augé, à la fin de Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, écrit :
Dans ses modalités modestes comme dans ses expressions luxueuses, l’expérience du non-lieu (indissociable d’une perception plus ou moins claire de l’accélération de l’histoire et du rétrécissement de la planète) est aujourd’hui une composante essentielle de toute expérience sociale. D’où le caractère très particulier et au total paradoxal de ce que l’on considère parfois en Occident comme le mode du repli sur soi, du « cocooning » : jamais les histoires individuelles (du fait de leur nécessaire rapport à l’espace, à l’image et à la consommation) n’ont été aussi prises dans l’histoire générale, dans l’histoire tout court. À partir de là, toutes les attitudes individuelles sont concevables : la fuite (chez soi, ailleurs), la peur (de soi, des autres), mais aussi l’intensité de l’expérience (la performance) ou la révolte (contre les valeurs établies) (Augé, 1992, p. 149).
Dans son mémoire sur le poète franco-ontarien Patrice Desbiens, Anthony Lacroix reprend les mots d’Augé afin d’attester, d’une part, de l’absence d’études sur les questions de lieux-refuges et afin, d’autre part, d'asseoir sa définition du concept. Pour Lacroix, un lieu-refuge serait « un lieu dans lequel un individu vivant une oppression sociale ou psychologique se sentirait momentanément à l’abri, pouvant s’extraire à la fois de sa réalité oppressive et du moment lié à cette oppression » (Lacroix, 2019, p. 23). Le lieu-refuge se définirait aussi « par un entre-deux spatial et temporel » (Lacroix, 2019, p. 13). Plusieurs de ces éléments ne sont pas sans rappeler les hétérotopies de Foucault et les espaces sécuritaires (safe spaces) qui furent surtout pensés par des théoriciennes et militantes féministes.



Trêve de théorie
Je sais que tout ce que je viens de dire, ça peut paraître comme une quinzaine de personnes qui, enfermées dans leurs bureaux, s’obstinent à créer des termes pour des choses que l’on pense savoir et que l’on connaît souvent par expérience, et c’est sans doute un peu vrai. Plus haut, je parlais de l’idée de lieu-vécu, et je pense que dans tout ce que j’ai écrit (ou cité) à propos de l’étude des lieux, c’est peut-être ce qu’il y a de plus essentiel à retenir. Parce que les lieux peuvent être réels ou imaginaires, ouverts ou fermés, tout en lumière ou ombragés, ils ne prennent du sens que parce que nous leur en donnons en les traversant, en les écrivant, en les transformant tout comme ils le font aussi.
Références :
Augé, M. (1992). Non-lieux : Introduction à une anthropologie de la surmodernité. Seuil. Bachelard, G. (2020). La poétique de l’espace (Éd. critique). PUF.
Deschênes-Pradet, M. (2019). Habiter l’imaginaire : Pour une géocritique des lieux inventés étude. Lévesque éditeur.
Foucault, M. (2009). Le corps utopique : Suivi de Les hétérotopies. Nouvelles éditions Lignes; WorldCat.org. http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb42025436g Lacroix, A. (2019). Les lieux-refuges et leurs représentations dans la fissure de la fiction de Patrice Desbiens suivi de Une île au fond des draps . Université du Québec à Rimouski.
Mitterand, H. (1986). Le discours du roman (2. ed). Presses Univ. de France.
Soja, E. W. (1989). Postmodern geographies : The reassertion of space in critical social theory. Verso. Tuan, Y. (2006). Espace et lieu : La perspective de l’expérience. Infolio; WorldCat.org.
Weisgerber, Jean. (1978). L’espace romanesque.Éditions L’ Âge d’Homme; WorldCat.org. http://bvbr.bib-bvb.de:8991/ F?func=service&doc_library=BVB01&local_base=BVB01&doc_ number=002137614&line_number=0001&func_code=DB_ RECORDS&service_type=MEDIA
Photos du fond prises par Mathilde Chetaille
Pour en finir avec l’opacité : ce qui se cache dans et derrière
vos livres
Aux poubelles les critiques et les analyses littéraires : dans le cadre de cet article, je délaisse les feux des projecteurs pour plutôt m’intéresser à ce qu’il y a en coulisses. Il s’agit ici de lever le voile sur le processus d’édition qui peut paraître, d’un œil extérieur, opaque, peu accessible, dans l’ombre du sacre de l’Auteur.rice avec un grand A. Voyons ça comme une tentative de mieux se saisir des marques de l’éditeur.rice et d’en restituer les épaisseurs, de mettre au jour et de décortiquer la complexité d’opérations autour du livre en tant qu’objet. Ce qui rend le livre si captivant et d’autant plus digne d’intérêt, ce sont ces rapports qu’il entretient avec toute une constellation d’acteur.rices et de savoir-faire. Ce panorama se veut une entrée en matière, une occasion de mieux voir comment notre conception du livre, parfois étroite, ne permet pas toujours de prendre conscience de toutes les implications et manifestations éditoriales que l’on a tendance à relayer au second plan. Qui plus est, le livre et par le fait même l’édition sont amenés à s’adapter, tout comme le sont l’écriture et la littérature en regard de pratiques alternatives et du numérique. Les revues, les magazines, les médias écrits n’y échappent pas non plus : les formes et les méthodes se multiplient, font émerger de nouvelles voix, de nouveaux possibles, transforment autant la création que nos manières de lire.
Par Frédérik Dompierre-Beaulieu, cheffe de pupitre aux arts
I. La fonction éditoriale : qu’est-ce que c’est ?

Avant de sauter à pieds joints du côté des pratiques éditoriales que l’on pourrait qualifier d’alternatives ou de marginales, il convient de voir en quoi consiste le processus éditorial traditionnel, c’est-à-dire pour les livres en format papier. Par ailleurs, notez que dans ce texte, je parlerai d’éditeur.rice au singulier, non pas dans le but de désigner un unique individu, mais l’instance éditoriale de manière générale. Sans non plus présenter tout de suite les différent.es acteur.rices de la chaîne du livre (qui n’en est pas tout à fait une, vous verrez) qui débordent amplement du cadre des maisons d’édition tout en leur étant intimement lié.es, il faut dire que le travail éditorial n’est pas nécessairement assuré par une même et seule personne. On pourrait penser au cas d’un comité de tri et de sélection des textes, par exemple. La maison d’édition, quant à elle, implique des tâches et des acteur.rices qui ne sont pas toustes, pour leur part, concerné.es directement par le travail de l’éditeur.rice (les comptables, par exemple).
En d’autres mots : l’édition est une affaire d’équipe, de collaboration et de compromis, aussi.
Parlons du rôle de l’éditeur.rice dit.e conventionnel.le, donc. Quel est-il, au-delà de ces représentations à la Guillaume Musso ou de celles dignes des films hollywoodiens entretenant une vision (faussement ?) romantique et mythique de l’éditeur.rice possessif.ve et de sa relation, soit fusionnelle ou au pire ultra problématique et conflictuelle, avec l’auteur.rice, génie entêté.e et incompris.e, avare et fétichiste de ses mots, motivé.e par cette mystérieuse vocation d’écrivain.e et foudroyé.e par l’inspiration divine, rien de moins ?
Bien que cela puisse sembler évident, il faut savoir, d’entrée de jeu, que l’éditeur.rice exerce ce que l’on appelle une fonction éditoriale : « La fonction éditoriale ( editor ) est propre à celui (ou celle) qui découvre, qui consacre et qui dirige la publication d’ouvrages et, plus largement, qui acquiert par le fait même un statut professionnel et une valeur symbolique spécifique dans le champ littéraire. Elle comprend le travail de développement du manuscrit et d’accompagnement de l’auteur, "la mise au point du texte et le choix des documents éventuels qui l’accompagnent,
la conception d’une maquette et le choix des éléments strictement techniques (format, papier, couverture, mode d’impression)" (Legendre, 2008, p. 5) » (Poirier et Genêt, 2014).
Ce qu’il faut retenir, c’est que l’éditeur.rice se fait l’intermédiaire entre l’auteur.rice, son texte (et éventuellement son œuvre) et la communauté de potentiel.les lecteur.rices, possédant des compétences et un savoir-faire dans l’édition, dans ce que c’est que d’éditer un ouvrage.
Vous l’aurez compris avec la précédente définition, le processus implique lui-même diverses tâches qui ont chacune leur visée : elles se subdivisent en trois fonctions éditoriales. De toute évidence, ces fonctions ne s’appliquent pas uniquement aux livres et aux maisons d’édition, mais également aux revues ou aux journaux, avec, entre autres, des directions de publication, voire des mécènes (quoique plus rares de nos jours). Les définitions telles qu’établies par Benoît Epron et Marcello Vitali-Rosati dans L’édition à l’ère numérique serviront ici d’assise théorique.

D’abord, une fonction de choix et de production : c’est que l’éditeur.rice a à voir avec la découvrabilité et la curation des contenus : « C’est la différence la plus évidente entre un contenu édité et un contenu non édité. Entre le manuscrit dans le tiroir d’un auteur et le livre sur l’étagère d’une librairie ou d’une bibliothèque, il y a un processus de choix et de mise en forme qui distingue radicalement ces deux objets. En quoi consiste exactement ce processus ? Il s’agit d’une sélection parmi plusieurs contenus existants, fondée sur la qualité ou sur des exigences de marché ou encore — le plus souvent — sur un mélange des deux. Éditer signifie décider quels contenus sont dignes d’être rendus accessibles à un public. » (Epron et Vitali-Rosati, 2018, p. 14). Outre la réception de manuscrits, l’éditeur. rice peut procéder par commande de textes, en fonction d’une thématique ou d’un sujet qu’il considère comme digne d’intérêt ou lucratif, notamment. La ou les personnes responsables de la sélection et de la production veillent, par la suite, à l’élaboration du manuscrit et de son propos, à sa mise en forme ainsi qu’à sa fabrication, c’est-à-dire à son incarnation matérielle. L’œuvre ne jaillit pas de nulle part, et le livre ne se compose pas uniquement d’un texte, d’un style et d’une rhétorique : il n’est jamais détaché des conditions matérielles qui lui permettent d’exister et d’être lu. C’est pourquoi on parlera souvent du livre en tant qu’objet.
Ensuite, une fonction de légitimation : l’édition confère au manuscrit puis au livre une valeur symbolique et une
crédibilité par l’autorité qu’acquiert l’éditeur.rice au fil des publications, des succès et des ratages. Iel se construit une réputation qui lui est propre et qui lui permet d’attester de la qualité des contenus qu’iel choisit de publier, c’està-dire qu’iel les légitime. C’est, en quelque sorte, un gage de qualité reconnu par les lecteur.rices, en plus de leur fournir des indications quant au type de littérature auquel on peut s’attendre. Ainsi, toujours selon Epron et VitaliRosati, la fonction de légitimation « a une importance sociale et politique fondamentale : c’est le dispositif grâce auquel nous distinguons des formes d’autorité qui nous permettent de nous repérer dans les contenus, de choisir les textes que nous voulons lire, et de savoir quelle confiance leur accorder. La fonction de légitimation établit donc une différence entre les contenus et des indices sur leur valeur et finalement sur leur sens.» (Épron et VitaliRosati, 2018, p. 15).
Enfin, une fonction de circulation et de diffusion (visibilité) : lorsque l’on parle de publication, il faut entendre le terme comme étant une mise à disposition publique du livre (ou d’un autre format papier (ou pas !), le cas échéant), mais aussi comme le fait d’occuper publiquement une certaine position, d’assumer une posture, d’où sa dimension performative. Sans cette publication, sans diffusion et sans visibilité, le texte demeure invisible, inaccessible. « Mais l’invisibilité n’est pas la seule caractéristique qui distingue [ce manuscrit dans le tiroir de l’auteur.rice] du livre publié : justement parce qu’il est dans le tiroir, le manuscrit ne s’adresse à personne, il n’est pour personne. La fonction de diffusion confère donc d’une part une visibilité et d’autre part une adresse. » (Epron et Vitali-Rosati, 2018, p. 15). Comme nous l’avons vu plus tôt, l’éditeur.rice crée un pont entre l’auteur.rice et les lecteur.rices. Non seulement un geste de publication d’un contenu, « il s’agit plus précisément d’identifier un lectorat, d’analyser ses besoins, ses compétences, ses désirs et ses pratiques, de faire en sorte que le contenu lui soit adressé. Un contenu est édité quand il est pour quelqu’un. » (Epron et Vitali-Rosati, 2018, p. 16).
Au-delà de « la » fonction éditoriale, il ne faut pas oublier que l’éditeur.rice doit, la plupart du temps et à quelques exceptions près, répondre à des impératifs marchands et économiques. Il y a donc une tension entre la fonction éditoriale telle que détaillée ci-haut et cette nécessité commerciale qu’est la fonction entrepreneuriale, permettant à la maison d’édition et aux autres acteur.rices impliqué.es de dégager des revenus afin d’assurer la poursuite de leurs activités (et leur survie… ah ! capitalisme, quand tu nous tiens…). L’éditeur.rice doit savoir se jouer de cette dualité : c’est un travail d’équilibre. Par exemple,







éditeur.rice pourrait décider de miser gros sur des ouvrages représentant de potentiels succès commerciaux grand public, la plus large part de profits qu’il en dégage lui permettant par la suite de financer des projets davantage nichés, hors normes et particuliers, s’annonçant probablement moins lucratifs et rejoignant un public nettement plus restreint. Parallèlement, il incombe à l’éditeur.rice, en collaboration avec l’auteur.rice, d’établir et de négocier un contrat et les droits de diffusion, d’utilisation et de reproduction du livre. En raison de ces diverses considérations, parfois contradictoires, avec lesquelles doit composer l’éditeur.rice, il faut bien admettre que sa relation avec l’auteur.rice s’en trouve directement affectée, autant positivement que négativement, s’éloignant néanmoins des clichés et des stéréotypes précédemment énumérés. Dans son article « De la relation de l’auteuréditeur. Entre dialogue et rapport de force », Olivier Bessard-Banquy explique qu’il n’y a « pas d’auteur sans éditeur et, de la même manière, pas d’éditeur sans auteur. L’un fait l’autre, l’un ne va pas sans l’autre. Mais cette relation cache en vérité un déséquilibre, ou plutôt une différence de nature, car si leurs intérêts sont liés, indiscutablement, leurs positions, leurs points de vue, à tout le moins, sont distincts et leurs préoccupations ou leurs obsessions à l’occasion opposées, parfois inconciliables. L’un est par nature cantonné au strict domaine de la création, l’autre est par métier dans le monde pratique de la vente, ils ne se soucient pas des mêmes choses, ils ne poursuivent pas les mêmes buts. L’un veut s’imposer dans le domaine des arts, l’autre veut réussir sur le plan des affaires. » (Bessard-Banquy, 2018, p. 5). Cette vision de la relation auteur.rice-éditeur.rice mériterait certes d’être nuancée, j’y reviendrai un peu plus loin.
Bien entendu, toustes les éditeur.rices n’accompagnent pas de la même manière leurs auteur.rices, s’adaptant plus ou moins à leurs mentoré.es. Force à double tranchant, faut-il croire, puisque les traitements différentiels peuvent eux aussi être source de tensions.
Fin de la parenthèse. Revenons à la question du processus d’édition, par-delà la valse dans laquelle s’engagent l’auteur.rice et l’éditeur.rice. Au cours dudit processus, et à travers les trois fonctions éditoriales, l’éditeur.rice doit souvent déléguer certaines tâches, pour la révision, la correction ou la traduction du manuscrit, la promotion et la commercialisation, par exemple, ou faire appel aux artisan.es du livre lors de la fabrication, pour l’infographie et l’iconographie, pour ne nommer que celles-ci. Plusieurs autres personnes peuvent donc être impliquées : direction artistique, assitant.e-éditeur.rice, comptable, graphiste, imprimeur.euse, relieur.euse-doreur.euse ou
distributeur.trice, directions et responsables marketing et publicité, attaché.es de presse, différent.es représentant.es, libraires et bibliothécaires. La liste est longue et varie en fonction des ressources et de la taille de la maison d’édition, du moins, dans le cas des acteur.rices qui œuvrent au sein de cette dernière. Toustes ces acteur.rices forment la chaîne du livre, ou faudrait-il plutôt dire l’écosystème du livre, puisque l’idée de consécution, comme autant d’acteur.rices placé.es à la queue leu leu est en fait contestée par leur forte interdépendance. L’esprit de collaboration est particulièrement présent et est même encouragé, faisant état d’une connivence et d’un respect entre elleux, bien qu’il puisse y avoir une concurrence et des rivalités commerciales. L’environnement éditorial s’avère donc plus complexe et rhizomatique qu’il n’en paraît.
*À propos du schéma…

Quitte à me répéter, cette chaîne du livre n’en est pas réellement une. Si le présent schéma tend à placer les étapes de production et de circulation ainsi que le acteur.rices les un.es à la suite des autres, comme un circuit à sens unique, le réseau de relations qui les unis ne fonctionne pas sur le même principe (d’où l’utilisation du terme « réseau »). Prenons l’exemple des livres invendus : les services de prêt et de vente de livres ou alors les lecteur.rices ne représentent pas toujours la fin du parcours des imprimés. Les livres invendus peuvent en effet être renvoyés au.à la distributeur.rice ou à l’éditeur.rice afin d’être redistribués ou « réintégrés » au circuit, entreposés, recyclés ou envoyés au pilonnage. Autre cas de figure : le.a diffuseur.rice, qui planifie les commandes de concert avec la maison d’édition en fonction du nombre d’exemplaires qu’elle souhaite mettre en circulation sur le marché, reçoit également des commandes de la part des libraires, notamment, et retourne ensuite les informations à la maison, qui elle se charge de les transmettre à l’imprimeur.euse et aux fabricant.es. Le schéma représente en ce sens une simplification de cet écosystème auquel des acteur.ices, qui interagissent, peuvent s’ajouter ou se soustraire. Il en est de même pour des tâches plus spécifiques liées à leur travail au quotidien, ici résumé ou pouvant relever d’une strate ou d’une autre. Les frontières sont poreuses, les allers-retours se multiplient (ça part de tous bords tous côtés comme on dit) : cela dépend du modèle éditorial, qui n’est pas fixe. Je me suis ici librement inspirée des modèles proposés par Sophie Kloetzli dans « La chaîne du livre papier » et Kelvin Smith dans L’édition au XXIe siècle. Entre livres papier et numériques.





II. L’énonciation éditoriale et la question de la matérialité
Maintenant : comment et à quel degré ce processus éditorial intervient-il sur l’œuvre, sur ce produit fini qu’est le livre lorsque nous, lecteur.rices, le tenons entre nos mains, le feuilletons dans une librairie ou dans une bibliothèque, le recommandons à nos ami.es ou à notre famille ? Ce qu’il aura fallu retenir de la première partie, l’essentiel, il me semble, c’est que l’édition constitue une forme de médiation du contenu et de l’objet-livre.
De manière générale (notez bien la généralisation ici), c’est à l’auteur.rice que revient le mérite de l’œuvre; c’est son nom qui nous marque d’entrée de jeu, que nous retenons — probablement en compétition pour la première place avec le titre et la couverture du livre. De plus, si le texte et les idées qu’il véhicule semblent être au cœur du livre et en faire l’essentiel, le produit fini est en fait le résultat d’un travail de collaboration et d’accompagnement (toujours en fonction du modèle éditorial papier traditionnel). N’oublions pas que l’œuvre porte en elle l’empreinte du processus éditorial, qui lui donne ainsi une forme, une orientation ainsi que de nouvelles potentialités de sens à travers cet assemblage énonciatif et discursif complexe qui est construit. L’œuvre « achevée » s’articule autour d’un certain nombre d’autres éléments significatifs qui ne relèvent donc pas uniquement de l’auteur.rice et de son manuscrit, ce qui tend à remettre en cause l’idée de l’autorité du texte : ces éléments découlent des interventions de nombreuses instances provenant de plusieurs corps de métier, d’une multiplicité de voix qui y laissent leurs traces. Ce sont aussi ces marques sémiotiques qui érigent l’œuvre, lui sont constitutives et lui donnent un cadre spécifique. Le livre est en ce sens polyphonique : il est le produit d’une « élaboration plurielle de l’objet textuel » (Souchier, 1998, p. 172). C’est ce que l’on nomme l’énonciation éditoriale,

qui consiste à construire l’objet textuel couche après couche, un peu comme un oignon.
Le titre, la mention générique, la couverture et le choix du matériau, le texte de quatrième de couverture, la collection dans laquelle l’œuvre s’inscrit, le choix typographique et la taille de la police, l’espacement entre les lettres, les lignes et les marges, le format et les dimensions du livre, la qualité du papier, les textes d’accompagnement comme les préfaces et les postfaces, les notes de bas de page, le type de reliure, les illustrations, la façon dont l’éditeur.rice invite l’auteur.rice à parfaire son texte par commentaires, hachures et réorganisation… C’est chargé, je vous l’accorde. De la dimension graphique à l’intervention immédiate dans le texte, voilà autant de marques éditoriales en apparence anodines parce que souvent invisibilisées — l’énonciation éditoriale a pour caractéristique de rester cachée, à moins que l’auteur.rice ne nous la dévoile luimême dans son texte — mais qui, « si [elles] ne touchent pas à l’intégrité linguistique d’une œuvre, [en font] autrement lorsqu’elles lui permettent de prendre corps » (Souchier, 1998, p. 140). Ces manifestations portent un sens et une fonction : elles ne sont pas neutres.
Nuance importante : dans son article, Emmanuël Souchier nous met en garde contre une vision du paratexte tel que l’envisage Gérard Genette, qui lui place les composantes énumérées ci-haut à part du texte, de manière complètement distincte et indépendante. Il insiste plutôt sur le fait qu’elles font partie intégrante de l’œuvre et participent de la métamorphose du texte initial, et qu’ainsi « à des degrés divers, ces traces ou marques d’énonciation éditoriale façonnent et constituent l’identité du texte. Elles déterminent donc les conditions de sa réception. » (Souchier, 1998,




p. 142). Les marques de l’énonciation éditoriale ont de fait une incidence à la fois sur la manière que les lecteur.rices appréhendent une œuvre et la perçoivent avant de l’avoir lue — ce que les théories de la réception et Hans Robert Jauss nomment « horizon d’attente » — et directement sur la manière de la recevoir et de la consommer, c’est-à-dire sur l’expérience de lecture.
Par ailleurs, les maisons d’édition, les revues, les journaux et même les collections ont ce que l’on appelle une ligne éditoriale. Cette ligne directrice définie constitue en quelque sorte une signature, une image de marque, ou, pourrionsnous dire, une marque de commerce. C’est aussi une affaire de réputation. Elle découle d’un ensemble de choix qui peuvent être esthétiques et formels, thématiques, idéologiques, moraux ou éthiques, et traduit une conception particulière de ce qu’est la littérature , mais pas que : il pourrait tout aussi bien s’agir d’éditions scientifiques ou spécialisées dans le livre de recettes (petite précision : littérature n’est pas synonyme de livre, et livre n’est pas automatiquement à associer à littérature (voilà, c’est dit)). Cette ligne éditoriale oriente d’emblée la sélection des textes, la façon dont l’éditeur.rice entrevoit et approche un manuscrit, comment iel veille à son élaboration, donne une forme et un souffle à l’œuvre, la fait correspondre à un certain idéal. La ligne éditoriale, en d’autres termes, témoigne d’un agenda et de tout un système de valeurs. Elle traverse comme un fil rouge le catalogue des maisons d’édition, leurs collections et leurs projets (qui peuvent sortir du format livresque). Tout comme les autres marques d’énonciation éditoriale — d’ailleurs elles-mêmes influencées par la ligne éditoriale —, elle intervient sur la capacité du texte à être visible et à transmettre un sens et un message. Certes, le degré d’intervention de cette ligne


éditoriale sur les contenus et les objets-livres peut varier, puisqu’elle est propre à chaque maison d’édition, à chaque éditeur.rice, collection, auteur.rice, œuvre, etc. C’est du cas par cas. Et qu’elle soit dissimulée ou très frontale, elle oriente d’une façon ou d’une autre la réception des contenus par les lecteur.rices.
Les couvertures des œuvres publiées chez Les Herbes rouges ou bien appartenant à la Collection Blanche de Gallimard sont très facilement reconnaissables. Elles reprennent sensiblement toutes la même facture (pour ne pas dire identité) graphique, bien que ces deux cas de figure soient diamétralement opposés. Le premier, revue littéraire québécoise devenue maison d’édition indépendante, « œuvre à animer, soutenir et pérenniser une littérature singulière et saisissante » et est reconnu pour donner une voix à l’avant-garde littéraire, la contreculture et la littérature engagée; le second cas incarne quant à lui une grande collection de littérature et de critique françaises de Gallimard, dont les titres sont publiés depuis 1911. Les couvertures des Herbes rouges arborent toutes sortes de couleurs, d’illustrations et de photographies; celles de la Collection Blanche misent sur la sobriété et l’épurement, la neutralité et l’élégance. Dans tous les cas, ces caractéristiques renvoient à toute une symbolique propre à ces deux maisons, en plus d’être des repères pour les lecteur.rices.
De même, on ne s’attendra pas à la même chose d’un ouvrage paru aux Éditions du remue-ménage, éditions féministes « engagées, critiques et libres », du magazine Québec Science ou alors des contenus et des œuvres publiés chez Productions Rhizome, axées vers des projets interdisciplinaires alliant littérature, performances,
installations, spectacles et technologies numériques. Chaque éditeur.rice occupe un créneau. Si on conseille aux auteur.rices de tendre le plus de perches possibles lorsque vient le temps d’envoyer leur manuscrit aux éditeur.rices, user de stratégie en ciblant des maisons dont la ligne éditoriale colle davantage à leur démarche, leur texte et leurs valeurs a également le potentiel de porter fruit et de payer gros.
Autre nuance dont il faut tenir compte : toutes ces composantes regroupées sous le chapeau de l’énonciation éditoriale sont susceptibles de changer au fil du temps et des rééditions. Pensons aux éditions critiques parsemées des réflexions de l’éditeur.rice, des ajouts de préface et de postface, des versions illustrées grand format, de l’intégration du texte dans un recueil ou un ouvrage collectif suivant une certaine ligne thématique, ou alors, exemple classique et des plus communs, des livres republiés en format poche. Même si le propos de l’auteur.rice reste le même, s’agit-il vraiment du même texte ? Je suis tentée de répondre à la négative : tous les livres ne sont pas les mêmes. Un livre écrit par un.e auteur.rice X et portant le titre Y n’est pas du tout le même d’une édition à l’autre. N’importe quel objet changera en fonction des voix qui sont associées au support et du travail éditorial réalisé par des personnes qui ont une vision singulière de l’œuvre. Ainsi, un livre correspond à une certaine version du texte, à « un état d’un texte à une époque donnée, et que cet état qui a pu textuellement changer au fil de l’histoire, changera encore dans les années à venir tant du point de vue matériel et visuel que du point de vue de son discours d’accompagnement. » (Souchier, 1998, p. 140).
L’énonciation éditoriale, c’est donc une question de médiation et de mutation, de marques à la fois techniques, visuelles, culturelles, thématiques et idéologiques, d’une forme et d’une matérialité qui font non seulement exister le texte et le donnent à lire de façon singulière, mais l’amènent à se transformer, mettent au jour sa plasticité : « L’énoncé de cette "énonciation" n’est donc pas le texte (le discours de l’auteur), mais la forme du texte, son image; c’est le texte considéré comme objet concret et qui a été configuré à travers cette activité plurielle qu’est l’énonciation éditoriale. » (Souchier, 1998, p. 145).

III. Les pratiques éditoriales alternatives

Un peu plus tôt, je citais un article d’Olivier BessardBanquy, dans lequel il affirme qu’il n’y a pas d’éditeur.rice sans auteur.rice, et pas d’auteur.rice sans éditeur.rice. Permettez-moi de le contredire et de le contester sur la base de modèles éditoriaux qui échappent à cette association habituelle et à cette relation supposée réciproque entre éditeur.rice et auteur.rice : la presse alternative et les éditions « hors édition ». Se plaçant volontairement en marge de la réputée institution littéraire, parfois écrasante, contraignante, incestueuse et élitiste (eh oui, qui l’eût cru…), certaines de ces pratiques tendent à se refuser aux circuits fermés traditionnels. Une chose est claire : le livre est polymorphe, est capable de transfiguration et sait se passer d’une fabrication, d’une diffusion et d’une circulation que l’on voudrait standardisées. Il est possible de déjouer les règles de l’institution littéraire, de procéder d’un décentrement ou d’un éclatement du modèle typique valorisé et légitimé, et ce, dans un désir d’émancipation. Je n’ai pas ici la prétention de brosser un portrait exhaustif de ces pratiques alternatives ou de ces contre-littératures, qui sont très nombreuses, mais je propose plutôt d’en dégager quelques cas intéressants.

On peut penser aux éditions « parallèles » et « sauvages ». Les éditions parallèles comprennent notamment, mais non exclusivement l’autoédition. L’écrivain.e se retrouve en situation de double posture, puisqu’iel devient auteur.rice-éditeur.rice, ce qui lui confère une plus grande liberté par rapport à son texte et ses choix esthétiques : « Afin de proposer des livres pouvant rivaliser avec la production courante, l’auteur-éditeur doit acquérir et mettre en pratique — en plus d’écrire, voire d’exercer une tout autre profession — un grand nombre de compétences éditoriales allant de la mise en page à la distribution. » (Habrand, 2016, p. 27). La logique de l’autoédition affecte la dynamique de diffusion, comme il n’y a pas d’intermédiaire entre l’auteur.rice et les lecteur.rices, modalité de publication d’ailleurs souvent privilégiée en contexte numérique, avec, par exemple, les fanfictions, les blogues ou les textes publiés sur les réseaux sociaux via un compte personnel ou une page. Dans ce contexte, on peut aussi parler d’autopublication. Cela dit,


l’édition en contexte numérique — que l’on nommera plutôt éditorialisation, loin d’être une simple copie numérique de l’édition papier, d’où l’utilisation d’un terme et d’un concept totalement différent — est un sujet qui m’aurait probablement exigé une autre douzaine de pages. Une prochaine fois.
De retour au papier. Les éditions sauvages, quant à elles, ne recourent pas nécessairement à l’autoédition et à l’autopublication dans son penchant solitaire et, disons plus individuel, puisqu’elles peuvent être collectives. Par ailleurs, cela fait surtout référence aux conditions de production. Pourquoi ne pas parler format (encore, je sais) ? Effectivement, les productions alternatives n’échappent pas à la question graphique et matérielle : « Ici, la dimension littéraire s’émancipe au-delà des mots pour s’exprimer à travers un travail artisanal où la vision de l’artiste se dévoile autant dans le contenant que dans le contenu. » (Pépin, 2022). Les zines, œuvres justement à dimension artisanale « sur le mode du Do It Yourself », à tirage restreint et souvent à « l’inspiration contre-culturelle » ou à caractère politique en témoignent, et renvoient à un imaginaire de la clandestinité (Habrand, 2016, p. 19).
Certains collectifs d’édition autogérés, comme La Fatigue éditions, cherchent, par leur pratique et leur modèle éditorial, à se délier des impératifs marchands ou idéologiques des éditeur.rices traditionnel.les. Ils évitent ainsi de sacrifier leur vision en se permettant d’exploiter des formes plus éclatées et des discours plus engagés, radicaux ou militants que certain.es pourraient qualifier de « dérangeants », types de discours qui ne sont évidemment pas réservés aux éditions indépendantes. Celles-ci se délient toutefois d’une quelconque dilution et édulcoration potentielle, en plus de s’éloigner de la verticalité de la gestion traditionnelle. C’est tout à fait cohérent avec la démarche de La Fatigue, tout comme celles de plusieurs instances de presse et d’édition marginales, qui font entre autres de l’accessibilité leur cheval de bataille, tant en ce qui concerne les ressources nécessaires à la publication — pensons, à Québec, à l’atelier d’impression et d’autoédition communautaire Le Pieu — que l’accessibilité aux contenus en eux-mêmes. Les textes produits par La Fatigue sont justement disponibles gratuitement sur leur
site web, ce qui, en plus, s’inscrit dans la logique de démocratisation de l’écriture, de la littérature et de l’édition prise en charge par les « contre-modèles » évoqués jusqu’à maintenant.
Ces exemples de démarches hors édition, papier ou numérique, ne sont pas dénudés d’une ligne ou d’une énonciation éditoriale pour autant, et elles ne s’en retrouvent pas totalement obsolètes. Épron et Vitali-Rosati nous rappellent que « la fonction éditoriale n’a jamais été aussi présente qu’aujourd’hui » (Epron et Vitali-Rosati, 2018, p. 12). À la fois les conditions de production et de circulation en plus du format déterminent et influencent le produit, ont une incidence sur sa manière d’être au monde et de rejoindre un public, même s’il ne s’agit pas d’un livre à proprement parler.
Mais l’indépendance, comme toute chose, a un prix (le capitalisme, toujours le capitalisme), tant pour l’auteur.riceéditeur.rice que les initiatives collectives : « Ce type d’édition [reste] toutefois marginal sur support papier en raison des obstacles de production et de distribution. En effet, une publication imprimée autoritative telle que la définit Évelyne Broudoux [Rebillard et Chartron, 2004], c’est-à-dire directement prise en charge par l’auteur, suppose un investissement parfois non négligeable et une diffusion souvent réduite. Les volumes concernés et les zones géographiques couvertes [restent] donc limités » (Epron et Vitali-Rosati, 2018, p. 61). Ces pratiques éditoriales hors édition ne sont ainsi pas sans difficultés. Elles supposent une connaissance du domaine de l’édition et de la publication, un certain savoir-faire technique lié à la fabrication artisanale ou aux contraintes technologiques du numérique et peuvent s’avérer particulièrement chronophages, malgré qu’elles aient le potentiel de réduire les coûts de production en raison de leur nature artisanale et de leur circulation restreinte. Elles soulèvent aussi des enjeux liés à la postérité des contenus, puisque ces derniers ne sont pas pris en charge officiellement par l’institution. Mais il y a de l’espoir, quand même : de plus en plus d’acteur.rices de la scène littéraire se dédient aux éditions et aux productions alternatives et à leur valorisation, ici même, au Québec, en organisant divers événements, comme des colloques ou des salons. Le Petit salon du zine


et de l’édition alternative, le festival d’arts littéraire s Caniches, ou l’Expozine, en sont de bons exemples.
*En bonus, et si cela vous intéresse, vous pouvez consulter cet épisode du balado d’Impact Campus dans lequel je me suis entretenue avec Tristan Février, membre du collectif La Fatigue éditions et de l’atelier d’impression autonome Le Pieu, basé ici, à Québec. Scannez le CODE QR !



IV. Le cas d’Impact Campus

Un coup parti : pourquoi ne pas se prêter au jeu en ne plaçant nul autre qu’ Impact Campus sous la lentille de l’analyse éditoriale ?
Si vous suiviez déjà nos activités, vous savez probablement qu’ Impact Campus , qui relève de la Corporation des médias étudiants de l’Université Laval (CoMÉUL) — tout comme CHYZ 94,3—, propose divers types de contenus et formats accessibles gratuitement : des articles publiés sur le web, des magazines en format papier, des balados (diffusés sur diverses plateformes depuis l’automne dernier) et enfin, une nouveauté ce printemps, des zines.
Question de suivre le propos de l’article, concentrons-nous sur le papier, en l’occurrence le magazine (et les zines). En amont de la rédaction des textes que vous pouvez lire ici, Impact Campus met en place diverses conditions de production préalables qui ont une influence sur la suite des choses, c’est-à-dire sur d’autres étapes du processus ou les textes eux-mêmes. D’abord, il faut savoir qu’Impact négocie et met en place une entente avec son imprimeur, ce qui détermine le nombre de pages du magazine, son format, le type de papier et de reliure. Ces informations ne varient pas au fil des numéros. L’équipe permanente établit
également un échéancier pour toutes les étapes, que ce soit la remise des textes, l’envoi à l’impression, la réception des copies ou la soirée de lancement.
Autres constantes : les différentes éditions du magazine reprennent sensiblement toutes le même gabarit : sommaire, page de présentation à l’intérieur de la couverture, ou alors informations sur la page couverture. Elles sont également toutes divisées en sections, qui peuvent légèrement varier dépendamment des articles proposés comme elles reflètent les intérêts et les enjeux couverts par les journalistes de l’équipe permanente et les journalistes collaborateur.rices. La nature des articles peut également varier : articles scientifiques, journalistiques, essayistiques, critiques et chroniques d’opinion, entrevues et entretiens, articles collaboratifs, reportages photos, textes de création ou enquêtes. Plus précisément, certains articles peuvent également être récurrents, peu importe le thème, comme l’éditorial, les horoscopes, les listes de lecture musicales et les suggestions littéraires.
Le thème : parlons-en. C’est l’équipe permanente qui détermine les thèmes des magazines. La CoMÉUL est basée sur un mode d’horizontalité des échanges (bien que la rédaction en chef et le directeur de programmation, la direction générale et le conseil d’administration s’assurent de mener le bateau à bon port en s’occupant de la gestion des équipes et de la gestion administrative). C’est le thème qui détermine, de manière très forte et directe, les sujets que nous déciderons de couvrir. De manière générale, néanmoins, le magazine privilégie les textes qui s’inscrivent dans la durée plus que dans l’actualité (ceux-là, on les redirige vers le web). Le thème peut certes être interprété très littéralement ou plus librement, mais il nous guide, et renvoie à un modèle de production de contenu par commande de textes, en plus d’influencer certaines composantes graphiques, comme la couverture. Elle est parfois élaborée à l’interne, parfois à l’externe.
Après avoir transmis le thème et les échéances aux collaborateur.rices, et que les journalistes et collaborateur.trices aient toustes déclaré leur(s) sujet(s) et le nombre de pages estimé, c’est la période de rédaction. Les journalistes employé.es accompagnent, en simultané, les collaborateur.rices, en corrigeant puis en donnant des
conseils quant aux idées ou à la structure de leur texte, en fonction de leur expertise et de leur bagage de connaissances, leurs spécialités et, bien sûr comme précédemment établi au courant de cet article, de leurs préférences personnelles, de leur vision individuelle et de ce qu’il est souhaité atteindre en tant qu’équipe.
S’entame ensuite la première étape de correction, effectuée par les membres de l’équipe permanente et des correcteur.rices en sous-traitance : chaque texte doit être revu trois fois plutôt qu’une. S’ensuit l’élaboration graphique par notre graphiste, qui peut se fier à nos indications et inclure les photos que nous avons préalablement sélectionnées ou y aller de son imagination et de sa sensibilité artistique. Nous nous lançons alors dans la correction de l’épreuve PDF, constamment recorrigée et revérifiée au fil des versions et des actualisations, jusqu’à ce que nous atteignions la version finale que nous envoyons par la suite à l’impres-sion.
Après la réception des copies viennent le lancement et la distribution. La fréquence de publication, à raison d’un magazine par session, détermine le nombre de copies en circulation. Les points de chute ciblés, autant sur qu’en dehors du campus, en favorisent la diffusion. Certaines de ces instances, comme la Maison de la littérature, peuvent même nous conférer une légitimité et une crédibilité supplémentaires à celles de la CoMÉUL ou de l’Université Laval. Elles choisissent de sélectionner et de présenter nos magazines parce qu’elles considèrent que leur diffusion en vaut la peine, et elles ont une autorité et un pouvoir symbolique qui leur permet d’en attester. C’est un gage de qualité pour les lecteur.rices qui nous lisent grâce à ces acteur.rices et à ces établissements. ***
Tout comme le livre, le magazine que vous tenez entre vos mains est le résultat d’une énonciation plurielle, inclusive, innovante, singulière et avant toute chose sensible. Il rend compte d’un effort collectif et engagé. Nous travaillons main dans la main pour communiquer cette vision qui est la nôtre, en abordant des questions et des enjeux qui nous (et vous) sont chers, en y ajoutant notre grain de sel, ici et là. Il en vient à définir, petit à petit, l’identité d’ Impact


Campus en tant que média par et surtout pour les étudiant.es. Nous espérons qu’il réussira, d’une façon ou d’une autre, à vous toucher, puisqu’après tout, un contenu n’est réellement édité que s’il est pour quelqu’un.
Références

Bessard-Banquy, O. (2018). De la relation auteur-éditeur. Entre dialogue et rapport de force. A contrario, 2 (27), p. 79-96. https://www-cairn-info.acces.bibl.ulaval.ca/revue-acontrario-2018-2-page-79.htm
Epron, B. et Vitali-Rosati, M. (2018). L’édition à l’ère numérique. La Découverte.
Habrand, T. (2016). L’édition hors édition : vers un modèle dynamique. Pratiques sauvages, parallèles, sécantes et proscrites. Mémoires du livre / Studies in book culture, 8 (1), https://www-erudit-org.acces.bibl.ulaval.ca/fr/revues/ memoires/2016-v8-n1-memoires02805/1038028ar/
Kloetzli, S. (2016). La chaîne du livre papier. Actualitté. https://actualitte.com/article/32778/distribution/la-chainedu-livre-papier
Pépin, W. (2022). La poétique du zine et de l’édition alternative s’invite au festival Caniches. Impact Campus. https://impactcampus.ca/arts-et-culture/poetique-zine-deledition-alternative-sinvite-festival-caniches/
Poirier, P. et Genêt, P. (2014). La fonction éditoriale et ses défis. Dans M. E. Sinatra, M. Vitali-Rosati (dir.), Pratiques de l’édition numérique (édition augmentée), Presses de l’Université de Montréal.
Smith, K. (2013). L’édition au XXIe siècle. Entre livres papier et numérique, Pyramid.
Souchier, E. (1998). Lire et écrire : éditer, des manuscrits aux écrans, autour de l’œuvre de Raymond Queneau, université Paris VII-Denis-Diderot.
Souchier, E. (1998). L’image du texte pour une théorie de l’énonciation éditoriale, Les cahiers de médiologie, 2 (6), p. 137-145.
Quand nature et écologie s’invitent sur les tablettes
de nos librairies
Le thème de ce présent magazine éveille immédiatement, pour moi, l’imaginaire de la nature. Bien sûr, les cartes répertorient les espaces urbains, les pays, bref ce que l’humain a eu comme impact sur cette Terre qu’il habite – mais elles répertorient aussi les cours d’eau et leurs méandres, les zones forestières, alpines, nordiques. Elles nous rappellent sans cesse que malgré notre point de vue parfois captif des villes, malgré notre horizon coupé par les immeubles, nous faisons partie d’un ensemble bien plus vaste que l’univers urbain. Si nous avons longtemps pensé que cet ensemble était à notre merci, disponible pour exploitation, la crise climatique à laquelle nous faisons face collectivement nous rappelle que la Terre n’est pas qu’un objet de prédation. Serons-nous des arroseur.euses arrosé.es ? Plusieurs écrivain.es, chercheur.euses, poète.esses. et philosophes se penchent sur les effets des changements climatiques sur nos consciences. Écoanxiété et défaitisme côtoient prise de conscience positive et écologisme militant dans cette petite liste (évidemment non exhaustive) de publications, plutôt récentes, sur le sujet.
Par Florence Bordeleau, journaliste multiplateforme
Essais


VULGARISATION – Inês Lopes, Les visages de l’écoanxiété , Montréal, Écosociété (Radar), 2023, 152 p.
Petit nouveau de la collection Radar, Les visages de l’écoanxiété met des mots sur cette angoisse qui habite 73% des jeunes québécois.es de 18 à 34 ans (Rossato, 2023, paragr. 3). Si ce livre s’adresse principalement aux adolescent.es, il m’a semblé qu’il pouvait être intéressant pour toute personne qui peine un peu à démêler ses « éco-émotions », ou à comprendre et accompagner des proches dans cette situation. Le mot d’ordre de Lopes, « validation émotionnelle », est omniprésent dans le texte, et permet à quiconque d’appréhender avec plus de douceur et d’empathie les émotions négatives que les changements climatiques peuvent provoquer. Il s’agit d’un petit baume pour les solastalgiques de première ligne (lisez le livre pour savoir ce que ça signifie!).

MILITANTISME & ÉCOFÉMINISME – Vandana Shiva, Restons vivantes. Femmes, écologie et lutte pour la survie traduit de l’anglais par Agnès el Kaïm, Paris, Points (Terre), 2023 [éd. originale : 1988], 430 p.
Trente ans après sa publication originale, Restons vivantes vient tout juste d’être traduit en français. Shiva y pose les bases de l’écoféminisme, en tissant des liens entre colonialisme, domination de la nature et oppression des femmes, principalement à travers la lentille de l’agriculture. Détentrices de connaissances séculaires sur l’art de cultiver avec soin et intelligence, les femmes se font déposséder de ce savoir par des compagnies comme Monsanto, qui uniformisent les cultures, appauvrissent les sols et s’approprient les semences en les stérilisant et les brevetant. En s’inspirant des luttes paysannes indiennes, Shiva propose ici un modèle alternatif au capitalisme, axé sur le respect profond de la vie, et fondé sur le rôle particulier attribué au genre féminin depuis des siècles.
Romans et recueil de poésie



EFFONDREMENT – Antoinette Rychner, Après le monde, Paris, Buchet-Castel, 2020, 288 p.
Sans doute l’une de mes lectures les plus bouleversantes, malgré la forme si étonnante qu’elle nuit parfois à la fluidité de la lecture (une narration au féminin pluriel parfois rythmée à la manière de chants). Dans Après le monde, Rychner propose une « fin du monde » réaliste à faire frissonner (n'hésitez donc pas à aller consulter Les visages de l'écoanxiété si la lecture de Rychner vous perturbe). Les deux protagonistes, qui s’improvisent bardes et gardiennes des histoires de ces temps nouveaux, naviguent de microsociété en microsociété, découvrant avec les lecteur.rices les modes de fonctionnement choisis par de petits groupes d’humains rescapés de la chute du capitalisme.

ÉCOLOGIE – Mireille Gagné, Frappabord , Chicoutimi, La Peuplade (Roman) 2024, 216 p.
Ce roman dont l’histoire se déroule en 1942 (en plein durant la Seconde Guerre, donc) semble s’inspirer de la pandémie dont se relève progressivement le monde, ainsi que des enjeux sociaux et écologiques que cette dernière a mis en évidence. Cette fiction jette un regard un peu effrayant sur ce à quoi pourrait ressembler une Troisième Guerre mondiale qui miserait sur les armes bactériologiques. La narration, plurielle, nous transportant tantôt dans la tête d’un humain, tantôt dans celle d’un frappabord, propose en elle-même une piste de solution : et si l’on cessait de placer l’être humain au centre de tout, et que l’on réalisait qu’il ne peut échapper à l’écosystème terrestre, auquel il est nécessairement intriqué, quoiqu’il en pense ?
FILIATION – Marie-Hélène Voyer, Mouron des champs, La Peuplade (Poésie), 2022, 216 p.
Voyer signe, dans ce second et magnifique recueil de poésie, une ode à la transmission générationnelle entre femmes ; elle se laisse habiter par les voix de « ses vieilles vivantes» qui se transforment parfois en oiseaux. Comme dans Frappabord et Après le monde, la parole n’est pas endossée par un « je » unique. Le « nous » a la part belle, tout comme le « tu ». Les images du Bas-Saint-Laurent créées par ce recueil sont émouvantes à transformer n'importe quel.le lecteur.rice en ami.e et protecteur.rice de la nature.
Cloud Atlas – pour une cartographie des nuages
Par Camille Sainson, journaliste multiplateforme

Piano. Violon. Basse.
Telles des notes de musique, les destinées s’éparpillent dans le temps et l’espace. Gouttes d’eau dispersées dans l’océan.
Impossible de tisser une trame linéaire. Six personnages. Six époques.
Adam Ewing.
Robert Frobisher.
Luisa Rey.
Timothy Cavendish. Sonmi-451.
Zachry.

Cartographie d’une symphonie. Tache de naissance sur un grain de peau. Comète qui traverse les âges. L’écho d’une parole
Nos vies ne nous appartiennent pas, Nous sommes liés aux autres, Passé et présent. Et par chaque crime Et par chaque gentillesse, Nous engendrons notre avenir.

Héritage – une vague qui s’échoue sur le sable.
Révolution idéologique.
Insurrection contre la tyrannie.
Coup de pistolet.
Le sang se répand sur le sol.
Silence.
Le rêve se brise, les paupières se soulèvent.
Conscience de l’aube.

Un journal flotte sur l’écume du Pacifique.
Des lettres d’amour prennent la poussière dans un tiroir.
Murmure d’une légende.
Les œuvres vagabondent de lèvres en lèvres.
Les personnages sont les gardiens de la mémoire.
Mots – destructeurs d’empires.

Nuages – voiles blanches sur l’océan
Passé Présent Futur
Les constellations s’organisent. Des visages se tournent vers le ciel étoilé, écoutent la formation d’un monde.
Celui de leurs ancêtres.
La dernière note retentit. Écho qui flotte encore un instant dans l’air. Avant de s’évanouir dans le noir.
Une journée dans l’esprit d’un étudiant, ou le « moi » dans toute sa beauté
Note préliminaire
Si vous vivez dans votre tête, votre expérience du présent n’est pas fluide. Elle est hachurée, erratique et confuse. Ce texte montre la souffrance qu’une personne peut vivre dans une telle situation, et c’est d’une laideur épouvantable.
Par Émilien Côté, journaliste collaborateur
BIP. BIP. BIP. Hmmm (06:00 A.M.)
Tabarnak. Hungh… Mains moites. Allez, lève-toi.
Céréales…..Brosse à dents……Chemise. Je vais tomber dans mes bottes.
Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Pourquoi je compte mes pas ?
Arrête de faire ça ! You’ve been dickmatized. (Kiddy Smile, 2018). Ostie qu’il fait froid. J’aurais dû mettre mes grosses mitaines. Je vais saigner du nez, c’est sûr.
Dick dick dick dick dickmatized.
Too late.
Bon, cinq minutes de retard, l’autobus.
Je les ai mis où, mes écouteurs ?
Pschiiiit. « PARCOURS : 292.» DIRECTION : PLACE JACQUES-CARTIER.
« Bonjour. » Bonjour. Bip. Pschiiiit.
Il est gros, le chauffeur. C’est pas le même que d’habitude. Ah tiens, mes écouteurs. Vitre. / Maisons qui défilent.
Téléphone. Il est quelle heure ? (07:20 A.M.)
Adèle en fond d’écran. Je t’aime, Adèle.
Playlist. Sound of Violence — (Dennis De Laat, 2011.) Play.
When the sun goes down
As long as I’m gonna be around ya
« PARCOURS : 292. WHEN THE SUN GOES DOWN YEAH !
Pause.
ABBA — Dancing Queen, 1976. Pschiiiit. « Bonjour. » Play.
Ooh, see that girl Trafic. Je vais être en retard, c’est sûr.
Watch that scene Au moins, les morons du secondaire sont pas là ce matin.
Digging the dancing queeeeeeen
You « 292. Direction can jive Place Jacques-Cartier ».
« PROCHAIN ARRÊT : STATION UNIVERSITÉ LAVAL — ARRÊT 1561. »
Je t’aime tellement, Adèle. Adèle. J’ai envie de te *******.
Pschiiiit. Air froid. Dents froides. Dentiste qui te gèle la putain de dent.
Maudite slush. Est-ce que mes pantalons sont sales ?
Kant — Cours 7 Il est quelle heure ? (08:32 A.M.)
« Bonjour tout le monde. Alors on va reprendre où on en était la dernière fois, à savoir Feel like I wanna be inside o’ you / When the sun goes down (Dennis De Laat, 2011).
« D’où la question de Kant : comment les jugements synthétiques à priori sont-ils possibles ? »
When the sun
« En fait, ce qu’il faut comprendre ici When the sun goes When the sun goes When the sun goes aROUND YA ! yeah Yeah yEAH yeAH eaaH EEAH ! EAH !!!
« c’est à travers l’intuition pure de l’espace et du temps. »
Masturbation. ADÈLE. ADÈLE. ADÈLE. ADÈLE.
« Alors, on se voit la semaine prochaine. » Il est quelle heure ? (11:20 A.M.)
Merci.
Il est quelle heure ? (12:06 P.M.) Adèle, je t’aime. Cafétéria. Trop de monde. Trop de bruit.
« Pis, pas trop de devoirs ? »
Non, ça va quand même bien en ce moment.
« Content pour toi. Faut dire qu’on est juste chanceux d’avoir un aussi bon professeur dans un cours sur Kant. »
On est choyés, je suis totalement d’accord là-dessus.
« Ça va bien toi, sinon ? »
Oui, ça va bien. Tout est tranquille. Allez, ciao !
…………………………..Est-ce que je vais le revoir demain ? Pense pas à demain, mon petit câliss. Il est quelle heure ? (02:27 P.M.) Adèle, fuck. Froid, FRoiD, -15°C, Adèle, je t’aime. ///// Pschiiiit. « PARCOURS : 292. DIRECTION : SAINT-AUGUSTIN. »
Bip. Pas de place. Câlisse. Il est quelle heure ? (03:56 P.M.)
AAAAAAAH ! ������������ Habit – (Uniform, 2017). Trafic……. / je t’aime Adèle.
Maison……..Pomme….Chambre…..Chaise…….Ordinateur. Allez, dégage le chien.
Pfff… Il est quelle heure ? (05:08 P.M.)
Mouchoirs.
Clic. Nouvelle fenêtre privée. Clic. (La porte est fermée. Personne à la maison.)
Play.
« ********** » « ****** ? » « ******** »
« ******** ! » Climax, un film de Gaspar Noé. ///////////// ////////// /////// //////
Pas d’énergie. Livre à lire sur ������������ Kant. Nietzsche critique Kant dans le Crépuscule des idoles. Hitler pensait que Nietzsche était antisémite, mais, mais mais…… MAIS Nietzsche n’était pas antisémite. Il détestait le mari de sa �������� sa sœur, parce que c’était un antisémite. Heidegger était un nazi. Les Allemands, les nazis, les Juifs. Spielberg a réalisé un bon film sur les Juifs. Bibliographie sur Kant. Les Prolégomènes, non mais franchement, c’est quoi ce nom ?
prolégomènes PROlégomènes ???? LÉGOMÈNES/LEGO/LÉGAUX LÉLÉLÉLÉLÉLÉLÉLÉLÉLÉLÉLÉLÉL/
« Émilien, on mange ! » BLOCS LÉGAUX LEGAULT Le troisième lien est une aberration.
OK, je descends.
When the sun goes down
Yeah
Yeah Qu’est-ce qu’on va manger ce soir ? Des prolégomènes ?
Yeah No really…
Down Down LÉLÉLÉLÉLÉLÉLÉLÉLÉL
Ça sent bon ! Il est quelle heure ? (06:42 P.M.)
Il fait dont ben froid dans la cuisine ! Peut-être que l’isolant ����������������
« Qu’est-ce que tu en penses, Émilien ? »
Excuse-moi, j’ai pas entendu. Tu disais ?
« Toujours dans la lune, ça a pas de bon sens ! Est-ce que tu aimes le poulet de ce soir ? »
Il est excellent, merci beaucoup ! « En tout cas, faudrait acheter WHEN THE SUN GOES DOWN //// Dentifrice. J’ai un examen demain. J’ai un exam demain. J’ai un eamen dem ain. Ai un examen de mains. J’ai un examen demainé. Jai un examen demais. J’ai un examen dmain. J’ai un amen de main. Amen.
Il est quelle heure ? �������������� (08:29 P.M.)
4 étapes. Aller aux toilettes. Se laver le visage. Prendre sa douche. Se sécher avec la serviette.
Night is young and the music's hiiiiiiigh (ABBA, 1976). HEUHIGH HEUHIGH……….. L’eau est gelée.
Digging the dancing queeeeeeeeen
YOU CAN DANCE YOU CAN JIVE….OF YOUR
Peut-être que les lesbiennes ****************************. Prendre le savon.
Dance ____L’eau est trop chaude.
4 étapes. Frotter les bras, le ventre, les jambes, les pieds, le visage, le cou, les yeux, les aisselles, le plancher //
OK, on se calme.
…………………………………Pyjama. Lit. Noir.………Qu’est-ce que je vais faire demain ? (10:30 P.M.) Il est quelle heure ? 10:30, 10:30, 1030, 10:30, 10 30. 10 301 3010 300 310 30 130 Il est quelle heure ? (10:31 P.M.) Putain.
Deux prolégomènes pour le prix d’un. Lesbiennes. Ordinateur. Big fucking murder.
Adèle.J’ai envie de m’arracher la peau.
Clic.
Youtube : comment arrêter de penser ?
Non, arrête… Arrête. Comment arrêter de penser ?
Partagez plus Polluez moins
Changez vos habitudes de consommation avec Partage Club, une application mobile de partage d’objets gratuite pour la communauté universitaire.

Activez votre abonnement dès maintenant avec les codes promotionnels :
• Communauté étudiante
ULAVAL2023ETUD
• Membre du personnel
ULAVAL2023EMPL
Télécharger l’application
En partenariat avec

