












Rédactrice en chef
Emmy Lapointe (elle) redaction@impactcampus.ca
Chef de pupitre actualités
Antoine Morin-Racine (il) actualites@impactcampus.ca
Cheffe de pupitre aux arts
Frédérik Dompierre-Beaulieu (elle) arts@impactcampus.ca
Journaliste multiplateforme
Camille Sainson (elle) societe@impactcampus.ca
Journaliste multiplateforme
Léon Bodier (il) multimedias1@impactcampus.ca
Journaliste multiplateforme
Marie Tremblay (elle) multi2@impactcampus.ca
Journaliste édimestre
Mégan Harvey (elle) photos@impactcampus.ca
Directrice de production
Paula Casillas Sánchez (elle) production@impactcampus.ca
de la couverture par Paula Casillas Sánchez
Journalistes collaborateur.rices Dayanne Rodrigues., Émilien Côté, Julianne Campeau et Carolanne Foucher
Conseil d’administration AGA 7 Novembre
Contact publicitaire publicite@chyz.ca
Impression
Publications Lysar inc. Tirage : 5000 exemplaires Dépôt légal : BAnQ et BAC
Impact Campus ne se tient pas responsable de la page CADEUL et de la page ÆLIÉS dont le contenu relève entièrement de la CADEUL et de l’ÆLIÉS. La publicité contenue dans ImpactCampus est régie par le code d’éthique publicitaire du journal, qui est disponible pour consultation au : impactcampus. qc.ca/code-dethique-publicitaire
Impact Campus est publié par une corporation sans but lucratif constituée sous la dénomination sociale Corporation des Médias Étudiants de l’Université Laval.
1244, pavillon Maurice-Pollack, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6 Téléphone : 418 656-5079
ISSN : 0820-5116
Découvrez nos réseaux sociaux !







Dès le 21 novembre






Découvrez les nouvelles vidéos de notre communauté de recherche qui répond aux questions du grand public sur une foule de sujets.
Un impact collectif
Sisyphe ou l’art de l’inachèvement heureux par Emmy Lapointe
12 L’hyperréalité, un espace où « ce réel disparu cède la place à son simulacre »* par Léon Bodier
20 paroxysme.mp4/hyper-pop par Frédérik Dompierre-Beaulieu
32 Briser le plafond de verre par Marie Tremblay
36 Dans la noirceur par Emmy Lapointe
40 O Mundo está em chamas ! par Dayanne Rodrigues
42 Créatures de tous les extrêmes par Marie Tremblay
44 Direction : le sommet par Camille Sainson
48 La mémoire collective, une faculté qui amplifie par Marie Tremblay
53 Extrêmes par Paula Casillas et Camille Sainson
58 L’Horoscope culturel d’Impact Campus par l'équipe d'Impact Campus
62 Le Palmarès de Chyz 94.3 par l'équipe de Chyz 94.3
64 Top 10 films pour la fin de l'année 2024 par Camille Sainson
66 La naissance de l’autre, la mort de soi par Emmy Lapointe
68 Jusqu’ici tout va bien… Divagations autour de l’éternisation de la Fin du monde par Antoine Morin-Racine
76 Deuxième vie par Émilien Côté
80 Le point d’ébullition par Julianne Campeau
82 par Carolanne Foucher
P rticip tion individuelle seulement
Être étudi nt u premier cycle l’Université
• Du 17 novembre u 20 j nvier (inclusivement)

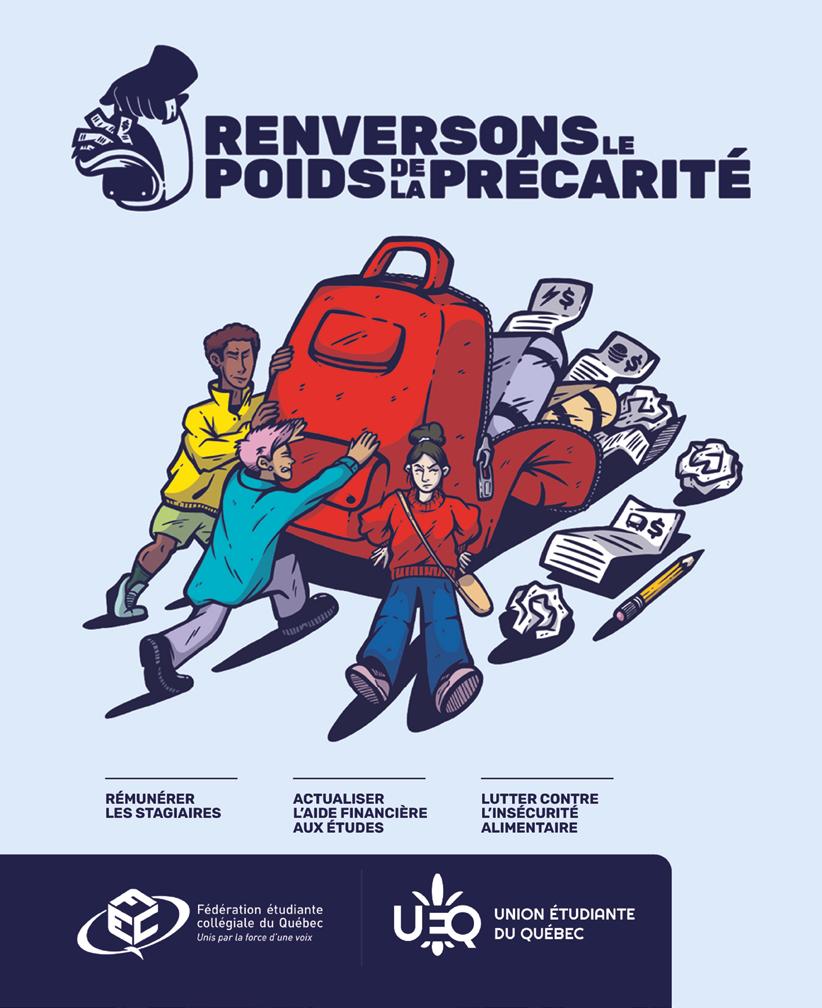


Créée en automne 1997 par le Comité Exécutif de l'ÆLIÉS, la Chaire Publique contribue à mettre en valeur l’avancée des connaissances des divers domaines d’enseignement et de recherche de l’Université Laval
Une fenêtre ouverte sur le savoir
L
c u l t u r e l l e d e l ’ A E L I É S E l l e o r g a
p o u r l e b é n é f i c e d e s m e m b r e s d e l ’ A E L I É S e t d e l a
c o m m u n a u t é u n i v e r s i t a i r e e n g é n é r a l e . E l l e v i s e a i n s i
à m e t t r e e n v a l e u r l ’ a v a n c é e d e s c o n n a i s s a n c e s d e s
d i v e r s d o m a i n e s d ’ e n s e i g n e m e n t e t d e r e c h e r c h e à
l ’ U n i v e r s i t é L a v a l
Une véritable tribune sociétale
D e p u i s p l u s d e 2 5 a n s , l e c a l i b r e d e s é v é n e m e n t s
o r g a n i s é s f o n t d e l a C h a i r e p u b l i q u e A E L I É S u n e
v é r i t a b l e t r i b u n e s o c i é t a l e , a v e c e n t ê t e d ’ a f f i c h e ,
d ’ é m i n e n t s p e n s e u r s d e n o t r e t e m p s C e s g r a n d s
d é b a t s e t p a r t a g e s a v e c l e s é t u d i a n t s d e 2 e t d e 3
c y c l e d e l ’ U n i v e r s i t é L a v a l s o n t a u c œ u r d e s
p r é o c c u p a t i o n s c o n s t a n t e s q u e c o n n a i s s e n t n o s
s o c i é t é s e e
JOINDRE LA CHAIRE PUBLIQUE
Maison Marie Sirois
2320, rue de l'Université Université Laval Québec (Québec) G1V 0A6
Événements scientifiques & culturels
D e s c o n f é r e n c e s t h é m a t i q u e s e t
d e s o c c a s i o n s d e r e n c o n t r e s s u r l e s
g r a n d s e n j e u x s o c i é t a u x a c t u e l s
Accompagnement en matière de vulgarisation scientifique
R e n f o r c e m e n t d e s c o m p é t e n c e s d e l a
c o m m u n a u t é é t u d i a n t e d e l ’ U n i v e r s i t é
L a v a l e n m a t i è r e d e v u l g a r i s a t i o n
s c i e n t i f i q u e .
Appui aux associations et structures de l’Université Laval
A p p u i e t p a r t e n a r i a t s t r a t é g i q u e e n
m a t i è r e d ’ o r g a n i s a t i o n d ’ é v e n e m e n t
c u l t u r e l e t s c i e n t i f i q u e
chaire.publique@aelies.ulaval.ca www.chairepublique.com +1 (418) 656 7190
/chairepubliqueneo
/Chaire Publique




Mont-Orford, [Vers 1890-vers 1965], BAnQ Québec, Collection Magella Bureau, (03Q,P547,S1,SS1,SSS1,D324), Photographe non identifié.

Par
Emmy Lapointe, rédactrice en chef

L’essai de Camus sur le mythe de Sisyphe me fascine depuis que je l’ai lu à la fin du secondaire. C’est sans doute ce qui me rapproche le plus d’un étudiant du cégep Limoilou membre du comité communiste, et la vérité est un peu gênante; c’est un texte auquel je retourne souvent. L’essai peut paraître un peu maladroit en 2024 alors que Camus aborde la question du suicide comme un enjeu philosophique plutôt que social ou psychologique, mais c’est un texte de 1942.
Alors que Pearl Harbor vient d’être attaqué et que la rafle du Vélodrome d’hiver est en train de se préparer, Camus, par le biais du suicide, pose une question très simple : la vie vaut-elle la peine d’être vécue ? Et il prend comme appui Sisyphe, personnage mythologique connu (voire usé), qui, après avoir déjoué la mort et les dieux, est condamné à hisser une immense roche jusqu’en haut d’une montagne. Mais cette roche, éternellement, retombe une fois arrivée au sommet, et Sisyphe doit la monter encore et encore.

Pour Camus, le tragique ne naît pas du geste de monter la pierre et de la voir redescendre chaque fois, le tragique naît parce que Sisyphe monte la pierre en sachant qu’elle redescendra, et pourtant, il continue de la monter. Mais Sisyphe monte-t-il la roche pour qu’elle atteigne le sommet, pour qu’elle atteigne ce tout petit plateau et qu’elle y reste pendant quelques secondes ?
Autre considération philosophique de dude blanc nous provenant cette fois-ci de notre bon vieux Schopenhauer. Dans son livre Le Monde comme volonté et comme représentation, il explique que l’expérience humaine se construit autour d’un cycle fort simple; nous désirons et donc nous souffrons, puis nous obtenons et donc, nous nous ennuyons. Tic-tac, tic-tac, toute notre vie sur une pendule avec, en son centre, le moment où nous comblons notre désir.
Constater ça, c’est aussi constater le tragique.
L’idée de la pendule de Schopenhauer comme la réactualisation du mythe de Sisyphe par Camus repose sur cette réflexion : à quoi bon faire les choses si chaque fois, après avoir atteint un point culminant, elles dépérissent ?
Après une conversation d’environ une centaine de pages avec lui-même et quelques philosophes morts, Camus aboutit à cette idée : il faut imaginer, malgré le tragique derrière la chute inévitable de la roche, Sisyphe heureux.
Il explique juste que la roche, c’est le projet de Sisyphe et
que la monter devrait suffire « à remplir un cœur d’homme ». De son côté, Schopenhauer dit que par la compassion, par la contemplation, par l’affranchissement des désirs (si nous admettons qu’une telle chose est possible), nous pouvons nous échapper, au moins temporairement, du cycle incessant de souffrance et d’ennui.
Ce que j’en comprends, quand je relis leurs vieux textes un peu poussiéreux à la lumière de nombreux « ça donne quoi tout ça » existentiels que j’ai accumulés et qui peuplent la vie universitaire ou la vie tout court, c’est qu’attendre le sommet est la chose la plus dangereuse qui soit.
Un jour, mon premier livre est sorti en librairie et je n’ai rien ressenti. Un autre jour, j’ai déposé mon mémoire et je n’ai rien ressenti. Pourtant, l’écriture du livre m’a procuré de la joie. La recherche et la rédaction du mémoire aussi. Simplement, l’achèvement en tant que tel ne m’a rien procuré si ce n’est l’impression de ne pas ressentir la bonne chose. Au départ, je pensais que c’était parce que je vivais toujours « dans le futur » et que je ne pouvais donc pas ressentir la joie d’un événement que je sentais déjà loin. En vrai, il y a assurément un peu de ça, mais c’est surtout que je ne perçois pas l’achèvement.
Le livre que vous tenez entre vos mains, je l’ai commencé, puis j’en ai « terminé » une première version, une seconde, j’ai signé un contrat, je l’ai envoyé à l’impression, il est sorti en librairie. Aucun de ces points n’était vraiment plus haut qu’un autre quand je les franchissais, pas même plus haut que l’écriture en elle-même; ils formaient plutôt une constellation un peu informe. Alors, je ne sais pas quand j’ai terminé mon livre, je ne sais même pas si je l’ai vraiment terminé tout comme je ne me souviens pas du moment où je suis tombée amoureuse ou de celui où j’ai cessé de l’être. Je peux vous dire, pour donner du sens aux récits que je vous et me raconte, qu’il y a eu un avant, un après, qu’il y a eu ici un point névralgique et là un autre, mais la vérité, c’est qu’il y a surtout eu un pendant. Et c’est à ça que j’essaie de me raccrocher quand je pense au dépôt de la thèse ou pire au post-doc alors que je n’ai pas une ligne d’écrite. C’est à cette idée très simple que je me raccroche quand je pense aux sentiments que je peux développer ici et là et que je tente de les inscrire dans un discours rationnel et de les structurer. Je me raccroche à cette idée selon laquelle je dois donner un sens aux choses, parce que je les fais et les vis, pas parce qu’elles seront faites, vécues, à refaire, à revivre.

L’hyperréalité, un espace où « ce réel disparu cède la place à son simulacre »*
« Avez-vous déjà questionné la nature de votre réalité ? » C’est la question que le créateur des robots Bernard Lowe pose à sa création, la gynoïde Dolores, dans la série-télévisée HBO Westworld (Joy, Nolan, 2016-2022). Cependant, cette réflexion est-elle amenée à la femme robot pour lui faire prendre conscience de sa nature artificielle, ou est-elle, dans un sens plus large, posée directement aux spectateur.rices devant l’écran ? « Questionner la nature de sa réalité » c’est remettre en question ou douter de ce qui est considéré comme vrai ou réel, ou encore remettre en cause la perception qu’on a de la réalité.
Par Léon Bodier, journaliste multiplateforme
La réalité et les philosophes
C’est « l’une des questions philosophiques les plus anciennes, qui ne cesse de tourmenter l’esprit » (Salamé, 2016, p. 5) des théoriciens et philosophes depuis la Grèce antique, commençant par Parménide et Héraclite, des penseurs présocratiques qui ont tous deux abordé ces questions sur la nature de la réalité. Parménide, en particulier, a proposé une vision de la réalité comme étant unique et immuable. Dans son poème philosophique, De la nature, il affirme que l'être est et que le non-être n'est pas, ce qui implique que le changement et la multiplicité ne sont que des illusions. Parménide est l’un des premiers à affirmer que la réalité perçue par les sens est trompeuse et que seule la raison peut révéler la vraie nature du monde. Héraclite, quant à lui, est souvent opposé à Parménide en raison de sa conception du monde en perpétuel changement. Il est célèbre pour sa maxime « On ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve », soulignant l'idée que la réalité est constamment en mouvement et que tout est flux. Pour Héraclite, la réalité est une succession de transformations, ce qui complique l'idée d'une vérité fixe ou d'une réalité objective stable. Tous deux questionnent la nature du réel, l’un en insistant sur son immuabilité, l’autre sur son caractère changeant.
Protagoras, également un sophiste présocratique, introduit un scepticisme sur l'idée qu’une réalité objective puisse exister tout court avec sa célèbre maxime « L'homme est la mesure de toutes choses ». Selon lui, il n'existe pas de vérité universelle, chaque individu étant capable de percevoir la réalité de manière subjective. En d'autres termes, ce qui est vrai pour une personne peut ne pas l'être pour une autre. Cette approche relativiste radicale remet fondamentalement en question la notion de réalité objective, et renforce l'idée que la réalité est façonnée par nos perceptions individuelles. Ceci contraste avec les conceptions de Parménide et d'Héraclite, en ce qu'il nie l'existence d'une réalité en dehors des perceptions humaines.
En s’inscrivant dans une tradition de réflexion amorcée par Parménide, Protagoras et Héraclite, Platon a synthétisé et systématisé cette question de la réalité objective en distinguant le monde des Idées du monde sensible. Le concept de la caverne de Platon apparaît dans La République et illustre sa vision du monde. Dans ce mythe, des prisonniers sont enchaînés dans une caverne et ne perçoivent que des ombres projetées sur un mur, croyant que ces ombres constituent la réalité. Platon utilise cette métaphore pour démontrer que la réalité perçue par nos sens n'est qu'une illusion, et que seule la connaissance des Idées — ou Formes — permet d'atteindre la vérité.
Ainsi, la caverne invite à une distinction entre le monde sensible, imparfait et changeant, et le monde intelligible, immuable et parfait, suggérant que la réalité objective ne peut être appréhendée que par la raison.
Gottfried Wilhelm Leibniz, dans sa métaphysique, notamment avec l'exemple du « brin d'herbe », introduit ensuite le concept de la monadologie. Pour lui, la réalité est composée d'une infinité de « monades », des entités individuelles et indivisibles qui reflètent chacune l'univers tout entier. Chaque monade, bien que fermée sur ellemême, possède sa propre perception du monde. Dans cet esprit, le brin d’herbe est autant une manifestation de la complexité infinie du monde que de l'interconnexion de toutes les choses. Leibniz défend l'idée d'un univers où chaque élément contient une perspective unique de la totalité, ce qui renforce l'idée que la réalité objective est difficilement saisissable, car elle dépend de multiples points de vue harmonisés par un plan divin.
En lien avec cette question sur la réalité objective, des philosophes comme Emmanuel Kant ont également apporté leur contribution en affirmant que nous ne pouvons jamais accéder à la « chose en soi », mais seulement aux phénomènes tels qu'ils apparaissent à travers les filtres de nos structures cognitives. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, à son tour, a cherché à dépasser ce clivage entre subjectif et objectif en affirmant que la réalité se développe dialectiquement à travers l'histoire, par le processus de l'Esprit s'autocomprenant. Ainsi, l'histoire devient le lieu où la réalité/ l'Esprit progresse vers une compréhension de soi-même, intégrant à la fois les dimensions subjectives et objectives dans un mouvement unifié.
En somme, la question de la réalité objective a évolué depuis Parménide depuis une vision transcendantale de la vérité vers une reconnaissance du caractère subjectif des perceptions humaines, pour aboutir à une vision plus complexe de la réalité où interagissent subjectivité et objectivité. Pourtant, c’est une idée plus provocante qui reste de cette réflexion sur la réalité : « Dans son mythe de la caverne, Platon prouve que l’homme préfère l’illusion à la vérité » (Salamé, 2016, p. 5).
Crise globale : « le meurtre du réel et la naissance de l’illusion séductrice » (Salamé, 2016, p. 14)
L'anthropocène désigne une nouvelle époque géologique qui se caractérise par l'avènement des humains comme principale force de changement sur Terre, surpassant les forces géophysiques (vie-publique.fr). Cet âge marqué par l'impact significatif des activités humaines sur l’environnement se distingue également par une série de
crises globales interdépendantes. C’est une période de désordre planétaire profond où les actions humaines ont bouleversé les systèmes naturels et sociaux, entraînant des dérèglements à la fois au niveau écologique, politique, économique et moral.
Dans la culture planétaire actuelle, le modèle de consommation et de production de masse encouragé par le capitalisme mondialisé, participe à la déstabilisation des équilibres naturels et sociaux, créant une spirale où les besoins artificiels prennent le dessus sur les nécessités vitales : « La culture de masse est celle de l’excès » (Salamé, 2016). L'exploitation effrénée des ressources naturelles, la destruction de la biodiversité et les changements climatiques soulignent l'incapacité pour l'humanité d’adopter une éthique durable. En effet, les dérèglements climatiques (augmentation des températures, montée des océans, etc.), les catastrophes naturelles ainsi amplifiées, et la destruction d'écosystèmes essentiels menacent tous la survie de nombreuses espèces, y compris l'humanité, et perturbent les cycles naturels nécessaires au maintien de la vie. Ces économies basées sur une croissance infinie entrent en contradiction avec les limites planétaires, provoquant également des inégalités croissantes entre les pays et les individus ; les tensions géopolitiques liées à l'accès aux ressources, mettent en péril la coopération internationale. Ainsi, l’humain, à travers ses systèmes économiques, politiques, et médiatiques est submergé par la surconsommation, et l'accélération de la mondialisation est vue comme une accélération de cette aliénation.
« Mais à une époque que Baudrillard semble vouloir situer vers la fin de l’ère industrielle et l’avènement de l’ère informatisée, l’homme a voulu parfaire le monde réel pour être heureux. C’est la raison pour laquelle l’homme a voulu imiter Dieu. Par conséquent, il veut créer un autre monde. Cela le pousse à détruire le monde réel » (Salamé, 2016, p. 18).
Face à ce monde, le philosophe français Jean Baudrillard a prolongé et radicalisé les réflexions sur la réalité, affirmant que, dans la société contemporaine, la distinction entre le réel et l'imaginaire s'efface. Contrairement à Parménide, Héraclite, et Protagoras qui questionnaient la nature de la réalité objective ou subjective, Baudrillard propose que nous vivons désormais dans une réalité simulée, où les signes et les symboles ont pris le dessus sur le réel luimême : « Baudrillard a modernisé l’allégorie de la caverne : il n’a fait que reprendre la théorie platonicienne, mais en lui donnant une forme actuelle » (Salamé, 2016, p. 88).
Dans ses ouvrages comme Simulacres et Simulation (Baudrillard,1981), le philosophe développe l'idée de Platon, voulant nous placer dans un monde de simulacres, où les copies, les médias et les représentations n'ont plus de référent réel. C'est ce qu'il appelle L’HYPERÉEL : une réalité fabriquée, où les distinctions entre vrai et faux, réel et virtuel, se dissolvent.
« Parlons donc du monde d’où l’homme a disparu. Il s’agit de disparition, et non pas d’épuisement, d’extinction ou d’extermination. L’épuisement des ressources, l’extinction des espèces, ce sont là des processus physiques, ou des phénomènes naturels. Et là est toute la différence, c’est que l’espèce humaine est sans doute la seule à avoir inventé un mode spécifique de disparition, qui n’a rien à avoir avec la loi de la nature. Peut-être même un art de la disparition » (Baudrillard, 2008, p. 11).
L'anthropocène est ainsi vu par Baudrillard comme un espace où se manifeste une sorte d’univers parallèle. La nature elle-même devient une hyperréalité, façonnée par les technologies humaines, créant un environnement qui mime la réalité naturelle, mais en est une version artificielle et détachée. Par ailleurs, la montée en puissance de l'informatique, des médias, et de la communication conduit à une surcharge de données et d’images qui « sont complices de l’homme, car elles l’aident à camoufler le réel » (Salamé, 2016, p. 19). La société ne consomme plus des objets ou des idées réelles, mais des représentations immatérielles, des simulacres d’information exacerbant l’effet d’hyperréalité parce que « l’homme préfère l’illusion à la vérité » (Salamé, 2016, p. 5). La prolifération de ces systèmes caractérisés par l’exagération des flux d'informations et de simulations qui semblent plus réels que le réel est fondamentalement détachée de tout ancrage concret : « Ce qui se passe, c’est plutôt que l’art s’est substitué à la vie sous cette forme d’esthétique généralisée qui donne finalement une « disneyfication » du monde » (Baudrillard, 1983, p. 150).
Baudrillard évoque la manière dont la morale, la politique, et l'économie deviennent elles-mêmes des simulacres, des systèmes autoréférentiels déconnectés de toute substance réelle. En effet, ces simulacres créent des « figures mensongères », des représentations sans lien avec un référent originel dont l’humain, aliéné par ces illusions, n’est plus capable de distinguer le vrai du faux. Par exemple, l’évolution de l’argent, de l’art et de la mode tend vers des formes de plus en plus immatérielles. L'argent n'a plus de valeur matérielle, il devient une abstraction flottante (cryptomonnaies, spéculation). L'art moderne, quant à lui,
devient souvent une accumulation et une répétition mécanique de formes (comme chez Andy Warhol ou Jeff Koons). La mode, enfin, se déplace vers une culture de l'image et de l'éphémère. Ces excès créent un monde où le tangible n'a plus trop de sens.
Dans la crise actuelle, le réel est vu par Baudrillard comme une entité inaccessible parce qu'il est unique, pur, et insaisissable pour la conscience humaine. À chaque tentative de compréhension, l'homme projette une version de ce réel, mais cette version n'est jamais fidèle à la réalité.
C'est ce processus de projection et de reconstruction artificielle qui tue le réel, selon Baudrillard, car en cherchant à le saisir, l’Humain finit par le remplacer par une copie imparfaite : « Quand on dit que la réalité a disparu, ce n’est
pas qu’elle a disparu physiquement, c’est qu’elle a disparu métaphysiquement. La réalité continue d’exister – c’est son principe qui est mort » (Baudrillard, 2004, p. 12). Ces thèmes convergent vers l’idée d’un monde dominé par l'hyperréel, où les distinctions fondamentales entre vrai et faux, nature et artifice, original et copie, sont devenues caduques : « Tout ce monde de fiction s’enracine dans la haine du naturel, de la réalité, il est l’expression d’un profond malaise avec le réel » (Nietzsche, 1990, p. 33).
Cet effet laisse place à une aliénation extrême où Nietzsche voit un monde qui tend pleinement vers le nihilisme, mais « [i]l serait intéressant alors de voir que ce monde hyperréel critiqué par Baudrillard, est un lieu de passage nécessaire à l’avènement du sens et à l’accomplissement du vrai progrès humain. » (Salamé, 2016, p. 233).
Uglies est un roman dystopique de Scott Westerfeld paru en 2005 et adapté pour les plateformes de streaming par Netflix cette année. Dès les premières pages, le livre nous plonge dans un monde futuriste où toute la population est considérée comme « Ugly », jusqu’à ce qu’iels soit rendu. es « Pretty » par une chirurgie esthétique extrême lorsqu’iels atteignent l’âge de 16 ans.
Dans la culture actuelle, centrée autour d’une hyperconnection mondialisée aux réseaux sociaux et aux médias, on comprend facilement la production de Uglies (McG, 2024) dix ans après la vague de film dystopique qui avait commencé en 2014 avec Hunger Games (incluant aussi Divergent, Maze Runner, The 5th Wave, The Darkest Minds, The Giver, etc.). Plus focalisé sur les crises environnementales et les sociétés de contrôle à l’époque,
Netflix propose aujourd’hui un film qui se déroule plutôt dans un monde dystopique où chaque individu subit une transformation esthétique pour atteindre une norme de beauté prédéterminée. Par-là, le film Uglies donne une vision complexe de la transformation de la réalité sous l’effet des signes et des représentations médiatiques – un exemple concret de critique de l’Hyperréel dans laquelle notre société s’est plongée ces dernières années.
Par exemple, la mode, pour Baudrillard, est une production de sens qui semble arbitraire, mais qui en réalité est au cœur du sociologique : « La mode est ce qu’il y a de plus inexplicable : cette contrainte d’innovation de signes, cette production continuelle de sens apparemment arbitraire, cette pulsion de sens et le mystère logique de son cycle sont en fait l’essence du sociologique » (Baudrillard, 1972,

p. 89). Elle crée un flux constant de nouveaux signes qui servent à maintenir la société en perpétuelle transformation. Dans le film à l’étude, l’apparence physique est un code social strict à respecter, où l’innovation devient le mot d’ordre, engendrant une esthétique de l’artifice. Dans une culture hyperréelle comme celle d’Uglies, la mode devient une simulation de soi-même, un cycle d’innovation sans fin qui fait perdre tout lien avec la réalité tangible (un concept également aperçu dans le Panem de Hunger Games, par exemple).
Dans cette culture, où la perfection physique devient une obligation sociale, la société hyperréelle de Uglies met en scène le concept d’hypercorps : « Il (l’hypercorps) est un objet qui a pour unique fonction de consommer ou d’être consommé. Il est idéalisé par les médias et les publicités qui créent un véritable culte du corps. Tout ce qui est rattaché au corps est vénéré : la peau, les muscles, la santé, la silhouette, les besoins, et la sexualité » (Salamé, 2016, p. 37). Le corps transformé – devenu un objet de consommation, idéalisé par les médias et les publicités –est vénéré, non pour sa réalité ou ses besoins naturels, mais pour sa capacité à être modifié et amélioré. La perception du corps a ainsi perdu tout lien avec ce qui est « réel », et ce sont les normes imposées par le système hyperréel qui dictent ce qui est accepté comme réalité.
Baudrillard définit le réel comme ce qui est unique et irréductible, mais dans la culture de Uglies, le processus de transformation esthétique est précisément un mécanisme d’élimination des singularités où les personnages, reconstruits, remplacés par des représentations identiques, sont tous modifiés pour correspondre à une norme unique : « Baudrillard définit le réel comme étant ce qui est égal à lui-même, l’objet insolite, l’évènement inédit, la personne singulière et le monde atypique. Or le monde réel n’existe plus, car ce monde est celui de la similitude. Il contient une multitude d’images, d’évènements et de personnes identiques. Toutes les spécificités du monde réel sont annulées » (Salamé, 2016, p. 19). Ce qui reste est une personne reconstruite par les signes, les objets de consommation, et les représentations visuelles précises ; une « individualité de synthèse » où l'individu traditionnel, avec ses passions et son caractère unique, a disparu dans ce monde fonctionnel : « L’équivalent d’une purification ethnique qui toucherait non seulement des populations singulières, mais s’acharnerait sur toutes les formes d’altérité. Celle de la mort – qu’on conjure par l’acharnement thérapeutique. Celle du visage et du corps qu’on traque par chirurgie esthétique » (Baudrillard, 1995, p. 157). En effaçant les formes d’altérité (maladie, mort, différences de race et de langue), quand l’homogénéité
annihile l’individualité, cet univers dystopique élimine ce qui rend le monde réel.
Cette chirurgie obligatoire est finalement la manière dont la société de Uglies parvient à tout calculer pour maximiser sa survie : « La finalité ne disparaît pas au profit de l’aléatoire, mais au profit d’une hyperfinalité, d’une hyperfonctionnalité : plus fonctionnel que le fonctionnel, plus final que le final – hypertélie » (Baudrillard, 1983, p.12). Le concept d’hypertélie — une finalité poussée à l'extrême au point de devenir contre-productive — résonne particulièrement dans cette dystopie, où l’obsession de la perfection finit par aliéner les individus et détruire leur humanité. Les modifications corporelles sont pour eux un moyen de radicalement éliminer la différence et les guerres, car ils créent des visages poussant une réaction biologique de désir de protection. Afin de survivre en tant qu’espèce humaine, les personnages perdent finalement ce qui les rend humains : « En éliminant l’autre sous toutes formes (maladie, mort, négativité, violence, étrangeté) sans compter les différences de race et de langue, en éliminant toutes les singularités pour faire rayonner une positivité totale, nous sommes en train de nous éliminer nous-mêmes » (Baudrillard, 1995, p. 161).
Fondée sur des simulacres de beauté et de perfection qui ne correspondent à aucune réalité naturelle, cette hyperréalité crée une forme d'aliénation pour les personnages qui ne peuvent plus percevoir leur véritable identité, étant constamment confrontés à un simulacre de perfection. Un concept qui peut être mis en lien avec l'idée que « dans notre propre monde de simulacres » il existe également des signes et des représentations qui ont pris le dessus sur toute réalité tangible et où l’individu n’a plus vraiment d’accès à un soi authentique.
Le film Uglies ne fait pas seulement référence à nos préoccupations actuelles vis-à-vis de l’apparence physique, de la perfection, des manipulations technologiques et des normes esthétiques, il les amplifie, les stylise et les transforme en hyperréalité. Le film participe à un cycle de simulacres et de représentations qui brouillent la distinction entre la réalité et la fiction : le monde de Uglies devient alors une sorte de réalité plus vraie que la réalité ellemême, car il renforce et intensifie des angoisses culturelles déjà présentes.
Baudrillard critique la quête de la perfection visuelle qui, en atteignant un niveau de détail excessif (par exemple en haute définition), perd sa capacité à créer de l'illusion et ne devient qu'un spectacle sans substance. Dans cette vision, l’image est devenue si omniprésente et parfaite


qu’elle ne représente plus une réalité, mais la remplace. Dans une culture hyperréelle, les films eux-mêmes, comme Uglies, deviennent des simulateurs d’un monde qui n’existe plus. Ils créent une réalité alternative, une perfection visuelle pour ne devenir qu'une représentation en ellemême, coupée de toute réalité : « Nous allons de plus en plus vers la haute définition, c’est-à-dire vers la perfection inutile de l’image. Qui du coup n’est plus une image, à force de se produire en temps réel. Plus on approche de la définition absolue, de la perfection réaliste de l’image, plus se perd sa puissance d’illusion » (Baudrillard, 1996, p. 161).
De plus, le fait que Uglies critique la quête de perfection esthétique tout en étant lui-même un produit hyperesthétique (où tout est travaillé à l'extrême : les effets visuels, les visages des acteurs, les décors futuristes) place le film dans une position paradoxale. Il dénonce une forme de société, mais le fait à travers les outils mêmes qui amplifient l’hyperréalité. Cela crée une mise en abyme où le.a spectateur.rice est immergé.e dans une hyperréalité tout en étant conscient.e que ce qu’iel consomme est une critique de cette même condition. Ainsi, le film, dans une culture de consommation, devient lui-même un produit de l'industrie culturelle. En tant que tel, il fait partie d'un cycle
de reproduction de contenus où la frontière entre l'authenticité et l'artifice est brouillée. Uglies fait partie d'un genre cinématographique déjà existant – la dystopie, le film postapocalyptique – et s'inscrit dans un réseau de références culturelles qui recycle des thèmes, des motifs et des esthétiques populaires dans les dernières décennies.
En tant que produit de divertissement, le film utilise des récits stéréotypés et une esthétique codifiée qui n'ont plus de lien direct avec ce qu’ils souhaitent représenter. Le film reproduit et critique simultanément des simulacres culturels (comme la beauté standardisée ou l’obsession de l’image), tout en renforçant ce cycle de production esthétique. En ce sens, Uglies est autant une réflexion sur l’hyperréalité qu’un produit direct de cette condition : « Un univers parallèle où tout est inventé par l’homme et où tout est parfait » (Salamé, 2016)

L’Université : « la genèse d’un nouveau monde » (Salamé, 2016, p. 15).
Selon Michel Foucault, un autre philosophe français, une hétérotopie est un lieu concret qui juxtapose plusieurs espaces, reflétant et parfois inversant les normes de la société.
Loin du monde extérieur (le marché du travail, les impératifs économiques, etc.), les universités deviennent ces espaces presque autonomes, structurés par des savoirs, où les signes qui lui sont spécifiques (théories, connaissances, disciplines), n’ont pas nécessairement d’équivalent direct ou de corrélation immédiate avec la réalité sociale extérieure. Néanmoins, cet espace universitaire est, en quelque sorte, une simulation du réel — un lieu où est produit un simulacre de la société à travers ses débats, ses théories et ses réflexions, mais aussi ses structures dans la mesure où on y retrouve des restaurants, un journal, un coiffeur, une banque, une clinique médicale, etc. Pour les étudiant.es et les enseignant.es, l’Université devient un lieu dans lequel iels peuvent donner du sens à leur existence et à leur rôle dans la société – plus d’un.e y reste de l’enfance à la retraite. Elle recrée le monde extérieur, mais sous une forme académique, à la fois réelle et symbolique, distincte, mais en interaction avec le monde extérieur : c’est une hétérotopie hyperréelle.
Dans notre monde contemporain, la violence se manifeste sous des formes invisibles, mais omniprésentes, notamment à travers le quadrillage des rapports sociaux, la ségrégation culturelle et la discrimination professionnelle. Ces forces structurent « le monde extérieur », créant une réalité marquée par des rapports de domination et d’exclusion : « La violence est omniprésente dans nos sociétés, elle camoufle le spectre du réel disparu » (Salamé, 2016, p. 30). Dans ce contexte, l’Université pourrait apparaître comme « un lieu autre » qui offre une échappatoire temporaire à cette violence systémique, se plaçant à l’écart des structures du monde extérieur tout en les reproduisant afin d’envisager les moyens d’ « inverser les normes de la société » sous forme de simulacres théoriques grâce auxquels ces mêmes mécanismes peuvent être analysés et même transformés.
Elle devient un espace où les étudiant.es, à l’abri de la fragmentation sociale et des rapports de violences structurelles du monde extérieur, peuvent repenser ces structures en ayant accès à un monde simulé, où la violence sociale est théorisée, décortiquée, et où l'on peut imaginer d'autres formes d'organisation, afin de rendre visible ce « spectre du réel disparu » (Salamé, 2016, p. 30). Ainsi, l’Université pourrait être un lieu où l’hyperréalité
n’est pas une déconnexion de la vérité, mais une matrice où cette vérité peut être réinventée et réintégrée. Les étudiant.es peuvent ainsi imaginer et élaborer des méthodes pour déconstruire les formes de ségrégation, pour promouvoir l’égalité culturelle, et pour atténuer la discrimination professionnelle une fois de retour dans la réalité sociale.
Au contraire des hyperréalités comme Disneyland et celle aperçue dans l’univers utopique de Uglies, l’Université agit donc comme une « bonne » hyperréalité en ce sens où elle fournit les outils intellectuels et critiques pour interpréter, comprendre et remodeler le monde, permettant ainsi une réintroduction dans la réalité sociale avec une capacité accrue à la transformer. Ce pouvoir de transformation est ce qui différencie ce simulacre d'une hyperréalité stérile : ici, la simulation est un tremplin vers une réappropriation critique et potentiellement transformative du monde extérieur. Ici, le réel est déconstruit pour être reconstruit à travers de nouveaux paradigmes ; au sein de cette hétérotopie hyperréelle, il s’agit de bannir le réel pour mieux redéfinir le monde.
Baudrillard, J. (1972). Pour une critique de l’économie politique du signe, Gallimard.
Baudrillard, J. (1981). Simulacres et simulation, Galilée.
Baudrillard, J. (1983). Les stratégies fatales, Biblio essais.
Baudrillard, J. (1995). Le crime parfait, Galilée.
Baudrillard, J. (1996). Le complot de l’art, illusion et désillusion esthétiques, Sens et Tonka.
Baudrillard, J. (2004). Le pacte de lucidité ou L’intelligence du mal, Galilée.
Baudrillard, J. (2008). Pourquoi tout n'a t’il pas déjà disparu ? , L’Herne.
Denis, M. et F. Gemenne. (2019). Qu’est-ce que l’Anthropocène ? , Vie publique, https : //www.vie-publique.fr/paroledexpert/271086-terre-climat-quest-ce-que-lanthropocene-ere-geologique# : ~ : text=L'Anthropocène%20est%20une%20 nouvelle,d'un%20désordre%20planétaire%20inédit.
Nietzsche, F. (1990). L’Antéchrist, Folio.
Salamé, N. (2016). L’hyperréalité du monde postmoderne selon Jean Baudrillard : essai de lecture analytique et critique, L’Harmattan.
Image A : Code Spotify
Image B : McG, (2024). Uglies
Image C : McG, (2024). Uglies *(Salamé, 2016, p13)







« Plus qu’un genre, mieux qu’une étiquette figée, l’hyperpop est peut-être tout simplement une sensibilité, une manière d’être au monde » (Ackermann, 2024, p. 36).
Article par @_vilainefille_
Pssst.






…ou ici


C’est ici que tout commence …peut-être même là.











« Hyperrapide, hyperconnectée, hypersucrée », telle est la manière dont Julie Ackermann décrit l’hyperpop dans son livre Hyperpop. La pop au temps du capitalisme numérique. Cet avant-goût musical, celui qui devrait être en train de vous percer les tympans, là, maintenant (à moins que vous n’ayez décidé d’ignorer mon introduction, et puis, au fond, je n’y peux déjà plus rien de toute façon), est en effet celui d’une musique (mais pas que) expérimentale, électronique, une pop 2.0. aussi « boursouflée que la culture commerciale dont elle se nourrit. Les voix ne sont pas puissantes mais suraiguës. Les sons ne sont jamais diffus mais catapultés à la vitesse de la lumière. Les synthés ne sont pas un soutien pour la mélodie, ils s’élèvent jusqu’au ciel. Les couleurs, elles, ne sont jamais pâlottes mais éclatantes comme la carrosserie profilée d’un bolide. Enfin, si le

Triste et amer constat que nous lance Ackermann, il faut bien l’admettre. C’est qu’il n’est plus possible d’ignorer ni de fermer les yeux sur cette même-plus-si-insidieuse façon qu’ont le capitalisme et l’idéologie néolibérale de s’immiscer partout – en voilà un euphémisme – et, qu’il soit douloureux de se l’avouer, dans nos sphères les plus intimes. Ils sont écrasants, envahissants, bien que nuisibles et non viables, s’efforcent à déterminer nos identités, nos raisonnements : « les images, les humains, les objets, l’art : tout est avalé par la sphère marchande […] tous les espaces et infimes interstices de la vie sont appréhendés comme des sources potentielles de valeur : les regards, […] les mouvements/ rythmes de vue, la créativité, les relations sociales, les pérégrinations sur nos téléphones et nos ordinateurs » (Ibid., p. 41). Et la libération prend des airs de mirages, car, il nous semble, elle ne peut provenir des mêmes systèmes d’oppression qui ont vu naître et prospérer les conditions mêmes de leur existence et de notre aliénation, de l’intrication toujours plus complexe et tentaculaire des





morceau dispense un sentiment de joie, cette joie sera forcément extatique. Hyperbolique. » (Ackermann, 2024, p. 17).
Née dans les années 2010 avec des artistes comme SOPHIE, 100 gecs, Charli XCX, Hannah Diamond ou le label PC Music d’A.G Cook – certain.es pointeront plus précisément 2013 – il faut savoir que l’hyper(bolique/ rapide/connectée/sucrée)pop se définit, si la préfiguration du terme n’était pas suffisante, dans son rapport à l’excès. Un excès qui, nous le verrons, n’en est pas moins complexe, multidimensionnel, ambiguë, parce que « la formule magique hyperpop tient en effet aux contradictions qu’elle étire » (Ibid., p. 52). Et c’est là tout son charme.

structures qui les composent et de l’expansion vorace de leur domination. Le réalisme capitaliste de Mark Fisher nous l’aura bien appris : nous sommes « malgré nous » face à notre incapacité à nous imaginer en dehors de cet ordre hégémonique et de nous organiser en fonction d’un monde qui se voudrait post-capitaliste.
Personne n’échappe au brainwashing capitaliste.
Ni même l’hyperpop. « Que l’hypercapitalisme définisse en premier lieu les conditions de vie des artistes hyperpop explique leur adhésion ambiguë à ce dernier, et notamment à sa pop music, le genre musical le plus soumis et modelé par la recherche de profit. Au recroquevillement et à l’idéal de rupture, l’hyperpop a toujours préféré embrasser son époque et le manège infernal de la marchandise mondialisée, ne pas se construire contre. Le style est animé par le désir de se sentir vivant.e dans le système capitaliste mortifère, que ce soit par le choix de la jouissance






hédoniste ou en tâchant d’entrer en résonance avec lui. » (Ibid., p. 44).
Personne n’échappe au brainwashing capitaliste.
Ackermann explique que le sujet de l’hyperpop est donc justement celui d’un monde caricaturé, stéréotypé, gonflé, selon cette idée maximaliste, voire de cette posture hypermaximaliste face à un hypercapitalisme. Elle parle alors de capitalisme cartoon : « Si les esthétiques du plastique, du dessin animé et de la caricature sont constituantes du style (on les retrouve sur de nombreuses pochettes et clips, comme sur les singles que réunit la compilation Product de SOPHIE), c’est bien parce qu’elles incarnent la phase terminale et accélérée du devenirproduit néolibéral. Avec ses voix enfantines et ses sodas colorés, l’hyperpop immerge l’auditeur.ice dans les rouages d’un capitalisme cartoon dont l’apparence fun et mignonne masque le caractère agressif et froid » (Ibid.,p. 43).
L’hyperpop, donc, est frénétique. Excessive, faite de contradictions. Elle se définit par le rapport qu’elle entretient aux excès d’une pop, certes, « mais animée par le projet d’être intensément elle-même, et donc d’être intensément pop. Entre imitation et subversion, ironie et sincérité, l’hyperpop pourtant ne choisit pas. Elle voue un amour ambiguë à la culture capitaliste en jouant avec les affects que nous entretenons avec elle. Elle zoome simultanément sur ses qualités tout en révélant la monstruosité des fétiches qui lui sont rattachés, du culte de la lisseur à celui de la marchandise » (Ibid., p.7). L’hyperpop, à la différence peut-être de la pop capitaliste et patriarcale dont elle s’inspire, en est une lucide, consciente, réflexive, qui ne se cache pas de ses inspirations ni de ce qu’elles

impliquent, représentent ou reconduisent. Elle les récupère pour mieux se jouer d’elles.
Lors d’un entretien téléphonique avec l’artiste québécoise Virginie B à propos de son dernier projet musical hyperpop Astral 2000 et de sa relation au genre, elle aborde justement cette lucidité, cette liberté : « Tout le monde y apporte son grain de sel. Y’a quelque chose que j’ai lu qui était "l’hyperpop, c’est une pop qui est consciente d’elle-même". Et c’est vraiment ça : c’est une composition qui va écouter la pop en soi, pis qui va décider de prendre certains éléments, d’en laisser d’autres, d’en condenser plusieurs ensembles, pis d’amener ça pour, par exemple, je sais pas quelqu’un qui est hyperactif. Une composition où ça change à toutes les 20 secondes, où y’a des nouvelles idées qui se suivent et arrivent, mais quand c’est bon, c’est que c’est bien ficelé ensemble. Il est là le travail de l’hyperpop, dans le fait de bien ficeler. Mais aussi, dans le fait d’aller s’inspirer de tout ce que la pop a à offrir, parce que la pop, c’est un immense paysage. Même chose pour la composition visuelle qui accompagne l’hyperpop ! C’est la même chose : c’est prendre des codes de la pop, selon comment on te l’as vendue, donnée, comment on te l’as exprimée. C’est peut-être pour ça d’ailleurs que le y2k est aussi important. Dans l’hyperpop, on référence le y2k parce que c’est une époque de grosse clameur pour la pop. Son gros truc c’était les girls bands, les boys bands, le bubbly, le brillant, le CD, tout était là dans les années 2000. Là, c’est d’aller prendre le kitsch et le quétaine de ça, le fun, pour en faire quelque chose de nouveau. Ce que j’aime avec l’hyperpop, c’est comment les artistes vont prendre ça et vont jouer avec le produit, vont jouer avec le fait que c’est une plateforme qui est produite, et explorer plus loin, se mettre à déranger, à faire bouger les shits »
On peut facilement – même si cela n’est probablement pas si évident – dire de l’hyperpop qu’elle est accélérationniste, mais ne s’inscrit toutefois pas dans une logique de décroissance. L’artiste pop expérimentale pseudoantigone, aussi connue sous le nom de Simone A. Medina Polo, explique, dans un billet de blogue, que « l’accélérationnisme en tant que pratique tend à accepter et embrasser cette complicité pour ce que l’on pourrait décrire comme une forme de technomancie – à savoir une pratique de corruption, de piratage et de dislocation des fondements mêmes de l’accélération » (traduction libre) (Medina Polo, 2021), celle d’un capitalisme toujours plus fort, toujours plus rapide. Ainsi, ce principe d’intensification dont parlent Ackermann et Virginie B, selon lequel « les artistes poussent des caractéristiques de la pop parfois différentes au bout de leur logique » (Ackermann, 2024, p. 48), consiste à accélérer « la pop et en dévoiler l’ultime dessein, la conclusion logique : l’inéluctable devenir-produit de chaque chose – l’art, les humains, les pop stars, le son » (Ibid., p. 52). L’hyperpop vise à mieux détruire et remodeler de l’intérieur, à « se construire dans les entrailles du système » (Ibid., p. 46), à provoquer et accélérer la mise en échec du capitalisme et du patriarcat qu’elle critique tout autant qu’elle assume, « contradiction fructueuse, entre critique de la monstruosité de devenir-produit et célébrations des possibles technologiques » (Ibid., p. 53).
Personne n’échappe au brainwashing capitaliste.
Et l’hyperpop a justement ceci d’intéressante en ce qu’elle permet de rendre compte d’une double posture, faite des tensions d’un environnement socioculturel et technologique idéologiquement marqué qui reconduit d’une part des systèmes de domination et d’exploitation et propose d’autre

part un espace de résistance et d’émancipation, sans pourtant avoir la prétention d’être détachée des conditions qui les voient naître, puisque « l’accélérationnisme revendique l’idée selon laquelle le capitalisme est une fatalité qu’il faut "accepter" et tordre ses logiques afin d’en sortir et d’assister au surgissement d’un autre type de société » (Ibid., p.45). L’hyperpop se sent concernée par cet état du monde tout en désastre ; mais là où le réalisme capitaliste de Fisher, en étant incapable de s’imaginer un futur différent dont il serait encore possible de se saisir, tend à se réfugier dans une pensée hantologique abusivement nostalgique du passé et elle-même incapable d’envisager de nouvelles potentialités culturelles, artistiques et esthétiques – parce que selon lui, « la pop culture est non seulement devenue rétromaniaque, mais cannibale d’elle-même », et qu’elle « serait poussée à réactualiser mécaniquement les mêmes contenus esthétiques », nous trompant de son « illusion d’un renouveau culturel (factice) tout en mobilisant les affects d’une audience large, [celle d’un] présent perpétuel frelaté, constitué de bribes agglomérées [qui] remplacerait tout élan vers le futur » (Ibid., p. 134) – nous verrons que l’hyperpop nous fait sans cesse, comme un aveu sincère, la presque miraculeuse démonstration de sa capacité de réinvention, de création et d’émancipation. Et c’est d’autant plus vrai depuis la pandémie, dont « l’enfermement, la frustration, l’incertitude et l’angoisse (…) ont fait de l’hyperpop une échappatoire parfaite, un défouloir rêvé en ces temps troublés » (Ibid., p.29).
Et s’il y avait plus au réalisme capitaliste de Fisher ? (Indice : oui. Beaucoup plus).






C’est maintenant très clair : par-delà tout pessimisme fataliste et dystopique, l’hyperpop et son esprit de résistance par la réappropriation et la (dé/re)construction, en regard de son contexte technologique et numérique de production et de diffusion, implique de s’emparer « des technologies de l’image et du son [d’une industrie musicale capitaliste et patriarcale] pour les subvertir » (Ibid., p. 54). Ce processus touche directement la façon dont se définissent les artistes hyperpop et dépasse en ce sens largement l’aspect musical ou esthétique, car il porte en son cœur une importante dimension identitaire maintenant toujours plus plastique, modulable, malléable. Les références à la fluidité son partout : dans les titres des chansons, les paroles, les visuels, les apparitions et les manifestations physiques, les sonorités mêmes des morceaux, les voix transformées : c’est un tout. Pensons à SOPHIE, artiste précurseure du genre, qui « révèle avec lucidité les dynamiques de réification capitaliste en s’appropriant les technologies d’altération de soi, de l’AutoTune à la 3D en passant par Photoshop. Normative et participant bien souvent à la reproduction de modèles problématiques, la technologie est ici surtout célébrée pour sa capacité à modeler les identités numériques qui transcendent les limites physiques du corps. L’espace numérique est hacké au profit d’une réinvention de soi infinie, les technologies servant à sculpter des entités plus fluides. » (Ibid., p.56). Parce qu’il est possible de « plier […] le capitalisme à son désir, de le métamorphoser, en brisant l’un de ses mythes les plus tenaces : celui de l’identité comme concept essentialiste et fixe. » (Id,).
Virginie B, avec BBBBB et son album Astral 2000, se fait justement « reine désinvolte, nymphe numérique, créature intemporelle ». « C’est différents archétypes je crois. Je pense que c’est une personnification pour que t’en prennes possession, que t’en fasses ce que tu veux, selon ce qui



te parle à toi. C’est pas mal ça : un personnage qui te permet, en tout cas ce que j’espère, de vivre aussi par procuration tout ce que t’as besoin de vivre à l’intérieur de toi, mais à l’extérieur. Tout est dans l’extra, aussi, parce que y’a beaucoup de choses dans la vie qui sont très stressantes, y’a beaucoup de questionnements. Le numérique amène tellement de faussetés et de filtres à la vie, donc pourquoi ne pas prendre ça et l’amener vraiment plus loin pour en faire une espèce de personnage, et le vivre nous-même complètement, en personne, mais au travers de cette folie-là. » Elle ajoute qu’« il faut encore que le personnage prenne vie sur scène, et sur les réseaux, aussi. À voir où ça va aller : peut-être que ça ira complètement dans le monde numérique. Je pense que tous les deux, mon co-réal et co-prod Louis Jay et moi, on fantasmait sur cette idée-là, de faire quasiment totalement partie du monde numérique. Je ne sais pas encore, il faut voir comment je vais faire pour l’amener là en fait. »
Cela dit, en quoi pousser et gonfler à l’extrême les conceptions et les représentations problématiques de l’identité de genre telles que reconduites par la pop, avec, par exemple, une féminité irréaliste, nocive et réductrice, ne mérite non pas la critique et la réprimande, mais renvoie à un idéal d’émancipation ?
« C’est vrai aussi que la pop est quand même associée à quelque chose de plus féminin dans la conception de genre et de ce qu’est la femme. C’est pour ça que le fait de pousser cette espèce d’idole là, cet archétype-là vraiment loin, c’est intéressant. Y’a cette espèce d’espace de jeu avec ça, pis d’appropriation en fonction de ses propres codes. Y’a quelque chose de très queer aussi avec tout ça. Le fait que la forme et le corps ne sont pas importants : c’est l’énergie que t’en donne en bout de ligne, cette espèce de prise de contrôle d’un corps ou d’un code qu’on













t’as donné. Comme beaucoup de monde en ce moment, je réfléchis la question du genre et des rôles complètement construits qui font le féminin et le masculin. De jouer avec ça dans les extrêmes, je pense que la communauté queer le fait depuis vraiment longtemps, et je m’identifie de plus en plus à la communauté queer aussi de mon côté. (…) On est vraiment dans une ère de réflexion commune, j’ai l’impression que tout bouge dans cette direction-là. L’hyperpop, c’est un bel espace pour l’explorer. J’y réfléchis beaucoup, et j’aime bien cette idée que je puisse peut-être donner un espace safe pour y réfléchir, autant en spectacle, sur scène, que dans la musique elle-même, pour moi et pour les autres aussi. C’est important de vivre de la sexualité et l’identité à l’extérieur de soi, en représentation, », m’explique Virginie B.


Mais encore ? De quels codes parle-t-on ? Et comment, concrètement, passer de leur simple reprise à une réelle réappropriation ?
L’exemple de la voix s’avère particulièrement révélateur à cet égard, exemple que tente de décortiquer Ackermann en dénotant l’aspect genré et en montrant aux lecteur.rices les subversions possibles. Ce sont des enjeux qu’explore également Chananha Clement dans son mémoire de maîtrise en musicologie, « Let’s Leave Our Bodies” : Vocal Somatechnics and Queer Identity in Hyperpop and Lo-fi Folk ». Ce qu’il faut d’abord comprendre, c’est que, traditionnellement, les attributs de genre liés à la voix sont appris via diverses sphères médiatiques, la musique pop, entre autres, au sein desquelles « la voix et les intonations des femmes sont modelées par des désirs masculins cishétéro » (Ackermann, 2024, p. 121), rapports de domination qu’incarne la voix aiguë associée à la féminité. Est effectivement entretenue une vision essentialiste et objectivante de la voix. Mais ce n’est pas tout : « les femmes






seraient émotionnelles, débordantes et leurs comportements – y compris leur voix – devraient à tout prix être contrôlés. Autrement dit, elles doivent être aigües, mais dans une moindre mesure. Des notes trop hautes et trop puissantes seraient une menace à l’ordre patriarcal » (Ibid., p. 125). Le but de l’approche de la babyvoice, cette voix poussée à l’extrême particulièrement, présente dans l’hyperpop, n’est donc pas de reconduire une féminité essentialisante et réductrice, dictée par le patriarcat, mais de les contrecarrer : « Cette voix de l’infantilisation et de la sexualisation féminine – qui peut aussi bien sûr être utilisée comme une arme et un outil d’empouvoirement – est le stigmate dont l’hyperpop s’empare et détourne » ( Id .). Ackermann, en soulignant notamment l’importance des outils technologiques de type Autotune dans cette émancipation des scripts genrés traditionnels, particulièrement pour les personnes issues de la diversité sexuelle et de genre, ajoute que les voix de l’hyperpop, peuvent être « tellement traitées qu’elles deviennent méconnaissables : hyperféminines ou hypermasculines, mais jamais vraiment masculines ou féminines. Posthumaines » (Ibid., p. 116).
Les normes de genre sont de ce fait remises en cause par le traitement hyperpop queerisant de la voix, une voix pop traditionnellement féminine que l’on cherche à dégenrer, toujours dans ce fameux rapport à l’excès. Cela « permet surtout aux artistes hyperpop de modeler des voix affranchies du mythe binaire dans une perspective postgenre » ( Ibid ., p. 116). Dans l’hyperpop, la voix devient avant toute chose un outil, un glitch supplémentaire dans la machine capitaliste et patriarcale, pratique de corruption qui n’est pas sans rappeler certaines idées du Manifeste Xénoféministe. L’hyperpop est un « site de résistance aux modes d’existences normatifs qui révèle la productivité de l’aberration, du dysfonctionnement et de l’erreur » (Ibid., p.








117), qui, à la limite, peut même se rapprocher d’une forme de poésie sonore.

« C’est certain que j’essaie d’écrire les textes en les écrivant à ma manière et non pas en essayant de faire de la poésie, parce que je ne suis clairement pas une poète. Mais je pense que ma voix s’est intégrée tranquillement au son, elle faisait encore plus partie du décor musical, au même titre que les autres instruments, (…) pis je pense que j’ai pu l’utiliser justement de manière moins classique ou lyrique. Je ne sais pas si on est dans la poésie musicale, mais ce que j’ai beaucoup aimé faire, ç’a été de prendre les voix pour les couper, les scinder. C’était beaucoup plus proche de l’approche du DJ et du techno, et même du art pop, qui était de prendre les voix, de les couper, mais aussi de les travailler et de les trafiquer, de venir les superposer ensemble pour perdre le sens même de ce qu’est une voix. », me dit Virginie B à propos d’Astral 2000.
Tous des éléments maintenant plus facile à utiliser et mettre en œuvre avec la démocratisation des outils numériques et de leur accessibilité, que l’on pourrait regrouper sous l’expression « accélérationnisme queer », « définissable comme une stratégie de transformation du réel capitaliste ouvrant vers un horizon de la queerité (moins comme une orientation sexuelle qu’une vision politique visant à dépasser les carcans anciens, les binarités usées et les vieilles normes qui emprisonnent le monde, à l’instar du fétiche de l’identité) » (Ackermann, 2024, p. 54), mais aussi d’omnipotentialité. C’est aussi vrai pour l’industrie musicale, qui a tout à gagner à faire plus de place à la queerité, peu importe sa forme, n’en déplaise à l’élitisme des hommes-blancs-cis-hétéros qui peuplent les maisons de disque et les boîtes de production. L’idée n’est pas uniquement de se positionner en marge comme d’autres contre-courants culturels ont pu le faire auparavant,




mais, encore une fois, de changer le mainstream de l’intérieur (Madden, 2021 ; Battan, 2021). L’hyperpop nous permet de devenir qui l’on veut ; elle et ses glitchs transcendent toutes conceptions de genre, réinitialisent nos manières de le vivre, de l’exprimer, de le performer. Il faut voir l’hyperpop comme une nouvelle manière d’être au monde et d’être à l’art, et c’est pourquoi elle est fondamentalement queer.
La technologie, en s’en emparant, nous offre une multiplicité d’identités, vocales ou non, identités plurielles, émancipées de la physicalité du corps. Désidentification, dissolution, transfiguration : pick your fighter. C’est le jeu de l’avatar, du cyborg de Donna Haraway dans son Cyborg Manifesto, des (hyper)pop stars virtuelles avérées ou autoproclamées : c’est l’immatérialité même du corps, [une] immatérialité utopique, entrevue dans la dissolution du soi (et donc du genre) véhiculée par la plasticité et la liquidité » (Ackermann, 2024, p. 57-58). Mais ne vous méprenez pas ; l’hyperpop, malgré ce qu’elle pourrait laisser miroiter, malgré ses simulacres et ses illusions et ce qui apparaît comme une totale absence de contact avec la forme, est fondamentalement incarnée, et surtout sincère.




















Malgré l’écran de fumée technologique, virtuel, immatériel et même hyperréel de l’hyperpop qui pourrait renvoyer à tout un imaginaire de la superficialité et de l’inauthenticité, la réalité (!) est pourtant nettement plus complexe.



D’abord, parce que le capitalisme et ses technologies numériques ainsi que ses plateformes de constante mise en scène de soi ont depuis un moment déjà su révéler l’inefficacité du concept d’authenticité, que l’on est venu à largement dépasser : « l’hyperréalité n’est [plus] en dehors de nous, mais en nous. […] L’authenticité ne peut plus être une valeur refuge, critique et subversive : Elle a été reconfigurée par la soumission quasi-totale de la vie quotidienne au capitalisme » (Ibid., p. 77), et c’est pourquoi nous parlerons plutôt de sincérité. Que l’hyperpop soit perçue comme inauthentique n’a rien d’alarmant et ne devrait sous-tendre aucune connotation négative, notamment parce qu’elle « n’a au contraire jamais caché sa dimension fabriquée, industrielle. […] Elle a exalté son caractère synthétique et en a fait la matière de son art » ( Ibid ., p. 78). Que l’hyperpop soit perçue comme inauthentique ne la rend donc pas moins sincère et chargée en émotions, « une émotion certes glacée car digitalisée, mais intensifiée et honnête » (Id.). Émotion – et je pense que nous en avons déjà partiellement fait la démonstration – essentielle dans le processus de création hyperpop et la place que cette démarche accorde aux technologies, que tend trop souvent à masquer l’attention et l’importance dédiée à l’art en tant que résultat. Virginie B me confie qu’elle est à son tour fascinée par la technologie et son potentiel de création : « J’aime ça, je geek beaucoup làdessus avec ma réalisatrice, entre autres, Rosalie Bordeleau. On adore plonger dans l’univers de la technologie, pour voir ce que je veux sortir, qu’est-ce que ça fait à la création. (…) J’essaye de me nourrir d’informations à ce sujet-là le plus possible, et qu’elles


soient les plus variées que possible pour pouvoir mieux comprendre la technologie et moins en devenir un possible produit, pour pas qu’on capitalise sur mon ignorance. Après, moi j’essaye de réutiliser ce que j’ai appris sur ces technologies pour possiblement en créer de l’art, en plus de les ramener à un niveau humain. Pis on s’est posé beaucoup de questions sur l’intégration de l’IA dans une œuvre : comment est-ce qu’on fait, est-ce qu’on peut justifier cet usage-là, est-ce que ça se vaut, est-ce qu’on vole le travail de quelqu’un d’autre, etc. On continue constamment de réfléchir là-dessus, pour être sûrs qu’on l’amène de la bonne manière, mais aussi parce qu’il FAUT réfléchir à ces questions-là. Les œuvres ne sortent pas de nulle part, et ça reste juste un outil, au même titre que l’époque pré-Photoshop et post-Photoshop. C’est un nouveau machin qui arrive, qui se base sur beaucoup beaucoup d’informations qui elles sont créées par des humains. J’aime l’intersection que ça crée, parce que c’est absolument imparfait. C’est aussi imparfait que ce que tu vas lui demander que ce soit, et qui réside dans ta capacité et ta qualité à le demander, avec ce qu’on appelle les prompts. L’intelligence artificielle ne réfléchit pas de son propre vouloir, pis c’est important de réfléchir à l’intégration de l’intelligence artificielle à l’art. On ne peut pas remplacer le travail d’un.e artiste pour autant, par exemple en remplaçant un.e artiste 3D par de l’art 3D fait par intelligence artificielle, parce que ce n’est pas remplacer, c’est une copie. Par contre, si tu prends quelque chose qui est complètement faux, que tu l’amènes à un extrême, que tu montres que c’est faux, et que tu n’essayes pas de reproduire, là on tombe dans quelque chose qui est autre. C’est là que ça devient intéressant. »
L’hyperpop est multicouche et plus complexe qu’il n’en paraît ensuite parce que la sincérité de l’hyperpop, qui vient initialement de l’amour qu’elle porte à la pop des années













2000 et ses esthétiques, dans un esprit disons de nostalgie, est surpassée par sa lucidité et sa dimension réflexive : « L’hyperpop joue de la même façon avec les affects de la vie capitaliste : elle se laisse toucher par l’émotion commodifiée, mais refuse d’y être totalement soumise ; elle se sait charmée par la pop music, mais elle sait pourquoi » (Ackermann, 2024, p. 107). L’hyperpop est à la fois sincère et ironique : elle est méta/post-ironique. Et elle est en plus antinostalgique, tout simplement parce que cette supposée unidimensionnelle nostalgie 2000 « a été réévaluée à l’aune de nouvelles valeurs » (Ibid., p. 134), et que contrairement aux hipsters et à l’inévitable cycle marquant l’impossibilité de tout renouveau de Fisher, l’hyperpop n’est pas rétromaniaque. Elle est antinostalgique en ceci qu’elle entretient une relation complexe et hybride au temps, qu’elle s’inscrit dans une démarche de « réappropriation transfiguratrice du passé », et « se fonde sur les potentiels utopiques contenus dans le passé dans une logique accélérationniste » (Ibid., p. 135). Toute est dans toute ? C’est, en plus, un rapport queer au temps, parce que l’hyperpop est futuriste, quoiqu’ancrée dans un passé réécrit et réimaginé, nous propose simultanément, dans l’instant présent, différentes temporalités, et ainsi « entre en décalage avec la chrononormativité cis-hétérocapitaliste » (Ibid., p. 138).
« C’est multilayered en tabarnak », me dit mi-sérieuse mirieuse Virginie B. « Ce n’est pas du réchauffé, tout simplement parce que c’est une réflexion sur ce qu’on nous a donné. En plus, c’est une époque qui est/était extrêmement commerciale, et on est dans un moment, je pense, de réalisation sur à quel point on est un produit sur les réseaux, à quel point on est dépendant de tout ça pour vivre des connexions, par exemple. Y’a un désir, une recherche de connexion face à, par exemple, l’intelligence artificiel qui arrive et la peur de s’éloigner, dans tout ça. On essaye de ramener ça à la possible connexion qu’on peut






avoir ensemble, en face, en spectacle. Je pense que tout ça, ça vient avec une réflexion sur comment on peut s’éloigner de l’époque produit, de l’époque pop, du gros glam de tout ça et de faire quelque chose de différent qui serait fucking vrai, de fucking queer, qui est plus libre et moins contrôlé. »
Nous avons dit que la magie de l’hyperpop résidait précisément dans ses contradictions, et c’est vrai. Plus qu’un produit plastique et en apparences purement artificielle et nostalgique, l’hyperpop naît avant tout d’une fusionnelle rencontre entre humain et machine, nature et culture, corps et esprit, organique et mécanique, sincérité et ironie, et c’est en ce sens qu’elle renvoie à l’image du cyborg d’Haraway. C’est sans équivoque : il a beaucoup plus au réalisme capitaliste de Fisher.
L’hyperpop est cette trace lumineuse dans un monde depuis longtemps crépusculaire ; « elle reflète une génération de personnes souhaitant collectivement échapper aux dures réalités d’un monde en décomposition en utilisant les technologies destinées à les détruire pour créer leur propre utopie. D’une manière à la fois troublante, mais pourtant magnifique, l’hyperpop est devenue l’équivalent réel de la drogue du “bonheur” inventée par Aldous Huxley dans Le meilleur des mondes » (traduction libre) (Jajo-Azabo, 2020).
L’hyperpop est le lieu d’une critique radicale transcendante, poussée à l’extrême ; une nova qui, dès le moment où on peut enfin, dans une sorte d’éblouissement, en percevoir les éclats, est déjà dans un ailleurs dont il reste encore à nous saisir. « Plus qu’un genre, mieux qu’une étiquette figée, l’hyperpop est peut-être tout simplement une sensibilité, une manière d’être au monde » (Ackermann, 2024, p. 36).













Bienvenue dans l’éther numérique☺ https : //paroxysme-mp4.neocities.org/
Là-bas, des listes de lecture, des blogues, des œuvres numériques, des avatars, des suggestions lectures. Pardelà la théorie, la pratique, la création, l’art : l’hyperpop ♥



Ackermann, J. (2024). Hyperpop. La pop au temps du capitalisme numérique, éditions Façonnage.
Battan, C. (2021). Mainstreaming. The New Yorker, https : //go-gale-com.acces.bibl.ulaval. ca/ps/retrieve.do ? tabID=T003&resultListType=RESULT_LIST&searchResultsType=Singl eTab&retrievalId=38ae0ec3-46b1-48e3-9f7e-cf8a88daa571&hitCount=1&searchType=Adv ancedSearchForm¤tPosition=1&docId=GALE%7CA671403336&docType=Article&s ort=RELEVANCE&contentSegment=ZCPQ-MOD1&prodId=CPI&pageNum=1&contentS
Clement, C. (2024). “Let’s Leave Our Bodies” : Vocal Somatechnics and Queer Identity in Hyperpop and Lo-fi Folk [Research Master in Musicology, Utrecht University], https : // studenttheses.uu.nl/handle/20.500.12932/47598
Jajo-Azabo, M. (2020). Music for the End of Music for the End of the World : The Rise of









Hyperpop, Daily Nexus, https : //dailynexus.com/2020-11-16/music-for-the-end-of-the-worldthe-rise-of-hyperpop/Madden, E. (2021). How Hyperpop Became a Force Capable of Reaching and Rearranging the Mainstream, Billboard, https : //www.billboard.com/music/ pop/hyperpop-history-mainstream-crossover-9595799/
Medina Polo, S. A. (2021). Hyperpop, Capitalist Realism, and Articulating the Future, Medium - pseudo-antigone, https : //pseudo-antigone.medium.com/hyperpop-capitalist-realism-andarticulating-the-future-2523626c98c7















Un jour, l’humain découvre le feu et l’autre, il envoie des navettes dans l’espace. Depuis les débuts de l’exploration spatiale, l’humain ne cesse de repousser les limites du réalisable. Nous allons sans cesse au-delà des espérances des générations précédentes. Pour explorer l’espace, il faut sortir du cadre conventionnel. Cela nécessite des gens créatifs qui seront un moteur pour l’innovation, un moteur vers ce que l’on croyait impossible. Certain.es peuvent se demander : à quel prix ? En réalité, nous devons bien des inventions au développement des technologies spatiales; tous ces efforts sont donc loin d’être vains.
Par Marie Tremblay, journaliste multiplateforme
Près de nous
Dans toutes les sphères de la vie, il y a des traces de l’ingénierie et de la recherche spatiale. La nourriture déshydratée que nous apportons en randonnée, les appels vidéo d’un océan à l’autre, les écouteurs sans fils, les détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone, les vêtements coupe-feu des pompier.ères, les matériaux isolants : la liste s’étire (Canadian Geographic Education, s.d.). En se questionnant sur comment produire de la nourriture dans l’espace, des techniques pour la culture des plantes ont été développées et ont contribué à l’agriculture en milieux urbains et en régions défavorables (ASC, 2020). En réfléchissant au manque d’eau dans la Station spatiale internationale (ISS), un système de filtration qui récupère celle contenu dans l’urine a été mis au point. À travers la planète, cela favorise l’accès à l’eau potable (ASC, 2020). Il s’agit de penser à l’impensable et de sortir du cadre conventionnel.
Une autre avancée très utile que nous utilisons au quotidien est la localisation GPS, rendue possible grâce aux satellites de navigation (Canadian Geographic Education, s.d.). Je me souviens, quand j’étais enfant, de l’énorme carte routière pliée en dix dans le fond de la voiture… c’était loin


d’être idéal pour trouver son chemin pendant que trois enfants se disputaient sur la banquette arrière. Les nombreux satellites en orbite ont tout changé. Maintenant, nous pouvons prendre les itinéraires les plus judicieux, rester informé.es de la circulation routière et même localiser les contrôles policiers. Cependant, nous avons probablement perdu une certaine débrouillardise à force de se faire indiquer le bon chemin.
Cette technologie est parfois utilisée à des fins moins pratiques et plutôt douteuses. La Snap Map, par exemple, donne accès à la localisation précise des utilisateur.rices qui y consentent à toustes leurs « ami.es » sur la plateforme. Nous pouvons aussi attribuer les publications Instagram au développement spatial. J’exagère légèrement, mais il n’en reste pas moins que l’appareil photo de nos téléphones fonctionne avec un capteur CMOS-APS (Canadian Geographic Education, s.d.). Il est avantageux en raison de sa petite taille et de son coût moins élevé, parfait pour amener à bord d’un vaisseau ! On le retrouve aussi dans plusieurs caméras modernes.
Finalement, les astronautes font office de rats de laboratoire pour développer nos connaissances sur le corps humain. Dans l’espace, la microgravité et le rayonnement solaire ont plusieurs effets sur leur santé. La densité des os ainsi que la masse musculaire diminuent, les vaisseaux sanguins perdent leur élasticité, l’ADN peut être endommagé par les forts rayonnements et les perceptions des astronautes risquent d’être altérées (ASC, 2018). Dans les faits, les changements observés chez les astronautes s’apparentent
au vieillissement naturel et aux effets d’un mode de vie sédentaire. Nous avons appris énormément sur les problèmes cardiovasculaires, les troubles de l’équilibre, l’Alzheimer, l’asthme, le cancer et autres, permettant de développer des traitements plus efficaces. Des robots chirurgicaux ultras précis ont aussi vu le jour grâce aux innovations créées pour la Station spatiale internationale (ASC, 2020).
Très loin de nous
Depuis le début de l’exploration spatiale, de grandes distances ont été parcourues. L’ISS peut paraître très loin de la Terre, mais elle se trouve à seulement 416 kilomètres de la surface. Le 20 juillet 1969, un astronaute a foulé le sol lunaire pour la première fois avec la mission Apollo 11 (Lebelle, 2019), totalisant un voyage de 384 400 kilomètres (ASC, 2023). Remettons en perspective cet exploit pour bien comprendre la grandeur de cette réussite. À cette époque, les ordinateurs étaient bien loin de ce qu’ils sont aujourd’hui. Le code qui a envoyé les astronautes sur la Lune pourrait désormais se faire facilement sur un téléphone intelligent (Auclert, 2019). Le programme Apollo s’est poursuivi et a envoyé douze hommes sur la Lune avant de mettre fin au programme en 1972 (Lebelle, 2019).
Présentement, la NASA projette d’envoyer quatre astronautes à 130 km de la face cachée de la Lune, le point le plus éloigné où des humains auront voyagé (ASC, 2024).
L’objet créé par l’humain le plus distant dans le cosmos est la sonde Voyager 1, qui poursuit son voyage à plus de 24,5 milliards de kilomètres de la planète Terre (NASA, 2024).

Il est difficile de s’imaginer des milliards en dollars, mais des milliards en kilomètres… C’est une distance dont l’ampleur est insaisissable. La sonde Voyager 2 se trouve, quant à elle, a plus de 20,4 milliards de kilomètres (NASA, 2024). Les deux engins, envoyés en 1977, sont usés et pourraient être qualifiés de dinosaures au point de vue technologique. Cependant, après plus de 47 années, ils communiquent toujours avec la Terre et ses technologies de 2024. Les informations envoyées par les sondes traversent cette grande distance en 45 heures. Les ondes sont si faibles qu'il faut plusieurs télescopes pour recevoir de l’information compréhensible (Perreault, 2023). N’est-ce pas incroyable tout ce que nous pouvons faire ?
Je n’avais jamais réfléchi à ce qui arrive aux navettes, satellites et autres conceptions spatiales une fois leur mission complétée. Assez ironiquement, plusieurs engins spatiaux terminent leur vie au point Némo, le point océanique le plus éloigné de toute terre ferme (Le Corre, 2024). Il s’avère qu’ils sont envoyés volontairement dans ce dépotoir sous-marin, à six jours de bateau de toute civilisation. C’est le prix à payer pour éviter les risques liés aux chutes de ces engins. Plusieurs pièces se désagrègent dans l’atmosphère, d’autres peuvent exploser, le reste tombe à une vitesse phénoménale vers un endroit où –

croisons les doigts – personne ne vit. Ramener les débris sur terre est une tâche d’une surprenante complexité. Au fond de l’eau, 263 carcasses gisent dans un désert océanique. La station spatiale internationale est, elle aussi, promise à ce sort (Le Corre, 2024).
Il semblerait que l’ampleur des conséquences soit proportionnelle à celle de nos découvertes. Cette situation me met face à un questionnement : jusqu’où pourrons-nous réellement aller ? Le progrès amène le progrès, dans une roue qui n’en finit pas de tourner. La curiosité humaine est insatiable. Nous sommes pris.es de l’incontrôlable envie de découvrir l’inconnu. Certaines personnes ne quitteront pas leur village, et voilà que d’autres survoleront la face cachée de la lune et, peut-être même, poseront le pied sur Mars.

Références
Agence spatiale canadienne. (2018). Pourquoi réalise-t-on des expériences scientifiques dans l’espace ? https : //www.asc-csa.gc.ca/fra/iss/science/pourquoi-realise-t-on-desexperiences-scientifiques-dans-l-espace.asp
Agence spatiale canadienne. (2020). Retombées de l’exploration spatiale au quotidien. https : //www.asc-csa.gc.ca/fra/a-propos/retombees-de-l-exploration-spatiale-au-quotidien/
Agence spatiale canadienne. (2023). La Lune. https : //www.asc-csa.gc.ca/fra/astronomie/ systeme-solaire/lune.asp
Agence spatiale canadienne. (2024). Les missions Artemis. https : //www.asc-csa.gc.ca/fra/ astronomie/exploration-lune/missions-artemis.asp
Auclert, F. (2019). Apollo 11 : Un bond géant technologique grâce aux ordinateurs de la mission. Futura Sciences. https : //www.futura-sciences.com/tech/actualites/tech-apollo-11bond-geant-technologique-ordinateurs-mission-76792/ Canadian Geographic Education. (s.d.). Pourquoi nous explorons l’espace. ArcGIS
StoryMaps. https : //storymaps.arcgis.com/stories/588e510e625a4456ac84a65c69673ea6
Lebelle, A. (2019). Les missions Apollo : Chronologie. Radio-Canada. https : //ici.radiocanada.ca/nouvelle/1227896/missions-apollo-chronologie
Le Corre, J. (2024). Où se trouve le point Nemo, l’endroit le moins fréquenté du monde ?
Le Point. https : //www.lepoint.fr/eureka/ou-se-trouve-le-point-nemo-l-endroit-le-moinsfrequente-du-monde-13-05-2024-2560001_4706.php#11
Perreault, M. (2023). Comment communiquer avec Voyager ? La Presse. https : //www. lapresse.ca/actualites/sciences/2023-12-24/demystifier-la-science/comment-communiqueravec-voyager.php
NASA. (2024). Where are they now ? https : //science.nasa.gov/mission/voyager/whereare-they-now

Par Emmy Lapointe, rédactrice en chef
J’ai 4 ans, nous habitons une maison louée dans Charlesbourg. J’ai demandé la chambre au sous-sol, parce qu’elle n’a pas de fenêtre. Je sais maintenant que ça n’a rien de sécuritaire, mais pour moi, à ce moment-là, une fenêtre, c’est juste une chance de plus qu’un méchant entre.
Un sommeil troublé
Si certain.es attendent le moment d’aller au lit comme j’attends Noël, d’autres l’anticipent beaucoup. Entre l’insomnie, les cauchemars, les terreurs nocturnes et la paralysie du sommeil, la nuit n’est pas toujours synonyme de repos. Et même une fois le soleil levé, ces expériences nocturnes continuent de nous suivre.
Les cauchemars, on les connait toustes plus ou moins. Ce sont des rêves désagréables, parfois très intenses qui nous réveillent en plein milieu de la nuit et qui nous laissent, pendant plusieurs heures parfois, un malaise quasi indicible. Généralement, ils se produisent pendant la phase paradoxale du sommeil, là où les rêves sont les plus vifs, mais pour certain.es, ils deviennent une routine angoissante qui érode les nuits.
La paralysie du sommeil, c’est une autre histoire et pour dire vrai, peut-être encore plus effrayante. Vous vous réveillez, conscient.es de tout, mais incapables de bouger. Comme si vous étiez pris.es au piège dans votre propre corps. Ajoutez à ça des hallucinations – des ombres qui bougent, des sons étranges – et vous obtenez une expérience à la frontière du cauchemar et de l’éveil.
Et puis, il y a les terreurs nocturnes, ces épisodes où, sans comprendre pourquoi, on se met à hurler, à se débattre, comme si on était menacé.es par quelqu’un ou par quelque chose. C’est un phénomène qui touche essentiellement les enfants, mais qui peut apparaître chez les adultes, et contrairement aux cauchemars, on ne se souvient de rien au réveil, mais le corps lui, s’en souvient.
Mes parents sont séparés depuis environ deux ans, je pense. L’heure du coucher devient de plus en plus difficile. Surtout chez papa. Je m’endors dans son lit, sinon, je ne dors pas. Il me monte dans mon lit mezzanine chaque nuit de je ne sais pas quelle façon. Mais chaque nuit, je rêve que mes parents meurent de la grippe aviaire, du cancer, dans un accident. Dans mes cauchemars, je ne les sauve jamais, même si mon plafond reflète les étoiles ou les poissons de mes veilleuses.
La peur en rêve
Comme mentionné précédemment, les cauchemars surgissent principalement pendant la phase de sommeil paradoxal, là où l'activité cérébrale est la plus intense. Ce sont des moments où notre esprit, normalement occupé à digérer les événements de la journée, bascule dans des scénarios angoissants qui peuvent sembler très réels. Que ce soit des poursuites sans fin, des situations où l'on se sent pris.es au piège ou même des scènes extrêmement banales, mais tout de même inconfortables, les cauchemars ne laissent généralement personne indifférent.e.
Mais d'où viennent-ils ? Les causes peuvent être multiples, mais bien souvent, elles sont liées à notre état émotionnel. Le stress est un déclencheur majeur : quand notre cerveau est sous pression, il se met à traiter nos inquiétudes même pendant la nuit. L'anxiété, tout comme les événements traumatisants, peuvent aussi venir hanter nos rêves. Parfois, des troubles du sommeil comme l'insomnie ou des changements dans notre routine de sommeil viennent aggraver les choses, rendant les cauchemars plus fréquents.
Non seulement les nuits teintées par les cauchemars laissent un goût amer au réveil, mais elles peuvent aussi avoir un impact sur la mémoire et sur l’humeur. Sans surprise donc, une personne qui fait souvent des cauchemars peut ressentir de la fatigue, être plus irritable, ou même éprouver des difficultés à se concentrer. En perturbant le cycle du sommeil, les cauchemars créent une sorte de cercle vicieux : plus on dort mal, plus le risque de cauchemars augmente.
Après, il n’y a pas de miracle pour réduire les cauchemars, mais quand même, il n’y a pas rien à faire! Les techniques de gestion du stress comme la relaxation ou la méditation peuvent aider à calmer l’esprit avant de se coucher. Dans certains cas, les thérapies cognitivo-comportementales se sont révélées efficaces pour aider à transformer des pensées anxiogènes en scénarios plus positifs. Et évidemment, adopter une bonne hygiène du sommeil est essentiel : un horaire de sommeil régulier, un environnement calme, pas d’écran et des rituels relaxants comme les soins du visage et la lecture avant de dormir peuvent contribuer à diminuer les cauchemars de façon assez considérable.
On va voir une psychologue, c’est la première fois que j’en vois une. Elle s’appelle sûrement Isabelle. Isabelle me donne des exercices à faire avant de dormir et même quand je me réveille. Mon préféré, c’est l’œuf, parce que je suis à l’abri. Isabelle conseille à mes parents de ne plus me faire écouter le téléjournal.
Se réveiller, conscient.es de tout ce qui se passe, mais le corps ne répond pas, incapable de bouger ou de parler. Ce moment suspendu peut durer de quelques secondes à quelques minutes, mais paraît tout le temps interminable.
Ce qui rend l’expérience de la paralysie du sommeil encore plus angoissante, ce sont les sensations qui l’accompagnent. Beaucoup de personnes rapportent une pression intense sur la poitrine comme si quelque chose d'invisible les empêchait de respirer correctement. Des hallucinations peuvent aussi survenir : des sons étranges, des voix murmurantes (un terrible ASMR) ou des silhouettes sombres qui semblent se rapprocher. Le cerveau, à moitié endormi, confond encore la frontière entre rêve et réalité, ce qui rend le tout encore plus terrifiant.
Les causes des paralysies du sommeil sont souvent liées à notre mode de vie. La privation de sommeil, par exemple, est l'un des déclencheurs principaux. Lorsque le corps manque de repos, il devient plus vulnérable à ce genre de
dysfonctionnement. Le stress et les changements soudains de rythme de sommeil (comme les décalages horaires ou les changements de travail) peuvent également jouer un rôle. Dans certains cas, la paralysie du sommeil est associée à des troubles comme la narcolepsie. Mais en fait, la paralysie du sommeil s'explique par un dysfonctionnement du mécanisme qui paralyse naturellement les muscles pendant le sommeil paradoxal. Normalement, ce mécanisme empêche notre corps de bouger pendant les rêves pour éviter qu’on ne se blesse en réagissant physiquement à nos rêves. Mais dans le cas de la paralysie du sommeil, ce mécanisme se met en marche alors qu’on est déjà conscient.es, d’où cette sensation d’être « bloqué. es » entre le rêve et l’éveil.
Évidemment, ce qu’on peut mettre en place pour réduire la fréquence des cauchemars s’applique ici aussi, mais il faut surtout stabiliser son horaire de sommeil et ne pas hésiter à consulter un.e professionnel.le si les épisodes sont trop fréquents.
Je ne sais pas si mes parents savent que je passe plusieurs heures par nuit à ne pas dormir. Souvent, je suis réveillée entre 2-3h et 5-6h du matin. Je me réveille à cause de cauchemars, même si je suis rendue à 10 ans. Souvent, je lis ou j’écoute Canal D. Les émissions, la nuit, sont terrifiantes, mais éveillée, peu de choses me font peur, pas même Un tueur si proche.
Une terreur qui ne s’explique pas
Les terreurs nocturnes, ce sont des expériences déconcertantes tant pour le.la dormeur.se que pour les témoins. Ce sont des périodes de panique intense, souvent marquées par des cris et des mouvements brusques.
À première vue, les terreurs nocturnes pourraient ressembler aux cauchemars, mais contrairement à eux, elles se produisent pendant le sommeil profond (généralement au stade 3 ou 4), bien avant d’atteindre le sommeil paradoxal où les rêves, et donc les cauchemars, se déroulent. Autrement dit, alors que les cauchemars sont des rêves effrayants, les terreurs nocturnes sont plus une sorte de réaction physiologique où la panique prend le dessus sans même que le rêve n'en soit la cause.
Les enfants sont les plus souvent touchés par les terreurs nocturnes. C’est un phénomène relativement commun durant l’enfance, particulièrement entre 3 et 12 ans, et qui finit généralement par disparaître en grandissant. Mais ce
n'est pas réservé aux plus jeunes, certains adultes peuvent également en faire l’expérience.
Les causes des terreurs nocturnes peuvent varier. La fièvre, par exemple, peut déclencher ces épisodes chez les enfants. Chez d'autres, la privation de sommeil ou le stress intense jouent un rôle. Il semble aussi y avoir une part génétique dans cette histoire : si un parent a vécu des terreurs nocturnes, il y a plus de chances que l’enfant en vive aussi.
Si les terreurs nocturnes peuvent être impressionnantes, surtout pour les proches qui en sont témoins, il y a des moyens d’en atténuer la fréquence. Comme toujours, s'assurer que l'environnement de sommeil est calme et rassurant, instaurer des routines, ça peut être gagnant. Il est toutefois crucial de s’attaquer aux causes sous-jacentes comme le stress ou la fatigue. Si les terreurs nocturnes sont fréquentes, il faut consulter (évidemment, je dis ça comme si c’était la chose la plus facile à faire, consulter).
J’ai 13, peut-être 14 ans. Je dors souvent les lumières allumées. Je n’ai plus de veilleuse, mais j’ai un lecteur dvd portatif. Je m’endors sur les mêmes DVD. C.R.A.Z.Y, Harry Potter et la coupe de feu, Aurélie Laflamme et les 3 premières saisons de Ramdam. Je me réveille toujours aux mêmes moments; quand Cédric meurt, quand Nicolas rattrape Aurélie dans la rue, quand Zach est à Jérusalem, ce qui est toujours mieux qu’après un cauchemar.
Pour la suite des nuits Quand on parle de troubles du sommeil comme les cauchemars, la paralysie du sommeil, et les terreurs nocturnes, il peut être facile de les confondre, même si leurs causes et leur fonctionnement divergent, surtout parce qu'ils partagent tous un point commun : ils rendent le sommeil, normalement réparateur, effrayant et perturbant.
Les cauchemars provoquent un état d’hypervigilance au réveil, ce qui peut mener à une fatigue et une irritabilité pendant la journée. La paralysie du sommeil, en raison des hallucinations et de l'incapacité à bouger, peut laisser une sensation de terreur bien après que l'épisode soit terminé, tandis que les terreurs nocturnes, elles, laissent surtout les proches déconcertés, étant donné que celleux qui en souffrent ne s'en souviennent souvent pas.
Ces phénomènes peuvent parfois interagir ou se superposer. Par exemple, quelqu’un qui souffre de paralysie
du sommeil peut également être sujet aux cauchemars, surtout si son cycle de sommeil est désorganisé ou s'iel traverse une période de stress intense. De même, une personne qui connaît des terreurs nocturnes à répétition peut se sentir anxieuse à l’idée d’aller se coucher, ce qui peut entraîner des cauchemars ou d’autres perturbations du sommeil. Bref, un diable qui se mange la queue.
Dans un monde idéal, nos nuits seraient des moments de refuge où notre corps ferait le plein, notre tête, le tri, et elles permettraient à nos semaines de se rythmer calmement. Et d’expérience, les nuits mouvementées ont tendance à nous faire nous sentir bien seul.es, et en colère, mais tout le monde est seul.e la nuit, et c’est très bien comme ça. Le temps de la nuit s’écoule autrement, et même si la fatigue et l’irritabilité nous rattraperont plus tard aujourd’hui, être éveillé.e la nuit apporte une connaissance particulière qui est celle de la lenteur, du sans bruit et du regard oblique sur les choses.
J’ai 27 ans. Ma mère m’appelle. Elle me dit qu’elle va au Zone sur la rue Cartier et me demande si j’aime encore les veilleuses. Je lui dis que oui, évidemment. Elle m’achète une petite boule rose lumineuse dans laquelle dort un faux petit chat blanc. Je la branche le premier soir dans ma chambre. La lumière qu’elle émet est trop faible pour lire, juste assez forte pour que je discerne les traits de Brioche qui vient de se tourner sur le côté et qui fait des biscuits sur mon bras, elle n’a tellement pas peur de la nuit.

Matthew, W. (2018). Why we sleep : Unlocking the power of sleep and dreams (First Scribner trade paperback edition). Scribner.
Morin, C. M. (2009). Vaincre les ennemis du sommeil (3e éd). les Éditions de l’Homme.
« L’avenir est enfumé », comme le souligne si bien le docteur Mike Flannigan, chercheur spécialisé dans les incendies de forêt. Nos actions négligentes provoquent des ravages. Nous subissons déjà les conséquences du réchauffement climatique. Les feux de forêt, qui jadis faisaient la une des journaux chaque été, sont devenus notre quotidien. Démuni face à leur ampleur, le Portugal n’a eu d’autre choix que de déclarer l’état de catastrophe naturelle. Le Brésil est enveloppé d’une épaisse et écrasante fumée noire, dévoré par des flammes avivées par notre passivité. Mais que représentent ces incendies, au-delà de leur aspect dévastateur ?
Par Dayane Rodrigues, journaliste collaboratrice
Plus concrètement, cette dévastation incendiaire correspond à la « propagation des feux dans les zones forestières et les savanes. Les incendies se multiplient pendant les périodes de sécheresse et sont donc intrinsèquement liés à la baisse de l’humidité ambiante » (Défense Civile de Rio de Janeiro). Selon le climatologue Carlos da Câmara, plusieurs phénomènes météorologiques, comme la canicule, la baisse de l’humidité, le vent intense venant de l’est et l’absence de précipitations durant l’été ont contribué à la dégradation de la situation (SAPO Portugal). Les changements climatiques entraînent par exemple une augmentation des températures, ce qui assèche la Terre, ses eaux, sa végétation et ses sols. Cela facilite la propagation des incendies, car pour qu’un feu puisse se propager, trois conditions doivent être réunies : un combustible (la végétation), un comburant (l’air et l’oxygène), et une source d’énergie, qui peut aller d’un simple éclair à une cigarette jetée au sol.
49% des Portugais.ses sentent vulnérables face aux incendies d’après l’Eurobaromètre sur la sensibilisation et la préparation de la population de l’Union européenne aux risques de catastrophes. Pas surprenant, étant donné que le Portugal est l’un des pays les plus touchés par les feux de brousse en Europe. En septembre, il n’a fallu que six jours pour que les flammes impitoyables ravagent 135 000 hectares. Le Portugal est ainsi devenu le troisième pays ayant subi la plus grande perte de biodiversité de la décennie. Unissant plusieurs villes du nord comme du sud dans la dévastation, plus de 64 incendies ont causé la mort de neuf personnes et fait 174 blessé.es.
La situation est similaire au Brésil depuis déjà des mois.
L’Institut brésilien de recherches spatiales a enregistré plus de 223 257 foyers d’incendie entre le 1er janvier et le 10 octobre 2024, dont la majorité se trouve en Mato Grosse (INPE). Selon eux, le pays regroupe 76% des incendies de toute l’Amérique du Sud. L’Amazonie fait face à une sécheresse historique et à un nombre record d’incendies. Un constat aussi triste qu’alarmant, car non seulement la forêt tropicale est le poumon vert de notre planète, mais elle abrite également des milliards d’espèces, dont certaines demeurent encore inconnues. 10% de la biodiversité mondiale y réside selon le World Wide Fund for Nature. La sécheresse n’est toutefois pas la seule coupable : l’accroissement des incendies criminels (et leur impunité), surtout dans le sud de l’Amazonie, est un autre facteur clé qu’il faudrait souligner. Selon le président de l’Institut brésilien de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables, Rodrigo Agostinho, « la déforestation coûte cher, mais le feu beaucoup moins. Ils [les exploitants de l’agriculture et de l’élevage] n’ont besoin que de se procurer du gasoil et de l’éparpiller. » L’Institut de recherche environnemental de l’Amazonie (IPAM) a observé que les incendies criminels deviennent de plus en plus courants dans le développement de l’agro-industrie. D’ailleurs, dans des biomes naturels comme l’Amazonie, les feux naturels sont « un phénomène rare », selon Ane Alencar, directrice de L’IPAM. Il faut comprendre que l’origine criminelle des feux de brousse est avant tout une question économique. Ces espaces détruits sont développés en pâturages. « En Amazonie, 71 millions d’hectares de forêts ont été convertis en pâturages en 35 ans », explique l’économiste agricole et environnemental brésilien Jean Marc von der Weid. Par exemple, entre le 22 et le 24 août 2024, la ville de São Paulo a enregistré


26 000 foyers d’incendie, dont 81% étaient situés dans des zones agricoles (IPAM).
Ce qu’on oublie, cependant, c’est que le feu a des impacts directs et indirects sur nous. Selon la Confédération nationale des municipalités brésiliennes, environ 11,22 millions de personnes ont été affectées par les fumées des incendies forestiers depuis le début de l’année.
Et il y a un autre aspect que certains journaux passent sous silence : qui sont les habitant.es de l’Amazonie, ces terres précieuses et protégées ? Les peuples autochtones. L’IPAM relève que 3,12 millions d’hectares des terres destinées aux peuples indigènes ont été détruits par le feu. L’accès à des ressources comme l’eau ou la nourriture devient de plus en plus restreint, les obligeant à l’exode. Les plus jeunes et les personnes âgées sont les plus affecté.es par cet environnement dévasté. Parmi de nombreuses autres conséquences sur leur santé, on note notamment le développement de problèmes respiratoires. Cependant, iels n’ont aucun accès à des soins médicaux, limité en raison de l’inaccessibilité des zones dans lesquelles iels vivent. La qualité de l’air ne cesse de se dégrader et les vents transportent à son tour la pulvérisation de ces terres vers d’autres continents.
Les forêts se transforment en cimetières. Les flammes ravagent des villes et des pays entiers, transportant le résidu toxique de leur destruction aux pays voisins. Le monde entier est en feu. Nous devons nous réveiller et protéger notre Terre, non seulement pour nos générations futures, mais aussi pour la nôtre, en particulier pour les plus vulnérables et les plus démunis. Notre meilleur plan d’action est d’agir et non de réagir.
Atlas climatique du Canada. (n.d.) Les incendies de forêt et le changement climatique, Prairie Climate Centre. https : // atlasclimatique.ca/les-incendies-de-foret-et-le-changement-climatique
Défense civile du Rio de Janeiro. (2024). Incêndios Florestais - O que é ? , Site officiel de Defesa civil – Rio de Janeiro. https : //defesacivil.rj.gov.br/index.php/para-o-cidadao/como-agir-em-desastres/22-incendios-florestais
Faria, G. (2024). Incêndios no Brasil : entenda os fatores que explicam o atual cenário, Revista Forum. https : //revistaforum. com.br/meioambiente/2024/9/11/incndios-no-brasil-entenda-os-fatores-que-explicam-atual-cenario-165430.html
Institut national des recherches spatiales brésiliennes. (2024). Dados : Apenas Satélite de Referência – AQUA Tarde (Premier tableau), Programa Queimadas- Situação atual. https : //terrabrasilis.dpi.inpe.br/queimadas/situacao-atual/situacao_atual/ MadreMedia/ Lusa. (2024). Quase metades dos portugueses sentem-se vulneráveis a incêndios. Eurobarómetro divulga dados de inquérito, SAPO Portugal. https : //rr.sapo.pt/noticia/pais/2024/09/30/quase-metade-dos-portugueses-sentem-sevulneraveis-a-incendios/395695/
Mayer N. (2023). Feux de forêt : quelles sont les causes ? , FUTURA. https : //www.futura-sciences.com/planete/questionsreponses/foret-feux-foret-sont-causes-7730/
Neto, A. S. (2024). Incêndios em Portugal : os fatores que explicam a “situação anómala” que não se via desde 2001, SAPO Portugal.https : //pplware.sapo.pt/planeta/incendios-em-portugal-os-fatores-que-explicam-a-situacao-anomala-que-nao-sevia-desde-2001/
Prazeres, L. (2024). Como queimadas em terras indígenas aumentaram 76% e deixaram crianças e anciãos “sufocados”, BBC news Brésil. https : //www.bbc.com/portuguese/articles/c9819351gq4o
Redação CicloVivo. (2024). Brasil em chamas : o que se sabe sobre os incêndios até agora. Ciclo Vivo. Meio Ambiente https : //ciclovivo.com.br/planeta/meio-ambiente/brasil-em-chamas-o-que-se-sabe-sobre-os-incendios-ate-agora/ Ribeiro, A., Rudnitzki, E., Menezes, L. F. (2024). Quais são as causas das queimadas que afetam o país e como se proteger dos efeitos, Aos Fatos, https : //www.aosfatos.org/noticias/queimadas-brasil-causas-efeitos/
Sociedade. (2024). Incêndios : época mais crítica termina hoje marcada pelos fogos que mataram noves pessoas, Alvorada. https : //www.alvorada.pt/index.php/sociedade/12365-incendios-epoca-mais-critica-termina-Whoje-marcada-pelos-fogosque-mataram-nove-pessoas
Symons, A. (2024). Portugal é um dos países mias afetados por incêndios florestais extremos devido às alterações climáticas, Euronews - Clima. https : //pt.euronews.com/green/2024/06/29/portugal-e-um-dos-paises-mais-afetados-por-incendiosflorestais-extremos-devido-as-alterac
Wells, I. (2024). Queimadas na Amazônia : a luta de indígenas para sobreviver a seca e incêndios recorde, BBC News
Brésil.https : //www.bbc.com/portuguese/articles/c870lewr10eo
WWF Brésil. L’Amazonie, une forêt tropicale en danger, WWF France.https : //www.wwf.fr/espaces-prioritaires/amazonie

Par Marie Tremblay, journaliste multiplateforme
L’oxygène et l’eau sont-ils réellement des éléments essentiels à la vie ? Il n’en fait aucun doute pour la survie humaine. Cependant, les biomes terrestres regroupent une foule d’organismes pouvant survivre dans les conditions les plus extrêmes. Ils sont qualifiés d’espèces extrêmophiles (qui aiment les extrêmes). Certaines peuplent les eaux très salées, les environnements chauds (80°C à 105°C) ou froids (0°C), les milieux acides, basiques, arides ou encore les profondeurs à pression élevée. D’autres survivent en conditions anoxiques (sans oxygène), en présence de grande concentration de soufre et même dans des environnements radioactifs (Dietrich et Guezennec, s.d.). Chacune de ces espèces a développé, au cours de son évolution, des mécanismes pour tirer profit de ces environnements peu peuplés. Une espèce en particulier peut résister à toutes ces conditions : le tardigrade, aussi appelé ourson d’eau.
Mesurant moins d’un millimètre, le tardigrade ressemble à gros vers segmenté, soutenu par quatre paires de pattes avec des griffes. Cette espèce est présente dans tous les recoins du globe où il y a de l’eau, y compris dans les profondeurs de l’océan et dans les hautes altitudes. Depuis sa découverte en 1773 (Lebelle, 2024), le tardigrade a été soumis aux environnements les plus hostiles où, à la grande surprise des scientifiques, il survit. Le tardigrade résiste même, pendant plusieurs minutes, à des températures allant de -272 degrés Celsius à +150 degrés Celsius (Miller, s.d.). En 2007, des tardigrades ont été envoyés dans l’espace, les exposant à des rayonnements ultraviolets mille fois plus élevés que ceux sur Terre (La Presse, 2008). De retour dans le vaisseau spatial, ils ont repris leurs activités biologiques, y compris la reproduction, au contact de l’eau après six minutes.
On pourrait pratiquement qualifier ses mécanismes de super pouvoirs. Pour résister à la sécheresse et autres conditions non favorables, il expulse plus de 95% de l’eau contenue dans son corps, perdant ainsi les deux tiers de sa taille d’origine. Ce processus, appelé cryptobiose, permet d’arrêter le métabolisme de l’organisme (Pappas, 2022).
Pour préserver les cellules et les tissus, « des protéines transforment l'intérieur de leurs cellules en un gel qui empêche les membranes cellulaires de se froisser et se détériorer » (Martinage, 2022). Par ailleurs, ces protéines ont seulement été observées chez le tardigrade, bien que d’autres espèces soient capables de processus semblables. En mode de vie actif, leur espérance de vie est de trois mois à deux ans. En hibernation, ils peuvent survivre sans eau ni nourriture pendant une trentaine d’années (La Presse, 2008). Récemment, les chercheur.euses ont enfin découvert ce qui permettait aux oursons d’eau de résister aux rayonnements. Ils ne sont pas à l'abri de la dégradation de l’ADN, cependant, ils sont en mesure d’augmenter leur production de gènes réparateurs d’ADN (Labelle, 2024).
On peut se douter que cette espèce n’est pas vouée à disparaître de sitôt avec de telles adaptations. Les tardigrades ne sont qu’un des nombreux exemples d’une espèce ayant des capacités hors du commun, développées pour la survie en milieux hostiles. La nature regorge encore de mystères à explorer et de nouvelles découvertes qui pourraient révolutionner notre compréhension du vivant.
Références :
Dietrich, J. et Guezennec, J. (s.d.). Extrêmophiles. Encyclopaedia Universalis. https : //www. universalis.fr/encyclopedie/extremophiles/
La Presse. (2008). Le tardigrade, capable de survivre au vide spatial. https : //www.lapresse.ca/ actualites/sciences/200809/19/01-670128-le-tardigrade-capable-de-survivre-au-vide-spatial.php
Lebelle, A. (2024). L'endurance incroyable du tardigrade face aux rayonnements. Radio-Canada. https : //ici.radio-canada.ca/nouvelle/2066870/tardigrade-endurance-rayonnements-explications
Martinage, X. (2022). Le secret du tardigrade pour résister à la dessiccation enfin dévoilé.GEO https : //www.geo.fr/animaux/le-secret-du-tardigrade-pour-resister-a-la-dessiccation-enfindevoile-211751
Pappas, S. (2022). Tardigrades survive drying out thanks to proteins. Live Science.https : //www. livescience.com/tardigrades-survive-drying-out-proteins
R-Miller, W. (s.d.). Tardigrades : The resilient creatures of science. American Scientist. https : //www. americanscientist.org/article/tardigrades


ville.quebec.qc.ca/ transformerlaville
● séance d’information
● sorties urbaines
● ateliers thématiques
8848 mètres d’altitude. -30°C. Raréfaction de l’oxygène. Après deux mois de préparation, c’est l’ascension. Sagarmatha. Chomolungma. Everest. Les noms se multiplient, mais l’objectif reste le même : gravir le plus haut sommet du monde. Mais pourquoi ? « Parce qu’il est là », répond George Mallory, alpiniste britannique qui disparaît sur la face Nord en 1924. A-t-il atteint son but ? On ne le saura jamais. Parce que c’est ça, l’Everest : un voyage dont on ne revient pas toujours.
Par Camille Sainson, journaliste multiplateforme
L’Everest fascine pour son gigantisme, sa beauté, pour son défi aussi. Malgré sa dangerosité, il attire de plus en plus de monde ; pas moins de 600 personnes ont été recensées lors de la saison 2024. Huit mort.es seulement, dix de moins qu’en 2023, et pourtant, les problèmes sont de plus en plus fréquents, tant pour les alpinistes que pour la préservation de cet espace naturel. L’ascension est pourtant restrictive; la préparation dure deux mois, le permis d’ascension coûte 15 000$, il faut faire appel à une agence expérimentée dans la chaîne de l’Himalaya dont les services sont à minima au prix de 50 000$, et bien sûr, être en parfaite condition physique. Les 800 derniers mètres à gravir étant dans la zone dite « de la mort » –« les scientifiques considèrent que le corps humain est incapable de s'acclimater à une altitude supérieure à 8 000 mètres » (Wilkinson, National Geographic, 2024) – c’est loin d’être un parcours de santé ! Et puis, il faut un peu de chance aussi ; des conditions météorologiques favorables pour que s’ouvre la fameuse fenêtre de l’ascension. Or,
c’est là que réside une partie du problème ; ladite fenêtre pouvant être rare et très courte, toustes les alpinistes vont se ruer au sommet en même temps.
En 2019, l’alpiniste Nirmal Purja Magar a pris une photo devenue virale où l’on peut voir presque 320 personnes en file qui attendent patiemment leur tour pour profiter de la vue panoramique. Le collaborateur de la National Geographic Society, Dirk Collins, relate : « on avait l'impression de faire la queue dans une station de ski, pendant un week-end bondé (…). Faire la queue sur l'Everest est frustrant, certes, mais surtout ennuyeux. On ne s'y attend pas. » (Wilkinson, National Geographic, 2020). De son côté, Mark Fisher, un guide expérimenté et membre de l'équipe scientifique dirigée par la National Geographic Society explique : « la foule fait les gros titres... Elle révèle le manque d'expérience des personnes qui s'attaquent à cette montagne (…). Certaines personnes ne semblaient pas savoir comment s'économiser, quelles
techniques d'escalade efficaces adopter, ni comment se préparer à survivre dans un tel environnement » (Wilkinson, National Geographic, 2020). La montée étant désormais plus « accessible », grâce à l’aide des Sherpas et de guides chevronné.es, ce n’est pas un hasard de voir que près de 381 permis ont été délivrés par les autorités népalaises cette même année 2019 – chiffre que l’on doit doubler si l’on veut inclure tout le personnel accompagnant. Malgré tous ces problèmes de circulation, ce sont 478 permis qui ont quand même été délivrés en 2023, soit une augmentation de plus de 25%. Alors cette année, le gouvernement népalais a décidé de prendre des mesures et de légiférer sur un nombre maximal d’alpinistes autorisé.es à faire l’ascension (chiffre non dévoilé pour le moment, on attend de voir…).
Tout récemment, nous avons pu voir le documentaire Kaizen du jeune youtubeur Inoxtag qui retrace son parcours d’un an en vue de gravir l’Everest. De manière authentique,

nous suivons son entraînement jusqu’à l’arrivée tant attendue dans la chaîne de l’Himalaya. L’accueil des spectateur.rices est plutôt mitigé et les critiques ne sont pas tendres, tous regrettent globalement l’absence d’une quelconque dimension écologique ou politique qui mettrait justement en lumière tous les problèmes que subit cet espace naturel.
En effet, l’Everest est une zone protégée, intégrée au Parc national de Sagarmatha au Népal. Ce parc, établi en 1976, couvre une superficie de 1 148 km² et a été inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1979 en raison de sa biodiversité exceptionnelle, mais aussi de ses paysages ! C’est donc un véritable enjeu que de parvenir à le protéger et à éviter d’en faire une attraction touristique aux nombreux déboires. Parce qu’actuellement, la neige éternelle qui recouvre les sommets n’est plus si immaculée que ça…
Quel est donc le premier problème ? L’accumulation des déchets.
Pour un espace resté longtemps inaccessible, où les empreintes éphémères de la panthère des neiges ne se mêlaient pas encore aux traces de bottes, pieux, mousquetons, mais aussi déchets plastiques et selles humaines, l’arrivée de l’alpinisme – que l’on peut, sans faire dans l’euphémisme, qualifier de « masse » – a tout bousculé. Avec l’afflux croissant de touristes vient forcément une quantité innombrable de déchets. Bouteilles d'oxygène vides, tentes, équipement d'escalade, médicaments et batteries jonchent le sol autour de différents camps. Une opération de nettoyage menée entre 2019 et 2023 a permis de ramasser plus de 110 tonnes de déchets, soit l’équivalent de 70 voitures ! Et forcément, avec le froid, il n’y a pas que les déchets plastiques qui résistent à la décomposition, on estime à environ 15 tonnes la quantité d’excréments qui s’accumulent : rien n’est plus vraiment biodégradable à -30°C ! Tout ceci a donc un impact sur la biodiversité et peut également favoriser la transmission de maladies.
Alors que certain.es n’hésitent pas à l’appeler « bombe à retardement fécale », le magazine Géo mentionne dans son article qu’au « camp de base situé à 5 200 mètres – où l’on installe des toilettes sèches depuis quelques années déjà –, les déchets humains sont récupérés quotidiennement et fournis aux agriculteurs locaux, qui s’en servent comme engrais. » (Privé, Géo, 2019). Voilà une bonne solution !
Quid du deuxième problème ? Le changement climatique. Directement lié à l’impact humain sur l’écosystème, le réchauffement global de la planète a plusieurs conséquences sur l’Everest. D’abord, ce sont les glaciers les plus touchés, ils ont perdu en moyenne 100 mètres d'épaisseur depuis les années 1960. La superficie glaciaire totale a donc diminué de 21 km² entre 1962 et aujourd'hui (soit la taille de Monaco tout de même). Le glacier South Col – point le plus élevé de la montagne – fond environ 80 fois plus vite qu’il ne s’est formé. Une étude parue dans Nature en 2022 montre que la glace disparue ces trente dernières années est comparable à 2000 ans d'accumulation au sommet du glacier (Schaepmeester, Futura, 2022). Bien entendu, cette fragilisation des sols augmente le risque d’avalanche, mais elle menace aussi l’approvisionnement en eau potable des habitant.es de la région.
Tout ça pour vous dire que ne devrait pas grimper qui veut – alias celleux qui ont des rêves trop grands par rapport à leur condition physique, malgré leurs porte monnaies bien remplis. Parce que oui, l’argent ne devrait pas pouvoir tout acheter, il faut aussi que les alpinistes se sensibilisent à l’environnement qu’iels tentent de dompter. Rappelons que ce n’est pas chose rare que de croiser un cadavre ou deux sur la route du sommet ; la montagne ne pardonne pas, il y a chaque année une dizaine de mort.es et de disparu.es. Alors, si vous voulez vous lancer, commencez par bien vous préparer.


Suggestions culturelles :
À lire :
Tragédie à L’Everest de Jon Krakauer (1997) : livre autobiographique relatant les événements ayant conduit au désastre de 1996 où huit alpinistes ont trouvé la mort dans une tempête.
Prisonniers de l’Annapurna de Jean-Christophe Lafaille (2003) : histoire vraie de la survie de l’alpiniste Jean-Christophe Lafaille sur la face sud de l’Annapurna alors que son compagnon de cordée vient de disparaître.
Le Sommet des Dieux de Jirô Taniguchi (2004) : À travers les souvenirs de Fukamachi Makoto, photographe d’une équipe japonaise venue vaincre l’Everest, on s’aventure aux côtés d’Hoba Joji, véritable légende du piolet, sur les traces du mythe de Mallory. Plus qu’une ode à la compétition ou à la liberté, ce manga adapté d’un roman très célèbre au Japon illustre avec de splendides graphismes ce monde à part où cohabitent la dure loi de la montagne et la folle passion humaine. Un incontournable du genre à découvrir en cinq tomes.
À voir :
Everest de Baltasar Kormákur : Inspiré d'une désastreuse tentative d'ascension de la plus haute montagne du monde, Everest suit deux expéditions distinctes confrontées à de violentes tempêtes de neige. Luttant contre l'extrême sévérité des éléments, le courage des grimpeurs est mis à l'épreuve par des obstacles toujours plus difficiles à surmonter alors que leur rêve de toute une vie se transforme en un combat acharné pour leur salut.
Le Sommet des Dieux, film d’animation de Patrick Imbert : Le photographe Fukamachi trouve un appareil photo qui appartiendrait à George Mallory, un alpiniste disparu sur le mont Everest, et se lance dans une aventure d'escalade avec son ami Habu Joji.
Everest , documentaire de Greg MacGillivray, Stephen Judson et David Breashears : Une équipe internationale d’alpinistes gravit le mont Everest au printemps 1996. Le film dépeint leurs longs préparatifs pour l’ascension, leur ascension jusqu’au sommet et leur retour réussi au camp de base. Il montre également bon nombre des défis auxquels le groupe a été confronté, notamment les avalanches, le manque d’oxygène, les murs de glace traîtresse et un blizzard mortel.
Références :
Wilkinson, F. (2020). Piège mortel : les dangereux embouteillages au sommet de l'Everest. National Geographic https : //www.nationalgeographic.fr/environnement/2020/04/piege-mortel-les-dangereux-embouteillages-au-sommet-deleverest
Wilkinson, F. (2024). Gravir l'Everest, pourquoi pas vous ? National Geographic.
https : //www.nationalgeographic.fr/voyage/gravir-everest-pourquoi-pas-vous-aventure-depassement-de-soi-defi-escalade Privé, M. (2019). Sur l'Everest, des toilettes sèches installées à 7000 mètres d'altitude. Géo
https : //www.geo.fr/aventure/sur-leverest-des-toilettes-seches-installees-a-7000-metres-daltitude-195342 Schaepmeester, D. (2022). L'Everest a perdu plus de 2.000 ans de glace en 30 ans ! Futura
https : //www.futura-sciences.com/planete/actualites/fonte-glaces-everest-perdu-plus-2000-ans-glace-30-ans-96726/

Je crois que ce qui nous rend profondément humain, c’est notre capacité à ressentir les émotions. L’intensité et la quantité de sentiments que nous pouvons éprouver. Mourir de rire, mourir d’amour, mourir d’envie, mourir de peur… Cette tournure de phrase qui indique un débordement, un trop plein si grand que nous ne pouvons pas nous empêcher de le raconter à autrui. Nous cherchons la validation et la reconnaissance de ce que nous vivons à travers les autres.
Par Marie Tremblay, journaliste multiplateforme
Physiquement, l’émotion se ressent pendant environ 90 secondes (Bolt Taylor, 2021). Moins de deux minutes, c’est le temps qui s’écoule entre le moment où le cerveau reçoit l’information et celui où les différentes hormones terminent de circuler dans le corps. Ce qui reste de l’émotion, nous le retenons en souvenirs, nous en parlons, nous le transmettons. Bernard Rimé parle du « partage social des émotions » pour décrire le phénomène de propagation
d’une émotion. Cela se produit en raison de notre besoin de l’extérioriser. Une personne peut reprendre une histoire qu’elle a entendue et la raconter à quelqu’un d’autre, transmettant ainsi les émotions à travers le récit.
Ce phénomène peut rapidement faire boule de neige et nous pouvons être touché.es par l’histoire d’une personne que nous ne connaissons pas. L’émotion peut aussi être

vécue collectivement, lors d’une catastrophe, par exemple. Les gens en parleront à d'autres, réveillant en elleux le besoin de la transmettre, et ainsi, de fil en aiguille, chacun.e, touché.e à son tour, ressentira l'envie de la partager à nouveau (Rimé, 2016). C’est une boucle sans fin. Si bien que l’information peut circuler sans arrêt pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Nous l’avons bien vu durant la Covid. Partout, la peur, pendant des mois. Des moments d’émotions intenses dans la mémoire collective, il y en a des milliers, et nous continuerons d’en accumuler. Nous ne cesserons jamais de vivre passionnément.
La colère, moteur de révolte
La colère, ce sentiment noir, destructeur, trompeur, même. Elle est la continuité de toute émotion qui n’a pas été vécue à sa juste valeur. La frustration de ne pas comprendre ce qui est en train de se produire, la frustration de ne pas être vu.e ou entendu.e. Entre les mains des mauvaises personnes, la colère est un outil de destruction inégalée. En revanche, dans le cœur d’un peuple, la rage au ventre peut se traduire en moteur de changement.
La Révolution française est le meilleur – et le pire – exemple d’un peuple en colère. L’image des gens armés de fourches et assoiffés de sang royal est forte et absurde à la fois. J’avoue avoir pris un malin plaisir à écouter le Balado de
Charles Beauchesne sur le sujet. Oreilles sensibles s’abstenir, car il décrit plutôt bien les excès de violence et les nombreuses décapitations. Même si la méthode parait louche aujourd’hui, les Français.es ont tout de même réussi à complètement bouleverser la face du monde.
La colère ne se doit pas d’être sanglante, elle peut aussi être une source d’espoir. À travers les siècles, la révolte a permis de bâtir une société plus juste et égalitaire. Cependant, il reste encore bien des luttes à gagner. Lors de la manifestation pour sensibiliser à la cause environnementale en 2019, je me souviens de la colère des gens, de leur impuissance face à l’inaction du gouvernement. Dans cette énorme foule de 500 000 personnes (Radio-Canada, 2019) arpentant les grandes rues montréalaises, je vivais l’apogée d’un sentiment d’espoir partagé. Je faisais partie de quelque chose de grand et d’important. Au fond de moi, un sentiment d’appartenance hors du commun prenait racine pour la jeunesse qui doit se battre pour un futur décent. Je voulais croire que la masse en colère que nous étions était suffisante pour que tout change, mais tous les mouvements n’aboutissent pas en révolution.
Le pouvoir rassembleur du deuil
Quand je pense à des moments d’émotions intenses

vécues collectivement, je songe inévitablement aux deuils nationaux : rien ne rassemble comme la mort. Chacun.e perdu.e dans notre petite individualité, nous nous retrouvons dans ces moments, car nous avons besoin d’une épaule sur laquelle pleurer la mort, la disparition, la finalité. Besoin de savoir que, dans ce bas monde, nous ne sommes pas seul.es. Malgré la noirceur de ce qui nous rapproche, l’humanité resplendit.
Je n’étais même pas une idée lorsque la princesse Diana est décédée tragiquement dans un accident de voiture. Pourtant, regarder les images et écouter les témoignages de cette époque me rend émotive. J’essaie d’imaginer ce que cela devait être, à ce moment-là, de perdre une si grande femme pour si peu. C’est révoltant qu’une personne si jeune perde la vie et particulièrement dans le contexte qui entoure la mort de Lady Di ; une poursuite transformée en cauchemar par des paparazzis avides et sans pitié. Un éclair et la vie se retrouve suspendue pour toujours. Partout à travers la planète, des gens pleuraient la Princesse du Peuple. Il est estimé que 2,5 milliards de personnes ont suivi les funérailles (Duschene et Laurence, 2022). Il y a dans cette disparition une tragédie qui marque les esprits à jamais.
Lorsque Karl Tremblay est décédé, le Québec fut couvert d’un voile noir, une tristesse à l’unisson dans la province.
La chronique de Patrick Lagacé sur le sujet m’a particulièrement touchée. Il écrivait « je pense qu’on sent le peuple plus qu’on ne le voit », puis il ajoutait plus loin « Le peuple n’est pas sorteux, disais-je, mais depuis mercredi il est là, les yeux rougis, kleenex à la main » (Lagacé, 2023). C’est vrai et c’est touchant. Le chanteur des Cowboys Fringants, tout comme la princesse Diana, était l’ami du peuple. Sans l’avoir jamais rencontré, il était un grand chum. Dans ses paroles et sa musique, il a su parler à chacun.e de nous.
L’euphorie
J’ai mis plus de temps à trouver des moments de joies collectives pures. Les bonnes nouvelles marquent moins que les tragédies. Cependant, je me risquerai à dire qu’elles arrivent plus fréquemment et à plus petite échelle, dans une spontanéité déséquilibrante. Le premier aprèsmidi ensoleillé du mois d’avril où les gens sortent leur couverture de pique-nique ne fait pas la une. Ou peut-être que pour vraiment ressentir la joie collective, il faut être là. Je crois que la nature humaine tend à la jalousie et à cette fameuse peur de ne pas faire partie du groupe.
La mémoire québécoise se souviendra longtemps de l’éclipse solaire totale d’avril dernier. J’étais en session d’études à l’étranger, je n’y ai donc pas assisté. Néanmoins, l’excitation et l’appréhension de toustes a rapidement

traversé l’océan pour me rejoindre. Une foule de petits humains fébriles qui portent des lunettes assorties et mettent leur quotidien sur pause pour un spectacle céleste fascinant et si rare… Il y a de quoi être jaloux.se. Plus de 100 000 personnes se sont rassemblées au parc JeanDrapeau (Lebelle, 2024) pour s'émerveiller devant le phénomène et j’aurais voulu être l’une d’entre elles. Pour vivre le moment, certes, mais surtout parce que j’aurais voulu pouvoir garder ce souvenir avec moi toute ma vie.
Le dernier événement que j’aborderai dans ce texte est la chute du mur de Berlin en 1989. Les Allemand.es ne s’y attendaient pas, bien qu’iels le souhaitaient. Après 28 ans de séparation, iels ont finalement pu se réunir (RadioCanada, 2019). L'événement marquait la fin du rideau de fer, la fin de la guerre froide. Les gens festoyaient, dansaient, détruisaient le mur à coups de pioche. C’était la fin d’une longue oppression. Il était désormais permis de traverser de Berlin-Est à Berlin-Ouest sans frontières, sans contrôles. Les Berlinois.es. pleuraient littéralement de joie. Existe-t-il une exaltation plus grisante que la liberté retrouvée ?
En écrivant ces lignes, je prends conscience qu’il est difficile de compartimenter les émotions en un moment précis. La tristesse se mélange à la colère, l’espoir à la déception. En réalité, la plupart de ces événements
comportent des dimensions plus larges, touchant plusieurs groupes, avec des désirs, des mœurs et des croyances distinctes. Notre infinie complexité provient, sans doute, de ces ambiguïtés. Malgré tout, le monde reste capable de tirer profit de ce qui peut être accompli et vécu dans la solidarité.
Bolt Taylor, J. (2021). The 90 second life cycle of an emotion [Vidéo]. YouTube.https : // www.youtube.com/watch ? v=vxARXvljKBA
Duchenes, A. et Laurence, J-C.(2022). Lady Di, le grand mythe. LaPresse. https : //www. lapresse.ca/international/2022-08-28/il-y-a-25-ans-la-mort-de-la-princesse/lady-di-le-grandmythe.php
Lagacé, P. (2023). Le peuple pleure Karl Tremblay (1976-2023). La Presse. https : //www. lapresse.ca/actualites/chroniques/2023-11-17/karl-tremblay-1976-2023/le-peuple-pleure. php#
Lebelle, A. (2023). Éclipse totale de soleil au parc Jean-Drapeau. Radio-Canada. https : // ici.radio-canada.ca/nouvelle/2063460/eclipse-totale-soleil-parc-jean-drapeau
Radio-Canada. (2019). Forte mobilisation pour la grève mondiale du climat. https : //ici. radio-canada.ca/nouvelle/1318625/forte-mobilisation-greve-mondiale-climat-greta-thunberg
Radio-Canada. (2019). La chute du mur de Berlin : archives historiques. https : //ici.radiocanada.ca/nouvelle/1376456/berlin-allemagne-mur-communisme-histoire-archives
Rimé, B. (2016). Émotions en actions : dimensions sociales et au travail. WebTV Université de Picardie. https : //webtv.u-picardie.fr/watch_video.php ? v=H5S882RNODO7
S.a. (2019). La chute du mur : Symbole pour l’Europe. Le Grand Continent. https : // legrandcontinent.eu/fr/2019/11/09/la-chute-du-mur-symbole-pour-leurope/


Mont Denali 6190m
Plus haut sommet d'Amérique du Nord


Willis Tower 527m

Chichén Itzá 24m


Tour CN 553m



EmpireBuildingState 443m



Machu Picchu 2430m d'altitude
Temple le plus haut du monde


6962m

Salto Ángel 979m Plus haute cascade du monde

Plus haut sommet d'Amérique du sud


Christ Rédempteur 38m 709m d'altitude

Tour Eiffel
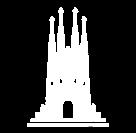
330m




Mont Blanc 4807m

Elbrouz 5642m
Plus haute montagne d'Europe

Sagrada Familia 172m
Monument toujours en construction. Église la plus haute du monde


Monument de la Renaissance Africaine 52m
Plus haute statue d'Afrique


Pyramide de Khéops 140m




Kilimandjaro 5891m

Par Paula Casillas et Camille Sainson


Chutes Victoria 1700m de largeur Chutes d'eau les plus larges au monde

Everest 8848m

Cité interdite
17 millions de visiteur.euses annuels Monument le plus visité au monde

Plus haut sommet du monde



Statue de l'Unité
240m
Statue la plus haute du monde


Taipei 101 508m


Tour Pétronas
4050m
Plus hautes tours jumelles du monde
Challenger Deep 10925m de profondeur
Point le plus profond jamais mesuré dans les océans




Puncak Jaka 4884m
Point culminant de l'Indonésie et de l'Océanie


Station Spatiale Internationnale



419km d'altitude Voyager 1 24 027 223 226km de la Terre
Comment le bde peut-il vous aider ?
de la réglementation qui est en vigueur à l’Université Laval
En vous conseillant
sur les démarches à entreprendre pour résoudre une situation conflictuelle
En vous accompagnant
directement dans vos démarches, notamment devant le comité de discipline
des questions ?
Révision de notes
Plan de cours Évaluation des cours Plagiat
Nos valeurs et approches
La confidentialité
L’autonomisation
La responsabilisation
le bde peut vous aider et c’est gratuit !
Bureau 2258, pavillon Maurice-Pollack 418 656-7098
bureaudesdroits.ca bureau.droits@cadeul.ulaval.ca
/bdeUlaval @bde_ul
1
Promouvoir et défendre les droits et intérêts de toutes les étudiantes et étudiants de premier cycle
Ce qui représente :
2
35 000 membres
Son fonctionnement ?
Assemblée générale
Conseil d’administration
Caucus des associations
89 ✂ssoci✂tions départementales et facultaires
entérine le travail de la CADEUL et son bilan financier
prends des positions d’ordre politique et pédagogique que la CADEUL défendra valide chaque mois les dépenses de l’association et veille à son bon fonctionnement
Contribuer à la vie étudiante
• En offrant des services
• En investissant dans vos projets et vos initiatives
En tout, c’est :
14 services et filiales qui sont là pour vous
Une import✂nte ✂ssoci✂tion ✂u Québec
Influente et crédible, elle contribue à l’amélioration des perspectives d’avenir avec des enjeux comme l’accessibilité aux études postsecondaires, la qualité de la formation universitaire et la transition socioécologique
Comité exécutif
travaille sur les mandats que les trois instances lui ont donnés
• En dynamisant votre campus
• En offrant la possibilité de vous impliquer dans les instances et les activités parascolaires
150+ adaptés à vos besoins emplois étudiants
Quelques exemples de projets animant votre campus :

Béliers
The Messenger (2018) - Sabotage Studio - Jeu vidéo
The Messenger est un jeu d'action et de plateformes rétro développé par le studio québécois Sabotage Studio. Sorti en 2018, le jeu a rapidement gagné en réputation pour sa maîtrise du genre et son hommage aux classiques des années 80 et 90, notamment les jeux Ninja Gaiden. Les Béliers, connus pour leur esprit compétitif, leur amour de l’action, et leur détermination face aux défis, trouveront dans The Messenger un excellent moyen de canaliser cette énergie.

Lions
Forever & Ever (2024) - Thee Heart Tones - Album - Modern Soul / Chicano Soul
Ces temps-ci, cher.ères Lions, l’heure est au rayonnement, à la chaleur, mais aussi à la douceur. Laissez-vous envelopper par les sons mi-nostalgiques mi-modernes de l’album, par sa profondeur et sa maturité, son magnétisme, ses nuances : ils résonneront assurément avec votre désir d’authenticité et de réconfort. Vous serez encore plus en mesure de véritablement vous connecter avec les autres, de les inspirer. Après tout, l’expression sincère de la passion vous fait vibrer. Emboîtez-lui le pas. À votre tour, faites-vous lumière ; en ces temps de turbulences, osez la bienveillance.

Her Story (2015) - Sam Barlow - Jeu vidéo - Enquête
« Jeu de fiction policière à la narration non linéaire, […] Her Story permet aux joueur.euses d’accéder à une base de données policière faite de séquences vidéo archivées et qui couvrent sept entretiens de 1994 dans lesquels une Britannique est interrogée par des détectives au sujet de son mari disparu » (herstorygame.com, traduction libre).
Ce jeu vidéo de type film interactif saura, cher.ères Sagittaires, combler votre soif insatiable de curiosité, de défis et d’énigmes, alors que votre perspicacité et votre sens aiguisé de la déduction y seront mis à rude épreuve. Mais ne craignez rien : votre esprit vagabond saura amplement vous guider dans les méandres de cette affaire mystérieuse bien que fascinante, votre plaisir grandissant au fur et à mesure que vous assemblerez les pièces du casse-tête et y ferez sens. Nous vous conseillons, cher.ères Sagittaires, de ne pas sous-estimer le pouvoir de la lucidité quand vient le temps de nourrir votre désir d’évasion et d’immersion. Profitez de ces moments pour satisfaire votre besoin d’exploration extérieure tout comme celle intérieure, intime, à travers une trame narrative émotionnelle complexe. N’ayez pas peur des dilemmes moraux : ils sont riches et sauront assurément vous stimuler. Prêtez-vous au jeu (!) et laissez-vous surprendre.

Joli Chaos (1991) - Daniel Bélanger - Album - Pop rock, folk rock
Cher.ères Taureaux, les mots et les mélodies mélancoliques de Daniel Bélanger résonneront en vous comme une vérité. L’album Joli Chaos sera une ode à votre vie qui semble parfois n’aboutir nulle part. À travers les nombreuses décisions qui vous déchirent et les déceptions accumulées, vous trouvez le moyen, non sans peine, de rester positif.ve. Permettez-vous d’être vous-même et faites-vous confiance, vous savez mieux que quiconque ce que vous voulez. Osez prendre les décisions qui font peur, foncez vers vos rêves. Malgré le sentiment de solitude profond qui vous décourage parfois, n’oubliez pas que vous pourrez toujours vous épauler sur les personnes qui vous sont chères. Prenez l’habitude d’aller vers elles. Il y a du beau dans le désordre, il s’agit de savoir comment le regarder. Rappelez-vous que le monde est imparfait, mais que la vie fait bien les choses.
Hannibal (2001) - Ridley Scott - Film

« Dix ans après avoir échappé au FBI, Hannibal Lecter coule des jours tranquilles à Florence, où il gagne sa vie comme professeur en histoire de l'art. A des milliers de kilomètres de là, Mason Verger, la seule victime du tueur à avoir survécu, met tout en œuvre pour retrouver son bourreau…» (traduction libre, Prime Video)
Si on avait voulu aller dans le plus récent, on aurait pu conseiller aux Vierges de regarder la série Monsters : The Lyle and Erik Menendez Story (Netflix, 2024), mais c’est encore et toujours la précision et le perfectionnisme de Lecter qui soulignent si bien votre humeur en cette saison et qui l’emporte pour cette suggestion. Son attention obsessionnelle aux détails, son intelligence méthodique et son contrôle froid de chaque situation rappellent votre capacité d’analyse, d’organisation et votre tendance au perfectionnisme extrême qu’une mauvaise note à la mi-session viendrait ébranler.

Babylon (2022) - Damien Chazelle - Film
« Los Angeles des années 1920. Récit d’une ambition démesurée et d’excès les plus fous, Babylon retrace l’ascension et la chute de différents personnages lors de la création d’Hollywood, une ère de décadence et de dépravation sans limites. »
Cher.ères Capricornes, Babylon de Damien Chazelle est un film qui résonne avec votre ambition et votre détermination. Plongeant dans l'âge d'or d'Hollywood, il explore les luttes et les excès des artistes en quête de succès. Les dilemmes moraux des personnages, tiraillé.es entre ambition et intégrité, reflètent vos propres défis. La richesse visuelle et sonore du film saura nourrir votre appréciation pour l'art tout en vous incitant à réfléchir sur le prix de la réussite. Laissez-vous emporter par cette œuvre captivante qui célèbre à la fois le rêve et la réalité !

Les amours imaginaires (2010) - Xavier Dolan
Les amours imaginaires raconte l'histoire de deux ami.es, Francis et Marie, qui tombent amoureux du même homme, Nicolas, un jeune et mystérieux garçon au charme magnétique. Leur fascination pour Nicolas les conduit à rivaliser secrètement l'un contre l'autre, chacun espérant conquérir son cœur.
Le film est à votre image les Gémeaux, c’est-à-dire en apparence léger, mais il cache, derrière son esthétique empruntée tantôt à la nouvelle vague, tantôt à des cinéastes comme Wes Anderson, ce désir d’être vu.e et aimé.e au-delà d’une image léchée. Vous trouverez difficile de ne pas vous retrouver à l’un, voire aux trois personnages, sans parler de la trame sonore qui semble avoir été écrite pour vous entre Indochine, Isabelle Pierre et Dalida.
Vol de nuit (1931) - Saint Exupéry - Folio - Aventure

« Ainsi les trois avions postaux de la Patagonie, du Chili et du Paraguay revenaient du sud, de l'ouest et du nord vers Buenos Aires. On y attendait leur chargement pour donner le départ, vers minuit, à l'avion d'Europe.. Trois pilotes, chacun à l'arrière d'un capot lourd comme un chaland, perdus dans la nuit, méditaient leur vol, et, vers la ville immense, descendraient lentement de leur ciel d'orage ou de paix, comme d'étranges paysans descendent de leurs montagnes… »
Cher.ères Balances, Vol de nuit d'Antoine de Saint-Exupéry est une œuvre qui explore les thèmes du devoir et de l'engagement, résonnant avec votre quête d'harmonie et d'équilibre. À travers le personnage de Fabien, pilote courageux, le récit met en lumière les sacrifices nécessaires pour atteindre des objectifs supérieurs, même au péril de sa vie. La nuit, omniprésente dans le roman, symbolise à la fois la beauté et l'incertitude, un reflet de votre sensibilité face aux dualités de l'existence. En naviguant entre les cieux et les tempêtes, Fabien incarne votre propre lutte pour trouver un équilibre entre passion et responsabilité. Laissez-vous emporter par cette méditation sur le sens du devoir et la beauté du risque !
Valide (2021) - Chris Bergeron - Éditions XYZ - Autofiction / Science-fiction

« D’abord : ceci est une mutinerie. Et si notre mutinerie doit réussir, il faut que je nomme bien les choses, sans détour. Sans ça, tu ne dérogeras pas à tes certitudes. Alors voilà : je suis trans. Comme dans transgression. J’ai cassé les genres, je me suis soustraite aux codes. Je suis trans. Comme dans translation. J’ai fait glisser les éléments qui constituent ma personne d’un état vers un autre. Ma géométrie a été variable. Je suis trans. Comme dans transmutation. Ma vie est une alchimie. J’ai fait de l’or avec du plomb. Je suis trans. Comme dans transports amoureux. J’ai connu toutes les ardeurs. Celles des femmes, celles des hommes et celles de cielleux qui ont quitté le bal des binarités. Je suis trans. Comme dans transie. Par la peur, par l’amour, par la solitude. Je suis trans. Comme dans transhumance. J’ai changé de troupeau et de pâturage. J’étais un mouton. J’ai tenté d’être une brebis. Mais en vain. Je comprends aujourd’hui que je suis une louve parce que je suis trans. Comme dans transgenre. Et ce soir, je suis une révolution. /avertissement : code rouge... activation du protocole d’extraction-interrogation... échec de transmission... standby/. »
Ah ! Cher.ères Verseaux ! Quoi de mieux que la littérature de science-fiction pour éveiller votre esprit visionnaire ? Explorant de nouveaux possibles, il y a là un livre parfait pour sortir des sentiers battus et combattre la grisaille quotidienne. Laissez ce récit futuriste alimenter vos rêves de changements et de formes neuves. Faites toutefois attention à garder les pieds sur Terre (mais pas trop). Peut-être est-ce le temps d’envisager des solutions concrètes, incarnées, porteuses de votre créativité et axées sur la collectivité. N’hésitez pas à déstabiliser les normes et structures établies (ou même votre entourage, s’il le faut). La révolution approche.

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) - Carl Jung - Test des 16 Personnalités
Le Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) est un test de personnalité basé sur les théories de Carl Jung. Il classifie les individus en 16 types de personnalité distincts selon quatre dimensions : Extraversion/Introversion, Sensation/Intuition, Pensée/Sentiment, et Jugement/Perception.
Vous, nos chèr.es ami.es les cancer, êtes émotif.ves, sensibles, intenses, souvent prisonnier.ères de vos émotions et sujets aux sauts d'humeur. Vos besoins de sécurité et de protection restent toutefois bien présents, et quoi de mieux qu’un test de personnalité pour tenter de psychanalyser (et peut-être justifier) vos angoisses ? Mais restez comme vous êtes ! Vos suranalyses font paraître notre propre besoin d’aller voir un.e psy un peu moins pressant…
Neverender (2024) - Justice et Tame Impala - Pop Electronica

Neverender, le nouveau super-single issu de la fusion dance de deux des plus grands noms de la pop de notre époque (Justice et Tame Impala), est la chanson qu’il vous faut, cher.ères Scorpions, pour vous bulldozer à travers votre automne comme un.e badass. Un mix juste assez équilibré de la puissante french touch des gars de Justice et la voix enivrante de Kevin Parker (Tame Impala) qui est sûr de venir complémenter toute l’assurance et la passion pour laquelle on vous connaît (assurez-vous d’en laisser pour les autres aussi quand même…). Il peut paraître chiche de ne proposer qu’une chanson comme recommandation, mais sa qualité de vers d’oreille presque intarissable et les deux excellents remix qui l'accompagnent (on recommande particulièrement celui de Kaytranada) en valent la chandelle.

Poissons
Perfect Days (2023) - Wim Wenders - Film
Film germano-japonais qui suit quelques semaines du quotidien et les petites péripéties d’un employé des toilettes publiques du quartier de Shibuya à Tokyo.
Si vous n’avez pas encore vu ce film sûr de devenir un classique dans les années qui viennent, courez voir Perfect Days, le petit dernier de Wim Wenders. Un film d’une simplicité et d’une béatitude juste assez bien dosée pour l’hypersensitivité de votre signe, Perfect Days se plonge la vie frugale, mais contentée d’un concierge qui aime, ses plantes, le rock des années 1970-80 et prendre en photos les ombres que font les feuille des arbres. La vie d’Hirayama n’est pas sans embûches, mais il se dégage de cette œuvre le genre de bonheur tranquillisant dont vous avez besoin dans ce monde de vipères où toustes courent pour être à la gorge de toustes. Vous trouverez en lui quelqu’un de similaire à vous, un rêveur parfois un peu trop empathique, mais facilement contenté par les petits bonheurs.
À ne pas manquer cette année sur les ondes de CHYZ 94,3 :
Écoute Local - lundi de 16h à 17h

La playlist hebdomadaire façonnée par Mémo Gauthier qui vous tient au courant des projets musicaux les plus éclectiques de la ville de Québec.
Conduite Antisportive - lundi de 14h à 15h et vendredi de 15h à 16h
Les lundis, l'équipe de CAS vous parle de toutes les actualités sportives universitaires. Les vendredis, on parle du sport sur le plan international.
Chéri.e, j'arrive ! - mardi au jeudi de 16h à 17h30
La mythique quotidienne culturelle du retour à la maison refait son apparition sur notre grille horaire. Rejoignez Noémie Fontaine pour ressentir le pouls culturel de la ville de Québec.
Les Arshitechs du son - lundi au vendredi de 17h30 à 18h30
Depuis 1997, les Arshitechs du son mettent de l'avant la musique Hip-Hop à l'échelle locale et internationale.
Le Deuxième Service du Ré-Show - samedi et dimanche de 11h à 12h
Pour tout connaître sur l'actualité locale et internationale, rejoignez Alex Baillargeon qui traite de chaque sujet de manière critique.
CHYZ 94,3 est le diffuseur officiel du Rouge et Or, des Remparts de Québec et des Capitales de Québec.
Visitez la grille horaire sur le chyz.ca !
Astral 2000
Virginie B


Album Bleu
Marie-Pierre Arthur


XUV BéLi


Le sol ou le ciel
David Bujold
Abracadabra
Klô Pelgag




Ma troisième émergence
Larynx
Cardinal Avec pas d'casque
Transformation
Sheenah Ko
Tintamarre
Les Hay Babies
J'ai trouvé Jésus
CURE-PIPE
Le comte de Monte Cristo d’Alexandre de La Patellière et Matthieu Delaporte (2h53)
«Victime d’un complot, le jeune Edmond
Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu’il n’a pas commis. Après quatorze ans de détention au château d’If, il parvient à s’évader. Devenu immensément riche, il revient sous l’identité du comte de Monte-Cristo pour se venger des trois hommes qui l’ont trahi.»
Here – Les plus belles années de notre vie de Robert Zemeckis (1h43)
«Une odyssée à travers le temps et la mémoire, centrée sur un endroit en Nouvelle-Angleterre où, depuis la préhistoire jusqu'à plus tard, depuis une maison, l'amour, la perte, la lutte, l'espoir et l'héritage se jouent entre des couples et des familles au fil des générations.»
Emilia Pérez de Jacques Audiard (2h10)
«Surqualifiée et surexploitée, Rita use de ses talents d’avocate au service d’un gros cabinet plus enclin à blanchir des criminels qu’à servir la justice. Mais une porte de sortie inespérée s’ouvre à elle : aider le chef de cartel Manitas à se retirer des affaires et réaliser le plan qu’il peaufine en secret depuis des années : devenir enfin la femme qu’il a toujours rêvé d’être.»
L’amourauprésent de John Crowley (1h47)
« Une chef prometteur et un jeune divorcé voient leur vie changée à jamais lorsqu'une rencontre fortuite les réunit, dans une histoire d'amour profondément émouvante qui s'étend sur une décennie.»
« À 12 ans, Bailey vit avec son frère Hunter et son père Bug, qui les élève seul dans un squat au nord du Kent. Bug n’a pas beaucoup de temps à leur consacrer et Bailey, qui approche de la puberté, cherche de l’attention et de l’aventure ailleurs. »






Un parfait inconnu de James Mangold (1h50)
«New York, début des années 60. Au cœur de l’effervescente scène musicale et culturelle de l’époque, un énigmatique jeune homme de 19 ans arrive dans le West Village depuis son Minnesota natal, avec sa guitare et un talent hors normes qui changeront à jamais le cours de la musique américaine. Alors qu’il noue d’intimes relations durant son ascension vers la gloire, il finit par se sentir étouffé par le mouvement folk et, refusant d’être mis dans une case, fait un choix controversé qui aura des répercussions à l’échelle mondiale…»
PlanèteB d’Aude-Léa Rapin (1h58)

Par une nuit au cœur d’une révolte qui fait rage dans tout le pays, subitement une poignée d'activistes disparaît. Parmi eux, se trouve Julia Bombarth, 30 ans. Elle se réveille dans un monde totalement inconnu : Planète B.

Leurs enfants après eux de Ludovic Boukherma et Zoran Boukherma (2h26)
«Août 92. Une vallée perdue dans l’Est, des hauts fourneaux qui ne brûlent plus. Anthony, quatorze ans, s'ennuie ferme. Un après-midi de canicule au bord du lac, il rencontre Stéphanie. Le coup de foudre est tel que le soir même, il emprunte secrètement la moto de son père pour se rendre à une soirée où il espère la retrouver. Lorsque le lendemain matin, il s’aperçoit que la moto a disparu, sa vie bascule.»
«Le conte gothique d'une obsession entre une jeune femme hantée et un vampire épris d'elle, causant des horreurs indicibles sur son passage.»
«Un célèbre documentariste canadien, condamné par la maladie, accorde une ultime interview à l’un de ses anciens élèves, pour dire enfin toute la vérité sur ce qu’a été sa vie. Une confession filmée sous les yeux de sa dernière épouse…»






Parmi les films sortis en 2024, c’est à propos de The Substance que j’ai entendu le plus « L’astu vu ? ». Même des gens qui n’écoutent pas d’horreur et encore moins de body horror. L’expérience cinématographique du dernier film de Coralie Fargeat fascine, dérange, marque.
NDLR : Attention, divulgâcheurs en vue.
Par Emmy Lapointe, rédactrice en chef
Synopsis
Elisabeth Sparkle (Demi Moore), une célébrité « vieillissante » venant tout juste de perdre son poste à la télévision, cherche désespérément à retrouver sa jeunesse et sa renommée. Elle recourt donc à un médicament visiblement illégal appelé The Substance qui crée une version plus jeune d’elle-même, Sue (Margaret Qualley). Tandis que Sue grimpe vers la gloire, Elisabeth subit des conséquences dévastatrices, s’ensuit alors une lutte psychologique et corporelle intense entre les deux versions d’elle-même.

You are one
Les diktats de beauté et de jeunesse éternelle pour les femmes, le regard masculin; rien de nouveau sous le soleil d’Hollywood. Coralie Fargeat n’innove donc pas avec les thématiques de son plus récent film, mais bien dans leur traitement. À cheval entre le body horror et la satire, les transformations corporelles d’Elisabeth sont à la fois grotesques et violentes à commencer par la naissance horrifique de Sue qui émerge littéralement de son dos. C’est une scène d’horreur qui dépasse la simple transformation physique; elle marque une rupture viscérale entre l’idéal de la jeunesse et le corps réel.
Et tandis que Sue incarne cette perfection tant convoitée, Elisabeth, elle, entre dans un processus de décomposition inexorable. Le miroir tout comme la photo de Sue sur un énorme tableau publicitaire devant son appartement deviennent ses bourreaux en lui renvoyant constamment l’image d’un corps qui ne correspond plus à ce qu’il devrait être. Cette transformation incarne à la fois l’obsession collective pour la jeunesse et l’horreur intime de voir son corps trahir cette obsession.
L’équipe médicale derrière The Substance a été claire avec Elisabeth : il n’y a pas d’elle et de toi, vous êtes une. Pourtant, la dissociation entre Elisabeth et Sue ne laisse pas de doute et marque une perte de contrôle irréversible où l’esprit d’Elisabeth se fragmente face à l’incarnation de son propre désir. Sue, projection idéale de jeunesse et de perfection, devient le rappel constant de son incapacité à échapper au vieillissement. Son image hante Elisabeth qui voit son corps et son esprit se dissoudre dans l’illusion d’une jeunesse éternelle qu’elle ne peut ni habiter ni fuir.
Visuellement, The Substance, c’est intense. Les couleurs saturées – rouge sanglant, jaune éclatant, bleu gothique – et le contraste constant entre éclairage de néon et noir quasi complet participent à mettre en place une atmosphère d’excès. Les symboles comme les œufs ajoutent à la surenchère visuelle et renvoient à l’idée d’une renaissance fragile, voire impossible. Fargeat multiplie les clins d’œil à des classiques de l’horreur et du body horror comme Death Becomes Her et Carrie qui participent eux aussi à la saturation esthétique.
Et si la cinéaste met en place tous ces procédés, c’est pour dépasser la simple critique de l’obsession de la beauté et le culte de la jeunesse féminine. Elle le fait pour montrer l’échec de l’idéal patriarcal. Parce que dans The Substance, il n’y a pas d’issue pour Elisabeth. Son corps, sa carrière et son esprit se détériorent alors qu’elle lutte contre un système qui l’a déjà abandonnée. Mais il n’y a pas non plus d’issue pour Sue qui survit seulement parce qu’elle vide Elisabeth, et donc elle-même, et que ce sont les mêmes regards posés sur elle que ceux qui se posaient jadis sur Elisabeth qui la forcent à se vider encore et encore.
Cette violence est irréversible, ce qui est pris à l’autre ne revient jamais. On le voit bien au monstre qui se crée de l’ultime tentative d’Elisabeth de se reposséder. Étrangement, c’est cette bête aux deux têtes et demie qui nous paraît le plus vulnérable, le plus humain des personnages.

« C’est l’histoire d’un homme qui tombe d’un immeuble de 50 étages. Au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer : « Jusqu’ici tout va bien… Jusqu’ici tout va bien… Mais l’important c’est pas la chute. C’est l’atterrissage. » - La Haine, 1995
Par Antoine Morin-Racine, chef de pupitre actualités
Il y a un apocalyptisme particulier qui se perçoit comme un bruit de fond lugubre dans la symphonie de l’histoire humaine. Un goût névrotique pour le cataclysme qui a toujours su s’exprimer partout où nous nous sommes groupés avec assez de consistance pour nous raconter nous-mêmes et qui vit aujourd’hui dans une symbiose particulièrement paradoxale avec l'apocalypse climatique avenante.
À l’approche lancinante de notre première véritable rencontre avec l’extinction en tant qu’espèce, les récits se tendent, les toiles de signes qui naissent de nos cultures se complexifient. Certain.es succombent à l’anxiété et d’autres s’entêtent à croire que tout doit continuer. Les contradictions s’empilent. La meilleure chose à faire reste probablement de les adresser, politiquement; de faire aboutir les cassures et les révolutions auxquelles elles peuvent mener lorsqu’elles deviennent insupportables. Audelà de notre nécessité à dépasser ces contradictions par contre, il peut aussi y avoir un certain plaisir, peut-être même une certaine utilité, à les étudier.
L’analyse des différentes formes que prend aujourd’hui cette obsession millénaire pour l’apocalypse peut peut-être nous aider à mieux vivre avec l’ironie d’un monde qui refuse de faire quoi que ce soit pour l’éviter.
L’Apocalypse comme obsession
La plupart des sociétés humaines ont toutes eu, à un moment ou à un autre de leur existence, un penchant pour l’eschatologie (l’étude de la fin du monde), une fascination macabre, entre la pulsion d’autodestruction et la terreur existentielle, élevée à un niveau métaphysique devant le sort ultime de ce qui nous est collectivement cher à la face de l’éternité.
Les Scandinaves avaient foi en une grande bataille entre les dieux qui signalerait la fin de leur ère et le début d’une nouvelle, les religions abrahamiques croient toutes en leurs propres versions du « Jugement dernier » où Dieu descendra de son ciel pour juger les actions des mortels, mais aussi du Déluge, duquel survivent quelques humains de qui nous descendrions toustes. Les bouddhistes ont une cartographie immensément complexe des « sphères » que traversera l’univers, la nôtre en étant une parmi des dizaines d’autres qui suivront.
Il est bien connu et plusieurs historien.nes ont documenté comment les ravages de la Peste noire dans l’Europe médiévale ont mené à une vague particulièrement féroce de fanatisme religieux aux accents particulièrement apocalyptiques. (Dubar, 2010.)
Sous les effets de l’industrialisation américaine galopante du milieu du 19e siècle et l’aberration blasphématrice que ses excès suscitaient au sein du protestantisme provincial du nord-est des États-Unis, plusieurs sectes de millénaristes firent leur apparition dans la région. C’est ainsi que des milliers de croyant.es suivirent le prédicateur William Miller en haut d’une colline pour découvrir que le monde n’allait PAS prendre fin le 22 octobre 1844.
Il fait partie des rites de toute collectivité digne de ce nom et spécialement celles en temps de crise; de faire fleurir ses propres interprétations de la fin du monde. Les Américain.es d’aujourd’hui, par contre, comme avec beaucoup de choses, l’expriment avec une certaine indécence qui invite à la réflexion.
Fort.es d’une culture bâtie autour de l’angoisse calviniste et de plusieurs vagues de millénarisme dans son histoire, certains des exemples contemporains et laïques les plus accablants de cet apocalyptisme récurrent se trouvent notamment dans ce cinéma catastrophe américain qui a connu son heure de gloire dans les années 1990 et 2000. Un genre cinématographique qui peut se concevoir comme la distillation d’un moment où le Nord global n’avait rien d’autre à faire de ses plus belles années que de s’obséder à penser sa propre destruction.
Parmi quelques autres comme Michael Bay ou Irwin Allen avant lui, le représentant du film catastrophe le plus fidèle est probablement Roland Emmerich. Maître dans l’art de faire passer la mort de millions de personnes pour un événement solennel à grands coups d’orchestre mélodramatiques, de scénarios tirés par les cheveux et de discours boboches- badass , Emmerich est l’auteur d’artefacts culturels inestimables de la Fin de l’Histoire comme Independance Day (1996), la première version américaine de Godzilla (1998), Le jour d’après (2004) ou le « tellement-mauvais-que-c’est-bon » 2012 (2009).
Un réalisateur avec un talent inconscient pour le nanardesque dont l’œuvre frôlerait l’outsider art si l’on n’en était pas venu à mettre des millions de dollars entre ses mains. Emmerich est le genre de créateur qui a su se hisser une place dans les hautes sphères de l’industrie culturelle pas tant par son talent que parce qu'il incarne pleinement, sans même le savoir, la culture de son époque.
Le jour d’après (2004) suit l’histoire de l’humanité aux prises avec une super-tempête qui la ramène dans une ère glaciaire en l’espace de quelques jours. Construit autour d’une compréhension pour le moins expéditive de la glaciologie tirée d’un roman pulp écrit par un animateur
de radio AM dans les années 1990, c’est l’arrêt subit des grands courants marins comme le Gulf Stream, lui-même causé par la fonte de la banquise et des glaciers, qui est à l’origine d’une tempête interplanétaire.
Autre qu’un film qui réussit à héroïser la profession de glaciologue et tente de nous faire croire que l’air descendant d’un cyclone a le pouvoir de geler une personne sur place en l’espace de quelques secondes, il fait état de notre incapacité collective à concevoir la réalité de la crise climatique dans le temps et dans l’espace qui lui est particulier.
Le philosophe Timothy Morton a été le premier à désigner la crise écologique comme un « hyper-objet », c’est-à-dire objet dont on ne peut nier l’existence , mais qui est tellement vaste qu’il ne peut s’observer que par les épiphénomènes qu’il cause. Une chose à la dimension spatiale et temporelle tellement immense, tellement complexe qu’elle ne peut être considérée que de manière conceptuelle et son étendue sera toujours fondamentalement impossible à saisir complètement pour la conscience humaine.
Il est possible de conceptualiser le réchauffement de la planète, de le théoriser, de le mesurer par les ravages qu’il cause, même d’en faire un enjeu politique au sein de nos collectivités, mais quand vient le temps de passer à l’action, même si les instructions pour le limiter peuvent être scientifiquement déterminées au parties par millions de CO2 près, il y a une viscéralité qui manque à l’enjeu pour qu’il enclenche une réponse qui serait proportionnelle au danger existentiel qu’il nous pose.
C’est pourquoi un film comme Le jour d’après se sent le besoin de compresser narrativement le changement climatique d’une telle manière. L’on s’imagine la fin des temps, l’on en construit des récits, en partie pour vulgariser ce qu’elle représente, arriver à en faire sens.
La fonte des glaciers et le ralentissement des courants constituent certes de véritables dangers climatiques pour l’humanité, mais même dans leurs dérégulations les plus rapides, elles peuvent prendre des décennies avant de faire effet. (Woods Hole Oceanographic Institution), une échelle de temps non seulement difficile à porter à l’écran à une époque qui est obsédée avec l’instantanéité et le sensationnalisme. Qui plus est, ses effets ne sont pas aussi spectaculaires qu’une masse de givre mouvante qui menace de vous congeler vivant.e. Ceux-ci ressemblent plutôt à des tempêtes de plus en plus féroces, des inondations de plus en plus fréquentes, un rivage qui s’effrite de plus en plus vite chaque année, un ensemble
de facteurs empirant qui se vit comme une misérabilisation constante de notre capacité d’existence, mais dont la profonde déprime qu’elle amène en y pensant ne se transmet pas bien avec les codes cinématographiques puériles du Hollywood des années 2000.
L’un des intérêts d’imaginer la fin du monde, c’est aussi évidemment de fantasmer qu’on puisse lui survivre. C’est ce qu’Emmerich fait dans son cartoonesque 2012. S’étant donné pour objectif une version actualisée du mythe de l’Arche de Noé, Emmerich déformera à cet effet la théorie déjà tordue et bien en vogue selon laquelle notre monde allait prendre fin le 21 décembre 2012 selon le « calendrier maya ». En résulte un film où les protagonistes les plus importants, après être sorti.es évidemment vivant.es de multiples désastres et un déluge de proportions littéralement bibliques, se sauvent inopinément sur des bateaux aux allures de vaisseaux spatiaux qui s’immiscent dans le script avec la grâce d’un éléphant dans un café de porcelaines. À l’appel d’un seul scientifique prétendant que les continents allaient s’engouffrer dans la mer, l’ensemble des gouvernements du monde auraient mis leurs différends de côté pour construire en secret ces « arches » destinées à sauver celleux qui on eut la chance de ne pas servir de figurant.es dans la destruction des grands monuments du monde. Surfant sur l’anxiété post-récession et la vague de pseudodocumentaires de la History Channel à ce sujet, le revisionnement de 2012 a, aujourd’hui, quelque chose de bizarrement nostalgique. Pas qu’il serait désirable que ce genre de films reviennent au cinéma, mais on y trouve une relique d’un temps où même la possibilité du retournement de la terre sous nos pieds pouvait être balayée par une finale cheesy où un père divorcé se réconcilie avec sa femme et ses enfants sur un bateau futuriste.
Non seulement fantasmer qu’on puisse lui survivre, mais qu’on puisse même l’éviter en trouvant un moyen de la contrôler. Le 19 juillet dernier sortait en salle le film Twisters. Bien qu’il ne soit pas une création d’Emmerich, Twisters constitue tout de même une suite d’un des classiques du cinéma catastrophe des années 1990, quoiqu’avec une touche de géo-ingénierie en plus. On y suit l’histoire d’une rivalité entre deux équipes de chasseur.ses de tornades en Oklahoma. La jeune météorologiste, Kate Carter revient au stormchasing dans son État natal après avoir vu quatre de ses ami.es s’envoler il y a 5 ans lors d’une expérience ratée qui tentait de « dompter » une tornade. Naviguant un triangle amoureux plus qu’un peu quétaine, celle-ci survit contre toute attente à plusieurs tempêtes mortelles en l’espace d’à peu près une semaine, et s’amourache pour Tyler Owens un ex-toréador devenu star des médias sociaux en chassant la mauvaise météo. Dans une finale

anselm-kiefer-rorate-caeli-desuper-2016
ébouriffante où une tornade particulièrement puissante menace la plupart de nos protagonistes et a déjà commencé la destruction de la ville natale de notre personnage principal, Kate réussit à s’introduire dans l’œil de celle-ci et à libérer plusieurs barils de produits chimiques qui l’arrêtent juste à temps, réalisant ainsi son rêve de pouvoir contrôler la météo dans le but de sauver des vies.
Quoique théoriquement possible, plusieurs consultant.es scientifiques ayant participé à la conception du film sont d’accord pour affirmer que les quantités de polymères absorbants et d’iodure d’argent utilisées devraient être vastement plus élevées (autour de 30 tonnes) pour avoir un effet sur la tornade. Qui plus est, les ramifications environnementales de leur utilisation sont potentiellement dangereuses, sans compter que le « domptage » d’une seule tornade ne fait pas disparaître la cellule orageuse qui l’a causée (Jones, 2024).
Mais revenons à Emmerich, car c’est son magnum opus,
Independance Day (1996), qui nous permet d’observer la consécration la plus évidente de ce fantasme de contrôle sur l’apocalypse qu’on n’aurait pas tort d’associer à la modernité avancée. Dans un monde où les extraterrestres descendent sur les tours jumelles avant Al-Qaeda, l’Amérique repousse une invasion de vaisseaux assez gros pour ombrager les plus grandes villes du pays à l’aide d’un casting de personnages aussi héroïques que farfelus. Jeff Goldblum est un informaticien plus intelligent que tout le monde qui réussit à mettre un virus directement dans le mainframe des aliens, Will Smith est un pilote de jet téméraire qui agit comme leaders des innombrables comic reliefs du film, et le président des États-Unis est un vétéran de la guerre du Golfe à la fois cool, sérieux et solennel. Après qu’un pilote un peu fou dont personne n’a cru l’histoire d’abduction se soit kamikazé dans le ventre mou du vaisseau mère, tout part miraculeusement en fumée, ce qui permet au président de prononcer un discours larmoyant où il déclare qu’ils célèbrent aujourd’hui ensemble « le jour de leur indépendance », le triomphe
littéral de notre espèce sur la fin du monde.
Malgré tout ce que ces œuvres peuvent nous dire sur la forme que peut prendre notre obsession eschatologique à ce moment-ci de notre histoire, il serait naïf de croire que tous ces films ne sont pas des artéfacts d’un temps déjà révolu. Le jour d’après a 20 ans cette année, Independance Day presque 30 et Twisters, même s’il est sorti en juillet, tire l’entièreté de son intérêt des codes maintenant nostalgiques qu’il reproduit.
Avec des œuvres comme Don’t look up (2021) d’Adam McKay ou même le décevant Civil War (2024) d’Alex Garland, on voit pourrir sous nos yeux le cadavre de l’optimisme néolibéral d’antan. Nous avons transitionné du bête amusement devant la destruction à grande échelle d’une époque où ce que l’on savait de l’enjeu environnemental se résumait à trouver Al Gore fatiguant, à une vague appréhension plus sombre, beaucoup plus cynique. Notre culture riposte à l’hédonisme qui l’a précédé et dont elle est maintenant mal à l’aise. Particulièrement dans un monde post-pandémique, elle réalise à tâtons ce qu’implique véritablement la déliquescence sociale et l’effondrement civilisationnel.
Les certitudes à propos du monde qu’elle se plaisait non-
chalamment à détruire s’effritent, mais à quel rythme ? Si même, l’on était capable de concevoir dans sa totalité le cataclysme qui nous attend, l’on est certainement encore assez naïf.ves pour penser à tout coup que l’on fera partie des « chanceux.ses » à ne pas mourir dans d’atroces souffrances. Plus encore, l’on croit toujours dur comme fer que l’on peut arriver à le contrôler et l’on semble encore incapable d’imaginer un futur où la survie de notre espèce n’est pas attachée au triomphe pimpant de notre mode de vie écocidaire.
L’intérêt d’étudier ces films dont on ne veut pas admettre qu’ils sont maintenant « vieux » réside dans les façons dont ils ont modelé de manière pérenne nos imaginaires; comment les mythes dont ils font état survivent, se transforment ou meurent selon les directions que prennent nos cultures.
La Croissance comme lubie
Plus tôt cette année, un sondage exclusif du quotidien britannique The Guardian (Carrington, 2024) indiquait avoir interrogé 380 scientifiques du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC). 77% d’entre elleux estimaient que les températures globales allaient dépasser 2,5 C au-dessus de la normale préindustrielle d’ici 2100. Seulement 6% des scientifiques sondé.es ont
anselm-kiefer-dein-und-mein-alter-und-das-alter-der-welt-1997

affirmé croire en la capacité de l’humanité de respecter la limite de 1,5 C décidée lors des Accords de Paris il y a maintenant presque 10 ans.
En l’espace de deux semaines à l’automne 2024, la côte sud-est des États-Unis aura été frappée par deux ouragans de catégorie 4 et 5 dans ce qui s’avère être la saison des tempêtes la plus meurtrière depuis l’ouragan Katrina en 2005.
Presque l’entièreté de la Floride recevait l’ordre d’évacuer à l’approche de l’ouragan Milton qui passera de la catégorie 1 à la catégorie 5 en moins de 12h. À l’annonce d’une crue pouvant engloutir le premier étage de la plupart des maisons à Tampa Bay, la mairesse de la ville mettra en garde ses citoyen.nes avec les mots suivants à l’approche de la tempête :
« Je peux le dire sans aucune dramatisation : si vous choisissez de rester dans l'une des zones d'évacuation, vous allez mourir. ». (Radio-Canada, 8 octobre 2024.)
Empalé.es par des débris voyageant à près de 230km/h, électrocuté.es par la chute d’une ligne à haute tension, enseveli.es sous des glissements de terrain ou noyé.es par des refoulements d’égouts qui ont monté de plusieurs mètres en l’espace de quelques heures, un total de 230 personnes ont perdu la vie à cause de l’ouragan précédent (Hélène) dans les états du Sud-Est. 600 manquaient encore à l’appel à l’approche de Milton. (FranceTVInfo, 1er octobre 2024.)
Celui-ci a cependant déçu les titres sensationnalistes qui l'ont précédé. Avec « seulement » 17 morts à son actif en date du 11 octobre (NBC, 11 octobre 2024) et le gouverneur climatosceptique de la Floride affirmant que son État a « évité le pire » (Radio-Canada, 10 octobre 2024), les lendemains de la catastrophe ont le potentiel de faire croire à beaucoup qui n’ont souffert que de l’eau dans leur entrée de garage, qu’avec juste un peu plus de préparations, un peu plus de sacs de sable, un levee juste un peu plus haut, il leur serait possible de continuer à conduire leur F-350 à moins de 10 mètres du niveau de la mer.
Petit train continu ainsi d’aller loin, et les compagnies pétrolières sont maintenant dirigeantes des grands sommets sur les réchauffements climatiques, la mise à mort de la tarification carbone devient l’enjeu électoral de l’heure (Radio-Canada, 15 septembre 2024) et l’on met notre confiance dans l’expansion de notre colonialisme hydroélectrique pour continuer à croire que la croissance à laquelle nous nous devons de survivre pourrait être
« verte ». Plus de 1000 milliards de dollars sont encore investis dans les énergies fossiles (Villiers, 2023) et 425 projets d’hydrocarbures ayant, à eux-mêmes, le potentiel de nous emmener bien au-delà de 1,5 C (Kühne et al. 2022, Carbonbombs.org) sont toujours en voie de se réaliser.
Pendant ce temps, les dissonances s’exacerbent. L’essence coûte de plus en plus cher, mais l’on est persuadé que les gisements de plus en plus durs à exploiter qu’il nous reste sauront nourrir la croissance exponentielle de nos besoins en pétrole (Auzanneau et Chauvin, 2022). Même chose pour l’épicerie, et on s’attend de rendements agricoles mondiaux qu’ils ne tiennent pas compte des sécheresses de plus en plus longues (Ortiz-Bobea et al., 2021). On se targue de vouloir faire la « transition énergétique », mais l’on peine à savoir s’il y a assez de cuivre dans le monde pour la réaliser (IEF, 2024). On a hâte de faire du ski, mais le fleuve peine de plus en plus à geler chaque hiver. Les objectifs climatiques vont et viennent, d’échec en échec, répétant que les changements à venir sont « catastrophiques » et « irréversibles », mais à la dernière COP, on ne parlait maintenant plus d’« éliminer » l’utilisation globale des carburants fossiles, mais bien de la « réduire » (CBC, 28 novembre 2023).
Et de plus belle, il y a du sens à se réfugier dans la fin du monde. C’est comme ça que notre apocalyptisme millénaire s’est récemment manifesté dans la vie de plusieurs environnementalistes par le biais d’une connivence particulière pour un mouvement de pensée très en vogue et fasciné à l’idée de « l’Effondrement ». La « collapsologie » comme l’a baptisée le biologiste Pablo Servigne dans un petit essai intitulé Comment tout peut s’effondrer (2015) peut être considérée comme la rencontre entre cette obsession primale pour l’apocalypse, notre cynisme envers la politique climatique du statu quo et la véracité alarmante de plusieurs des constats de ces collapsologues.
Particulièrement en des temps comme ceux-ci où la matrice néolibérale a ultimement réussi à forcer dans nos psychés l’idée qu’il n’existe vraiment aucune alternative à son hégémonie, plusieurs s’y réfugient par espoir de la faillite prochaine d’un système qui les rend misérables et dont iels ne comprennent pas comment il fait pour tenir encore.
Malgré leur indéniable exactitude scientifique, il est d’une étrange beauté de voir les mêmes fantaisies, les mêmes espoirs, les mêmes incompréhensions se jouer au sein de ce mouvement de pensée politico-scientifique que dans tous les récits mythiques et autres films catastrophes qui l’ont précédé. Il y a, chez beaucoup d’adeptes, souvent amateurs de la collapsologie, un penchant similaire pour

la contraction de phénomènes qui nous dépassent, pour l’Effondrement avec un grand E, subit, un enthousiasme pour la quête de LA chose et LE moment qui fera tout basculer. « L’Effondrement d’ici 2030 » écrit-on sur dans les vignettes de certaines vidéos YouTube (Greenletter Club, 2020) sans réaliser que celui-ci ressemblera probablement plus à une suite sans fins de petits empirements juste assez graduels pour être tolérables, mais misérabilisants à un point où la réalité du déclin ne pourra éventuellement pas être évitée.
Et il y a, dans les écrits de plusieurs de ces penseurs (Servigne, 2018), le même espoir de voir l’humanité se relever, quoique fondamentalement différemment, de l’Armageddon inarrêtable du changement climatique et du Jugement dernier du déclin pétrolier. Une volonté similaire non pas tant de contrôler l’emballement écologique que d’au moins y survivre.
C’est en puisant dans la même obsession pour l’apocalypse qui a justifié notre descente vers le cataclysme climatique et en se nourrissant de l’optimisme inavoué qui a, malgré tout, toujours vécu caché en filigrane de notre pulsion autodestructrice et de nos anxiétés existentielles que la collapsologie s’inscrit à notre époque.
Ainsi, peu importe la connivence politique, il semble
heureusement toujours plus difficile de se résigner à la face du chaos que de croire en une postérité que l’on sait peutêtre naïve, mais sans laquelle on ne pourrait continuer à vivre dans de ce monde au sein duquel rampent des contradictions qui s’intensifient chaque jour.
En 2050 (ou en 2042, ou en 2035, qui sait), lorsqu’on oscillera entre Netflix et pénuries alimentaires, entre les premières coupures d'internet et le développement toujours plus fulgurant de l'IA, entre la localisation grandissante de tous nos enjeux politiques et l’ère de gloire de l’hégémonie internationale chinoise, entre le génie industriel que demandera le siphonnement des dernières goûtes de pétroles aux confins de l’Arctique et l’effritement continuel des banquises, l’on peut au moins être sûrs qu’il y aura des gens pour croire à notre « triomphe », aussi fragile et incertain puisse-t-il être, sur la Fin du monde. Non pas un triomphe de tout l’Empire qui l’aura amené, mais de celles et ceux qui se seront rendu.es compte qu’iels devaient le renverser pour continuer à vivre.
AUZANNEAU, M., & CHAUVIN, H. (2022). PÉTROLE LE DÉCLIN EST PROCHE. LESEUIL CarbonBombs.org. (s. d.). CarbonBombs.Org. Consulté 17 octobre 2024, à l’adresse https : //carbonbombs.org/ Carrington, D., & editor, D. C. E. (2024, mai 8). World’s top climate scientists expect global heating to blast past 1.5C target. The Guardian. https : //www.theguardian.com/environment/

anselm-kiefer-ein-wort-von-sensen-gesprochen-one-word-spoken-by-scythes-2020
article/2024/may/08/world-scientists-climate-failure-survey-global-temperature
Chung, E. (2023, novembre 28). The fossil fuel phrases that countries will fight over at the upcoming COP28. CBC News. https : //www.cbc.ca/news/science/unabated-phase-downout-cop28-1.7041210
Daniel Yergin, Frank Hoffman, John Mothersole, Kertin Rajan, Mohsen Bonakdarpour, & Olivier Beaufils. (2022, juillet 18). Growing appetite for copper threatens energy transition and climate goals . S&P Global Market Intelligence. https : //www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/research/growing-appetite-copper-threatens-energy-transitionclimate
Dubar, C. (2010). La fin des temps : Millénarisme chrétien et temporalités. Temporalités. Revue de sciences sociales et humaines, 12, Article 12. https : //doi.org/10.4000/ temporalites.1422
Greenletter Club (Réalisateur). (2020, avril 9). NOTRE CIVILISATION VA S’EFFONDRER
- Yves Cochet #04 [Enregistrement vidéo]. https : //www.youtube.com/watch ? v=tWLkvzxs3s8 Hurricane Milton aftermath : 17 dead as Florida power outages and flooding persist. (2024, octobre 12). NBC News. https : //www.nbcnews.com/weather/hurricanes/live-blog/hurricanemilton-aftermath-live-updates-rcna174988
ICI.Radio-Canada.ca, A. F.-P. (s. d.). « Si vous choisissez de rester, vous allez mourir » :
La Floride face à l’ouragan Milton. Radio-Canada; Radio-Canada.ca. Consulté 12 octobre 2024, à l’adresse https : //ici.radio-canada.ca/nouvelle/2110734/floride-partir-avant-ouraganmilton-rester-mourir
ICI.Radio-Canada.ca, Z. P.-. (s. d.). Selon Poilievre, la tarification du carbone engendre « famine » et « malnutrition ». Radio-Canada; Radio-Canada.ca. Consulté 13 octobre 2024, à l’adresse https : //ici.radio-canada.ca/nouvelle/2104671/pierre-poilievre-taxe-boursecarbone-famine-malnutrition
Jones, N. (2024, juillet 25). Please Don’t Try to Shoot Diaper Gel Into a Tornado. Vulture https : //www.vulture.com/article/what-in-twisters-could-really-happen-tornadoes-explained.
html
Kühne, K., Bartsch, N., Tate, R. D., Higson, J., & Habet, A. (2022). “Carbon Bombs”—Mapping key fossil fuel projects. Energy Policy, 166 , 112950. https : //doi.org/10.1016/j. enpol.2022.112950
Ortiz-Bobea, A., Ault, T. R., Carrillo, C. M., Chambers, R. G., & Lobell, D. B. (2021). Anthropogenic climate change has slowed global agricultural productivity growth. Nature Climate Change, 11(4), 306-312. https : //doi.org/10.1038/s41558-021-01000-1
Ouragan Hélène : Plus de 110 morts et 600 disparus aux Etats-Unis selon un bilan encore provisoire. (2024, octobre 1). Guadeloupe la 1ère. https : //la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/ ouragan-helene-plus-de-110-morts-et-600-disparus-aux-etats-unis-selon-un-bilan-encoreprovisoire-1525916.html
Pablo Servigne, Raphaël Stevens, & Gauthier Chapelle. (2018). Une autre fin du monde est possible : Vivre l’effondrement (et pas seulement y survivre). SEUIL.
Radio-Canada Info (Réalisateur). (2024, octobre 10). Ouragan Milton : « nous avons évité le pire », dit DeSantis [Enregistrement vidéo]. https : //www.youtube.com/watch ? v=oByBObZiXas
Rozsa, M. (2024, juin 22). The complicated legacy of « The Day After Tomorrow ». Salon https : //www.salon.com/2024/06/22/the-day-after-tomorrow-is-one-of-the-only-true-climatechange-films-why-do-scientists-hate-it/
Villiers, C. (2023, avril 17). Infographie : Énergies fossiles : Record de subventions en 2022. Statista Daily Data. https : //fr.statista.com/infographie/29741/subventions-a-laconsommation-de-combustibles-fossiles-dans-le-monde-en-milliards-de-dollars
Woods Hole Oceanographic Institution. (s. d.). What’s After the Day After Tomorrow ? Https : //Www.Whoi.Edu/. Consulté 12 octobre 2024, à l’adresse https : //www.whoi.edu/know-yourocean/ocean-topics/climate-weather/abrupt-climate-change/whats- after-the-day-aftertomorrow/

Par Émilien Côté, journaliste collaborateur
Avertissement : Les personnages qui figurent dans ce texte, ainsi que leurs récits, sont entièrement fictifs.
Il n’y avait aucune chose sur terre que je voulais posséder. Je ne connaissais personne qui valait la peine d’être envié. Tout le mal que j’avais souffert, je l’oubliais. Penser qu’autrefois j’étais le même homme ne me gênait pas. Je ne sentais aucune douleur dans mon corps. Czesław Miłosz, Don
Deux camarades se promènent ensemble sur une route boisée dans un territoire nordique. Ils voyagent de lieu en lieu depuis toujours, sans domicile. À chaque endroit où ils s’arrêtent, ils ramassent des souvenirs, augmentant sans cesse leur bagage. À la longue, ils accumulent un fardeau qui complique beaucoup leur marche. Ils se déplacent à grand-peine, mais ils finissent par s’habituer à leur misère avec les années, au point de la croire naturelle.
Sur la route boisée, les deux hommes doivent monter une côte escarpée. Par mégarde, le premier dérape sur le sol boueux et tombe sur le dos, perdant ainsi tous ses bagages. Heureusement, il n’est pas blessé, mais quand il se relève, il se sent tout léger. Un immense sentiment de soulagement l’habite. Souriant, il demande alors à son ami : « Pourquoi ne laisses-tu pas tes affaires sur le bord de la route ? Ne garde que l’essentiel et ça sera vraiment plus facile ».
À sa grande surprise, celui-ci lui répond : « Tu sais, j’aime beaucoup ces objets. Ils font partie de moi. Je ne peux pas les laisser tomber ». Le premier rétorque ensuite : « Mais vois à quel point tu marches difficilement. Tu ne peux même pas profiter du paysage ! ». Et l’autre de lui répondre : « Arrête de m’agacer avec tes histoires. Reprenons notre chemin, le soleil va bientôt se coucher ». Le premier camarade déclare enfin : « Bon d’accord, mais je te le dis : tu rates la chose la plus merveilleuse qui soit ».
Je suis libre (Antoine, 34 ans)
Quelque chose a changé. Je suis beaucoup plus calme que d’habitude. Je viens de lire un texte extraordinaire. Ses mots m’ont apaisé. Quand je relève les yeux, on dirait que mon attention est tournée vers l’intérieur. Je sens la couverture du livre sous mes doigts, toute lisse. Mes bras et mes jambes se relâchent. Je ne pense à rien, c’est un soulagement incroyable ! Les murs de ma chambre sont d’un bleu limpide, comme si on avait enlevé la saleté qui les recouvrait après des années de négligence. J’oublie qui je suis. Le moment présent se dévoile dans toute sa splendeur. Pour la première fois de ma vie, je suis libre.
Je suis née (Océanne, 27 ans)
J’ai de la difficulté à parler depuis plusieurs jours. Je souris bêtement aux gens que je rencontre. Qu’est-ce qui m’arrive ? Je suis née une deuxième fois, comme un bébé qui ne possède rien. Toute ma vie, j’ai été dans l’erreur. Je vivais sans m’en rendre compte, piégée dans la confusion et la peur. Je pensais que je ne me sentirais jamais bien dans ma peau… je pleure rien que de l’écrire. Aujourd’hui, je réalise que j’ai le choix de sortir de ma tête. Il y a une
impression grandissante de joie et d’exaltation, un petit soubresaut dans mes épaules. Le passé n’a plus d’importance. Toutes mes fautes sont pardonnées. Je peux commencer à vivre.
Je suis seul (Nicolas, 40 ans)
Mes repères ont volé en éclat. J’ai vu une chose prodigieusement belle, mais je ne sais pas ce qu’elle veut dire. Je ne me sens pas à la hauteur de ce que je suis en train de traverser. Les événements vont trop vite. Je n’en parle pas aux autres, parce que les gens que je connais ne semblent pas avoir vécu la même expérience. Je ne savais même pas qu’on pouvait la vivre ! Les livres ne m’apportent plus aucune inspiration. Je dois réapprendre à penser, à parler et à agir, sinon c’en est fini de moi. Mon esprit ne peut pas se maintenir dans cet état de tension encore très longtemps. Rien ni personne ne peut m’aider. Je suis seul.
Je ne travaille pas (Christine, 48 ans)
Cet après-midi, je travaille à mon poste. Je suis employée dans un centre d’appels. Alors que je rédige un dossier dans mon système informatique, j’éprouve soudainement un vide, un vertige. Ensuite, une profonde sensation de vitalité à la base de ma colonne vertébrale. C’est une lumière puissante, mais d’une grande tendresse, fraîche comme de l’eau pure.
Cette perception se propage aussi dans mes poumons. Il y a une légère pression à l’arrière de ma tête. Mes mains sont moites. Intérieurement, tout est immobile, même lorsque je parle au téléphone. Les voix sont claires dans mes oreilles. Ma conscience est lucide, alerte et détachée. Je ne travaille pas. Le travail n’a jamais existé, j’en ai la certitude absolue.
Je ne résiste pas (Martin, 65 ans)
Je suis dans ma chambre ce soir. Au téléphone, on m’annonce qu’elle est morte. Une tante à qui on rend visite chaque année. Je m’arrête et mon niveau de vigilance augmente tout de suite. Je sens quelque chose monter. C’est comme une vibration, une pulsation qui vient du fond de mes entrailles. Je la laisse prendre de l’ampleur dans mon corps. Je ne résiste pas, je plonge.
La tristesse est là, mais ce n’est rien à côté de la puissance de l’énergie que je ressens. Je suis dans un état d’acceptation total. L’émotion se déploie sans entrave, comme une fleur. Aucune particule de temps dans mon cerveau. Le niveau d’attention est maximal, je ne bouge pas d’un pouce. Il n’y a rien, seulement cette vitalité
fulgurante. Après une demi-heure, l’intensité se résorbe, et quand je me couche un peu plus tard, la sensation disparaît.
Je t’aime (Annie, 53 ans)
Ça fait plusieurs années que je vis avec cette lumière dans mon corps. Elle est là tous les jours, comme une présence rassurante. Quand je la vois, je sais que je suis de retour chez moi, mais quand je suis éloignée d’elle pendant trop longtemps, je ressens un malaise, le malaise d’être hors de chez soi, dans le monde. Ce n’est pas grave. Je dois rester présente et lucide, peu importe la douleur, l’ennui ou la misère qui surviennent.
Ce matin, je suis assise dans la cuisine et je regarde par la fenêtre. Une grosse araignée se promène sur sa toile au soleil. Je sens une extension des muscles à l’arrière de ma tête. Deux respirations, puis une chaleur à la base de ma colonne vertébrale. Je vois la pièce d’un seul coup, et une paix délicate s’installe. Le monde est parfait. Je ne changerais rien à ma vie, pas même le plus petit détail. Il doit en être ainsi. Qui que tu sois, sache que je t’aime.
Je n’ai pas peur (Claire, 91 ans)
La lumière est brillante. Je n’ai pas peur. Tout va bien.
Références :
Miłosz, C. (2001). Gift dans New and collected poems : 1931-2001. The Penguin Press. Ma traduction. https : //www. scottishpoetrylibrary.org.uk/poem/gift-0/
anselm-kiefer-ash-flower-aschenblume
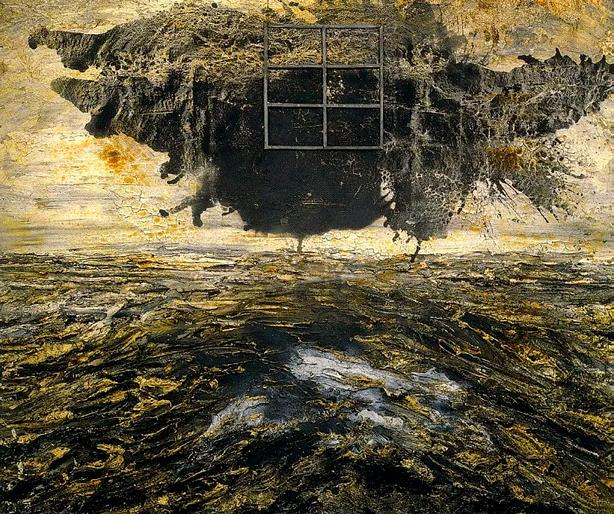

Écris-nous à redaction@impactcampus.ca
Par Julianne Campeau, journaliste collaboratrice

Oups ! Mes pensées se sont rendues à ma bouche. Je regarde les gens autour de moi. La fille derrière le comptoir prépare une nouvelle batch de café, quatre étudiants ont les yeux rivés sur leur ordi, le groupe assis sur les divans continue de jaser, indifférent à ce qui se passe autour. Fiou ! Rassurée, je réussis à me détendre quelques secondes, avant de me raidir de nouveau, lorsque mon attention se porte sur la page vierge de mon document Word.
Un rire tonitruant me fait sursauter. Ma mâchoire se serre. Pas de doute sur sa provenance : je reconnais la voix du gars qui parle trop fort depuis tout à l’heure. Pendant un moment, j’ai l’impression que c’est mon ordinateur qui me rit en pleine face.
Mes poings se serrent. Je sens une légère douleur alors que mes ongles trop longs s’enfoncent dans mes paumes. Mon cœur, beaucoup trop énergique, est comme une bombe à retardement, sur le point d’exploser dans ma poitrine. Et moi avec, je crois que je suis sur le bord d’éclater puis de garrocher mon ordi sur le gars qui parle trop fort. En temps normal, les placotages ambiants ne me dérangent pas. Mais là, une odieuse combinaison de stress et de caféine rend tout bruit insupportable. La chose intelligente à faire serait d’aller m’enfermer à la bibliothèque, là où les gars qui parlent trop fort sont jetés dehors à grands coups de « Cchhhh ! ». Mais je ne le fais pas. Je me commande un autre café.
Au comptoir, je dépose la tasse plus brusquement que je ne l’aurais souhaité.
− Je voudrais un refill de velouté s’il te plaît.
− On est en train d’en refaire, si t’es prête à attendre quelques minutes…
− Non, non. J’vais prendre un corsé.
− Ok. J’te laisse de la place pour du lait pis du sucre ?
− Non, non. Ça va être beau.
Pendant que la bénévole s’affaire, mes mains tremblantes tentent de compter la monnaie dans mon portefeuille. Les pièces tombent par terre. Je sens les regards se fixer sur moi. L’envie me prend de leur lancer le café brûlant en pleine face. Je réussis finalement à ramasser le change et à payer. Je dépose la tasse trop brusquement sur la table. Ça renverse un peu. Dieu merci, le liquide ne se répand pas jusqu’à mon ordi. Je vais chercher une napkin pour l’essuyer. En revenant à la table, je réalise que j’ai oublié de laisser un pourboire. Mes pièces tombent encore de mon portefeuille que j’ai omis de fermer tantôt. Alors que je me dirige (encore) vers le comptoir, quelqu’un referme le paravent. Bon, tant pis. Plus d’argent pour moi !
Je retourne à ma rédaction pas encore entamée dont les consignes ne sont tellement pas claires que personne n’a compris s’il fallait faire un compte-rendu sur Madame Bovary, ou sur un article portant sur le roman de Flaubert. Un de mes camarades de classe a demandé des précisions sur le forum du cours. On attend encore la réponse. Le travail est à remettre demain. Je me rends de nouveau sur

le forum, juste pour voir. Toujours pas de message de la part du professeur.
J'attrape ma tasse de café et avale un peu du liquide noir, espérant que ça me donne le courage d’amorcer l'écriture. Je prends le temps de savourer son goût amer et réconfortant. Probablement aussi que j’essaie de retarder le moment où il va vraiment falloir que je commence à travailler.
Mes yeux effectuent des allers-retours entre l’écran et le clavier. Mes mains, tremblantes, hésitent au-dessus des touches. Puis, je me force à écrire une, deux, trois phrases. Lentement, précautionneusement, la petite ligne noire avance sur la page, de gauche à droite, de haut en bas, laissant traîner un amoncellement de lettres sur son chemin.
Éventuellement, les petits pas prudents laissent place à une course effrénée. Les mots s’alignent à une vitesse folle, au point où la pauvre petite ligne noire peine à suivre le rythme de mes doigts, infatigables, qui dansent sur mon clavier d’ordi comme s’il n’y avait pas de lendemain, dans une chorégraphie qui semble constituer le travail d’une vie.
Au bout de même pas une heure, la symphonie des touches du clavier prend fin. Pour me récompenser, je bois une gorgée de mon café. J’ai un petit rictus : le liquide est rendu froid. Je me permets de prendre un refill pour le réchauffer. Je l’ai bien mérité. Et il va falloir que je sois alerte pour la prochaine étape : la relecture.
La moitié de la tasse avalée, mon cœur bat tellement vite
que je me dis qu’il serait préférable d’attendre avant de la terminer.
Alors que je finis de corriger mon texte, j’aperçois une notification en provenance du forum du cours. Je lis le message : « Bonjour, plusieurs étudiants m’ont partagé leurs interrogations concernant le travail de synthèse. Je précise donc que le travail porte non pas sur Madame Bovary, mais bien sur un des travaux à propos du livre à l’étude. »
J’arrête de lire. Mes mains s'agitent plus que jamais. Je serre tellement mes poings, mes ongles s’incrustent dans ma chair. Au bord de la crise cardiaque, j’hyperventile. Mon organisme a atteint son point d’ébullition. Ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’explose. Je lâche un cri et frappe la table. En relevant la main, ma tasse à moitié pleine tombe sur le côté. En essayant de sauver mon ordi, je l’échappe par terre. Il se brise en deux. Lâchant un sacre, je tente de me lever, mais trébuche sur mon sac et fais tomber ma tasse par la même occasion. En essayant, encore, de me redresser, je me coupe avec un des fragments. Une fois debout, je constate les dégâts. Une mare de café coule et dégoûte de la table, sur mon sac. Mon ordinateur et ma tasse gisent en morceaux sur le plancher et, comme si ce n’était pas assez, j’ai une grosse entaille à la main. L’envie de lâcher un deuxième cri me prend, mais je me retiens, réalisant que mon premier a fait de moi la chose la plus intéressante de la pièce. Mon regard croise celui du gars qui parle trop fort. J’attrape les deux bouts de mon ordi, puis les lance dans sa direction, quelques secondes avant que mon corps n’explose.
Par Carolanne Foucher, écrivaine invitée
Au Normandin, on déjeune lentement lui et moi. On se prend chacun un Journal de Québec, et on lit les nouvelles chacun de notre bord, en ponctuant les moments de silence de « oui, je vais prendre un refill de café, merci », de regards doux, de flattage de mains. Ça fait déjà quelques dates qu’on a, mais c’est drôle, le fait qu’il soit venu à ma fête hier, ça scelle quelque chose. Éventuellement, je le vois qui sort son cellulaire et se met à scroller sur Instagram. Tant mieux pour lui. Moi je continue ma lecture, révoltée par un énième scandale dans le monde du hockey.
— Vas-tu faire ça ?
Je lève les yeux vers lui, son téléphone tendu vers moi, l’écran allumé sur un mème qui tient en deux phrases écrites en blanc fond noir :
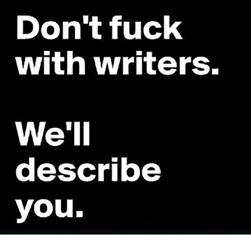
Je ris. La serveuse arrive avec nos assiettes et les dépose devant nous sans trop de cérémonie, mettons. Elle parle en point form
— Bénés asperges-champignons. Bénés bacon-cheddar. Mayo-ketchup ?
Je salive déjà, crisse que j’avais envie de ça. Ma fourchette fait éclater le jaune d’un de mes bénés, qui se mélange à la sauce hollandaise. Ça sent le citron, j’ai tellement faim. La serveuse est repartie, je n’arrive pas à dire si j’ai répondu oui à sa question. Chose certaine, je voudrais ET mayo ET ketchup.
— …. Mais vas-tu faire ça ? Me crisser dans un de tes livres ?
— Je pense pas que je suis rendue à parler de toi dans ce que j’écris, es-tu déçu ?
Je suis arrogante en disant ça, il le sait, je pense qu’il aime ça. On se dévore des yeux. Je salive déjà, crisse que j’ai envie de lui. Le jaune d’œuf se répand, insidieux, partout dans l’assiette. Une scène de crime. La serveuse revient, deux petits cups métalliques dans les mains qu’elle dépose entre lui et moi, sans même s’arrêter. Sa vitesse contraste avec notre lenteur. Mayo et ketchup trônent fièrement sur la table. Eh ben. J’avais répondu oui à sa question finalement.
C’est ma fête, j’ai 31 ans. Il était là hier pour fêter avec moi.
Ça scelle quelque chose.
…Et je pense que c’est toujours ça qui est dangereux avec ces gens-là : ils attendent que ce soit scellé, qu’on soit all in, qu’on s’abandonne complètement, avant de finalement s’arranger pour qu’on parle d’eux, irrémédiablement, dans nos récits.











Découvrez votre nouvel espace ! NOUVEAU
Venez découvrir notre tout nouveau concept, la bulle Halte mieux-être

Plus de 20 espaces, dispersés sur tout le campus, sont prêts à vous accueillir et vous offrir une pause bien méritée. N’attendez plus, votre bien-être commence ici !

Pour en savoir plus ulaval.ca/mon-equilibre-ul