












Rédactrice en chef
Emmy Lapointe (elle) redaction@impactcampus.ca
Chef de pupitre actualités
Antoine Morin-Racine (il) actualites@impactcampus.ca
Journalistes collaborateur.rices Émilien Côté, Julianne Campeau , Rafael Forteza et Dayane Rodrigues, Camille Baril
Conseil d’administration AGA 7 Novembre
Contact publicitaire publicite@chyz.ca
Impression
Cheffe de pupitre aux arts
Frédérik Dompierre-Beaulieu (elle) arts@impactcampus.ca
Journaliste multiplateforme
Camille Sainson (elle) societe@impactcampus.ca
Journaliste multiplateforme
Léon Bodier (il) multimedias1@impactcampus.ca
Journaliste multiplateforme
Marie Tremblay (elle) multi2@impactcampus.ca
Journaliste édimestre
Mégan Harvey (elle) photos@impactcampus.ca
Directrice de production
Paula Casillas Sánchez (elle) production@impactcampus.ca
Publications Lysar inc. Tirage : 5000 exemplaires
Dépôt légal : BAnQ et BAC
Impact Campus ne se tient pas responsable de la page CADEUL et de la page ÆLIÉS dont le contenu relève entièrement de la CADEUL et de l’ÆLIÉS. La publicité contenue dans ImpactCampus est régie par le code d’éthique publicitaire du journal, qui est disponible pour consultation au : impactcampus. qc.ca/code-dethique-publicitaire
Impact Campus est publié par une corporation sans but lucratif constituée sous la dénomination sociale Corporation des Médias Étudiants de l’Université Laval.
1244, pavillon Maurice-Pollack, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6 Téléphone : 418 656-5079
ISSN : 0820-5116
Découvrez nos réseaux sociaux !







Perséphone tardera par Emmy Lapointe
12 Le sommeil chez les jeunes : un enjeu de santé ? par Camille Sainson
16 La transition optimiste de Rob Hopkins paroxysme par Marie Tremblay
22 A Book of Noises – Vers un chant du monde oublié par Camille Sainson
24 Jouer comme des filles par Emmy Lapointe
34 Acrobates identitaires par Marie Tremblay
40 « Aucun repli n’est stratégique » : histoire imparfaite de la dernière décennie du mouvement étudiant par Antoine Morin-Racine
50 Espaces de transition : Les aéroports comme frontières de genre et de temps par Léon Bodier
52 Sodade par Dayane Rodrigues
54 Seule dans la Ville Reine : mes aventures torontoises par Julianne Campeau
58 L'horoscope culinaire d'Impact Campus par l'équipe d'Impact Campus
64 2001 l’Odyssée de l’espace – vers une aube éternelle par Camille Sainson
66 Interstices de réalité : matière noire et mondes possibles dans Dark Matter par Léon Bodier
69 Interludes audiovisuels : de l'orchestre aux ondes numériques par Léon Bodier
72 Suggestions de films à thématique interlude par Camille Sainson et Emmy Lapointe
74 CHYZ 94.3 par l'équipe de CHYZ 94.3
76 ni hier ni demain, ni ombre ni lumière : la liminalité en sept ou huit temps par Frédérik Dompierre-Beaulieu
98 Le moment dans It Only Takes a Moment par Léon Bodier 88
88 Taller y resiliencia par Rafael Forteza
90 Le démon qui te possède par Émilien Côté
92 Ssssse glisse, s’insinue et s’enlace dans les interssstices de la béance… par Camille Baril
94 En attendant l’aurore par Camille Sainson
17 février u 13 m rs 14h
!iot-euqilpmII !iot-euqilpm
21 février u 14 m rs 12h
Collège Élector l

*VALIDE DU LUNDI AU VENDREDI


Créée en automne 1997 par le Comité Exécutif de l'ÆLIÉS, la Chaire Publique contribue à mettre en valeur l’avancée des connaissances des divers domaines d’enseignement et de recherche de l’Université Laval
Une fenêtre ouverte sur le savoir
L
c u l t u r e l l e d e l ’ A E L I É S E l l e o r g a
d ’ é v é n e m e n t s d o n t d e s c o n f é r e n c e s t h é m a t i q u e s
p o u r l e b é n é f i c e d e s m e m b r e s d e l ’ A E L I É S e t d e l a
c o m m u n a u t é u n i v e r s i t a i r e e n g é n é r a l e . E l l e v i s e a i n s i
à m e t t r e e n v a l e u r l ’ a v a n c é e d e s c o n n a i s s a n c e s d e s
d i v e r s d o m a i n e s d ’ e n s e i g n e m e n t e t d e r e c h e r c h e à
l ’ U n i v e r s i t é L a v a l
Une véritable tribune sociétale
D e p u i s p l u s d e 2 5 a n s , l e c a l i b r e d e s é v é n e m e n t s
o r g a n i s é s f o n t d e l a C h a i r e p u b l i q u e A E L I É S u n e
v é r i t a b l e t r i b u n e s o c i é t a l e , a v e c e n t ê t e d ’ a f f i c h e ,
d ’ é m i n e n t s p e n s e u r s d e n o t r e t e m p s C e s g r a n d s
d é b a t s e t p a r t a g e s a v e c l e s é t u d i a n t s d e 2 e t d e 3
c y c l e d e l ’ U n i v e r s i t é L a v a l s o n t a u c œ u r d e s
p r é o c c u p a t i o n s c o n s t a n t e s q u e c o n n a i s s e n t n o s
s o c i é t é s e e
JOINDRE LA CHAIRE PUBLIQUE
Maison Marie Sirois
2320, rue de l'Université Université Laval Québec (Québec) G1V 0A6
Événements scientifiques & culturels
D e s c o n f é r e n c e s t h é m a t i q u e s e t
d e s o c c a s i o n s d e r e n c o n t r e s s u r l e s
g r a n d s e n j e u x s o c i é t a u x a c t u e l s
Accompagnement en matière de vulgarisation scientifique
R e n f o r c e m e n t d e s c o m p é t e n c e s d e l a
c o m m u n a u t é é t u d i a n t e d e l ’ U n i v e r s i t é
L a v a l e n m a t i è r e d e v u l g a r i s a t i o n
s c i e n t i f i q u e .
Appui aux associations et structures de l’Université Laval
A p p u i e t p a r t e n a r i a t s t r a t é g i q u e e n
m a t i è r e d ’ o r g a n i s a t i o n d ’ é v e n e m e n t
c u l t u r e l e t s c i e n t i f i q u e
chaire.publique@aelies.ulaval.ca www.chairepublique.com +1 (418) 656 7190
/chairepubliqueneo
/Chaire Publique

Par Emmy Lapointe, rédactrice en chef
« Cependant, vainement la mère éperdue a recherché sa fille dans tous les coins de la terre, et partout sur l’océan. À son lever, l’Aurore aux cheveux humides ne la trouve pas au repos. […] Dès que le jour bienfaisant avait fait disparaître les étoiles, du lever au coucher du soleil, elle repartait en quête de sa fille. »
– Les Métamorphoses, Ovide (5, 438-508).

Perséphone, après avoir été enlevée par Hadès – une façon très mythologique de séduire – se retrouve aux Enfers et trône aux côtés de son nouveau mari. Déméter, sa mère, passe des jours et des jours et des mois à fouiller terre et mers pour retrouver sa fille. Elle ne féconde dès lors plus les champs.
« Partagé entre son frère et sa sœur affligée, Jupiter coupa en deux parties égales le cours de l’année. Désormais la déesse, puissance divine commune aux deux royaumes, vit avec sa mère le même nombre de mois qu’avec son époux. Aussitôt se transforment son état d’esprit et l’aspect de son visage. La déesse, qui naguère pouvait paraître triste, arbore un front heureux, tel le soleil qui, l’instant d’avant était couvert de nuages chargés de pluie, en émerge après les avoir vaincus.»
– Les Métamorphoses, Ovide (5, 564-571).
Zeus, père de Perséphone, frère de Déméter – famille là aussi très mythologique – et d’Hadès, décide de couper la poire en deux. Perséphone vivra six mois par an sur terre avec sa mère et six mois en enfer avec son mari.
Ce cycle est interprété comme l’alternance des saisons : son départ symbolise l’hiver et son retour, le printemps. Elle n’appartient ni totalement au royaume des morts ni entièrement au monde des vivants, mais pour celle et celui qui l’attendent, elle rythme leur vie. Tout s’arrête pour Déméter, puis tout s’arrête pour Hadès.
Le temps d’arrêt de Déméter est marqué par le froid, par l’engourdissement des champs. Il n’y a rien à faire d’autre qu’attendre que l’hiver passe. Et pour être franche, je n’en ai que faire de l’attente et de la solitude d’Hadès. Et je n’arrive pas à voir autre chose en l’hiver de Déméter que celui que nous traversons en ce moment.
Le plus long des hivers Quand je parle de l’hiver, oui, je parle de celui qui tire à sa fin au moment où ce magazine sortira des presses comme de celui qui, pour une rare fois, a fait fermer l’Université aujourd’hui. Mais je parle aussi et surtout de cet hiver terrifiant qui n’a rien à voir avec les mètres de neige qui s’accumulent, et tout à voir avec le climat politique et social qui peut
nous miner pour des années encore. Un hiver qui nous rend impuissant.es, qui nous figent sur place.
Quoi faire alors ? Éviter d’acheter des produits américains, cesser d’y mettre les pieds, quitter Méta, X, boycotter Netflix, continuer de partager des story sur la situation en Palestine, en Ukraine, souhaiter à tous les 11h11 qu’on ne manque pas que ce ne soit pas, ici aussi, un gouvernement fédéral de droite qui prenne le pouvoir ?
Quoi faire ensuite ? Culpabiliser, parce qu’on n’arrive pas à quitter Instagram ou parce qu’on a passé une commande sur Amazon ?
Qu’importe, l’hiver durera.
Je ne dis pas qu’il faille baisser les bras, juste que l’hiver sera long et qu’il faut préserver son énergie, en regagner même si on peut.
Un historien de l’art, Michel Lessard, décédé il y a quelques années, termine un de ses livres sur l’architecture québécoise en parlant de l’hiver, et je trouve dans ses mots une forme d’apaisement.
« Dehors, ce soir, au moment où j’écris cette dernière page, il neige pour la première fois cet hiver. C’est le 25 novembre 1971 et la traditionnelle bordée de neige de la Sainte-Catherine nous tombe dessus, plus violente que jamais. Je me demande même à entendre siffler le nordet et à voir le voile opaque de la poudrerie qui recouvre la ville de Québec si je pourrai donner mes cours à mes étudiants demain.
Je suis heureux et content comme l’est presque tous à une première neige. Il y avait aujourd’hui une effervescence bien caractéristique dans les salles de cours. Mon épouse s’est endormie avec mon fils. Tout le monde s’est encabané. Pas âme qui vive dans les rues déjà fermées par les lames, même les ouvriers de voirie surpris par la soudaineté de cette première attaque.
Ce soir a dû être la première vraie réunion familiale depuis le printemps et ce dans la plupart des foyers. Il me plaît à penser que l’hiver qui nous a forcés à lutter et à vaincre plus d’un plan reste la plus grande alliée de l’homme québécois, un ami plus efficace que toutes ces lois de tous ces ministères. L’hiver c’est nous, c’est notre force. Chez nous, au pays du Québec, l’hiver n’a jamais tué le printemps mais le prépare. »
– Encyclopédie de la maison québécoise, 1972, Michel Lessard, p. 682-683.



Dans un monde où la performance et la productivité sont souvent valorisées au détriment du repos, le sommeil des jeunes, et particulièrement des étudiant.es, devient un sujet de préoccupation croissant. Sarah Fakroune, doctorante en psychologie spécialisée dans l'étude des déterminants socio-cognitifs et socio-écologiques du sommeil depuis 2016, nous éclaire sur cette problématique complexe.
Par Camille Sainson, journaliste multiplateforme
Y-a-t-il un problème entre les jeunes et le sommeil ?
Selon Sarah Fakroune, il serait plus juste de parler de « difficultés » plutôt que de « problème » concernant le rapport des jeunes au sommeil. Elle souligne que la population étudiante est particulièrement vulnérable « et plus à risque de développer un manque chronique de sommeil ». Les exigences académiques poussent souvent les étudiant.es à sacrifier leurs heures de repos, créant ainsi un cercle vicieux préjudiciable à leur santé et à leurs performances.
L'insomnie, trouble du sommeil le plus répandu chez les étudiant.es, touche plus de 10% d'entre eux. Sarah Fakroune précise les critères définissant ce trouble : « il faut qu'il y ait tout d'abord une insatisfaction du sommeil de manière générale, que ce soit envers la qualité ou la quantité de sommeil. Puis tu dois avoir au moins un de ces symptômes, et ce, au moins trois fois par semaine : de la difficulté à s'endormir, se réveiller trop tôt le matin (sans avoir eu au moins 6h de sommeil), avoir des perturbations de sommeil (réveille plusieurs fois dans la nuit ou difficultés d'endormissement) ».
Combien d'heures faudrait-il dormir environ chaque nuit ?
Contrairement à l'idée reçue des huit heures de sommeil par nuit, Sarah Fakroune explique que la « santé du sommeil » est un concept plus complexe. « C'est un peu un mythe de dire qu'il nous faut huit heures de sommeil par jour, en tout cas c'est à nuancer » affirme-t-elle. Elle identifie donc six composantes clés de la santé du sommeil:
1. La régularité des heures de coucher et de lever
2. La satisfaction du sommeil (est-ce que tu te sens reposé au réveil ?)
3. Le niveau de somnolence diurne
4. La temporalité (il vaut mieux être endormis entre 2h et 4h du matin)
5. L'efficacité du sommeil (à quel point tu passes du temps dans ton lit sans être endormi)
6. Le nombre d’heures de sommeil
Selon la Fondation du Sommeil, les adultes devraient dormir entre 7 et 9 heures par nuit, bien que 6 à 10 heures puissent être appropriées selon les individus. Sarah Fakroune souligne que des durées de sommeil en dehors de cette fourchette peuvent être associées à des problématiques de santé : « ce n'est pas ça qui va causer des problèmes de santé, mais ça peut-être un indicateur ; par exemple, une personne qui souffre de dépression, elle a tendance à dormir un peu plus ».
La chercheuse revient sur l'importance de la période entre 2h et 4h du matin où « notre corps sécrète un pic de mélatonine, cette substance miracle qui va te faire dormir. Ce n'est pas un somnifère, mais un indicateur de ton cycle de vie ». Ce pic s'accompagne d'une baisse de la température corporelle, également associée à une perte de vigilance, « c'est d'ailleurs ce que tu peux observer en milieu de journée, on a une toute petite baisse de température en début d’après-midi qui peut insuffler de la somnolence. À 4h du matin, c’est plus problématique si l’on est réveillé ; c’est, par exemple, l’heure où il y a le plus d'accidents de la route ».
Quels sont les facteurs aggravants ?
Sarah Fakroune identifie trois types d'activation qui peuvent perturber le sommeil :
1. Activation physiologique : liée à la température corporelle, au rythme cardiaque, aux tensions musculaires, etc.
2. Activation cognitive : associée à l'activité mentale, comme travailler tard le soir.
3. Activation émotionnelle : liée aux émotions ressenties, qu'elles soient positives ou négatives.
Ces activations peuvent se combiner, rendant l'endormissement plus difficile. Par exemple, l'anxiété liée à une présentation imminente peut engendrer une activation à la fois cognitive et physiologique.
La chercheuse insiste toutefois sur l'importance de ne pas « performer » son sommeil : « c'est normal de vivre de mauvaises nuits, mais il y a des choses qui nous échappent, des éléments qui parfois perturbent notre sommeil, on n'a pas prise dessus et ce n'est pas grave. Même avec un manque de sommeil, c'est possible de vivre normalement ».
Qu'est-ce que l'hygiène du sommeil ?
L'hygiène du sommeil englobe tous les facteurs qui influencent la qualité du repos. Sarah Fakroune les classe en trois catégories principales :
1. FACTEURS ENVIRONNEMENTAUX :
» Température de la chambre idéalement autour de 18-19°C
» Niveau de bruit
» Luminosité
2. FACTEURS COMPORTEMENTAUX :
» Régularité des horaires de sommeil
» Exposition à la lumière naturelle
» Gestion des siestes maximum 30 minutes en milieu de journée
» Activité physique éviter l'exercice intense 2-3 h avant le coucher
» Gestion du stress et de la rumination noter ses préoccupations peut aider
» Utilisation des écrans attention à la lumière bleue et au contenu stimulant
3. FACTEURS LIÉS À LA CONSOMMATION :
» Alimentation éviter les repas lourds et difficiles à digérer avant le coucher
» Hydratation boire suffisamment, mais pas excessivement avant le sommeil
» Caféine reste dans l'organisme jusqu'à 6 heures
» Alcool même en petite quantité, peut perturber le sommeil
Vers quels problèmes le manque de sommeil mène-t-il ?
Sarah Fakroune distingue les effets à court terme (quelques jours à quelques semaines) et à long terme (plusieurs mois ou années) du manque de sommeil :
EFFETS À COURT TERME :
1. Fatigue accrue et somnolence diurne
2. Maux de tête
3. Irritabilité, impatience et stress
4. Baisse de libido
5. Difficultés de concentration et problèmes de mémoire
6. Baisse des performances, notamment académiques
7. Diminution de l'immunité
8. Changements physiques (cernes, teint pâle)
9. Augmentation de la tension artérielle
10. Perturbation des hormones régulant l'appétit et la satiété
EFFETS À LONG TERME :
1. Diabète
2. Obésité
3. Maladies cardiovasculaires
4. Augmentation de la tension artérielle
5. Vieillissement prématuré de la peau
6. Déficits d’attention
7. Perte de mémoire
Sarah Fakroune souligne l'importance cruciale du sommeil, particulièrement pour les étudiant.es. Elle encourage à le considérer comme un allié plutôt qu'un obstacle à la productivité : « parfois il est plus judicieux de s'arrêter dans ce qu'on fait pour le retravailler le lendemain ou s'organiser autrement pour éviter de manquer de sommeil. Parce qu’au final, on est plus performant lorsque notre sommeil est optimal ».
Conclusion
Le sommeil, loin d'être un simple temps d'inactivité, joue un rôle fondamental dans notre santé physique et mentale. Pour les jeunes, et particulièrement les étudiant.es, maintenir une bonne hygiène de sommeil peut s'avérer crucial pour leur réussite académique et leur bien-être général.
Les recherches de Sarah Fakroune mettent en lumière la complexité des facteurs influençant le sommeil et l'importance d'une approche holistique de la « santé du sommeil ». En comprenant mieux ses mécanismes et en adoptant de bonnes pratiques d'hygiène de sommeil, les jeunes peuvent améliorer significativement leur qualité de vie et leurs performances.
Il est essentiel de sensibiliser davantage la population à l'importance du sommeil. Cela passe par une meilleure éducation ainsi qu’une remise en question de certaines normes sociétales qui valorisent parfois le surmenage au détriment du repos.
Les institutions éducatives ont également un rôle à jouer en prenant en compte les besoins de sommeil des étudiant. es dans l'organisation des emplois du temps et la gestion de la charge de travail. En fin de compte, investir dans un bon sommeil, c'est investir dans sa santé, son bien-être et sa réussite future.


Des agences scientifiques du monde entier ont coordonné la publication simultanée de rapports révélant qu’en 2024, le réchauffement global avait atteint 1,6 °C au-dessus des niveaux préindustriels. Cette hausse ne reflète pas encore une moyenne de 1,5°C sur cinq ans, cible visée par l’Accord de Paris. Ce constat souligne néanmoins l’urgence d’une transition écologique, un concept élaboré il y a déjà près de 20 ans par Rob Hopkins.
Par Marie Tremblay, journaliste multiplateforme et étudiante en sciences de l’environnement
Les rapports révèlent que le temps pour agir face aux changements climatiques est plus court que prévu. Pourtant, l’humanité préfère ignorer l’urgence climatique et reporte l’action avec des excuses comme « c’est pas ma job » ou « je peux rien y faire ». Au fond, ces excuses cachent une peur bien plus profonde : celle de perdre notre confort. Cette peur s’apparente à un deuil que la société moderne peine à accepter. Nous sommes enfermé.es dans une machine capitaliste qui ne cesse de générer des besoins artificiels — des désirs déguisés en nécessités — et qui nous pousse insidieusement vers un mode de vie fondé sur la surconsommation. Sortir de cette roue n’est pas seulement une question de politiques environnementales
et de « petits gestes » , mais aussi d’un profond changement dans nos valeurs et nos priorités.
Enchaîné.es à notre confort
Commençons par définir le confort, tel qu’il est perçu aujourd’hui. Sa signification varie selon les revenus et les valeurs de chacun.e, mais il peut être résumé ainsi : l’ensemble des biens et privilèges que nous tenons pour acquis dans notre société. En d’autres mots, notre qualité de vie.
Le confort c’est…
La machine à café, la douche brûlante de 20 minutes, le chauffage à 22°C l’hiver, l’air climatisée l’été, la sécheuse, le lave-vaisselle, le garage chauffé l’hiver, la piscine à 85°F…
Tous ces éléments ont un point commun : leur dépendance au pétrole. Et préparez-vous, ce mot, pétrole, reviendra souvent. Certes, l’hydroélectricité qui les alimente est qualifiée de verte, mais leur empreinte va bien au-delà de leur simple usage. Du plastique de la machine à café, de la base de douche usinée et du climatiseur, aux poignées de la sécheuse et à la porte du garage imitation bois, en passant par les rebords de la piscine hors terre, tout découle du pétrole. Ajoutons à cela le transport des matériaux, de l’usine au magasin, puis du magasin à notre maison… L’or noir est partout : dans nos vêtements, nos chaussures, nos appareils électroniques, nos matelas et bien plus encore.
Revenons à l’hydroélectricité, cette fameuse énergie verte. Elle aussi dépend des hydrocarbures. Entre la construction et la mise en fonction de la centrale, l’utilisation du pétrole est omniprésente : machineries, matériaux, transports des employé.es. Impossible d’y échapper. Dans le livre Manuel de transition: de la dépendance au pétrole à la résilience locale paru en 2008 mais dont les propos sont plus actuels que jamais, l’auteur Rob Hopkins compare le pétrole à la potion magique dans Astérix et Obélix. On peut comme la concoction de Panoramix, « le pétrole nous rends bien plus forts, plus rapides et plus productifs que jamais » (Hopkins, 2008, p.19).
Les bases de la transition écologique
C’est en prenant conscience du phénomène du pic pétrolier que Rob Hopkins, enseignant en permaculture, est devenu un fervent défenseur de la cause écologique. Le pic pétrolier désigne le moment où la production mondiale de pétrole atteindra son maximum avant d’entamer un déclin irréversible. Pour Hopkins, ce constat est une évidence : nous devons nous affranchir de notre dépendance aux énergies fossiles et adopter un mode de vie résolument plus écologique. De cette réflexion est né le concept de transition écologique, qui repose sur deux dimensions principales : la résilience et la production locale.
Selon Hopkins, il est essentiel de repenser notre avenir sans pétrole tout en imaginant des solutions intégrant simultanément les enjeux du pic pétrolier et des changements climatiques, qui sont intimement liés. Aborder ces problématiques de manière isolée serait, selon lui, inefficace. Une société émettant moins de gaz à effet de serre reste vulnérable si elle dépend des hydrocarbures.
En cas de crise pétrolière soudaine, les conséquences seraient désastreuses : flambée des prix des biens, effondrement économique et incapacité d'agir sur le plan climatique. Une telle situation mettrait la société dans un état de choc, à la fois financier et psychologique, rendant toute transition encore plus difficile à réaliser. Il y a 17 ans, l’auteur écrivait : « Les changements climatiques disent que nous devrions changer, tandis que le pic pétrolier dit que nous serons contraints de changer » (Hopkins, 2008, p.37).
La transition écologique, telle que la conçoit Hopkins, vise donc à construire une résilience face aux fluctuations des stocks de pétrole tout en poursuivant activement les efforts pour réduire les changements climatiques. Cela implique de repenser en profondeur nos modes de vie et le confort qu’ils nous procurent. L’une des solutions avancées par Hopkins est le a de l’économie locale. En effet, la production locale permettrait non seulement de répondre aux besoins fondamentaux des communautés, mais aussi de renforcer leur autonomie et leur capacité d’adaptation. Il ne s’agit pas d’abandonner totalement les échanges commerciaux, mais plutôt de redéfinir les priorités en favorisant des systèmes locaux qui réduisent notre dépendance aux énergies fossiles.
En parallèle, cette économie locale encourage une réflexion à plus petite échelle, où les communautés s’organiseraient autour de la coopération et de l’entraide. Hopkins souligne également l’importance de soutenir des initiatives citoyennes par des fonds dédiés, favorisant ainsi l’émergence d’une multitude de petits projets innovants qui, ensemble, peuvent avoir un impact significatif. Ces projets, pensés localement, sensibilisent les citoyen.nes et renforcent l’engagement communautaire, créant ainsi une dynamique de changement à plus grande échelle.
« La plupart d’entre nous savons instinctivement que nous vivons au-dessus de nos moyens collectifs et avons une idée de ce que nous devons faire » – Hopkins, 2008, p.77.

Une transition victime d’inertie Hopkins s’est penché sur les mécanismes qui régissent le changement chez les êtres humains avec des spécialistes du comportement. Reconnaître le problème est généralement la première étape. Une fois que c’est fait, nous pouvons envisager l’idée de le résoudre. Ensuite, il faut planifier et préparer le changement. C’est sans doute l’étape la plus importante, puisqu’elle permet d’éviter les effets de surprises et d’insécurités pouvant mener à une rechute. Vient finalement l’étape ultime : se mettre en action pour changer concrètement ses habitudes ou son comportement. À ce stade, soit on saute, soit on s’éloigne doucement du bord. Après tout, pourquoi changer ?
Hopkins suggère que ces stades, souvent étudiés chez les patient.es souffrant de problèmes de dépendances, s’appliquent tout aussi bien à la transition écologique. En effet, nous sommes déchiré.es entre deux réalités : vouloir sauver notre planète et abandonner notre « précieuse potion », le pétrole, ou préserver nos habitudes actuelles au détriment de l’environnement.
Cette vision plus psychologique s’applique bien dans un contexte local (individuel, municipal, etc.). À cette échelle, les dynamiques de changement sont plus faciles à comprendre et à influencer, car elles impliquent des interactions humaines directes et des objectifs spécifiques à un contexte donné. Cependant, lorsqu'on tente d'étendre cette approche à une échelle plus vaste, comme celle des
provinces, des nations ou même de la communauté internationale, les défis deviennent exponentiellement plus complexes. Il est difficile d’obtenir un consensus à la table familiale, alors imaginez une table de politicien.nes des quatre coins du monde. Chaque individu, ville, province ou pays traverse les étapes du changement à son propre rythme, influencé par ses spécificités culturelles, économiques et politiques. Cela rend pratiquement impossible la création d’un mouvement uniforme et cohérent à grande échelle.
Bien que la sensibilité du public aux changements climatiques ait considérablement augmenté ces dernières années, les actions peinent à suivre les discours. L’enjeu environnemental ne semble pas être une priorité réelle. Et même lorsqu'il l'est, les processus économiques et politiques viennent ralentir et compliquer la mise en œuvre des mesures nécessaires. De manière générale, les gouvernements adoptent une posture réactive, répondant davantage aux pressions de la population qu'en anticipant les problèmes que causeront incessamment les changements climatiques. Pourtant, malgré les nombreuses manifestations pour le climat et les appels à agir, les actions concrètes restent insuffisantes. En réalité, les gouvernements privilégient souvent des mesures d’atténuation, car elles sont moins coûteuses à court terme, plutôt que des stratégies de mitigation qui nécessitent des transformations profondes et des investissements plus importants.

Le Québec est un des leaders planétaires en ce qui concerne les mesures environnementales. Entre 2023 et 2024, 1,5 milliard de dollars ont été investis pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C’est également la province avec les émissions de CO2 par habitant.e les plus basses en Amérique du Nord (MELCCFP, 2024). Au Québec, nous avons un plan de transition énergétique qui vise à réduire la consommation énergétique des Québécois.es. Cette stratégie se développe en quatre volets : résidentiel, affaires, transport et innovation.
Au niveau résidentiel, le gouvernement offre des programmes qui permettent aux citoyen.nes de rénover leur maison pour « améliorer la performance énergétique » (Gouvernement du Québec, s. d.) des habitations, en améliorant leur isolation. Par ailleurs, le programme incite les propriétaires à retirer les systèmes de chauffage polluants – mazout et propane, principalement – par des systèmes électriques. Enfin, les développeurs immobiliers sont encouragés à construire des maisons et des bâtiments à haute performance énergétique.
Pour transformer le secteur des affaires, le gouvernement encourage les entreprises à réduire leur GES ainsi que leur utilisation d’énergies fossiles. Une autre mesure comprise dans le plan de transition écologique vise à revaloriser les rejets thermiques en énergie.
La mesure la plus connue des Québécois.es est certainement le programme Roulez vert qui offrait des subventions pour l’achat de voitures électriques jusqu’à très récemment. Le gouvernement souhaite également implanter des bornes de recharges rapides et accessibles. Le transport de marchandises, qui représente à lui seul 34% des GES du Québec, est également visé par des programmes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’essence.
Finalement le programme Technoclimat finance des projets d’innovation axés sur les nouvelles énergies et la réduction des GES.
Ce plan se concentre sur la lutte aux changements climatiques par la réduction des GES et les énergies alternatives. En soi, cette stratégie répond à plusieurs critères de Hopkins : augmenter la résilience grâce à l’hydroélectricité et autres bioénergies, favoriser le changement à petite échelle et encourager l’innovation par des programmes de financements. Cependant, ces mesures ne remettent pas en question le mode de vie et ne sont pas orientées vers une production locale, deux éléments cruciaux pour une transition écologique selon Hopkins.

Voir le verre à moitié plein
Le changement, par nature, suscite des peurs et des résistances. Pour qu’il soit accepté, il ne suffit pas d’expliquer quoi faire, il faut surtout montrer comment le faire. On ne dit pas à quelqu’un de sauter dans le vide en espérant qu’iel accepte sans hésitation ; iel a besoin d’un parachute, d’un plan, d’une assurance qu’iel saura voler. C’est pourquoi la manière d’aborder un enjeu est aussi cruciale que l’enjeu lui-même. Rassembler les gens autour d’un objectif commun est un art maîtrisé par une minorité de personnes.
Dans son livre, Hopkins démonte les excuses courantes qui freinent l’action, qu’il résume en sept « mais » : je n’ai pas d’argent, mes efforts seront bloqués, je ne veux pas voler la place des groupes environnementaux, ça n'intéresse personne, c’est trop tard, je n’ai pas l’énergie, je n’ai pas les compétences. Il replace ces obstacles au second plan, insistant sur l’essentiel : une idée et un peu d’initiative suffisent à enclencher le mouvement. Le reste - les bonnes personnes, le financement, les ressourcessuivra naturellement. Comme un simple flocon qui, en dévalant la pente, finit par devenir une boule de neige massive, un petit geste peut déclencher un effet domino insoupçonné. Le succès du mouvement Villes en transition peut en témoigner. En 2005, Hopkins s’est lancé sur la
première initiative de ville en transition à Totnes, Angleterre, avec une centaine de personnes. Vingt ans plus tard, on recensait 1196 initiatives réparties dans 43 pays (Taloté, 2015).
Hopkins ne se contente pas de répondre aux interrogations, il propose aussi une méthode concrète en douze étapes pour amorcer la transition. Plutôt que d’imposer une marche à suivre rigide, il offre un cadre flexible qui permet aux communautés d’adapter le processus à leur réalité. Tout commence par la fondation du projet : rassembler un groupe de personnes motivées, sensibiliser la population aux enjeux comme le pic pétrolier et organiser des événements pour faire connaître l’initiative. Ensuite, il s’agit de structurer l’action en formant des groupes de travail spécialisés et en développant des stratégies adaptées aux besoins locaux. Petit à petit, les efforts convergent vers l’élaboration d’un plan concret visant à réduire la consommation d’énergie et à renforcer la résilience collective.
L’objectif n’est pas seulement de proposer des solutions, mais de créer un élan participatif où chacun.e peut contribuer à sa manière. Son discours est résolument optimiste et dynamique, convaincu que ce tournant peut devenir une opportunité pour l’humanité de se réinventer.

Il met de l’avant l’imagination et la créativité comme moteurs essentiels du changement, des qualités qu’il s’efforce d’insuffler à son public. En donnant aux citoyen. nes les outils et la confiance nécessaires pour agir, Hopkins transforme l’inquiétude face à l’avenir en une force motrice pour le changement.
Quant est-il de notre confort ?
Rob Hopkins promeut un mode de vie plus simple, axé sur les ressources locales et la force des communautés, non pas pour nous priver, mais pour redéfinir ce que signifie réellement le confort. Ce n’est pas un appel à la privation, mais à une réévaluation de ce qui est véritablement essentiel à notre qualité de vie.
Réduire notre dépendance au pétrole impliquera inévitablement de ralentir notre rythme de vie. Notre modèle économique, fondé sur la surproductivité et la consommation effrénée, ne pourra plus fonctionner de la même manière. Cependant, loin d’être un sacrifice, cette transformation pourrait nous apporter des bénéfices inattendus : une diminution du stress, un mode de vie plus équilibré et une reconnexion profonde avec la nature et avec les gens qui nous entourent. En cessant de voir la nature comme une ressource à exploiter, nous pourrions enfin la percevoir comme un élément vital de notre existence.
Bien sûr, cette vision ne fait pas l’unanimité. Pour certain.es, un monde post-pétrole évoque une utopie, un retour à des valeurs de solidarité et d’harmonie. Pour d’autres, il s’agit d’une dystopie, d’une perte de confort et de modernité. Mais la transition ne dépend pas de l’adhésion de toustes. Prendre conscience de l’ampleur du pic pétrolier, c’est aussi réaliser que l’utilisation d’un objet n’est que la partie émergée de l’iceberg de son cycle de vie. Celleux qui y croient peuvent déjà amorcer le changement en modifiant leurs habitudes et en influençant leur entourage.
Peut-être qu’un jour, l’humanité parviendra à sortir de l’impasse dans laquelle elle s’enfonce. Du moins, il est encore temps d’espérer et surtout d’agir.
Références :
Gouvernement du Québec. (s. d.). Transition énergétique | Page d’accueil. https:// transitionenergetique.gouv.qc.ca/ Hopkins, R. (2008). The transition handbook : From oil dependency to local resilience. Green Books. MELCCFP. (2024). Bilan 2023-2024 de l’action climatique du gouvernement du Québec (66 p.). Gouvernement du Québec. https://cdn-contenu.quebec.ca/cdncontenu/adm/min/environnement/publications-adm/plan-economie-verte/bilan2023-2024-action-climatique-quebec.pdf Taloté, T. (2015). Le mouvement des villes en transition : Un véritable projet de décroissance ? 14, 176-184.




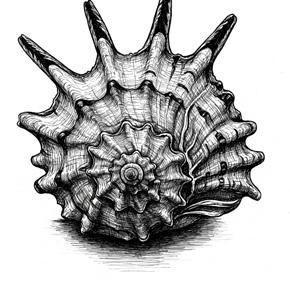
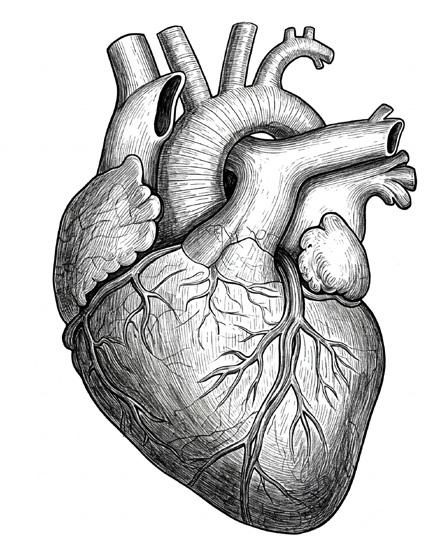




Par Camille Sainson, journaliste multiplateforme





Le silence n'existe pas. Ce que nous appelons silence n’est qu’une illusion, un seuil d’écoute encore inexploré. Caspar Henderson, dans A Book of Noises: Notes on the Auraculous, nous guide à travers un labyrinthe sonore, un monde vibrant où chaque note, chaque bruissement, chaque résonance esquisse une cartographie intime du réel. Comme un astronome décryptant les étoiles, il tend l’oreille aux échos du cosmos, à la polyphonie secrète de la Terre, et aux murmures oubliés des êtres qui l’habitent.
Tout commence par un frisson ancestral. Aux confins du temps, avant que la lumière ne danse sur l’univers, les premières vibrations résonnent déjà. « For the first two to three hundred thousand years after the Big Bang the rapidly expanding universe reverberated as if filled with countless cosmic bells » (Henderson, 2023, p. 9). La matière s’organise en vagues sonores, et c’est dans cette partition originelle que se dessinent nos galaxies. La musique des sphères n’est pas une métaphore : elle est une vérité enfouie, un fil invisible reliant notre souffle au chaos harmonieux du Tout.
Puis vient la Terre, vaste orgue dont les touches, du grondement d’un volcan à l’écho d’un oiseau au crépuscule, composent une symphonie mouvante. Henderson évoque l’« auraculous », ce qui émerveille l’oreille, un mot qu’il forge pour décrire ces miracles auditifs qui transpercent le quotidien. Il raconte le vol des oiseaux rassemblés en nuée dont le mouvement semble chorégraphié par une main invisible, et surtout, leur bruissement, ce tissu sonore d’une précision infinie. « It was loud, but discernibly composed of lots of smaller noises – the fluttering of individual pairs of wings arriving at the ear fractions of a second apart with, perhaps, fractionally distinct timbres and microtones » (Henderson, 2023, p. 1), et soudain, on entend ces ombres en vol, on sent l’air ciselé par leurs ailes.
Il y a aussi le chant du vivant, cette biophonie qui nous précède et nous survivra. Les baleines aux mille échos, les abeilles dont la danse murmure des messages codés, le cri du martin-pêcheur brisant la surface d’un lac. Henderson accorde une place particulière à cette voix en voie d’extinction : le bruissement du monde s’affaiblit. Le silence artificiel que nous tissons de nos machines et de nos villes masque un effondrement, une perte irrémédiable. « Our greatest fear should perhaps be that we have forgotten how to listen to the living Earth », prévient le biologiste David George Haskell, cité dans le livre (Henderson, 2023, p. 5). L’oreille devient alors un acte de résistance, une posture d’éveil face au vacarme du déclin.
S’en suit la rumeur humaine. Notre propre bruit, celui du langage, de la musique, des tambours archaïques aux dissonances modernes. Henderson scrute la magie du son articulé, la manière dont le souffle devient sens, comment, modelé par les cordes vocales, il donne naissance à la poésie, aux cris de joie ou de révolte. Il s’arrête sur le disque d’or de Voyager, ce fragment de notre monde, envoyé au hasard des étoiles dans l’espoir qu’une oreille étrangère l’intercepte. Y figurent les voix de cinquante-cinq langues, le rire d’un enfant, la chanson d’une mère. Et puis, il y a ce chant de la nuit profonde, le blues hanté de Blind Willie Johnson : Dark Was the Night, Cold Was the Ground. Une plainte sans mots, un gémissement à la lisière du silence, témoignage brut de la douleur et de la beauté humaine.
« “The isle is full of noises,” rejoices Caliban in The Tempest; “Sounds, and sweet airs, that give delight and hurt not.” Further, the word “sound” doesn’t always have positive associations. As Macbeth begins to disintegrate he comes to see life as “full of sound and fury, / Signifying nothing”. If Shakespeare was happy to use the words interchangeably, then maybe we can be too » (Henderson, 2023, p. 6).
Henderson conclut son voyage dans l’invisible par un appel : écouter. Dans un monde qui s’assourdit sous le poids du bruit et de l’oubli, l’acte d’écouter devient un devoir sacré, une communion avec ce qui fut et ce qui demeure. Le livre refermé, le silence n’est plus possible. Il bruisse encore, empli de ce que nous n’avions pas su entendre. Et nous, tendant l’oreille, nous voilà peut-être enfin éveillé.es.
Suggestions d’écoutes :
The Harmony of the World - Willie Ruff, John Rodgers
The Music of the Spheres - Johanna Beyer
Sleep – Max Richter
Vox Balaenae - George Crumb
Dark Was the Night, Cold Was the Ground - Blind Willie Johnson
Références :
A Book of Noises, Caspar Henderson, 2023.

Le 19 janvier 2025, plus de 18 000 spectateur.rices se sont retrouvé.es au Centre Vidéotron pour voir la Victoire de Montréal affronter la Charge d’Ottawa dans le cadre la Grande Tournée de la Ligue professionnelle de hockey féminin (LPHF/PWHL). Un pari remporté par la ligue qui, dans sa deuxième année d’activités, semble avoir le vent dans les voiles.
Par Emmy Lapointe, rédactrice en chef
Rien de nouveau sous le soleil, au même titre que plusieurs autres sports, le hockey féminin a longtemps été considéré comme une copie carbone de son pendant masculin, souvent perçu comme plus, rapide, plus physique, plus « authentique ». Dans les dernières décennies, les joueuses se sont retrouvées cantonnées à des ligues précaires, sans véritable reconnaissance ni médiatisation significative.
Avec la création de la LPHF, on assiste à ce qui semble être un tournant décisif dans la professionnalisation du hockey féminin. Dotée d’une convention collective, de salaires garantis et de certains avantages sociaux, la ligue semble enfin offrir aux joueuses des conditions décentes; de quoi transformer en profondeur la pratique et la perception du hockey féminin, tout en suscitant de nouvelles interrogations.
Car si le hockey féminin profite aujourd’hui d’une vague
d’intérêt médiatique et d’un soutien plus franc, demeure la question cruciale : doit-il se calquer sur la culture masculine pour gagner en popularité ? En d’autres termes, est-il condamné, pour survivre, à reproduire les dynamiques (parfois toxiques) du hockey masculin ou peut-il parvenir à en tirer du positif et construire un univers neuf qui soit viable ?
Pour comprendre ce qui se joue, il nous faut d’abord revenir sur le long cheminement du hockey féminin : ses origines, ses luttes pour être reconnu, ses ligues avortées. Saisir comment la culture masculine, malgré ses dérives, a façonné l’apprentissage et la détermination de nombreuses joueuses. Voir ce que la LPHF apporte de réellement novateur : quels changements concrets, quelles limites, quelles possibilités pour la suite des choses. Et pour accompagner ces réflexions, les témoignages d’Alexandra Labelle et de Catherine Dubois, deux joueuses de la Victoire de Montréal qui ont vécu la transition.

La première trace officielle de hockey féminin remonte à 1891, lorsqu’un match est documenté à Ottawa.
Dès 1892, Lady Isobel Stanley, fille du gouverneur général Lord Stanley (donateur de la célèbre Coupe Stanley), s’engage dans la promotion de ce sport pour les femmes. À une époque où le hockey est déjà solidement ancré dans l’identité canadienne, voir des femmes manier le bâton sur la glace apparaît comme une curiosité, voire un comme un pied de nez à l’ordre établi. Malgré cette avant-garde, l’expansion reste lente et souvent cantonnée à des ligues locales : dans les années 1920-1930, on voit apparaître des équipes comme les Edmonton Rustlers ou les Toronto Pats qui témoignent d’un enthousiasme grandissant, mais encore sous-financé. Dans les années 30, on voit apparaître des vedettes féminines comme Hilda Ranscombe. Les formations impressionnent par leur niveau de jeu et suscitent l’admiration du public local. Néanmoins, avec la Seconde Guerre mondiale, les efforts s’essoufflent.
À partir des années 60, une vague de renouveau arrive de l’Europe alors que la Finlande crée, en 1967, la Fédération internationale de hockey sur glace féminin (IIHF). Des compétitions internationales non officielles voient alors le jour jusqu’à ce qu’en 1987, un premier Championnat international de hockey féminin se tienne à Toronto. On sent un engouement : médias et spectateur.ices prennent conscience du niveau de jeu. Un second championnat officiel à Ottawa, en 1990, consolide cette impression. En 1992, il est décidé que le hockey féminin intégrera les Jeux olympiques d’hiver à compter des jeux de Nagano, en 1998. La médaille d’or est alors remportée par les Américaines.
Les années 2002-2010 sont dominées par le Canada, aussi bien aux Jeux qu’aux Championnats du monde.
L’internationalisation de la discipline entraîne une croissance exponentielle du nombre de jeunes filles rejoignant des équipes locales, notamment en Amérique du Nord, en Scandinavie et dans certains pays d’Europe continentale.
Malgré l’enthousiasme suscité par les JO, la professionnalisation du hockey féminin tarde à se concrétiser. L’arrivée de la National Women’s Hockey League (NWHL) en 2015 est une étape décisive : pour la première fois, une ligue féminine verse un salaire à ses joueuses. Toutefois, le modèle économique reste fragile : budgets serrés, diffusion limitée, couverture médiatique sporadique.
En 2017, les joueuses de l’équipe nationale américaine menacent de boycotter le Championnat du monde de l’IIHF, exigeant de meilleures conditions et un soutien financier équitable. Leur victoire symbolique prouve le pouvoir de négociation grandissant des athlètes, mais ne résout pas tous les problèmes. La Canadian Women’s Hockey League (CWHL), pourtant pionnière, ferme ses portes en 2019 faute de financement. La création cette même année de la PWHPA (Association des joueuses professionnelles de hockey) reflète alors l’urgence de trouver un modèle véritablement durable.
En 2021, la NWHL se rebaptise Premier Hockey Federation (PHF), avec un discours plus ambitieux et une légère augmentation des salaires. Deux ans plus tard, la PWHL (Professional Women’s Hockey League) voit officiellement le jour soutenue par des investisseurs majeurs. Pour la première fois, une ligue féminine de hockey se dote d’une convention collective, de salaires minimums garantis et d’une réelle structure économique.
Le hockey masculin comme standard
Dans la langue française comme dans beaucoup d’autres domaines dont le sport, on utilise le neutre pour parler du masculin et on précise le féminin. Le hockey féminin donc, dans son appellation comme dans sa lutte vers la professionnalisation, s’est toujours construit par rapport au hockey masculin et à la culture qu’il a construite.
(Canada, Gardienne de but)
Manon Rhéaume (Canada, Gardienne de but)
Fait historique : Première femme à jouer dans un match de la LNH.
Née en 1972 à Québec, Canada.
En 1992, elle devient la première femme à jouer un match préparatoire dans la LNH avec le Lightning de Tampa Bay. Médaillée d'argent olympique (1998).
A inspiré une génération de jeunes gardiennes et a contribué à briser la barrière entre le hockey masculin et féminin.
Ainsi, de base, le hockey est associé à des valeurs traditionnellement masculines; la vitesse et la puissance physique, la résistance à la douleur, la mise en échec érigée en symbole de virilité et une « culture du code » qui justifie bagarres et coups d’éclat pour imposer le respect.
Dans ce contexte, le hockey féminin a été perçu, des décennies durant, comme une version « allégée » du hockey, reléguée au rang de curiosité ou de compétition de second plan. Pour beaucoup, l’absence de mises en échec constituait la preuve irréfutable que le hockey féminin serait « moins spectaculaire », « moins intense », et donc moins digne d’intérêt. Cette perception péjorative a conforté l’idée selon laquelle les femmes ne pourraient prétendre à un hockey « complet » et « physique ». Or, ce discours a eu un impact direct sur la médiatisation et le financement du hockey féminin : peu ou pas de matchs télévisés, une couverture journalistique réduite à quelques lignes dans la presse locale et, surtout, des subventions et des partenariats très limités.
Pour les chercheur.ses Kajsa Gilenstam, Staffan Karp et Karin Larsén, cette vision participe d’une volonté d’affirmer le hockey masculin comme seul et unique dépositaire de l’essence du sport, maintenant ainsi les femmes dans un

statut de subordonnées. On voit ainsi comment un modèle hégémonique s’impose : le hockey masculin est la norme et toute variante – comme le hockey féminin – est traitée en parent pauvre, incapable d’égaler la robustesse et l’attrait que procurerait un match d’hommes.
En pratique, cette règle a rapidement eu des effets contrastés. Weaving & Roberts (2012) suggèrent qu’elle ne protège pas nécessairement les joueuses : si les mises en échec sont proscrites, les contacts irréguliers ou maladroits n’ont pas disparu, bien au contraire. Les chiffres d’Agel et al. (2007) sont frappants : environ 21 % des blessures en hockey féminin sont liées à des commotions cérébrales contre 9 % en hockey masculin. Pourquoi un tel écart ? Les chercheuses avancent l’hypothèse suivante: les joueuses ne s’attendent pas à recevoir de gros impacts et peuvent donc se mettre en danger par une posture moins vigilante.
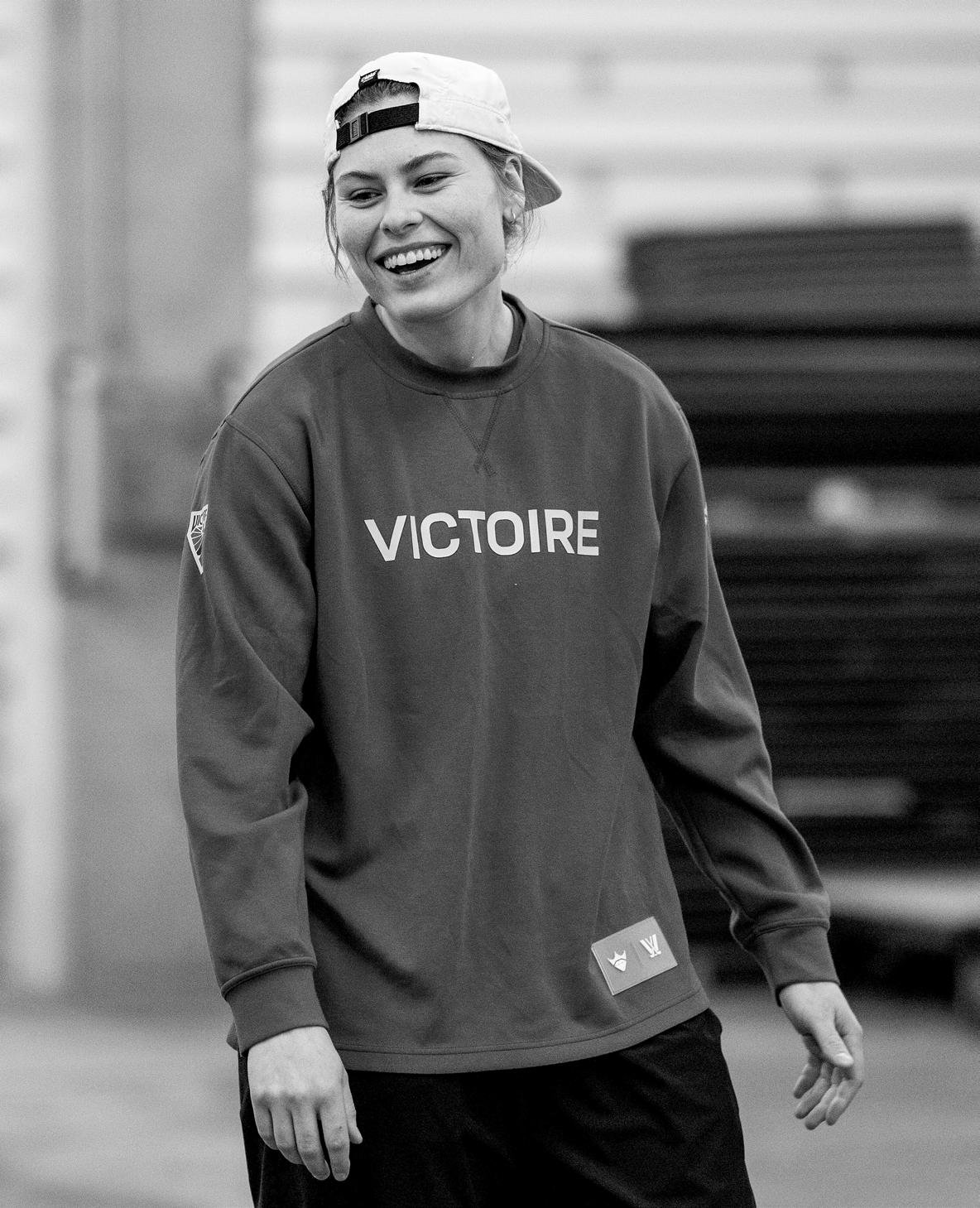

Après, on peut se demander si les mises en échec sont nécessaires au hockey – et c’est une question à laquelle je ne répondrai pas –, mais assurément, la longue absence de la mise en échec dans le hockey féminin aura contribué à renforcer l’idée que le hockey féminin est un « hockey secondaire » qui n’aurait pas le droit de recourir à l’ensemble des techniques du sport, notamment la dimension physique. On retourne dès lors à la logique de la différenciation genrée : le hockey masculin serait « l’original », le hockey féminin « une adaptation » limitée.
Néanmoins, pour certain.es, la présence réduite de contacts aurait permis au hockey féminin de développer un style plus axé sur la technique, la vitesse et la circulation de rondelles.
Au-delà des règles, la culture du hockey masculin façonne directement la formation et l’expérience des jeunes joueuses. Jusqu’à tout récemment et même encore aujourd’hui selon l’emplacement géographique, la plupart des filles ont joué, voire jouent avec des « équipes de garçons » jusqu’à l’adolescence.
Pour l’avoir fait pendant plusieurs années, jouer avec les garçons, c’est particulier. C’est se changer dans une infirmerie ou dans la chambre des arbitres, c’est être traitée
Fait historique : Souvent considérée comme la plus grande joueuse de l’histoire du hockey féminin.
Née en 1978 à Shaunavon, Saskatchewan, Canada.
5 participations aux Jeux olympiques (19982018), remportant 4 médailles d’or et 1 médaille d’argent.
Première femme à jouer dans une ligue professionnelle masculine en position d’avant en Finlande (2003-2004).
Après sa retraite, elle est devenue médecin et directrice du développement des joueuses des Maple Leafs de Toronto.
(Canada, Attaquante)
Fait historique : L’une des premières superstars du hockey féminin et pionnière noire du sport.
Née en 1964 à Toronto, Canada.
A remporté quatre Championnats du monde avec le Canada.
Première joueuse intronisée au Temple de la renommée du hockey (2010) avec Cammi Granato.
Surnommée la « Wayne Gretzky du hockey féminin » dans les années 1980-1990.
Attaquante)
Fait historique : Capitaine clutch, elle a marqué à chaque finale olympique victorieuse du Canada.
Née en 1991 à Beauceville, Québec, Canada. Trois fois médaillée d’or olympique (2010, 2014, 2022) et médaillée d’argent en 2018.
A marqué les buts gagnants en finale olympique en 2010, 2014 et 2022, un exploit unique.
Considérée comme la meilleure joueuse de hockey actuelle.

différemment pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Il faut prouver sa place et faire face à des regards curieux. Pourtant, il est vrai que ces années passées en équipes mixtes peuvent forger le jeu des athlètes. Nombreuses sont les joueuses d’élite qui estiment avoir gagné en combativité physique et en rapidité au contact des garçons. C’est le cas notamment d’Alexandra Labelle pour qui « jouer avec des gars [lui] a appris à être plus physique et à [se] protéger ».
Un patin dedans, un patin dehors
Selon Jamie Ryan, il existe souvent chez les joueuses une double contrainte. D’une part, il faut s’intégrer dans la culture masculine pour pouvoir progresser techniquement. D’autre part, il faut refuser de calquer toutes les pratiques (rites d’initiation, agressivité, silence sur les blessures) pour préserver un espace de jeu différent, voire plus inclusif. Beaucoup de joueuses admirent le hockey masculin pour sa visibilité, pour son intensité, mais le critiquent pour ses dérives, sa culture de la bagarre et son ambiance souvent toxique (harcèlement de vestiaires, violences à caractère sexuel, bizutage, etc.). Cette ambivalence nourrit l’idée d’un hockey féminin en quête d’identité propre. Catherine Dubois l’exprime clairement : « Le hockey féminin est un espace beaucoup plus ouvert, justement, parce qu’on sait ce que c’est d’être exclue. »
Parce qu’elles ont expérimenté la marginalisation, les joueuses tendent à valoriser la solidarité et à rejeter certains aspects de la « masculinité hégémonique » comme la brutalité gratuite ou la loi du silence sur les commotions. Nancy Theberge, sociologue du sport, souligne que de nombreuses équipes féminines développent d’autres formes de leadership et de camaraderie en privilégiant la cohésion d’équipe sans recourir aux rites archaïques qu’on retrouve parfois dans les vestiaires masculins.
Notons aussi les initiatives pour célébrer le mois de l’histoire des Noir.es ou les membres de la communauté LBTQIA2+. Néanmoins, je dois avouer avoir eu un certain malaise à voir apparaître parmi les commanditaires des marques de médicaments (sur)utilisés pour la perte de poids comme Ozempic et Weegovy. Ces médicaments sont d’ailleurs largement plus utilisés chez les femmes que chez les hommes, ce qui pose une question éthique pour la ligue : pour acquérir une pérennité économique, faut-il accepter d’entacher les mesures d’inclusion en faisant la promotion de médicaments qui, littéralement, encouragent
la culture de la diète et plus largement, l'assujettissement des corps féminins ?
Ainsi, le hockey féminin apparaît indissociable du modèle masculin qu’il tente à la fois d’imiter (pour gagner en notoriété, en compétitivité et en capital économique) et de fuir (pour ne pas reproduire des codes jugés toxiques).La PWHL : jouer autrement ?
En 2023, la création de la Professional Women’s Hockey League (PWHL/LPHF) a été annoncée comme l’événement le plus important du hockey féminin depuis son intégration aux Jeux olympiques. Dans un paysage marqué par l’instabilité (CWHL, PHF, NWHL) et le manque de soutien, cette ligue entend rompre avec la précarité habituelle. Qu’en est-il réellement ?
Une ligue stable
La LPHF se distingue avant tout par l’existence d’une convention collective négociée avec l’association des joueuses (PWHLPA). Parmi les dispositions clés :
● Des contrats garantis pour toutes les hockeyeuses.
● Un salaire minimum de 35 000 $ US annuels, indexé à 3 % d’augmentation par an.
● Une moyenne salariale fixée à 55 000 $ US pour la première saison, ce qui permet de dégager un véritable revenu et de vivre du hockey.
● La prise en charge complète des assurances santé, dentaire et vision, un luxe inédit dans l’histoire du hockey féminin.
● Des indemnités de logement et de relocalisation évitant la précarité parfois rencontrée dans les ligues précédentes.
Ces mesures sont destinées à créer un environnement professionnel stable dans lequel les joueuses n’auraient plus à cumuler deux ou trois emplois pour financer leur passion. Pour évaluer la portée de cet engagement, il faut se souvenir que la CWHL ne versait pas de salaire avant sa disparition en 2019 et que la PHF (ex-NWHL) souffrait d’une extrême variabilité budgétaire, ce qui a conduit à des réductions de salaire et à la fermeture de certaines franchises.
Pour Catherine Dubois qui a joué pour la Force de Montréal (PHF/ ex-NWHL), la LPHF est « la première ligue où on sent que ça pourrait vraiment durer ». Par « durer », l’attaquante

Fait historique : Figure de proue de la lutte pour la professionnalisation du hockey féminin.
Née en 1989 à Palo Alto, Californie, États-Unis. Médaillée d’or aux JO de 2018, après avoir aidé les États-Unis à battre le Canada.
L’une des pionnières du mouvement PWHPA, militant pour de meilleures conditions pour les joueuses.
L’une des joueuses les plus populaires et médiatisées du hockey féminin.
évoque évidemment la pérennité économique, mais probablement aussi la légitimité que confère le fait d’avoir un statut clair.
Les comparaisons avec les ligues masculines sont inévitables, mais la LPHF ne prétend pas rivaliser avec la LNH en termes de salaires, mais l’idée est de s’inspirer de ses standards en matière d’infrastructures, de couverture médiatique et de conditions de travail.
Avantages sociaux
Si la dimension salariale est cruciale, la LPHF innove aussi sur le plan social. Le congé de maternité, payé à 100 % du salaire, tranche radicalement avec les pratiques habituelles dans le sport professionnel où une grossesse peut parfois mettre fin à la carrière d’une athlète. Le congé parental de 8 semaines pour les joueuses ayant un enfant et l’assurance invalidité pour les blessures de carrière viennent compléter le tableau.

En fait, ces protections sociales vont plus loin que ce qu’on observe en LNH où les joueurs ne bénéficient pas d’un congé parental aussi formalisé. Il y a là une volonté de dépasser la simple logique du sport-business.
La PWHL mise sur une identité distincte, non seulement par sa structure économique, mais aussi par le style de jeu qu’elle promeut. Les principales différences avec la LNH incluent :
● Pas de mises en échec, mais un contact autorisé, ce qui amène un jeu plus technique.
● Un format de prolongation en 3 contre 3, suivi de tirs de barrage en saison régulière.
● Si un but est marqué par l’équipe en infériorité numérique, leur pénalité prend fin, c’est ce qu’on appelle le jailbreak. Cependant, au moment où la pénalité commence, les joueuses de l’équipe punie doivent rester sur la glace jusqu’au prochain arrêt de jeu.
Au fil des matchs, on constate que l’absence de bagarres et la réduction de la violence affichent un hockey davantage axé sur la vitesse, la créativité et la précision. Cela dit, il ne faut pas croire que le jeu n’est pas physique; une seule partie contre Boston ou New York le prouve.
Une médiatisation croissante
Si la PWHL bénéficie d’une meilleure visibilité que les projets antérieurs (CWHL, PHF), elle doit encore prouver sa capacité à attirer des téléspectateur.rices et à susciter
Fait historique : Première femme à commenter un match de la LNH à la télévision nationale.
Née en 1973 à Richmond Hill, Ontario, Canada. Capitaine de l’équipe canadienne championne olympique en 2002 et 2006.
Première femme à commenter un match de la LNH sur Hockey Night in Canada.
Son rôle dans les médias a permis de faire avancer la visibilité des femmes dans le hockey.
l’intérêt des grandes chaînes sportives. Les rivalités naissantes, la promotion de stars et le soutien de médias numériques donnent de l’espoir. L’enjeu sera de fidéliser ce nouveau public, souvent curieux de découvrir un sport féminin en pleine mutation.
Des initiatives comme la diffusion de matchs en direct sur des plateformes de streaming, l’implication de la LNH pour quelques opérations promotionnelles et l’amélioration des équipements audiovisuels dans les arénas concourent à offrir un produit plus attrayant. Reste à savoir si cette médiatisation peut se maintenir dans la durée, notamment face à la concurrence du hockey masculin et de nombreux autres sports.
(Canada, Activiste et organisatrice)
Fran Rider (Canada, Activiste et organisatrice)
Fait historique : Une pionnière qui a œuvré pour la reconnaissance internationale du hockey féminin.
Née en 1950, Canada.
Fondatrice de l’Ontario Women’s Hockey Association (OWHA) en 1975, une organisation qui a contribué au développement du hockey féminin au Canada.
A joué un rôle clé dans l’intégration du hockey féminin aux Championnats du monde et aux Jeux olympiques.
Témoins d’une transition
Pour mieux cerner ce tournant, rien de tel que la voix des joueuses elles-mêmes qui ont connu les précédentes ligues et la précarité qui les accompagnait. Alexandra Labelle et Catherine Dubois incarnent deux trajectoires semblables : un parcours en ligues universitaires, des passages dans la CWHL ou la PHF, puis la transition vers la PWHL.
Ancienne attaquante des Carabins de Montréal et de la Force de Montréal, Labelle a vécu le paradoxe d’une ligue reconnue pour la qualité de son jeu, mais incapable de verser des salaires réguliers. Aujourd’hui, elle s’engage en PWHL avec confiance tout en gardant en tête certains enjeux. Pour l’attaquante, « ce qui fait la différence, c’est l’investissement financier et médiatique. »

Pour elle, la PWHL est crédible, parce qu’elle s’appuie sur un capital solide et sur une volonté réelle d’en faire une ligue pérenne, plutôt qu’un énième projet avorté. Labelle est aussi consciente qu’il faut développer la ligue étape par étape et qu’il faut notamment prendre en considération le bassin de joueuses et de la transition vers la ligue professionnelle, « parce qu’il y a une grosse marche entre les ligues universitaires et la LPHF. »
Côté expansion, parce que la ligue ne compte que six équipes pour le moment (Montréal, Toronto, Ottawa, New York, Boston et Minnesota), on peut s’attendre à voir apparaître deux nouvelles équipes d’ici deux ans. Plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour cette expansion. Déjà, il faut s’assurer que la croissance ne soit pas trop rapide. Ensuite, les villes choisies doivent attirer un public, mais elles doivent aussi se situer à distance d’autobus de certaines autres équipes pour réduire les coûts de déplacement.
Ancienne joueuse des Carabins de l’Université de Montréal et de la Force de Montréal (PHF), Catherine Dubois a vite constaté les limites d’une ligue qui manquait de stabilité économique. L’arrivée de la PWHL lui apparaît comme la concrétisation des efforts menés depuis des années par les joueuses elles-mêmes pour exiger mieux.
Un des points forts de la ligue selon Dubois, c’est la compétitivité et le fait « que tout le monde peut battre tout le monde. »

(Canada, Défenseure)
Fait historique : Première femme autochtone à jouer pour l’équipe nationale canadienne aux Jeux olympiques.
Née en 1992 à Mallard, Manitoba, Canada.
Membre des Premières Nations de Cote et de la Nation métisse.
Médaille d’argent olympique en 2018 avec l’équipe du Canada.
Première femme autochtone à représenter le Canada en hockey aux Jeux olympiques d’hiver.
A joué dans la CWHL avec les Calgary Inferno, remportant un championnat Clarkson Cup en 2016.
En 2021, elle est devenue dépisteuse pour les Blackhawks de Chicago, devenant la première femme autochtone à occuper un tel poste dans la LNH.
Ensemble
Quand j’ai commencé à jouer au hockey, il n’y avait pas d’équipes de filles à Québec avant le niveau Midget (15-17 ans). Ce n’était juste pas quelque chose que je pouvais envisager, jouer avec les filles. Et c’était correct. Je me changeais dans l’infirmerie, je rejoignais les gars quelques minutes avant le match dans la chambre. Et pour vrai, les gars ont toujours été gentils, m’ont toujours défendue.
Mais quand je suis arrivée niveau Bantam (1314 ans), j’ai eu la possibilité de transférer avec les filles, ce que j’ai fait. Avoir des coach filles qui ne lançaient pas de bouteilles au-dessus de notre tête quand on faisait un hors-jeu, être dans la chambre avec les autres, j’avais l’impression de découvrir un tout autre pan du hockey. Malheureusement, ce pan-là avait un coût. Nos pratiques étaient à des heures pas possibles et à l’aréna le plus creux de la ville. Comme il n’y avait qu’une seule équipe à Québec, une fin de semaine sur deux, on était sur la route.
Je savais déjà à ce moment-là que le hockey était un loisir pour moi, que je ne dépasserais pas le niveau collégial et je voyais tout ce que ça coûtait en temps et en argent à ma mère,
un coût cinq fois plus élevé que pour un garçon. Alors, j’ai arrêté.
Mon intérêt pour le hockey est devenu un truc qui appartenait à l’enfance et à l’adolescence et qui réapparaissait une fois aux quatre ans pour les JO – la finale de 2014 à Sotchi est d’ailleurs l’un de mes Roman Empire. Puis, depuis l’automne, ça me revient. Je me réintéresse au hockey par le hockey féminin. J’y reviens comme certaines personnes autour de moi y arrivent. Et cette (re)naissance-là me fait vraiment plaisir.
Même que ça m’émeut.
Quand j’entends Alexandra Labelle me dire qu’elle n’en revient pas que sa passion soit son travail ou Catherine Dubois me confier qu’il n’y a rien comme le support de ses coéquipières, que ça l’aide à travailler sa confiance, ça me remplit de joie.
Quand je vois le Centre Vidéotron être sold out pour un match de la Victoire et que l’auditoire se compose d’équipes de hockey masculines et féminines, de femmes d’un certain âge, de dudes, de personnes de la communauté LGBTQIA2+, je me dis que le hockey féminin rassemble beaucoup.
Références :
Agel, J., Dompier, T. P., Dick, R., & Marshall, S. W. (2007). Descriptive epidemiology of collegiate women’s ice hockey injuries: National collegiate athletic association injury surveillance system, 2000–2001 through 2003–2004. Journal of Athletic Training, 42(2), 249-254.
Gilenstam, K., Karp, S., & Larsén, K. (2007). Gender in ice hockey: Women in a male territory. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 18(2), 235-249.
Ryan, J. (2021). Skating on thin white ice: Imagining a queer futurity in hockey. [Article universitaire].
Theberge, N. (2000). Higher Goals: Women’s Ice Hockey and the Politics of Gender. Albany: SUNY Press.
Weaving, C., & Roberts, S. (2012). Checking hockey’s gendered boundaries: Women’s hockey, bodychecking and the politics of exclusion. Canadian Journal of Women and the Law, 24(1), 262-284.
PWHL (2023). Convention collective de la PWHL [PDF].

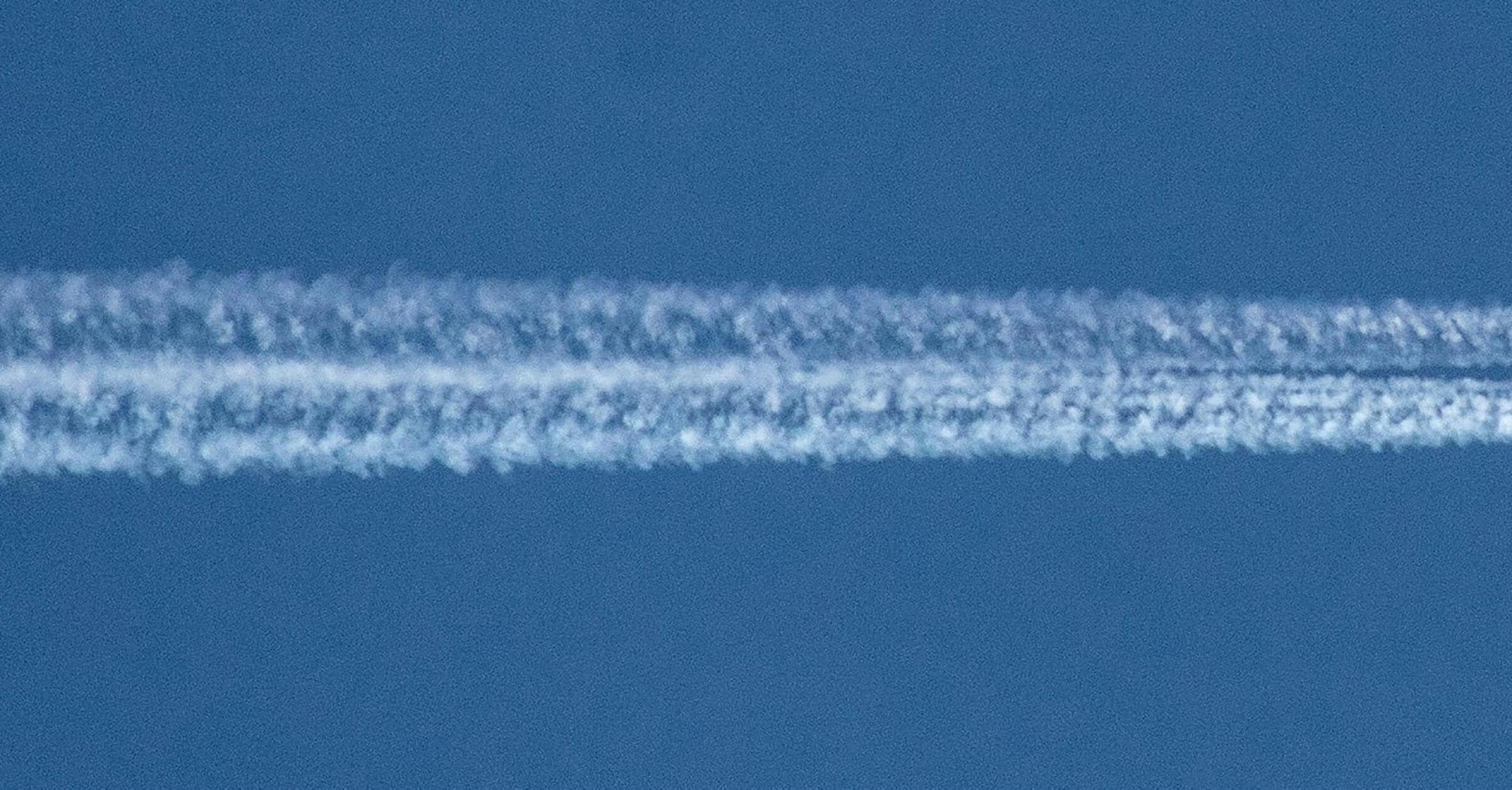
Une lecture marquante en ce début d’année pour moi est le livre Rue Duplessis : ma petite noirceur de Jean-Philippe Pleau, sociologue et animateur de radio. Dans ce récit autobiographique, Pleau raconte sa réalité de transfuge de classe. Ce terme décrit la migration sociale d’une personne, dans ce cas-ci de la pauvreté vers la « bourgeoisie », pour reprendre les mots de l’auteur. À travers les pages, l’auteur explique la différence culturelle entre les deux mondes sociaux et les conflits intérieurs qui accompagnent cette transition au quotidien. À défaut de trouver des étudiants transfuges de classes – donnons-nous quelques années encore –, j’ai rencontré des étudiants qui vivent une autre dualité intérieure et sociale : vivre avec plusieurs identités culturelles.
Par Marie Tremblay, journaliste multiplateforme
Au Québec, 24% des jeunes âgés entre 15 et 24 ans (Gouvernement du Canada, 2022) ont déclaré avoir des origines culturelles ou ethniques multiples. Il est important de faire la différence entre origines culturelles et ethniques. Bien que les deux soient souvent complémentaires, elles ne désignent pas les mêmes aspects de l’identité. Les origines ethniques renvoient à l’héritage biologique et génétique, tandis que les origines culturelles réfèrent aux traditions, valeurs, langues et pratiques qui influencent également le mode de vie.
On dit d’une personne « qui appartient à deux cultures majeures » (Grosjean, 1993), qu’elle est biculturelle. Elle peut naître de deux parents d’origines différentes, mais peut également devenir biculturelle, c’est le cas des personnes immigrantes. Le linguiste François Grosjean, s’est d’abord penché sur la question du bilinguisme, puis de fil en aiguille, s’est attardé à la question du biculturalisme, deux concepts liés, mais intrinsèquement différents. Grosjean affirme que l’être biculturel participe à la vie des deux cultures et qu’il adapte ses comportements selon le contexte culturel dans lequel il se trouve. Il ajoute une

troisième caractéristique : « [il] combine et synthétise des traits de chacune des cultures. En effet, certains traits proviennent de l’une ou l’autre culture et se combinent tandis que d’autres n’appartiennent plus ni à l’une ni à l’autre, mais sont la synthèse des deux. » (Grosjean, 1993).
Grosjean exprime donc que les deux cultures, oui coexistent, mais peuvent également se fusionner vers un nouveau tout propre à chacun. Né d’une union interculturelle, immigré de première, deuxième génération, expatrié, comment l’individu jongle-t-il entre ses différentes identités? L’image d’un funambule qui marche sur un fil de fer tendu entre deux cultures est celle qui me vient à l’esprit. Entre ces deux rives, toutes les possibilités de l’être biculturel existent. Il peut être entièrement, à moitié, en partie l’une ou l’autre culture.
C’est une façon d’être qui, selon Grosjean, peut être particulièrement déroutante pour l’individu monoculturel qui a tendance à catégoriser naturellement les autres dans certains groupes. C’est un réflexe presque inconscient que nous avons tous. De la même manière que nous catégorisons les objets, la nourriture ou les métiers, cette structuration nous aide à comprendre et à organiser notre perception du monde. Lorsqu’il s’agit d’interactions
sociales, cette catégorisation influence aussi notre comportement : par exemple, nous adaptons souvent notre langage en présence de personnes que nous associons aux « aînés ».
Dans le cas des personnes biculturelles, la situation est plus complexe : elles n’appartiennent ni entièrement au groupe A ni entièrement au groupe B. Alors, à quel groupe les rattacher ? Il est facile de se tromper et d’attribuer une identité à quelqu’un en fonction de son accent, de sa couleur de peau ou de nos propres préjugés (Grosjean, 1993).
Bien que l’ouvrage de Grosjean ait été publié il y a 30 ans et que la société québécoise se soit depuis largement ouverte sur le monde, ce biais inconscient demeure. Pourtant, il ne résulte pas d’une mauvaise intention, mais plutôt d’un mécanisme profondément ancré dans notre façon d’appréhender la diversité.
Pour en savoir davantage sur les dilemmes, les déchirures et les atouts qui habitent l’être biculturel dans un contexte plus actuel, je suis allée à la rencontre de cinq étudiant.es pour récolter leur témoignage.
Quelles sont tes origines culturelles et à quelle culture t’associes-tu le plus?
Nathan, 19 ans : Mon père est Québécois et ma mère est Française. Dans ma tête, je me suis vraiment toujours senti autant Français que Québécois, autant Québécois que Français. […] J'ai grandi à Rome, à Nairobi, à Paris et un petit peu à New York. Partout où j'étais, j'ai beaucoup fréquenté des Français, étant donné que je suis toujours allé dans des écoles françaises. J'ai l'impression que, pendant ma jeunesse, c'est donc un petit peu cette culture qui a pris le dessus sur les autres parce qu’elle était constante.
Alexa, 23 ans : Si je devais faire un diagramme quelconque, en pourcentage ça serait plus simple : 80% c'est Québécoise et Européenne (Belge), et 20% c'est Africaine. Ma mère vient du Rwanda et mon père de la République démocratique du Congo, mais il est parti quand il avait 5 ans, donc il a vécu toute sa vie en Belgique. Je me vois plus Européenne que Québécoise, mais les deux sont vraiment sur un pied d'égalité. Je dis plus Européenne parce qu’avec mes parents, je ne parle pas avec l'accent québécois.
Benjamin, 22 ans : Je suis Canadien et Belge, ma mère est belge. Je m'identifie plus à la culture canadienne parce que j'ai grandi ici.
Hugo, 21 ans : Je suis français, mais j'habite au Québec depuis 4 ans. Je m'identifie plus à la culture canadienne parce que, maintenant, je connais mieux le Canada que la France.
Alicia, 17 ans : Ma mère est Brésilienne, mon père est Canadien et Américain. J'ai l'impression d'être « internationale » à la place d'être Canadienne, Brésilienne ou Américaine. Je suis là et j’ai conscience de tout, mais je ne fais pas vraiment partie d'une catégorie. C'est le fun parce que je peux comprendre plus les autres, mais on dirait que je ne sais pas, moi, je suis quoi.
Te sens-tu catégorisé dans une culture par tes interlocuteurs?
Nathan : Je me suis vraiment souvent fait catégoriser comme français. Et il y a une époque où ça m’affectait. J'en suis plus là. […] C'est aussi une bonne manière de partir des conversations.
Alexa : J’ai l’impression de m’être tellement bien intégrée que ça paraît pas. À l'université et au Cégep, je me suis sentie un peu plus catégorisée, dans le sens qu'il y avait plus de diversité. On dirait que ça ne me dérange pas [de me faire catégoriser] quand ce sont des gens qui me connaissent, mais ça me dérange un peu quand c'est des gens qui ne me connaissent pas parce que c'est basé sur des pensées préconçues.
Hugo : C'est drôle parce que quand je suis au Québec, je suis considéré comme Français, mais quand je rentre en France, on m'appelle le Canadien. Quand je suis arrivé ici, je trouvais ça normal d’être catégorisé comme Français. Après un moment, je me suis rendu compte que beaucoup de Français au Québec critiquaient






énormément de choses. Ils râlaient sur la nourriture, sur le climat, ils disaient qu’ils ne comprenaient pas l’accent québécois... En fait, il y avait beaucoup de négativité envers le Québec. Moi, c'était mon rêve de venir ici. Donc, après avoir pris conscience de ça, j'avais honte de m'identifier au fait d'être Français.
Alicia : Quand je suis au Brésil, je me fais vraiment regarder comme une petite gringa (étrangère en portugais, mot souvent utilisé de façon péjorative pour qualifier les non-hispaniques).
Quels sont les enjeux liés au biculturalisme?
Nathan : Je pense que l'enfance est nécessairement compliquée, à moins que tu choisisses complètement un bord. C'est peut-être plus facile, mais c'est peut-être pas souhaitable non plus. Ça crée pas mal de troubles identitaires, il y en a qui s'en sortent mieux que d'autres.
Alexa : J'ai de la difficulté parce que je sais que, peu importe dans quel groupe je vais être, je vais me sentir un peu à part. Du côté de mon père, je vais me sentir à part parce que je n’ai pas ce sentiment profond de la religion. C'est vraiment un conflit à l'intérieur de moi. Ça me fait aussi beaucoup de peine de ne pas connaître les langues de mes parents. J'ai l'impression que si j'avais eu ça, je me serais moins sentie à l'écart.
Lorsqu’on immigre, on veut tellement se faire accepter par notre société d’accueil qu'il peut être facile d’oublier absolument tout de notre background . Les traumas générationnels, par exemple, le génocide qui s'est passé au Rwanda, se développent différemment rendu au Québec. Je pense que c’est super important de ne pas oublier ces choses-là. Et ça, j'essaie du plus profond de mon cœur que ça n’arrive jamais.
Benjamin : On voit souvent des enfants des premières générations d'immigrants qui disent qu'une fois qu'ils vieillissent, ils se rendent compte à quel point leurs parents ont fait des efforts pour eux et ont tout sacrifié. Je le vois vraiment avec mes grands-parents.
[…] Quand on parle avec nos grands-parents, on change notre langage. Quand on joue aux cartes, il faut dire septante et nonante. Ce n'est pas que notre comportement change parce qu'on est une personne à deux visages, mais ce ne sont pas les mêmes règles de bienséance ni les mêmes règles de comportement à suivre.
Hugo : Le principal enjeu, je dirais, c’est l'immigration. En ce moment, c'est ultra instable. Il faut que je passe par des démarches provinciales et fédérales, que je prouve telle ou telle chose. Donc, même si j’ai envie de rester au Canada, au final, c’est le gouvernement qui décide à ma place.
La liberté, ce n'est pas de pouvoir faire ce qu'on veut, mais de pouvoir faire des choix et ensuite, de les assumer. […] Les premiers mois, je n'ai pas pu téléphoner à ma sœur parce qu'à chaque fois qu'on s'appelait, elle se mettait à pleurer. […] Je me sentais coupable de ce choix-là parce que je vis ici et je suis super heureux, mais eux, ils sont malheureux parce que je ne suis pas là.
Alicia : Je parle français, anglais et portugais. Des fois, j'ai l'impression que je ne suis pas capable de penser. Je pense tellement à ce que je veux dire, que je ne suis pas capable de bien le dire dans la langue que je veux.
[En parlant de la culture brésilienne] Je ne me sens pas autant connectée parce que je suis athéiste. Au Brésil, le catholicisme, c'est un big thing. J'ai l'impression que je n'ai pas ce niveau avec la culture. Ça crée un peu des chicanes dans ma famille, l'aspect religieux.
Quels sont les avantages du biculturalisme?
Nathan : Un passeport canadien et un passeport français, ça permet d’aller pas mal partout. Personnellement, j'ai l'impression que j'ai de la misère à rester statique à un endroit pendant quelques années, mais en même temps, j'ai envie d'être chez moi. Avec deux pays d'origine, je pourrais éventuellement déménager en France et je serais autant chez moi qu'ici. Je peux changer de vie sans partir de chez moi.
Alexa : Je peux pick and choose. […] Je pense que ce que je prends beaucoup du Québec, c'est la liberté. Je peux être tout ce que je veux, même si, à cause de mon background, ça peut être difficile.
Benjamin : C’est quand même une fierté d'avoir deux nationalités. Ça nous rattache à nos origines.
Hugo : Je pense que je n’ai jamais été aussi heureux dans ma vie que quand je suis arrivé ici. J'avais l'impression d'avoir beaucoup moins de limites ou de barrières. En fait, j’avais tout à construire. C'est comme si je renaissais sur plein de points et j'ai trouvé ça tellement incroyable.
Ça m'a aidé à comprendre pourquoi que certaines personnes sont fermées d'esprit. On a des schémas de pensée qui ont été conditionnés par le contexte, les gens qu'on côtoie, nos parents, notre culture… Je me dis, finalement, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un d'être moins ouvert. […] Je mets toute ma bienveillance dans mes relations avec les gens, même si on est totalement différents sur plusieurs de choses.
Alicia : Ma mère et ma grand-mère se sont vraiment assurées que je sois connectée avec mon côté brésilien. C'est pour ça que je connais le portugais. C'est la première langue que j'ai apprise, avant l'anglais et le français. Je me sens choyée d'avoir l'opportunité de pouvoir parler en plusieurs langues avec différentes personnes, de






pouvoir changer comment je parle. Tu as un autre niveau de connexion avec le reste de ta famille.
Avoir plusieurs cultures te permet de comprendre mieux les autres cultures en général. Tu peux être plus empathique envers les inégalités. Surtout, l’Amérique latine où il y a tellement de pauvreté. On dirait que j'ai plus conscience du reste du monde.
À travers ces rencontres, j’ai compris que le langage, tout comme le territoire, nous permet d’exister. Le territoire nous ancre dans le matériel, tandis que la langue nous fait exister dans l’immatériel. Même au sein de la francophonie, deux individus peuvent éprouver des difficultés à se comprendre. L’adaptation à l’autre devient alors essentielle, car elle permet non seulement de communiquer, mais aussi de partager une identité culturelle. La connexion qui en découle en est d’autant plus profonde. En tant que Québécoise, je ressens la chaleur du sentiment patriotique qui m’envahit lorsque j’entends d’autres Québécois à l’étranger.
L’autre aspect qui a particulièrement retenu mon attention est la place de la spiritualité au sein de certaines cultures. La société au Québec, en France et en Belgique est laïque sur le plan politique. Cela influence grandement notre mode de vie. Une personne ayant accès à une culture plus spirituelle constate nécessairement le décalage qui se crée entre ces différentes façons de penser.
Plus largement, je crois que le mot culture n’a pas d’échelle définie. Au Québec, il y a des familles qui n’accordent pas la même importance à la religion, tout comme les gens de Québec et Montréal continueront de s’obstiner sur la prononciation du mot « baleine ». Voyez-vous, en tant que personne plutôt monoculturelle, je tente de comprendre les sentiments des autres en les mettant en perspective avec ma propre expérience culturelle. Voilà un mécanisme que François Grosjean jugerait sans doute normal.
Peut-être qu’un jour, je deviendrai biculturelle à mon tour, me permettant de comprendre pleinement le déchirement identitaire décrit par Jean-Philippe Pleau et certains de mes interlocuteurs. Je suis profondément reconnaissante envers chacune des personnes qui m’ont confié des fragments de leur histoire, m’offrant ainsi une précieuse ouverture sur leur réalité. Bien sûr, ces témoignages ne représentent qu’une infime partie des expériences vécues par les personnes biculturelles. Néanmoins, j’espère qu’ils vous inciteront à aller à la rencontre des autres, car sous les apparences se cachent souvent des histoires insoupçonnées.
Références
Gouvernement du Canada. (2022). Ajouter ou enlever des données - Origine ethnique ou culturelle selon le genre et l’âge : Canada, provinces et territoires. https:// www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/cv.action?pid=9810035501
Grosjean, F. (1993). Le bilinguisme et le biculturalisme : Essai de définition. Travaux neuchâtelois de linguistique, 19, Article 19. https://doi.org/10.26034/tranel.1993.2342

« Aucun repli n’est stratégique » : histoire imparfaite de la dernière décennie du mouvement étudiant
Les prochains mois marqueront le 10e anniversaire de la grève du printemps 2015. Suite chaotique et douce-amère du « triomphe » que fut celle de 2012, P15 incarne la fin d’une époque et le début d’une autre dans l’histoire du mouvement étudiant québécois; le commencement d’une décennie de déliquescences, de règlements de compte et de remaniements incertains, mais aussi de nouvelles formes d’organisations, d’espoirs forcenés et de luttes vivantes.
Par Antoine Morin-Racine, chef de pupitre aux actualités
Face à l’attentisme du conseil exécutif de l’ASSÉ (Association pour une solidarité syndicale étudiante) qui voulait reconduire la grève à l’automne pour mieux la mener avec les syndicats à leurs côtés, une faction du mouvement déterminée à tirer le Québec une seconde fois dans la contestation ouverte de son gouvernement libéral s’en ira en guerre avec à la gorge le slogan « Aucun repli n’est stratégique ».
Même si la contre-stratégie qu’il porte est critiquable, quand on jette un œil aux dix dernières années, on peut, avec raison, avoir le sentiment que l’on n’a jamais cessé de se replier… De dissolutions en petites victoires, malgré quelques élans de mobilisations non négligeables et après une pandémie mondiale, il se ressent une ambiance de vide qui n’a pas su être comblé. Chez les plus vieux.illes qui ont vécu ses décennies de gloires, il persiste une sorte d’incrédulité face à toute la léthargie du mouvement étudiant en ce moment et en dépit de tout ce que les plus jeunes ont pu accomplir dans les dix dernières années, même celleux qui viennent d’y entrer se font prendre à dire que « c’est plus ce que c’était ».
Mais faire état de la vague impression de temps mort qui nous habite ne nous donne pas le droit de nous pâmer dans la nostalgie et de se contenter d’esthétiser notre désespoir, car de très belles et conséquentes choses se sont tout de même accomplies dans les dix dernières années.
Pour bien saisir le fonctionnement du mouvement étudiant, il est nécessaire de l’imaginer comme allant et venant à la manière des marées. Certains événements ou conjonctures vont entraîner une recrudescence du mouvement durant certaines périodes, comme un contexte local et international particulièrement chaud en 1968, l’abandon de la gratuité scolaire comme promesse du gouvernement en 1978, ou l’annonce d’une hausse de 325$ des frais de scolarité en 2012. Mais ce qui caractérise sa longévité, c’est sa capacité à survivre entre ces différentes effervescences de mobilisation. C’est dans les entractes entre ces moments de gloire, à la marée basse, dans ces moments de réflexion entre les campagnes ou dans le vacuum laissés par l’exécution d’une association nationale, dans les décennies où il est faux de dire que « rien ne se passe », que le mouvement étudiant s’est constitué et reconstitué comme force politique.
Il revient souvent à celleux qui sont né.es trop tard pour faire l’Histoire la responsabilité de faire le point… Peut-être est-il encore trop tôt pour se prononcer et peut-être qu’un essai dans un magazine étudiant n’est pas la bonne forme
pour rendre compte de la décennie dans toutes ses nuances, mais pour se déprendre de ce sentiment perpétuel de post-2015, post-2019, post-2020, et en l’honneur des luttes qui ont tout de même été menées, il en va d’au moins essayer de donner un sens à la dernière décennie du mouvement étudiant, parce qu’il faut déjà commencer à la mettre derrière nous et parce qu’il est maintenant nécessaire de la placer dans la grande fresque de l’histoire du mouvement étudiant québécois, mais aussi parce que son avenir n’a jamais semblé aussi incertain.
P15 : Zénith et chant du cygne
Pour comprendre comment le Printemps 2015 se place dans l’histoire du mouvement étudiant, il est nécessaire de le comprendre comme la fin d’une autre décennie, celle de 2005 à 2015. De 2005 à 2012, le mouvement étudiant, malgré une « entente à rabais » après la grève de 2005 et une cuisante défaite après celle de 2007, se constitue graduellement autour de l’ASSÉ comme une force politique farouchement opposée à l’économie néolibérale et capable de mobiliser de plus en plus de sa base pour lui nuire. Son développement est bordélique, conflictuel, par moments autosaboteur, mais quand on le met en perspective, il s’en dégage une construction graduelle de la puissance étudiante qui culminera lors du printemps érable.
Après quelques années de reconstruction suite à la grève de 2007, le mouvement étudiant se tient donc relativement uni et déjà bien mobilisé à l’automne 2010 face à l’annonce d’une deuxième hausse des frais de scolarité en moins de 5 ans.
Ce qui suivra fait aujourd’hui partie du domaine historique public. Résultat d’une unité relative, mais juste assez tenace entre les différentes associations nationales, d’une capacité de mobilisation encore jamais vue dans l’histoire du mouvement étudiant et d’une écœurantite populaire qui, mêlée à une touche de répression bien médiatisée, réussiront à transformer une grève étudiante en véritable contestation populaire, la grève de 2012 est un mythe dont il ne convient pas d’essayer de faire ou défaire l’histoire ici. Que l’on considère 2012 comme un jalon de l’histoire québécoise ou comme une défaite déguisée en triomphe, ce qui est certain c’est que le mouvement étudiant en est sorti avec le sentiment d’être une force politique tellement considérable qu’il avait maintenant la capacité de s’attaquer frontalement à la société néolibérale.
Face au retour des libéraux trois ans plus tard et à la promesse d’un régime d’austérité dès l’élection du gouvernement Couillard, l’idée d’une grève sociale contre ses mesures austéritaires commence à flotter au sein du
mouvement. L’organisation de cette prochaine grève échappera cependant aux grandes associations nationales comme l’ASSÉ, parce que menée premièrement par la base plus anarchiste du mouvement étudiant qui se réunira autour des Comités Printemps 2015.
P15 constitue ainsi la tentative de réaliser un rêve pour la gauche étudiante : la possibilité d’être à l’initiative d’une grève générale qui irait au-delà des seuls enjeux étudiants et ainsi peut-être causer une fracture dans le système en place, ce totalitarisme économe où il est tout à fait sensé de vouloir couper en santé quand les temps d’attente à l’urgence se comptent en heures et de prévoir des projets d’exportation gazière quand la crise climatique est déjà à nos portes.
S’étant surpris.es elleux-même 3 ans auparavant par leur capacité à tirer une masse quasi-critique de Québécois.es dans une contestation ouverte du gouvernement, il en allait maintenant de reprendre un moment de contestation « qui ne s’était pas joué jusqu’au bout » en 2012 (Collectif de Débrayage, 2016, p.12).
Certes, les deux revendications imposantes, mais pertinentes, de la grève étaient officiellement l’abandon du programme d’austérité du gouvernement et l’arrêt de l’exploitation des hydrocarbures dans la province, cependant, P15 ne peut se comprendre en s’arrêtant seulement à sa liste d’épicerie politique.
Là où 2012 était un discours fort, étayé et rassembleur qui, malgré quelques débordements, fut matraqué injustement par un gouvernement arrogant qui sera démis à coup de casseroles, 2015 était un cri de rage violent et effervescent contre l'écrasante normalité néolibérale qui sera matée par

le « gros bon sens » sous les applaudissements de la majorité silencieuse. Là où le travail de mobilisation de masse de 2012 fut préparé des années à l’avance par l’ASSÉ, 2015 fut spontané et s’organisera en quelques mois sous la pression des factions anarchisantes du militantisme étudiant. Là ou 2012 sera mobilisée par des militant.es de l’aile plus syndicaliste de l’ASSÉ (avec quelques anarchistes motivé.es), 2015 sera l’œuvre de celleux qui étaient aux barricades contre le SPVM trois ans plus tôt et qui n’avaient pas grand-chose à faire si la starlette GND refusait ou acceptait l’offre du gouvernement.
Là où 2012 retirait sa participation au système d’éducation pour négocier une annulation de la hausse, 2015 balançait un cône orange à la fenêtre du capital en se mettant en opposition carrée à la totalité du fait social néolibéral. De là son slogan emblématique qui renferme à la fois toute la beauté et la désespérance de son geste : « Fuck TOUTE ! ». 2012 était contre la hausse, 2015 était contre « TOUTE ».
La grève sera donc étudiante : à partir du 21 mars, quelque 60 000 collégien.nes et universitaires commenceront à débrayer à l’approche du dépôt du budget. Mais outre quelques moments de solidarités notables entre les mobilisations syndicales et étudiantes, la lutte ne parviendra pas à devenir populaire.
Malgré la prise d’initiative des comités P15, l’ASSÉ et le reste des factions moins radicales du mouvement se mettront tout de même dans l’idée de coordonner une grève sociale contre l’austérité avec les centrales syndicales qui s’unissent tranquillement vers un front commun depuis l’année dernière. Seul bémol, même si les conventions collectives du secteur public viennent à échéance en mars 2015, celleux-ci ne peuvent pas tomber

en grève dès leur expiration, et leur droit de grève légal ne s’ouvre qu’après plusieurs allées et venues bureaucratiques entre les centrales et le gouvernement qui peuvent durer plusieurs mois. La pleine puissance d’une contestation où les syndicats ET le mouvement étudiant sont en grève contre le budget austéritaire du gouvernement ne peut être atteinte qu’à l’automne ou si les syndicats décident de tomber en grève illégalement ce printemps, ce qui, malgré les espoirs des Comités P15, est fort improbable.
Et c’est à propos de ce bémol que le mouvement étudiant se déchirera. C’est là-dessus que s’ouvrira une nouvelle décennie de son histoire : en tombant à l’intérieur d’un gouffre irréconciliable entre la promesse incertaine d’avoir l’énergie pour reprendre la grève à l’automne et la tâche quasi-impossible de continuer à faire monter la pression durant tout l’été.
Après deux semaines de mobilisation somme toute conséquentes durant lesquelles une manifestation réunira près de 130 000 personnes à Montréal le 2 avril, l’ASSÉ proposera un « repli stratégique » à ses associations membres lors de son congrès du 5 dans l’idée d’attendre que les syndicats puissent se mobiliser avec elleux à l’automne.
Face à l’indignation que provoquera le soudain volte face de l’exécutif chez les militant.es de la base, les membres de l’exécutif en place remettront leur démission… qui sera promptement refusée par les associations membres pour qu’elles votent de suite la destitution de leurs élu.es au congrès.
La colère ingouvernable qu’on lancera à l’exécutif sortant tentera bien d’être récupérée au cours des mois d’avril et mai pour continuer le combat, notamment par le biais de plusieurs occupations, mais, une à une, sous le poids des conflits internes et de la fatigue mais surtout de la répression, les associations en grève voteront toutes le retour en classe avant la fin du mois de mai. Dans une lutte particulièrement féroce contre la répression de son administration sur ses étudiant.es militant.es, la grève à l’UQAM et l’occupation qui tentera de la faire continuer se terminera par une émeute désespérément cathartique où le SPVM en aura pour son argent en budget de contrôle de foule.
L’été passera ensuite au rythme de quelques manifs de soir et autres mobilisations écologistes en région, mais le mal était fait. C’était la croissance de la fatigue et non la dissidence qui était maintenant inarrêtable.

L’« Automne chaud » arrivé, l’énergie et la coordination feront défaut à la mobilisation et celle-ci se videra de son sang aux côtés d’une tiède campagne de contestation syndicale et quelques manifestations nationales où le black bloc fera office de coping mechanism pour militant.es aigri.es. Il n’y a rien de très grave à un peu de vandalisme entre ami.es tout de noir vétu.es. Bien souvent, le seul moyen de donner une véritable frousse au pouvoir est par le billet d’un panneau de circulation encastré dans ses belles vitrines, mais vient un point ou l’émeute comme sport est parfois le signe d’une contestation qui s’épuise.
La violence acérée de la répression policière participera aussi à achever la mobilisation. À coups de grenades à bout portant gracieuseté du SPVQ, de sit-ins pacifiques poivrés sans merci par le SPVM, de vieilles madames qui se fracassent le crâne par terre parce qu’elles ne courent pas assez vite, à force de vomir du sang à cause des gaz lacrymogènes et de se faire pointer des fusils à balles réelles dessus par des agent.es provocateur.rices, l’ardeur étudiante se dispersera par reculs lancinants et chaotiques.
Entre celleux qui pensent qu’aucun repli n’aurait pu être stratégique et celleux qui la voit plus acrimonieusement comme une fuite en avant qui n’avait pas « les conditions objectives » avec elle, la grève de 2015 cristallise son statut contradictoire de zénith enragé et tragique chant du cygne d’une des décennies les plus importantes de l’histoire du mouvement étudiant.
D'un espoir d'être l'étincelle radicale à une contestation populaire, P15 se transformera, au fil des hésitations de replis, des désagréments fratricides et des brutalités policières, en un défoulement cher payé à tenter de botter les tibias du capital. Cela ne lui donne pas pour autant tort d’avoir existé, mais cela n’en fera jamais une victoire.
Le Printemps 2015 aura ainsi raison de l’ASSÉ, et les années suivantes ne feront que confirmer l’agonie de sa vie utile en tant qu’organisation.
La « grande » ASSÉ, celle qui était née dans les ferments du Sommet des Amériques et de l’altermondialisme, celle qui avait « fait 2012 », l’avant-garde de la contestation étudiante qui, par ses talents de mobilisation, pouvait être remerciée pour presque tous les gains étudiants des 14 dernières années,était maintenant vue par une partie grandissante du mouvement sous son jour d’assemblée de violeurs égocentriques aimant s’entendre parler dirigé subtilement par une cliques de bureaucrates hypocrites prêts à tordre le code Morin comme ils le voulaient pour faire passer leur ligne de parti en assemblée générale et de violeurs égocentriques aimant s’entendre parler. Vous n’avez qu’à lire les démissions de ses différents comités Femmes et voir au travail le boysclub d’un certain parti de gauche pour vous en donner une idée.
Quand on fait ressortir de vieux souvenirs à celleux qui y étaient, c’est comme si on pouvait entendre les engueulades de pause-café entre deux motions.
Suivant tout une tendance dans la gauche internationale à ce moment, une critique du « centralisme » de l’ASSÉ et des rapports de pouvoir informels en son sein s’est développée à partir de 2012 par la faction anarchisante du mouvement étudiant. C’est en 2015 que cette tendance organisationnelle dite plus « affinitaire » et « autonomiste » en est venue à rivaliser avec celle plus structurante de l’ASSÉ. Pour une partie grandissante du mouvement, désillusionnée de la démocratie directe d’assemblée, car témoin des multiples manigances qui peuvent s’y perpétrer et écœurées des jeux de pouvoir vicieux au sein d’une organisation qui se disait démocratique, un mode d’organisation plus flexible permettant une liberté et une diversité d’action aux militant.es étaient à l’ordre du jour. Pour plusieurs, inspiré.es par l’autonomie italienne et les Foucault, Debord, Deleuze, Agamben, Negri et cie. (Archives Révolutionnaire, 2024) il en allait de se réunir non pas dans de grandes organisations nationales, mais dans la fédération plus décentralisée de petits groupes autonomes formés par des gens militants ensemble et partageant une camaraderie commune, une « affinité ». Dans certains de ses retranchements les plus intenses, cette tendance fait même un pied de nez à la stratégie du mouvement de masse.
Pour d’autres, cependant, aussi nécessaire ces dynamiques de pouvoir puissent-elles être à confronter, la critique

organisationnelle qui l’accompagne est discutable, car le reniement d’une organisation nationale comme celle-là signifie également la perte d’une capacité d’organisation longue, efficace et à grande échelle, capacité d’organisation qu’iels n’ont pas tout à fait tort de dire que le mouvement étudiant n’a pas su retrouver depuis.
Au travers des chicanes de plus en plus hargneuses entre ces différentes tendances, certain.es tenteront bien de sauver l’ASSÉ dans l’intérim entre 2015 et 2019, de redresser ses finances, de régler ses problèmes de sexisme et d’entendre les critiques de ses membres, de faire survivre l’organe politique avec lequel le mouvement étudiant s’était donné une grande partie de sa force, mais d’autres étaient déterminé.es à la faire tomber pour que puisse naître et grandir tout ce qui bouillonnait déjà autour de ses obsèques.
Les organisations sont faites pour mourir
L'ère d'agonie d'une organisation est bien souvent l'ère de gloire d'une autre, et la séquence 2016-2020 du mouvement étudiant en est bien la preuve. Au moment de sa mort effective en avril 2019, une vive campagne de grèves de près de 3 ans vient de se terminer autour de la salarisation des stages et les mobilisations pour le climat sont en pleine effervescence. Le discours du déclin en est un qui peut toujours être relativisé.
Par la volonté de faire cesser l’insultant travail gratuit des étudiantes-travailleuses ayant à accomplir des stages

non-payés durant leur formation, plusieurs anciennes militantes du mouvement étudiant étant revenues aux études dans des programmes professionnels en viendront à mener une campagne de près de 2 ans aux côtés de milliers d’autres étudiantes pour un salaire à leur travail.
La plupart des stages non-rémunérés se trouvent dans des corps de métiers à majorité féminine notamment dans les milieux du soin comme le travail social, les soins infirmiers, l’éducation, la psychologie, etc., ce qui donnera une orientation foncièrement féministe à la lutte. Remaniement bien mérité pour un mouvement qui, malgré ses postures publiquement féministes, avait souvent mis de côté cet enjeu au profit de luttes plus « unitaires ».
Suivant l’initiative des étudiantes en psychologie ayant fait grève à l’automne 2016 pour la rémunération de leur internat, s’organisera ainsi une véritable « convergence des ras-le-bol » (Collectif, 2021 p.20) qui débouchera entre autres sur la création de la CRAIES (Campagne de Revendication et d’Actions Interuniversitaires des Étudiant-es en Éducation en Stage), mais surtout des CUTE (Comités Unitaire sur le Travail Étudiant) et la fondation de plusieurs coalitions régionales pour la rémunération des stages. Tout au long de l’année 2017, des dizaines de milliers de stagiaires et d’étudiant.es solidaire tomberont plusieurs fois en grève en exigeant la rémunération, voire la salarisation des stages.
Cette nouvelle itération du mouvement étudiant émanera
des critiques de l’ASSÉ déjà mentionnées à propos de ses structures et de ses problèmes de machisme, mais aussi d’une réaction face à un certain mépris pour les programmes techniques et l’enjeu des stages au sein du mouvement (Collectif, 2021 p.17). Une lutte moins « unitaire », certain.es diront « affinitaire », mais d’une pertinence tout de même solidarisante vu les conditions absolument déplorables des stagiaires. Une lutte avec la volonté de s’organiser de manière moins centralisée, son momentum devant rester sous le contrôle des stagiaires militantes à qui elle revient et pas à une grande organisation nationale comme l’ASSÉ ou l’UEQ (Union Étudiante du Québec).
La mobilisation des CUTE et de la CRAIES prendra de court le nouveau gouvernement de la CAQ et leur gagnera la rémunération du dernier stage en enseignement ainsi que la création des « Bourses Perspectives » qui rémunèrent la réussite à hauteur de 1500$ et 2500$ à la fin de chaque session dans certains des programmes dont les stages sont non-rémunérés (et dont la fin vient d’être devancée à l’hiver 2025…) mais pour bien des militantes, ce sera trop peu trop tard. Trois ans de luttes les ayant épuisées, plusieurs sentaient qu’elles étaient arrivées au bout de ce qu’elles étaient prêtes à donner au mouvement. Après une semaine de grève particulièrement drainante à l’automne 2018, et une tentative de grève générale illimitée à laquelle l’énergie des militantes manquait à l’hiver 2019 les CUTE procéderont à leur auto-dissolution pendant le reste de l'année.

Au même moment, pendant ce qui peut apparaître en rétrospective comme « l’An 1 » de la crise climatique, s’organise toute une mobilisation de la jeunesse inspirée des grèves pour le climat de Greta Thunberg. La contestation partira initialement des grèves du vendredi dans les écoles secondaires pour se rendre jusqu’à l’université, culminant lors de plusieurs manifestations qui, malgré leur caractère bon enfant, feront tout de même sortir des centaines de milliers de personnes dans la rue.
Face au wake-up call de la jeunesse mondiale qui fera entrer la gravité du problème (pour quelques mois au moins) dans la tête d’une grande partie de l’opinion publique, la classe politique mondiale tentera de se faire rassurante avec toute une série des steppettes tentant de convaincre les enfants qu’iels « les entendaient », mais toute une génération de nouveaux.elles militant.es étaient déjà en marche.
L’été 2019 verra ainsi l’organisation graduelle d’une nouvelle frange affinitaire du mouvement étudiant autour de la question climatique. Après un congrès désordonné, mais rempli d’espoir à Saint-Fulgence au Saguenay, la Coalition Étudiante pour un Virage Environnementale et Social (CEVES) voit le jour. Quoique moins prononcée que dans les CUTE, on sent également une volonté d’autonomie et de flexibilité d’action dans l’organisation de la CEVES. Composée à la fois de comités environnementaux locaux,
de représentant.es d’associations étudiantes et d’individus voulant s’impliquer pour la planète, on pensera même à la CEVES comme potentielle successeure de l’ASSÉ dans une fusion des enjeux environnementaux et étudiants.
La CEVES sera notamment derrière l’organisation de la manifestation du 27 septembre où 150 000 personnes sortiront dans les rues de Montréal pour marcher aux côtés de ladite Greta, La Coalition sera au cœur de la continuation de la mobilisation environnementale pendant le reste de 2019 et survivra à la pandémie, organisant notamment une semaine pour l’action climatique complètement en ligne dans les premiers mois de confinement. Malgré cette lueur d’espoir dans un moment de panique, cependant, la CEVES prendra peu à peu la forme d’un pôle central du mouvement pour l’action climatique autour duquel naîtront de surcroît d’autres mobilisations comme le mouvement de contestation de la COP15, qui, lui, fera ensuite naître l’organisation Rage Climatique et plusieurs autres groupes environnementaux.
« Il ne faut pas espérer des organisations militantes qu’elles soient éternelles, sans quoi elles deviennent des ONG », me déclare un ancien militant de la CEVES.
Qu’elles se meurent en laissant un statu quo tout aussi niais à celleux qui suivent, en ne débouchant que sur une réforme de plus ou en semant le souvenir d’une insurrection

étouffée, toutes les organisations militantes finissent par mourir, d’épuisement, de répression ou de régicide, et les mouvements sociaux qu’elles font vivres se meuvent dans l’histoire au rythme de leur disparition. Leur effondrement ne devrait pas constituer un objet de réjouissance, encore moins de nostalgie. La seule chose qu’on puisse espérer c’est que celleux qui survivront seront en mesure de continuer leur combat.
…puis tout s’arrête… Mais que faire lorsque tout s’arrête ? Que faire quand le cours habituel du pouvoir et de sa contestation est fracturé par une pandémie pour laquelle on nous enferme à plusieurs reprises pendant des mois ? Que faire quand, après des semaines complètes sans être sorti de chez soi à pourrir devant un fil infini de contenu abrutissant, on a de la difficulté à aligner deux idées devant un groupe d’ami.es ? Que faire quand notre socialisation par le biais des écrans a fait de nous des êtres tellement surconscient.es de l’image que nous projetons aux autres qu’elle nous fait raser les murs de chaque interaction réelle que nous avons à subir ? Que faire lorsque le capital possède une emprise si omnisciente sur nos vies qu’il s’attaque maintenant à notre capacité à s’organiser politiquement ?
Le capitalisme dans sa nouvelle forme algorithmique s’est avantagé de la pandémie pour saper un peu plus chaque jour depuis maintenant 5 ans nos capacités de socialisation (et donc, nos capacités de mobilisation politique). Toute l’architecture du pouvoir capitaliste s’est récemment refermée sur nous afin d’expérimenter ses nouvelles compétences d’atomisation.
Les raisons ne nous manquent pourtant pas d’être en colère, et nous le sommes ! Les convictions que nous tenons sont peut-être de plus en plus révolutionnaires, mais leur potentiel émancipateur est nullifié quand on les réduit à l’état de vulgaires esthétiques qu’on affiche vertueusement sur Instagram. Nous n’avons pas cessé de voir les

contradictions s’intensifier, les loyers augmenter, les salaires stagner, le racisme systémique perdurer, mais même après une véritable insurrection au sud de la frontière à l'été 2020, nos capacités de mobilisation ne semblent pas avoir arrêtées de se détériorer…
L’inflation galopante fait travailler tout le monde toujours plus d’heures chaque semaine et cela inclut la population étudiante. De moins en moins d’entre elleux ont le temps, l’énergie et la motivation de s’impliquer dans les associations étudiantes ou dans un groupe militant, et encore moins pour une grève. Les campus se sont reremplis, mais ils baignent dans un mutisme occupé où tous.tes vaquent à leurs études, seul.es, l’un.e à côté de l’autre. Le train-train militant ne s’est jamais complètement arrêté pour autant, mais les quelqu’un.es à s’être impliqué.es en son sein ne se racontent pas d’histoire quant à l’ambiance stagnante qui règne depuis la pandémie dans le mouvement étudiant.
Une véritable rupture épistémique s’est opérée dans la passation des savoirs sur laquelle a toujours dépendu le mouvement étudiant, lui qui se vit et se réinvente au rythme des cohortes à presque tous les ans. Même les étudiant.es les plus lambda ont jusqu’à oublié qu’iels avaient une association pour les représenter ! Celleux qui sont impliqué.es sont d’une génération de militant.es qui, Dieu merci, a une bien meilleure compréhension du consentement que les précédentes, mais qui se contentera d’une story Instagram, parce que trop anxieuse pour aller tracter; les seul.es encore assez « courageux.euses » pour aller déranger les gens étant quelques trotskystes essayant de vendre leurs quotas de revues.
Le « social » sans lequel aucun « mouvement » ne peut naître est attaqué par une existence qui nous désapprend activement à créer du lien. C’est peut-être par Internet qu’on se politise, mais c’est seulement en présentiel qu’on crée du politique.
Continuons le combat : ruminations pour une reprise des hostilités
Au lendemain d’un party de couloirs comme on n’en « avait pas vu depuis longtemps » dans l’aile des associations étudiantes de l’UQAM, un graffiti annonce : « La Fin des couloirs vides » sur l’un des murs brutalistes autour du Café Aquin.
C’est dire que même à l’UQAM, cette université née de la grève pour faire la grève, ce centre névralgique et nombriliste du mouvement étudiant, s’est vu assénée un coup tellement féroce à son militantisme que celleux qui restent se réjouissent d’une fête qui n’aurait semblé aucunement exceptionnelle ne serait-ce que 6 ou 7 ans plus tôt…
Si on annonce la « Fin des couloirs vides », cependant, ce doit être parce que l’immobilisme post-pandémique s’estompe, non ?
Malgré un campement démantelé de force par la police à Laval et une occupation peuplée des usuals suspects à l’UQAM, les campements pro-palestiniens de la dernière année ont tout de même fait naître une recrudescence d’action militante ne serait-ce que du côté anglophone de la gauche étudiante montréalaise.
Depuis maintenant deux ans, la CRUES (Coalition de Résistance pour l’Unité Étudiante Syndicale) s’affaire également à bâtir une « organisation syndicale combative
qui regroupe des associations étudiantes locales aux niveaux régional et à l’échelle du soi-disant Québec » sans reproduire les erreurs de l’ASSÉ. Optant pour l’assemblement plus autonome des gauchistes du mouvement étudiant plutôt que la fédération des associations étudiantes à une bannière unitaire de gauche comme à l’ASSÉ, leur pari est ambitieux : « […] construire des milieux étudiants révolutionnaires en misant sur une augmentation massive de la conscience politique et sur le renforcement de l’autonomie de chacun.e en tant que sujet révolutionnaire » (Première Ligne, 2023). Ses militant.es s’attèlent à un beau défi : concilier la tendance autonomiste que la gauche étudiante a prise dans la dernière décennie avec l’existence d’un syndicat étudiant provincial tout en tentant de convaincre les associations étudiantes existantes de réintégrer la voie du syndicalisme de combat et de signer un cahier de positions résolument révolutionnaires. Reste à voir si ces « milieux » seront construits à temps et assez puissants pour contrer la prochaine hausse…
La dernière décennie est un tableau encore confus; s'y entremêlent des portraits contradictoires de déclin et de germinations. Entre la certitude résiliente que la marée finira toujours bien par remonter et la panique devant une nouvelle configuration démobilisante de nos relations humaines, une tentative d'emprise sur la situation se fait appeler. Aussi futile puisse-t-elle être, cette tentative semble mandater une critique, une prise de position sur le court que semble suivre le mouvement.
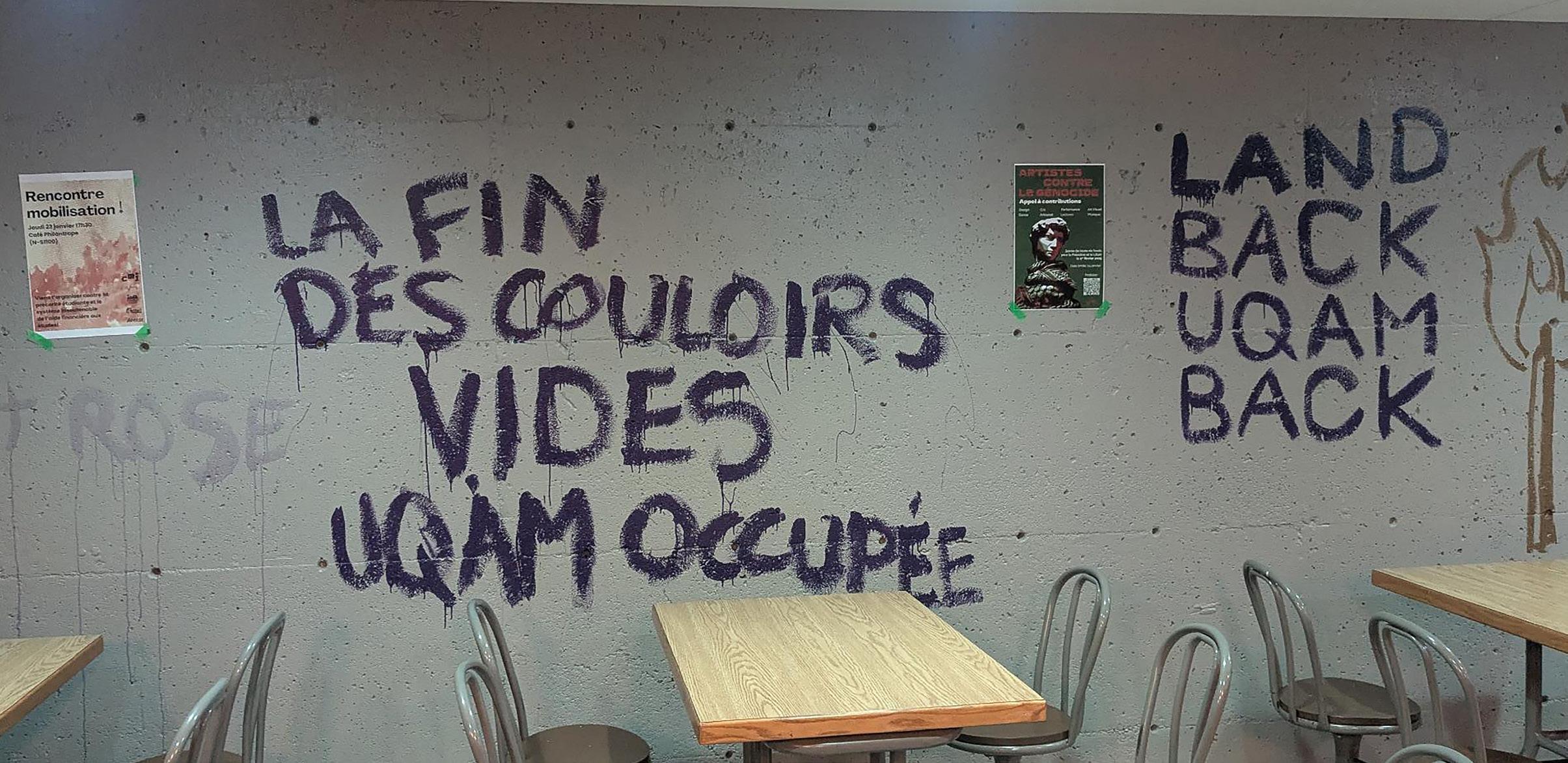
Car il faut parler de la prochaine hausse en « quand » et non en « si », et le fait est que même si « en instaurant le plus grand et le plus long mouvement étudiant de l’histoire nord-américaine, on se destine à bien des déceptions » (Collectif de Débrayage, 2016, p.14), aucune organisation ou mouvance étudiante de la dernière décennie n’a été capable de reproduire l’ampleur et l’intensité de mobilisation de P15, et encore moins de 2012. Il en va donc de « reprendre les hostilités » (Anonyme, 2011), pour des stages avec salaire, pour mettre fin au saccage climatique, pour un avenir dépris de l'omniscience du capital, mais comment ?
Même si « les mouvements sont faits pour mourir » (Le Jardin s’embrase, 2007), le rhizome qui tente en ce moment de fleurir de leurs cadavres est attaqué de plein fouet par les forces immunitaires du capital.
10 ans après la grève qui pensait partir la révolution, avec un gouvernement de retour en mode austéritaire et un mouvement étudiant qui n’a toujours pas quitté sa décennie de reconstitution; qui déambule dans une agonie dont on ne sait pas si elle nous mènera à l’extinction ou la réincarnation, la seule manière sensée de mourir serait avec cette phrase de Deleuze à la bouche : « Il n’y a pas lieu de craindre ou d’espérer, mais de chercher de nouvelles armes » (Deleuze, 1990, p.3).
L’auteur tient à remercier celleux qui ont étés généreux.ses de leur temps en se remémorant leurs expériences des 10 dernières années au sein du mouvement étudiant et sans qui l’écriture de ce texte n’aurait été possible : Mélissa Miller, André-Philippe Doré, Samuel Provost, Jaouad Laaroussi, Julia Wilkie, Justin Arcand, Étienne Simard, Dr. Pascale Dufour, Étienne Paré, Olivier Turcotte, Léonard Leclerc, Marco, Jason F. Ortmann et Félix Étienne.
Références : Anonyme. (2011). Fragments pour une reprise des hostilités. https://faire-greve.blogspot.com/ C.A.J. (2023). Perspectives révolutionnaires pour le milieu étudiant. Première Ligne, 1(2). https://premiereligne.info/ perspectives-revolutionnaires-pour-le-milieu-etudiant/ Collectif. (2021). Grève des stages, grève des femmes. Remue-Ménage. https://www.editions-rm.ca/livres/grevesdes-stages-greves-des-femmes/ Collectif de Débrayage. (2016). Fuck Toute. Sabotart. Gilles Deleuze. (1990). Post-scriptum sur les Sociétés de Contrôle. L’Autre Journal, 1(1), 8. Infokiosques.net. Le Jardin s’embrase. (2007). Les mouvements sont faits pour mourir. Tahin-Party. Révolutionnaires, A. (2024). POST-SITUATIONNISME ET APPELISME AU « QUÉBEC » – Fragments 2004-2019. Partie II. Archives Révolutionnaires . https:// archivesrevolutionnaires.com/2021/03/20/postsituationnisme-et-appelisme-au-quebec-fragments-20042019-partie-ii/




Par Léon Bodier, journaliste multiplateforme

Les aéroports, ces vastes lieux clos où les gens convergent dans un flux incessant de départs et d'arrivées entre deux destinations, incarnent des frontières au sens le plus littéral du terme. Pour l’autrice Gloria Anzaldúa, une frontière n'est pas seulement une ligne de démarcation politique ou géographique, mais un espace psychologique et culturel, « un lieu vague et indéterminé créé par le résidu émotionnel d'une limite artificielle » (Anzaldúa, 1987). Dans cet esprit, les aéroports fonctionnent comme des zones liminales où les normes peuvent être interrogées et redéfinies. Les aéroports, avec leurs zones de transit, de contrôle de sécurité, et leurs salles d'attente, ressemblent à des territoires chargés de possibilités et de restrictions. Ces espaces sont régis par des règles strictes de sécurité et de conduite, mais ils offrent aussi un moment de suspension des routines quotidiennes. C'est dans cette suspension que les personnes transgenres, comme moi, trouvent parfois un espace potentiel pour exprimer et explorer leur identité de genre d'une manière qui n'est pas souvent possible dans d'autres contextes. Pour moi, l’expérience d'adopter temporairement une présentation de genre différente entre l'arrivée et le départ est symptomatique de la manière dont les aéroports peuvent servir de passage au travers de frontières personnelles et identitaires. Anzaldúa parle de la frontière comme d'un lieu où « le prohibé et l'interdit habitent », où « le pervers, le queer, le dérangeant » prospèrent.
Par exemple, les toilettes des aéroports, avec leurs signes binaires, deviennent des microcosmes de plus grandes luttes pour l'acceptation et la reconnaissance. Dans ces espaces, les individus transgenres vivent souvent une tension accrue. Choisir entre des portes marquées « Hommes » et « Femmes » peut sembler trivial pour certain.es, mais pour d'autres, c'est une décision lourde de conséquences. Celle-ci peut susciter de l'anxiété, mais peut aussi être, dans les aéroports, une forme de résistance discrète contre les catégories rigides de genre. En effet, chaque passage à travers les frontières est un acte de négociation avec les normes sociales, un acte qui, avec l’utilisation d’une toilette différente entre départ et arrivée, peut être affirmant.
Anzaldúa évoque également le concept de « nepantla », un terme nahuatl signifiant être « entre les chemins ». Dans les aéroports, beaucoup de personnes transgenres se trouvent dans un état de nepantla — entre les genres, entre les règles établies, entre le départ de leur ancien soi et l'arrivée à un soi renouvelé. C'est un espace où les identités peuvent devenir fluides, changeantes, souvent en réponse à un effet de soustraction temporaire au regard et aux réactions du monde existant en dehors de l’aéroport.
Cette fluidité est donc aussi temporelle. Les aéroports suspendent le temps; les heures de départs des vols, les décalages horaires, les attentes prolongées créent un sentiment d'intemporalité. Pour une personne en transition, cette suspension offre un répit temporaire des contraintes temporelles habituelles associées à la « réalisation » de son genre — le temps nécessaire pour se préparer, pour se conformer aux attentes du genre, est mis entre parenthèses.
Par ailleurs, Anzaldúa souligne l'importance de construire des ponts plutôt que des barrières. Les aéroports, en tant que frontières modernes, reflètent les tensions et les possibilités de l'identité transgenre. Ils offrent des moments de transition, non seulement entre les destinations, mais aussi entre les identités. Anzaldúa nous invite à voir ces frontières non comme des obstacles, mais comme des lieux de passage potentiels, des espaces où les normes peuvent être contestées et où de nouvelles formes de coexistence peuvent être imaginées. Pour les personnes transgenres, chaque passage à travers ces zones peut être un acte de définition de soi, un pas vers la création d'un espace où être pleinement soi-même n'est ni prohibé ni dangereux, mais plutôt une possibilité de diversité et de fluidité de l'identité humaine. Pour moi, c’est un espace où j’ai pu faire fleurir mon identité d’homme, affirmer ma place dans le monde.


Sodade est le mot créole (capverdien) décrivant un sentiment inconscient, un poids dans le cœur qui ne semble pas disparaître ou s'apaiser. Sodade, c’est un sentiment de manque, de déficit, de lacune… une nostalgie inexplicable liée à un lieu, une personne ou une mémoire. En réalité, cette douleur - bien que souvent enfouie - prend une forme plus imposante chez beaucoup d’entre nous qui ne vivons plus dans la ville où nous sommes né.e.s ou avons grandi. Comment apprendre à vivre avec ce poids lorsque tu ne t’attends pas à le ressentir, après un changement de résidence, par exemple, qu’il soit permanent ou temporaire ? En français, nous parlerions du « mal du pays », alors qu’en anglais, le terme approprié serait « homesick » [si nous parlons d’un lieu], traductions qui ne rendraient pas justice au mot créole. Comment expliquer et apprivoiser ce mal-être, ce deuil de qui tu étais, de ce soi qui a disparu dans ce nouveau pays et qui aura du mal à réapparaître quand tu rentreras «chez toi» ?
Par Dayane Rodrigues, journaliste collaboratrice
«Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazos las veces que pude. Ey, ojalá que los míos nunca se muden » / « J’aurais dû prendre plus de photos quand tu étais encore là. J’aurais dû t’embrasser et t’enlacer plus quand j’en avais encore l’opportunité. Eh, j’espère que les miens ne bougerons jamais. » (DtMF. Bad Bunny, MAG, Scotty Dittrich, JULIA LEWIS, Tyles Spry & La Paciencia) (Traduction libre). Le nouvel album de Bad Bunny m’a conduit à réfléchir aux changements physiques et mentaux que nous pouvons subir lors d’un déplacement. L’album évoque le changement de Puerto Rico sous l’effet de la gentrification, et la perte culturelle qui en découle. Cette chanson en particulier peut être interprétée comme un réconfort mélancolique, une expression artistique de ce que nous aurions aimé faire ou chérir davantage quand nous étions sur place. Malheureusement, tu ne sais jamais qu’un moment ne se reproduira plus, que les événements vécus deviendront des souvenirs, que les visages des êtres chers deviendront flous.
Voici l’histoire d’un.e immigré.e qui s’installe dans un nouveau pays. Un lieu où personne ne partage sa culture, où sa famille ni ses ami.e.s ne sont présent.e.s. Le dépaysement total : beaucoup de personnes ne se rendent pas compte du déracinement subi lorsque tu ne sais plus où se trouvent tes repères. Une partie de ce qui te définit n’est plus présente ni tangible. Il y a ce dicton qui dit que c’est à nous de transformer un lieu en une maison, mais comment le faire sans ancrage concret ? Le changement est un acte individuel avant tout et parfois solitaire. C’est un deuil qui n’est pas facile à faire : dire au revoir à tes habitudes, à tes coutumes, devoir apprendre ou réapprendre à vivre sans tes refuges ou repères. Seuls ceux qui l’ont vécu pourront le comprendre, mais même ainsi, le degré du deuil ne sera jamais le même pour tous.tes. Des questions indirectement culpabilisantes : « Pourquoi es-tu triste? Tu as tout », lorsque tu sais que

tu dois être reconnaissant.e envers celleux que tu as, mais que tu es loin de ta famille, de tes ami.e.s, de ce que tu connais. Lorsque le temps d’adaptation arrive et que la réticence disparaît, un sentiment de trahison t'envahit. Une impression que tu es en train d’oublier ta culture, ton identité, que les liens que tu avais se défont.
Puis, vient une nouvelle étape : tomber amoureux.se d’une nouvelle culture tout en oubliant petit à petit la sienne. Tu ne te rends pas compte de cette perte d’une partie de ton essence jusqu’au moment où tu te retrouves confronté.e à quelqu’un encore enraciné dans ta culture ou lorsque tu retournes « chez toi », au lieu de départ. C’est à ce moment-là, (paradoxalement) lors de ce choc culturel, que tu te rends compte que tu n’es plus celui ou celle que tu étais avant la transposition. C’est l’entracte, un moment de transition, où tu dois redécouvrir qui tu es en fusionnant ton passé et ton présent pour créer ton futur, ton nouveau toi. Personne ne parle de la culpabilité ressentie pendant cette intermittence, parce que tu te sens bien dans ce nouvel environnement, ou parce que tu es en train de tisser des nouveaux liens, de semer des graines. La peine dans laquelle tu te trouvais est « oubliée » jusqu’au moment où tu reviens à la réalité. Personne ne te parlera de la blessure que la sodade laisse dans ton cœur. Personne ne te parlera de la blessure qui se crée lorsque tu rentres enfin « au pays » et que ton nouveau « chez toi » n’est plus dans le pays dans lequel tu te trouves. Les nouveaux repères que tu t’es créés semblent être une trahison. Ce sentiment se multiplie lorsque tu es de retour à ton point de départ et la seule chose que tu veux est de rentrer. Tu ne pleures plus parce que ta famille et tes ami.e.s sont loin, mais parce que ta famille adoptive, celle qui t’a accueilli.e, t’as permis de t’adapter et de créer ta nouvelle maison, n’est plus avec toi. Tu te sens comme un.e traître : ton cœur est divisé en
deux. Cependant tu as eu l’opportunité de rentrer ou retourner chez toi, ce qui n’est pas donné à tout le monde. Ce retour temporaire ou permanent qui devrait te rendre heureux.se - car c’était la seule chose que tu désirais depuis un long moment - n’a pas l’effet souhaité. Un nouveau vide se crée, un nouveau manque s’installe et la sodade se déplace. Tu te retrouves encore une fois seul.e, sans que personne ne comprenne ce que tu ressens. Car pourquoi devrais-tu être triste si tu as eu ce que tu voulais, c’est-à-dire retourner « chez toi » ? Mais ce n’est plus la même chose, ce n’est plus chez toi. Ta nouvelle « maison » a disparu ; tu te sens à nouveau déraciné.e et décalé.e. Tu le savais mais tu ne t’attendais pas à un tel choc parce que tes ami.e.s et ta famille ont continué leurs vies lorsque tu es parti.e, alors que pour toi, rien n’a changé, bien qu’en réalité tout ait changé.
Il y a différentes façons de venir en aide face à ce manque lorsque tu te retrouves dans cette « nouvelle » maison, jadis familière mais maintenant étrangère. Le partage de tes souvenirs, de tes ressentis, de tes envies. En d’autres mots, le partage de ce qui t’as modelé et permis que tu deviennes la personne qui est en transformation est ce qui te permettra de rester enraciné à la fois dans tes origines et tes nouvelles habitudes. Ce n’est pas parce que tu n’es plus là-bas que cela veut dire que tu dois tout oublier. La transition, cet entracte, est très importante pour que la sodade ne soit pas un poids, mais un réconfort.
Je ne te dirais pas ce qui se passe après cette entracte, car c’est à chacun.e d’apprendre à vivre avec ses deux identités et d’avoir le courage de les fusionner pour atteindre une meilleure version de soi, en plus, d’être capable d’accepter que rien ne sera comme avant. La seule chose que je peux te dire, c’est que ça va aller.
À l’automne 2022, durant la semaine de lecture, j’ai fait quelque chose qui en a étonné (et inquiété) plus d’un au sein de ma famille : un voyage solo, dont je vous fais, aujourd’hui, le récit.
Par Julianne Campeau, journaliste collaboratrice
Jour 1 : Arrivée à Toronto J’arrive à la gare Union en fin d’après-midi. Avant de me diriger vers mon hôtel, je me rends dans le hall d’entrée, qui serait, d’après ce que j’ai entendu, absolument magnifique. Finalement, il est assez beau, mais je crois que mes attentes étaient trop hautes. Je prends le métro, direction le Victoria’s Mansion’s Guest House, un hôtel pour les voyageurs à budget modeste. Ma chambre est peu décorée et fait à peu près la taille d’un (assez grand) placard à balais. Mais bon, ça a l’air propre, et le lit est très confortable. Ça va faire la job. Prochaine étape : le souper. Je me dirige vers une épicerie recommandée sur le site internet de l’hôtel. En me baladant dans les rues du centreville, je commence à me dire que j’aurais peut-être dû m’habiller un peu plus chic : tout le monde ici semble vêtu de linge qui coûte cher. Et moi, petite touriste québécoise qui ne voulait pas attirer les voleurs, je me promène en jeans et en chandail
de laine. J’ai laissé mon manteau à l’hôtel. Je trouve même qu’il fait chaud pour porter de la laine. Je ne pensais pas qu’il ferait cette température-là en novembre. À l’épicerie, je m’achète un repas tout préparé ainsi que des cupcakes au chocolat (ils avaient l’air trop bons). De retour à l’hôtel, j’appelle chez moi pour savoir si le plat d’aluminium dans lequel est servi mon repas peut aller dans le micro-ondes. La réponse est non. Je verse donc mon souper dans une des assiettes à ma disposition. Une fois mon repas chauffé, je m’installe sur le bureau. Je recrache la première bouchée. Le goût est infect. Je suis incapable d’avaler cette nourriture immonde. Je jette tout et vais directement au dessert. Étrangement, je n’ai faim que pour un seul des deux cupcakes dans la boîte. Je range le deuxième dans le petit frigo. Ce sera mon dessert pour un autre souper.
Jour 2 : Downtown Toronto
J’attends qu’il fasse clair avant de quitter l’hôtel. Pour déjeuner, je prends un café et un croissant dans un café à
deux minutes de marche du Victoria’s Mansion’s Guest House. Puisque le Royal Ontario Museum (ROM) n’ouvre qu’à 10h, j’en profite pour m’avancer dans mes lectures pour l’uni. Le ROM n’est qu’à quelques minutes de marche d’où je me trouve. Sa façade est quelque peu déroutante : comme si l’architecte n’avait pas su se décider entre un style plus traditionnel et un style plus… Comment dire? Flyé? J’imagine que ça a son charme. En ce qui concerne ma visite, je crois, comme on dit, qu’une image vaut mille mots.
C’est avec regret que je quitte le ROM. J’aurais bien aimé avoir le temps de visiter un plus grand nombre d’expositions, mais je dois manger avant de me rendre au Bata Shoe Museum, à 14h. Je dîne à la cafétéria du musée avant de filer vers le musée du soulier. Le Bata étant beaucoup moins grand que le ROM, je réussis à le visiter en entier en un après-midi.
Après ma visite fort intéressante au Bata Shoe Museum, je prends le métro, direction le marché St. Lawrence. C’est au moment de sortir de la ville souterraine que je réalise, soudain, l’importance de s’hydrater en voyage. J’ai tellement soif, j’ai l’impression que je vais m’évanouir. Heureusement, je repère une épicerie assez rapidement après avoir quitté le métro, où je m’empresse de demander à la caissière où se trouvent les bouteilles d’eau. Je reprends la route vers le marché St. Lawrence, supposément un incontournable de la Ville Reine. C’est là que je vais souper ce soir. Le bâtiment, de l’extérieur comme de l’intérieur, donne l’impression d’entrer dans un gigantesque entrepôt du XIXe siècle. Avant de choisir ce que je vais manger, je me mets en quête d’un présent à offrir à ma mère, qui fête son anniversaire ce même jour, ainsi qu’un souvenir pour moi. Je trouve finalement, et le cadeau et mon souvenir (un bracelet et une bague), dans une boutique vendant de l’artisanat tibétain, nommée Kailash. Il est maintenant l’heure de choisir ce que je vais
manger. Après avoir peut-être fait deux fois le tour du marché, j’opte finalement pour des sushis, puis me dépêche de rentrer à l’hôtel, avant qu’il ne fasse noir. De retour dans ma chambre, je mange le cupcake que j’ai laissé dans le frigo la veille.
Jour 3 : L’ouest de la ville
Dès qu’il fait clair, je me rends au même café qu’hier, où je mange le même déjeuner, et je me dirige vers la station de métro la plus proche. Aujourd’hui, je quitte le centre, direction l’ouest de la ville, pour visiter la Casa Loma : un manoir somptueux rêvé par Henry Pellatt, riche homme d’affaires qui y habitera avec sa femme pendant un certain temps, jusqu’à ce que des problèmes financiers ne le force à vendre son immense demeure. Je crois qu’il s’agit de l’activité qui m’a le plus fait tripper lors de ce voyage. Vous comprendrez peut-être, vous aussi, mon émerveillement.
Une fois que j’ai fait le tour de tous les recoins de ce gigantesque manoir, je dîne à la cafétéria, au sous-sol, puis je prends le métro, direction le Monkey’s Paw, une boutique de livres anciens. Bon, OK, en y repensant, je me dis qu’il aurait été plus intéressant d’aller au Museum of Contemporary Arts, mais, dans ma tête, il fallait que je me rende dans cette boutique qui allie deux de mes passions : la littérature et l’histoire. Au fond de la librairie se trouve le Bibliomat, sorte de machine distributrice de livres qui, pour 5$, choisit un livre pour toi. J’ai obtenu My Life with Women, de Richard Armour. Jamais entendu parler. J’achète également une vieille édition (début du XX e siècle) de



l'œuvre intégrale de Lord Byron, auteur que je n'ai encore jamais lu. Mon magasinage terminé, je me rends dans une pâtisserie non loin, qui m’a été recommandé par un guide de voyage. Je me commande un gâteau au chocolat avec du thé vert (à ma grande déception, il n’y avait plus de thé noir), puis je passe le reste de l’après-midi à avancer mes lectures pour mes cours. Éventuellement, il me faut retourner à l’hôtel pour y déposer mes achats, avant d’aller souper. Ce soir, je mange au restaurant Bumpkin’s, juste en face de l’hôtel, qui le recommande sur son site Internet. Le fait d’être cliente du Victoria’s Mansion’s Guest House me donne également droit à un léger rabais sur la nourriture. Aujourd'hui, je me gâte : après une entrée de champignons sautés dans du beurre à l’ail, je me délecte d’un plat de poulet cajun. J’aurais bien pris un dessert, mais, après le poulet, il n’y a malheureusement plus de place dans mon estomac. Pas de cupcake ce soir.
Je ne parlerai pas du lendemain, car il ne s’est rien passé d’intéressant. Je me suis rendue tôt à la gare, où j’ai déjeuné, puis lu, en attendant mon train. Cette courte escale à Toronto peut sembler anecdotique, un simple interlude dans ma vie, mais en ce qui me concerne, je crois que ce n’est qu’après ce voyage que j’ai pris réellement conscience que j’étais une adulte. En effet, cette escapade solo m’a permis de réaliser que j’étais désormais capable de me débrouiller sans qu’un « adulte responsable » regarde par-dessus mon épaule.











Cher.ères Béliers, pour commencer la journée du bon pied, quoi de mieux qu’une poutine déjeuner ? Patates au four assaisonnées, fromage en grains et trio de viandes audacieux – saucisses épicées, bacon croustillant et porc effiloché fondant – ou une option végée tout aussi savoureuse, le tout enduit d’une délicieuse sauce hollandaise. Vous vous réjouirez de trouver seulement des ingrédients locaux dans votre assiette. Ce plat est une dose d’énergie en concentré qui saura nourrir votre force intérieure, mais il est aussi une très bonne manière de voir qui peut en manger le plus. Soyons honnêtes, Béliers, vous ne reculez devant aucun défi, même celui d’une assiette bien remplie !
Après tout, pourquoi se contenter de l’ordinaire quand on peut viser l’extra ?

Lions - Boeuf Wellington
Cher.ères Lions,
Votre goût pour l’extraordinaire ne connaît pas de limites. Ne faites pas les choses à moitié et laissez-vous séduire par l’enrobage feuilleté et doré du Bœuf Wellington : son imposante et spectaculaire présentation ainsi que sa garniture riche en saveurs sauront combler votre appétit ainsi que votre tendance à vouloir en mettre plein la vue. Il y a là un plat d’exception qui incarne à merveilles votre charisme naturel, votre audace et votre personnalité flamboyante, quoique raffinée.
Sous vos apparences se cachent en fait une attention toute particulière aux détails et, surtout, un cœur des plus tendres. Vous brillez tous deux par votre panache, tout comme votre profondeur. L’occasion parfaite de partager un repas convivial, un brin théâtral et certainement mémorable avec votre entourage.

Cher.ères Sagittaires, cette semaine, les astres vous invitent à savourer la convivialité et la chaleur réconfortante d’une raclette. Épicurien.enne et curieux.se de nature, vous aimez essayer des choses étranges, même en cuisine. Pourquoi ne pas revisiter la raclette avec des influences du monde ? Essayez des fromages venus d’ailleurs, comme le gouda fumé ou le cheddar vieilli, et accompagnezles de charcuteries atypiques, comme du pastrami ou du chorizo ibérique. Votre table deviendra une véritable invitation au voyage! Enfin, n’oubliez pas de partager ce moment avec vos proches : la raclette est avant tout une expérience collective. Sous l’influence de Jupiter, votre générosité brillera, et vous serez le roi ou la reine de la soirée !

Taureaux - Pâté chinois
Steak, blé d’inde, patates, cher.ères Taureaux personne ne maîtrise cet ordre mieux que vous. Maïs en grains, maïs en crème, certain.es d’entre-vous ne seraient pas d’accord, mais c’est sans importance. Ce qui compte, c’est que ce plat réconfortant soit apprêté à votre manière. Pour briser la routine et ajouter un peu de piquant, vous pouvez même ajouter du paprika sur le dessus, du moins c’est ce que Ricardo conseille (et vous lui faites confiance). Le pâté chinois est un classique intemporel qui, même tout droit sorti du congélateur, saura satisfaire une tablée d’ami.es improvisée. Une fois dans l’assiette, chacun.e est maître de mélanger, garder étager, enduire de ketchup : la manière de le manger est propre à soi. Cependant, vous êtes strictes sur une chose : interdit de mettre de la mayonnaise!

Les Vierges, connues pour leur précision, leur amour du détail et leur préférence pour la simplicité, pourraient préférer un cocktail qui reflète ces qualités. Un mélange simple mais raffiné, le Gin Tonic est sûrement la meilleure façon de vous relaxer après une journée de travail d'analyse de données ou de comptabilité. Délicieux et rafraîchissant, tout en restant sobre et élégant, nous savons que vous n'abuserez pas d’alcool, car vous être connu.es pour votre prudence et votre capacité à maintenir un contrôle sur vous-mêmes, en plus d’accorder beaucoup d'importance à votre santé et à votre bien-être. Mais c’est le moment de relâcher un peu cet extérieur tiré à quatre épingles !

Capricornes, vous ne vous satisfaisez pas d’un repas simplement réconfortant, non, même le réconfort doit avoir un prix. Laissez-vous donc tenter par la confection d’une tarte au citron. Ce dessert est comme vous : complexe; on doit le faire partie par partie sans perdre de vue l’objectif ultime. Il est acide, mais cette acidité, une fois coupée avec le goût sucré de la meringue, devient fraîche tout comme vous, cher.ères Capricornes. Après vous avoir délicatement monté.es en neige, vous êtes irrésistibles.
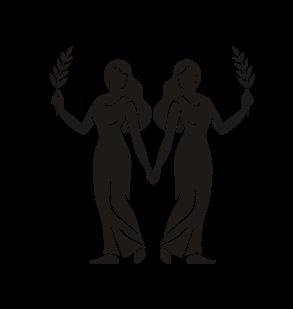
Même dans vos repas, vous réclamez haut et fort la liberté. Pour vous, le choix idéal se traduit par des tortillas de maïs, un mélange de sans viande et à votre disposition, une tonne de choix. Maïs, poivrons, oignons caramélisés, fromage, yogourt citronné, coriandre, tomates et sauces, plein de sauces. Salsa verde, sauces piquantes, guacamoles. Chaque nouveau tortilla que vous réchauffez dans une poêle de fonte deviendra un monde de possibles.

Vous avez besoin de fraîcheur, mais aussi de quelque chose de charnel à l'approche de la chaleur qui revient. Profitez-en pour vous installer sur votre terrasse, dans votre cour ou même au bord d'une fenêtre ouverte ensoleillée après vous avoir préparé deux vigoureux tartares. Gâtez-vous et allez vous chercher le meilleur saumon que votre argent peut vous acheter et de la bonne viande sauvage à couper en petits morceaux. Mélangez chacun d'eux avec un peu de moutarde de Dijon, de zeste de citron et de câpres, puis servez sur un croûton avec un peu d’huile d’olive. Un plat balancé mais aussi raffiné (comme vous).

Cher.ères Verseaux,
Votre esprit rebelle vous exige d’oser et d’oublier les classiques, car c’est en territoires inconnus que vous trouvez votre inspiration. Vous méritez un dessert à votre image : imprévisible, doux, puis intense. Ses saveurs inattendues, toutes en contraste, vous permettront non seulement de faire un doigt d’honneur à la routine et de vous sortir de l’engourdissement hivernal, mais aussi d’affirmer, par-delà vos airs parfois détachés, ce feu intérieur qui ne demande qu’à s’exprimer. Après tout, vous plier aux conventions n’est pas dans vos habitudes… Laissez la profonde amertume du chocolat noir et la braise ardente du piment d’Espelette embraser vos sens (et vos lèvres) : leurs éclats éveilleront les esprits et marqueront les palais, promesse d’un printemps incandescent. Voilà qui vous connait !
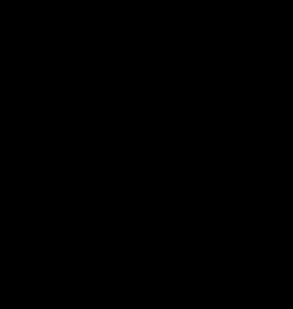
Les Cancers, réputé.es pour leur attachement aux traditions et leur sensibilité émotionnelle, trouveront les échos de ces traits dans la tarte au sucre, un dessert traditionnel québécois. Emblématique des rassemblements familiaux et des festivités, la tarte au sucre évoque le confort du foyer et les souvenirs partagés autour de la table. Ce dessert simple mais profondément satisfaisant reflète la nature des Cancers, qui chérissent les moments de convivialité et la chaleur des liens familiaux. Avec sa garniture riche et douce, coulant sur une pâte croustillante, chaque bouchée est une célébration des histoires familiales racontées par les Cancers mémorialistes, avec parfois plus de couleurs que dans la réalité. En dégustant une tarte au sucre, les Cancers peuvent se permettre un moment de nostalgie et d'émotion, renouant avec les traditions qui nourrissent leur esprit familial et leur besoin de réconfort.

Cher.ères Scorpions, si vous deviez être un dessert, ce serait clairement le mi-cuit au chocolat : intense, mystérieux.se et plein de surprises. Avec son extérieur moelleux et son cœur fondant qui se révèle à la première bouchée, il vous ressemble dans votre façon de cacher des trésors sous une apparence maîtrisée. Envie d’une twist audacieuse ? Ajoutez une pincée de piment pour un côté épicé ou un peu de fleur de sel pour relever le goût du chocolat (et impressionner tes potes).
Facile à préparer, ce dessert est parfait pour une soirée chill entre ami.es ou pour séduire quelqu’un avec votre talent culinaire. Quelques ingrédients, 10 minutes au four, et voilà un dessert qui fera sensation, tout comme vous. Alors, prêt.es à vous lancer ?

Poissons-Risottocrémeuxauxchampignonssauvages
Un plat réconfortant pour les quelques journées froides qu'il reste à votre printemps de douceur et de rêverie. Laissez-vous envoûter par un risotto crémeux aux champignons sauvages, où les arômes terreux de quelques chantrelles ou une poignée de porcinis se mêlent à la subtile vivacité de trois ou quatre pétoncles saisies dans une réduction de vin blanc, le tout abrillé d'un bon parmesan râpé finement. Ce plat plaira à votre goût pour la complexité tout en satisfaisant votre côté délicat. Ne vous reste plus qu'à savourer les derniers jours de pluie et la neige qui disparaît avant le début de la saison vive.





Par Camille Sainson, journaliste multiplateforme

L’aube de l’humanité. Un désert silencieux. Paisible. En bord-cadre, un squelette et un crâne. De manière symbolique, Stanley Kubrick place ici une Vanité, un memento mori, annonçant peut-être déjà le destin de son protagoniste : David Bowman. Allégorie du temps qui passe, nous entrons donc dans l’une des thématiques principales du film. Pour « boucler la boucle » de cette étude sur le temps, le réalisateur fait de la dernière scène de son film un apogée philosophique autant que métaphysique : Bowman se trouve dans une chambre au style Louis XVIII et vieillit petit à petit, à travers des ellipses invisibles, au sein d’un temps long, lent et silencieux. Lors de son ultime repas, il fait tomber son verre de vin rouge. Cette chute incarne l’achèvement de la vie humaine, de la civilisation. Une fois sur son lit de mort, alors que le monolithe surgit et se dresse face à l’astronaute, ce dernier pointe son index vers lui. Dans l’histoire de l’art, l’indexation signifie l’appel ou la reconnaissance d’une puissance sacrée. Le monolithe est le symbole d’une puissance supérieure, presque divine, qui donnera la mort, mais permettra également la résurrection. Le monolithe n’est plus ce qui apparaît ou s’enfouit dans l’attente d’une découverte, mais ce qui répond à un appel humain formulé à l’issue d’un parcours initiatique. Alors que dans la première partie du film, il a pour fonction d’introduire les préhominiens dans le temps en définissant un seuil temporel, dans la dernière partie, il fermera cette même porte du temps en annonçant la mort. La verticalité du monolithe fait de lui un monument, une porte sans cadre qui nous fait lever les yeux, dont la couleur noire semble renvoyer implicitement au phonogramme filmique encore
vierge. Il n’est plus uniquement un objet de contemplation, mais symbolise la puissance de l’art, en particulier celle du cinéma. Jean-Michel Bertrand le dit lui-même : « il y a dans 2001 une immanence du philosophique qui tient à la présence, dès l’incipit, d’idées relatives au temps, à l’espace, à la conscience, à l’homme comme être pour la mort (notamment). À quoi s’ajoute la réflexivité du film sur le cinéma, la sensation et le rapport esthétique au monde » (Bertrand, 2006). Kubrick use de la temporalité pour l’étirer, la condenser à sa guise, créant ainsi une chambre hors du temps logique, chambre mortuaire de Bowman, métaphore du cinéma en tant qu’unique art capable de jouer avec la durée. À la fin de 2001, le signifié et le signifiant ne font plus sens, l’émotion prime, les qualités sensibles de l’image nous saisissent, nous surprennent par leur nature et leur retentissement. Le monde est devenu un cinéma dans lequel Bowman est confronté à des situations optiques et sonores pures. Lors de la séquence finale, la caméra avance vers le monolithe, le noir envahit l’écran accompagné de la musique Ainsi parlait Zarathoustra . Nous retrouvons, tel un miroir, la scène initiale du film où le long noir nous faisait écouter patiemment le Requiem de Ligeti. Apparaît enfin un fœtus astral, naissance permise grâce à la mort de Bowman, naissance soulignant l’éternel recommencement, le début d’une nouvelle aube de l’humanité.
Références :
Jean-Michel Bertrand (2006), 2001 l’Odyssée de l’espace, La puissance de l’énigme, L’Harmattan
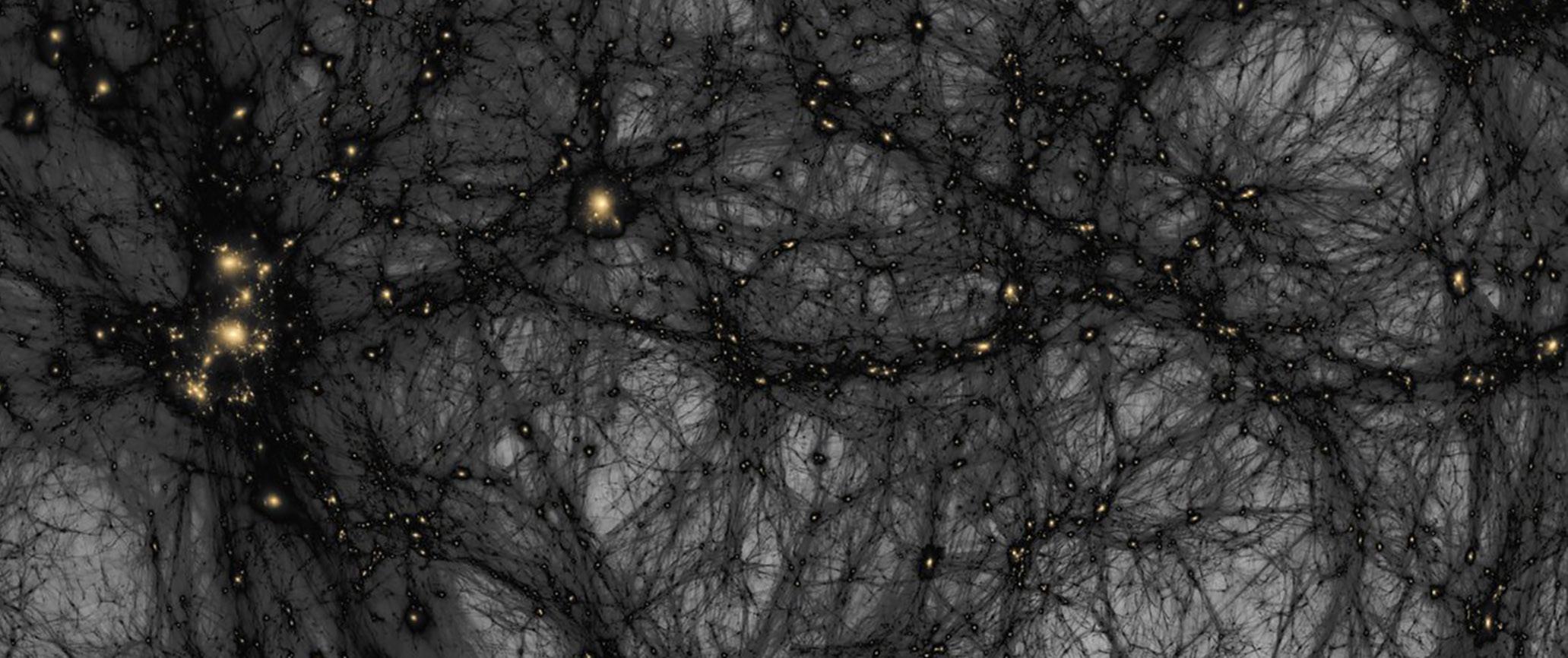
Par Léon Bodier, journaliste multiplateforme
1. Dunkle Materie
L'astronome suisse Fritz Zwicky a suggéré l'idée de matière noire dans les années 1930 en étudiant les amas de galaxies, et en observant que celles-ci ne pouvaient correspondre aux théories existantes basées uniquement sur la matière visible. Il a conclu qu’un autre élément devait exercer une force supplémentaire, qu'il a appelée dunkle Materie (matière noire en allemand).
En effet, la présence de matière noire permet d'expliquer de nombreux phénomènes observés à l'échelle cosmologique qui seraient autrement incompréhensibles avec les modèles basés uniquement sur la matière visible. Les halos de matière noire ont une masse beaucoup plus grande que la matière visible à l'intérieur des galaxies, permettant d’expliquer pourquoi les galaxies dans les amas se déplacent plus vite que ce que la gravité due à la matière visible pourrait provoquer. Ainsi, ils fournissent le puits de potentiel gravitationnel nécessaire pour capturer et maintenir la matière baryonique (gaz et étoiles) qui forme les galaxies visibles. Par ailleurs, les effets de la matière noire sont également observables dans les phénomènes de lentilles gravitationnelles où la lumière des objets
éloignés est courbée par la présence de matière noire , modifiant ainsi leur apparence.
La matière noire a agi comme une sorte de « squelette » pour la structure de l'univers à grande échelle, ou encore de « colle gravitationnelle » sur laquelle la matière ordinaire s'est accumulée et a formé des galaxies en stabilisant leurs interaction les unes avec les autres. Sans la présence de matière noire, les galaxies pourraient perdre plus facilement leur matière ou se disperser sous l'effet des interactions gravitationnelles avec d'autres galaxies. La matière noire elle-même n'émet ni n'absorbe de lumière, d'où son nom, ce qui la rend invisible et détectable uniquement à travers ses effets sur la matière visible. Bien que son rôle dans l’univers soit crucial pour l'évolution des structures cosmiques telles que nous les connaissons, la nature exacte de cet « interlude galactique » reste l'un des plus grands mystères de la physique et de l'astronomie.
2. Le chat de Schrödinger Tout comme la matière noire interagit avec la matière visible en étant invisible, il existe dans la connaissance humaine des zones d'ombre — des aspects de la réalité

que nous ne pouvons pas encore comprendre. Le chat de Schrödinger est une expérience de pensée conçue par le physicien Erwin Schrödinger en 1935 pour illustrer une des bizarreries de l’univers. L'expérience implique un chat hypothétique placé dans une boîte fermée avec un dispositif contenant un atome radioactif, un compteur Geiger, un flacon de poison et un marteau. Si l'atome se désintègre, le compteur Geiger détecte la radiation et déclenche le mécanisme qui libère le poison, tuant le chat. Si l'atome ne se désintègre pas, le chat reste en vie.
Selon les principes de la mécanique quantique, tant que la boîte n'est pas ouverte, l'état de l'atome (et donc le sort du chat) est considéré comme une superposition d'états; le chat est à la fois mort et vivant jusqu'à ce que quelqu'un observe l'un des deux états. Cette expérience de pensée n'est pas destinée à être réalisée pratiquement, mais plutôt à souligner les problèmes d'interprétation et les paradoxes apparents dans le contexte du monde que nous observons quotidiennement.
Sur le plan ontologique, la matière noire et l’expérience du chat de Schrödinger remettent en question notre compréhension de la « réalité », posant des interrogations sur ce que nous considérons comme « réel » dans un univers largement invisible. Et, si deux choses peuvent être vraies simultanément, à quel point notre expérience sensorielle du monde est-elle un guide fiable de la constitution totale de l'univers ?
3. Les mondes possibles
Pour le philosophe David Lewis, chaque possibilité imaginable correspond à un monde concret isolé des autres, aussi réel que notre « monde actuel », un terme
simplement utilisé comme référence indexicale qui varie selon le locuteur. Tout comme la matière noire structure l'univers sans être directement observable, les mondes possibles de Lewis existent objectivement et influencent la réalité de leur propre univers concret, même s'ils sont isolés du nôtre.
Umberto Eco, quant à lui, voit les textes comme des structures ouvertes qui génèrent diverses réalités. Dans son approche, « la fabula » – l'intrigue de base – est une série de scénarios alternatifs ouverts selon les actions, les événements et les choix narratifs. Les personnages sont vus comme des microcosmes de mondes possibles, chacun avec ses propres pensées et perspectives qui enrichissent la fabula principale. Le lecteur, à son tour, participe activement à cette création en interprétant et en imaginant des dimensions alternatives du texte, ce qui en fait un co-créateur du monde narratif. Le paradoxe du chat de Schrödinger illustre la superposition quantique où plusieurs états existent simultanément jusqu'à l'observation de l’un de ces états. C’est une idée qui résonne avec la notion d’Eco voulant que chaque récit soit une série de réalités potentielles existant en parallèle jusqu'à ce qu'une interprétation (du lecteur ou de l’auteur) les fixe.
L'intersection des théories de Lewis et Eco peut être vue comme un échange entre la métaphysique et la narratologie. Lewis fournit une base philosophique pour l'existence de mondes multiples en tant qu' entités concrètes et indépendantes, ce qui élève la discussion des mondes fictifs au-delà du simple cadre littéraire ou conceptuel. Eco, en utilisant cette base, montre comment les narrations, surtout dans le contexte postmoderne, ne se contentent pas de représenter un monde mais engendrent un éventail
de mondes interprétables, où chaque texte devient un lieu de rencontre pour ces divers univers possibles. C’est le concept que la série-télévisée Dark Matter sur Apple TV+ explore en neuf épisodes.
4. La série-télévisée Dark Matter (2024)
Créée par Blake Crouch d'après son propre roman, la sérietélévisée met en scène Jason Dessen, un homme qui a construit une machine, appelée « la boîte », fonctionnant sur le principe de la superposition quantique. Comme l’expérience du chat de Schrödinger, elle crée un environnement rempli de matière noire/invisible au sein duquel les différentes réalités possibles peuvent ainsi coexister simultanément, jusqu’à ce que l’observation de son utilisateur en fixe une en particulier.
Cette idée s'inspire donc également de la théorie des mondes multiples voulant que chaque décision crée une bifurcation, engendrant un univers alternatif où une autre possibilité est explorée. Au début de la série, Jason se retrouve dans un monde dans lequel il n'a jamais quitté sa carrière scientifique pour fonder une famille, ce qui le plonge dans une crise existentielle. Il découvre que d'autres versions de lui ont fait des choix différents, résultant en des vies radicalement différentes. Accompagné d'Amanda, une femme qui joue un rôle clé dans sa quête, Jason entreprend un voyage géographique et émotionnel à travers ces réalités alternatives dans lesquelles ils explorent
les répercussions de choix passés, sans imaginer qu’ils fassent présentement des décisions qui vont fracturer encore plus l’avenir.
Coincé dans l’interlude que représente la « boîte », David Lewis interpréterait ces multiples réalités comme des mondes coexistant simultanément, chacun avec sa propre concrétude et son histoire distincte. Les univers parallèles dans Dark Matter ne sont pas de simples variations ; ils sont présentés comme des possibilités pleinement formées et habitables. Umberto Eco, avec sa vision des textes comme des machines à générer des interprétations, verrait probablement l’interlude que représente la « boîte » comme une possibilité de percevoir, une démonstration de la capacité des récits à explorer et à développer de multiples réalités où le spectateur est invité à concevoir des possibilités au-delà de ce qui est montré explicitement. Surtout, la matière noire, le chat de Shrödinger et Dark Matter, nous amènent à réfléchir sur notre responsabilité envers l'inconnu. Dans notre quête de connaissance, jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour explorer et exploiter ces mystères de l'univers ?

Par Léon Bodier, journaliste multiplateforme
Définition d’interlude (nom masculin)
● Petit intermède dans un programme de radio, de télévision, de spectacle.
● Courte pièce musicale exécutée entre deux autres plus importantes.
● au figuré Épisode (entre deux périodes).
Les interludes, en tant que forme de divertissement distincte, ont une histoire riche qui traverse le temps et les médias, allant du théâtre traditionnel au cinéma et à la télévision moderne. En examinant comment ces pauses stratégiques ont enrichi la narration et influencé l'expérience spectatorielle à travers les époques, nous explorons notre relation changeante avec ces moments de transitions, essentiels pour tisser des liens émotionnels avec les œuvres qu’elles rythment.
Origine au 15e siècle
Les interludes théâtraux apparaissent en Europe avec le théâtre élisabéthain comme de courtes pièces dramatiques jouées lors de banquets ou entre les actes de pièces plus longues. Ils étaient structurés en une partie, avec peu de personnages, et composés essentiellement de discours souvent comiques, satiriques ou didactiques, servant à divertir ou à transmettre des messages moraux ou politiques. Le roi et les nobles employaient eux-mêmes de petits groupes d'acteurs, assez nombreux pour mettre en scène ce type de spectacle. Ainsi, Henri VII entretient une troupe de quatre acteurs, son fils, Henri VIII en a huit. La fille de ce dernier, Élisabeth 1ère, conserve les comédiens d'interludes de son père sans les remplacer.
16e et 17e siècle
Aux 16e et 17e siècles, les interludes étaient des éléments essentiels dans le théâtre anglais, évoluant des pièces de moralité médiévales pour devenir des divertissements intégrés aux grandes pièces de théâtre sous l'ère jacobéenne. Par exemple, William Shakespeare a fréquemment utilisé des interludes musicaux, des sketchs comiques ou des danses dans ses pièces, comme des
moyens d'enrichir le récit principal ou d'introduire un changement de ton ou d'atmosphère. Ces intermèdes permettaient aux dramaturges de jouer avec des formes théâtrales nouvelles et d'explorer des thèmes tangents à l'intrigue principale, offrant ainsi une profondeur supplémentaire. Bien que la plupart des interludes étaient des esquisses de nature non religieuse, certaines servaient de moyen pour commenter ou critiquer les normes et politiques de l'époque, et sont donc aujourd’hui classées comme des pièces de morale à l’instar de celles de John Heywood, l’un des plus célèbres écrivains d’interludes, The Play of the Wether (1533) and The Playe Called the Foure P.P. (c. 1544).
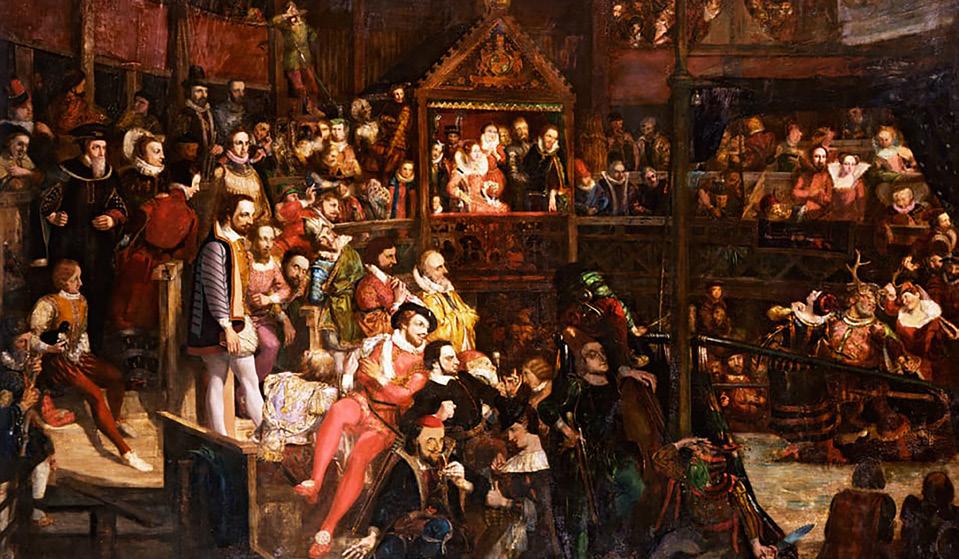
Au 18e siècle, les interludes à l'opéra et au ballet ont pris une importance particulière, marquant souvent une transition entre les actes ou servant d'éléments de divertissement à part entière. Dans l'opéra, ces intermèdes pouvaient inclure des arias (une pièce de musique écrite pour une voix seule dans un opéra), des récitatifs ou des ensembles musicaux qui permettaient de souligner des aspects thématiques ou de développer davantage le caractère des personnages. Ces passages musicaux offraient aux spectateurs un moment pour réfléchir aux événements de l'opéra ou simplement pour apprécier la musique sans l'intrigue principale en progression. Dans le ballet, les interludes fonctionnaient souvent comme des
pièces de danse qui pouvaient servir d’occasion pour montrer la coordination, la technique des danseurs, la créativité du chorégraphe et le génie créatif derrière la mise en scène. Un exemple marquant fut l’interlude dans Le Carnaval de Venise de Jean-Georges Noverre, qui arrivait à créer une atmosphère immersive par ses décors et costumes extravagants afin de transporter le public jusqu’à Venise.
Au 19e siècle, le vaudeville intègre fréquemment des interludes pour introduire une variété de performances artistiques, telles que des numéros de chant, de danse, de jonglage ou de magie. Ces segments étaient essentiels pour le format du vaudeville qui reposait sur une succession rapide de divers actes, ce qui offrait au public une expérience de divertissement constamment renouvelée. Le mélodrame, quant à lui, était caractérisé par ses expressions exagérées et son accent sur la tension émotionnelle. Ainsi, la musique jouait un rôle crucial en amplifiant l'atmosphère et en soulignant les moments clés de l'intrigue. Ces interludes pouvaient être des morceaux spécialement composés qui reflétaient le thème de la scène ou les émotions des personnages, servant à renforcer l'impact émotionnel du drame sur le public. Dans

The Bells (1871), les interludes musicaux utilisaient des motifs sonores récurrents pour amplifier l'angoisse du protagoniste, enrichissant ainsi la tension qui caractérise ce mélodrame. Dans East Lynne (1861), les interludes musicaux soulignent souvent les transitions de scène, les moments clés de l'intrigue, comme les révélations et les confrontations, aidant à maintenir l'engagement émotionnel du public. Le vaudeville The Passing Show (1894), lui, intégrait des interludes variés, des sketches comiques aux numéros de danse, pour maintenir une atmosphère légère et divertissante tout au long du spectacle. Les "Variety Shows" de Tony Pastor ou des frères Weber et Fields, quant à eux, juxtaposaient des interludes humoristiques et musicaux pour équilibrer l'énergie du spectacle et engager continuellement le public.
Début du 20e siècle
Avec l'avènement du cinéma muet, les interludes musicaux joués en direct par des orchestres locaux ou des organistes étaient essentiels pour accompagner les images et enrichir l'expérience émotionnelle des spectateur.rices, et jouissaient d’une certaine flexibilité et adaptation aux réactions de ces derniers. Ceux-ci guidaient le public à travers l'histoire, soulignant des transitions importantes ou des moments clés, et contribuaient à une meilleure compréhension des développements de l'intrigue sans paroles. Avec l'avancement de la technologie cinématographique, des systèmes comme le Vitaphone ont été développés dans les années 1920, permettant une synchronisation de la musique enregistrée avec le film, ce qui a marqué le début de la fin de l'ère du cinéma muet. L'avènement du cinéma parlant ("talkies") à la fin des années 1920 a transformé l'importance des interludes musicaux, mais l'ère du cinéma muet avait déjà établi la musique comme un élément fondamental de l'expérience cinématographique.
Au milieu du 20e siècle, les entractes musicaux au cinéma étaient utilisés dans les films de longue durée pour offrir une pause relaxante au public, permettant de se détendre et d'entamer une discussion sur ce qu’ils venaient de voir. À la télévision, les interludes tels que les tests patterns et les moments musicaux jouaient un rôle crucial dans la gestion des transitions et des imprévus techniques, fournissant une pause au public et maintenant l'engagement durant les temps d'arrêt. Par ailleurs, la première publicité apparaît aux États-Unis le 1er juillet 1941. Cet affichage pour les montres Bulova a été diffusé juste avant un match de baseball entre les Brooklyn Dodgers et les Philadelphia Phillies sur la chaîne WNBT (aujourd'hui connue sous le nom de WNBC), marquant le début officiel de la publicité

télévisée. Cette première, qui n’a finalement duré que 10 secondes, a coûté 9 dollars pour sa diffusion et consistait en une simple image d'une horloge accompagnée de la voix off, “America runs on Bulova time.” Ce moment a transformé la façon dont les produits étaient commercialisés et perçus par le grand public.
Fin 20e et début 21e siècle
Dans l'ère numérique, les interludes continuent d'évoluer avec les technologies, trouvant leur place dans les jeux vidéo, les vidéos en streaming, et même dans les expériences de réalité virtuelle, où ils peuvent offrir des pauses narratives, des expansions de l'univers ou des commentaires créatifs sur l'action principale adaptés aux habitudes de consommation numérique. Les séquences d'ouverture des série télévisées, comme celles de Game of Thrones (HBO, 2011-2019), sont devenues emblématiques, établissant le ton et le style visuel de l'œuvre. Les concerts, eux, utilisent des interludes musicaux lors des changements de mise en scène, tandis que les plateformes en ligne emploient des animations et vignettes pour séparer les segments de contenu. Les interludes interactifs dans l’épisode Bandersnatch de Black Mirror (Channel 4, 2011-présent) qui permettent aux spectateurs d'influencer le déroulement de l'histoire montrent l'adaptabilité et la diversité des formats médiatiques modernes, enrichissant l'expérience globale des consommateur.rices.
Les interludes ont évolué depuis les salons royaux privés jusqu’à devenir des battements perpétuels à toutes nos chaînes de consommation artistique publique. Parfois aussi agaçants qu’une pub sur YouTube ou aussi soulageants que l’entracte de The Brutalist (Corbet, 2024), ils font partie d’un quotidien qui n’a de cesse de se nourrir d’images et d’arts, servant surtout à nous rappeler de prendre une respiration…avant de passer à la suite.
Brooker, Charlie. "Bandersnatch." Black Mirror. Netflix, 2018. https://www.netflix.com/title/80988062.

Par Camille Sainson et Emmy Lapointe
LostHighway (1997)David Lynch
« La vie de Fred Madison, saxophoniste dépressif, est chamboulée lorsque de mystérieuses cassettes vidéo arrivent à son domicile. Sur la première, Fred et sa femme, Renee, peuvent contempler leur immeuble. Sur la deuxième, ils se voient en train de dormir. Quelqu'un les a donc filmés pendant leur sommeil. Avertie, la police confesse son impuissance et sa perplexité.»
2001 : L'Odyssée de l'espace (1968) - Stanley Kubrick
« À l'aube de l'Humanité, dans le désert africain, une tribu de primates subit les assauts répétés d'une bande rivale, qui lui dispute un point d'eau. La découverte d'un monolithe noir inspire au chef des singes assiégés un geste inédit et décisif.
En 2001, quatre millions d'années plus tard, un vaisseau spatial évolue en orbite lunaire au rythme langoureux du "Beau Danube Bleu". À son bord, le Dr. Heywood Floyd enquête secrètement sur la découverte d'un monolithe noir qui émet d'étranges signaux vers Jupiter.»

Memoria (2021) - Apichatpong Weerasethakul
« Une horticultrice écossaise spécialisée dans les orchidées rend visite à sa sœur malade, à Bogota en Colombie. Au cours de son séjour, elle se lie d'amitié avec une archéologue française, en charge du suivi d'un projet de construction, et avec un jeune musicien local. Chaque nuit, elle est dérangée par des détonations de plus en plus fortes qui l'empêchent de dormir…»





Melancholia (2011) - Lars Von Trier
« À l'occasion de leur mariage, Justine et Michael donnent une somptueuse réception dans la maison de la soeur de Justine et de son beaufrère.»
Wiplash (2014) - Damien Chazelle
« Andrew, 19 ans, rêve de devenir l’un des meilleurs batteurs de jazz de sa génération. Mais la concurrence est rude au conservatoire de Manhattan où il s’entraîne avec acharnement. Il a pour objectif d’intégrer le fleuron des orchestres dirigé par Terence Fletcher, professeur féroce et intraitable. Lorsque celui-ci le repère enfin, Andrew se lance, sous sa direction, dans la quête de l’excellence…»
The Tree of Life (2011) - Terrence Malick
« L'histoire d'une famille à Waco, au Texas, en 1956. Le fils aîné est témoin de la perte de l'innocence et se débat avec les enseignements contradictoires de ses parents. »

ThePerksofBeingaWallflower(2012) - Stephen Chbosky
« Deux lycéens de dernière année prennent un élève introverti de première année sous leur aile et lui font découvrir le monde réel. »
MaryandMax (2009) - Adam Elliot
« Une fillette australienne solitaire forge une amitié épistolaire avec un vieux garçon new-yorkais atteint du syndrome d'Asperger ».
LesÊtreschers(2015) - Anne Émond
« Sur une vingtaine d'années, les tourments d'un ébéniste du Bas St-Laurent et de sa famille, marqués par le suicide du patriarche. »
Emporte-moi (1999) - Léa Pool
« En 1963, dans un quartier populaire de Montréal, les difficiles expériences familiales et sentimentales d'une adolescente. »
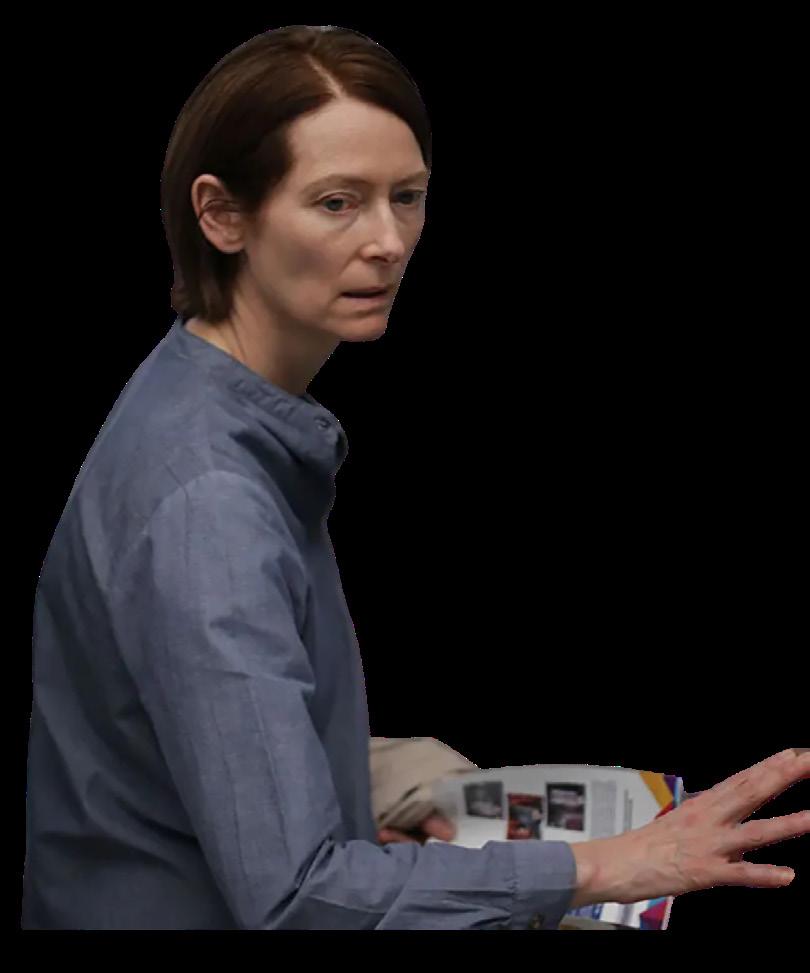





À ne pas manquer cette année sur les ondes de CHYZ 94,3 :
Écoute Local - lundi de 16h à 17h

La playlist hebdomadaire façonnée par Mémo Gauthier qui vous tient au courant des projets musicaux les plus éclectiques de la ville de Québec.
Conduite Antisportive - lundi de 14h à 15h et vendredi de 15h à 16h
Les lundis, l'équipe de CAS vous parle de toutes les actualités sportives universitaires. Les vendredis, on parle du sport sur le plan international.
Chéri.e, j'arrive ! - mardi au jeudi de 16h à 17h30
La mythique quotidienne culturelle du retour à la maison refait son apparition sur notre grille horaire. Rejoignez Noémie Fontaine pour ressentir le pouls culturel de la ville de Québec.
Les Arshitechs du son - lundi au vendredi de 17h30 à 18h30
Depuis 1997, les Arshitechs du son mettent de l'avant la musique Hip-Hop à l'échelle locale et internationale.
Le Deuxième Service du Ré-Show - samedi et dimanche de 11h à 12h
Pour tout connaître sur l'actualité locale et internationale, rejoignez Alex Baillargeon qui traite de chaque sujet de manière critique.
CHYZ 94,3 est le diffuseur officiel du Rouge et Or, des Remparts de Québec et des Capitales de Québec.
Visitez la grille horaire sur chyz.ca !
Journal d'un loup-garouLou-Adriane Cassidy


The Hornbook Gus Englehorn


Thunder Perfect Mind Motherhood


Nouveau langage N NAO
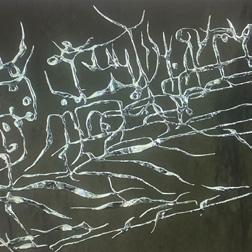
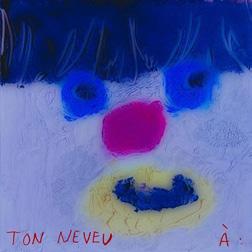
Dans l'abysse Thick Glasses


Hallucinogène
Delphine
Quand je pleure, je suis content Velours Velours
Because You Love Everything Marlaena Moore
À: Ton Neveu
Le Vide Original Gros Bonnet
Liminalité [n. f]
1. Du latin limen, seuil
2. Expression de l’entre-deux
Par Frédérik Dompierre-Beaulieu (elle), cheffe de pupitre aux arts



Tirant notamment ses sources des Backrooms , une websérie de Kane Pixels côtoyant les esthétiques du found footage et de l’horreur analogique – devenue peu de temps après un jeu dont l’élaboration des niveaux, participative, relève des multiples utilisateur.ices qui osent, à leurs risques et périls, s’y aventurer – , la liminalité telle qu’envisagée par les différentes sous-cultures d’Internet évoque souvent, bien avant son rapport à l’entre-deux ou au (rite de) passage, une réalité alternative, ou du moins altérée, sensée provoquer une sensation d’inconfort. En ce sens proche cousine de l’uncanny valley, cette liminalité quasi-numérique ne relève toutefois pas du simple design graphique ou alors d’univers sciences-fictionnels créés de toutes pièces, puisque renvoyant à des espaces bel et bien réels. Habituellement marquée par une esthétique minimaliste, amatrice, monochrome ou aux palettes de couleurs ternes ou atténuées (mais pas toujours), la liminalité, pour certain.es, se fait synonyme d’étrangeté : les lieux qui la portent et lui donnent forme sont pour la plupart re ou décontextualisés. Couloirs interminables, immeubles et bureaux vides, centres commerciaux abandonnés, paysages nocturnes, brumeux et enneigés, stationnements oubliés, motels vacants, aires de jeux désertées et négligées : s’il y là des lieux transitoires, tous semblent stériles, surtout dénudés de l’humanité qui les caractérisait jadis. La solitude ou l’isolation, l’absence y pèsent lourd. Malgré tout, l’impression d’une présence éthérée, insaisissable. S’en dégage une forme de quiétude, de mélancolie (kenopsia) puis d’inquiétude et de malaise ; les endroits sont en apparences familiers, mais les regards daignant s’y attarder auront tôt fait de remarquer qu’ils peuvent aussi être légèrement décalés, d’où leur nature incertaine, dérangeante, voire aliénante. Imaginons des chaises positionnées face aux murs ou à des endroits inusités, des escaliers ne menant nulle part, de fausses portes, des rues vous ramenant sans cesse au même point de départ, objets proportionnellement déformés, souvenons-nous des couloirs labyrinthiques de l’hôtel Overlook dont on peine encore, 45 ans plus tard, à faire sens.
Quelque chose de l’ordre de la distorsion, de la confusion et de l’ambivalence, de la curiosité, aussi. C’est une question d’atmosphère et de perspectives.
Par-delà ses allures cauchemardesques ou simplement inhabituelles, la liminalité peut simultanément convier un sentiment de réconfort, parce que nostalgique. Si toustes et chacun.es ne la ressentiront pas de la même manière ou au même moment, elle sait généralement convoquer des lieux communs et issus de l’imaginaire collectif en faisant notamment référence au passé, à l’enfance, par exemple. Alors que le vaporwave s’inspire principalement des années 1980 et 1990, tant sur le plan visuel qu’auditif – couleurs pastel et néons, iconographie des débuts de Microsoft ou d’univers vidéoludiques, statues grecques ou romaines, musique dont le tempo a été radicalement ralenti, récupération ou réappropriation d’éléments smooth jazz , synthétiseurs ou musique d’ascenseur –, beaucoup des montages vidéo ou des photos liminales partagées sur les réseaux sociaux et associées aux esthétiques nostalgia core ou kidcore ciblent spécifiquement des éléments thématiques issues de la culture pop, technologique ou consumériste des années

1990 et 2000. Là où la liminalité tend à paraître quelque peu sinistre, elle est parallèlement capable de se faire rassurante, douce ou plus gaie, se manifestant tantôt à travers les couleurs vives et éclatantes d’une innocence typiquement enfantine, enjouée et fantaisiste, tantôt par un réalisme quotidien, authentique, chaleureux ou maladroit tout droit sorti des photomatons, pellicules jetables et appareils photo compacts.
Il y a là des tendances qui risquent de toucher droit aux cœurs milléniaux.alles et génération Z, bien qu’il soit également possible d’être nostalgique d’un passé que nous n’avons-nousmêmes pas expérimenté (anémoia). Nostalgie douce-amère s’il en est une, puisqu’en occasionnant une romantisation d’un avant que l’on se remémore plus simple, la liminalité nous confronte à l’inéluctable finitude d’un temps dont il n’est maintenant possible de saisir que par simulation, en se prêtant au jeu du faire semblant, de part et d’autre d’une mémoire faillible et fragmentée.
« Les souvenirs d’enfance semblent flous et lointains, qualités qui les rendent comparables aux rêves. […] En ce sens, l’espace liminal peut être interprété comme faisant référence au seuil entre la mémoire et la réalité, ou entre la conscience et l’inconscience. » (Matter, 2024) (Traduction libre).
…autobus scolaires VHS et clubs vidéo télévisions cathodiques terrains de jeu Burger King anniversaires McDonald TM tapisseries et plafonds parsemés d’étoiles photoluminescentes manèges à la pièce au centre commercial catalogues de Noël piscines gonflables planches à roulettes et énormes parachutes dans les gymnases d’écoles primaires croquettes en forme de dinosaures peluches pâte à dents sucrée tapis de cinéma aux motifs de confettis Mr. Freeze en été lits superposés carrés de sable crayons de cire et feutres parfumés sirop à saveur de gomme balloune collection de gommes à effacer et d’autocollants manettes de jeux vidéo et téléphones transparents pantalons tachés de gazon bicyclettes décorées de billes multicolores et de froufrous métalliques bottins téléphoniques mixtapes et CD gravés jeux de boîtes de céréales forts en hiver habits de neige sous les déguisements d’Halloween jeux de pinball et solitaire sur l’ordinateur familial fausses caisses enregistreuses trois-skis coins-coins en papier journées pédagogiques portrait gâchés par le flash feux d’artifices et pétards WordArt tatouages temporaires vaisselle dépareillée flûtes à bec beiges commerces dont nous avons depuis longtemps perdu la trace…
Tour à tour sensible, tangible et hors d’atteinte, ne se savant plus ou songes ou rêves, elle ne laisse plus que les échos d’un agréable spleen, en clair-obscure puis son évitable évanouissement
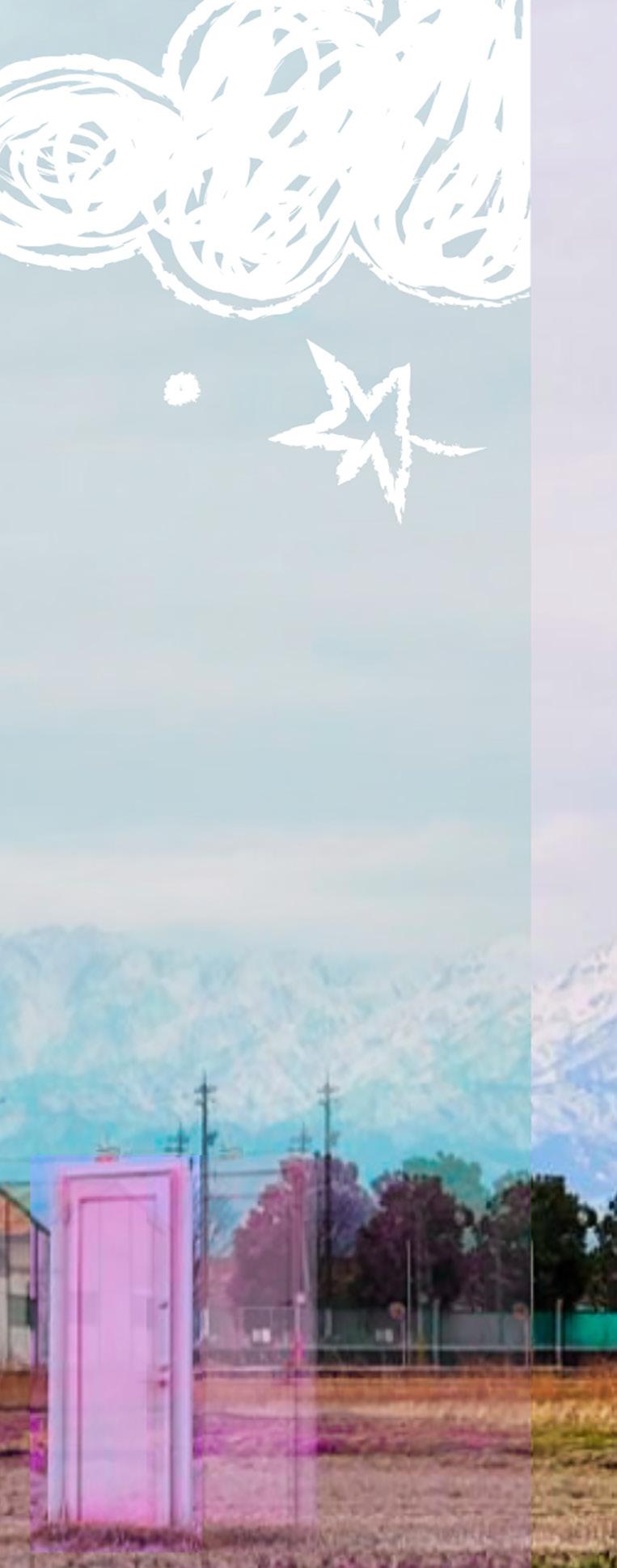
La liminalité est fondamentalement expérientielle, profondément subjective et introspective. On la ressent ; l’on ressent son
f l o t t
e m e n t
Esthétiques, sous-cultures et sous-genres ; la liminalité a de multiples visages. Et tout comme les couloirs, ascenseurs, stationnements, escaliers ou salles d’attente mille fois traversés n’ayant pour seule destinée que l’incessante ritournelle de nos allers et retours, elle est de nature transitoire, l’expression d’un entre-deux. Entre deux lieux, entre deux temps – les tempêtes ou l’heure bleue en sont de doux exemples –, plus encore entre deux états.
En nous dévoilant les limites, frontières et marges qu’il conviendra ainsi tout autant de franchir que de renégocier et de redéfinir, la liminalité nous expose d’un même temps à son incertitude, et plus sereinement, peut-être, à ses potentialités. Ni tout à fait hier, ni tout à fait demain, cet entre-deux, s’il engendre une destruction des repères ainsi qu’une forme de désorientation, est tout autant propice à la déambulation, à l’exploration, en d’autres mots, à l’introspection.
En plus d’être symbolique et visuelle, la liminalité, dont la myriade de représentations n’a certainement pas fini de susciter quelconque malaise ou apaisement chez ses spectateur.rices, est plus largement à envisager, émotionnellement voire métaphysiquement, en tant que phase. La relation qu’entretient le sujet à la liminalité n’est pas unidirectionnelle, comme si sa simple vue, d’images en images sur le web, suffisait à en rendre compte. L’on pourrait qualifier de liminaux les souterrains de l’Université Laval, que l’on pense aux lointains points de fuite qu’ils donnent à voir, à leur éclairage jaunâtre et plutôt sombre, à tous leurs recoins, casiers abandonnés et drôlement situés, à leur craques et fissures, à celui, étrange et en forme d’oeuf, que l’on nomme l’œsophage, au goût de l’isolement et de la vulnérabilité qu’ils laissent en bouche ou encore à certaines des fresques en décorant les murs, qui, il faut l’admettre, ont parfois de quoi faire frissonner. C’est peu dire, leur traversée peut s’avérer longue, périlleuse et solitaire, malgré les salutaires efforts de chauffage de l’université et les quelques téléphones rouges
d’urgence dont on ne sait plus s’ils sont le signe d’un futur secours ou d’une imminente tragédie...
Et l’atmosphère de l’hôtel Overlook dans The Shining aura sans aucun doute marqué les esprits tout comme le cinéma d’horreur – salle de bain lugubre toute de vert céladon, salles communes délaissées, meublées par le silence et ses échos, couloirs sans queue ni tête, tapisserie fleurie, blafarde et nauséeuse, moquettes tantôt fades, tantôt sombres, kitsch ou flamboyantes, bien qu’à tout coup angoissantes ou étouffantes. À l’exception qu’ici, la liminalité transcende, et de loin, l’inextricable épopée du petit Danny Torrance et de son fameux tricycle de plastique dans les méandres de l’hôtel. Celui-ci n’a plus la signification passagère que la période estivale, autrefois, a pu lui connaître, mais devient le lieu d’un séjour inhabituellement prolongé, n’accueille en son antre qu’un froid et une solitude hivernale que l’on tentera tant bien que mal d’apprivoiser. C’est en en franchissant le seuil que se floutent les frontières entre le monde ordinaire et le surnaturel, que s’effritent peu à peu les normes sociales et que s’affirment l’inconscient et la psyché des personnages. La liminalité se manifeste à travers les fantômes de l’Overlook, ceux de Jack, de par l’anticipation d’une folie que l’on sait déjà meurtrière.
Faire l’expérience de la liminalité en tant qu’espace dérégulé, en tant qu’entre-deux, spectre et phase, c’est réciproquement lui donner forme à partir de notre introspection et des préoccupations qui nous sont chères. Elle se fait miroir, nous amène forcément à nous y projeter : c’est par et grâce à cette subjectivité qu’elle parvient à tirer de sa force affective. La liminalité, sublime, change au fur et à mesure qu’on en fait l’expérience. Elle s’oppose à l’immobilisme et au passéisme, à condition de ne pas trop longtemps y rester, sans quoi ses traits risquent de toujours un peu plus s’apparenter à la monstruosité de l’ennui et de l’aliénation…

télescopage dans une nuit américaine la succession des lampadaires me tient éveillée
bercée par l’exigence d’un déplacement, errante je dérive derrière les fenêtres du train
dans l’écho d’une station-service, arbres fléchis et gares placardées le long des rails — si j’existe
en ce moment même, dans ce train, que faire de ma pensée sinon tendre à nouveau vers l’illusion du stable la rassurante immobilité
de ce qui tient encore debout — je suis constamment prise entre les deux
en soixante-dix heures je traverse un continent entier je vomis une seule fois — la turbulence du temps
me berce — caresses maladroites à la source de mon malaise
en cette cage, seul le mouvement me console : je rénove l’entre-deux
entre futur et passé, entre morte et vivante le présent est un sac trop lourd
une petite boîte percée où je miaule comme un chat disparu
la fenêtre ne retient rien mais l’horizon patiemment me transforme les avions défilent sur une ligne cassante en filaments la montagne se défait et j’oublie le ciel : un détail une petite croix blanche sous les érables
une clôture renversée au milieu du champ nu j’évite la nostalgie de ce que je laisse derrière
habillée de mon scaphandre — ni dehors ni dedans — je sors puis contourne
la chienne enterrée dans le terrain vague et je deviens le terrain vague
en mémoire du futur m’égare un instant

la noirceur arrive éventre ses bagages fauves dans ma charpente fragile un spectacle un muscle une remontée vers la beauté de ce qui flanche à la moindre bourrasque
(si la fin arrive où s’enfuit l’intérieur ?)
les trous noirs se reposent au fond de mon squelette quand je détourne le regard le vent passe au travers les oiseaux se réfugient à l’est du thorax ordonnent les travaux minutieux de la nuit
(l’envers de ma présence serait-il déjà le fantôme ?)
je soigne la noirceur et elle s’installe dans les recoins des pièces ou des yeux rêver, angoisser : un même ondoiement sur la clavicule large du matin
j’ai pensé à la souplesse du mot accalmie mais les profondeurs ne m’offrent aucun repos
dehors s’effrite, bientôt ce sera l’ondée peut-être la dernière neige
vivre n’a plus de provisions en cas d’effondrement
une partie de moi agite la main en dernier témoignage
par la fenêtre je me vois emprunter la ruelle et osciller
vers le gouffre sans nuit qui sauve les contours
en orbite je me suspends entre l’élan et la chute
cette chambre n’est pas ma chambre mais son réservoir
où tout prend feu tels les fragments d’une phrase longue et bûchée qui m’échappe, inatteignable à un étage sans seuil j’ai apporté ma solitude au bout de l’escalier — nuit ouverte — sans savoir son sens diagonal descente ou remontée vers la patience d’un bulbe un noyau rêche où je m’accorde le droit au brouillard
car il se peut que le réel simplement s’efface Scaphandre, Mélissa Labonté
Plus qu’une simple transition, l’espace et le temps liminal sont l’occasion d’une transformation, que les tendances mall core , after-hours , et dead mall illustrent à merveille lorsqu’elles multiplient les portraits de centres commerciaux en plein temps mort, du paisible silence des heures de fermeture à l’âpre ou chagrine désolation de leur abandon. Fût pourtant un temps où ces géants, symboles de promesses et d’excès, brandissaient fièrement la bannière du bon vieux rêve américain…

Étant enfant, mon père et moi avions une genre de tradition, certains soirs après la garderie, la semaine sur trois où il ne travaillait pas de nuit : une promenade dans les allées des jouets du Walmart. Sorte de pèlerinage, de moment hors du temps, une tranche de vie marquée par le calme, un ralentissement défiant le rythme effréné et machinal auquel se prêtait habituellement la traversée des commerces, où une commission n’attendait pas l’autre. Nous prenions notre temps, scrutions jeux, poupées et casse-têtes, blocs Lego multicolores et peluches en tout genre, écoutions toutes les musiques, dansions de concerts avec hamsters et cactus que l’on activait tous en même temps. Ma mémoire me joue sans doute des tours, mais mon père semblait s’amuser autant que moi, prenait plaisir à me voir rire lorsqu’on faisait dire des conneries au Furby ou qu’on gloussait à cause des coussins péteurs. Et en y repensant, c’était peutêtre une façon pour lui de garder son cœur d’enfant à travers mes yeux pétillants, celui d’un garçon qui avait lui aussi déjà rêvé en parcourant presque trop attentivement les pages du catalogue Sears de ses
petits doigts. Si nous n’y allions pas pour acheter quoi que ce soit, je ne peux m’empêcher de voir en ces moments attendrissants le sceau d’un capitalisme qu’on nous prédestinait à souhaiter et à chérir dès l’âge du biberon.
Et pareillement, mes quelques visites annuelles à Québec n’étaient réellement complètes qu’à une seule condition : une bonne vieille virée aux Galeries de la Capitale, à l’époque où le Simons se pavanait encore de ses cubes de verre turquoise, où je m’impatientais des séances d’essayage de ma mère qui me paraissaient alors interminables, où on en profitait pour se goinfrer outre mesure de Ashton ou de Tiki Ming, où on finissait toujours par croiser miraculeusement quelqu’un de notre petit coin de pays – le monde est petit ! – et où j’avais encore trop peur de m’aventurer dans le célèbre manège du train malgré mes presque 11 ans déjà.
En villes ou en régions, notre enfance ou notre adolescence étaient bercées par la même chanson, celle du centre d’achats comme d’une expérience banlieusarde sans égal, nous procurant cette impression de stabilité, où l’on sentait qu’on avait réussi dans la vie, lieu d’errances comme de dépenses où l’on pouvait tout accomplir en un après-midi, un condensé artificiel coloré bien sucré bien gras bien salé comme l’Amérique seule sait les faire. Un endroit où flâner entre ami.es et prendre des nouvelles du gazon des voisin.es. La socialisation à son meilleur, oui, celle du sordide consumérisme occidental et de ses heures de gloire. Ah ! Ce qu’il faisait bon placoter et tout flamber…

Certains malls sont peut-être toujours pleins à craquer les beaux samedis un jour de pluie, mais force est de constater que nous sommes malgré nous aux premières loges de leur déclin, où l’âge d’or de leur adolescence cède tranquillement sa place à une ère que l’on voudra crépusculaire.
Si la niche qu’est celle des dead malls ne cesse de gagner en popularité, ce n’est pas uniquement dû à un simple effet de mode comme il s’en fait à la douzaine toutes les semaines.
« La beauté de ces centres commerciaux morts réside dans le fait même qu’ils laissent derrière eux une relique du passé. Une grande partie de leur attrait vient des contradictions qu’ils représentent.
Marie-Gemma Brown, doctorante à l’Université du Queensland, le saisit parfaitement lorsqu’elle décrit l’attrait de la sous-culture des dead malls comme une "tension entre un désir nostalgique et une critique, entre le sentiment d’Histoire et celui d’avenir, et enfin entre le rêve et l’éveil." Les centres commerciaux morts sont fascinants parce qu’ils sont "réels" – un artefact vivant de ce qui, autrefois, avait de l’importance, était significatif. Brown qualifie ces centres commerciaux d’"utopies pétrifiées", ajoutant que "les vidéos et les images de dead malls contiennent les murmures fantomatiques des cultures consuméristes du passé – les traces spectrales de mondes oniriques depuis longtemps perdus. " À bien des égards, le dead mall est paradoxal ; il est d’abord un temple du consumérisme, et se transforme ensuite en sa propre antithèse. » (Sarju, 2025) (Traduction libre).
L’exemple du dead mall est ainsi tout sauf anecdotique ; en leur statut de ruines, effondrement des promesses de l’ère moderne et du néolibéralisme, réside en fait la quintessence même de la liminalité. Car tout comme les ruines, ces centres commerciaux, qu’il nous est depuis peu possible d’entrevoir sous un nouveau jour, nous informent quant au passage du temps, nous invitent à contempler les lignes brisées de notre
impermanence. Penser notre disparition et notre oubli à travers le vide et la chute des centres commerciaux peut être confrontant, même quelque peu désagréable. Et faire l’expérience de leur désertion nous rappelle que notre présence constituait leur seule et unique raison d’être. Leur mort n’est pas synonyme d’immobilisme, au contraire : elle représente un monde en changement, une déstabilisation. La nostalgie idyllique de ces temps révolus, tranquillement, laisse place à l’inquiétude, prend les airs d’une détresse existentielle. Mais les dead malls peuvent, paradoxalement, permettre d’apporter une forme d’apaisement et de réconfort à cette angoisse ou, par exemple, au sentiment d’écoanxiété, puisqu’en plus de mettre le doigt sur la transition à laquelle nous faisons face, ils sont aussi synonymes de quiétude et de ralentissement, ralentissement que la pandémie nous aura, à sa manière, fait désirer. À travers ses ambivalences et ses transformations, entre ce qui a été et ce qui sera, la liminalité nous surprend presque à rêver de notre propre disparition…
« [Pourtant, certains centres commerciaux continuent] de vendre du rêve. Il y a là une profonde ironie, et les paroles de Brown sonnent encore une fois d’autant plus vraies : "À une époque de futurs impossibles, nous devrions embrasser cette hantise. Se rappeler comment rêver collectivement, c’est commencer à relâcher et laisser tomber l’emprise du capitalisme sur la réalité." Se pourrait-il qu’au milieu du déclin de ce que représentait autrefois la culture des centres commerciaux, quelque chose de réel et rafraîchissant ait émergé ? » (Sarju, 2025) (Traduction libre).
Là où l’interlude tend à évoquer, à la manière de l’intermède, une mise en suspens, brève pause ou digression avant de terminer la tâche précédemment entreprise, pont entre un commencement et son achèvement, la liminalité me semble adopter un fonctionnement inverse. Elle se loge dans cet interstice, flottant entre deux parenthèses que l’on aurait presque trop naturellement positionnées dos à dos, n’ayant à leur suite qu’une ouverture…

sommes-nous bien inépuisables ?
sinon comment nous refaçonner ?
à la fois terrorisées et superbes sur la crête du réel abattu en repoussant les braises un peu plus jusqu’à bercer un grand feu sur les genoux
sommes-nous bien infinissables ?
qu’est-ce que la fin ? un besoin un besoin ?
Scaphandre, Mélissa Labonté


Références : Labonté, M. (2024). Scaphandre, Éditions du Noroît.
Matter, D. (2024, 14 novembre). Liminal Space in the 2020s. Trash Mag. https://www.trashmag.xyz/ online-pub/liminal-space-in-the-2020s
Sarju, R. (2025, 19 janvier). The dead mall: A different kind of purgatory. The Varsity . https:// thevarsity.ca/2025/01/19/the-dead-mall-a-differentkind-of-purgatory/
Par Rafael Forteza, journaliste collaborateur
San Fransisco Mazapa, 10 novembre 2024.
Les engrenages tournent. Les courroies transmettent. Une main tient fermement une pierre noire. Friction des scies rondes. L’atelier est plein de poussières d’idées. Le geste est fin. Mémoire d’un art vieux comme la pierre noire travaillée (un peu moins vieux quand même).
La obsidiana.
Découper. Tailler. Polir. La pierre gravite dans l’atelier comme un petit astre. D’un outil à un autre. Chacun accomplit sa tâche. Mouvement monotone qui dans la pierre noire rejoint les autres mouvements monotones. Pour que la pierre noire danse.
Un temps vague passe. Eloy me tend un petit ovale brillant. Le reflet du Soleil de midi le dévoile. Il est joli. Des couches multicolores marquent la peau de l’ovale.
La obsidiana arcoiris.
L’obsidienne est une pierre volcanique vitreuse. Elle se crée quand la lave touche l’eau.
Et refroidit rapidement. On la travaille depuis l’époque précolombienne. En Nahuatl, elle se nomme itztli. Le petit ovale brillant aurait pu être modelé avec une autre identité. Une lame. Une effigie. Un bijou. Cette matière donne corps aux besoins des humains. Un bout de


temps. Un bout d’idée. Un bout de savoir-faire. Un bout d’histoire. Qui repose dans la paume d’Eloy.
Je prends le petit ovale brillant. Eloy me dit de le garder dans ma poche. Il a une vertu protectrice. Merci. Je connais Eloy depuis une heure. Il a travaillé une pierre noire. Ses doigts ont manipulé cette pierre noire autour de scies rondes. Elle est devenue un petit ovale brillant. Pour me montrer la mémoire dans un geste. Pour me protéger.
J’ai regardé longtemps le petit ovale brillant sous le Soleil de midi. Ce petit bout rassemble beaucoup de choses. Je me dis. Sa texture est douce. Regarder un petit ovale brillant. Un peu comme écouter une jolie histoire au nous. Qui repose dans la paume d’une main.

Un entrepôt du Rancho a brûlé en juillet. Comme la forêt mésophile. Qui brûlait au même moment. Résultat des sécheresses prolongées.
Les Olveira et leurs voisins ont passé une semaine dans la forêt mésophile. En juillet. Pour limiter la progression des feux.

Huahuaxtla. Mexique. Novembre 2024
La Sierra Norte . Demeure de la forêt mésophile. Une communauté végétale. Unique. Riche. Humide. Avec ses milles ruisseaux qui la traverse. Source d’eau pour les communautés humaines voisines.
Une communauté végétale menacée. Aussi. En proie aux feux de forêt. Résultat des sécheresses prolongées. Effet des changements climatiques. Qui affectent la Sierra Norte.
Les Olveira. Une coopérative familiale de trois générations. Propriétaires d’un Rancho. Et de vingt vaches. Établis dans le creux d’une vallée de la Sierra Norte

En novembre. Les Olveira me présentent différentes essences de chênes de la forêt mésophile. Que nous replantons jour après jour. Dans les bouts de forêts brûlées. En juillet.
La résilience. C’est le sourire des Olveira. Qui replantent la forêt mésophile. Leur voisine. Pour prendre soin d’elle. À leur mesure. Comme elle l’a toujours fait pour eux. En emmagasinant l’eau. En leur acheminant. Une communauté du vivant. Unie dans une épreuve commune.
Merci à Village Monde et la RITA pour leur soutien dans cette aventure.

Par Émilien Côté, Journaliste collaborateur
Deux amis se rejoignent après leur cours au troisième étage du pavillon De Koninck, et discutent de leurs vies personnelles. C’est un mardi soir, il n’y a pas beaucoup de monde. La conversation arrive soudainement sur un sujet étrange.
Félix : Il faut que je te parle de ce qui m’est arrivé dimanche après-midi. C’est un peu bizarre… Je me promenais seul sur un sentier au parc du Mont-Bélair. Le temps était doux et il neigeait un peu. J’étais absorbé dans mes pensées, puis tout d’un coup, le soleil est sorti des nuages. Je me suis arrêté pour voir à quel point le boisé était magnifique, mais en regardant les arbres, la neige et la lumière, je n’ai rien senti…
J’aurais dû trouver une quelconque beauté dans le paysage, mais tout me paraissait… gris. Affreusement terne et sans vie. Une espèce de panique s’est mise à monter dans mon ventre et m’a submergé. Je me suis dit : « Je suis en train de passer à côté de ma vie et je ne m’en rends même pas compte ! ».
Olivier : TU ES EN TRAIN DE PASSER À CÔTÉ DE TA VIE ET TU NE T’EN RENDS MÊME PAS COMPTE ? Qu’estce qui est arrivé après ?
Félix : En fait, j’ai réalisé que si je ne faisais rien, toute ma vie passerait et que la mort viendrait me chercher sans que je sois arrivé à me sortir de cette impression de vide, de désespoir. J’aurais manqué le plus essentiel. Ensuite, la panique s’en est allée et les pensées habituelles sont revenues. J’ai sorti mon téléphone et je suis allé sur Instagram. Mais honnêtement, je me sens encore mal aujourd’hui.
Olivier : J’ai vécu plusieurs expériences de ce genre-là moi aussi. Comme toi, j’avais le vague pressentiment que quelque chose n’allait pas, sans pour autant pouvoir mettre le doigt dessus. Je ne peux pas le prouver, mais il me semble que la majorité de l’humanité est prise dans le même malaise, la même inquiétude.
Félix : C’est une sorte de voile d’obscurité, une lourdeur, un fardeau. Quand je suis dans mes cours ou dans l’autobus, il y a souvent ce parfum d’ennui, mêlé d’agitation ou de dégoût. Je crois que c’est la même chose que mon indifférence de l’autre jour, le même malheur. J’ai tout le confort du monde et pourtant je me sens misérable !
Olivier : Mais j’ai trouvé comment remédier à cette léthargie.
Félix : Sérieusement ?
Olivier : Attends, on est dans une situation particulière ! On vient de voir quelque chose d’énorme, une maladie collective qui nous ronge en silence. Que faire ? Quel est le virus ? Qui est responsable ?
Félix : À vrai dire, je suis trop distrait, toujours la tête ailleurs, jamais ici et maintenant. C’est pour ça que je ne voyais pas la beauté des arbres.
Olivier : Donc c’est la pensée qui est responsable. On l’a prise en flagrant délit, la voilà coincée !
Félix : Mon Dieu, je n’en ai aucune idée… Je pense continuellement sans pouvoir m’en empêcher, et j’ai l’impression d’être poussé par une tendance invincible à fuir le calme, sans être capable de rester immobile. Mon attention est poussée, tiraillée dans la confusion.
Olivier : Autrement dit, la première étape est d’éviter toute forme de fuite, d’évitement de soi-même. Ça veut dire qu’il faut arrêter de se réfugier dans le divertissement de masse, cette plaie qui nous transforme en automates serviles. Face à la noirceur de mon esprit, je suis seul. Je dois être complètement honnête et voir que ma distraction est la source de cette noirceur.
Félix : Mais comment peut-on tenir debout par soi-même ? Sans aucun appui intérieur, on sera pris par le vertige, par un sentiment d’urgence insupportable.
Olivier : On arrive au point de bascule. L’attention doit être totale, sans jugement. En ce moment, une pensée émerge à mon insu. Je dois la regarder droit dans les yeux, ne pas la perdre de vue une seule seconde, rester alerte. Suivre son mouvement sans y prendre part. Ainsi, je cesse d’alimenter mon émotion négative ; je la tue dans l’œuf.
Félix : Qu’est-ce qui se passe ensuite ?
Olivier : Je ne peux pas vraiment te le décrire en mots. C’est comme de se réveiller après un long rêve. Il y a une sensation de pure présence, de pure conscience, dont la lumière dissout toute la souffrance que tu as vécue et que tu ne vivras jamais. C’est dans cette sensation que se trouve la beauté perdue dont les arbres enneigés ne sont qu’un reflet.
Félix : Ça semble vraiment difficile de faire le geste intérieur dont tu parles. Est-on en droit de l’exiger de tout le monde ?
Olivier : La chose en tant que telle est très simple. Le plus difficile, c’est d’en voir l’absolue nécessité. J’ai pu t’en parler parce que tu as pris conscience de ton mal-être, mais si j’en parle à une autre personne et qu’elle me dit « Non, je ne vois pas de quoi tu parles », alors je ne peux rien faire. Il ne suffit pas d’en rester au niveau des mots. Le plus important, c’est de voir si en toi, il y a effectivement un démon qui te possède. Et si c’est le cas, sache que cette créature part en fumée lorsque ton attention la dévoile en plein jour.
Par Camille Baril (la « signature » : trace de l’esclave...)
Sssssss…. Fait celui qui rampe le sol et habite les bas-fonds de la Terre, au plus creux des eaux, des forêts et des rochers. Sssssss…. il se glisse, s’insinue, s’insère, siffle, signifie, s’infiltre, et s’enlace dans le sens tangible* et concret* de sa sensualité enracinée sur Terre. Sssssss… trait d’union entre végétal et animal, son frottement érotise le sol, ses pleins touchers et son charme fluide tisse les motifs incommensurables de l’affect et du désir. Sssssss… bruissement du sens de la matière sombre qui se déploie et circule entre les bouches de la Terre et de la Mère. Sssssss… sifflement mythique de l’animalité, vibration de la chaire sensible, aimantée et frottée. Sssssss… chant du foyer de l’éros et de la fusion des corps qui se disent avant la langue. Sssssss…parole sinueuse et poétique des interstices, des repères et des plis. Sssssss… le son l’inarticulé de la « poésie mondaine » nous portant dans le mystère du devenir. Sssssss… rêve, chôra, devenir, écoumène, fractale… Sssssss… Chaos, Gaïa, Éros, Serpent, habiter, oeuvre humaine... Sssssss…
Gaïa minoenne avec Serpents (-1600 av. ère)
Avec son sens sinueux, Serpent file et se faufile sur l’horizon Terre-ciel. Il habite la Terre, des fonds marins jusqu’aux confins des cavernes de Gaïa, Nuna, Pachamama, Asase Ya, Terre-mère... Entre désir, sentiments et pensées, Serpent est un symbole des nerfs sensationnels de l’animalité et de leur incarnation dans les plis des gestuelles. Symbole de fertilité et fécondité archétypale émergeant avec Sapiens, Serpent est intimement lié à la matrice du « don originaire » qui « engendre des mondes ». Les forces antagonistes et complémentaires en Serpent, entre guérison et poison, font de lui un porteur de « don » pour l’humanité. Il porte une « pharmakon », une médecine, soit un horizon mondain vers la guérison des maux et des symptômes. Selon Gaston Bachelard, nos bras, nos jambes et nos intestins ont des réalités reptiliennes, digestives... En outre, les enjeux alimentaires sont mythiques, ils révèlent « notre monde » et son sacré, relativement aux touchers, aux passages, à l’apprenance et à la sagesse. Nous sommes tous en relation avec des « reptiles intérieurs » qui nous prédiquent dans un sens. Serpent, cet être liant désormais menacé d’extinction, change incessamment de peau pour survivre. Profondément phénoménal, il se transmute laissant derrière lui son ancienne peau gisant au sol, trace de sa révolution et de son grand état de vulnérabilité. Serpent à sonnette garde toujours des traces de son passé au bout de sa queue, un lieu primordial permettant son mouvement et son sifflement. Serpent symbolise les corps en renouvellement, la cyclicité, la renaissance, l’élévation, la sagesse et la connexion à la Terre. Serpent relie Corps-esprit : il parle la langue de la Terre, il signale et notre manière de s’y lier est significative.
Pharmakon d’Asclépios, fils d’Apollon

*Tangible, de tango : « toucher »
*Concret, de concrescere : « grandir ensemble »
*Autorité, de auctoritas: « pouvoir du don »
Dans les mythes démocratiques fondant notre cosmos mécaniciste et urbain, Serpent devient « le monstre de Gaïa ». Serpent et Gaïa sont perçus comme problématiques et se font progressivement domestiquer voire éliminer par les Parèdres. La mythologie grecque évincera le sens originaire de la « logique du don » de Terre-mère, car Zeus maintient toute l’Autorité*. Apollon, fils de Zeus, tue le Python mythique de Delphes faisant gémir simultanément « tous les serpents du monde ». Il y installe son sanctuaire et se proclame Oracle (prédicateur) panhellénique. Pour « calmer les foudres de Gaïa », Apollon instaure alors les « Jeux pythiques » aux 4 ans, soit les Jeux olympiques. Non merci !? Il devient la voix cachée du « nombril du monde » hellénique, harmonisant en creux l’émergence de l’univers symboliques des « Cités-États » et des familles, dont Oedipe. Les cités prédiquées par la fractale apollinienne donnent naissance au fameux « miracle grec » (!) L’écoumène démocratique qui émerge opère une série de réductions géométriques, mathématiques et idéologiques pour appréhender la réalité et participe d’une fracture sensible incommensurable ; vraisemblablement un symptôme post-traumatique du Parèdre-Incesteur-Prédateur mythique à l’Occident depuis Ouranos
Apollon tuant Python
et Cronos. Émerge alors les conseils d’administration, le droit, l’écriture, la démocratie, le gouvernement, les théâtres, les gyms, la philosophie, la science, la médecine clientéliste, la pédophilie institutionnalisée et les guerres de domination territo- riales ; interdits, tabous, inconscients, vides, déchets humains… À l’époque des philosophes antiques, les femmes sont dominées et la civilisation entière est prédiquée par une « logique de l’identité du sujet universel ». Dans l’Antiquité, Terre et Mère sont exploitées ; l’esclavage, la pédophilie et la prostitution sont institués. Les citoyens et philosophes pris dans leur vérité du logos, argumentative et autoréférencée n’arrivent plus à considérer l’humanité de ce qui est « Autre ». Athéna, « ancêtre » de Marie, divinité de la fertilité et de la sagesse, sortie de la tête de Zeus, est prédiquée dans la virginité : les liens homme-femme sont problématiques. Les Athéniennes de l’Antiquité revivent cycliquement les funérailles d’Athéna et sont en souffrance. Méduse, Cassandre et les athéniennes lui vouent un amour indéfectible. Poséidon violera Méduse pour se venger d’Athéna et Apollon crachera dans la bouche de Cassandre pour qu’elle ne soit jamais crue ; toutes deux subiront le sacrifice du bouc émissaire. Méduse sera ostracisée en tant que « sale gorgone » puis achevée par Persée, un autre « héro » au coeur des violences fondatrices. Avec le monothéisme, Serpent motive Ève à croquer la pomme : sur eux deux incombent la « honte » du « péché originel » de l’humanité sur Terre. Dans les discours, Serpent devient associé au poison, à la violence, au danger à tenir loin... Une pure monologie patriarcale : le Parèdre n’aime pas les sifflements de Serpent à l’oreille de Femme et nous avons désappris à écouter ses signaux.
Méduse, prêtresse de Athéna, violée par vengeance, sidérée et « pétrifiante » pour l’homme
Ouroboros : mort de la vie et vie de la mort
Cher Serpent,
Aujourd’hui, l’Ouroboros est porteur pour symboliser notre écoumène, avec bien sûr le fameux Wendigo... Dans un contexte capitaliste où presque tous les liens sont médiés par le vide (argent, droit, fonctionnalité, utilité, désir de jouir…), Serpent est totalement replié sur lui-même. Homoérotique, autodévorateur et invivable, Serpent est déterrestré. Il a perdu sa Mère, se mange dès lors la queue à perpétuité et anéantit ses signes existentiels pour le devenir. Serpent ne s’élève plus entre Terre-ciel mais se perd dans sa trajection autoréférentielle. Il n’échange plus qu’avec lui-même et ne porte plus les messages de la digestion des touchers sur Terre. Sujet Universel, l’Ouroboros évoque une trajection aliénante de l’humanité avec l’émergence de tout un système d’abus mécanisé. Dans l’interstice abyssal du dualisme, entre philosophie-géographie, privé-public, émotion-raison, nature-culture, homme-femme, sujet-objet… la machine administrative tient loin des consciences l’essence symbolique des choses avec son horizon relationnel fracturé. Les phénomènes de violences sexistes renvoient à des temps mythiques qui outrepassent tout régime de vérité logique.
Pour ton anniversaire lunaire, que ton gémissement se transmute en musique, que ta sidération se transforme danse et que ta poïétique sensible ramène les Ouroboros à leur Mère-Don originaire.
Que cette année soit mésologique, trajective, fractale et révolutionnaire. Que les consciences s’éveillent aux sens de tes plis existentiels. Que pour ta Lune, tous y laissent leur peau et leur trace...
Bonne renaissance !
Bien que la parole mythique de Gaïa et Serpent soit coupée par l’« arrêt sur ob-jet » qui « re-présente » et « projete » la réalité tragique d’un univers sans monde, tous les corps portent en eux la mémoire des violences au fondement de notre écoumène, ainsi que la mémoire de l’amour de la Terre présent dans les coeurs autochtones. Les corps parlent et n’oublient rien.
Pour continuer la déconstruction de l’univers symbolique constituant notre cosmos mondain et pour en apprendre sur la « mésologie », la science révolutionnaire de la poésie humaine sur Terre, procurez-vous gratuitement le prochain numéro d’Aspects sociologiques « Les chroniques du capital ». Ça sort le 20 mars à 19h00 au Café Fou Aeliés, soyez-y !

Par Camille Sainson, journaliste multiplateforme
Déambulation. n. f.
Du latin deambulatio « promenade » Action d’aller au hasard, se promener sans but. L’écho de mes pas déambule dans la nuit.
22h06
Le ventilateur suspendu au plafond répand une brise agréable sur mes épaules. J’avale une énième gorgée d’IPA et repose fermement la chope sur le comptoir en bois. Le serveur s’en empare, actionne la pompe, laisse couler le flot ambré avant de replacer le verre devant moi. Je le vide sans autre pensée que les arômes d’orge et de citron qui envahissent ma bouche. Final Resting Place. 7.5%. Je ne titube pas encore.
23h37
Les copains, Jerry et Michael, pénètrent dans le bar. Ils s’empressent de venir me saluer et commandent trois bières à emporter. On substitue ma choppe en verre pour un gobelet en plastique. La soirée peut commencer. Dans la rue, la chaleur nocturne s’accroche à ma peau, les néons éblouissent mes pupilles, la musique sature mes tympans. Cacophonie ambiante, tous les bars ont ouvert leurs portes et fenêtres pour faire danser la nuit. On passe à côté du Gateway et du Old Absinthe House. J’esquive un groupe de touristes, perds de vue Jerry pendant un court instant, allonge mes enjambées, ma bière tangue dans le verre, un peu de mousse s’en échappe, macule mon tee-shirt, je relève les yeux, Michael attrape mon bras, on s’arrête.
Le Booze étire sa façade blanche au-dessus de nos têtes.
00h12
La salle est pleine à craquer. Je peine à me frayer un chemin. À force de coups de coudes et d’excuses, j’agrippe enfin le comptoir. Le barman me demande une carte d’identité. Je la tends sans me reconnaître. Paul Grim. Vingt-neuf ans. Un mètre quatre-vingt-quatre. Photo en noir et blanc. Signature d’il y a dix ans.

On s’installe dans la cour avec nos pintes de blonde. Aucune étoile dans le ciel, que des lumières artificielles. Des musiciens en fonte composent une large fontaine. L’eau sort des trompettes, des guitares et du piano, coule en un flot ininterrompu, musique qui se contemple plus qu’elle ne s’écoute. Michael laisse vagabonder son regard sur l’écume stagnante à la surface, vague blanchâtre comme celle qui lèche la coque de notre chalutier. Ses mains calleuses réchauffent son verre. Dernière nuit avant d’embarquer. Avant d’enrouler les câbles d’acier, cordages, lests et flotteurs,
de préparer les cages, de s’assurer que le filet n’est pas déchiré, le tout sous un soleil accablant.
1h03
Jerry entend sa chanson, il se rue à l’intérieur et laisse le courant d’inconnus emporter son corps. On suit son impulsion. Les pièces se succèdent, labyrinthe hypnotique, les lumières nous guident. Sueur. Alcool. Musc. Femmes en talons hauts. Éclairs de soie et de coton. Tissus, odeurs, chevelures, enchevêtrement de chairs Obscurité audacieuse. La gêne se noie dans la liqueur. Michael s’accoude au bar.
Une main étrangère glisse dans la mienne. M’entraîne sur la piste.
Pied gauche légèrement en arrière, pied droit sur place.
Son sourire éclipse le défilement des heures.
Un, deux.Le beat de la musique est notre métronome. Le poids de mon corps passe d’une jambe à l’autre. Elle se déhanche avec assurance. Chassé vers la gauche. Trois, quatre. Chassé vers la droite. Cinq, six. Je danse au milieu de la piste, mes yeux perdus dans les siens.
1h46
J’embrasse une inconnue. Lèvres rouges. Haleine alcoolisée. Peau collée à la mienne. Sueur endiablée. On partage une cigarette sur le balcon du troisième étage. La rue s’étire un peu plus bas, file vers la rivière. Je me cramponne à la rambarde en fer pour ne pas tomber. Jazz. Blues. Disco. Champ magnétique qui vibre dans mes veines. Bulles de houblon dans ma tête.
Les lendemains n’existent plus.
Michael et Jerry viennent me chercher, on doit continuer à avancer. Profiter de cette dernière soirée en ville.
2h01
J’emprunte l’escalier, vole sur les marches comme dans un rêve éveillé. Deuxième étage. Ambiance collée serrée. Trombinoscope. Blanc. Noir. Blanc. Noir. Jour. Nuit. Mémoire. Oubli.
Mes jambes avancent au ralenti. Couloir puis escalier. Toujours plus de marches. Des gens montent, d’autres descendent, chorégraphie de somnambules.
Premier étage. Bars, pistes de danse, tapisserie tropicale.Les doubles portes béantes s’ouvrent sur la rue, invitent les curieux à en franchir le seuil, nous poussent à explorer d’autres lieux.
2h34
Moiteur extérieure. Des gouttes suintent le long de mon dos.
Les gars rigolent, se charrient, on tourbillonne. Je titube, pas de danse, déhanché sur le côté, marche en arrière, le tempo des guitares et des pianos me guide. Chaleur au creux de mon ventre. Sens désinhibés.
J’oublie la réalité.
Tous les balcons sont bondés, il pleut des colliers de perles. Verts. Rouges. Bleus. J’en enfile un. Plus que deux clopes dans mon paquet. Mon pouce sur la molette du briquet. Flamme, combustion, inspiration. La fumée s’accroche à mes pas.
Daiquiri. Jester. The Swamp.Les clubs se multiplient. Les pavés aussi.
Je commande un Sazerac au Prohibition. Quelques pièces sur le bois du comptoir, whisky, absinthe et bitters coulent dans mon estomac.
De retour dans la rue, Michael me tire en arrière, on a perdu Jerry.
3h04
Le temps n’a plus d’importance.La foule anonyme brouille ma vision.
On avance vers le sud. Des fanions, guirlandes et drapeaux s’étendent entre les bâtiments.
Je grimpe sur un poteau, tente de discerner des cheveux blonds et une casquette des Pelicans.
Jerry n’a jamais manqué un appareillage. Il a trop besoin de son salaire pour payer ses soirées d’ivresse mensuelles.
Six dollars la pinte à droite. Sept dollars à côté. Cinq dollars et cinquante cents sur le trottoir d’en face.
Jerry nous retrouvera.
On pousse la porte du Johnny White’s. 3h37
Shot. Un. Deux. Trois. Quatre.
Mes pupilles se dilatent.
Les premières notes de Neil Diamond parviennent à mes oreilles.
La foule lève les mains au ciel, je hurle de concert Sweet Caroline, good time never seemed so good. Michael m’entraîne sur la piste. La pièce tangue autour de moi. Des bras. Des jambes. Des visages. Chaos d’êtres humains. Je ne vois plus rien. 4h
Ivre d’alcool et de fumée, je vomis dans le caniveau.
La soirée ferme ses portes, le silence de la ville étouffe la musique, la rue se vide.
Jerry nous a textés. Il s’est trouvé une femme pour la nuit.
Michael me propose un taxi. Je refuse. J’ai besoin de marcher pour décuver.
On se sépare, je prends la direction du fleuve. Autour de moi, les enseignes s’éteignent. Plus que deux heures avant l’aurore. Courte parenthèse avant que la lumière ne vienne sécher les souvenirs de la veille.
Je quitte Bourbon Street pour Saint Philippe.
Il fait toujours une trentaine de degrés. Pas de vent, pas de pluie, rien pour respirer.
Ma vision n’est pas nette, je transpire le rhum et le houblon, mes jambes me portent sans savoir où elles vont.
Je veux errer sans m’arrêter, sans être rattrapé par les contraintes de la sobriété.Le néon clignote au-dessus de la station Dumaine. Le prochain tramway ne va pas tarder. J’achète un billet à la borne automatique. Aller simple.
5h13
La ville court derrière la vitre. Immeubles, hôtels, enseignes ne forment plus qu’une vague impression, un sentiment de gris qui s’attache à mes poumons. Et puis tout disparaît.
Fleuve, berges, herbes folles et grillons insomniaques s’emparent du paysage.
J’appuie ma tête contre la fenêtre, mes pensées défilent sans que je puisse les arrêter.
6h05
Terminus.
Le port déploie ses quais sur l’eau engourdie par la nuit.
Les bateaux de pêche se balancent au gré du courant .
Jerry, enveloppé dans les bras d’une femme, rêve à ce corps chaud blotti contre le sien.
Michael fume une dernière cigarette avant d’aller s’enrouler dans les draps en coton de sa chambre d’hôtel.
Ils ont encore trois heures devant eux.
Du rose vient tacher l’horizon.
Je trempe mes pieds dans le fleuve, laisse mes rêves s’évaporer.
La soirée s’efface, sans un bruit, dans une éclosion de lumière.
L’aurore me réveille.

Par Léon Bodier, journaliste multiplateforme
La comédie musicale Hello, Dolly! raconte l'histoire de Dolly Gallagher Levi, une marieuse professionnelle et une veuve espiègle, qui décide qu'il est temps de se remarier et jette son dévolu sur le riche marchand de Yonkers, Horace Vandergelder. La première de Hello, Dolly! a eu lieu à Broadway en 1964 et a été un succès immense, remportant 10 Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale. Avec une musique de Jerry Herman et un livret de Michael Stewart, la chanson It Only Takes a Moment retient notre attention. Cornelius Hackl, qui travaille comme commis pour Horace Vandergelder, est un homme jeune et aventureux qui aspire à plus que sa vie monotone. Lorsqu’il rencontre Irene Molloy, une chapelière à New York, il en tombe éperdument amoureux. C’est le moment de lui dire.
[CORNELIUS, spoken]
If it pleases the court, I have something to say. Oh, I'll go slowly, so you can get it all down! (sung)
It only takes a moment
For your eyes to meet and then Your heart knows in a moment
You will never be alone again
I held her for an instant
But my arms felt sure and strong
It only takes a moment
To be loved a whole life long
[CLERK, spoken]
I missed a few words back there, Mr Hackl. Right after "it only" [ALL]
...Takes a moment!
For your eyes to meet and then
Your heart knows in a moment
You will never be alone again
He held her for an instant
But his arms felt sure and strong
It only takes a moment[IRENE]
He held me for an instant
But his arms felt safe and strong
It only takes a moment
To be loved a whole life long
[CORNELIUS]
And that is all That love's about [IRENE]
And we'll recall When time runs out
[CORNELIUS & IRENE]
That it only took a moment
To be loved a whole life long!

Dans ce morceau, Cornelius cherche et demande ce qui est plus court qu’une minute. Insatisfait par la réponse, il veut alors savoir ce qui est plus bref qu’une seconde. Mais en vérité, ce n’est pas une mesure de temps qu’il veut, plutôt un mot pour exprimer l’espace dans lequel s’est produit cet éclat d’émotions ayant éclipsé tous les autres avant lui. Parce qu’un espace, c’est aussi ce qui permet d’exprimer une durée, un intervalle, un instant, mais c’est surtout physique, une étendue, un milieu. Et lorsqu’un sentiment vient ébranler l’état d’être auquel nous étions jusqu’alors habitué.es, nous voulons un endroit dans lequel le mettre, parce que le laisser flotter dans l’arche du temps, ça ne permet pas de s’y accrocher comme on le voudrait. Comme une lettre que l’on glisse dans le coffre sous le lit en attendant d’être prêt.e à parcourir nos secrets. Ainsi, un moment désigne non seulement cet instant encore plus éphémère qu’une seconde, mais aussi cette zone dans la poitrine entre l’inspiration et l’expiration où existe cette nouvelle émotion ayant converti notre état d’être en un état de résonance. Pulsion cathartique ou d'autodestruction, le désir de revisiter la lettre dans le coffre n’est pas toujours un choix. L’envie de vouloir toujours habiter cet espace entre les mots sur la page peut l’être, et plus souvent qu’on ne s’autorise à l’admettre, l’inclination est de ne vouloir exister que là, entre deux respirations. C’est le cas de Cornelius pour qui il suffit d’un moment pour être aimé toute une vie.

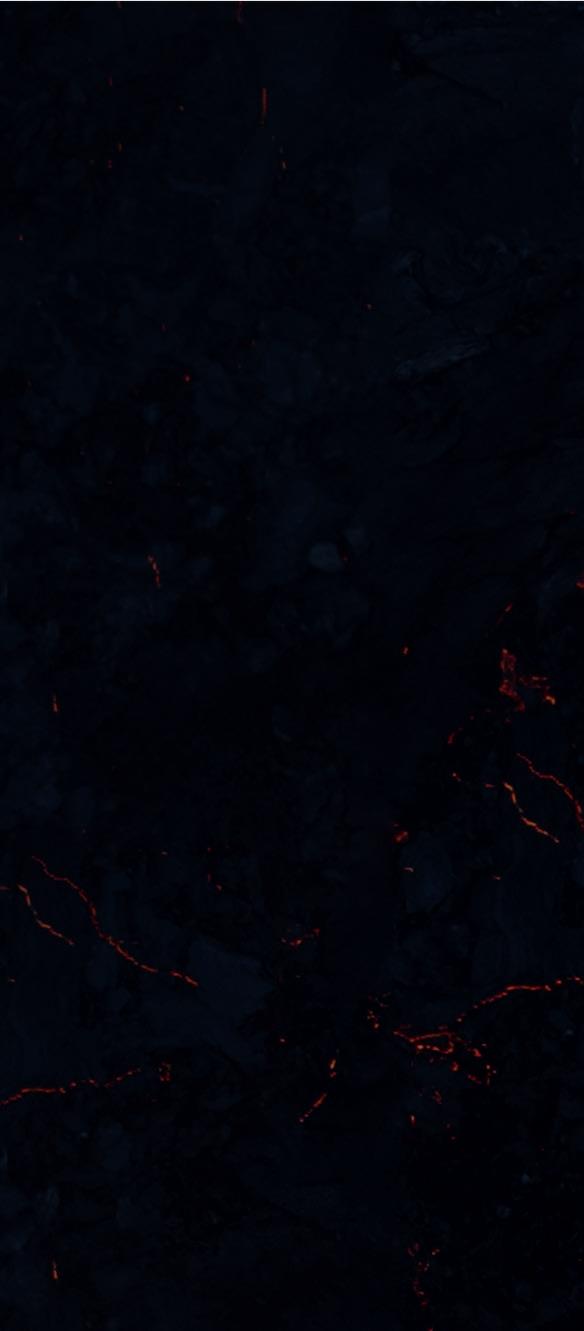







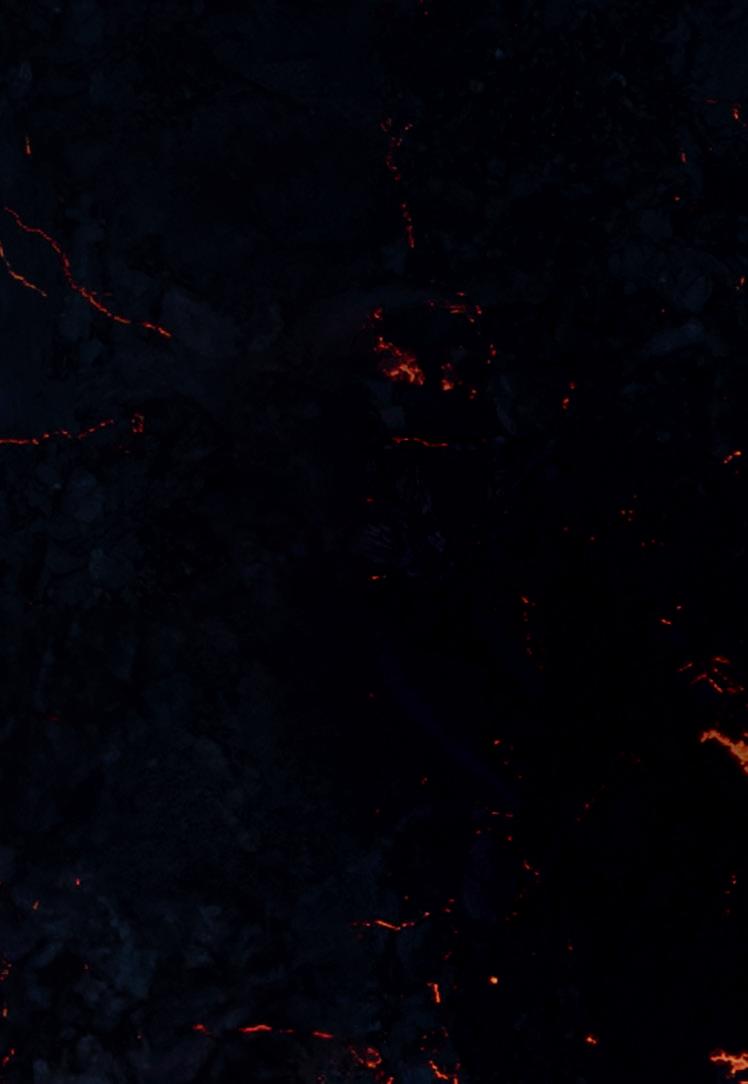






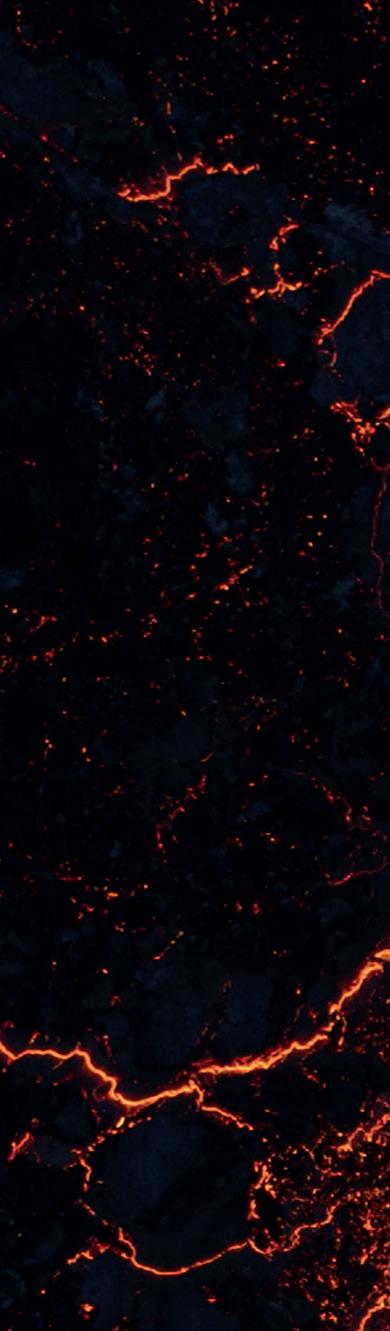
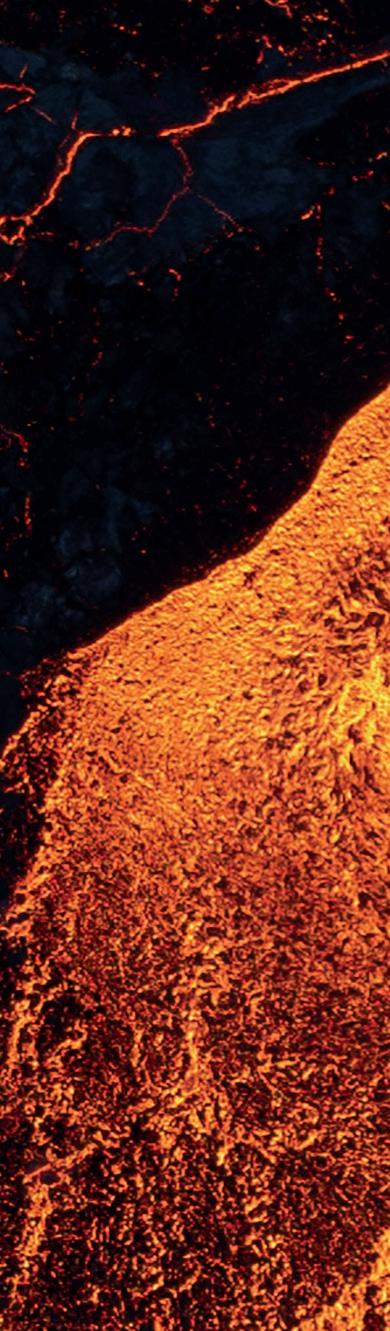








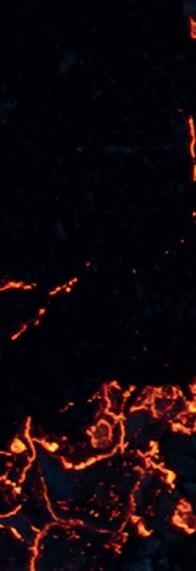
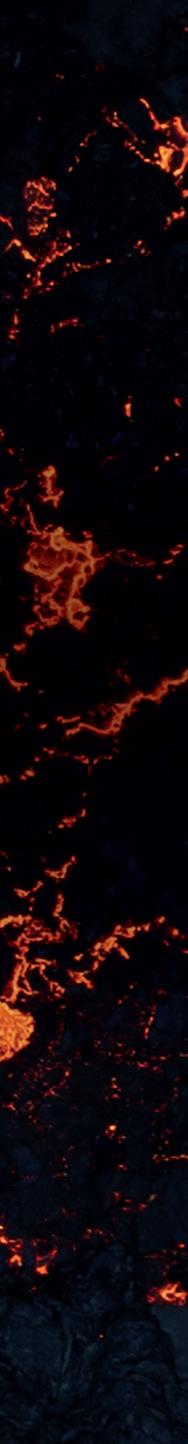

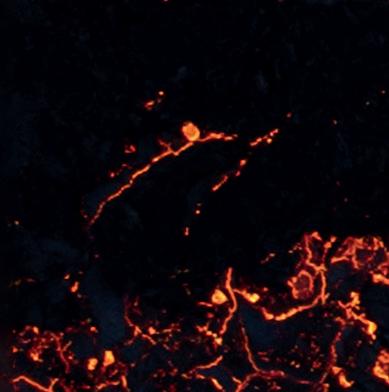



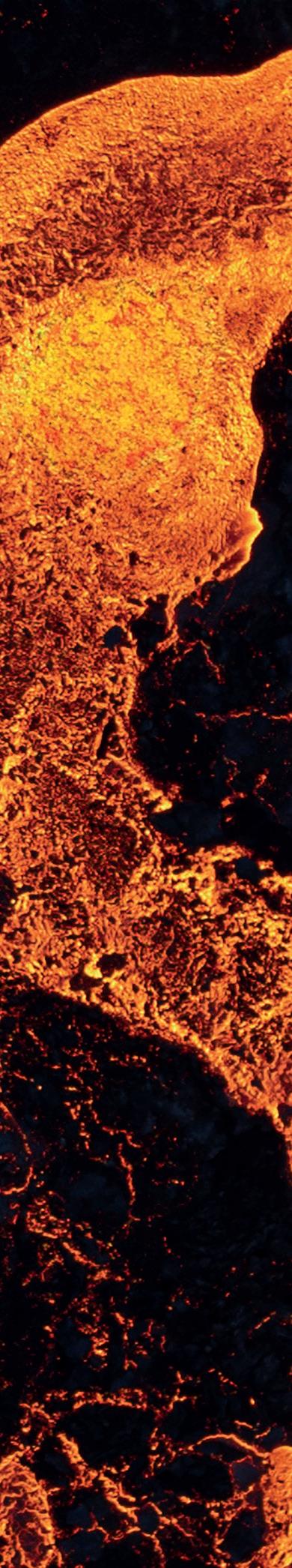





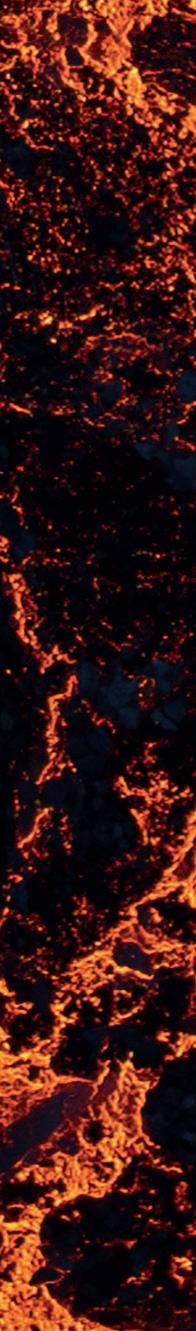








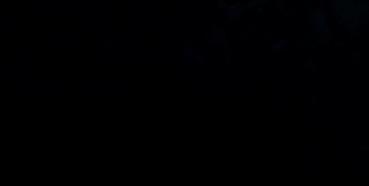



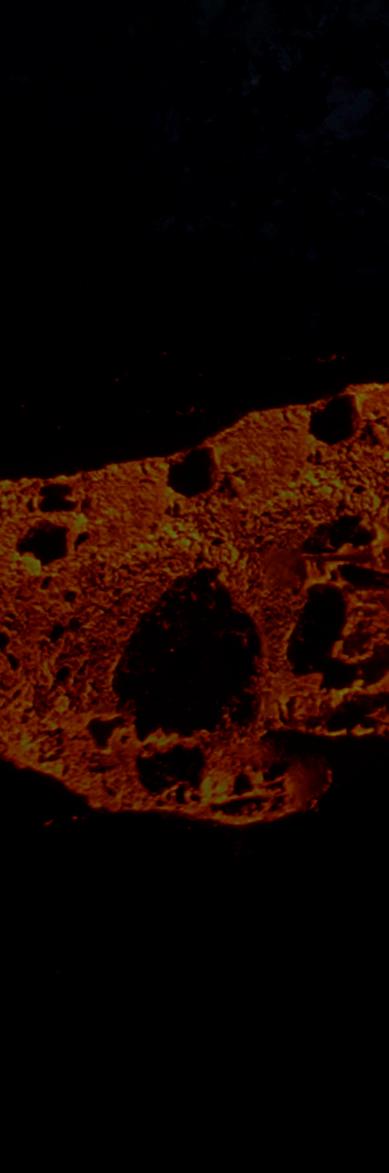




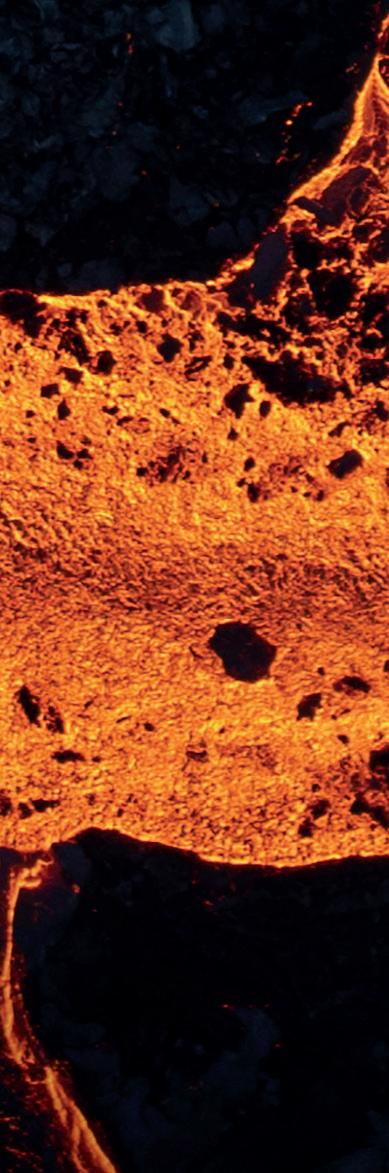


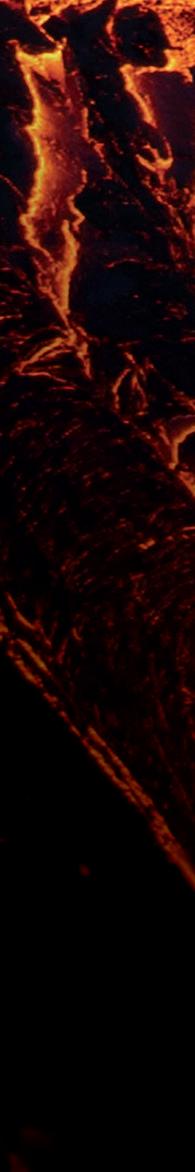

Découvrez votre nouvel espace ! NOUVEAU

Plus de 20 espaces, dispersés sur tout le campus, sont prêts à vous accueillir et vous offrir une pause bien méritée. N’attendez plus, votre bien-être commence ici !
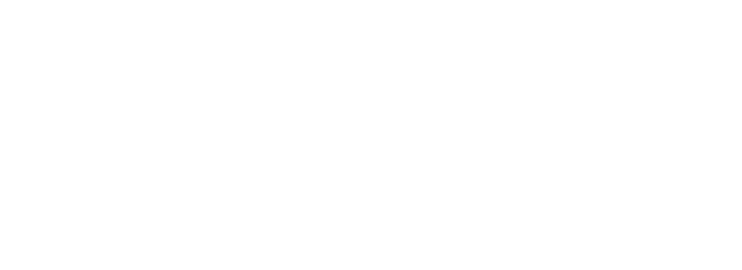

Pour en savoir plus ulaval.ca/mon-equilibre-ul
Venez découvrir notre tout nouveau concept, la bulle — Halte mieux-être