

NOUS SOMMES
Rédactrice en chef
Emmy Lapointe (elle) redaction@impactcampus.ca
Cheffe de pupitre actualités
Jade Talbot (elle) actualites@impactcampus.ca
Cheffe de pupitre aux arts
Frédérik Dompierre-Beaulieu (elle) arts@impactcampus.ca
Chef de pupitre société

Ludovic Dufour (il) societe@impactcampus.ca
Journaliste multimédia
William Pépin (il) multimedias1@impactcampus.ca
Journaliste multimédia
Sabrina Boulanger (elle) photos@impactcampus.ca
Directrice de production
Paula Casillas (elle) production@impactcampus.ca
Directeur général
Gabriel Tremblay dg@comeul.ca
Représentant publicitaire

Simon Rodrigue publicite@chyz.ca
Journalistes collaborateur.rice.s
Marilou Fortin-Guay, Marie-Claude Giroux, Marie Tremblay, Sarah-Kate Dallaire, Benjamin Rochon, Malika Netchenawoe, et Érika Hagen-Veilleux
Conseil d’administration

François Pouliot, Émilie Rioux, Daniel Fradette, Ludovic Dufour, Antoine Chrétien Sara Lucia Pena, Félix Etienne, Alex Baillargeon et Kevin Michaud
Réviseures linguistiques
Maxence Desmeules et Érika Hagen-Veilleux
Impression
Publications Lysar inc. Tirage : 2000 exemplaires Dépôt légal : BAnQ et BAC
Impact Campus ne se tient pas responsable de la page CADEUL et de la page ÆLIÉS dont le contenu relève entièrement de la CADEUL et de l’ÆLIÉS. La publicité contenue dans Impact Campus est régie par le code d’éthique publicitaire du journal, qui est disponible pour consultation au : impactcampus. qc.ca/code-dethique-publicitaire
Impact Campus est publié par une corporation sans but lucratif constituée sous la dénomination sociale Corporation des Médias Étudiants de l’Université Laval.
1244, pavillon Maurice-Pollack, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6 Téléphone : 418 656-5079
ISSN : 0820-5116
Découvrez nos réseaux sociaux !
@impactcampus
ACTUALITÉS
Le campus : en bref
En novembre, plusieurs changements ont eu lieu sur le campus, de la plantation de centaines d’arbres en passant par la création du Bureau du respect de la personne. De nouvelles recherches ont été publiées par des équipes lavalloises alors que le Rouge et Or continue d’impressionner. Voici un bref retour sur l’actualité du campus.
Sur le campus
L’Université Laval, en collaboration avec la Ville de Québec, a amorcé le projet de verdissement de la Cité universitaire en plantant près de 400 arbres sur le campus. Ces efforts viennent entre autres pallier la prochaine coupe de 330 arbres qui se situent sur le chemin du futur tramway. L’ajout d’arbres permettra d’augmenter la diversité forestière et d'améliorer la qualité de vie des étudiant.es et citoyen.nes. Il s’agit également d’une occasion pour la Chaire de recherche sur l'arbre urbain et son milieu, créée en 2020 en partenariat avec la ville, de former « un laboratoire vivant et de contribuer à l'avancement et la transmission des connaissances sur les arbres en milieu urbain » (ULaval Nouvelles, 2022a). Finalement, ce sont environ 1200 arbres qui seront plantés sur le campus.

Afin de faciliter la gestion des dénonciations et des plaintes, en plus de favoriser la résolution de conflits, l’Université à mis sur pied le Bureau du respect de la personne. Cette entité « regroupe désormais le Centre de prévention et d'intervention en matière de harcèlement et le Centre d'intervention et de prévention des violences à caractère sexuel, en plus de traiter les divulgations d'actes répréhensibles. L'objectif de ce regroupement est d'assurer une meilleure concertation entre les intervenantes et intervenants » (ULaval Nouvelles, 2022b).
Sommeil et alimentation, recherches lavalloises Plusieurs résultats de recherche ont été publiés par des équipes de l’Université Laval le mois dernier. D’abord, une équipe de la Faculté de médecine et du Centre de recherche du CHU de l’Université Laval ont, dans une étude exploratoire, identifié un lien entre un sommeil de mauvaise qualité et le développement d’inflammation des tissus mammaires. L’inflammation chronique a d’ailleurs été associée au risque de cancer du sein dans plusieurs études. Les chercheuses de Laval rappellent donc que le sommeil est un aspect important dans la prévention des cancers et qu’il devrait être abordé avec les médecins lors des visites médicales. Une autre recherche, cette fois menée par le centre NUTRISS et l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels de l’Université Laval ainsi que par l'Institut national de santé publique, suggère que « pour passer d'une alimentation de qualité nettement sous la moyenne québécoise à une alimentation de qualité nettement au-dessus de la moyenne québécoise, une famille de quatre personnes pourrait avoir à payer 1800$ de plus par année » (Hamann, 2022a). Ce résultat témoigne du défi que pose l’accès à une alimentation de qualité pour les familles à faible revenu. Les chercheur.euses rappellent qu’il est « essentiel de mettre en place des politiques pour que les recommandations visant la saine alimentation puissent concilier qualité et pleine accessibilité à tous les aliments sains » (Hamann, 2022b).

Bienvenue à Québec !
En novembre, le Rouge et Or a une fois de plus démontré qu’il était fait d’or et d’excellence. La performance la plus spectaculaire est sans contredit celle des joueuses de rugby qui ont été sacrées championnes canadiennes. Du 2 au 6 novembre, l’équipe a participé au Championnat U SPORTS qui se tenait à Victoria, en Colombie-Britannique. Après une saison régulière où elles avaient marqué 382 points et en avait seulement accordé 22, pour finalement remporter le titre de championnes du RSEQ, les Lavalloises étaient favorites pour ce championnat. Elles ont d’ailleurs livré une performance à la hauteur de nos attentes, disposant facilement des Axewomen d’Acadia au quart de finale avec un score de 68 à 0. En demi-finale, elles ont vaincu les Gryphons de Guelph 30 à 8 afin d’accéder à la finale contre les Gaels de Queen’s. Rapidement, elles ont inscrit des points au tableau pour finir la rencontre avec la marque de 22 à 5. Il s’agit de la deuxième fois en trois ans que l’équipe accède au titre de championne nationale.
Il n’y a pas que le rugby qui a terminé sa saison, c’est également le cas de nos équipes de soccer. En saison régulière, l’équipe masculine s’était classée quatrième, avec une fiche de 5 victoires et 4 défaites. Cette position leur a permis de participer à la demi-finale, contre les Carabins de Montréal, le 28 octobre dernier. Malheureusement, l’équipe n’a pas obtenu la fin escomptée,
s’inclinant 2 à 1 contre leurs adversaires. Ainsi, les hommes ont terminé leur saison alors que les femmes ont eu l’occasion de se rendre plus loin. Classée deuxième en saison régulière, avec une fiche de 10 victoires et 1 défaite, elles ont affronté les Carabins de Montréal en finale du RSEQ. Encore une fois, Montréal a eu raison du Rouge et Or, la partie se terminant 2 à 1 en faveur des joueuses de la métropole. Malgré cette défaite, le classement en saison régulière leur a permis de participer au Championnat U SPORTS. Ce dernier s’est déroulé du 10 au 13 novembre, au PEPS de l’Université Laval. Jeudi soir, les Lavalloises ont rencontré les Thunderbirds de UBC et les ont vaincues 2 à 1, leur permettant ainsi d’accéder à la demi-finale contre les Capers de l’Université du Cap-Breton. Contre toute attente, alors que les Capers étaient les favorites, le Rouge et Or a remporté la partie, 2 à 0. Cette victoire les a donc propulsé en finale canadienne contre les Carabins de Montréal. Après une première demie plutôt calme, c’est à la 75e minute de jeu que les Montréalaises ont réussi a marqué le premier et seul but de la rencontre. Alors qu’elles avaient gagné le bronze l’an passé, les Lavalloises obtiennent donc la médaille d’argent, une première dans leur histoire.
Finalement, novembre signe également la fin de la saison du RSEQ pour le football. Au terme de la saison régulière, le Rouge et Or football se trouvait en première position au


classement, avec une fiche de 7 victoires et 1 défaite. Cela leur a permis d’accueillir les Stingers de Concordia en demi-finale le 05 novembre dernier. Cet affrontement aux mille et un revirements s’est soldé par la marque de 38 à 27 en faveur de Laval. La prochaine étape pour les hommes de Glen Constantin était donc la finale de la Coupe Dunsmore, qui s’est déroulée le 12 novembre dernier, à Québec. Sans surprise, le Rouge et Or s’est retrouvé face aux Carabins de Montréal, promettant ainsi aux 12 375 spectateur.rices un match enlevant. Il s'agissait en effet d’un match digne d’une finale et digne des deux meilleurs programmes au Québec. Alors que les deux équipes prenaient tour à tour les devants, Kevin Mital ayant marqué les trois seuls touchés du Rouge et Or, c’est à 40 secondes de la fin que les Carabins ont réussi à égaliser le score à l’aide d’un botté de placement, 24-24. Alors que tout le monde retenait son souffle, le Rouge et Or a réussi à progresser sur le terrain pour tenter le tout pour tout, un placement de 48 verges au moment où le cadran allait afficher 0. Raté, les Carabins n’ayant toutefois pas réussi à sortir le ballon de la zone des buts, un point a été accordé au Rouge et Or, les sacrant ainsi champions provinciaux. Il s’agit de la première fois depuis 2018 que l’équipe remporte ce titre. Les Lavallois auront maintenant à affronter les Mustangs de Western, meilleure équipe au pays, en Coupe Mitchell [NDLR: L’événement sera déjà passé une fois ce magazine imprimé].
Références
ULaval Nouvelles (2022a). Foresterie urbaine et tramway, ULaval Nouvelles. https://nouvelles.ulaval.ca/2022/11/02/ foresterie-urbaine-et-tramway-b287feb05beb6dd7cfa217 7b56b318f9?sourceOrganizationKey=ulaval.
ULaval Nouvelles (2022b). Création du Bureau du respect de la personne, ULaval Nouvelles. https://nouvelles.ulaval. ca/2022/11/07/creation-du-bureau-du-respect-de-lapersonne-0d7d2c65ee140acac0a47b12631ba99d?sourc eOrganizationKey=ulaval.
Hamann, J. (2022a). La qualité du sommeil associé à des marqueurs inflammatoires du cancer du sein, ULaval Nouvelles. https://nouvelles.ulaval.ca/2022/11/07/laqualite-du-sommeil-associee-a-des-marqueursinflammatoires-du-cancer-du-sein-47956cc9dbb59dda7c c7db571d694008?sourceOrganizationKey=ulaval.
Hamann, J. (2022b). Facture d’épicerie pour des familles ; 1800$ de plus pour améliorer substantiellement son alimentation, ULaval Nouvelles. https://nouvelles.ulaval.ca/2022/11/10/facture-depiceriedes-familles-1800-de-plus-pour-ameliorersubstantiellement-son-alimentation-61245f7f3f9488c69bf 1d8df497cf8c3?sourceOrganizationKey=ulaval.
concours
16 février 2023
COMMENT AUDITIONNER?
C’est simple ! Il suffit de nous transmettre une vidéo de votre performance des arts de la scène d'au maximum dix minutes.

Du 28 novembre 2022 au 8 janvier 2023 inclusivement vous pouvez nous envoyer votre candidature.
Suivez le QR code pour tout connaître sur les conditions d’inscription !

À gagner, un premier prix de Ainsi que deux prix de participation de et Ainsi que deux prix de participation de et À gagner, un premier prix de

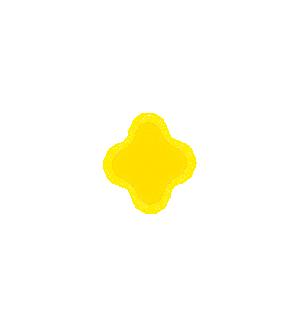








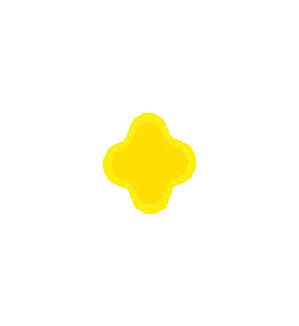



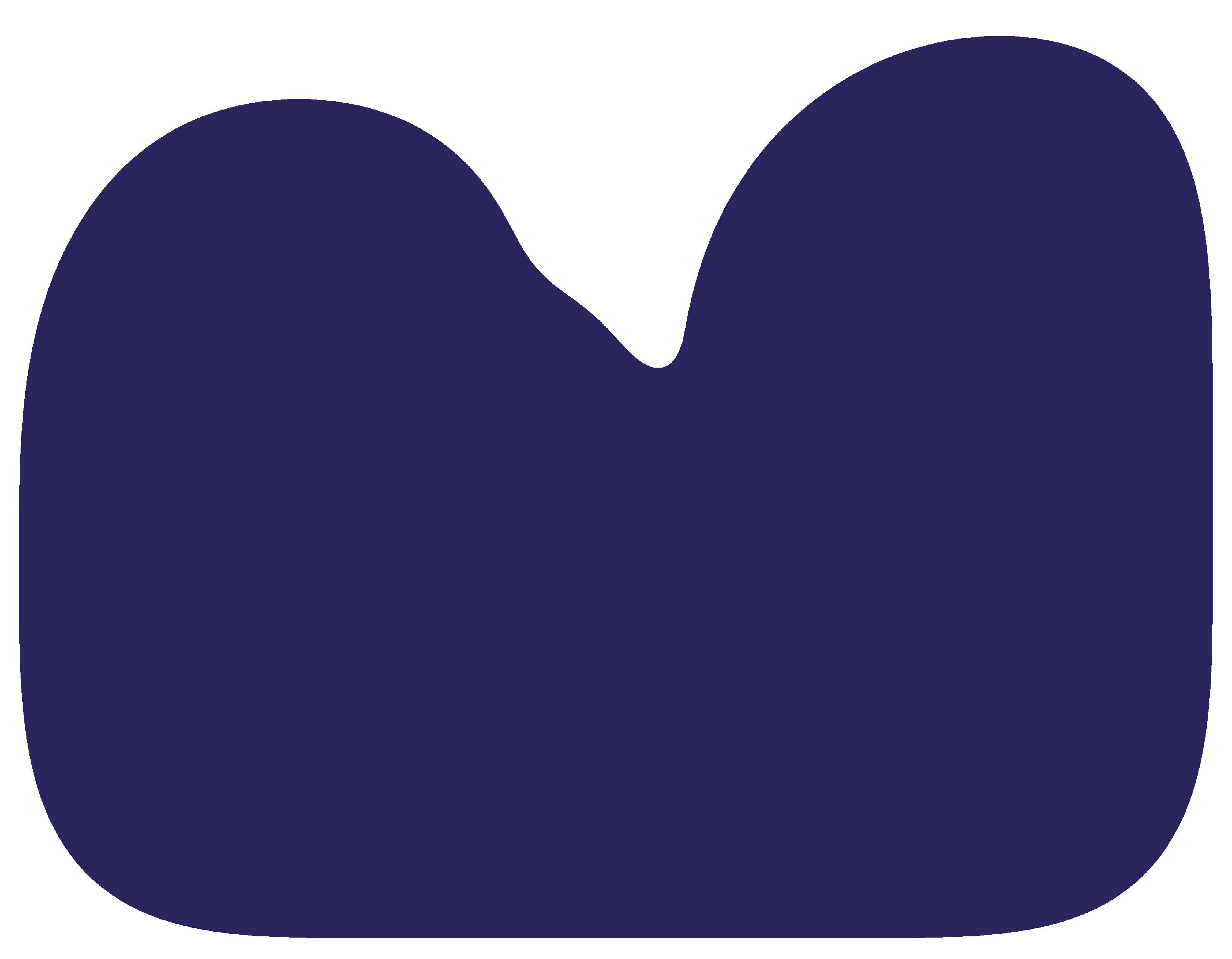
Modalité : être une étudiante ou un étudiant de premier cycle à l'Université. Du 14 novembre au 10 janvier (inclusivement) détails sur cadeul.com/agenda

À la rencontre des disparu.es
Avant d’écrire celui-ci, j’avais commencé un tout autre éditorial. Je partais de ce que Pierre Nepveu, professeur et auteur, avait écrit dans Écologie du réel. Dans son livre, il y parle de littérature québécoise, de centres, de décentrement, de migration, d’exil. Alors, j’ai repris ses propos, les ai mêlés à notre thème de ce dernier magazine : intersection, ça allait, mais quelque chose sonnait faux. Ce n’était pas ce que j’avais envie d’écrire pour fermer 2022.
Par Emmy Lapointe, rédactrice en chef
Michel
Et alors que je rédige mon second éditorial et que mes étudiant.es planchent en silence sur leurs comptes-rendus critiques, dehors, c’est la première neige, la première vraie, celle qui reste au sol. Je pense aux mots de Michel Lessard qui, dans un livre d’architecture, a écrit : « Dehors, ce soir, au moment où j’écris cette dernière page, il neige pour la première fois cet hiver. C’est le 25 novembre 1971 et la traditionnelle bordée de la Sainte-Catherine nous tombe dessus, plus violente que jamais. Je me demande même à entendre siffler le nordet et à voir le voile opaque de la poudrerie qui recouvre la ville de Québec si je pourrai donner mes cours à mes étudiants demain.
Je suis heureux et content comme on l’est presque tous à une première neige. Mon épouse s’est endormie avec mon fils. Tout le monde s’est encabané. Pas âme qui vive dans les rues déjà fermées par les lames […].
Ce soir a dû être la première vraie réunion familiale depuis le printemps, et ce, dans la plupart des foyers. […] L’hiver c’est nous, c’est notre force. Chez nous, au pays du Québec, l’hiver n’a jamais tué le printemps mais le prépare. » J’ai découvert Michel Lessard en pandémie, en confinement. Alors que je me sentais contrainte à l’immobilisme, il est le seul qui a su apaiser l’agitation incessante qui me coulait au travers du corps. Michel Lessard est décédé en avril 2022.
Jean-Marc

J’ai commencé l’insomnie pendant l’enfance, et la nuit, pour me rassurer, des films jouaient en boucle sur mon DVD portatif. L’un des films qui jouaient le plus, c’était C.R.A.Z.Y de Jean-Marc Vallée. C’est un film dur, mais pour moi, c’est une œuvre réconfortante. Pour moi, C.R.A.Z.Y, c’est la découverte de Charles Aznavour, de David Bowie, des difficultés d’aimer. Jean-Marc Vallée est décédé à l’aube de l’année 2022.
Lori
Quelques jours avant le shut down général en 2020, j’ai rencontré Lori Saint-Martin dans un café de Saint-Roch pour discuter avec elle de son dernier livre Pour qui je me prends. Il y était question de son rejet de la langue anglaise, de sa langue maternelle qu’elle ne reconnaissait plus comme telle, puis, de leur réconciliation. Les langues, des fenêtres sur les autres y écrit-elle.
On a parlé, en ce début de mars-là, pendant près de deux heures. Elle m’a partagé son parcours comme professeure, comme autrice, comme traductrice, comme féministe. Je lui ai confié mon admiration, la présence récurrente de son nom dans toutes mes bibliographies de travaux.
Lori Saint-Martin est décédée le 22 octobre 2022.
Sous une publication Instagram dans laquelle je citais les derniers passages de son livre Le nom de la mère, un ouvrage fondateur en études littéraires féministes, j’ai écrit les seuls mots que j’avais trouvés ce jour-là. J’y racontais la rencontre que j’avais eue avec Lori, avec l’œuvre et la femme. En commentaires, Florela, la maman d’une de mes meilleures amies, a écrit : « Tu restes avec un beau souvenir d’elle, vos chemins se sont croisés pour vous permettre de vivre des moments inoubliables ! »
Se croiser
Je n’ai pas pu parler de toustes les disparu.es de la dernière année, parce que cette année, il me semble que des pertes, il y en a eu encore plus qu’à l’habitude. Après ça, c’est peut-être moi qui ai porté mon attention plus là-dessus.
Et c’est là que ça devient peut-être un peu quétaine, mais de tout ça, je retiens les mots de Florela, vos chemins se sont croisés. Ces personnes ont été des points d’ancrage lumineux et même si je martèle mes étudiant.es de ne jamais terminer leurs textes avec un souhait, je nous souhaite quand même à toustes, pour la prochaine année (et toutes celles à venir), de croiser la route de personnes qui seront quelque chose comme un phare pour nous.
L’errance universitaire : ces parcours qui semblent aller partout et nulle part

Je haïs les intersections. Je les trouve bruyantes, angoissantes, dangereuses. Et puis, je ne sais jamais quelle direction emprunter. On affectionne particulièrement les lignes bien droites, ces histoires de vie qui racontent des parcours clairs et directs. En réalité, les lignes droites n’existent nulle part dans la nature. C’est ce que je me dis en repensant à mon parcours universitaire qui semble aller partout et nulle part.
Par Marilou Fortin-Guay, journaliste collaboratrice
La première fois que j’ai senti que j’avais à faire un choix décisif pour ma carrière, j’ai opté pour des études en sciences de la nature. Les lignes droites sont particulièrement propices à la création d’oppositions binaires, comme la dichotomie présumée des sciences humaines et des sciences de la nature. Déjà, je ressentais l’urgence de délimiter quelque chose, au risque de me définir par défaut. Il s’agissait d’une déci-sion réfléchie, mais justifiée par l’idée répandue que les sciences de la natures « ça garde les portes ouvertes ». Le problème avec les portes ouvertes, c'est qu'il faut les refermer une à une. C’est plus facile à dire qu’à faire, surtout quand on a le désir de tout essayer, qu’on craint toujours de manquer quelque chose, de regarder avec regret les chemins non parcourus avec l’impres-sion d’avoir raté la chance d'être quelqu’un d’autre. Les intersections m’angois-sent. Elles me remettent au visage le sentiment terrifiant que je suis libre, responsable de mon existence et, qu’ultimement, il faut choisir.
À l’université, j’ai opté pour un programme avec une tonne de débouchés. Un chemin bien ficelé,
une promesse de diplôme, une ligne qui s’ajoute au CV. Tout ça était logique dans ce cocon universitaire qui nous incubait jusqu’à la vie adulte et nous recrachait sur le grand marché du travail. Mais souvent, le programme qu’on choisit à 18 ans en feuilletant un catalogue de professions ne nous convient pas. À l’époque, je ne réalisais pas à quel point je ne savais rien de l’adulte que je voulais devenir plus tard… beaucoup plus tard. C’est mieux comme ça. À quoi ressemblerait notre vie si elle se figeait à nos 20 ans ?
Après quelques années à l’université, l'enthousiasme s’est essoufflé. Quand mon souffle me manque, je sais que je suis arrivée au bout de la route, diplôme en poche ou non. Or, se réorienter n’est pas chose facile, parce qu’on nous apprend tôt dans la vie qu’abandonner, c’est échouer. On comprend rapidement l’impor-tance de se définir en faisant référence à un métier, parce que « ce qu’on fait dans la vie » est un sujet chaud dans les party de famille.. Dire qu’on veut être avocat.e, médecin ou comptable, c’est clair, sécuritaire, socialement acceptable, mais
pas toujours honnête. Avouer qu’on n’en a aucune idée rend les gens plus perplexes. Je me dis qu’au fond, mieux vaut être incertaine plutôt qu’insatisfaite.
Après trois changements de programme, j’ai compris qu’il ne suffisait pas d’accumuler les crédits pour se sentir sur son « X ». Je commence sincèrement à croire que ce « X » est en réalité destiné à cocher une case plutôt qu’à sentir qu’on fait la bonne chose. Je cherche toujours le « X ». Peut-être que le « X » ne se déniche pas au travail. Peu importe, je ne suis pas encore convaincue qu’il existe.
Avec le temps, nos parcours universitaires nous convainquent de faire fi des chemins tracés d’avance, des plans A, des plans B, des titres accolés aux diplômes. L’université est un lieu propice pour se perdre, se poser des questions, tester des idées, revenir à ces intersections encore et encore pour en explorer toutes les avenues possibles. C’est aussi ça, nos parcours universitaires, penser aller quelque part et finir ailleurs.
Errer n’est pas un manque d’ambition. Se perdre n’est pas du temps gaspillé.
Je conclus ce bref témoignage sur l’errance universitaire avec une idée élégamment posée dans un numéro du magazine Beside consacré aux trajectoires de la nature :
« En fait, tous les êtres vivants évoluent en suivant des trajectoires mouvantes au sein d’écosystèmes complexes et interconnectés. Alors que les autres espèces refaçonnent constamment leur environnement, nous traçons des lignes et nous nous attendons à ce qu’elles ne bougent pas. » (« Le cercle parfait », 2018, p.13)
Sur ce, au plaisir de vous croiser à l’une ou l’autre de vos intersections.
Référence
Métayer, C. (2018). « Le cercle parfait ». Beside, 4, 13.
Tu dis potatoes, je dis patate
Depuis quelques mois déjà, j’ai l’impression que ma vie se dédouble et je ne sais toujours pas si je devrais la recoudre. Encore moins si c’est possible. C’est que depuis quelques mois déjà, je partage ma vie entre Québec et le Colorado, entre le fleuve et les Rocheuses, entre patates et potatoes. YQB, YYZ, DEN encore et encore. Ces aéroports -zones tampons- où je fonds pour qu’on me replace dans le moule approprié. Celui de l’Ouest, des miles et du McDo ou celui de l’Est, des kilomètres et du McDo (Est-ce que le McDo serait ma seule constante dans mon monde de décalage???). Je n’ai pas choisi le Colorado, il m’est juste tombé dessus. J’ai rencontré un Américain, je suis tombée amoureuse et maintenant je fais assez d’allers-retours pour savoir où est la machine distributrice à gâteau dans l’aéroport de Pearson. Ces temps-ci, je me questionne beaucoup, on me questionne beaucoup : Est-ce que tu vas aller le rejoindre? Est-ce que c’est difficile? Est-ce qu’il va venir vivre ici? Je ne sais pas, oui c’est difficile et non je ne pense pas, pas tout de suite. J’ai donc eu envie, pour ce mag, de parler de mon expérience en couple binational, parce que même s'il y a une séparation évidente, il y a également une rencontre, un croisement, une intersection.


Par Jade Talbot, cheffe de pupitre actualités
On trouve l’amour lorsqu’on s’y attend le moins. Dans mon cas, je ne m’attendais certainement pas à le trouver entre deux parties de Warzone. Dans un environnement assez hostile, surtout pour les femmes, lorsque tu trouves des personnes respectueuses et gentilles, tu veux les garder avec toi. C’est de cette façon qu’est né un trio entre lui, son coloc et moi. Après plusieurs heures de jeu, nous avons commencé à parler un peu plus de nos vies, à rester dans le lobby une heure de plus juste pour discuter. Plusieurs mois ont passé et nous étions désormais des ami.es. À ce moment, j’avais déjà des sentiments pour lui, mais à quoi bon les partager, nous étions séparé.es par des milliers de kilomètres. Il m’avait dit aussi qu’il ne cherchait pas de relation et encore moins à distance. Et puis un jour, je lui ai dit que j’allais en vacances au Maine - mon amie et moi adorons les villes côtières. Pourquoi aller là-bas, alors que tu pourrais venir me voir au Colorado, qu’il m’a dit.
-T’es sérieux ? -Oui.
Avant de partir le rejoindre, il m’a avoué qu’il avait des sentiments pour moi, je lui ai dit que c’était réciproque. Nous avions baissé nos gardes, parce que nous savions que rien n’arriverait et c’est précisément pour cela que c’est arrivé. Je suis donc partie le voir pour 10 jours, 10 jours où nous ne nous attendions à rien, 10 jours qui, finalement, sont passés trop vite. Depuis, nous cultivons un amour entre les visites et FaceTime.
Je suis assez privilégiée pour pouvoir aller le visiter plusieurs semaines d'affilée, mon emploi et ma situation académique me le permettent. Cependant, ces visites ne sont pas des vacances, je dois donc travailler comme si j’étais à Québec. Et si je dois accomplir mes tâches quotidiennes comme d’habitude, rien n’est comme
d’habitude. Mon appartement, là où mon bureau fait face à une grande fenêtre, mes rues, celles que je peux traverser les yeux fermés, mon café préféré où l’ensemble du staff connaît ma commande, tous ces repères s’envolent en même temps que moi lorsque je m’installe dans le siège E22 d’un Airbus A320-200. En fait, ils ne s’envolent pas, c’est vraiment que moi qui part, qui les laisse. Et si perdre ces lieux me pèse, m’éloigner de mes proches est une tragédie. Partir signifie ne pas être là pour partager leur quotidien, leurs petites et grandes occasions. Mais rester signifie ne pas être là pour partager son quotidien, ses petites et grandes occasions. Je me retrouve donc entre deux mondes où inévitablement je ressens un manque d’un côté ou de l’autre. En discutant avec une amie qui vit sensiblement la même situation, nous en sommes venues
à la conclusion qu’il s’agissait d’un des plus grands défis des relations à longue distance. Ne pas vivre le quotidien avec la personne que tu aimes, ne pas pouvoir être témoin de ce qui se passe, ne pas avoir les mêmes référents.
Ce dédoublement de ma vie me laisse devant un choix impossible. Impossible parce qu’un jour je devrai choisir entre ici et là-bas, choisir de qui et de quoi m’éloigner. Pire encore, le Colorado commence à ressembler à une maison. Tranquillement, je me construis de nouveaux repères, je dépose petit à petit des briques de familiarité. Je connais désormais le meilleur chemin pour me rendre à l’épicerie, j’ai déjà un café préféré, je sais que si on trouve un stationnement devant le Oskar Blues, c’est qu’on est chanceux.euses et les employé.es de la boutique de


limonade savent que j’en prends toujours avec du sirop au basilic. Je ne peux pas faire comme si cela me surprenait non plus, parce que malgré tout, j’ai l’intention de m’y sentir à la maison. En fait, j’essaie activement de me bâtir une deuxième vie là-bas. À sa façon, mon copain m’aide également à m’intégrer, il comprend que c’est important pour moi de me bâtir un réseau et nous avons comme plan de nous faire de nouveaux.elles ami.es. Alors que je me sens de plus en plus à l’aise au Colorado, je sens qu’il sera de plus en plus difficile de faire un choix. Il y a quelques mois, lorsque sa ville m'était inconnue, j'aurais dit sans hésiter que je resterais à Québec. Maintenant, avec notre trajectoire de vie, je risque de passer au moins quelques années là-bas. La fin de ma maîtrise semble signer la fin de ma vie à Québec. Plus que jamais, je me sens dans un croisement de ma vie et c’est terrifiant.
Et si j’ai l’impression de me perdre entre deux mondes, je pense que nos différences m'aident à m’ancrer. À Québec, je suis une Québécoise parmi les Québécois.es, je suis comme une maille dans un tricot. Je vis sans trop accorder d’importance à mon identité, emportée par mes habitudes et ce que je prends pour acquis. Avec lui, je suis consciente de nos différences et j’affiche avec beaucoup de fierté qui je suis, pas seulement en tant que Québécoise, mais en tant que personne. Je pense que c’est en protégeant cette identité et en y intégrant mes nouvelles expériences ici et là-bas que je pourrais recoudre ma vie qui semble se dédoubler. Le McDo ne sera pas ma seule constante parce que ce sera moi. Vivre entre deux mondes ce n’est pas perdre un morceau de soi-même, c’est plutôt y ajouter une couche. Tu dis potatoes , je dis patates, et je trouve ça magnifique.
Être sur son Y
En novembre 2021, j’ai rédigé un article pour Impact Campus qui s’intitulait Retour aux études pour ne pas s’éteindre. Depuis, j’ai toujours tenté d’entretenir la flamme en moi, de la garder allumée, mais quelques fois, elle vacille... Pour reprendre le contexte de cet article, j’avais pris la décision de poursuivre mes études à temps partiel en communication publique afin de quitter un emploi de soutien administratif qui avait depuis longtemps cessé de m’animer.
Par Marie-Claude Giroux, journaliste collaboratrice
Depuis, je me suis mise à tenter d’être sur la bonne voie de mon Y. J’ai associé tout récemment la symbolique de cette lettre à mon cheminement grâce à Guillaume Dulude, docteur en psychologie. En effet, en regardant la vidéo Le courage de faire des choix qui font avancer sa vie à l’émission de Marie-Claude Barrette, il a défini précisément ce que je vivais depuis quelques années.
Comment le Y s’applique dans mon cheminement de carrière ?
Quand nous traversons une période difficile, nous devons faire des choix pour nous sentir mieux. Le Y représente donc le lieu de rencontre où se croisent deux voies : la voie
de gauche et la voie de droite. Sommairement, la voie de droite consiste à reproduire exactement les mêmes actions qui nous rendent confortables et qui nous font sentir bien. J’avais envie d’aller mieux, car plus les jours avançaient et plus je m’éteignais. C’est ainsi que j’ai emprunté cette voie quand j’ai quitté mon emploi pour aller vers un autre chemin semblable. Au bout d’un mois, je savais que j’avais fait fausse route et qu’il n’était pas question que j’attende encore 20 ans pour commencer la vie que je voulais. J’ai donc pris la décision de consulter d’abord un psychologue qui m’a référé à un conseiller en orientation, étant donné que mes besoins étaient plutôt dans ce domaine. Ces rencontres ont confirmé ma passion pour les commu-
nications et la nécessité de poser des actions qui m’amèneraient à effectuer un travail qui me correspond. Pour cela, je devais prendre la voie de gauche.
J’ai donc quitté cet emploi similaire à celui qui m’éteignait pour un emploi en gestion d’équipe. Étant donné que mon objectif, à moyen ou à long terme, était de faire un baccalauréat en communication humaine et organisationnelle, je me suis dit qu’après plus de 20 ans en tant qu’employée, j’irais chercher de l’expérience en gestion. Évidemment, la pénurie d’employé.es était parfaite pour moi. J’étais désespérée et les employeur.euses aussi! Sérieusement, c’est un bon moment pour des personnes comme moi qui désirent changer de carrière sans avoir toute l’expérience requise. Malheureusement, ce nouvel emploi n’a pas été le plus agréable. Je n’étais pas la bienvenue, car je prenais la place d’une autre personne qui avait plus d’années d’expérience que moi dans l’entreprise et qui convoitait ce poste. Au bout de 5 jours (je deviens moins patiente), j’ai quitté l’emploi qui ne correspondait pas tout à fait à mes valeurs d’ouverture d’esprit. J’ai communiqué mon ressenti de la meilleure façon possible à cette personne et à la direction, mais je n’ai tout simplement pas eu envie de poursuivre en me sentant exclue. Malgré toute la peine
que cela m’a causée, et le coup dur que ça a porté à mon estime, cette expérience n’a fait que confirmer à quel point je désirais aider les entreprises et les employé.es qui ont des difficultés communicationnelles à créer un milieu de travail sain pour toustes.

La voie de gauche me remplit d’incertitudes comme jamais. Je me mets en doute constamment, mais je sens en moi que c’est la bonne direction. Je me sens souvent très seule et l’idée de retourner dans la voie de droite me revient constamment en tête. Par contre, avec ces nouveaux tracés, j’ai l’impression de construire mon propre chemin, complètement unique, déstabilisant, mais ô combien satisfaisant. Je suis de plus en plus confiante et convaincue d’être une personne qui mérite sa place dans ce monde des communications. Jeune, j’étais présidente de mon école secondaire et je voulais changer le monde. En prenant la voie de gauche, je fais revivre cette présidence.
Par ailleurs, depuis quelque temps, j’ai la chance de travailler pour un OBNL qui me permet de déployer mes ailes et de dévoiler mon potentiel. Ce même OBNL m’a permis de rencontrer Marie-Claude Barrette et elle ne peut même pas s’imaginer à quel point cette entrevue m’a fait du bien.
SOCIÉTÉ ET SCIENCES
Conception cyclique dans la linéarité du temps
Plus je vieillis, plus je vois le monde comme un balancier. Une grande valse entre la gauche et la droite, la dictature et la démocratie, la prison et la liberté. J’observe les bouleversements du monde du coin de l’œil pour ne pas voir le pendule qui fonce de l’autre côté. Le pendule du rembobinage qui nous ramène dans l’Histoire. Il faut croire, après tout, que nous n’avons pas besoin d’une machine pour remonter le temps.
Par Marie Tremblay, journaliste collaboratriceParfois, je me demande si la mémoire collective oublie. On remplit les manuels d’histoire pour que les prochaines générations comprennent ce que nous avons vécu. Cependant, les leçons tirées ne sont pas nécessairement les bonnes. C’est une chose de les lire, c’est une autre paire de manches de les vivre. Est-il vrai que « nous apprenons de nos erreurs » ? Certaines aberrations se sont visiblement répétées, seulement différemment. Lors de certains moments de l’histoire, on aurait pu croire à un « déjà vu ».
Un exemple récent est l’enjeu de l’avortement aux États-Unis. L’accès à l’avortement est difficile, et les contraintes à franchir pour bénéficier de cette procédure médicale (souvent illégale) sont dignes d’une course à obstacles. C’était le cas avant Roe v. Wade , et c’est de nouveau le cas avec le renversement du célèbre arrêt. Que s’est-il passé pour qu’on en revienne au point où nous en étions dans les années 1970? J’exagère, puisque la situation varie grandement selon les États, mais l’idée de base demeure : le pendule suit son va-et-vient. Avant la légalisation, l’avortement restait un soin nécessaire prodigué par certain.es médecins. Pour les femmes blanches aisées, il était plus facile de se faire avorter dans un autre État ou même, un autre pays. Cependant, pour les jeunes femmes provenant de milieux difficiles ou les jeunes femmes racisées, la sécurité de cet acte clandestin n’était pas assurée : les drames se déroulaient derrière des portes closes.
C’est dans les années 1960 qu’une vraie
mobilisation pour la légalisation de l’avortement se fait sentir. Grâce à l’arrêt Roe v. Wade, en 1973, l’avortement lors du premier trimestre de la grossesse est légalisé, partout aux États-Unis (Nesci, 2017). La décision permettait à chaque État d’ajouter des réglementations concernant la procédure. C’est ce qui a tranquillement enfoncé Roe v. Wade dans sa tombe. Les politicien.nes extrémistes ont mis en place le plus de lois possibles afin de restreindre l’accès à l’avortement. Pendant ce temps, les milit -ant.es anti-avortement terrorisaient les femmes et le personnel soignant. Le nombre d’actes criminels est stupéfiant : huit meurtres, neuf incendies, 14 victimes de violence et je pourrais continuer ainsi (Nesci, 2017). Les pro-vie (ou devrais-je dire, anti-choix) ont mené une lutte acharnée qu’iels ont finalement gagnée. Juste comme ça, c’est tout près de 50 ans qui sont retournés dans le placard en juin dernier (MorinMartel, 2022). La lutte pour la légalité de l’avortement doit recommencer.

La situation des femmes iraniennes est un autre exemple de cet effet de balancier. Sous la monarchie absolue, les femmes ne pouvaient pas aller à l’école et elles étaient soumises à la charia (Fontaine, 2022). Cependant, lorsque le pays était gouverné par la dynastie des Pahlavi, le sort des femmes a progressé. En effet, l’éducation était désormais à leur portée et, en 1936, le port du voile a été interdit dans les lieux publics. Quelques années plus tard, les Iraniennes obtenaient le droit de vote et de divorce. En 1979, les religieux.euses extrémistes
ont repris le pouvoir et la liberté dont jouissaient ces femmes, appartenant dès lors au passé (Fontaine, 2022). Aujourd’hui, après des années d’oppression, les Iraniennes sortent dans les rues accompagnées des hommes et des ainé.es. Un mouvement de solidarité incomparable a provoqué le soulèvement du peuple après la mort de Mahsa Amini. Cette dernière est décédée à la suite de son arrestation justifiée par le port inadéquat de son hijab (Fontaine, 2022). Des parallèles peuvent donc être établis entre la situation actuelle et celle d’il n’y a pas si long-temps. Ce pays se retrouve à la croisée des chemins et la suite est imprévisible.
Le Québec n’est pas à l’abri d’un potentiel effet yo-yo : les mouvements radicaux germent dans l’ombre et peuvent nous exploser à la figure. Durant la campagne du premier référendum, Lise Payette, ministre de la Condition féminine, avait prononcé un discours prônant l’égalité des sexes. Cela avait enflammé un mouvement au sein des femmes au foyer fédéralistes, donnant naissance aux Yvettes (Godin, 2004). Était-ce un mouvement antiféministe? La ligne est floue. Au Québec, nous nous souvenons, mais ce ne sera probablement pas assez face à de nouvelles vagues radicales.
J’écris ces propos de mon point de vue de jeune fille québécoise aisée. Pour moi, ce qui est bien, ce qui est vrai, je l’ai appris par l’éducation que j’ai reçue. À mon avis, l’avortement et l’égalité des sexes ne devraient plus être un débat. Je reconnais avoir de la difficulté à comprendre le point de vue opposé. Pour être totalement franche, je ne peux tout simplement pas envisager d’autres options comme étant valables moralement. C’est ce que je trouve fascinant :
le nombre d’angles par lesquels on peut percevoir un évènement. Lorsque nous nous si-tuons sur la plaque tournante, quelle direction prenonsnous? D’autant plus s’il s’agit d’une si-tuation à laquelle nous avons déjà été confronté.es. L’issue sera-t-elle la même? C’est un grand vertige qui s’installe en moi quand je songe à toutes les possibilités qui attendent le monde; toutes ces choses qui semblent acquises, mais qui peuvent rapidement nous glisser entre les doigts et, à l’inverse, tout ce que nous avons encore à gagner.
Références
Fontaine, M. (2022) Comment la condition des femmes a-t-elle évolué en Iran ?, https://www. geo.fr/geopolitique/de-la-revolutionconstitutionnelle-a-la-mort-de-masha-aminicomment-la-condition-de-la-femme-a-t-elleevolue-en-iran-211878.
Godin, S. (2004) Les Yvettes comme l’expression d’un féminisme fédéraliste au Québec, Mens, vol. 5, no. 1, p. 73-117. https://id.erudit.org/ iderudit/1024389ar.
Morin-Martel, F. (2022) Le renversement de « Roe v. Wade » suscite consternation et inquiétudes au Canada , https://www.ledevoir. com/societe/726864/la-classe-politiquecanadienne-denonce-le-renversement-de-roev-wade.
Nesci, C. (2017) Le terrorisme antiavortement aux États-Unis: Un état des lieux de la désunion sur le corps reproducteur à l’ère de Donald J. Trump, L'Homme & la Société, vol. 203-204, no. 1-2, p. 271-286. https://www.cairn.info/revue-lhomme-et-la-societe-2017-1-page-271.htm.
L’interdisciplinarité, solution moderne mal
aimée des institutions
D’un peu moins de 2 milliards d’êtres humains en 1920, nous sommes passés à presque 8 milliards en 2022, du premier avion à l’homme sur la lune en l’espace de 56 ans et des premiers ordinateurs personnels 8-bits aux téléphones portables 5G 50 ans plus tard. Un monde plus peuplé, plus technologique, plus complexe prend forme. Le domaine scientifique n’échappe pas à cette tendance : de nouvelles disciplines apparaissent et se spécialisent. Nous ne sommes plus médecins, nous sommes désormais cardiologues ou pneumologues, nous ne sommes plus naturalistes ni mêmes géologues, mais paléontologues ou pétrologues.
Par Ludovic Dufour, Chef de pupitre science et société
Bien que l’on se souvienne de Galilée principalement pour ses observations en astronomie, il était également mathématicien, inventeur, physicien et philosophe. Ses travaux se penchent sur les étoiles, les lunes et les planètes, mais aussi sur la conception de la lunette d’observation, le mouvement des objets, les pendules, les aimants, pour ne nommer que ces sujets. Un de ses héritiers contemporains, Stephen Hawking, se contente quant à lui de l’astronomie et de la physique, ses observations concernant principalement la gravité, les trous noirs et la cosmologie. Pourquoi n’aborder que ces disciplines ? Peut-être parce que nos connaissances sont telles qu’il devient difficile de maîtriser plusieurs domaines à la fois ?

Plus les connaissances du genre humain s’agrandissent, plus il devient complexe d’en maîtriser la matière. Les questions de chaque champ d’étude deviennent également plus complexes, poussant les chercheur.euses à allonger leurs parcours académiques pour réellement comprendre une discipline. Ainsi, les généralistes scientifiques n’existent plus, iels ont disparu au profit d’une approche spécialisée de la science (Understanding Science).
Simultanément, de nombreux enjeux nécessitent des réponses plurielles, qui ne peuvent être fournies par une seule branche de recherche. La crise climatique ne peut être résolue que par des climatologues, par exemple. Iels nous permettent assurément de comprendre l’évolution du climat, ses causes et ses conséquences, mais leurs angles de recherche, à eux seuls, ne permettent pas de formuler un portrait exhaustif global de la situation, ni de présenter
toutes les solutions envisageables. Il faudra alors des médecins pour comprendre les conséquences de la pollution sur la santé, des urbanistes pour imaginer des villes moins polluantes, des ingénieur.es pour concevoir des alternatives vertes — bref, il faut inclure plusieurs domaines alors même que les scientifiques deviennent plus que jamais spécialisé.es. Pour y remédier, certaines études tentent donc l’approche interdisciplinaire.
L’idée est bien simple : réunir des expert.es de différents milieux au sein de recherches communes, le plus souvent dans le but de répondre à des problématiques modernes précises auquel un seul champ ne peut présenter de réponses complètement satisfaisantes. L’un des précurseurs de cette approche, Theodore Brown disait que «[l]es problèmes qui nous défient aujourd’hui, ceux qui valent vraiment la peine de s’y attarder, sont complexes, demandent des équipements sophistiqués et des outils intellectuels, ils ne se résolvent pas à une approche étroite [traduction libre].» (Brown dans Ledford, 2015). De plus, les chercheur.euses estiment que des études communes entre sciences naturelles et sociales sont plus susceptibles d’être entendues par les décideur.euses politiques (prud’homme, 2015).
Si aujourd’hui l’idée prend de l’ampleur et apparaît dans de nombreuses universités, elle n’a pas toujours été très populaire. En 1983, Brown, alors vice-chancelier à la recherche de l’Université d’Illinois, imagine la création d’un institut défiant les modèles standards d'isolation des départements. Il propose au contraire d’encourager le partage des savoirs et le travail commun en recherche
dans le but de répondre aux problématiques modernes. Plusieurs de ses collègues s’opposent à l’idée, arguant que le travail en commun ne mène qu’à des discussions et pertes de temps inutiles, craignant que leurs subventions de recherches ne disparaissent dans ces nouveaux projets ou critiquant l’approche interdisciplinaire. Plusieurs entretiennent même la mentalité que l'interdisciplinarité est une approche prisée par celleux qui ne parviennent pas à se distinguer dans leur propre domaine (Ledford, 2015).
Ces oppositions sont encore présentes aujourd’hui. En 1998, les problèmes étaient similaires pour Richard Zare, qui souhaitait aider au lancement de l’Institut interdisciplinaire Bio-X. Bien que possédant déjà une solide réputation, il s’inquiétait d’aller à l’encontre de son département qui voulait le garder parmi son équipe de chercheur.euses. Il note encore aujourd’hui que la pression des institutions est encore plus importante pour de jeunes professeur.es (Ledford, 2015).
Des études suggèrent également que les recherches interdisciplinaires ont plus de difficulté à recevoir du financement. En examinant les 18 476 propositions d’études faites en l’espace de 5 ans au Conseil australien de la recherche, on constate que plus une étude relie des domaines diffé-
rents, aux approches éloignées, moins elle court la chance de recevoir une subvention de la part du Conseil (Bromham, 2016). Les membres des jurys soumettent les propositions d’études aux standards de leur discipline, même pour celles qui, par leur nature, rassemblent plusieurs domaines. Si les jurys ne modifient pas leurs attentes en considérant la nature interdisciplinaire des recherches, ils risquent davantage de les refuser (Daniel, 2022).
De même, la tendance des institutions à réfléchir strictement par domaine favorise les recherches traditionnelles et l’isolement des champs d’études. La plupart des journaux de recherche et des conférences ne concernent qu’une seule matière. Les chercheur.euses tendent également à n’interagir qu’avec les autres professionnel.les de leur discipline. Pareillement, la majorité des citations d’une publication renvoie à des travaux du même domaine (Daniel, 2022). Par conséquent, les options de publication, les espaces d’échange avec des collègues ou même les possibilités de recevoir des distinctions pour leur travail sont limités pour les chercheur.euses interdisciplinaires. Bien que certains journaux interdisciplinaires existent, iels sont généralement moins réputés et certain.es scientifiques remettent en doute la qualité de leurs publications (Ledford, 2015). Certain.es chercheur.euses prenant part active au
travail interdisciplinaire éprouvent même des difficultés à former leur identité professionnelle et à s’intégrer à des communautés professionnelles (Daniel, 2022).
D’un autre côté, on identifie des complications au sein même des équipes de recherches. D’abord, les chercheur.euses collaborant avec d’autres expert.es de domaines variés rencontrent des embûches de communication. Le jargon scientifique change d’un milieu à l’autre et plusieurs notent la définition divergente des termes comme étant un obstacle à la collaboration. De plus, on remarque aussi que les cadres théoriques et méthodologiques peuvent différer entre les domaines, ce qui force les scientifiques à réévaluer leurs approches (Daniel, 2022).
La collaboration entre sciences naturelles et sociales se relève particulièrement problématique. Les premières, souvent considérées comme plus rigoureuses et en plus haute estime chez les spécialistes, prennent le dessus sur les secondes. Certain.es scientifiques rapportent que les spécialistes des sciences naturelles peuvent être amené.es à considérer le travail de leurs collègues plus facile. D’autres remarquent que les sciences sociales sont parfois ajoutées à un projet pour cocher une case, pour


donner l’impression que les implications de l’étude sont plus grandes qu’elles ne le sont réellement, sans avoir la volonté d’inclure significativement le regard de la discipline dans le projet. Parfois, on inclut même les spécialistes des sciences sociales bien après que le projet ait pris forme. Ce débalancement crée des frustrations chez les chercheur.euses et peut grandement affecter la cohésion de l’équipe (Ledford, 2015, Viseu, 2015).
Malgré ces embûches, les recherches interdisciplinaires gagnent du terrain. Depuis les années 80, les travaux de recherche citent davantage d’ouvrages hors de leur discipline. Le nombre de recherches mentionnant l’interdisciplinarité a également augmenté, avec un pic clair dans les années 2010 (Van Noorden, 2015). Cependant, les divisions départementales restent puissantes. Nancy Anderson, co-présidente de la commission responsable du rapport Facilitating Interdisciplinary Research du US National Academies, indique que dix ans après le rapport, la majorité des universités n’ont pas apporté de changement significatif à leurs approches : « Les divisions départementales restent en place – et au pouvoir – dans la plupart des institutions (…) Ça a été une immense déception [traduction libre] » (Anderson, dans Ledford, 2015).
En résumé, maîtriser plusieurs domaines d’études est aujourd’hui une tâche titanesque alors même que nos problématiques modernes se complexifient et demandent des réponses multidimensionnelles. Plusieurs expert.es recommandent une approche interdisciplinaire afin d’apporter des solutions plus complètes. Toutefois, malgré certains progrès, nos institutions tardent à mettre en place des mesures adéquates pour soutenir ces études qui comprennent intrinsèquement de nombreux défis, notamment au niveau de la cohésion des équipes. C’est indéniable que le monde académique et scientifique doit s’adapter à cette nouvelle réalité, et rapidement. Si la communauté scientifique ne développe pas les outils nécessaires pour résoudre les problématiques urgentes d’aujourd’hui, qui d’autre pourra le faire ?
Références
Bromham, L., Dinnage, R. & Hua, X. (2016) Interdisciplinary research has consistently lower funding success. Nature Vol. 534, P. 684–687. https://doi.org/10.1038/nature18315
Daniel, K. L., McConnell, M., Schuchardt, A., & Peffer, M. E. (2022). Challenges facing interdisciplinary researchers: Findings from a professional development workshop. PloS one, Vol 17. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0267234
Ledford, H. (2015). How to solve the world's biggest problems . Nature, Vol 525, P.308–311 https://doi. org/10.1038/525308a
Prud’homme, J. & Gingras, Y. (2015). Les collaborations interdisciplinaires : raisons et obstacles. Actes de la recherche en sciences sociales, vol 210, P. 40-49. https:// doi.org/10.3917/arss.210.0040
Understanding science. Modern science: What’s changing? University of California Museum of Paleontology. https://undsci.berkeley.edu/modern-science-whatschanging/#:~:text=Specialization%20and%20 collaboration&text=Because%20of%20this%2C%20 modern%20scientists,of%20Darwin's%20study%20at%20 left
Viseu, A. (2015). Integration of social science into research is crucial. Nature, Vol 525, P.291 https://doi.org/10.1038/525291a
Van Noorden, R. (2015) Interdisciplinary research by the numbers. Nature, Vol 525, P. 306–307. https://doi.org/10.1038/525306a
Les élections américaines de mi-mandat: des résultats qui tardent
Depuis le 8 novembre dernier, les électeur.rices américain.es et les candidat.es républicain.es et démocrates sont en attente des résultats des élections de mi-mandat (midterms). L’occupation des deux chambres du Congrès y est disputée, soit le Sénat et la Chambre des représentant.es.
Par Sarah-Kate Dallaire, journaliste collaboratrice
Au moment d’écrire cet article, les Démocrates demeurent à la direction du Sénat avec 51 sénateur.rices élu.es contre 49 élu.es républicain.es, tandis que les Républicain.es mènent la course à la Chambre des représentant.es avec 212 élu.es contre 204 élu.es démocrates. Cependant, rien n’est définitif, puisque pour remporter la Chambre des représentant.es, un parti doit obtenir la majorité de la chambre en faisant élire 218 élu.es.
Ce qui est en jeu Les représentant.es élu.es seront en poste pour un mandat de 2 ans, soit jusqu’aux prochaines élections présidentielles, alors que les sénateurs.rices sont élu.es pour un mandat de 6 ans. Un tiers des sièges au Sénat sont remis en élections durant les élections de mi-mandat. Au-delà des sièges du Congrès, un contrôle important est en jeu: celui de l’agenda du gouvernement américain. En effet, l’élection de mi-mandat représente une opportunité pour les Républicain.es de reprendre le contrôle d’une partie du gouvernement et ainsi empêcher les projets de loi démocrates promis depuis l’élection du Président Biden. À l’inverse, si les Démocrates remportent une ou les deux Chambres du Congrès, cela permettrait au Président d’adopter davantage de lois. Le Président Biden demeure optimiste quant à l’issue des élections de mi-mandat et a affirmé dans son discours à ce sujet que c’était « une bonne journée pour l’Amérique, une bonne journée pour la démocratie et une forte soirée pour les démocrates ».
Le parti qui détient la majorité des sièges décide également de ce qui est traité au Congrès. Les deux partis promouvant des enjeux et des intérêts différents, la suite du mandat présidentiel pourrait centrer son attention sur le droit à l’avortement, le contrôle des armes à feu ou sur l’immigration et l’économie. Les deux partis entretiennent également des visions divergentes en ce qui concerne l'environnement et
l’appui militaire apporté à l’Ukraine, ce qui pourrait changer le cours des deux prochaines années du mandat Biden et dicter la saveur des relations internationales américaines pour les années à venir.
Pourquoi les résultats tardent-ils ? Plusieurs motifs sont à l’origine des délais de confirmation des résultats électoraux américains. Il y a notamment des délais en ce qui concerne la réception des militaires et des votes par anticipation. De plus, le compte de ces votes n’est pas effectué au même moment dans tous les États. En effet, les 50 États américains ont tous des règles différentes lors des élections : certains comptent les votes par anticipation au moment de leur réception, tandis que d’autres États attendent le jour même de l’élection pour commencer le compte.
Certains États pourraient également se voir forcer un recomptage des votes ou un second tour de scrutin. C’est le cas notamment pour l’État de la Géorgie, où la loi exige que le gagnant remporte plus de 50% des votes. Comme le candidat démocrate Raphael Warnock y a remporté l’élection avec 49,4% des votes, les électeur.rices sont convié.es le 6 décembre prochain à un second tour de scrutin. Cela pourrait retarder les résultats finaux des élections de mi-mandat jusqu’au décompte des votes du 6 décembre.
Des premières historiques
Plusieurs premières historiques ont eu lieu jusqu’à présent durant cette élection de mi-mandat. L’Alabama a notamment élu une sénatrice, Katie Britt (républicaine), pour la première fois, tandis Summer Lee (démocrate) est passée à l’histoire comme étant la prémière femme noire élue à la Chambre des Représentant.es de Pennsylvanie. Becca Balint (démocrate) est quant à elle la première femme et
la première personne LGBTQ+ élue à la Chambre des Représentant.es pour l’État du Vermont.
La Chambre des Représentant.es accueille également son premier membre Indo-Américain, Shri Thanedar (démocrate), ainsi que son premier membre appartenant à la génération Z, Maxwell Alejandro Frost (démocrate).
De plus, le parti républicain présente un nombre record de candidat.es racisé.es durant la campagne de mi-mandat.
Il sera ainsi important de suivre les impacts qu’auront ces vents de changements au Congrès américain et sur la suite du mandat Biden.
Sources: Al Jazeera Staff. (10 novembre 2022). The historic Firsts of the 2022 US midterm elections, Al Jazeera, https://www.
aljazeera.com/news/2022/11/10/the-historic-firsts-of-the2022-us-midterm-elections
Brice, M. (11 novembre 2022). Runoff election in Georgia may decide fate of U.S. Senate, again. Reuters, https:// www.reuters.com/world/us/runoff-election-georgia-maydecide-fate-us-senate-again-2022-11-09/
The Associated Press. (s.d). Midterm Elections 2022, The Associated Press, https://apnews.com/hub/2022-midtermelections?utm_source=apnewsnav&utm_ medium=featured

USA Government (s.d). Congressional, State, and Local Elections, USA Gov, https://www.usa.gov/midterm-stateand-local-elections

À la poursuite du bonheur
On entend souvent parler du bonheur. Qu’on le présente sous forme de moment, d’expérience, de produit ou même d'état d’âme, il est omniprésent autour de nous. Mais de quoi parle-t-on, lorsqu’on prononce le mot bonheur ? En français, le terme tire son origine de l’expression latine bonum augurium – littéralement « bon augure » –, qui renvoie à son caractère naturellement aléatoire, relevant surtout de la chance. Sa définition, cependant, l’aborde sous un autre angle. Frédéric Lenoir, philosophe et sociologue contemporain, définit le bonheur comme « la conscience d’un état de satisfaction global et durable dans une existence significative fondée sur la vérité. » (Lenoir, 2015). C’est ce sentiment qui a été et qui est maintenant plus que jamais recherché. Que ce soit par le biais de la religion, de la philosophie ou de la culture, y a-t-il réellement un moyen d’être heureux.se ?
Par Benjamin Rochon, journaliste collaborateurUn bonheur essentiel
Le bonheur, au sens littéral du terme, est un sentiment intrinsèquement lié à notre personne. Ce caractère subjectif le rend malléable, différent pour chacun.e, et c’est pourquoi il est possible de le créer, soit en modifiant ses pensées, soit en vivant en harmonie avec le monde, en appréciant chaque petit moment. C’est du moins ce que tente d’enseigner Épicure, philosophe grec de l’Antiquité, en discernant trois types de désirs : ceux qui sont naturels et nécessaires, ceux naturels et non nécessaires et, finalement, ceux ni naturels, ni nécessaires. Les premiers ont trait à nos besoins fondamentaux, comme manger et boire. Ils sont faciles à assouvir et procurent un réel plaisir. En effet, qui n’a jamais été heureux de boire pour étancher sa soif, ou d’enfin pouvoir prendre un bon repas lorsque la faim se fait ressentir ? Les deuxièmes sont semblables aux premiers, à cela près qu’ils ne sont pas utiles à la survie, mais qu’ils procurent tout de même un plus grand bonheur que les précédents. Par exemple, quelqu’un peut vouloir prendre un repas copieux, alors qu’il n’a besoin de manger qu’un mets simple, et de l’accompagner d’un verre de vin, tandis que de l’eau suffirait. Les troisièmes sont, selon Épicure, à éviter, voire à repousser, car ils ne mènent pas au bonheur, et peuvent même l’en éloigner. Parmi eux se trouvent les désirs de pouvoir, de richesse, et de tout ce qui concerne le « superficiel ». Vouloir les assouvir, c’est se lancer dans un puits sans fond, car ils ne peuvent jamais être comblés, le besoin étant toujours plus grand à mesure
qu’on obtient ce qu’on veut. Puisque le plaisir consiste à combler un désir, se lancer dans la quête d’objets inatteignables mène forcément au malheur. Ainsi, en méditant sur ses envies, on pourrait jouir des plaisirs simples en privilégiant les désirs essentiels, ceux naturels et nécessaires, et ainsi éviter le malheur, pour atteindre l’état d’ataraxie, ou l’absence de troubles dans l’âme.
Le bonheur sous contrôle
Alors qu’Épicure mettait de l’avant sa distinction entre les désirs comme méthode vers le bonheur, un autre courant de pensée, le stoïcisme, propose d’autres méthodes. Les stoïcien.nes prônent eux aussi un chemin vers la félicité, mais différent cette fois de celui des épicurien.nes. Iels proposent la dichotomie du contrôle. En d’autres termes, il faut que l’attention soit projetée sur ce qui peut être contrôlé, c’est-à-dire les jugements, les pensées et les idées, et non les évènements extérieurs à soi, comme la maladie, la famine ou la mort. De cette façon, il revient à chacun.e de décider si quelque chose lui fait du tort ou le.a rend heureux.euse. Par exemple, l’un.e pourrait voir une séparation comme une affliction, un malheur, et s’apitoyer sur son sort, alors que l’autre y verrait une occasion de se recentrer sur soi-même, de venir à la rencontre de ses émotions et de vivre sa tristesse avec bonheur. Comme le dit Épictète dans le Manuel , « N’attends pas que les évènements arrivent comme tu le souhaites ; décide de vouloir ce qui t’arrive et tu seras heureux. » Encore une
fois, même si les circonstances sont défavorables, il serait possible de bâtir son bonheur en concentrant son énergie au bon endroit, sur soi-même.
Être libre pour être heureux
Un troisième chemin mène également à la béatitude, mais il s’avère plus ardu que les deux premiers. Environ un siècle avant la naissance du stoïcisme et de l’épicurisme, le bouddhisme fait son apparition en Inde. Cette philosophie prône l’absence des désirs liés à la personne, à l’égo, afin de minimiser la souffrance. Ces derniers sont la source de nos malheurs, c’est pourquoi il est nécessaire de s’en libérer pour vivre heureux, pleinement dans le moment présent. Par la méditation et la réflexion sur soi-même, il est possible d’éliminer les souffrances liées aux désirs en se détachant d’eux, pour ainsi accéder à un état de bonheur profond. Vivre est alors plus simple, puisque les évènements et autrui ne sont plus tributaires de la paix intérieure. Selon les bouddhistes, une analyse de ses désirs, une méditation profonde sur ces derniers pour s’en dissocier et se libérer des aléas de la vie, il serait possible d’accéder à un bienêtre profond, inébranlable.
Le bonheur impossible D’autres, cependant, stipulent que le bonheur n’est pas accessible en ce monde, qu’il ne peut donc pas être créé. C’est entre autres le cas de Schopenhauer, selon qui
certaines personnes sont davantage susceptibles d’être malheureuses, car leurs gènes les y prédisposeraient. Cela a même été démontré par plusieurs études scientifiques menées aux États-Unis au cours des dernières décennies. C’est pourquoi il faut apprendre à vivre en harmonie avec sa nature. Quelqu’un.e de foncièrement heureux.se le restera, alors qu’une personne malheureuse, qu’adviennent les évènements, demeurera triste et verra plus souvent qu’autrement le mauvais côté des choses. Ce dernier ne pourra donc pas modeler son bonheur, car celui-ci dépend d’un facteur sur lequel il n’a aucun contrôle. Le philosophe allemand soutient aussi que les sentiments chez l’humain fluctuent entre l’envie et l’ennui, et qu’ainsi, il est mû à une profonde misère. En effet, lorsqu’un désir se manifeste, celui-ci occupe son esprit et il vient à en oublier son bonheur, et au moment où le besoin est assouvi, il s’installe un sentiment de lassitude : « La vie donc oscille, comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l’ennui », dit Schopenhauer (Lenoir, 2015). Il est alors impossible de fabriquer son bonheur, car, pour y arriver, il faudrait avoir un contrôle sur celui-ci, ce qui ne semble pas être le cas.
Outre Schopenhauer, un autre philosophe défend le parti du bonheur impossible : Emmanuel Kant. Selon lui, la seule façon d’être heureux est de mener une vie guidée par la morale, afin d’accéder à la béatitude dans l’au-delà, en
d’autres termes, après la mort. Après en être venu à la conclusion que personne ne peut être heureux.se ici-bas, il affirme que le seul moyen de pouvoir un jour goûter au bonheur est d’être modéré.e dans son existence, de vivre justement. De cette façon, Dieu accorde à celleux qui ont mené cette vie une joie éternelle. Cet argument est aussi celui de Jésus et de Socrate, c’est pourquoi les deux n’ont pas reconnu une grande importance à la mort qui les attendait, sachant qu’ils seraient aussi heureux, sinon plus, au ciel que sur terre.
Ce que Schopenhauer et Kant n’ont pas pris en compte dans leur raisonnement, c’est que même si le bonheur est en partie influencé par les gènes, il revient à chacun.e de le déterminer. Selon la professeure Sonja Lyubomirsky, du département de psychologie de l’Université de Californie, le bonheur dépend à 10% de l’environnement, à 50% des gènes et enfin, à 40% de la personne, c’est-à-dire de sa volonté à vouloir être heureuse (Lenoir, 2015). Ainsi, malgré une certaine prédisposition, il est possible de travailler sur ses sentiments, positifs ou négatifs, afin de maximiser, en durée et en intensité, les moments de plaisir. De plus, chaque désir assouvi procure une certaine joie, aussi brève soit-elle. Il serait alors faux d’assumer qu’aucun bonheur n’est possible, sous prétexte que les seuls sentiments sont l’envie et la lassitude. Quant à un espoir de félicité après la mort, il en revient à chacun.e de vouloir y croire, car nul
ne sait ce qu’il y a de l’autre côté. Le seul moyen de s’assurer une existence agréable est de cesser d’espérer et de vivre maintenant, de jouir de chaque instant de plaisir en pleine conscience, sans ruminer sur le passé ou anticiper le futur.
Choisir son chemin Somme toute, le bonheur semble bien simple au premier abord, mais il se révèle d’une grande complexité au fil de son étude. Les philosophes et scientifiques de toutes les époques ont tenté de percer ses mystères, par l’étude des sentiments qui lui sont liés, jusqu’à l’influence de notre sensibilité, nos gènes, sur celui-ci. Au final, même s’il n’est pas complètement sous notre contrôle, le bonheur dépend de chaque personne, de ce qu’elle est et de ce qu’elle est prête à faire pour le créer. Il n’est pas quelque chose qui doit être cherché, encore moins espéré, mais bâti. Faute de voir la vie comme un chemin triste, parsemé de moments heureux, pourquoi ne pas la voir comme un chemin heureux, parsemé de moments tristes qui, au gré des expériences, nous font grandir, forgent le caractère et donnent un sens à ce qu’on appelle le bonheur.
Références
Lenoir, F. (2015). Du bonheur, un voyage philosophique, 1re éd., France, CPI BRODARD ET TAUPIN, 229 pages.
Ski-Doo et chocolat chaud : habiter la culture hivernale

L’hiver est dans le vestibule et il arrive emmitouflé du combo tuque-manteau-foulard. Décembre: la neige, Noël et les séjours au chalet émergent illico à l’esprit. La saison froide, c’est aussi, plus simplement, une poignée de mois dans l’année où la vie continue son train, – on travaille, on se déplace, on fait du sport. On parle de l’hiver comme d'un élément identitaire très fort, mais la relation que les Québécois.es entretiennent avec lui est peut-être plus grise que rose.

Les cache-cous morveux sur les calorifères après une partie de hockey bottine
Toit pentu, une ou deux cheminées, infrastructure de bois, abris Tempo. On reconnaît bien vite l’influence du froid et de la neige lorsqu’on observe une typique maison québécoise.
Et après : ponts couverts, ponts de glace balisés, qamutik, motoneiges, chiens de traîneau, raquettes, balayeuses à rails de tramway. Le monde du transport a été façonné en fonction du climat – ce sont des gens bien inventifs qui ont habité de tout temps les contrées où nous nous trouvons.
Ajoutons finalement l’entraide au dépognage de char posttempête, la chasse-galerie, le carnaval, les veillées dansantes, le sirop d’érable qui accompagne le dégel. Ce sont d’autant plus d’éléments culturellement forts qui prennent tout leur sens dans l’hiver, et même qui le ponctuent.
Les peuples du Québec sont des peuples forgés par l’hiver, il n’y a aucun doute là-dessus. Les adaptations se marient à la réalité froide et nivale, elles embrassent les caractéristiques de l’hiver et contribuent à créer une relation positive entre les hivernants et leur environnement. À plusieurs égards, la société actuelle, par son organisation et ses technologies, s’est éloignée du milieu auquel elle appartient.
Il est tout à fait possible de s’isoler chez soi pendant plusieurs jours : le télétravail, la livraison de l’épicerie, ou encore le nombre incalculable de divertissements et de sociabilités accessibles par Internet facilitent la chose.
C’est une idée qui plaît sans doute à plusieurs, pour qui l’hiver est hostile. La marge du monde extérieur est peutêtre douillette et confortable, mais elle ne favorise ni la santé d’un individu ni celle d’une communauté.
De nombreux enjeux sociaux sont fortement liés à l’hiver et à sa mise en valeur en ville. La santé mentale (isolement, dépression), la santé physique (hospitalisation en raison de chutes, déclin de la pratique de sport et d'activités à l'extérieur) ou le sentiment de sécurité diminué en raison de la photopériode écourtée sont des éléments souvent nommés. Mais encore, les inégalités sont accrues au sein de la population – pensons à l’accès à des infrastructures diverses (loisir, sport, espace gratuit, mobilité douce) et à des services de base (eau, toilette, espace où dormir) pour certaines populations vulnérables. (Vivre en ville, 2018, p. 8) L’étude de l’hiver mobilise de nombreuses disciplines, et l’urbanisme et l’architecture ont un impact majeur dans la façon de vivre cette saison.
Les fruits des rosiers sauvages se cueillent après un ou deux gels
Culjat et Erskine (1988) observent que la fréquentation des espaces publics et les interactions sociales chutent considérablement lorsqu’il fait en deçà de 10 oC – autant dire que cela représente une grande partie de l’année au Québec. La notion d’espace(s) public(s) mérite en ellemême une réflexion approfondie, mais dans le cadre de cet article, limitons-nous à cette définition : « l’espace public, à la fois physique et communicationnel, [est] un espace de circulation réel et symbolique où le ‘‘public’’, de ses usages et pratiques, participe aux transformations de la vie politique et des relations sociales ». (Bolduc, 2019, p. 8) Ce sont les parvis d’église, les trottoirs, les parcs, les ruelles et les places centrales que la population peut investir et animer. Ces espaces jouent un rôle très important dans la ville; ils structurent comme ils permettent la socialisation et la qualité de vie. Ils mettent en outre un paysage – urbain ou pas – en valeur.
Si les espaces publics sont moins fréquentés en hiver, c’est entre autres parce qu’ils sont réfléchis en fonction de l’été – leur aménagement n’est pas résilient au changement de saison. Pourtant, le cadre bâti peut contribuer à améliorer l’expérience de l’hiver. La ville elle-même se forge ses propres microclimats, certains bons comme d’autres mauvais : corridors de vents entre les tours, îlots de chaleur, terrasses ensoleillées au moment opportun. On

appelle design bioclimatique la pratique qui tire avantage des caractéristiques particulières d’un lieu d’implantation afin de maximiser le confort. Certes, lorsqu’il s’agit de penser à la hauteur des bâtiments et la largeur de la rue, c’est une pratique qui se doit d’être réfléchie très tôt dans le processus de conception de la ville ou du quartier, mais il y a toujours moyen d’adapter a posteriori.
Parmi ces adaptations, le verdissement est très en vogue : les arbres, arbustes et fleurs sont des éléments ajoutés que l’on utilise pour casser les îlots de chaleur. Les végétaux, dans une optique de visualisation quatresaisons, doivent être plantés en considérant leur résistance aux sels de déglaçage et leur attrait visuel une fois le temps froid arrivé – l’hiver urbain passe rapidement du blanc au brun, mais le cornouiller conserve son rouge, le sumac vinaigrier garde ses fruits, certains roseaux s’étirent audessus de la neige et les conifères restent verts. La couleur est de mise, par les végétaux et autres dispositifs, pour égayer la grisaille ! Par ailleurs, sachant que la course du soleil est plus anguleuse dans le ciel de l’hiver, sa trajectoire est pertinente à considérer pour mettre en valeur les rayons dans la ville. Il y a place à la créativité pour la valorisation de microclimats; ça concerne l’orientation des terrasses, des rues et des bâtiments, l’utilisation de couleurs claires sur ceux-ci, l’usage de vitres et miroirs, la disposition stratégique de mobilier urbain pour prendre des bains de soleil. Ces actions maximisent le confort par rapport au vent, à la neige, à la sloche et à la glace, et rendent la circulation plus sécuritaire.
La baisse de la fréquentation des espaces publics est par ailleurs corrélée avec la réduction de l’achalandage des commerces des les artères principales, en particulier les restaurants et commerces semi-courants. (Vivre en ville, 2018, p. 8) Peut-être que leur accessibilité n’est pas optimale en hiver ? Que les rues ne sont pas assez conviviales pour générer un trafic piétonnier ? La ville de Luleå, en Suède, fait circuler sous les trottoirs, dans des tuyaux en serpentin, des rejets d’eau chauffée en provenance des industries pour faire fondre la neige. (Vivre en ville, 2018, p. 38) Elle laisse aussi le centre de la rue couverte de neige pour qu’elle puisse être employée avec des traîneaux. Il y a certainement de quoi s’inspirer pour décupler l’attrait des artères aux commerces ayant pignon sur rue.
Voilà la bataille des villes nordiques : minimiser les inconforts de l’hiver, mais le mettre en valeur. Et cette mise en valeur, elle passe par la création d’opportunités et de lieux où interagir avec.
Faire des bonhommes de neige dans la rue en attendant l’autobus Legault (2013) observe six types d’espaces publics ayant des qualités intrinsèques en l’hiver. D’abord, l’étendue d’eau a un fort potentiel étant donné le grand espace vierge qu’il représente, où une grande variété d’activités peuvent

avoir lieu : patin, ski de fond, spa nordique, kite skiing, pêche sur glace et ainsi de suite. De grands vents balaient souvent ces espaces dégagés, il faut donc penser à des structures coupe-vent. La forêt est de son côté un lieu magnifiquement enneigé et bien à l'abri des courants d’air, particulièrement appréciée pour les balades à pied ou en raquette. La nuit y tombe bien vite, par contre. Souvent davantage présente en ville et plus accessible, la pente est l’endroit de prédilection pour les jeunes qui aiment glisser en crazy carpet et en snowskate. On s’approprie facilement une côte et les différentes configurations laissent place à toutes sortes de dérivés : toit en versant d’un bâtiment, énorme amas de neige, escalier condamné pour l’hiver, dénivellation naturelle. Le parc hivernal est pour sa part un lieu propice au rassemblement des diverses activités hivernales, comprenant un chalet pour se réchauffer. On peut penser aux arts qui peuvent tirer avantage de la neige et/ou de la noirceur : jeux de lumière, théâtre extérieur, sculptures de neige et de glace. Foyers, curling et patinoires y ont également une place de choix. Puis, c’est sur la place publique compacte que se tiennent de manière optimale les marchés, commerces, spectacles, fêtes et festivals et autres événements. Legault remarque qu’en Scandinavie, la place publique se limite généralement à une trentaine de mètres de longueur afin de créer un microclimat intime. Finalement, la rue piétonne profite des qualités de la neige : conserver des rues blanches permet les terrasses hivernales, l’usage créatif de la neige, les illuminations, et permet éventuellement de relier les différents espaces où l’on utilise ski de fond et traîneaux.
On peut grandement s’inspirer des idées soulevées par Legault, qui spécifie par ailleurs que ces espaces d’intérêt seraient d’autant plus intéressants si connectés entre eux, valorisant ainsi une transition facile et active entre le sport, les courses et la maison. Les sports et les loisirs doivent absolument être mis de l’avant, ils sont bien souvent la porte d’entrée à l’appréciation de l’hiver, tout en rompant l’isolement. En ville, rares sont les parcs linéaires reliant les milieux naturels qui permettent des activités comme le ski de fond. Québec a la chance d’avoir la rivière SaintCharles – les chemins de fer sont une autre piste intéressante à explorer. Le grand défi est de garder en tête que la variété des usages doit être respectée : le vélo d’hiver mérite d’être mieux desservi, et les espaces de balade doivent continuer à exister, tout en accommodant les activités saisonnières.
Tire ta beanie su’ tes oreilles, on sort jouer dehors La vie attire la vie et prenant le soin de mettre en place des
lieux jolis et conviviaux, les citoyen.nes de la ville auront l’occasion de redéfinir leur rapport à l’hiver. La neige est un magnifique médium qui est ô combien sous-utilisé : on désire la déplacer et l’éliminer, on ne lui concède que très peu de place. Dans l’optique de mieux l’intégrer à la ville, la créativité de toustes et chacun.e sera de mise afin de redorer son image. Il faudra jouer avec le beau manteau blanc dont parlent les poètes et le sculpter à nos couleurs – chaque tempête de neige est une occasion renouvelée. Nous devrons voir l’hiver comme un canevas d’opportunités plutôt que comme un lot de contraintes. Habiter cette saison comme elle le mérite, quoi !

Les impacts négatifs de l’hiver sur la santé des citadin.es peuvent tout à fait être altérés par un aménagement convenable des villes, quartiers et espaces publics. Ainsi qu’en soignant la relation qu’on entretient, individus comme collectivités, avec cette saison. Ça passe par l’adoption du vélo d’hiver, par l’acceptation que les tempêtes immobilisent, par la priorisation du déneigement des trottoirs, par la pose de guirlandes lumineuses, par le pelletage des escaliers des voisin.es âgé.es, par le choix de végétaux colorés toute l’année.
Normand Cazelais partage dans son livre une vieille liste d’un vieux magazine intitulée « Dix conseils pratiques pour mieux supporter l’hiver » (2017, p. 101). Comme quoi la
hantise de l’hiver ne date pas d’hier non plus. Pour ma part, je ne la trouve pas si désuète – elle m’a fait sourire et j’en prends bonne note.
- Envisagez l’hiver positivement
- Nourrissez-vous convenablement
- Vivez au grand air
- Gardez la forme
- Recevez à la maison
- Faites une bonne action
- Faites le ménage d’hiver
- Variez vos habitudes
- Prenez un congé
- Entourez-vous de lumière
Références
Bolduc, C. (2019). Cadrer la beauté : recherche-action par l'art, engagement et agentivité dans l'espace public de Limoilou [mémoire de maîtrise, Université Laval]. CorpusUL. http://hdl.handle.net/20.500.11794/33938
Cazelais, N. (2017). Vivre l'hiver au Québec (2e édition revue et augmentée). Fides.
Culjat, B., Erskine, R. (1988). « Climate-responsive social space: A Scandinavian perspective », J. Mänty et N. Pressman (dir.), Cities Designed for Winter, Helsinki, Building Books, 1988, p. 347-363.
Legault, O. (2013). « Le design hivernal des espaces publics : Études de cas scandinaves ». Imaginaire Nord.
Vivre en ville (2018). Ville d’hiver: principes et stratégies d’aménagement hivernal du réseau actif d’espaces publics montréalais, (coll. Vers des collectivités viables).

Rencontre des genres vidéoludiques
Pour nous simplifier la vie, nous catégorisons les choses. Que ce soit la littérature, le cinéma, la science, la géographie, la nature ou les langues, chaque chose doit avoir sa place assignée. Même les individus n’y échappent pas, on se classe par signes, personnalité, genre, âge, tous dans notre petite boîte confortable. Même si elles sont souvent un peu abstraites, ces classifications nous aident à comprendre le monde. Elles sont si pratiques que nous subdivisions toujours plus. Non contents d’avoir les règnes et les classes pour classifier le vivant, nous avons encore les embranchements, les ordres, les familles et les genres, question d’emboîter les catégories les unes dans les autres. Pourtant, nous souhaitons nous éloigner du cadre et pour se faire, nous faisons fi du classement ou nous mélangeons les idées. Avec le comique et le tragique, nous créons le tragicomique, avec un documentaire et la fiction, le docufiction. Dans l’espoir d’apporter quelque chose de neuf et de rafraîchissant, nous mélangeons les genres, que ce soit dans la littérature, le cinéma ou le jeu vidéo.
On peut distinguer deux manières de croiser les genres dans le jeu vidéo. La première, qu’on pourrait qualifier d’approche combinée, tente de croiser réellement plusieurs styles au sein d’un seul gameplay. Par exemple, Slay the Spire combine à la fois les éléments d’un roguelike1 et d’un deck-building game2 . On y escalade une tour dans le but d’atteindre le sommet et le boss final. Se faisant, le.la joueur.euse devra prendre plusieurs décisions, d’abord sur le chemin à suivre et la manière de construire son deck. Dois-je braver le chemin le plus difficile dans le but d’avoir de meilleures récompenses pour plus tard, ou au contraire prendre le chemin aisé, mais risquer de me retrouver trop faible pour la suite ? De même, on doit appliquer des choix stratégiques à la composition de notre deck, puisque c’est lui qui est utilisé lors des combats. Dois-je améliorer mes cartes, en prendre de nouvelles, en retirer ?


1 Sous-genre du RPG caractérisée par l’exploration de donjon, les combats au tour par tour, l’environnement créé de manière procédurale (c’est-à-dire généré de manière aléatoire par un ordinateur en suivant certaines règles prédéfinies) et la mort permanente des joueur. euses.
2Jeu de cartes où, au travers la partie, les joueur.euses modifient à leur pioche (le deck). Ils vont donc tenter d’en retirer les cartes les moins utiles tout en en ajoutant de meilleurs.
Ici, les éléments du roguelike et du deck-building sont tant interreliés qu’on ne peut imaginer l’un sans l’autre. Nous ne passons pas d’un genre à l’autre durant notre séance de jeu, nous les expérimentons simultanément. Les deux styles se complimentent l’un l’autre, l’aléatoire et la tension permanente du roguelike mettant encore plus de poids aux décisions du deck-building. On parvient avec ces croisements à briser le moule, à créer de l’original à partir de règles et de conventions préétablies en les plaçant dans un autre contexte.
La seconde méthode, que l’on pourrait qualifier d’approche séparée, délimite plus clairement deux gameplay différents, mais parfois complémentaires. Par exemple, Mount and Blade 2 : Bannerlord propose à la fois stratégie et action dans deux séquences séparées. On y incarne le.la chef.fe d’une bande armée. L’aspect stratégique consiste à maintenir des économies suffisantes pour pouvoir payer ses troupes, ne s’engager que dans des affrontements gagnables, assembler une armée de qualité et jouer d’un peu de diplomatie. Le côté action se manifeste lorsque notre armée en affronte une autre, à ce moment, en plus d’ordonner à ses troupes, on prend également directement le contrôle de notre personnage sur le champ de bataille.
Contrairement à d’autres jeux qui nous placent bien audessus de nos troupes où l’on se contente d’indiquer à ses régiments comment s’y prendre, ici on se retrouve au cœur du chaos de la mêlée. Transférer le.la joueur.euse d’un

rôle reculé et d’étendu, à acteur.rice actif.ve brise de belle manière la répétition d’une boucle de gameplay qui peut s’essouffler à la longue. Le mixage est d’autant plus intéressant quand les deux genres influent l’un sur l’autre. Une bonne performance dans la partie action peut renverser le cours d’une bataille pour offrir une victoire inespérée qui se reflète dans l’aspect stratégie. Au contraire, une bonne gestion de ses économies peut permettre des dépenses dans l’équipement du personnage pour ainsi améliorer ses performances lors des affrontements. De même, le jeu inclut des éléments RPG qui impactent et sont impactés par les deux genres. Par exemple, si le personnage combat beaucoup à cheval, il gagnera des niveaux en équitation. Ces niveaux l’amélioreront directement, avec une plus grande vitesse et un meilleur contrôle de sa monture, et procureront des avantages stratégiques, avec une armée qui se déplace plus rapidement sur la carte.

Évidemment, l’hybridation des genres ne comporte pas que des avantages. Après tout, il y a de bonnes raisons pour lesquelles les cadres sont créés et en sortir comporte son lot de risques. Si Slay the Spire combine si bien ses roguelike et deck-building, tous les autres styles ne se marient pas forcément aussi bien. Pour bien fusionner deux types, il faut en comprendre le fonctionnement afin d’en faire ressortir les forces sous un nouveau jour.

Une approche séparée inclut encore bien d'autres difficultés. D’abord, chaque joueur.euse n’aime pas tous les genres. Plus on inclut de gameplay plus on risque d’être forcé dans une direction qu’on ne veut pas prendre. Pour revenir à Mount and Blade, un.e admirateur.rice de stratégie pur et dur ne trouvera définitivement pas son compte s’iel n’aime pas au moins un peu les phases d’actions. On peut cependant limiter ces risques en laissant plusieurs options disponibles. Par exemple, Deux Ex peut être approché à la fois comme un jeu d’infiltration ou comme un shooter, selon la méthode que l’on préfère. Il reste cependant toujours un problème de taille pour les concepteur.rices, c’est qu’à créer plusieurs gameplay simultanément ils créent en réalité plus d’un jeu à la fois. C’est un obstacle technique de taille, car en divisant ainsi ses efforts, on sacrifie la qualité des deux styles. Il est bien plus facile de se concentrer sur un seul genre et d’être certain de produire de la qualité que de faire, avec les mêmes ressources, deux gameplay d’aussi haut niveau.
En réalité, les jeux qui prennent cette approche font souvent pâle figure face à leurs homologues si l’on ne tient en compte qu’un seul genre. Pour reprendre encore une fois Mount and Blade, c’est l’interaction entre stratégie et action qui donne sens au jeu. Si l’on prend ses aspects séparément, la stratégie a un manque flagrant de profondeur, notamment au niveau de la diplomatie et la gestion de
villes, de même pour l’action qui n’est pas aussi détaillée qu’un Elden Ring ou Kingdom Come : delivrance.
En bref, la rencontre des genres vidéoludiques est un excellent moyen d’apporter du nouveau ou d’offrir plusieurs gameplay dans un seul jeu. La première approche permet d’aborder des formules connues sous un angle original, de parier sur les forces d’un style pour en faire ressortir de nouveaux aspects. Quand c’est bien fait, on crée non seulement un excellent titre, mais parfois on inspire aussi un nouveau genre. Par exemple, Borderlands a largement popularisé, voir complètement inventé, le looter-shooter3 , en mélangeant jeu de tir à la première personne avec les mécaniques de loot de RPG. La seconde approche permet pour sa part de changer de style au milieu d’une séquence de jeu est un excellent moyen de varier le rythme d’un jeu et de garder son audience intéressée. Cette approche est particulièrement intéressante quand les genres s’influencent l’un l’autre. On ne pourra cependant pas toujours étoffer les différents genres abordés autant qu’un jeu à genre unique. Concluons maintenant cette analyse du mélange des genres en présentant quelques jeux hybrides que nous avons pu essayer.
3Le looter-shooter est un jeu de tir à la première personne où le.la joueur.euse améliore continuellement son équipement en accomplissant des missions et en pillant ses ennemi.es. Ce qu’iel y trouvera est en grande partie le produit du hasard, ce qui peut produire des combinaisons d’armes et d’équipement uniques.
Barotrauma
Création d’Undertow Games et FakeFish Games, Barotrauma présente un futur dans lequel les humains ont colonisé la lune de Jupiter Europe. La vie étant impossible à la surface irradiée de la lune, les colonisateur.rices ont établi une nouvelle civilisation sous la glace, au creux de profonds océans. Dans cet environnement hostile, la survie des habitant.es est assurée par les équipages de sousmarins qui s’assurent du commerce, du transport de personnels, de l’exploration et de la défense contre les pirates et la faune qu’abritent les profondeurs. Heureux mixage de simulation, survival horror, jeu de rôle, jeu de tir et coopération, on y incarne un des courageux matelots bravant la mer.
Bien que jouable seul.e, il est préférable de s’y attaquer à plusieurs, chacun.e ayant son rôle bien précis à bord, comme capitaine, mécanicien.es ou docteur.es. La coopération et la coordination seront mises à rude épreuve dans un jeu qui ne fait pas de cadeaux où la tension est constamment élevée. La mort rôde sous la glace. Pirate, extraterrestre, mouvement d’iceberg, pression, asphyxie ne sont que quelques-uns des dangers qui guettent les équipages et tout peut rapidement tourner à la catastrophe. Les genres s’y chevauchent autant qu’ils se séparent. Quand l’on pense à économiser les munitions on fait dans la simulation et le survival horror , quand on se retrouve dans une fusillade avec des pirates, on fait dans le jeu de tir. Disponible en accès anticipé depuis 2019, il présente

cependant beaucoup de contenu pour un jeu toujours en développement.
Spell Force 3 : Reforced
Spell Force, développé par Grimlore Games, combine les éléments d’un jeu de stratégie à temps réel et d’un RPG. Une sorte de bien heureux mélange entre Baldur’s Gate et Age of Empires. Dans la première partie on fait tout ce qui est classique dans un RTS, construction de bâtiments, recherche de technologie, balancer l’économie et assembler une armée dans le but d’éradiquer son adversaire. Dans la seconde, c’est un groupe d'aventurièr.ere que l’on contrôle, avec toutes les mécaniques associées aux genres, classes, montée de niveau, équipement, habileté spéciale, choix de dialogue et quête. Cependant, les deux genres s'emboîtent quand ces héro.ïnes prennent la tête des armées. On se retrouve alors à gérer les deux aspects à la fois. De nouveaux choix stratégiques sont donc créés ; dois-je dépenser mon expérience pour des aptitudes qui vont améliorer mon personnage ou pour celles qui vont améliorer son armée ?

La campagne principale nous plonge dans un monde médiéval fantastique où se croisent guerre civile, intrigue politique, épidémie et fanatisme dans un scénario des plus mystérieux. On y alterne du pur RPG aux savants mélanges
avec le RTS selon les besoins de l’histoire qui nous présente progressivement ces mécaniques. Seul hic, comme tout jeu de stratégie en temps réel, on ne peut se permettre de perdre le moindre instant, ce qui devient parfois problématique lorsque l’on veut prendre le temps de réfléchir à sa progression dans les niveaux.

Valkyria Chronicles

Développé par la célèbre compagnie SEGA, Valkyria Chronicles nous amène sur les champs de bataille d’Europa, une version alternative de l’Europe, dans un conflit vaguement calqué sur la Seconde Guerre mondiale. On y dirige la 7e escouade du 3e régiment de la milice de Gallia contre les forces de l’Alliance Impériale de l’Europe de l’Est suite à l’invasion du pays, le tout étant raconté dans une série d’épisodes aux styles graphiques qui comblera les fans d’animé japonais. L’action se déroule dans une étrange, mais rafraichissante, rencontre entre stratégie au tour par tour et jeu de tir à la troisième personne.
Le jeu nous fait progresser dans une série d’opérations avec des objectifs précis, défendre un point, capturer un secteur, neutraliser tous les ennemis, etc. Nous avons un nombre d’actions limité par tour, ce sera à nous de voir comment les utiliser les plus efficacement pour parvenir à
la victoire. On aura plus tard accès à des technologies pour augmenter l’équipement et de l’expérience pour nos soldat.es, à nous de voir comment optimiser nos troupes.
Où est la place du jeu de tir dans tout ça ? Eh bien c’est qu'aucun ordre n’est donné, car c’est au.à la joueur.euse de les réaliser lui.elle-même en prenant directement le contrôle de chacun.e de ses soldat.es. On se retrouve donc en pleine ligne de front et c’est à nous de prendre le chemin le plus sûr, d’éviter les tirs ennemis et d’attaquer efficacement. La situation devient particulièrement tendue lorsque notre plan, bien ficelé lors de la phase de planification, se retrou-ve face à l’inattendu, comme un ennemi embusqué lors de l’exécution. On doit alors imaginer une autre approche, ce qui n’est pas aisé quand les balles tombent tout autour.
Foxhole
Le jeu massivement multijoueur Foxhole, développé par Siege Camp, offre un mélange unique de stratégie, de coopération, de jeu de tir et d’infiltration. Des centaines de joueur.euses prennent part à un conflit opposant deux factions en incarnant les soldats sur les champs de batailles. Iels tenteront de prendre des points stratégiques et de faire progresser leur ligne de front durant des guerres qui peuvent s’étirer sur plusieurs semaines. Le caractère
unique du jeu se déroule cependant plus loin de la ligne de front.Hors des affrontements, une tout autre part de gameplay a lieu où le reste de l’équipe s’assure de produire les équipements dont leur coéquipier.ères ont besoin. Il faudra également transporter ses ressources jusqu’aux champs de batailles. Dans un autre ordre d’idée, les bases et les défenses des équipes sont aussi construites à partir de ces ressources et organisées par les joueur.euses. Donc un assaut réussi sera souvent suivi de l'arrivée d’une équipe d’architectes mettant en place les tranchés, bunkers, mines et obstacles antichars en préparation à une contre-attaque.
Ainsi on comprend que le tout demande communication et coordination pour que chaque front soit ravitaillé convenablement. On retrouve donc une carte globale où les demandes du front, des demandes telles que besoin de matériel médical, besoin d’armes antichar ou besoin de munitions, sont communiqués aux équipes de logistiques. Ces demandes étant particulièrement importantes, des groupes bien organisés peuvent s’infiltrer derrière les lignes ennemies pour déstabiliser ces chaînes d’approvisionnement. La coopération est de mise et chaque parti doit faire sa part pour assurer la victoire de son équipe dans ce jeu où chaque action peut avoir des conséquences directes sur l’avenir du conflit.
ÉCOUTE LOCAL 25 ans de CHYZ
ÉMISSIONS RETOUR ET NOUVEAUTÉS
Question de savoir

Question de savoir, c'est votre demi-heure d'actualité sur l'éducation supérieure présentée par l’Association des étudiantes et des étudiants de Laval inscrits aux études supérieures (AELIÉS).
Enjeux politiques, vie universitaire, recherche scientifique, perspectives d'avenir et bien plus sont à l'honneur de ce rendez-vous hebdomadaire mettant en vedette les étudiant.es membres de l'AELIÉS.
Tous les mercredis, de 11 h à 11 h 30.
West Indies

Un jeudi sur deux, rejoignez Jonathan Vallet, aka OiO, pour une soirée de musique Reggae comme aucune autre. Depuis 20 ans, West Indies livre une ambiance décontractée et ensoleillée dans les haut-parleurs des auditeur.trices de CHYZ 94,3. À ne pas manquer, entre 20 h et 21 h !

Chilule Pilule

Chilule Pilule est une émission axée sur la découverte musicale, mettant de l’avant de la musique émergente de France et ailleurs dans le monde. En mélangeant variété française, dreampop et synthpop à diverses formes de musique électronique, il s’agit d’un cocktail idéal pour la détente en fin de soirée.






Tous les mercredis de 22 h à 23 h 30.
Dans la mire climatique


Dans la mire climatique est l’émission de vulgarisation scientifique sur la politique et la justice climatique. Animée par Jeanne Desrosiers, Marie-Félixe Fortin et Naomi Laflamme, c'est tous les mardis de 11 h 30 à 12 h sur les ondes de CHYZ 94,3.


ARTS ET LITTÉRATURE
Sorties littéraires
À boutte : Une exploration de nos fatigues ordinaires – Véronique Grenier – Éditions Atelier 10

Quatrième de couverture : La technologie ne nous a pas libéré•e•s de nos quotidiens surchargés, contrairement à ce qu’on nous avait promis. Et il ne semble pas y avoir assez de café et de boissons énergisantes pour transcender la fatigue des jours et de nos vies numériques. Véronique Grenier se lance dans une « odyssée de la fatigue » pour explorer ce qu’elle appelle nos fatigues ordinaires, celles qui nous sont intimes, mais qui nous définissent aussi socialement. Car être fatiqué•e, c’est être occupé•e, et regarder nos fatigues, c’est affronter notre rapport au temps.
Pourquoi sommes-nous à ce point épuisé•e•s ?
Certaines fatigues nous dépassent-elles ?
Avons-nous un peu de prise sur elles ? L’autrice, « fatiguée depuis l’enfance », cherche à répondre à ces questions et en profite pour parler de parentalité, de luttes et de vêtements mous.
Histoires saintes – Carole David – Éditions Les Herbes rouges

Quatrième de couverture : Dans une ambiance kitsch ravivant le quartier Villeray des années quatre-vingt-dix, la vérité s’effiloche pour laisser voir au-delà : un univers fantasmé issu des plus grands espoirs de personnages coincés dans leur vie étriquée. Ici, l’ordinaire d’un séjour à la campagne ou d’un souper de Saint-Valentin se fait le terreau d’une transformation, d’une révélation. Ces Histoires saintes montrent avec grâce et concision douze instants où le voile entre les mondes, entre la réalité et le rêve, s’amincit pour laisser voir quelques pulsions secrètes.
On s'en fout quand on est mort – Joann Sfar–Éditions Gallimard


Quatrième de couverture : Une réflexion sur la transmission ainsi que l'influence de l'art et de la littérature dans laquelle l'auteur évoque sa vie de dessinateur, de professeur aux Beaux-Arts, son rôle de père ou encore sa passion pour la guitare.
Je ferai battre le coeur des pommes – MarcAndré Foisy – Éditions Le Noroît
Quatrième de couverture : Je m’arrête ici. Un regard se pose au plus près de vivre. L’instant capté est à la fois fragile et immense : ce n’est pas rien, un corps, dehors. Comment mesurer la distance entre ce que l’on perd et ce que l’on laisse, entre les limites de soi et celle du monde, entre le vaste et le petit ?
Le quotidien devient le témoin d’une tendresse cachée où se fabrique, par fragments, une mythologie de l’intime et de la solitude : un matelas, une fleur, la neige. Est-ce le matin ou la chambre noire qui révèle en premier ce qui nous reste ?
Je ferai battre le cœur des pommes n’est pas un testament. C’est une lettre d’amour à ce qui nous dépasse et nous survit. Avec des photographies de l'auteur.
Lire autrement
La révolution numérique des dernières décennies nous a amené.es à revoir notre rapport à la littérature et au livre papier. Des liseuses aux tablettes, de l’expansion d’Internet aux nouvelles formes de spectacularisation, la littérature s’est peu à peu émancipée du livre canonique tel qu’on l’envisage actuellement, et ce, dans une perspective d’expérimentation des médiums et des modes d’énonciation, tout en tentant de s’adapter aux nouveaux impératifs technologiques et économiques. Pendant longtemps, le support numérique était considéré comme incompatible avec le format papier, plusieurs voyant en ces changements une révolution qui annoncerait la mort du livre, rien de moins. Ce que l’on constate, en revanche, c’est davantage une coexistence des médiums, voire une relation de complémentarité contribuant à des littératures plurielles et surtout hétéroclites. Nous avons plus affaire à un décentrement du processus de création, d’édition et des modes d’appréhension qu’à un effacement d’une forme au profit d’une autre. L’hybridité de ces formes, notion clé, sera l’angle préconisé par notre survol.
Par Frédérik Dompierre-Beaulieu, cheffe de pupitre aux arts et William Pépin, journaliste multimédia
Que sont les arts littéraires ?

D’emblée, il convient de préciser et de définir certaines notions. Qu’entend-on par « arts littéraires » ? Et surtout, qu’impliquent-ils ? Essentiellement, les arts littéraires regroupent autant de pratiques que de modalités exploratoires et expérimentales, constituant par le fait même une constellation de manifestations littéraires. Ces dernières, différemment situées, concernent des créations dites hybrides qui tentent d’inscrire la littérature en dehors de sa forme livresque habituelle. D’ailleurs, le fétichisme de cette forme classique semble parfois prendre racine dans une nostalgie primant sur un rapport évolutif à l’avenir et au devenir de la littérature. En résultent des œuvres inattendues qui forcent le public à reconsidérer ce qui fait d’une œuvre une œuvre littéraire. Par ces médiations, aussi variées soient-elles, les arts littéraires nous invitent à créer et recevoir des imaginaires textuels et narratifs différents. La question du support en devient tout de suite pertinente, voire centrale. Bien que ce dernier n’appelle pas de contenus spécifiques, un lien étroit se tisse entre la création de l’œuvre littéraire et le média. Il faut comprendre que, malgré tout, le support n’est pas neutre, en ceci qu’il influence la manière dont on expérimente et construit l’œuvre, notamment car elle profite de son environnement médiatique. On parlera alors des propriétés dynamiques des arts littéraires et de leurs supports, c’està-dire de leurs incarnations et des façons dont elles transmettent le sens de l’œuvre. D’après les travaux faits par l’organisation Littérature québécoise mobile (LQM), soit un partenariat interuniversitaire (Université du Québec
à Montréal et Université Laval), ces incarnations se déclinent selon trois catégories : la spectacularisation, l’exposition et la médiatisation.
« [L]es arts littéraires désignent les pratiques littéraires où il y a la présence d’une dimension créative (excluant ainsi les pratiques de médiation et de patrimonialisation de la littérature), impliquant la publication d’un texte littéraire (au sens d’une mise à disposition publique, qu’elle soit pérenne ou éphémère – le livre étant la voie dorée empruntée depuis des siècles, d’où l’idée de s’intéresser à d’autres modalités de publication). » (Laboratoire Ex Situ, 2022, paragr. 2)
En ce sens, le chantier Nommer les arts littéraires, mené par l’équipe de Québec du partenariat LQM, a pour objectif de mieux cerner ce que sont les arts littéraires pour ainsi contribuer à leur valorisation. (Laboratoire Ex Situ, 2022, paragr. 5). La première étape consistait à produire une typologie des arts littéraires, que nous présentons à la page suivante. À noter toutefois que ce tableau fait partie d’un vaste chantier qui débouchera en second lieu sur le classement des œuvres d’arts littéraires dans une base de données pour en saisir l’évolution des pratiques au fil du temps. Ce travail témoigne, d’une part, de la complexité soulevée par l’hybridité des arts littéraires et, d’autre part, de la difficulté de catégoriser certaines œuvres qui vont forcément persister dans les angles morts typologiques, comme nous le verrons au fil des exemples convoqués.
La question du storytelling transmédiatique
Sachant qu’une œuvre d’art littéraire peut être composée de plusieurs modes d’expression et supports, nous nous sommes demandé quels procédés permettent de lier les parties entre elles pour constituer un tout narratif qui se tient. La question de la mise en récit, ou du storytelling si nous reprenons son penchant anglo-saxon, nous permettra de mettre en lumière les mécanismes de déploiement de plusieurs œuvres littéraires hybrides pour rendre compte de la complexité de ces créations souvent perçues comme non conventionnelles, voire illégitimes. La définition du storytelling de Christian Salmon est particulièrement éclairante, puisque selon lui, la notion
« désigne […] l’espace même dans lequel [les] discours s’émettent et se transmettent, c’est-à-dire un ‘‘dispositif’’ dans lequel s’opposent ou collaborent des forces sociales et des institutions, des narrateurs et des contre-narrateurs, des techniques d’encodage et de formatage, sans oublier la parole fragmentée qui palpite et se réverbère sans cesse dans la médiasphère. »(Salmon, 2009)
Les questions du dispositif et de la parole fragmentée sont cruciales dans le cas qui nous intéresse, puisqu'elles évoquent l’agencement de plusieurs mécanismes plus ou moins autoportants. Sa définition fait le pont avec les travaux de Henry Jenkins concernant le storytelling transmédiatique en ceci qu’une oeuvre peut avant tout être la somme de plusieurs autres, et ce, en transcendant les médiums :
« A transmedia story unfolds across multiple media platforms, with each new text making a distinctive and valuable contribution to the whole / Un récit transmédiatique se déploie au travers de plusieurs plateformes médiatiques, où chaque nouveau texte ajoute une contribution distincte et unique à l’ensemble (traduction libre)». (Jenkins, 2006)
Nous connaissons toustes des œuvres empruntant à cette mécanique de storytelling. Pensons à la franchise Star Wars, qui, plus qu’une saga cinématographique, s’incarne également à travers des livres, des bandes dessinées, des jeux vidéo, voire à travers d’autres produits filmiques indépendants de la saga canonique. Ces œuvres peuvent certes se présenter comme des adaptations des films originaux, mais elles peuvent aussi étendre l’univers des films pour proposer une histoire contributive à la narration globale. Jenkins prend l’exemple de The Matrix pour illustrer la pluralité des expériences qui sous-tend une oeuvre transmédiale : « The consumer who has played the game of watched the shorts will get a different experience of the movies than one who has simply had the theatrical film experience. The whole is worth more than the sum of the parts / les consommateurs ayant joué au jeu ou ayant visionné les courts métrages vivront le film différemment que celleux ayant seulement visionné le film. Le tout est plus important que la somme des parties (traduction libre)». (Jenkins, 2006)

C’est intéressant, parce que la transmédialité implique que le public est amené à faire son propre parcours au sein
d’une œuvre fragmentée, aspect que l’on retrouve à travers
L’île inventée de Christiane Vadnais et Barefoot Across America de Mark Baumer.
L’île inventée : le rôle du worldbuilding

L’Île inventée est le fruit d’une collaboration entre les Productions Rhizome à Québec, Arkham sur Loire à Nantes et la Quadrature. Le projet marie littérature, arts visuels et arts littéraires numériques. Il se décline sous plusieurs formes, soit un livre, un balado et une exposition immersive à la Maison natale de Louis-Fréchette, à Lévis, avec une itération presque identique à Nantes. (Cosmogonie de l’Île inventée , 2022). Nous avons affaire à une œuvre qui brouille la frontière entre la réalité et la fiction, dont la transmédialité se traduit par deux expositions muséales, la botanique et même l’archéologie sonore (?). Outre une rencontre entre l’art et la science, le projet se déploie sous le thème de l’utopie et de la société idéale en se basant sur des (faux) témoignages supposément retrouvés et prenant la forme de « bulles sonores » et de fragments encyclopédiques, notamment.
« Charlotte Sémafore, véritable force de la nature, aurait péri en devenant la première personne à quitter l’île. Aux oreilles attentives, ce conte révèle bien sûr une injonction capitale transmise aux Insulaires : maintenir le milieu fermé. L’île inventée, disent les Botanistes, est pareille à un jardin que l’on conserverait sous une cloche de verre.» (Vadnais, 2022)
Le livre
Ce qui nous frappe une fois le livre en main et les premières pages parcourues, c’est l’ambiguïté auctoriale qu’entretient Christiane Vadnais. En effet, si la couverture affiche bel et bien son nom en tant qu’autrice de L’Île inventée, la page de garde, quant à elle, attribue l’auctorialité du livre à Andsie Lou, personnage à qui l’on doit les témoignages recueillis par Vadnais. Cette dernière se présente comme celle qui établit et annote la présente édition. La postface, écrite par deux explorateur.rices fictif.ves, soit Louis-Émile Grenier et Flavie Ruse, réutilise le procédé d’insertion d’éléments fictionnels dans le réel. Le mensonge est donc un élément central du projet, puisqu’il permet d’aborder la réalité par la fiction en brouillant leur frontière respective. Au passage, mentionnons que le livre est l’extension des Contes des Estuaires , où la mythologie et certains personnages de L’île inventée se recoupent.
Cette contamination du réel par la fiction n’est pas sans rappeler le post-exotisme du romancier Antoine Volodine, sorte d’univers où la logique fictionnelle et littéraire crée une cohérence et un dialogue entre la majorité de ses ouvrages. Volodine se sert lui-même de cette bannière générique pour caractériser l’ensemble de sa production, mais plus encore pour construire un monde littéraire de l’intérieur qui appartiendrait également à ce genre. L’auteur y met en scène des formes nouvelles et inventées afin de mieux établir et comprendre cette production des écrivain. es fictionnel.les post-exotiques. Ces appellations inédites servent donc non seulement à qualifier l’univers de l’œuvre,
mais aussi à décrire le travail de Volodine. Il y a là une autothéorisation du post-exotisme, comme les personnages définissent elleux-mêmes leur discours, leur esthétique et le cadre dans lequel iels agissent. Avec Le post-exotisme en dix leçons, leçon onze, la page titre renvoie à ces figures fictif.ves qui prétendent être réel.les. En outre, les personnages de l’univers post-exotique de Volodine, par cet ouvrage, prennent la parole et écrivent leur propre manifeste du post-exotisme. Le livre offre une saisie critique de la dynamique d’un monde littéraire et de sa fiction, créée par les personnages de cette même fiction. Par ces mécanismes, Volodine permet à ces voix d’écrivain.es fictionnel.les d’exister en dehors de leur monde, à la manière de Vadnais et de Andsie Lou. Les auteur.rices se jouent habilement de la séparation entre le vrai et le faux, et s’amuse à contaminer notre réalité. Tout comme dans l’œuvre de Vadnais, la démarche de Volodine sous-tend la question de l’attribution d’une autorité brouillée. Dans les deux cas, la cohérence de l’univers est justifiée grâce à des éléments qui peuvent être externes au texte lui-même. On voit bien comment L’Île inventée procède elle aussi d’un métadiscours qui, en plus de sa transmédialité, enrichit l’œuvre et vient y superposer une couche de sens supplémentaire.
De plus, la matérialité du livre est suffisamment singulière pour nous y pencher : tiré à 500 exemplaires, il est hors du circuit traditionnel des marchés éditoriaux. À la base, donc, le livre de L’Île inventée est à considérer comme un objet rare, ce qui peut d’ailleurs contribuer à l’aura de mystère qui entoure sa cosmogonie. Il est constitué de
plusieurs artéfacts comme des témoignages, des « bulles sonores », des fragments encyclopédiques et des illustrations. Le livre se construit en réseau, c’est-à-dire que nous avons affaire non pas à un récit linéaire, mais bien à une œuvre littéraire composite, où les lecteur.rices sont amené.es à assembler les morceaux du puzzle par elleuxmêmes.
« Les contes sont comme les vents qui soufflent sur l’Île inventée. [...] Ils fauchent, emmêlent, déracinent. Parfois, ils vous emportent même là d’où ils viennent : comme l’histoire de Suzie, dite la “Calanchée”, dont j’ai [Andsie Lou] si minutieusement suivi les traces qu’elle est devenue la mienne. » (Vadnais, 2022)
Le balado
Le couple d’archéologues fictif.ves présenté ci-haut est d’ailleurs mis en scène dans la série de huit balados consacrée à L’Île inventée intitulée Cosmogonie de l’Île inventée, présentée sur les ondes de CKIA FM du 12 juillet au 30 août 2022 et désormais disponible sur Spotify. Le fondateur des Productions Rhizome, Simon Dumas, y interroge les deux « personnages » interprétés par des comédien.nes en compagnie de Christiane Vadnais, dans l’objectif d’en savoir davantage sur la cosmogonie de l’île.


Le balado doit être considéré comme faisant partie de l’archipel créatif de L’Île inventée, puisqu’il donne la parole à deux personnages fictifs et à leur autrice, tout le monde jouant donc le jeu de la fiction pour étendre celle-ci au-delà de la page, y compris l’animateur. De plus, chaque épisode
est ponctué d’un conte lié à l’univers de l’île, contribuant à façonner l’imaginaire autour de l'œuvre par une dimension littéraire singulière qui, ici, se trouve à être médiatisée par le balado.
L’exposition Jusqu’en décembre 2022, une exposition immersive est organisée à la Maison natale de Louis-Fréchette, à Lévis. Y sont présentés des illustrations, des objets et des artéfacts présents dans le livre, notamment par des installations qui permettent l’écoute de témoignages ou de contes. Une installation nommée les « passages mémoriels de l’Île inventée » nous permet d’observer la carte de l’île sur une table et d’interagir avec elle pour obtenir différentes rétroactions sonores, rétroactions qui s’incarnent également sous la forme d’extraits vidéos sur une télévision. À noter qu’une exposition similaire est présentée au Muséum de Nantes, faisant de ce projet une œuvre transatlantique, se présentant littéralement comme un « laboratoire d’hybridation ». (Exposition L’île inventée, 2022) De plus, de nombreux textes, dont des contes et des fiches de personnages, ornent les murs. Les textes littéraires exposés agissent donc en tant que lien entre les différents médiums, soit comme un pont entre le livre et ce qui se déploie matériellement en dehors de ce dernier.
La construction de ce monde fictif, son worldbuilding, est donc tributaire d’une contamination interdisciplinaire, c’està-dire que l’univers de L’Île inventée se construit à partir de plusieurs médiums et disciplines, vecteurs d’une hybridité inhérente à l'œuvre. Ainsi, plusieurs incarnations sont nécessaires pour raconter le projet, ce qui implique
portes d’entrée sont accessibles pour aborder cet univers.
Barefoot Across America : de la performativité à la performance

« My name is Mark Baumer. I am crossing America barefoot to save earth. Climate change is the greatest threat we’ve ever faced as a civilization. A lot of scientists agree. I am not a scientist. I am a poet. I am also a regular human being. / Mon nom est Mark Baumer. Je traverse les États-Unis pieds nus pour sauver la Terre. Les changements climatiques sont la plus grande menace que nous ayons rencontrée en tant que civilisation. Beaucoup de scientifiques sont d’accord. Je ne suis pas un scientifique. Je suis un poète. Je suis également un humain comme les autres.» (Traduction libre) (Baumer, 2016)
Avec Barefoot Across America , l’activiste et militant écologiste américain Mark Baumer récupère lui aussi la notion de transamédialité. Son projet, au croisement de la marche et de la création, s’inscrit dans la logique d’acte performatif politiquement engagé, soit par « divers niveaux d’agencement d’unités de langage et d’attitude qui se vérifient de plus en plus dans la sphère sociale comme culture de revendication » (La Chance, Martel, 2013), bien que les intentions artistiques de Baumer en constituent la toile de fond. Plus concrètement, le créateur répertoriait chaque jour son parcours aux États-Unis en publiant et diffusant des entrées de vlogue sur la plateforme YouTube
et/ou partageait des textes ou des images sur ses réseaux sociaux, tels Instagram, Twitter, Snapchat, Tumblr, Medium ou Facebook. Il est ainsi question d’une expérience de création liée à la marche et déployée par celle-ci. Se déroulant d’octobre 2016 à janvier 2017, l’œuvre s’est subitement achevée avec la mort de son créateur s’est fait happer par un véhicule utilitaire sport. À l’instar de L’île inventée, Barefoot Across America se déploie à partir d’une pluralité de médiums.
Lors de la journée d’étude Œuvres d’arts littéraires : comment rencontrent-elles leur public ? organisée par René Audet, Corentin Lahouste et Marie-Ève Muller le 21 octobre dernier à la Maison de la littérature, l’artiste, poète, performeur, critique, sémioticien et spécialiste en rien (pour reprendre ses mots) Yan St-Onge présentait ses réflexions quant à ce qu’il qualifie de projet-performance en se
penchant sur les enjeux des œuvres transmédiales et intermédiales. En décidant de publier au fur et à mesure son expérience sur diverses plateformes, Baumer crée un lien direct entre lui, son œuvre et son public, ce qui facilite les échanges. Qu’il s’agisse de ses vidéos ou des textes et photos mises sur ses sites personnels, Baumer participe d’une sorte d’écriture en ligne, cette « littérature » mise à l’écran empruntant au journal personnel et relevant de l’extimité, sa vie réelle se fondant à sa vie publique. Des formes telles que le carnet vidéo, les récits, les fictions, les aphorismes ou la poésie parsèment et érigent peu à peu l’entreprise de Baumer, qu’il serait ainsi préférable d’aborder sous l’angle du processus et de la médiation discursive que comme objet fini. Mais quel lien avec la performance de Baumer ? Selon l’Index du performatif, elle « réalise, concrétise, fait passer de la virtualité à l’actualité quelque chose que nous reconnaissons. — La performance se situe
dans un contexte à la fois culturel et situationnel » ((La Chance, Martel, 2013). Plus qu’un acte performatif, StOnge suggère de concevoir l’entreprise de Baumer comme une performance en elle-même, en ceci que l’artiste, dans son geste de revendication écologique, ne peut échapper à sa posture de performeur, puisqu’il doit inévitablement se mettre en scène sur diverses plateformes de diffusion pour véhiculer ses idées. Nous sommes ainsi face à une littérature qui dépend de son contexte et de la mise en récit qu’elle induit.
Si l’œuvre fragmentée et la performance de Baumer permettent de construire un récit intermédial et multimodal, son morcellement et les ruptures qu’elle impose engendrent une pluralité de lectures et d’interprétations, mobilisant à nouveau la notion de storytelling. Tout comme L’Île inventée, Barefoot Across America offre aux récepteur.rices une

multitude de points d’entrée : les publications ne sont pas numérotées et bon nombre d’entre se sont avérées éphémères (pensons à celles sur Snapchat, par exemple). Il n’y aurait en fait plus de règles guidant le public dans sa lecture, ce qui met en lumière le caractère désordonné et instantané inhérent à l’œuvre. Les internautes décident donc elleux-mêmes du temps accordé à l’expérience de lecture et l’ordre dans lequel iels l’abordent, ce qui leur octroie un rôle actif, les différentes couches de sens s’activant grâce à elleux.



À nouveau, la notion d’hybridité permet de mieux saisir la poétique de l’œuvre intermédiale et son esthétique fragmentaire, d’autant plus que dans le cas présent, la composante textuelle tend à s’effacer au profit de la cause défendue.
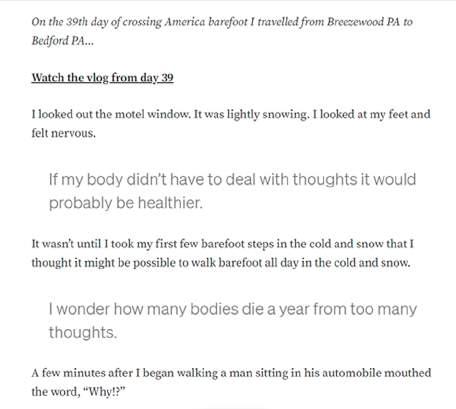
Et le livre dans tout ça ?
Comme nous l’avons rapidement expliqué un peu plus haut, il y a, collectivement, tout un imaginaire de la fin du livre ou du livre menacé qui s’est créé au fil du temps et des nouvelles pratiques, d’autant plus que la forme du livre tend à être conçue comme un dispositif conventionnel à codes fixes. Même si les arts littéraires invitent à reconsidérer la littérature en dehors du paradigme papier, le livre dans sa matérialité peut lui-même procéder d’une réactualisation des pratiques et usages littéraires, ses diverses manifestations contribuant à montrer le livre comme quelque chose d’autre que ce qu’il est habituellement. Il s’agit là d’une stratégie de défamiliarisation, voire d’étrangisation, technique artistique théorisée par les formalistes russes au début du 20e siècle et qui consiste à rendre le familier insolite, à présenter des conceptions communes sous des formes inconnues. Ce procédé opère d’un décentrement des idées reçues à l’égard d’un sujet
ou d’un objet connu et considéré fixe ou immuable, dans ce cas particulier, le livre. Il n’est donc pas en lui-même totalement à évacuer. On peut en fait s’en servir pour neutraliser le dispositif et même pour procéder d’une destruction de sa fonctionnalité traditionnelle. Si le livre se veut être à la fois un espace culturel et symbolique de représentations, il peut aussi être un espace de déploiement qui nous entraîne aux frontières de ce qu’est le livre.
Plus spécifiquement, Bertrand Gervais, professeur titulaire au département d'études littéraires de l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les arts et les littératures numériques, place ces incarnations sous l’appellation « figures du livre ». Selon lui, les figures du livre participent en effet d’une mise en scène du livre qui, de ce fait, ne se donne plus à lire, mais à voir, mobilisant notamment une dimension iconique et posant la question de la matérialité. L’attention portée à
l'œuvre se place donc davantage du côté du dispositif que de celui du sens, soit d’un angle sémantique et sémiotique. De cette manière, l’accès à une partie de la signification du texte, associée à la dimension langagière, est fragilisé, voire totalement soustrait. Les figures du livre, ce sont des écrits dans lesquels la dimension iconique et visuelle prévaut sur la dimension linguistique ou symbolique (Gervais, 2016). De plus, par l’intermédiaire des figures du livre que propose Gervais, ces utilisations singulières viennent aussi changer le rapport de manipulation au livre, qui, encore une fois, est collectivement usuel et établi. Les figures du livre engendrent ainsi un lien direct à l’exploration et à la découverte, caractère expérimental qui rejoint alors la notion d’arts littéraires. Gervais dresse à cet effet une liste des manifestations et incarnations de ces figures de livre.
Ces livres qu’on ne peut pas lire Le livre phagocyté

En biologie, la phagocytose correspond au processus cellulaire par lequel des microorganismes ou d’autres types de cellules sont internalisés, digérés ou détruits (Charbonnier, Sannier et Dupré, 2016). Le livre phagocyté est donc un livre dont le contenu demeure, mais où il y a un ajout, voire une forme d’envahissement et de parasitage par d’autres éléments ou médiums. Il s’en retrouve enveloppé, englobé. On peut notamment penser au Holy Bible, projet de Adam Broomberg et Oliver Chanarin. Les créateurs se sont servis de l’Ancien Testament afin de faire des liens avec des conflits plus actuels. L'œuvre reprend ainsi le texte de la Bible, sa couverture noire classique et son titre, en y ajoutant néanmoins des photos plaquées sur le texte ou en mettant en évidence des phrases liées aux dites photographies. Les lecteur.rices ne s’attardent plus au texte : le livre est donné à regarder. Le résultat est celui d’une bible phagocytée par l’expression contemporaine de la violence.

Le livre vidé de son contenu La nomenclature de cette incarnation semble aller de soi et parler en elle-même. L’exemple du livre Google, Volume I en témoigne. Les créateur.rices du projet ont puisé leur inspiration au sein de la banque d’images de Google. Pour chaque mot du Oxford Dictionary, iels ont remplacé chacune des entrées par la première photographie obtenue lors de la recherche du mot par images. On se retrouve ainsi face à un dictionnaire vidé de son contenu, dévié de sa fonction première, n’ayant plus aucune fonctionnalité et accentuant le régime iconographique de l'œuvre. Il y a en effet un déplacement du langage vers l’image : le livre est toujours présent, mais il a perdu de sa dimension sémiotique usuelle.
Le livre augmenté
Il s’agit d’un ouvrage dans lequel une part de manipulation habituelle est maintenue, mais, comme c’est le cas de Exit Strategy de Douglas Rushkoff, il y a un appareil critique qui nous déporte dans un autre univers. Dans le cadre de cette œuvre, une trame narrative est ajoutée : 200 ans après Exit Strategy , des internautes, agissant à titre d'anthropologues, découvrent son manuscrit virtuel et l’annotent. Il s’agit ainsi d’une métafiction éditée de manière à ce que le texte soit accompagné d’un ensemble de notes écrites par des internautes au moment de sa publication sur Internet. Ces notes apportent des explications sur des détails du roman, précisions supposément rédigées 200 ans plus tard, dans le futur.
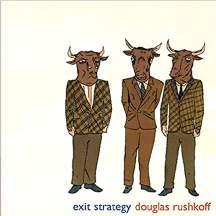
L'œuvre A Humument. A treated Victorian novel de Tom Phillips correspond quant à lui à ce que Gervais nomme livre d’artiste. Dans ce cas précis, la page est transformée en canevas que l’on réinvestit. Phillips retravaille chacune d'entre elles en les illustrant et en empruntant diverses techniques des arts plastiques, en conservant parfois certains mots à la manière d’un palimpseste afin de reconstituer un nouveau texte sur la base du texte initial. A Humument s’inscrit dans un rapport de reprise, de citation et de détournement face au texte de départ, mettant en lumière couches et superpositions. L'œuvre, s'incarnant en six éditions distinctes et uniques, reprend la logique de work in progress en s’étalant de 1966 à 2016. La dernière version est donc bien différente de la première, comme des pages furent ajoutées, enlevées ou modifiées.
Finalement, le livre matériau peut devenir, de son côté, une source d’image. On se servira du livre comme matériau pour créer et faire de l’art, des sculptures, par exemple, de sorte qu’il y ait une insertion du texte dans un système sémiotique second. Cette forme implique aussi tout un travail de photographie de l'œuvre, la pratique artistique s’éloignant du littéraire, voire s’en détachant entièrement. On soulève, au passage, le travail de Thomas Allen, qui utilise des livres de poche comme matériau. Ce dernier y découpe des images, pour ensuite les recoller sur le livre et donner au papier des angles spécifiques afin que lesdites images aient l’air de sortir du livre. Cela ressemble d’ailleurs étrangement aux cartes d’anniversaire ayant un contenu en trois dimensions lorsqu’on les ouvre.


Le livre altéré




Ce cas de figure regroupe divers projets de nature artistique qui se servent du matériau premier qu’est le livre, que l’on soumet à des transformations de toutes sortes. Le livre altéré connaît lui aussi diverses déclinaisons.
Les livres-livres, par exemple, sont faits de livres porteurs et de livres déportés. Bien que découle de cette forme une certaine illisibilité en raison de la coexistence sur une même page de deux textes et de deux systèmes d’écriture, il y a une correspondance claire entre le livre porteur et le livre déporté, c’est-à-dire celui que l’on retranscrit dans la page. Comme avec les créations de Louise Paillé, il y a, avec le livre-livre, un travail fait à travers et à même le livre. Cette métamorphose du littéraire au plastique opère ainsi un déplacement et obéit à une logique de collision entre les textes, et ce, dans le but d’orienter le développement formel et conceptuel de cette pratique et de son esthétique (Gervais, 2016).
Le livre altéré comprend également le livre vidé, à ne pas confondre avec le précédent livre vidé de son contenu. Ici, il s’agit non pas d’une logique de surenchère, comme la plupart des exemples cités ci-haut, mais plutôt d’une optique de retrait. Surtout, le livre vidé va bien au-delà du simple effacement des mots : on le vide de la page ellemême. On peut penser à Tree of Codes de Jonathan Safran Foer, où la page est déblanchie en en retirant des parties à l’aide d’un couteau à lame rétractable. On fonctionne par coupures et extractions. Cette pratique particulière construit un imaginaire littéraire privé dans lequel il y a un ou des textes fondateurs. D’ailleurs, en observant le livre et en tournant les pages, le retrait induit une impression de flottement des mots (Gervais, 2016). C’est tout un travail de réappropriation.
Concrètement, ça se trouve où des arts littéraires au Québec ?
En présentant les arts littéraires et leur hybridité avec un ton parfois un peu théorique, le risque était grand de faire l’impasse sur un aspect de leur incarnation qui nous semble crucial, soit leur déploiement concret dans la sphère culturelle québécoise. Nous voulions donc consacrer une partie conséquente de notre texte à la présentation de certaines initiatives culturelles innovantes. Le dénominateur commun de ces initiatives est la volonté de démocratiser la parole littéraire, de pluraliser les voix et de rendre
possible la mise en œuvre d’un réseau littéraire éclaté et nouveau. Cette liste est d’ailleurs non-exhaustive, puisque nous aurions pu tout aussi bien citer le Tremplin d’actualisation de poésie (TAP), le festival Québec en toutes lettres ou encore le collectif Le Bestiaire.



RAPAIL
Le Réseau des arts de la parole et des arts et initiatives littéraires (RAPAIL) est un projet démarré en novembre 2020 et dont la mission est de rassembler les différentes initiatives artistiques autour des arts littéraires et des arts

de la parole. Le RAPAIL se présente comme un réseau de contacts, où les artistes sont amené.es à échanger sur leurs pratiques et à contribuer à des actions communes dans l’objectif de valoriser et de légitimer ces formes d’arts nouvelles.

Pavillons
Pavillons est une plateforme où les auteur.rices sont invité.es à soumettre leurs projets de créations littéraires sous forme de feuilleton numérique. L’un des objectifs de la plateforme est d’assurer une meilleure rémunération des


artistes, notamment à l’aide d’une formule d’abonnement par projet. C’est un bon exemple d’initiative culturelle qui tente de s’affranchir des instances éditoriales traditionnelles pour proposer une nouvelle manière d’envisager les modes de distributions et de diffusion de la littérature québécoise.
Maison de la littérature
Faisant partie du réseau de la Bibliothèque de Québec, la Maison de la littérature est constituée d’une bibliothèque publique, de cabinets d’écriture, d’un atelier de BD, d’un studio de création, d’une résidence d’écrivain.es et d’une
scène littéraire (Maison de la littérature, 2022, paragra. 1). C’est un lieu culturel majeur dans la ville de Québec, puisque tout au long de l’année, des dizaines d’événements y ont lieu, comme des expositions, des ateliers, des conférences et des discussions.

La Charpente des fauves
Le terme le plus approprié pour définir le projet de la Charpente des fauves est sans doute celui de spontanéité. L’idée est de promouvoir des artistes multidisciplinaires aux visions marginales et innovatrices et de créer des espaces de création adéquats pour les accueillir, toujours dans une perspective exploratoire. Plusieurs espaces sont d’ailleurs disponibles à la location et une première édition du Fauve mag, une revue indépendante, a été publiée au printemps dernier.
Caniches | Contours poésie
Au printemps dernier s’est déroulée la première édition du festival en arts littéraires Caniches, mis sur pied par l’organisme Contours. Y étaient abordées plusieurs sphères constitutives des arts littéraires, comme la vidéopoésie et l’édition alternative par le biais des zines, notamment.

Conclusion
Malgré notre survol (certes parfois plutôt dense) des arts littéraires, un angle mort, un malaise persiste, que nous pourrions formuler de la manière suivante : qu’est-ce qu’un texte littéraire ? Quelle valeur littéraire pouvons-nous accorder à un texte qui, a priori, s’incarne en dehors de la page ? D’aucun.es pourraient juger que la littérature est avant tout un travail sur la langue, qu’un texte littéraire doit s’autosuffire indépendamment de son dispositif, mais qu’en est-il dans les faits ? Pourrions-nous, par exemple, considérer comme littéraire certains graffitis ornant les murs de la Basse-Ville de Québec ? Selon nous, c’est une question à double tranchant, puisqu’elle implique forcément l’idée de tri, le fait d’exclure certaines formes littéraires pourtant légitimes, la ligne entre adaptation et incarnation singulière se faisant de plus en plus mince.
Spoken Word Québec

Spoken Word Québec est une initiative qui a pour mission de démocratiser la parole littéraire dans la ville de Québec, notamment par le biais de performances littéraires et musicales, le tout dans une perspective d’ouverture, de partage et d’initiation au spoken word.


Le Collectif RAMEN
Les initiatives du Collectif RAMEN sont nombreuses : édition de fanzines, élaboration d’ateliers de création, organisation de spectacles littéraires, soirées de micro ouvert… l’objectif du collectif est avant tout de rendre accessible la poésie par l’intermédiaire de diverses activités et happenings.

Atelier Le Pieu
L’atelier Le Pieu est un projet d’édition alternative ayant vu le jour dans la dernière année, conçu dans l’idée de rendre plus accessible la réalisation de projets par la relève en arts littéraires. Le projet a été élaboré par le collectif La Fatigue en collaboration avec le collectif Le Bestiaire, un ensemble de créateur.rices spécialisé.es dans l’autoédition et la confection de zines. Leur objectif est d’accueillir des créateur.rices dans un studio indépendant au cœur du quartier Limoilou, afin d’offrir des formations quant à l’utilisation d’équipements spécialisés tout en offrant un espace de création adéquat.

Références
Maison de la littérature. À propos. (2022). La Maison de la littérature. https://www.maisondelalitterature.qc.ca/à-propos/ la-maison/
Baumer, M. (2016). Barefoot Across America. https://www.barefootacrossamerica.com/
Broomber, A. et Chanarin, O. (2013). Holy Bible. First Edition.
Charbonnier, A., Sannier, G. et Dupré, S. (2016). Mission phagocytose : comment adapter ses armes à la taille. Med Sci. Vol. 32 (no. 6-7). https://www.medecinesciences.org/en/articles/medsci/full_html/2016/07/medsci20163206p587/ medsci20163206p587.html#:~:text=La%20phagocytose%20est%20un%20processus,organismes%20et%20des%20 cellules%20apoptotiques.
Productions Rhizome. Cosmogonie de l’Île inventée. (2022). Productions Rhizome. https://productionsrhizome.org/fr/ actualites/8491/cosmogonie-de-lile-inventee
Muséum de Nantes. Exposition L’Île inventée. (2022). Muséum de Nantes. https://museum.nantesmetropole.fr/home/ expositions/lileinventee.html
Gervais, B. (2016). Imaginaire de la fin du livre : figures du livre et pratiques illitéraires. Fabula. no. 16. https://www. fabula.org/lht/16/gervais.html
Jenkins, H. (2006). Convergence culture. New-York University Press.
La Chance, M., Martel, R. (2013). Index du performatif. Inter, (115), 1-36 http://id.erudit.org/iderudit/70163ac
Laboratoire Ex Situ. Nommer les arts littéraires. (2022). https://ex-situ.info/projets/nommer-les-arts-litteraires/#volet3

Phillips, T. (1970). A Humument. A treated Victorian novel. Thames & Hudson.
Rushkoff, D. (2002). Exit Strategy. Soft Skull Edition.
Safran, J. (2010). Tree of Codes. Visual Editions.
Salmon. C. (2009). Storytelling saison 1. Chroniques du monde contemporain. Les Prairies ordinaires (coll. Essais).
Vadnais, C. (2022). L’Île inventée. Productions Rhizome.
Volodine, A. (1998). Le post-exotisme en dix leçons, leçon onze. Gallimard.
Zog, K. (2013). Google, Volume 1.Jean Boîte Éditions.
Zodiac
Sorti en salle en 2007, Zodiac, réalisé par David Fincher, s’inspire de faits réels et retrace l’histoire du dessinateur Robert Graysmith (Jake Gyllenhaal), du journaliste Paul Avery (Robert Downey Jr.) et du policier David Toschi (Mark Ruffalo) qui enquêtent sur une série de meurtres revendiqués par un certain Zodiac. Analyse d’un labyrinthe irrésolvable.

Par Emmy Lapointe, rédactrice en chef
Perdu d’avance
À la fois fidèle et transgressif du genre policier, le film de Fincher, bien qu’il se déploie dans un jeu que l’on sait perdu d’avance – l’identité du vrai Zodiac étant encore incertaine–, donne l’impression aux spectateur.rices que la sortie du labyrinthe viendra. Or, entre les routes d’un San Francisco que l’on reconnaît à peine, les tours de bagnoles de nuit et les messages faussement décryptables, tous les fils d’Ariane que l’on laisse derrière nous sont coupés par un monstrateur/narrateur qui s’amuse à nous faire croire que l’on progresse.
La voiture
En cinéma, lorsqu’un élément narratif, sonore ou visuel se répète au sein d’une œuvre, on dit de lui qu’il est un motif. C’est précisément par sa récurrence que le motif investit de sens un élément en apparence banal, mais qui finalement, dit beaucoup sur l’ensemble du film. Et comme pour aiguiller le.a spectateur.rice sur ses intentions de tromper, David Fincher semble avoir truffé Zodiac de motifs.
La première occurrence du motif de la voiture dans Zodiac se fait dès les prémices du film alors que Darlene Ferrin, jeune femme s’en allant chercher son amant, se trouve au

volant, ce qui, par ailleurs, inverse les rôles genrés des relations affectives hétérosexuelles en léguant à la femme l’action « virile » d’instiguer le rendez-vous et celui de conduire le véhicule. Ce renversement autorise le.a spectateur.rice à douter du symbole de réussite (American Dream) et de protection que revêt ordinairement l’automobile et laisse planer un doute quant au sens qu’il prendra au fil de l’histoire.
De fait, par sa présence marquée et répétitive, Fincher fait de la voiture bien plus qu’un accessoire intervenant dans l’histoire, elle devient un espace, un lieu récurrent rattaché aux crimes. En effet, le corps de la première victime alléguée du Zodiac, découvert en 1966 – seulement mentionné dans l’histoire et non dans le récit – est découvert dans un stationnement, alors que deux crimes du tueur se déroulent dans des voitures et que le principal suspect, surnommé Lee, vit dans un « trailer park ».
La répétition significative de ce motif permet de distinguer une séquence particulière relative aux meurtres du Zodiac : celle du meurtre de Darlene Ferrin et de la tentative de meurtre de son amant Mike Mageau. Cette unité formelle débute par un plan d’ensemble qui permet de
situer l’emplacement du crime à venir qui est, dans ce cas-ci, la ville de Vallejo, en bordure de San Francisco. Dans le plan suivant, on aperçoit la voiture des victimes par un travelling latéral et si l’on porte plus attention, on peut voir, dans le reflet de la fenêtre, les feux d’artifice du 4 juillet. Puis, viennent un champ-contrechamp des deux amant.es ainsi que des gros plans qui les détaillent, les objectifient. Iels deviennent donc objets de leur propre regard, mais aussi celui de l’auditoire, ce qui annonce implicitement qu’iels ne seront pas sujets de l’action, mais plutôt qu’iels la subiront. La suite est évidente. Iels se font tirer par le Zodiac.
Cette unité formelle se répète lorsque Graysmith rencontre Bob Vaugh, employé d’un cinéma que fréquentait le Zodiac, et cette répétition suscite l’inquiétude du.de la


spectateur.rice qui, consciemment ou non, associe l’unité formelle en question à l’imminence d’un meurtre, meurtre qui ne viendra pourtant pas.
Le motif de la voiture n’est pas seulement utilisé comme mécanisme de peur et de tension, il l’est aussi pour isoler le personnage de Graysmith. En effet, à chaque fois que le jeune dessinateur est plongé dans ses recherches, un bruit off de crissement de pneu se fait entendre. Or, ce bruit de crissement de pneu appartient à la scène d’ouverture : le meurtre de Darlene Ferrin et de la tentative de meurtre de Mike Mageau. Réintroduit de cette façon, le bruit rappelle un événement passé auquel Graysmith n’a pas assisté, mais par lequel il est obsédé, voire retenu dans le passé. Ce dernier élément se renforce davantage lorsque l’on constate que sa voiture, bien que le récit se déploie
sur plusieurs années, ne change jamais.
Ville énigmatique
Grâce à des marques écrites extradiégétiques (externe au récit), il est possible de savoir que le récit se déroule à San Francisco et dans ses alentours, or, ce sont pratiquement les seuls indices qui permettent cette déduction. En effet, outre un travelling vertical montrant la construction de la Transamerica Pyramid pour signifier une ellipse de quelques années et un très court panoramique vertical du Golden Gate Bridge, la ville de San Francisco est difficilement reconnaissable. En fait, même le Golden Gate Bridge est montré d’un point de vue atypique : la caméra semble fixée sur le haut d’une des poutres et ne permet que de voir une petite partie de la route. Le San Francisco
De plus, l’essentiel du film se déroule dans des lieux intérieurs comme le bureau de rédaction, le bar, la maison de Graysmith et ne sont jamais situés dans la ville. Lorsqu’il est enfin possible d’apercevoir les rues et les bâtiments de celle-ci, les scènes se déroulent soit de nuit ou dans une voiture. Il n’est donc pas possible de trouver un quelconque point de repère si ce n’est qu’au moment des meurtres. San Francisco n’est dès lors plus elle-même, elle est fragmentée, atomisée, énigmatique et contribue à entretenir un sentiment d’inquiétude chez le.a spectateur.rice.
Cryptage et décryptage
Il y a, dans Zodiac, cette idée de message crypté qui revient encore et encore, se hissant ainsi au rang de motif. Si le film raconte l’histoire d’une enquête policière, il raconte aussi et surtout l’histoire de gens qui ne se parlent pas. Il y a pratiquement toujours un intermédiaire entre le.a destinateur.rice et le.a destinataire, le message est constamment dévié.


Les différents partis de l’enquête ne se partagent pas leurs informations, ils ne travaillent pas ensemble. Nombreux sont les échanges faits par téléphone où il est souvent difficile de distinguer qui s’adresse à qui. Il faut ajouter à cela toutes ces fois où iels se renvoient les un.es aux autres. Le fait que les meurtres soient souvent commis aux frontières de la ville contribue à rendre la communication (déjà défaillante) encore plus inefficace, parce qu’il est
difficile de savoir – pour l’auditoire, mais aussi pour les personnages – qui s’occupe des investigations relatives aux différents meurtres.
L’incommunicabilité qui habite l’entièreté du récit semble être matérialisée par les lettres codées que reçoivent les protagonistes. Elles sont le point de départ du dérapage de Graysmith. Il va s’y attarder comme il s’attardera à la calligraphie du tueur et aux œuvres de fictions glissées (The most dangerous game, etc.) ici et là. Il entrera dans le jeu du décryptage, de l’énigme et peu à peu, il s’isolera et s’éloignera de la réalité. Ainsi, le motif du décryptage transforme le récit et le fait tranquillement passer d’un genre à l’autre : du film policier au film « psychologique ».
Le Labyrinthe Malgré la présence prépondérante de la voiture, de la ville énigmatique et du cryptage dans Zodiac , le labyrinthe semble être le motif dominant du film puisque les premiers participent à la construction globale du dernier. En ce sens, au même titre que la ville qui n’est jamais vue dans son entièreté et qui se présente plutôt comme morcelée, l’information relative à l’intrigue du film que détiennent les personnages n’est que partielle. Le motif de la ville énigmatique serait en somme un labyrinthe physique, « (...) une représentation, voire une interprétation » (Legrand, 2009, p. 61) du labyrinthe psychique où sont coincés les personnages. Ces derniers ne pourront s’en sortir, ne pourront joindre les différentes bribes d’information qu’ils possèdent, car incapables de les décrypter complètement et de communiquer. Par conséquent, ils
tenteront tous de résoudre l’énigme, mais, comme dans un labyrinthe, emprunteront les mêmes chemins, marcheront dans les traces de leurs comparses.
Bien que les personnages ne disposent pas de toute l’information nécessaire, le.a spectateur.rice, par la narration mixte, accède à ces différents points de vue et ainsi, aux parties qui constituent l’intrigue sans pour autant arriver à les arrimer et à résoudre l’enquête. La narration n’est donc pas entièrement omnisciente, car le.a spectateur.rice n’arrive pas à avoir une vision totale de l’histoire faute d’un point de vue fondamental manquant : celui du tueur. À la manière de la voiture qui sert à naviguer dans le labyrinthe physique que représente la ville, le Zodiac , responsable de la connotation inquiétante du véhicule, permet de circuler dans le labyrinthe psychique
du film. Il serait alors le véritable maître du jeu, sorte d’architecte de l’intrigue. Le tueur joue donc avec les codes de l’enquête en décidant des informations dont disposent les personnages et l’auditoire.
D’une perspective formelle, c’est par conséquent le Zodiac qui contrôle l’éclairage, s’en servant pour rester dans l’ombre, invisible en utilisant par exemple, lors de la mort de Ferrin et Mageau, une lumière frontale low-key afin d’éclairer de plein fouet les deux victimes. Or, en éclairant ainsi les amant.es, on éclaire aussi les spectateur.rices qui sont aveuglé.es et perdent de vue l’action et, plus important encore, le visage du Zodiac.
Le film serait un peu comme une mise en abîme dans laquelle le.a spectateur.rice sait pertinemment, parce qu’inspiré de faits réels, que l’identité du meurtrier ne sera jamais dévoilée, mais se perd tout de même dans la diégèse et regarde Graysmith faire de même alors que son obsession l’emporte dans une fiction au sein même d’un monde fictionnel. Toustes deux s’enfoncent dans le labyrinthe et, par conséquent, perdent leurs repères. Les indicateurs extradiégétiques spatio-temporels sont d’ailleurs de moins en moins reliés à Graysmith, alimentant ainsi l’idée qu’il ne se trouve plus entièrement dans la « réalité » de son monde. Le public, au même titre que le protagoniste, ne pourra s’échapper du motif labyrinthique et ne pourra arriver au terme de l’intrigue et accéder à la vérité.
Références
Legrand, D. (2009). David Fincher explorateur de nos angoisses, Paris, Cerf-corlet, (Coll. 7e art), 2009.

Kent Jones, « An Open-and-Shut Case : Why David Fincher’s Zodiac is the Film of the Year », dans Filmcomment, vol. XLIV, no 1 (janvier-février 2008).
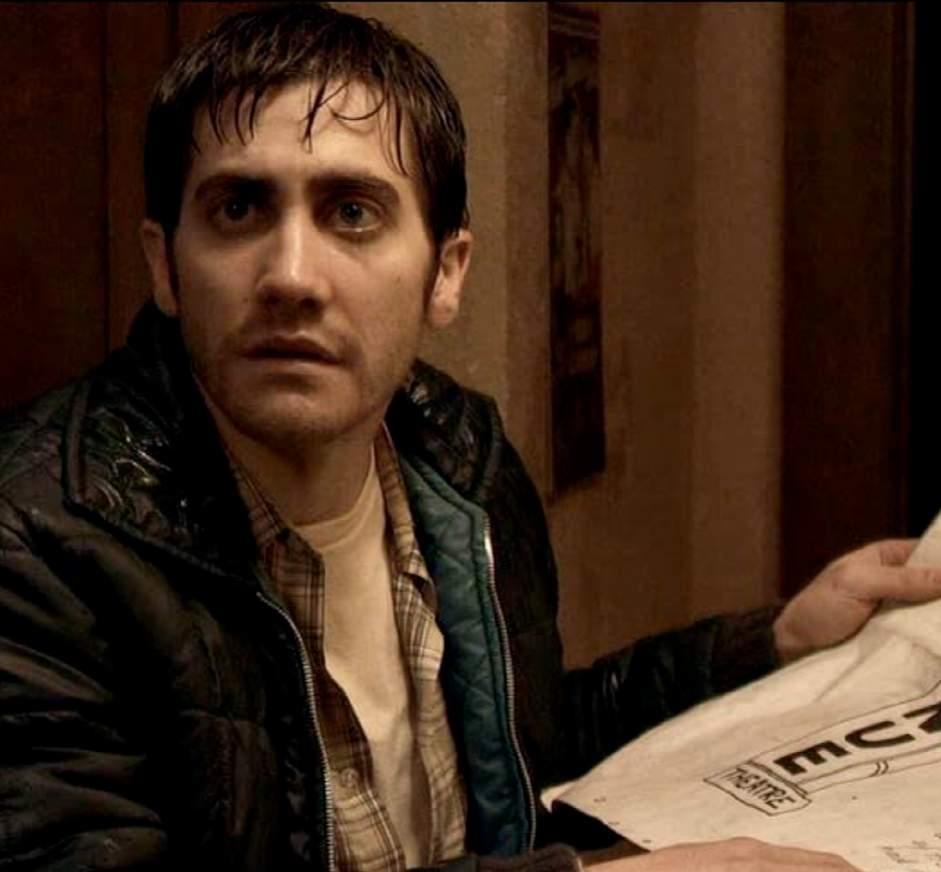
de papier mâché par
Sabrina Boulangerune vieille dame toute fripée son oreille doit être lourde, elle s’affaisse sous son propre poids la peau glisse sur le cartilage, ruisselle jusqu’au lobe qui semble prêt à rejoindre le sol à la manière d’une goutte d’eau qui perle à la lisière du vide et au creux de ce lobe qui dégoutte est lové un petit diamant qui s’accroche aux plis de la peau pour tenir en place et il brille et il shine le diamant et elle est belle l’oreille de papier mâché fièrement décorée de la vieille dame toute fripée

Déplacez-vous vers l'arrière
Dole®
Par Érika Hagen-Veilleux
la capsule géante traverse le pont Drouin d’un Mordor à un autre je travaille dans un de ceux-là celui de Sainte-Foy je l’ai même habité j’essaye d’oublier les aléas du quartier les foyers à l’éthanol les allées du Costco
je me remémore les apparts en corridors les bouchons de cire aux carrefours giratoires le trop-plein d’essence de vanille pour les crêpes chez Cora


je marche dans les rues d’une ville que je connais pas c’est beau ça pue en même temps j’achète une pêche je mange la pêche le jus attire les guêpes je reste calme immobile ça fait longtemps que je sais que mon plaisir est pas gratuit
on déjeune dans le parc industriel imperméables aux insultes des camions ça fait longtemps qu’on boit le sang-froid du vacarme
au Musée on ignore les panneaux bilingues qui indiquent comment respirer sans déranger personne
À bout de bras
Par Malika NetchenawoeJe ne suis qu’un bout de moi, Ou la matérialisation de mon indécision Je ne suis qu’un bout de pas assez, Et j’existe dans l’appréhension de ne pas reconnaître mon identité
Du corps, Trois fondements me composent
La femme L’homosexuelle Et la fille de son père
La femme suit les autres femmes, celles qui savent parler haut et fort, celles qui exigent et s’affirment dans leurs revendications.
L’homosexuelle joue de ses couleurs, se fond dans la masse des fins de soirées, des fiertés assumées, Elle se rappelle celleux qui se célèbrent dans un murmure solidaire.
La fille de son père s’encombre de poussière, sa pâleur ne clame pas son identité.
La fille de son père voudrait les yeux bleus, les cheveux lissés pour s’allier à sa peau mensongère.
La fille de son père ne reconnaîtra la vraie nature de ses cheveux qu’après de nombreux échecs capillaires.
À 18 ans, la fille de son père décidera de porter ses cheveux comme elle ne les voit pas à la télé, de sommer sa reconnaissance ethnique.
La fille de son père se sait trop blanche de par sa peau, trop silencieuse de par sa voix et trop noire de par ses cheveux. Elle décidera plus tard de se trouver juste assez de tout et de s’écrire à même cette peau désavouée.
La fille de son père est ainsi à l’intersection de ses altérités Elle porte à bout de bras ses vérités Hésite à s’affirmer sans autant pouvoir se cacher Elle n’a pas le ton qu’il faut pour se politiser Pourtant le monde politise sa réalité Elle comprend Elle réalise plutôt que Politique signifie nécessité Politique signifie réappropriation Politique signifie l’évidence de son existence et son droit de se revendiquer dans son entièreté.
Des pistes cyclables dégagées été comme hiver
Adeptes du vélo, saviez-vous que les pistes cyclables sur le campus seront déneigées cet hiver? Profitez de ces couloirs sécuritaires pour favoriser la mobilité active.
ssp.ulaval.ca/deplacements/cyclistes/periode-hivernale

