:11 11
 Couverture réalisée par Samuel Martel
Couverture réalisée par Samuel Martel

 Couverture réalisée par Samuel Martel
Couverture réalisée par Samuel Martel
Rédactrice en chef
Emmy Lapointe (elle) redaction@impactcampus.ca
Jade Talbot (elle) actualites@impactcampus.ca
Cheffe de pupitre aux arts
Frédérik Dompierre-Beaulieu (elle) arts@impactcampus.ca
Ludovic Dufour (il) societe@impactcampus.ca
Journaliste multimédia
William Pépin (il) multimedia1@impactcampus.ca
Sabrina Boulanger (elle) photos@impactcampus.ca
Paula Casillas (elle) production@impactcampus.ca
Directeur général
Gabriel Tremblay dg@comeul.ca
Simon Rodrigue publicite@chyz.ca
Laetitia Marie Zehe, Marie-Claude Giroux, Raphaëlle Marineau, Marilou Fortin-Guay, Marie Tremblay, Camille Desjardins et Malika Netchenawoe
François Pouliot, Émilie Rioux, Élise Thiboutot, Daniel Fradette, Ludovic Dufour, Charles-Émile Fecteau, Antoine Chrétien et David Tardif
Andrée-Anne Desmeules et Érika Hagen-Veilleux
Publications Lysar inc. Tirage : 2000 exemplaires Dépôt légal : BAnQ et BAC
Impact Campus ne se tient pas responsable de la page CADEUL et de la page ÆLIÉS dont le contenu relève entièrement de la CADEUL et de l’ÆLIÉS. La publicité contenue dans Impact Campus est régie par le code d’éthique publicitaire du journal, qui est disponible pour consultation au : impactcampus. qc.ca/code-dethique-publicitaire
Impact Campus est publié par une corporation sans but lucratif constituée sous la dénomination sociale Corporation des Médias Étudiants de l’Université Laval.
1244, pavillon Maurice-Pollack, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6 Téléphone : 418 656-5079
ISSN : 0820-5116
Découvrez nos réseaux sociaux !

Alors que les feuilles tombent et que le rythme du quotidien semble ralentir, l’Université Laval, elle, ne se fatigue pas. Depuis le début de la session, qui s’est déroulée sous le retour à la normale, plusieurs projets ont vu le jour et la communauté universitaire a su rayonner dans plusieurs domaines. Voici un bref retour sur l’actualité du campus, des recherches menées par nos équipes jusqu’aux exploits sportifs du Rouge et Or.
Par Jade Talbot, cheffe de pupitre actualité

Regards sur les plus récentes recherches
Plusieurs équipes de recherche ont fait connaître leur travail depuis le début de la session. D’abord, une équipe franco-québécoise travaillant sur les maladies respiratoires, dont fait partie un professeur de l’Université Laval, aurait découvert une façon de traiter ces maladies avec des médicaments prescrits pour les problèmes cardiaques. Ils seraient notamment efficaces contre l’influenza. Une autre équipe, travaillant sur les saumons, a démontré que capturer et remettre à l’eau ces créatures aurait une incidence négative sur le nombre de descendants qu’ils produisent par la suite. En collaboration avec le CHU de Québec, une équipe de l’UL a identifié un nouveau rôle qu’aurait la protéine p53, qui protège l’intégrité de notre ADN. En effet, elle empêcherait la formation de cellules contenant un nombre anormal de chromosomes, cellules associées au cancer. Finalement, une équipe de l’UL, en partenariat avec l’Institut national de santé publique du Québec (INSPQ) et d’autres établissements canadiens, vient de publier les résultats de son étude portant sur le variant Omicron. Elle a découvert que les personnes ayant été infectées par un sous-variant pré-Omicron de SARSCoV-2 bénéficient d’une protection plus forte contre les risques d’hospitalisation causée par le variant Omicron. Cette protection serait également plus élevée pour les personnes vaccinées.
Il y a quelques années déjà, le PEPS a perdu sa boutique de sport. Le local, vide depuis, reprendra vie avec l’arrivée d’une nouvelle boutique Décathlon. Y seront vendus vêtements et équipements de sport pour la communauté étudiante ainsi que pour les utilisateur.ice.s du PEPS.
En octobre, l’Université a souligné le mois de la cybersécurité en menant une campagne de sensibilisation auprès des étudiant.e.s. Plusieurs outils d’information, dont des vidéos, sont à la disposition de la communauté au ulaval.ca/cybersecurite.
Finalement, cette année, l’Université Laval lance à nouveau une campagne de financement Centraide. Déjà, plusieurs membres du personnel ont mis la main à la pâte en faisant don de leur temps à différents organismes soutenus par Centraide. Il est également possible de faire un don en argent, et ce, jusqu’au 11 novembre.
L’excellence en Rouge et Or Alors que certaines équipes ont fini leur saison, d’autres, comme l’équipe de basketball, la commencent tout juste. Au golf, nos équipes ont réussi un doublé au championnat du RSEQ, permettant ainsi d’établir le record de l’équipe masculine ayant remporté le plus grand nombre de championnats provinciaux consécutifs, tous sports confondus. Au rugby, l’équipe féminine a terminé sa saison régulière en première place au classement, pour une troisième année de suite. Avant d’affronter les Gee-Gees d’Ottawa le 8 octobre dernier, l’équipe a réussi l’exploit d’inscrire 382 points en cinq matchs et de n’en accorder aucun. Au football, plusieurs records ont été fracassés durant la saison. À la suite d’une victoire sans équivoque contre les Carabins de Montréal, l’entraîneur-chef, Glen Constantin, est devenu l’entraîneur le plus victorieux du football universitaire canadien avec une fiche de 197 victoires. Ce match, qui nous permet de reprendre la première position au classement, a d’ailleurs accueilli une foule record cette année avec 18 173 spectateur.rice.s. C’est également le match qui a accueilli le.a 2 000 000e spectateur.rice de son histoire. Finalement, le receveur Kevin Mital a battu le record d’équipe avec la réception de sa 10e passe de touché en une saison. Ce touché lui a également permis de rejoindre Félix Faubert-Lussier ainsi que Julian Feoli-Gudino pour le plus grand nombre de passes de touché en carrière (17) à seulement sa deuxième année dans l’uniforme du Rouge et Or.

 Par Emmy Lapointe, rédactrice en chef
Par Emmy Lapointe, rédactrice en chef
Ne pas oublier d’éteindre la télévision d’éteindre l’ordinateur d’éteindre toutes les lumières et d’éteindre toutes les étoiles – Patrice Desbiens
Si je ne partage pas l’amour des marches en forêt de Sabrina, si elle ne partage pas mon amour des rappeurs français, nous partageons, entre autres choses, l’amour des tasses, des vieux.eille.s et des étoiles. Elle connaît de ces dernières leur nom, leur âge; je connais d’elles ce que les applications d’astrologie en disent. Mais je pense que ce qu’on aime des étoiles, c’est ce qu’on ne sait pas d’elles, et que malgré qu’elles disent peu à leur propos et le reste, elles semblent tout promettre.
Messenger, Emmy-Sabrina,
27 juillet, 22 h 22
Emmy : J’espère que tu dors
Emmy : je te réserve ton VŒU pour demain
On espère des étoiles.
On espère qu’elles apparaissent dans les villes trop éclairées. On espère qu’elles apaisent le bruit de nos têtes. Et lorsqu’elles filent dans la nuit bleue – même si les étoiles qui filent ne sont pas vraiment des étoiles –, on leur demande quelque chose, comme on demande quelque chose quand le four affiche 11 h 11, quand un cil tombe sur une joue, quand on jette un sous dans une fontaine, quand on dit, au même moment que l’autre, la même chose.
On espère des étoiles.

8 août – 11 h 11
Emmy : Vœu
Sabrina : Yahoooo
Évidemment, les étoiles effraient aussi. Elles menacent d’exploser, de détruire les petits univers autour d’elles. Elles effraient, parce que porteuses de tous les vides. Elles effraient, comme le fond des océans, comme les rêves étranges, parce qu’elles sont la preuve de tout ce qu’on voit à peine, de tout ce qui pourrait être là, mais qu’on ne peut qu’imaginer.
Et si on imagine souvent le pire, reste qu’on imagine quand même. On prend ce qui nous tombe sous la main comme signe et on l’investit de sens, parce que plus que tout, on est des êtres d’espoir.
5 août – 22 h 20
Emmy : Prépare toi pour le VŒU
Sabrina : Oulalaaaa
5 août – 14 h 30
Sabrina : J’ai manqué ça once again
Sabrina : Misère hein
Sabrina : Mais c’est le festival du vœu soon, avec les Perséides
Sabrina : Je vais tenter de me rattraper
Pour le Bélier, le mois de novembre sera celui des épiphanies. Tu auras d’abord la réalisation soudaine et frappante qu’on ne lit ni l’avenir ni les personnalités dans les étoiles. Cette première révélation chamboulera ton état psychique. Si le cosmos ne peut donner sens à cet univers, alors quelle est la signification de ce monde chaotique, froid et amer ? L’absence de réponse te laissera bouleversé.
L’illumination qui suivra sera celle de l’acceptation de ta nouvelle réalité et de ce qu’elle apporte de beau. Si le monde n’a pas de sens, ce n’est pas un mal. Pendant que plusieurs qui font cette découverte pensent que plus rien n’a de sens, tu en trouves un nouveau : le tien. Les étoiles n’ayant plus d’emprise sur toi, tu n’es plus Bélier, case abstraite en marge d’un journal entre la section des sports et les mots croisés. Tu es toi, la somme de tes expériences, de tes mésaventures, mais aussi, et par-dessus tout, tu es ce que tu fais de ton temps, de tes envies, de tes ambitions.




Si on l’oublie souvent, il y a pourtant, dans chaque quotidien, un.e Taureau qui brille discrètement. Un.e Taureau qui traîne sur ses épaules la tristesse de ses ami.e.s et qui oublie parfois de se délester de ce poids. Les souffrances des autres ne sont pas les tiennes, mais malgré cela, novembre et ses nuits de seize heures te transformeront une fois de plus en quart de lune dans la noirceur
Premier.ère malaimé.e du zodiaque : le.a deux faces, le.a volatile, le.a people pleaser. Guess what, le dernier qualificatif est vrai, parce que pauvre Gémeaux d’amour, tous ces visages changeants, toutes ces personnalités que tu arbores, tu les arbores pour être aimé.e, parce qu’il y a peu de choses qui valent plus que ça pour toi : la validation des autres et, surtout, leur amour. Mais peut-être que novembre sera pour toi – parce que novembre force la solitude – le moment parfait pour te déposer, pour te retrouver toi et tes autres toi, seul.e.s et mille à la fois. Et si tu meurs d’envie de t’engourdir, de te saouler avec le bruit des corps qui t’entourent, fais-toi un peu violence, reste seul.e un peu plus longtemps; c’est une promesse, tu retrouveras le chemin vers toi, vers les autres aussi.




Toi qui es doux.ce
Toi qui es tendre Prépare ton tricot car pour toi novembre S’annonce d’un froid tristou [là-dessus rien contre ton signe, ce mois est rough pour toustes]
Toi qui aimes
Et qui aimes aimer Garde ta confiture home made pour janvier Pis écris-le pour toi, ce poème [oublie pas de prendre soin de toi, t’as pas à être le.a mom de chacun.e]
Un.e Lion en novembre, c’est un peu comme écouter de la musique de Noël en octobre : c’est plein de motivation. Tu en auras besoin, car comme le temps froid, les échéances de plusieurs de tes projets arrivent à grands pas. Si tu te sens dépassé.e, n’hésite pas à demander de l’aide à tes proches ou à tes collègues. En même temps que la température, tes barrières chutent et tu auras l’occasion de montrer ta loyauté. Elle te sera retournée, car les gens apprécient particulièrement l’énergie que tu dégages.
Pratique et logique, iel réfléchit, iel s’ancre au sol. Le.a Vierge s’enracine, son esprit s'accroche fermement comme un rhizome, iel chuchote son intériorité, sa compréhension, son empathie démesurée. Le.a Vierge (s’)écoute, son esprit vibre. Le sens de sa compréhension d’ellui, du monde comme de la vie elle-même est tel un reflet.
Prochainement, le.a Vierge pourrait sentir le besoin de se mettre en priorité en raison de la charge à laquelle iel fait face. Iel a besoin de réorganisation. En se concentrant sur la meilleure manière de trouver un équilibre, il sera plus facile de garder ses projets vivants et vifs. Iel ne doit pas se laisser envahir. Qu’iel sente l’homéostasie reprendre son cours, se mettre en branle.
Pour vrai, fais juste te décider.
Scorpion
Deuxième malaimé.e du zodiaque, le.a Scorpion tend au-dessus de son corps son terrifiant dard, s’assurant ainsi de garder les potentiel.les agresseur.ses à distance. Sauf que ces potentiel.les intru.es sont aussi les potentielles amours, les potentielles amitiés. Mais le ciel de novembre indique que quelqu’un qui n’est pas effrayé par ton dard s’approchera assez doucement de toi pour te glisser à l’oreille : laisse-toi aimer.
Le.a Sagittaire, c’est l’incarnation de la débrouillardise et de l’optimisme. Tu aimes rire et tu ries fort, tu aimes les histoires et tu es ô combien bon.ne conteur.euse. On ne se lasse pas de toi, tu as tellement à raconter ! Tu as une belle facilité à établir des relations, charismatique et intéressant.e comme tu es. Tu peux t’y déposer, tu sais, ne sois pas si pressé.e ! T’es tout feu tout flamme et c’est ta force comme c’est ta faiblesse.
En novembre, où ta saison débutera, le temps sera propice au dialogue plus qu’au monologue, ainsi qu’aux chaï lattés. Première piste de réflexion pour toi : le vieux dicton qui suggère que si l’humain a deux oreilles et une seule bouche, c’est pour écouter deux fois plus qu’il ne devrait parler.

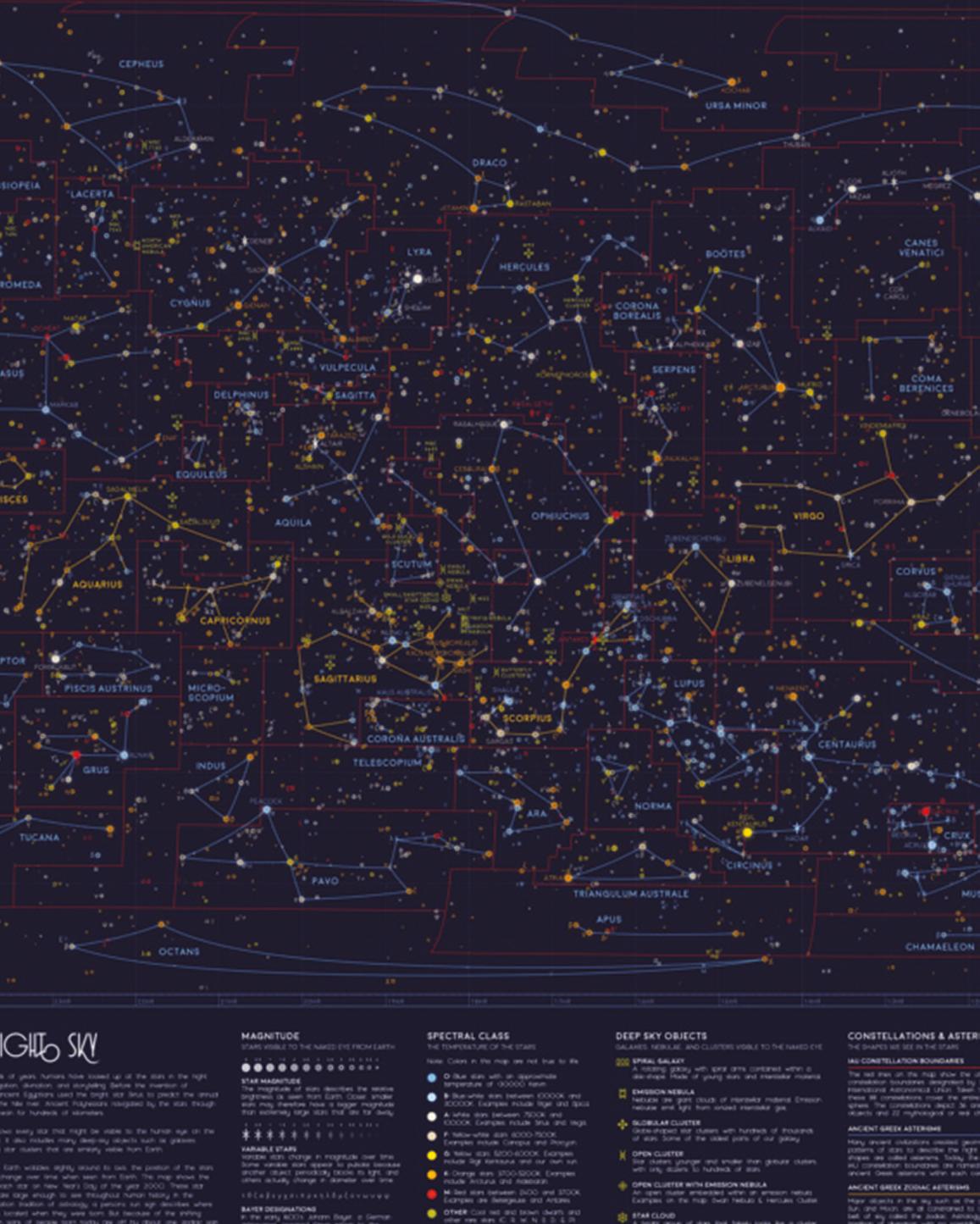


À l’approche de la saison des Capricornes, tu mérites de reprendre des forces, de prendre soin de toi. Alors que tu aurais envie de se blottir au chaud à la maison, car évidemment, la meilleure compagnie, c’est soi-même, recherche la chaleur des autres. Si tu as souvent raison, en novembre, sois ouvert.e aux erreurs, aux détours et aux chemins qui, au final, te feront grandir. Finalement, sache que c’est encore correct de commander un café glacé.




Iel est souvent mystère. Là où l’idée jaillit, le.a Verseau trouve moyen de transformer son énergie en poésie. En essayant de contenir le feu intérieur, le.a Verseau, un peu comme font les arbres lorsqu’ils sont cartographiés, s’inscrivent dans l’espace, travaillent sur le sol d’un vaste, vaste océan, qui prend plus d’espace que ce en quoi iel peut plonger. Le.a Verseau est remarquable, de par sa géologie profonde et complexe. Iel devient si insaisissable qu’iel est invisible à la lumière de la mer.
Pour ce mois de novembre, les astres élargiront tes horizons. Tu chercheras à explorer et pourrais sentir de grands courants te donner espoir en les opportunités qui te sont offertes. Tu auras néanmoins besoin de prendre du recul, de te lancer dans ce voyage sans pour autant te sacrifier toi-même.
Une idylle n’attend pas l’autre, dans tes pensées comme sur la place publique. Ton couraillage olympique est fortement alimenté par Vénus en Sagittaire. Respecte tes limites de vitesse et lève le pied momentanément. Attention à ne pas négliger les conseils de tes proches, après tout, iels connaissent suffisamment tes habitudes, les bonnes comme les mauvaises. Nota bene, la mélatonine n’est pas un allié de taille.
Au quotidien, au-delà de la routine boulot-dodo, les opportunités se manifestent, pas besoin de creuser très loin, cette fois-ci du moins. Jusqu’à la médiane du mois, Mercure est en Scorpion, synonyme d’un brin de chance professionnellement. Lorsque Sagittaire prend le relais le 17 novembre, attache tes Dr Martens parce que le vent vire de bord ! De grands traits de Sharpie apparaîtront dans ton front : incertitudes, incompréhensions, sentiment que tout va trop vite. Reste groundé.e. comme du cumin; la popotte, la lecture et la méditation sont de mise.
Ah! L’Afrique et ses mystères ! Des Africain.e.s vous ont-iels déjà parlé de l’œil noir ?
L’Afrique, ce magnifique continent, englobe tellement de règles fabuleuses, mais aussi sombres. Je vous parlerai ici de l’un des mythes les plus précieux de l’Afrique qui est celui de l’œil noir. Malgré la colonisation, les Africain.e.s sont très conservateur.rice.s et très attaché.e.s aux traditions et aux mythes transmis de génération en génération. Parmi ceux-ci, nous avons le mauvais regard des autres que nous appelons affectueusement « l’œil noir »; œil noir, nom très bizarre, je vous l’accorde !

En effet, l’œil noir fait partie des mythes les plus redoutés dans certains pays du continent africain. C’est l’une des croyances avec laquelle les Africain.e.s sont très strict.e.s. On dit toujours, en Afrique, qu’il faut se méfier de l’œil noir, car celui-ci peut avoir des conséquences très graves dans la vie courante. Lorsqu’il y a, par exemple, des célébrations importantes comme un mariage, une naissance ou encore une remise de diplômes, les Africain.e.s préfèrent ne pas les annoncer à tout le monde pour éviter l’œil noir. Je peux vous assurer que ce mythe est réel, car j’en ai moi-même été victime il y a de cela quelques semaines. J’ai mis sur les réseaux sociaux mes photos de graduation et j’ai fini par avoir un accident en fin de journée. Destin ou oeil noir ? Je dirais que c’est le mythe de l’œil noir qui s’est manifesté dans ma vie !
En effet, la tradition veut que ces occasions importantes soient révélées seulement aux plus intimes. L’œil noir peut être perçu aussi comme une forme de jalousie destructrice ou une transmission d’ondes négatives. En d’autres termes, dévoiler son projet à une tierce personne ne faisant pas partie de son entourage revient à prendre le risque d’attirer l’œil noir sur soi, ce qui provoquerait l’échec de ce projet.
Ennemi juré de plusieurs Africain.e.s, l’œil noir fait partie du côté obscur de la tradition africaine. Celleux qui jouent les Saint-Thomas, c’est-à-dire celleux qui veulent voir avant d’y croire, finissent toujours par être les victimes de l’œil noir. Comme il est dit, nul.le ne peut y échapper ! Ce mythe perdure dans le temps et affecte les plus vieux.eille.s comme les plus jeunes.
Ah! L’Afrique et ses mystères !
L’étymologie du mot miracle est apparue au XIe siècle après le premier récit chrétien. En effet, entre le milieu du 1er et le début du IIe siècle, le premier miracle est celui des noces de Cana –l’eau transformée en vin par Jésus. D’autres histoires de miracles sont venues s’ajouter dont la plus récente, en 1858 et reconnue par l’Église, concerne le miracle de Lourdes – l’apparition de l’Immaculée Conception (la Vierge Marie).
 Par Marie-Claude Giroux, journaliste collaboratrice
Par Marie-Claude Giroux, journaliste collaboratrice
Cependant, avec l’avènement de la pensée scientifique, ces miracles ont vite trouvé des explications logiques. Parmi celles-ci, on identifie les hallucinations causées par des troubles de santé mentale, la consommation de drogues ou la malformation cervicale chez le ou les témoins.
Bien que nous n'entendions plus tellement parler d’apparitions soudaines, la croyance envers les miracles perdure encore, mais s’est toutefois transformée. Aujourd’hui, que ce soit pour réaliser un rêve ou pour exiger une intervention divine quelconque, on les demande davantage par des prières incantatoires qu’on les constate. Pour ma part, il m’est arrivé de le faire et pour être bien honnête, je le fais encore. Sans avoir de grandes convictions religieuses, j’ai développé cet automatisme pour demander, par exemple, que des bonnes nouvelles arrivent pour un proche malade ou quand je veux gagner à la loterie.
Plus sérieusement, je ne crois pas que notre destin soit entre les mains du bon vouloir des divinités, mais je suis persuadée qu’un équilibre entre mes croyances et mes actions est nécessaire pour mon bien-être personnel. Mais, bien honnêtement, je trouve que c’est divinement plus valorisant d’accomplir quelque chose grâce à mes actions.
Malgré le fait que je suis convaincue que les miracles n’existent pas, ça me fait du bien de penser qu’une personne là-haut m’écoute quand je lui fais part de mes rêves les plus fous et qu’elle pourrait avoir la capacité de les réaliser. Tu sais, les rêves illogiques, mais qui font du bien à espérer, et qui de mieux pour me comprendre qu’un possible être supra naturel.
Je ne sais pas pour vous, mais moi, enfant, dès que j’avais la possibilité de faire des potions (comprendre ici que c’était très boboche du genre de l’eau avec du colorant), j’en faisais à outrance et avec n’importe quoi. Écouter Harry Potter faisait partie de mon quotidien et je voulais tellement devenir une sorcière que ce fût mon déguisement d’Halloween plusieurs années de suite, même l’an dernier. Le temps s’est écoulé et mon souhait ne s’est pas réalisé de la façon que la petite Raphaëlle de sept ans l’aurait voulu, mais j’ai découvert encore mieux : des pratiques simples, mais efficaces, des outils de divination et une communauté tissée serrée.

On peut se mettre d’accord qu’avec les séries de livres fantastiques et les films, le terme sorcière se fait associer au domaine du farfelu, du fantastique et bien souvent de l’irréel. Sauf que les pratiques païennes sont bien réelles et sacrées, et ce, depuis des siècles, qui disons-le n’ont pas été de tout repos pour toute personne pratiquant la sorcellerie, encore moins pour les groupes ayant été colonisés. À noter qu’en tant que femme caucasienne, je ne prendrai pas la parole vis-à-vis des pratiques qui ne concernent pas les personnes blanches. Il y a énormément de pratiques dans plusieurs communautés dont je ne fais pas partie, qui sont uniquement pour elleux. Malheureusement, plusieurs pratiques du witchcraft font l’affaire d’appropriations culturelles.
Alors pourquoi après autant de temps dans l’ombre, la sorcellerie ou witchcraft connaît-elle une (re)montée fulgurante ?
Je pense qu’elle était encore présente tout ce temps, simplement plus discrète et silencieuse. Depuis le début des années 2000, on voit une sortie du placard de plusieurs mouvements : les gens osent parler, se tenir debout pour leurs croyances, le féminisme reprend une bonne ampleur depuis les dix dernières années et par le fait même la sorcellerie. Je trouve que les deux vont de pair; on tuait des femmes durant le 15e siècle en Europe et partout ailleurs simplement parce que ces femmes étaient différentes et non conformistes. Ces atrocités, malheureu-

sement, se produisent encore aujourd’hui, et ce, partout dans le monde. Combien de féminicides avons-nous au compteur au Québec depuis le Nouvel An ? J’ai perdu le compte, car mon cœur et ma tête en souffrent trop. Il est logique alors qu’on associe, moi la première, la sorcellerie au féminisme. Des femmes qui se tiennent debout au risque de leur vie.

La sorcellerie, comme le féminisme, se doit d’être inclusive : tout le monde est bienvenu et le sera toujours. Nous sommes plusieurs dans la communauté à le dire : la sorcellerie est politisée et le sera toujours. C’est avec cette pensée en tête que je viens à croire que plus le féminisme reprendra de la place, plus la sorcellerie reprendra de la force.
L’art d’utiliser les plantes, de lire les étoiles, de comprendre des choses qui sont inexplicables (les arts de la divination par exemple) fut transmis de génération en génération, majoritairement grâce aux femmes. C’est lorsque j’ai commencé à m’intéresser réellement à tout ceci, à creuser, que j’ai trouvé des bijoux de sorcellerie dans mon quotidien, que je faisais sans même le savoir, comme jeter du sel derrière mon épaule droite avant de commencer à cuisiner ou bien ne jamais trinquer avec un verre d’eau, car tu peux risquer d’attirer le malocchio. Plusieurs mœurs et coutumes auxquelles ma famille italienne prend part descendent de nombreuses générations de sorcières et de païen.ne.s dans mon arbre généalogique. Certaines traditions sont mélangées avec la religion catholique, mais dans leur fondement, elles étaient païennes.
La sorcellerie est partout autour de nous. Ce ne sera peutêtre pas évident à voir, de comprendre que ça en est, mais la plupart du temps, cela en sera. Je rêve du jour où le féminisme et la sorcellerie ne seront plus pointés du doigt comme quelque chose d’irrationnel. Un jour ça viendra, peut-être durant une pleine lune, qui sait ?
« Un jour on inventera un pin’s spécial “sorcière” qui se portera à la boutonnière comme une Légion d’honneur. J’en rêve. Ce jour-là, il sera clair que la longue persécution qui aura tué des centaines de milliers de femmes en Europe est vraiment terminée, et que sorcières nous voudrons être. Alors, le mot “sorcière” s’inversera : il deviendra honorifique. » – Catherine Clément.
Petite liste personnelle de lecture de sorcières
- Le musée des sorcières, Catherine Clément

- The door to witchcraft, Tonya A. Brown
- Italian folk magic, Mary-Grace Fahrun
- Spells for change, Frankie Castanea
Mettons d’emblée quelque chose au clair : vous n’aurez pas affaire, dans cet article, à une spécialiste du tarot ou des oracles. Je n’aurai pas non plus la prétention de faire comme si. Pour tout dire, ma relation au tarot et aux oracles est toute neuve. Neuve, récente même, comme dans "je me sers de mon article comme prétexte pour enfin m’en imprégner ". Mon copain m’avait déjà tirée aux cartes, une fois au chalet. C’est tout. Si mon intérêt est présent depuis des lunes, c’est que, comme avec un peu tout, je n’ai jamais vraiment pris le temps de plonger dans cet univers aussi curieux et utile que créatif.
Par Frédérik Dompierre-Beaulieu, cheffe de pupitre aux arts14 octobre 2022
On arrive de La Poutinerie. Le fromage couik-couik et le sel des saucisses à hot-dog pourraient facilement nous préparer à une bonne semaine de jeûne. On est toustes assis.e.s en rond dans le salon de mon ami. La boule disco de sa colocataire nous surplombe. On sort mon Oracle de Lumière de Solar Éditions. Je n’ai pas le temps de faire grand-chose que mon ami s’empare du paquet, déballe le tout en deux temps trois mouvements et me le tend, en m’exhortant de brasser les cartes. « Il faut que tu transmettes ton énergie aux cartes. Je le sais, c’est ma grand-mère crosseuse qui m’a montré. » Je ne m’obstine pas, je me joue des figures comme on se joue des cartes de la QUNO familiales dans le bois avant une féroce partie de trou de cul. Après une suite de manœuvres et de gestes aussi mystérieux que méthodiques, il n’en reste plus qu’une devant moi. Ouhhhh. L’élue. Je la tourne.
La joie.
Le Tarot de la Joie est un Tarot divinatoire érotique en 69 cartes, vraiment divinatoire, vraiment érotique, qui se tire SÉRIEUSEMENT pour RIRE.
Relire cette phrase capitale, dans laquelle chaque mot compte triple, et qui exprime la raison d’être de ce jeu. Ce jeu peut bien entendu répondre à toutes vos questions d’argent, de travail, de santé, etc.
Toutefois, ne l’oublions pas, le Tarot de la Joie a été conçu pour répondre essentiellement à la question « que va-t-il m’arriver cette semaine sur le plan amoureux ET sexuel ? Et sous quelle forme ? ».
Oh, internaute attentif/ive, ne sois donc pas choqué(e) par ce qui va suivre.
Arcanes et divinations te ramèneront certes à la question amoureuse.
Mais dans le fond, n’est-ce pas la réelle raison de ta présence ici ?
Tarot et oracles : aux frontières du développement personnel, de la littérature et de la pédagogie

«
La joie nous rappelle qui nous sommes réellement, ce qui vibre au plus profond de nous et ce que notre âme a envie d’expérimenter. Rappelez-vous que la joie est la raison principale pour laquelle vous vous êtes incarné. »
(Widmer, 2020)
Parce qu’avant même de se lancer dans ces types de pratiques, pour la plupart d’ailleurs associées à une conception plutôt péjorative de l’ésotérisme, la relation que plusieurs entretiennent avec le tarot et les oracles commence en fait avec les perceptions qu’iels en ont. Pas besoin d’une utilisation religieuse du tarot et des oracles pour être en mesure de capter ce qui s’en dit dans le discours ambiant, les médias ou notre entourage pour explorer nos propres a priori. Cette relation où l’on observe de loin tient un discours en elle-même et permet de brosser un portrait des diverses représentations du tarot et des oracles, en plus de donner à voir comment ces pratiques sont médiatisées. Il y a là un lot de préconceptions qui circulent et qui contribuent à l’image que, collectivement ou individuellement, on a de ces pratiques, peu importe la position adoptée. Cette fois, j’ai décidé de balayer d’un revers de la main la formule casée de la dissertation ou de la récapitulation historique en interrogeant plutôt quelques personnes à ce propos. C’est par la singularité de l’expérience que je souhaite explorer le tarot et les oracles, cherchant à voir la multiplicité des usages que l’on peut en faire,comment on peut se les approprier, et ce, dans une perspective intimiste et anecdotique.
Les démystifier, donc. Oui, mais j’aimerais également pouvoir, à petite échelle, les dénuder des connotations qui tendent à entacher leur réputation, voir les formes que ces pratiques peuvent prendre, le sens qu’elles peuvent recouvrir, leurs occurrences et leurs différentes incarnations. Va pour le témoignage.

Autour de moi, je perçois un discours plutôt négatif. Ce n’est pas scientifique, c’est de l’arnaque, du charlatanisme. Je pense qu’il y a une confusion par rapport à la pertinence de ce genre de pratique. On a collectivement l’impression que c’est plus qu’un outil de réflexion réconfortant, mais que ça peut faire du mal parce que ce n’est pas issu de la pensée rationnelle. – Anonyme
La plupart de mes proches le voient comme une pratique ésotérique plus ou moins pertinente. Le tarot, dans la culture générale, est souvent moqué ou mis dans le même panier que le reste du bundle de la sorcière du dimanche avec son balai et son chapeau pointu. Je crois que pour bien comprendre la pratique du tarot et des oracles, il faut avoir été inhibé.e à un certain moment de notre vie dans la culture de la sorcellerie et de l’ésotérisme. D’autre part, les personnes que je connais qui pratiquent le tarot ou qui sollicitent des oracles voient le tarot et les pratiquant.e.s de celui-ci comme complètement légitimes, même que certaines personnes voient le tarot comme un référent social dans leurs décisions de vie importantes. Les pratiquant.e.s du tarot que je connais ne voient pas le tarot comme une apparition de la sainte bonté divine qui les guide dans leur vie, mais bien l’influence du hasard dans leur vie. Le hasard devient donc une entité à part entière qui peut s’exprimer à partir de diverses pratiques, telles que le tarot. Les Wiccans, tout particulièrement, ont des croyances qui peuvent parfois s’apparenter fortement à l’animisme et, tout dépendant de leur philosophie de pratique, personnifient beaucoup d’éléments de l’immatériel (le temps, l’aléatoire, les émotions, etc.) Ainsi, le tarot et les oracles peuvent être considérés comme un moyen de communiquer et d’avoir une opinion de cet immatériel. – Anonyme
J’en ai entendu parler sur les réseaux sociaux, surtout sur Tik Tok. – Anonyme
Je ne suis pas extrêmement familière avec le tarot et les oracles. Je ne l’ai pas pratiqué de manière assidue ni continue. J’ai l’impression que les personnes pratiquent cela afin de conduire à une discussion avec les autres ou bien avec soi-même. Se questionner sur ce qu’on souhaite sur le futur, notre vision du passé ou bien de ce qu’on vit présentement dans notre vie. Les personnes autour de moi l’utilisent beaucoup pour le plaisir. Iels tirent une carte, lisent la signification et font le comparatif avec leur vie. Ça permet de partager un peu sur soi-même de manière ludique. – Anaïs Béland, elle/she
J’ai l’impression que c’est une manière intéressante d’introduire des thèmes de réflexion sur soi-même, mais j’ai un peu de misère avec l’aspect « prédiction du futur » que certaines personnes mettent de l’avant. [J’en entends parler] principalement de manière anecdotique du genre « ma mère s’est fait tirer aux cartes et tout ce que la tireuse de cartes lui avait prédit s’est réalisé ». – Anonyme
Je l’utilise par période. Des fois, je l’apporte partout et je vais me tirer des cartes chaque jour et d’autre fois, je ne vais pas tirer de cartes pendant des mois. Ça dépend des problèmes que j’ai dans ma vie, plus j’en ai plus je vais faire des tirages. – Anonyme
J’ai toujours eu un intérêt pour l’astrologie, les étoiles, le tarot et l’énergie. J’ai une forte intuition dans la vie, et c’est pour ça que j’ai commencé. Jusqu’à maintenant, je peux dire que mon esprit est souvent juste. J’ai mon jeu depuis un an environ. [J’ai recours au tarot et aux oracles de manière] vraiment spontanée et occasionnelle. C’est surtout quand j’en ressens le besoin. Plus souvent lorsque je suis anxieuse. – Anonyme

Je dirais [que j’ai recours au tarot et aux oracles] de trois à quatre fois par semaine, lorsque j’ai une journée plus difficile ou quand j’ai de grands événements/grands changements qui arrivent dans ma vie. – Marianne, elle/iel
[Je les utilise] environ toutes les deux semaines, mais plus quand je vis des incertitudes et j’ai besoin d’aide pour préciser mes idées. [Je m’en sers aussi] quand j’ai des problèmes ou des situations inconfortables. Ça m’aide à réfléchir sur le problème, clarifier mes idées et développer un plan d’action. – Anonyme
Je ne crois pas au destin, mais les cartes du tarot de Marseille n’ont pas été créées pour rien selon moi. On retrouve des traces de l’usage divinatoire du tarot de Marseille depuis au moins le XVIIIe siècle et il était très possiblement utilisé bien avant. Je pense que l’usage d’accessoires de divination est une manière de régler un problème en utilisant une perspective différente sur celui-ci. Les cartes du tarot classique sont les seules que j’utilise, parce que je trouve qu’elles apportent toutes un angle intéressant, des avertissements et conseils de vie pertinents et qu’elles sont assez vagues pour épouser toutes les situations. C’est un outil précieux de flexibilité mentale, il nous permet d’étudier un problème d’un angle que l’on n’aurait pas nécessairement vu sinon. C’est pour ça que je me tire les cartes, pour avoir de nouveaux guides de pensée qui me mèneraient à une meilleure analyse d’une situation problématique. Par contre, quand je tire les autres, je préfère qu’iels y croient, parce que je suis bonne pour sortir le positif des cartes et je crois au pouvoir de l’effet placebo que ça peut entraîner. [J’ai tendance à avoir recours au tarot et aux oracles] seule pour répondre à une question ou donner une intention à ma journée ou je fais des tirages à mes proches qui le souhaitent. C’est comme un jeu, j’apprends à les connaître mieux et ça nous permet d’entraîner notre flexibilité mentale ensemble. – Anonyme

Le tarot et les oracles m’apportent du plaisir, principalement. J’aime l’effet de surprise et de découvrir ce que j’ai eu et d’en faire sens. Parfois, c’est étonnant comment cela peut nous parler. J’ai souvent recours au tarot et aux oracles avec d’autres personnes. J’aime partager ce genre de trucs avec les gens. C’est plus plaisant de comparer et de partager. Je suis une personne qui aime être entourée aussi. – Anaïs Béland, elle/she
Je me tire toujours au tarot pour m’aider à m’éclairer sur une situation en particulier. Je le fais rarement uniquement pour me « divertir », il y a toujours un but. Pour moi, le tarot doit toujours répondre à un questionnement ou une problématique dans notre vie. On n’utilise pas le tarot juste comme ça. Pour moi, le tarot sert à guider mes pensées et mes intuitions. Par exemple, si j’overthink une situation, j’utilise le tarot pour me recentrer et ajuster mon attention sur cette dite situation. Sans croire dur comme fer aux cartes, elles me permettent de « guider » mes énergies dans une direction plus précise. Seule, [cela] permet l’introspection, très personnelle, presque méditative. Avec quelqu’un, je sers de guide et d’interprète. Je prends la question/problématique de l’autre et je donne la signification de ses cartes. Je suis l’interprète du tarot. Sans vouloir me « vanter » ou quoi que ce soit, mais CHAQUE fois que j’ai tiré des gens de mon entourage, les cartes répondaient TOUJOURS à la question de départ. Je laisse les gens piger leurs propres cartes, mais c’est moi qui les place et qui les interprète. Pour le moment, j’ai seulement tiré des gens de mon entourage (ami.e.s proches, chum, parents), mais j’aimerais l’expérimenter avec des gens que je connais moins! – Anonyme Avec mon partenaire, on aime se tirer trois cartes au tarot et réfléchir à celles-ci, à ce que ça représente dans nos vies respectives et de notre vie de couple. Ça nous permet de bien communiquer et de ressortir des éléments qui n’auraient peut-être pas été discutés autrement. Quand je le fais seule, c’est vraiment pour démêler mes idées, voir plus clair et réfléchir à mon passé, présent et futur. – Marianne, elle/iel
Bien que je n’aie pas réellement pratiqué le tarot moi-même, mon entourage qui l’a pratiqué s’en servait majoritairement comme élément significatif dans leurs prises de décisions. Ainsi, leurs choix importants pouvaient être guidés par les résultats du tarot ou des oracles. De mon expérience, jamais une personne n’a pris une décision seulement grâce aux divinations, c’était seulement un argument supplémentaire ou un référent dans leur vie. De mon expérience avec la Wicca, le tarot et les divinations se passaient toujours en groupe ou, du moins, en dyade. Par contre, il faut savoir que la Wicca met l’emphase énormément sur l’importance de l’expérience du groupe et de la communauté. La réalité risque d’être différente dans d’autres regroupements. – Anonyme
Pour moi, c’est un outil d’introspection qui peut apporter de nouveaux angles de pensées sur un problème, et parfois trouver un autre angle d’approche que je n’aurais pas vu nécessairement. Un peu comme écrire dans un journal intime aide à sortir toutes ses idées sur papier pour y voir plus clair, mes cartes d’oracles m’aident à réfléchir et chercher en moi des solutions concrètes à mes problèmes, me permettent de prendre du recul pour mieux analyser la situation et m’aident à relativiser l’ampleur du problème. C’est aussi rassurant de voir des cartes qui te disent que tout va bien aller et que tu œuvres dans la bonne direction, que ta patience va bientôt être payante et que de bonnes choses viennent vers toi. [J’y ai surtout recours] seul.e, mais ma coloc et certain.e.s de mes ami.e.s aiment ça aussi alors parfois on tire des cartes ensemble. Seul.e peut m’aider à me poser des questions que je ne suis pas nécessairement prête à articuler devant autrui. Avec d’autres personnes, c’est bien pour voir comment d’autres personnes analysent les cartes et découvrir de nouvelles perspectives. – Anonyme
Dans mon deck d’oracle, la carte « Rain – Fecundity » a la description : « The conditions of greater prosperity are being met. Know that all will be well. Cleanse yourself of old outdated views. You have everything you need to grow. Let yourself be cleansed. » Je l’aime, car je l’ai pigée deux fois de suite alors que j’essayais de choisir entre deux options. Je l’ai interprétée comme « les deux sont des bonnes options, mais insignifiantes sur le long terme. Tu n’as pas besoin de te prendre la tête avec ça. Choisis ce que tu souhaites faire en ce moment, et non ce que tes idées préconçues te disent de faire ». C’est toujours drôle quand tu piges la même carte deux fois de suite (je te garantis que j’avais bien brassé les cartes !). – Anonyme
Je ne sais pas pourquoi, mais la carte de la tour revenait vraiment souvent dans mes tirages. Je l’avais oublié, mais maintenant je me souviens. – Anaïs Béland, elle/she
Destruction · Changement radical · Perte et la ruine · Nouveau départ · Événements imprévus Sombre et menaçant, la Tour est l'incarnation de la perturbation et du conflit. Pas seulement du changement, mais le mouvement brusque et les secousses provoquées par les événements imprévus et traumatiques qui font partie de la vie. La Tour dans votre main est toujours une menace, et implique inévitablement la tragédie, et vous devez décider si vous allez faire face avec grâce.
Le Tour symbolise les événements imprévus et ceux à venir dans votre vie. Cependant, les changements vont dans le sens de quelque chose de catastrophique, désastreux, et e globalement négatif. Cela pourrait être lié à une sorte d’accident, de catastrophe ou de dommages dans d’autres domaines de votre vie. La réponse fournie par cette carte est non. (https://www.trustedtarot.com/fr/cartes/signification/la-tour/)
La Carte de Tarot La Tour – appelée Maison Dieu dans le Tarot de Marseille – représente une tour en haut d’une montagne, foudroyée par un éclair. La Tour s’effondre, ravagée par les flammes. Deux personnages qui rappellent les captifs de la Carte du Diable plongent tête la première dans le vide pour échapper au chaos.
L’éclair qui déchire la Tour tombe du Ciel vers la Terre, symbolisant un bouleversement dont l’origine est Spirituelle ou Divine et qui s’applique au plan Matériel, à la vie humaine. La Tour représente donc un changement brusque, une destruction matérielle. Elle représente aussi les prises de consciences qui bouleversent nos vies et impactent profondément les personnes que nous sommes. Dans le Tarot de Marseille, l’explosion semble venir non pas de l’extérieur mais de l’intérieur même de la Tour. Cela signifie une “révolution intérieure” qui mène à de grands changements internes et intimes (Le Tarot de Marseille).

Espace littérature : les tarots et oracles littéraires
Ouan. Je ne pouvais pas vraiment passer à côté de la dimension ~ l i t t é r a i r e ~ du tarot et des oracles. Pour aborder ce qui accompagne pas mal mon quotidien ces derniers temps, je me servirai de l’oracle littéraire Clairvoyantes – Un oracle littéraire de la maison d’édition Alto, de L’Oracle des sorcières de la littérature de Taisia Kitaiskaia et Katy Horan ainsi que Le Tarot littéraire conçu par Virginie Fournier et Anaïs Savignac, avec la collaboration d’Hugo Bourcier et de Maxime Nadeau et illustré par Andreea Vrabie. Présentations rapides.

L’oracle littéraire Clairvoyantes, projet collectif réalisé sous la direction d’Audrée Wilhelmy et de la photographe Justine Latour et paru depuis avril 2022, est tant disponible en version imprimée que numérique. Papier, il prend la forme d’un coffret rassemblant un livret d’accompagnement de 104 pages ainsi qu’un paquet de 45 cartes. Voici la description laissée sur le site de l’éditeur à ce propos : « Oracle littéraire aux possibilités vertigineuses, Clairvoyantes réunit quinze autrices parmi les plus inspirantes de notre littérature. Le jeu invite à utiliser le pouvoir symbolique des histoires pour observer sous un nouvel angle les défis, les rêves, les relations et les projets qui animent notre quotidien. Le coffret contient un livret explicatif et 45 cartes réparties en trois domaines : figures, lieux, objets. Posez une question, tirez une carte de chaque domaine puis allez découvrir le récit qui y est associé et son interprétation. Au fil des trames que dessinent les cartes surgissent des pistes de réflexion, des germes de rêves, un infini de possibles. » (Éditions Alto, 2022) L’œuvre cherche à mettre au premier plan le travail d’autrices telles Mélikah Abdelmoumen, Stéfanie Clermont, Hélène Dorion, Louise Dupré, Dominique Fortier, Marie-Andrée Gill, Karoline Georges, Véronique Grenier, Catherine Lalonde, Perrine Leblanc, Catherine Leroux, Chloé Savoie-Bernard, Élise Turcotte et Christiane Vadnais, qui sont pour la plupart reconnues pour leur souci de la forme. Ainsi, toutes les cartes des trois catégories sont associées à un texte relativement ouvert et fort en symboliques. La déclinaison numérique de Clairvoyantes n’établit certainement pas le même rapport au toucher et à la matérialité que son homologue papier – aspect souvent fort important lorsque l’on parle du brassage des cartes, par exemple – mais elle se dote tout de même d’un élément supplémentaire et exclusif, soit la lecture des textes des cartes et figures par diverses comédiennes. Intéressant.

En ce qui concerne plutôt L’Oracle des sorcières de la littérature de Vega Éditions, le coffret contient 70 cartes illustrées et un livret d’accompagnement de 60 pages et présente « 30 écrivaines aux pouvoirs extraordinaires, des cartes de trente auteures, connues ou oubliées, qui ont marqué l’histoire de la littérature grâce au pouvoir de leurs mots. Parmi elles, Toni Morrison, Virginia Woolf, Anaïs Nin et Gertrude Stein. Le jeu est complété de quarante peintures sur le thème de la sorcellerie. » (Les Libraires, 2022). Néanmoins, le caractère littéraire ne se manifeste pas exactement de la même façon que chez l’oracle d’Alto, bien que dans les deux cas, on souhaite valoriser des figures féminines fortes. Ici, il n’est pas question de textes littéraires associés aux cartes, mais plutôt des résumés du travail et de l’œuvre des autrices en question, ce qui permet aux utilisateur.rice.s de découvrir tout un pan de classiques de la littérature au féminin en plus de repenser ces figures d’écrivaines émancipées, visionnaires et emblématiques à travers le temps.



Quelque chose de similaire est à observer du côté du projet Le Tarot littéraire , proposition reprenant 22 arcanes majeurs du tarot de Marseille. Pour chacun des arcanes, un.e auteur.rice fut sélectionné.e en fonction de l’association possible entre la carte et leur œuvre. Encore une fois, on reste dans une visée divinatoire, avec un livret d’accompagnement qui sert à décrire et expliquer les cartes du tarot. Néanmoins, on se sert de ce que l’on connaît de l’auteur.rice et de son travail pour aider et guider notre interprétation et ainsi répondre à nos questions. Les cartes sérigraphiées en noir, blanc et or et se présentant dans un sac en velours noir représentent de nombreuses heures de travail pour l’équipe de conception. Sans pour autant présenter des portions de création littéraire, ces deux oracles littéraires incitent à se plonger dans les œuvres de fiction et de poésie en faisant appel à notre propre créativité et en nous encourageant à écrire notre propre histoire, à être agentif.ve.s.
Dans les trois cas, ce qu’on remarque, c’est non seulement les façons dont l’immersion littéraire se conjugue aux arts divinatoires pour leur conférer des orientations particulières, mais également un

déplacement, une redéfinition du livre papier. Les œuvres présentées appartiendraient en ce sens non pas à une littéraire dite conventionnelle, mais plutôt à des pratiques appartenant à ce que l’on nomme les arts littéraires. Plus qu’une question de littérature, se dégage des trois propositions un souci de la forme, certes, mais aussi de la filiation et de la transmission, facteurs qui semblent constituer le fondement de ces oracles et tarots littéraires. On y retrouve d’ailleurs une forme de revalorisation et de renouement avec la tradition orale, trop souvent évacuée par l’écriture. En plus de la dimension introspective de la cartomancie qui nous pousse à reconsidérer notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes, les tarots et les oracles littéraires égayent cette pratique en lui octroyant un côté ludique et en venant accentuer leur dimension narrative. On pose des questions et on écoute, mais on se raconte, aux autres et à soi-même, surtout.

L’arcane La Force, est la onzième lame du Tarot de Marseille. Elle représente une femme de profil tenant la gueule d’un chien. Ici le symbole de la femme est celui d’une volonté humaine douce et le symbole du chien celui de nos instincts. L’arcane La Force est une véritable alliance entre la volonté et les instincts. C’est la source de la maitrise aussi bien de soi-même que des situations extérieures. Avec La Force nous manifestons notre énergie vitale et notre force de caractère. C’est un arcane qui évoque notre courage et notre détermination à aller au bout de nos objectifs.
La Force représente la capacité de réalisation de ce que nous désirons. La Force est un accord entre nos désirs et nos aptitudes à les mettre en œuvre. Elle est une vision claire de nos objectifs à atteindre.
La Force est un symbole de l’union et de ce fait elle représente les alliances et le mariage. C’est une union réussie et harmonieuse.
Dans sa face sombre, La Force représente les conflits, le fait de se mettre la pression et d’exiger trop de soi-même. Elle est une image des abus de pouvoir et d’une façon générale de l’opposition et du désaccord entre la volonté et les désirs.
Ce que représente l’arcane 11 La Force sur le plan du développement personnel :
Le positif
J’ai de l’’énergie et une grande force vitale. Je vais au bout de mon projet pour sa réussite.
Je me donne un objectif et je l’atteins. Je maitrise une situation. Je suis déterminée.
J’unis des forces opposées ou différentes. J’obtiens une alliance et je réconcilie les parties.
Je me marie. J’obtiens ce que je veux. Je suis l’axe d’une situation. Je fais preuve de logique. Le négatif, à l’envers
Je vis un conflit. Je rencontre un obstacle majeur, une opposition interne ou externe.
Je suis partagée et je ne parviens pas à tenir mes objectifs. Je lâche prise. Je me sens fragile.
Je force trop les choses et me force trop moi-même. Je veux trop obtenir à tout prix.(Le Tarot de Marseille)
« Nous croyons qu’être fort consiste à ne pas montrer notre vulnérabilité. Que cette puissance nous offre la possibilité ne nous protéger, de ne pas ressentir, de tout contrôler. Celle qui permet de transcender chacune de nos épreuves en apprenant et en comprenant mieux chaque fois. Celle qui nous soutient dans les moments difficiles et qui nous permet, à notre tour, de soutenir les autres lorsque nous en avons l’énergie. […] Ne vous laissez pas déstabiliser par la peur projetée parfois par votre entourage ou encore la société, car vous êtes fort. » (Widmer, 2020).

Le tarot-conte : une histoire d’amour Bon. Je vous vois déjà me rebattre les oreilles en me demandant pourquoi ne pas avoir inclus le tarot-conte dans la section sur la littérature. Le tarot-conte en fait partie, mais pas exclusivement. On déplace un brin l’intérêt. C’est qu’il y a avec cette forme particulière de la pratique du tarot et des oracles quelque chose qui s’inscrit bien au-delà du texte et de l’écriture. Si j’ai choisi de m’y attarder, c’est en fait en raison de son utilisation en contexte pédagogique. Ben oui! Cette fois, c’est avec Leïla Sikouk, doctorante en études littéraires, que je me suis entretenue. Elle m’explique que « lorsque l’on lit ‘‘tarot-conte’’, on imagine souvent un tarot classique, revisité avec l’univers des contes, dans un décor de princes et princesses ou de personnages issus des récits de Perrault. Il est vrai que l’on en trouve beaucoup de la sorte et de très beaux ! L’imaginaire ésotérique peut aisément se (con)fondre avec l’univers onirique. Or, le tarot-conte, qui lui me semble encore peu développé pour le moment (j’aimerais d’ailleurs en créer un bientôt !), désigne plus spécifiquement des cartes dont l’illustration ou les mots clés qui s’y inscrivent permettent de stimuler la créativité du lecteur pour l’invention d’une histoire. Bref, le tarot-conte, ce sont des cartes stimulatrices d’histoires ! De la même façon que je vois les oracles comme des ponts pour se connecter à son intuition, je vois les tarots-contes comme des tremplins pour stimuler son imagination. »
Quel lien avec la pédagogie ? C’est que, pour l’instant, la plupart des tarots-contes se destinent aux enfants et s’avèrent particulièrement utiles pour les enseignant.e.s : « En effet, c’est une vraie question pour les enseignant.e.s, particulièrement du primaire et du secondaire : comment enseigner l’imagination ? J’ai eu l’occasion d’y réfléchir à l’occasion de mon mémoire d’enseignement de maîtrise portant sur le sujet Enseigner l’imagination, le paradoxe de l’enseignant et ce n’est pas simple d’y répondre ! L’imagination est partout dans les programmes de français, comme si elle allait de soi, mais qu’est-ce que l’imagination ? Puis, d’abord, est-ce que ça s’enseigne, l’imagination ? En effet, en tant qu’enseignante, j’ai rencontré des enfants pour qui inventer une histoire est un vrai casse-tête, tandis que d’autres en écrivent en un jet, voire débordent du cadre de la consigne tant leurs idées fusent ! Le tarot-conte est ainsi un superbe outil pour aider les enfants et même les étudiants à créer. Pour l’imagination, nulle limite d’âge n’existe ! C’est pour les grands et les petits. » Plus spécifiquement, on se servira du tarot-conte en contexte de pédagogie différenciée. Selon Leïla, « les cartes sont autant de bases et fondations matérielles solides qui guident l’élève dans son cheminement créatif abstrait. Il peut ainsi tirer le fil de l’histoire à l’aide de ces balises.
Les cartes du tarot-conte agissent comme une véritable carte (au trésor) : elles aident l’enfant à se situer, à trouver des repères pour être mieux orienté dans son élan créatif plus ou moins spontané. C’est pourquoi, le plus souvent, elles proposent des personnages (animaux, humains, héros, etc.), des lieux, des objets, etc. qui (re)constituent la trame et le schéma narratif – soit l’itinéraire – de l’histoire. De plus, la dimension ludique permet à l’enfant d’apprendre et de progresser en récit d’invention, en élocution, en rédaction, sans trop de contraintes. Ou plutôt, avec des contraintes plaisantes et stimulantes, comme pour l’Oulipo. De nombreux jeux de société sont ainsi des tarots-contes qui s’ignorent ! » Pour rebondir sur les témoignages déjà récoltés, bien que le tarot puisse se pratiquer en groupe, beaucoup l’associent à une pratique individuelle et plus intime. Du côté des tarots littéraires, bien que l’oralité soit valorisée par la dimension narrative, la pratique reste relativement associée à l’écriture, à une lecture que l’on garde pour soi. Le tarot-conte se démarque en ceci qu’il tend à la fois à réinvestir la dimension orale des contes traditionnels que l’aspect plus collectif et rassembleur de ces derniers. Même, il s’agit là d’un outil que mêmes les psychologues, en dehors du son caractère ludique, peuvent se réapproprier : « D’une certaine façon, je trouve en effet que le tarot-conte ramène à l’héritage oral et collectif du conte ancestral puisqu’il s’agit de placer le.a tireur.se de cartes en conteur.euse-improvisateur.rice. Certes, on peut tout à fait piocher les cartes et écrire à partir de ces sources d’inspiration, mais la dimension visuelle des cartes, avec des illustrations et des techniques artistiques plus ou moins travaillées selon les cas, peut offrir une dimension scénographie qui n’est pas sans rappeler l’origine traditionnelle des contes oraux. Le geste même de retourner et d’exposer les cartes représente un geste mimétique et théâtral. Un tarot-conte improvisé oralement peut même se lire comme un album de littérature jeunesse. Les pages tournées sont autant de cartes révélées, avec leurs nouvelles couleurs, tonalités et péripéties. Par ailleurs, le tarot-conte est aussi utilisé par les psychologues, afin d’aider les enfants
à mettre en mots leurs émotions enfouies. Les cartes du tarot-conte agissent bien comme de vraies stimulatrices, que ce soit d’imagination ou d’inconscient. Le tarot-conte est un terreau fertile pour toutes sortes de fleurs ! »
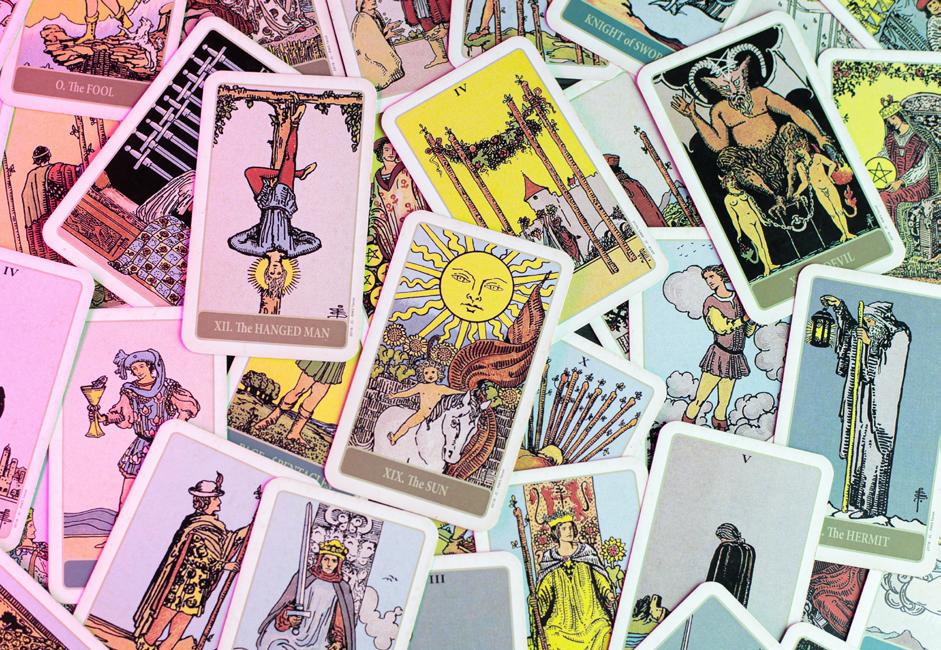
On comprend donc qu’il y a autant de déclinaisons et d’usages du tarot et des oracles qu’il y a de pratiquant.e.s. Plus qu’une simple histoire d’arnaque ou de prédictions, ces pratiques se posent comme un déclencheur à la réflexion et à l’introspection, permettant de mieux se connaître ou de jeter un éclairage nouveau sur une situation, de remettre à l’avant-plan des figures qui valent la peine d’être redécouvertes ainsi que d’apprendre et de mobiliser l’imagination. De quoi remettre à leur place les grands-mères crosseuses.
Wilhelmy, A., Abdelmoumen, A., Clermont, S., Dorion, H., Dupré, L., Fortier, D., Gill, M-A., Georges, K., Grenier, V., Lalonde, C., Leblanc, P., Leroux, C., Savoie-Bernard, Turcotte, É., Vadnais, C. et Latour, J. (2022). Clairvoyantes. Un oracle littéraire. Les éditions Alto.
Kitaiskaia, T. et Horan, K. (2022). L’oracle des sorcières de la littérature. Les éditions Vega.
Widmer, A. et Avada, J. (2020). Oracle de Lumière. Les éditions Solar.
Savignac, A., Fournier, V. et Vrabie, A. (2018). Le Tarot littéraire. Éditeur non spécifié.










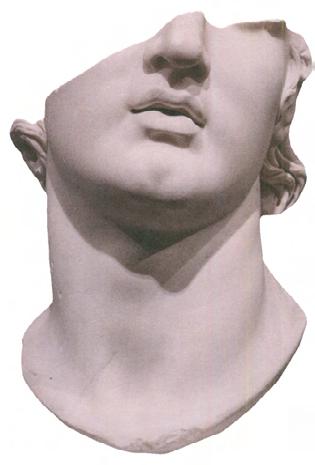


Une grande peur que j’avais, jeune, était celle de l’eau. De la mer, des lacs, du fleuve. Envisager un monde entier sous mes pieds, un monde marin qui pouvait m’engloutir, me figeait complètement. C’était un monde trop grand, trop creux et trop sombre pour moi, et c’était un environnement où je n’arrivais même pas à bien me mouvoir : quoi de plus terrifiant. Cette peur s'est accompagnée au fil des années d’une grande admiration, et mon vertige des profondeurs ne me semble désormais que l’un des éléments qui composent ma relation à l’eau. Notre relation s’est complexifiée. La crainte est amplifiée par le brouillard, les glaces, l’air humide qui chancelle, mais elle est désamorcée par la compagnie, les histoires et le temps à patauger dans l’eau. Et de ces choses qui persistent, il y a cette aura de mystère qui rôde autour du fleuve, telle une brume sournoise qui ne veut pas s’effacer à l’aube.
Par Sabrina Boulanger, journalistemultimédia
Note : certaines réalités décrites dans ce texte sont particulièrement genrées, d’où l’utilisation spécifique du masculin.
Là où peuvent exister les fantômes J'avais aussi peur du sous-sol sombre, non fini et froid de chez mes parents, là où mille recoins pouvaient cacher les monstres de mon imagination. C’est chose connue depuis longtemps : les espaces incompris catalysent le frétillement des esprits. Et la montagne et la mer sont de ces lieux à l’origine d’une foule de créatures et de mythes : ce sont des endroits difficiles d’accès, dont les aléas particulièrement abrupts suscitent la peur. Ainsi, la mer représente certes richesse et liberté, mais elle se compose également d’angoisse et de violence – elle est à la fois vie nourricière et mort tempétueuse. Ses eaux couvent des êtres et des lieux étranges qui ont longtemps été inaccessibles, et le vent y tourne bien vite. Puis cette mer, avec sa robe infinie, chatouille l’imaginaire et répond au besoin de rêver, en stimulant à la fois les belles histoires et les vilains personnages.
Le Saint-Laurent recueille depuis des siècles des rêveries, celles des autochtones comme celles des migrant.e.s européen.ne.s. Ce fleuve-vieillard a témoigné du métissage progressif parfois doux, souvent pas, de leurs cosmologies respectives. Tandis que les Européens naviguaient précautionneux de leurs monstres à eux, c’est de Atshen qu’ils devaient se méfier, ici. Et puis ces lieux que les Européens baptisaient de noms chrétiens et royaux, les Premiers Peuples les avaient déjà nommés puisque parcourus depuis des millénaires : « les Autochtones ne donnaient pas de nom aux lieux sans y avoir d’abord observé, exploré et senti les esprits. Ils n’imposaient pas les noms, ils les découvraient » (Cisnaros, 1987, p. 22). La terra nullius1 que pensait voir le colonisateur était plutôt un territoire mal lu.

Et pourtant. Dit-on qu’une oreille tendue permettait autrefois d’accéder à cette magie qui se cachait un peu partout, parmi les craquements de la glace et les hululements du vent. Les paysages laurentiens aiment se voiler de brume et entretenir le mystérieux, ce n’est pas nouveau. Les fantômes dormaient dans les anses à l’ombre des épinettes avant de s’immiscer dans les sous-sols.
1 « territoire n’appartenant à personne »


Gaston Desjardins (2007, p. 249) déplore la façon actuelle de consommer les paysages, derrière un écran ou une fenêtre de voiture qui file vite, à la façon fast food. Il invite plutôt à observer les milieux vivants qu’ils constituent vraiment; un paysage interagit avec qui s’y plonge – c’est une combinaison multisensorielle qui se décline ad vitam æternam en fonction du temps qu’il fait, de l’heure de la journée, des états d’âme. Il est bâti avec les toponymes et les récits, coconstruit de représentations et de symboles.
Un paysage ne peut être réduit à la qualité visuelle de ce qui s’élève devant nos yeux, ce serait limiter la part de l’affect qui le forge, et réduire le rôle de l’observateur. Non – le paysage comprend cet aspect humain qui le singularise, il fait partie de l’identité de la collectivité qui l’habite. Cet amalgame complexe qu’est le paysage, face à la sensibilité, révèle ses fantômes – il en a vu des vertes et des pas mûres – et s’est imprégné de tout ce vécu.
Les vérités se côtoient Le terme mythe provient du grec muthos qui veut dire récit, légende, et se rattache à un objet, qu’il représente. Le mythe prend pour fondement le sensible et l’imaginaire, ce qui le rend indissociable de la culture d’une société. (Paulet, 2006, p. 21) Le mythe se soumet à une logique qui est sienne, il est issu de la relation entre un peuple et son environnement, et est parfois teinté de ses peurs et de ses tabous. Il n’est pas une chose fausse, mais n’est pas la seule vérité.
La légende, elle, construit un narratif fictif qui s’évade de l’imaginaire collectif.
Le mystique coexiste avec le scientifique, ces systèmes de connaissance du monde ne s’invalident pas respectivement. À plusieurs égards, ils se complètent dans la quête de sens et de savoirs sur l'environnement, les humains, les animaux.
Et assurément, ces deux mondes comprennent leur part de mystère, d’irrésolu qui nous laisse sur notre faim.
« Qu’on m’apporte un astrolabe, une boussole. Je suis perdu. Je contemple donc la mer et les alentours à partir du navire. Mais le navire aussi m’échappe, comme la philosophie, comme la géométrie. La mer est pleine de mystères et de connaissances qui ne me parviennent pas. Et la fée des glaces n’arrive pas tout à fait à faire dissiper le mystère. Où est l’immanence? Où se cache la transcendance? Je cherche de plus en plus refuge dans le navire. Là où je sais que ce que je ne comprends pas existe. Le navire m’échappe, mais je crois au navire. Je n’ai pas le choix. Je pratique la foi du charbonnier. J’appartiens sans condition au navire du savoir et au savoir du navire. À tous risques. Et pour me rassurer, je me cite Michel Serre :
… ne parle-t-on de mythe que par ignorance de la géométrie…
Ce qui ne l’empêche pas de naviguer autant le navire que l’Odyssée. » (Perrault, 2022, p. 207)


L’île, emblème du rêve D'innombrables îles ponctuent le fleuve et l’estuaire et le golfe. Elles ont hébergé des ermites, des naufragé.e.s, des cimetières, des amours, des villages, des malades, des contrebandes, des phares – toutes ont quelque chose à raconter. Les îles ont de particulier qu’elles sont eau comme elles sont terre, elles sont espaces introvertis. Gaston Desjardins les présente comme l’union entre passé et présent, comme les gardiennes discrètes des vieilles mémoires. Dans l’imaginaire maritime, l’île sert de relais au désir, un désir celui de l’autre et de l’ailleurs. (Desjardins, 2007, p. 124) L’île représente l’espoir, elle est halte vers le rêve, lourde signification pour ces parfois minuscules rocs émergés. En ces lieux peu fréquentés si ce n’est que par quelques bateaux lointains, les fantômes y vivent en paix – peut-être dans l’attente de la visite, qui sait.
Dieu et le diable contemplaient l’horizon depuis le cap Diamant, songeurs. Devant eux se trouvaient pêle-mêle pierres, forêts, montagnes, lacs, ciel, sable, nuages et mer. Les deux personnages, d’un commun accord, décidèrent de faire le ménage dans le portrait. Le diable fut chargé de mettre en scène le fleuve Saint-Laurent. Il creusa un lit, sculpta caps et falaises, déposa plages et rochers, puis y versa l’eau. Le diable prit un pas de recul et admira son œuvre : il en était si fier! Taquin, il défia Dieu de faire mieux. Dieu, un brin susceptible, s’emporta devant la vantardise du diable. Il souffla une tempête si effroyable que le diable, pris de terreur, s’enfuit en courant en direction de l’Atlantique. Chacun de ses pas sur le fleuve faisait émerger la terre de l’eau, et c’est ainsi que le Saint-Laurent s’est tapissé de toutes ses îles. (inspiré de Desjardins, 2007, p. 122)

Les pêcheur.euse.s, les boat people et les colonisateurs ne connaissent pas la même face du Saint-Laurent. Les premiers connaissent ses bancs de morue, ses marsouins, ses maquereaux, et s’aventuraient tous les jours dans les eaux périlleuses pour nourrir leur famille. Les habitant.e.s de ses rives étaient des pêcheur.euse.s avant d’être des cultivateur.trice.s – on dit que le pays s’est d’abord vécu depuis la mer. Une telle proximité avec le cours d’eau n’est pas sans se refléter dans la relation entre les habitant.e.s et le fleuve : leurs quotidiens liés les forgent mutuellement. Parfaitement au courant des dangers, le pêcheur superstitieux mettait toutes les chances de son côté en laissant à quai femmes, prêtres, cercueils et blasphèmes. (Desjardins, 2007, p. 304) En fins observateurs, ils avaient appris à lire les respirations, les manies et les humeurs de leur fleuve pour évaluer le danger d’y naviguer.
Mais même les jours où les astres semblaient alignés, un rien pouvait renverser les prévisions et les avaler tout rond. Un pêcheur qui partait en mer n’était jamais certain de revenir, au grand dam de sa famille qui ne pouvait que prier et attendre. Les tragédies du Saint-Laurent sont nombreuses et bien souvent à l’échelle humaine : on parle de centaines et probablement de milliers de naufrages qui ont emporté encore plus de vies.
Le fleuve est beau et généreux, mais il est aussi cruel et sans pitié. Il garde à lui les âmes avalées, dont le vent des grèves charrie parfois les lamentations sourdes. Il en sera de nos morts, comme il en fut de nos vies, partagés entre la terre et l’eau. – Desjardins


la vieille chaloupe elle flotte encore la vieille chaloupe flotte encore elle nous porte mais on s’éloigne de la rive ne mettez pas les mains dans l’eau vous ne voulez pas réveiller ce qui dort dans ses noirceurs – Patrice Desbiens

Y a-t-il des eaux naviguées qui n’ont jamais connu de naufrages? La mer et la mort vont de pair, surtout avec les courants agités, les écueils, les hauts-fonds, les vents imprévisibles et la tendance à la brume du fleuve. Avec près de 400 bateaux coulés autour d’elle, Anticosti est réputée être le cimetière du golfe. Peut-être compte-t-elle même davantage de fantômes que de cerfs de Virginie. Mais des naufrages, il y en a eu en amont et en aval aussi – parmi ceux qui ont grandement marqué les mémoires, mentionnons celui de l’Empress of Ireland, le 29 mai 1914, où 1012 des 1477 passager.ère.s ont péri dans les eaux froides du Saint-Laurent, au large de Rimouski. Une collision dans la brume a percé la coque du navire, qui a sombré en 14 minutes.
La lumière des phares et le hurlement des cornes de brume ont grandement aidé les navigateur.rice.s des eaux périlleuses. Ce n’est qu’en 1807 que le Saint-Laurent voit son premier phare s’ériger, sur l’île Verte. Les infrastructures et leurs gardiens étaient entièrement tournés vers le large, leur existence était vouée, beau temps mauvais temps, à prendre soin des marins en leur indiquant les dangers. Et bien sûr en faisant office de présence rassurante, même si lointaine. L’histoire des phares du Québec en est une belle mais douloureuse, construite sur le dos des mort.e.s afin de veiller sur les vivant.e.s.

Clôture de ce texte de territoire, de fleuve et de fantôme sur les paroles de Cisneros, qui nous invite à réfléchir à l’espace mythique qu’il nous reste.

« Je crains pour le Québec. Il se croit petit mais il est un beau géant. Entouré en trois points cardinaux par une culture de vocation expansive, il ne reste que le Nord comme refuge mythique, comme réserve spirituelle. Mais tant qu’on continuera à voir le Grand Nord en termes purement économiques et politiques, les cancers de l’ambition humaine gagneront la bataille. L’identité et l’âme québécoises sont en danger, aussi bien que les indigènes de ces forêts et toundras, aussi bien que les esprits de ces lieux sauvages. » (Cisneros, 1987, p. 27)
Cisneros, D. (1987). Les lieux sauvages. Urgences, (17-18), 19–27. https://doi.org/10.7202/025417ar
Desbiens, P. (2020). Poèmes. L’Oie de Cravan.
Desjardins, G. (2007). La mer aux histoires : voyage dans l'imaginaire maritime occidental : de l'Antiquité méditerranéenne jusqu'aux rives du Saint-Laurent. Éditions GID.
Paulet, J.-P. (2006). L'homme et la mer : représentations, symboles et mythes. Economica.
Perrault, P. (2022). Le mal du nord. Lux.
Les chats noirs ont une bien mauvaise réputation auprès des superstitieux.se.s. Associés aux sorcières, aux mauvais sorts, à la malchance et même aux présages de morts, ils feraient l’objet de notre méfiance depuis qu’Héra, la femme de Zeus, ai transformé sa servante en chat noir. Depuis ce mythe, et bien que nous les ayons domestiqués il y a quelque 10 000 ans, leur mauvaise notoriété leur colle injustement à la fourrure avec presque autant d’insistance qu’une puce, car soyons réalistes, ils ne sont ni augures ni amis de sorcière. Cela étant dit, si croiser un chat, peu importe sa couleur, ne nous attire pas le mauvais œil, leur présence est tout de même un mauvais auspice, non pas pour nous, mais pour la stabilité des écosystèmes.
Par Ludovic Dufour, chef de pupitre société
Les études sont de plus en plus nombreuses sur le sujet : les chats domestiques sont une espèce envahissante. Présents sur tous les continents, même les archipels les plus isolés ont leurs populations de chats domestiques errants.
Chat domestique, chat errant, chat sauvage ?
On entend ici par chat domestique la race des chats des domestiques Felis silvestris catus . Les chats errants appartiennent à la même espèce, mais survivent sans l’aide de l’humain. Ce sont donc des chats domestiques par leur espèce, mais errants par leur mode de vie. Le terme chat sauvage selon le contexte peut indiquer l’espèce Felis silvestris ou n’importe quels félins semblables à un chat vivant dans la nature.
On utilisera donc dans ce texte le terme chat domestique pour désigner l’ensemble de l’espèce, peu importe s’ils ont un propriétaire ou non, chat errant pour mentionner spécifiquement les chats domestiques sans propriétaire vivant plus ou moins indépendamment du genre humain et chat sauvage pour l’espèce Felis silvestris.
Leur cycle de reproduction rapide – une chatte peut avoir trois portées par année – rend le contrôle de leur population difficile. De plus, ils reçoivent parfois des soins et de la nourriture de notre part, ce qui favorise la survie de cette espèce plutôt que d’autres prédateurs. Outre les populations errantes, les chats gardés comme animaux de compagnie qu’on laisse régulièrement aller à l’extérieur bénéficient évidemment de bien des avantages, nourritures abondantes, abris, vaccins pour ne nommer que ceux-là. (Trouwborst, 2020) Résultat, leur nombre monte en flèche et dépasse largement celui des prédateurs de même taille. La population de chats domestiques mondiale pourrait dépasser le milliard, tandis que, selon les estimés les plus généreux, toutes les autres espèces de félins combinés ne représentent que 10 millions d’individus. (Hunter, 2015)
Alors comment les chats domestiques sont-ils problématiques ? Principalement par la prédation. Même les chats les mieux nourris gardent un instinct de chasseur, couplé à une densité de population élevée, leur nombre de prises monte rapidement. (Trouwborst, 2020) Leurs victimes sont variées et nombreuses. Aux États-Unis, en prenant en compte seulement les estimations les plus basses, le chat domestique tuerait annuellement 1,4 milliard d’oiseaux, 6,3 milliards de mammifères, 258 millions de reptiles, et 95 millions d’amphibiens. (Loss, 2013) Au-delà de la perte directe que cela représente pour les espèces chassées,
les autres prédateurs souffrent également de cette compétition, car leur nourriture devient de plus en plus rare. (Trouwborst, 2020)
Bien que les chats errants soient ceux qui chassent le plus, poussés par la nécessité, les chats ayant des propriétaires sont aussi de grands chasseurs. Certaines études évaluent qu’entre 50% et 80% des chats qui vont régulièrement à l’extérieur chassent. De plus, ils ne ramèneraient qu’entre 23% et 10% de leurs proies à leur domicile ce qui peut nous faire sous-estimer leur succès. (Trouwborst, 2020)
Mais l’effet des chats domestiques sur l’écosystème ne s’arrête pas qu’à la prédation. Le succès des migrations d’oiseaux peut être affecté par la simple présence de chats, particulièrement sur des îles isolées. Les oiseaux migrateurs doivent trouver des endroits propices pour se reposer et trouver à manger avant de continuer leur voyage, or la présence de prédateurs, dans ce cas si de chats, peut encourager ces migrateurs à raccourcir leurs arrêts. Même en ayant un effet de prédateurs limité, les chats revoient le succès de ces voyages à la baisse. (Medina, 2014)
L’hybridation contribue également au déclin de certaines espèces proches du chat domestique. Certains chats sauvages dont la population est très basse se reproduisent avec les chats domestiques, ce qui crée des hybrides au
lieu d’augmenter le nombre de représentants de l’espèce menacée. Finalement, les chats sont porteurs de maladies et de parasites qui, dans certains cas, peuvent se transmettre à d’autres prédateurs, au bétail ou aux humains. (Medina, 2014) Au total, le chat domestique a été impliqué dans la disparition de 63 espèces, deux de reptiles, 21 de mammifères et 40 d’oiseaux, c’est-à-dire 26% des extinctions contemporaines de ces groupes. (Trouwborst, 2020)
Vu les conséquences dramatiques que les populations de chats domestiques, autant errantes qu’apprivoisées, ont sur l’écosystème, les scientifiques appellent à l’action. Non seulement des mesures de préventions sont souhaitables, mais les lois internationales concernant la protection des espèces menacées requièrent clairement leurs implémentations par les gouvernements. (Trouwborst, 2020) Alors quelles politiques doit-on mettre en place ?
C’est ici la partie qui ne va pas plaire aux amoureux.euse.s des chats. Les chercheur.se.s indiquent que les demimesures sont insuffisantes ou qu’elles ne s’attaquent qu’à une partie du problème. Bien qu’une clochette attachée au cou d’un chat réduise l’efficacité de sa chasse, il ne l’élimine pas complètement. Les clôtures conçues pour garder les chats à l’extérieur de certains territoires peuvent être détruites. La stérilisation réduit la surpopulation, mais n’en-

lève pas la prédation. Une étude résumant les effets des chats domestiques sur l’écosystème et l’obligation des gouvernements d’y remédier selon les accords internationaux identifient les deux mesures les plus efficaces. Premièrement, l’élimination la plus complète possible des populations de chats errants. Deuxièmement, l’interdiction de l’accès à l’extérieur aux chats de compagnie. (Trouwborst, 2020)
Cependant, plusieurs détenteur.rice.s de chats s’opposent farouchement à cette idée. Dans une étude conduite dans une ruralité anglaise, 73% des propriétaires estimaient que les chats tuant des animaux sauvages ne sont pas un problème et 98% repoussent l’idée de garder leur chat sur leur terrain en tout temps (McDonald, 2015).
Encore pire, des études s’intéressant à l’impact des chats domestiques sur l’écosystème et aux méthodes pour le limité sont visées par des campagnes de discrédition. Des groupes défendant les chats errants répandent de la désinformation et cherchent à cacher l’étendue réelle du problème. Ainsi, ils cherchent à diminuer les mesures entourant le contrôle des chats de compagnie et errants. Malgré le consensus scientifique sur l’impact des chats domestiques, la présence de ces groupes à des conférences scientifiques et à des tables rondes politiques est parvenue à influencer les décisions les concernant. (Loss, 2018)
Si nous nous sentons souvent démuni.e.s face aux catastrophes environnementales présentes et à venir, ici nous sommes bien capables d’agir ; il suffit de garder nos animaux à l’intérieur. Certain.e.s sont cependant hésitant.e.s face à cette solution. Selon elleux, les chats sont faits pour vivre à l’extérieur, ils devraient aller et venir où bon leur semble et ils seraient bien malheureux d’être enfermés à l’intérieur.
Cependant, des recherches indiquent que ce n’est pas le cas. Au contraire, les chats d’intérieur sont généralement en bien meilleure forme que les chats d’extérieur. En les laissant aller dehors, on expose nos compagnons à de nombreux dangers. Maladies, prédateurs, combats avec d’autres chats ou accidents de la route menacent régulièrement la santé des chats lors de leurs promenades.
Si les chats d’extérieur ont une espérance de vie d’environ quatre ans et demie, leurs homologues de salon en ont un de 15 ans. (Zoran, 2011)
Cela étant dit, les chats d’intérieur ont des besoins particuliers, les propriétaires doivent s’assurer que leur environnement est adéquat et stimulant à la fois pour éviter les comportements désagréables et s’assurer du bien-être de l’animal. D’abord, les expert.e.s recommandent des espaces élevés confortables où les chats peuvent fuir les sources de stress et observer leur environnement en sûreté. Leur instinct à la fois de prédateur et de proie les encourage à trouver refuge en hauteur et y fixer leurs futures prises. Plus de chats implique également plus d’espace, il est donc important d’en avoir suffisamment pour ne pas créer de compétition inutile entre les animaux. (Herron, 2010)
Ensuite, la nourriture et la manière de l’acquérir sont une bonne source de stimulation. En reliant la nourriture aux jeux, les chats peuvent satisfaire leur instinct de chasseur. Certains jouets sont spécifiquement conçus pour distribuer de la nourriture quand ils sont manipulés. On peut aussi donner des gâteries simplement quand on joue avec lui. Il faut aussi s’assurer que l’animal puisse manger dans un coin tranquille où il ne sera pas perturbé par des bruits ou d’autres animaux. Comme ils sont habitués à manger de petites proies en chasseur solitaire, il vaut mieux séparer les bols de nourriture des différents chats. (Herron, 2010)
De plus, pour éviter les comportements indésirables, on peut donner des alternatives appropriées. Par exemple des objets pour que les chats y usent leurs griffes, certains aiment bien simplement griffer l’écorce. Pour préserver nos plantes souvent victimes de nos félins, on peut en asperger les feuilles de substance désagréable au goût. Au contraire, on placera d’autres plantes, préférablement de l’herbe à chat, près des aires de repos pour encourager leur consommation. (Herron, 2010)
Finalement, comme précédemment mentionné, les jouets sont d’excellents moyens de satisfaire les instincts prédateurs des chats de compagnie. Il faut cependant s’assurer d’y inclure des nouveautés pour garder son animal intrigué et motivé. Fournir un espace pour observer l’extérieur est un autre bon moyen d’éveiller sa curiosité,
surtout si on y attire des oiseaux avec des mangeoires. (Herron, 2010)
Si rien n’y fait et que notre compagnon ne peut se passer de l’extérieur, il existe toujours des solutions pour qu’il retrouve le grand air. On peut l’accompagner lors de ses sorties et le munir d’un harnais. De cette manière, on ne l’expose à aucun danger et il n’est plus une nuisance pour la faune. Sinon, une cage d’extérieur fait très bien l’affaire, on le garde ainsi éloigné des menaces et de ses proies. De plus, on peut l’aménager de manière à ce qu’il soit libre de ses allées et venues vers l’extérieur.
Pour résumer, les chats domestiques menacent l’équilibre des écosystèmes et contribuent au déclin d’espèces menacées, par la prédation, leur influence sur les migrations, l’hybridation et la transmission de maladies. Les scientifiques préconisent donc l’éradication des chats errants et le confinement à l’intérieur des chats de compagnie. Malgré les objections des propriétaires de chats, ce mode de vie ne semble pas que plus souhaitable pour l’environnement, mais aussi pour les chats euxmêmes et il existe des moyens pour garder nos animaux heureux dans un environnement fermé. Si cet article vous semble être écrit par une personne détestant les animaux, détrompez-vous, je les adore. C’est justement pour les protéger que j’écris ces lignes. Il suffit de garder nos chats dans nos maisons pour les protéger eux et les écosystèmes.
Herron M. E. Buffington C. A. T. (2010). Environmental enrichment for indoor cats, Compend Contin Educ Vet, vol 32(12). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC3922041/
Hunter, L. (2015). Wild Cats of the World , Bloomsbury Publishing. https://books.google.ca books?id=hzNBCgAAQBAJ&lr=&source=gbs_navlinks_s
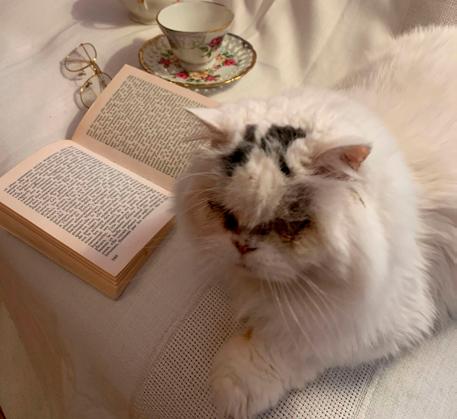
Loss, S.R. Will, T. Longcore, T et col. (2018). Responding to misinformation and criticisms regarding United States cat predation estimates. Perspectives and Paradigms. P. 3385-3396. https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/ s10530-018-1796-y.pdf?fbclid=IwAR2DS4Evy3PRwMDJ25jnFFuxL0PNLoLTfj7bjy82T-yxNCmOjZGk6MzUb8z
Loss, S. Will, T. Marra, P. (2013). The impact of free-ranging domestic cats on wildlife of the United States, Nat Commun, Vol 4. https://doi.org/10.1038/ncomms2380
McDonal, J.L. MacLeam, M. Evans, M.R. et col. (2015). Reconciling actual and perceived rates of predation by domestic cats, Ecology and Evolution, Vol 5 (14), P. 27452753. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ ece3.1553
Medina, F.M. Bonnaud, E. Vidal, E. et col. (2014). Underlying impacts of invasive cats on islands: not only a question of predation, Biodiversity and Conservation, Vol 23, P. 327–342. https://doi.org/10.1007/s10531-013-06034
Trouwborst, A. McComarck, P.C. Camacho, E.M. (2020). Domestic cats and their impacts on biodiversity: A blind spot in the application of nature conservation law, People and Nature , Vol 2(1), P. 235-250. https://besjournals. onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pan3.10073
Zoran, D. L. Buffington, C. A. T. (2011). Effects of nutrition choices and lifestyle changes on the well-being of cats, a carnivore that has moved indoors, Journal of the American Veterinary Medical Association , vol 239(5), P. 596-606. https://avmajournals.avma.org/view/journals/javma/239/5/ javma.239.5.596.xml
Avez-vous l'heure ?
C'est que les bus passent aux 12 minutes. Les cours commencent à 8h30. L'épicerie ferme à 22h. Ce texte prend 3 minutes à lire.
L'impression de ne jamais avoir assez de temps m'angoisse. J'ignore si c'est le sentiment d'impuissance ou la peur de manquer quelque chose qui me fait craindre d'être emportée par un raz-de-marée d'un bout à l'autre de la vie. Le temps passe. La vie s’achève vite.
Par Marilou Fortin-Guay, journaliste collaboratriceUn monde qui s'accélère
L'idée du temps qui passe vite n’est pas nouvelle. Depuis le 18ème siècle, on observe une dynamisation du monde, c'est-à-dire que les choses et les personnes bougent de plus en plus rapidement (Rosa, 2015). Le sociologue Peter Conrad constate que : « ce qui est en cause quand on parle de modernité, c'est l'accélération du temps » (Rosa, 2013, p.28).
Aujourd'hui, le trajet Montréal-Paris se fait en moins de 7 heures. Une campagne de sociofinancement amasse 50 000$ en quelques minutes. Transmettre un message à 3 millions d’abonnés prend 15 secondes.
Si nous nous sentons emporté.e.s malgré nous, c'est que ce rythme effréné paraît en grande partie inévitable. Le sociologue et philosophe Harmut Rosa écrit dans son livre Accélération, une critique sociale du temps que: « Les structures temporelles ont une nature collective et un caractère social; elles se dressent face à l’individu dans leur robuste facticité » (Rosa, 2013, p.11). Une conception partagée du temps est donc nécessaire à la coordination de la vie sociale.
Je comprends le besoin d'un ordre temporel précis et je ne suis pas contre les conventions. Toutefois, la société
actuelle impose un rythme difficile à suivre. Même si les avancées technologiques et l’automatisation permettent de sauver du temps, nous vivons paradoxalement une accélération du rythme de la vie. Nous manquons de temps à mesure que nous en gagnons. Tout doit toujours se faire plus vite. Finalement, c'est aussi l'augmentation du nombre d'actions qui s’accélère (Rosa, 2013, p. 380).
Les promesses d'une bonne gestion du temps Si les prouesses technologiques ne permettent pas de venir à bout de la rareté du temps, les gourous de la productivité, elleux, laissent croire qu'on peut gagner la course contre la montre en devenant de super gestionnaire de notre temps : planifier rigoureusement chaque minute, disséquer sa journée en blocs de productivité, faire du multitâche, mettre en place des systèmes complexes de gestion des priorités, etc. La quête de l'efficacité est alléchante dans un système capitaliste où le temps, c'est l'argent. Or, la culpabilité et la procrastination naissent trop souvent de cette impression d’être toujours en retard pour un monde qui va trop vite.
Restauration rapide, lecture rapide, voie rapide.
Pourquoi toutes ces manières d'aller plus vite ? L'image d’emprunter un escalier roulant à contresens


illustre bien nos efforts pour garder la tête hors de l'eau. Si on perd la cadence, on est laissé derrière. Autant nous aimons la productivité, autant la peur de l'exclusion nous pousse dans le dos. Alors, nous courons après l'argent, le travail, les obligations, les échéances.
La désynchronisation entre notre rythme individuel et la vitesse déterminée par certaines exigences sociétales crée ce sentiment constant de manquer de temps. Le temps qui passe trop vite, combiné à la perte de sens face à ce que nous devons accomplir, peut rendre misérable. C’est cette « agitation frénétique du quotidien et la perte d’intériorité» que Harmut Rosa critique (Journet, 2022). « La vie nous échappe », nous dit-il, « la société nous impose des rythmes toujours plus rapides. Et nous n’arrivons plus à suivre » (Rosa, 2013, p. 377).
Comment redonner au temps et à l'instant présent le pouvoir de nous combler ? Car c'est de cela qu’il est question, de se sentir plus comblé, moins vide, à la limite du burn-out.
« Pensez à un moment dans le dernier mois où vous vous êtes dit: voilà comment devrait être la vie. Quelque chose qui vous a touché, ému, fait pleurer » [traduction libre] (Rosa, 2015). Pour Rosa, la résonance est une solution à l'accélération sociale. Ce concept fait appel à notre manière d'être et d'interagir avec le monde. « Résonner » incite à profiter des possibilités inattendues du monde, pour y développer un sentiment d’appartenance et rebâtir une relation avec notre environnement, en dehors des exigences de productivité.
Je n'ai pas eu à élaborer de stratagème pour échapper au tourbillon de la vie, seulement à vivre une saison de maraîchage à semer, arroser, regarder pousser les légumes, les récolter. Dans une culture du numérique, qui m'a rendue excellente à être distraite, faire quelque chose
de mes mains, à échelle humaine, m’a permis de concentrer mon attention sur ce qui était devant moi. À ne plus savoir l'heure, j'en suis venue à ressentir le temps plutôt qu'à le mesurer. Cette insouciance temporelle rend plus disponible à ces moments de résonance. Suivre le rythme de la nature plutôt que le fil d'actualité rend l’agitation du monde plus tolérable. Entre nous, je préfère l'exigence du travail maraîcher à un horaire surchargé dépourvu de sens.
On ne peut pas se soustraire complètement au rythme de la société, même dans nos rêves les plus fous, sans s'exclure de la vie sociale. Combattre le train à grande vitesse de notre époque implique de réinventer quelque chose dans notre manière de vivre: résonner pour restaurer notre rapport avec le monde, observer la nature, créer des liens avec ce qui nous entoure. Et ce, malgré les technologies numériques qui fabriquent un espace temporel parallèle dans lequel nous sommes insatiables, distrait.e.s et agité.e.s. Ignorer l’heure est devenu un luxe, alors que nous sommes constamment à un geste de savoir s'il est 11h11. Nos grands-parents disent qu’une vie passe terriblement vite. À force de dire qu’on manque de temps, on finira par s'avouer qu'on ne l’a pas vu passer.
Rosa, H. (2013). Accélération : une critique sociale du temps. La Découverte


Journet, P. (31 juillet 2022). Apprendre à résonner. La Presse.https://www.lapresse.ca/actualites/ chroniques/2022-07-31/entrevue-avec-le-sociologuehartmut-rosa/apprendre-a-resonner.php
Rosa, H. (2015). Why are we stuck behind the social acceleration? YouTube. https://www.youtube.com/ watch?v=7uG9OFGId3A.
J’étais étendue dans mon lit, cherchant le sommeil. Une pensée martelait mon esprit : mon ami et son grand projet d’aller vivre en Angleterre. Mes pensées se sont emballées en réalisant que la date de son départ m’était inconnue. Je la sentais imminente, allais-je avoir le temps de revenir à Montréal pour lui dire au revoir ?
Par Marie Tremblay, journaliste collaboratriceJe me suis réveillée le lendemain sous le fait accompli : il était parti. En réalité, il volait dans l’avion au moment précis où je pensais à lui.

J’ai été submergée par un sentiment étrange, mais agréable. Malgré nos interactions grandement espacées dans les derniers temps, je nous imaginais connecté.e.s. Toute la journée, je me suis questionnée, car ce n’était la première fois qu’une coïncidence de la sorte survenait. Pourrait-il exister une force qui surpasse toute forme de communication? Une forme de connexion qui transcende l’univers physique et toute rationalité? C’est là que je suis tombée sur la théorie du principe de la synchronicité.
C’est le psychologue et psychiatre suisse Carl Gustave Jung qui a avancé ce principe après de nombreuses expériences de la sorte rapportées par ses patients. On parle de synchronicité lorsque deux événements (ou plus) se produisent de façon simultanée sans être expliqués par un lien causal, mais étant liés par une relation acausale. Plusieurs d’entre nous ont sans doute déjà vécu des exemples de synchronicité : avoir une chanson dans la tête et l’entendre à la radio quelques instants plus tard, remarquer un chiffre de manière répétitive, penser à une
personne quelques instants avant qu’elle nous contacte spontanément. Dans ses écrits, Jung aborde deux aspects qui caractérisent ce phénomène; l’individualité ainsi que l’aspect psychique.
Le lien acausal prend un sens grâce à la personne qui analyse les faits après qu’ils se soient produits. Ceci est défini par le « principe d’individuation » (C.G. JUNG, 1952). En effet, pour un autre individu, les événements en question pourraient n’avoir aucune signification particulière. Au début de ses recherches, Jung utilisait le terme « coïncidences significatives » (C.G. JUNG, 1952), tout simplement parce que ce qui se déroule dans la tête d’un individu ne se produit pas nécessairement dans la tête d’un autre. Le sens qu’une personne donne à une situation est basé sur son historique et son ressenti personnel. En effet, lorsque je me suis empressée de raconter à ma mère ce qui m'était arrivé, sa réaction a frôlé le désintéressement. Sa perception de la situation divergeait de la mienne.
Afin d’établir un lien entre les évènements, il est impossible de se référer à la méthode scientifique commune, puisqu’elle se base sur la causalité. Autrement dit, un phénomène s’explique nécessairement par un phénomène
antérieur et ainsi de suite. En science, c’est à la suite de multiples observations effectuées sur un échantillon significatif que l’on établit des « lois naturelles » (C.G. JUNG, 1952). Cependant, dans un phénomène comme la synchronicité, il n’y a pas de règles régissant les liens proposés entre les évènements. Jung propose de délaisser la conception scientifique traditionnelle du monde pour certains domaines plus généraux sans toutefois nier l’importance des liens causaux dans certains sujets comme la biologie. En acceptant que, malgré l’inexistence d’un lien causal, un phénomène puisse exister, il est nécessaire de supposer l’existence d’une tout autre sorte d’explications. Dans le cas du principe de la synchronicité, au moins un des événements doit se dérouler au niveau psychologique, soit dans le conscient ou l’inconscient. De cette façon, il est possible d’analyser la situation en se basant sur « les propriétés du monde empirique » (C.G. JUNG, 1952). Chacun.e peut fonder des explications, ayant son propre monde intérieur, basées non sur une théorie scientifique, mais sur des expériences, des observations et des circonstances. J’ai constaté que mon ami était dans l’avion (évènement physique) à l’instant même où je pensais à lui (événement psychologique) et j’ai perçu une relation entre les deux qui ne peut pas être expliquée rationnellement.

L’aspect psychologique du phénomène ajoute une toute autre dimension essentielle qui permet une analyse sans cadre logique.

Lorsqu’un phénomène de la sorte se présente, nous choisissons la manière de le percevoir. Nous pouvons décider de rester sceptiques ou de nous laisser imprégner par ce sentiment spécial et singulier. C’est notre réaction face à l’évènement qui est le plus important, qui donne du sens au phénomène. Il passe ainsi de simple coïncidence à un petit miracle singulier, et c’est notre interprétation de ce dernier qui en dit long, pas sur l’occurrence, mais sur nous. En fin de compte, je crois que répondre à la question « est-ce possible? est inutile, puisque la question qui demeure est: est-ce que j’y crois ? »
C.G. JUNG, 1952, Synchronicity: An Acausal Connecting Principle, 143 pages, Princeton University Press; Revised edition
Au bord d’un chalet perdu dans le bois du fin fond de la Beauce, vous et vos ami.e.s profitez du soleil couchant au bord d’un lac. Avec la nuit qui s’installe, les adeptes de films d’horreur commencent à comparer leur slasher favori avec votre situation actuelle ; des jeunes adultes éloigné.e.s de toute forme de civilisation alors que la nuit tombe, c’est effectivement une bonne introduction, quoique cliché. Puis suivent les histoires de fantômes, une sorte de concours de qui a la meilleure anecdote paranormale. Les témoignages s'enchaînent devant votre scepticisme. Il faut dire que les histoires de fantômes, ça n’a jamais été votre truc, vous êtes trop terre à terre, trop rationnel.le pour donner crédit à ça. Puis, une de vos amies, celle qui vous a prédit une mort précoce en lisant les lignes de votre paume de main et qui répète souvent que les gens qui sont scorpions sont désagréables, propose d’essayer un ouija.

Votre long soupir de découragement est enterré par les réactions excitées de vos ami.e.s. On éteint les lumières, on allume quelques bougies puis on installe le jeu sur la table du salon. Installé.e.s en cercle, vous écoutez les
instructions de votre amie. Toucher légèrement le pointeur du bout des doigts, ne pas enlever les doigts, parler clairement, une question à la fois, vous ne pouvez-vous empêcher de rouler les yeux quand elle vous met en garde contre les démons qui peuvent sortir si on ne suit pas les règles. Finalement, le jeu commence, « esprit, es-tu là? » demande la maîtresse de cérémonie officieuse. Les secondes passent, pas de réponse. « Y a-t-il un esprit, parmi nous? », toujours rien. « Esprit, souhaites-tu nous parler? » insiste-t-elle, mais cette fois, la planchette bouge, lentement, elle glisse vers le coin gauche indiquant « oui». La tension monte d’un cran, mais vous restez calme, vous vous dites que ce sont vos ami.e.s qui déplacent le pointeur, même sans le vouloir. Les questions commencent à s'enchaîner, « comment t’appelles-tu? », « esprit, quel âge as-tu? », les réponses sont de plus en plus rapides et la planche semble bouger avec plus d’aisance.
Alors que votre scepticisme semble vous quitter, vous décidez de prendre la parole pour tester ledit esprit. « Esprit, peux-tu m’aider à parler à ma grand-mère ? ».
Question piège, vos deux grand-mères sont bien vivantes. Le pointeur indique non. « Esprit, peux-tu m’aider à parler à mon grand-père? », cette fois, la présence indique oui. « Lequel? », moment de vérité, personne ne connaît le nom de votre grand-père à cette table hormis vous. La planche glisse et indique une à une les lettres formant le prénom de votre grand-père.

Des variantes de cette histoire, on en entend presque toustes, peut-être même que certain.e.s d’entre vous en sont le.la protagoniste. Plusieurs ont communiqué avec des membres de leur famille, d’autres ont essayé de prédire le futur, toustes sont convaincu.e.s d’avoir ouvert un portail vers l’au-delà. Malheureusement pour les voyant.e.s et chasseur.euse.s de fantôme en herbe, un regard scientifique sur le ouija nous apporte des réponses bien plus rationnelles que les rencontres avec les défunts, mais pas moins intéressantes pour autant.
C’est au 19e siècle que le spiritualisme commence à prendre racine aux États-Unis, alors qu’il était déjà bien présent en Europe. Les sœurs Fox, qui prétendaient pouvoir communiquer avec l’au-delà, ont captivé le public américain, donnant ainsi un essor au spiritualisme vers 1848. À une époque où les gens mourraient jeunes, où porter un enfant pouvait facilement mettre fin à une vie et où les hommes allaient en guerre, communiquer avec les esprits apportait du réconfort (Rodriguez McRobbie, 2013).
Avant toute chose, prouvons une fois pour toutes que ce sont les joueur.euse.s qui contrôlent le pointeur. Il suffit pour cela d’une expérience toute simple, comparons une séance normale à une séance où les participant.e.s ont les yeux bandés. On devrait avoir des résultats comparables si ce sont bien des forces surnaturelles qui déplacent le pointeur, or ce n’est pas le cas. Dans un épisode du National Geographic un groupe jouant au ouija les yeux découverts semble bien en contact avec l’autre monde, l’une des participantes parvient même à parler avec son grand-père, mais les choses se gâtent quand on leur couvre les yeux. Si le pointeur se déplace toujours, il n’indique rien de bien cohérent. Il vogue plutôt au hasard et s’arrête parfois dans des espaces vides. Pourtant, avant de connaître les résultats, les joueur.euse.s sont convaincu.e.s de n’avoir aucun contrôle sur la planchette. Certains expert.e.s du paranormal avancent différentes explications à ce phénomène, comme le besoin pour les participant.e.s d’être parfaitement conscient de leur environnement ou la vision des esprits reposant sur celle des joueur.euse.s. Les psychologues expliquent plutôt ce résultat par le phénomène idéomoteur
C’est en 1891 qu’apparaissent les premières publicités sur le ouija, où on le décrit comme un jeu magique qui répond aux questions sur le passé, le présent et le futur. On en parle également comme un jeu qui ne manquera jamais d’amuser les joueur.euse.s. Le ouija, qui était alors fait de bois, était annoncé au prix de 1,50$ (48,92 USD aujourd’hui) (Rodriguez McRobbie, 2013).
Le phénomène idéomoteur, ou réflexe idéomoteur, est une action ou un comportement inconscient qui est engendré par une pensée plutôt qu’un stimulus (Carpenter, 1852).
En gros, nous bougeons sans même nous en rendre compte, si nous croyons que nous allons bouger ou que quelque chose va bouger. Ainsi, si nous pensons que la planchette va se déplacer, inconsciemment nos doigts, nos bras, nos épaules font un mouvement.
En plus du ouija, cette théorie explique plusieurs autres expériences souvent attribuées au paranormal ou certaines pseudosciences. Par exemple, le docteur Hyman, appelé comme témoin dans le procès d’un chiropraticien, explique comment un outil utilisé par ce dernier repose sur le réflexe idéomoteur. On utilise l’appareil en frottant sa main sur une planche de plastique tout en bougeant une lentille sur le dos du patient. Si l’on rencontre de la friction sur la planche, c’est que la lentille passe sur une zone malade. Cependant, le docteur Hyman prouve que l'effet de friction est plutôt attribué à nos attentes et notre subconscient en utilisant des étudiant.e.s comme cobayes. Iels utilisent la machine de la même façon, cependant on leur explique que leur main collera à la planche quand ils passent sur une carte de couleur rouge. Non seulement les étudiant.e.s ressentent ce phénomène, mais l’une panique, convaincue que c’est l’œuvre du diable. Si l’on répète la même expérience, mais en précisant que leur main collera s’iels passent sur une carte noire, leur attente change et le résultat correspond à ce qui leur est expliqué. Il suffit donc d’anticiper un mouvement ou une sensation pour se convaincre que le phénomène s’est bien produit (Hyman, 2003).

En 1886, la presse témoigne d’une nouvelle pratique, les talking boards. L’outil permettrait de communiquer avec les esprits plus aisément et rapidement. Quatre ans plus tard, Charles Kennard aurait formé un groupe d’investisseurs afin de mettre en marché ce qui allait être le ouija. Cependant, ce n’est qu’en 1891 que le jeu a pu se retrouver sur les tablettes. En effet, Kennard souhaitait obtenir un brevet et pour cela, il fallait prouver à l’avocat que le jeu fonctionnait. Il aurait demandé à Kennard que la planche épelle son nom, qui n’était pas connu de Kennard ni de
son associé. Le ouija permet-il vraiment de parler à l’audelà ou ces hommes d’affaires ont-ils obtenu le nom avant l’entrevue? On ne le sait toujours pas, mais le ouija a bel et bien été mis en marché et l’est encore aujourd’hui (Rodriguez McRobbie, 2013 ).
Outre le phénomène idéomoteur sur lequel nous reviendrons plus tard, d’autres études montrent que les joueur.euse.s de ouija savent d’avance où le pointeur va se déplacer. Dans une étude où le regard des participant.e.s est suivi par ordinateur, iels regardaient parfois d’avance la lettre ou le chiffre que la planchette va indiquer. Plus on est loin dans la réponse, plus on est susceptible de « deviner » ce que sera la prochaine lettre. Par exemple, si l'on demande le nom de l’esprit, on a peu de chance de deviner les deux premières lettres, mais si l'on indique S et A on aura tendance à regarder tour à tour vers M,U,E et L. Les scientifiques en concluent donc que les résultats du ouija sont un résultat de notre tendance à vouloir donner du sens à des évènements aléatoires (Anderson, 2018). Cette même étude montre aussi que les participant.e.s sousestiment leur propre contribution au déplacement du pointeur. Les plus superstitieux.euse.s attribuent son déplacement aux forces surnaturelles, les autres ont tendance à accuser leurs homologues.
Au-delà des études portant spécifiquement sur le ouija, les chercheur.euse.s se sont également penché.e.s sur le lien entre la personnalité et la perception de causalité. Dans une expérience de 2018, les cobayes étaient d’abord invité.e.s à répondre à un test servant à savoir s’iels étaient pragmatiques ou superstitieux.euse.s. On posait des questions, par exemple sur l’efficacité des porte-bonheurs. Ensuite, on leur demandait de faire une expérience impliquant un bouton et une lumière. Les participant.e.s avaient le choix d'appuyer sur ce bouton, ou de s'abstenir d'y toucher, à 40 reprises. Le test était conçu pour que l'ampoule s'illumine 60% du temps, peu importe la décision des participant.e.s. Suite à l'exercice, iels étaient interrogé.e.s quant à leur impression de la cause à effet entre le geste d'appuyer sur le bouton et l'illumination de l'ampoule. La majorité considérait qu'enfoncer le bouton avait un lien avec la probabilité que la lumière s'allume,
même si en réalité ce lien était inexistant.. Enfin, les personnes ayant des tendances d’avantage superstitieuses y voyaient une correspondance plus forte (Griffiths, 2018). Cette observation peut expliquer pourquoi certain.e.s d’entre nous, s’iels ne connaissent pas l’explication scientifique, peuvent plus facilement identifier les esprits comme étant la source du déplacement de la planchette de ouija.
Malgré notre déconstruction du mythe paranormal entourant le ouija, ce jeu reste d’un grand intérêt, car même s’il ne permet pas de communiquer avec les revenants, il nous permet de communiquer avec l’inconscient. Dans une étude de 2012, des cobayes répondaient par oui ou par non à un test de connaissances générales en indiquant ensuite lesquelles de leurs réponses étaient choisies au hasard. Ces questions étaient ensuite posées dans un jeu semblable au ouija, où les joueur.euse.s avaient les yeux bandés pour leur cacher qu’iels étaient en vérité les seul.e.s à bouger l’indicateur. De cette manière, la planche, donc les cobayes avait un taux de bonne réponse de 65% pour des questions auquels iel n’avaient pas la moindre idée de la réponse, donc 15% plus élevé qu’en répondant consciemment au questionnaire. Les expert.e.s pensent donc qu’il est possible d’accéder à des connaissances inconscientes en utilisant le phénomène idéomoteur, et de répondre à des questions dont nous ignorions nous même avoir la réponse (Gauchou, 2012).
En 1966, le géant Parker Brothers achète les droits du jeu. L’année suivante, c’est plus de deux millions de copies qui ont été vendues, dépassant même les ventes du Monopoly. Aujourd’hui, le ouija est toujours présent dans la culture populaire américaine. Un film dont l’histoire est basée sur le jeu a même été réalisé en 2014, puis la suite en 2016. (Rodriguez McRobbie, 2013).

Si le ouija ne permet malheureusement pas de communiquer avec les morts, malgré ce que les témoignages et nos propres expériences nous disent, il peut nous en apprendre beaucoup sur notre propre esprit. Les mouvements inconscients, notre tendance à tirer des conclusions d'événements aléatoires et notre propension à trouver des
liens de cause à effet où il n’y en a pas expliquent ensemble comment nous nous convainquons habilement d’avoir percé le voile de l’au-delà, et ce, malgré notre plus grand pragmatisme. Cependant, ce jeu reste fascinant, car si les esprits restent silencieux, c’est avec une partie bien mystérieuse de notre esprit que nous entrons en contact avec eux.
1. Carpenter, W. (1852) On the influence of Suggestion in Modifying and directing Muscular Movement, independently of Volition. P. 147-153. https://www.sgipt. org/medppp/psymot/carp1852.htm
2. Gauchou, H. Rensink, R. Fels, S. (2012) Expression of nonconscious knowledge via ideomotor actions. Consciousness and Cognition, vol 21. P. 976-982. https://www2.psych.ubc.ca/~rensink/publications/ download/Ouija-GRF.pdf
3. Andersen, M. Nielbo, K.L. Schjoedt, U. et coll. (2019) Predictive minds in Ouija board sessions. Phenomenology and the Cognitive Sciences, vol 18, P. 577–588 https://link. springer.com/article/10.1007/s11097-018-9585-8#citeas
4. Griffiths, O. Murphy, R. Shehabi, N. et coll.. (2018) British Journal of Psychology. https://www.researchgate. net/publication/327223124_Superstition_predicts_ perception_of_illusory_control
5. Hyman, R. (2003) How People Are Fooled by Ideomotor Action. Quackwatch. https://quackwatch.org/ related/ideomotor/
6. Rodriguez McRobbie, L. (2013). The Strange and Mysterious Story of the Ouija Board. https://www. smithsonianmag.com/history/the-strange-and-mysterioushistory-of-the-ouija-board-5860627/
À l’image du thème de ce mois-ci, je m’adonnerai à un exercice essayistique singulier. Mes intentions initiales étaient nobles : apprendre à déconstruire la peur, à mettre en lumière ses facettes les plus subtiles pour en venir à bout une bonne fois pour toutes. Pour ce faire, j’avais pour objectif de me plonger dans un univers qui me terrifie, soit celui des jeux vidéo Silent Hill, dont les thématiques m’ont toujours fasciné sans toutefois que je puisse trouver en moi un quelconque courage pour m’y exposer. Si je n’y ai finalement jamais joué (ou presque : quelques minutes de Silent Hill 2 m’ont suffi pour éteindre ma PlayStation), j’ai néanmoins pu comprendre ce qui me fait si peur avec Silent Hill. Ce texte aura pour objectif d’analyser mon comportement paradoxal en tant que fan d’un univers dans lequel je n’ai jamais mis les pieds. J’en suis venu à la conclusion suivante : sans y jouer, j’ai tout de même su, à la fois par intérêt et fascination, m’immerger en diagonale dans ce monde dérangeant, c’est-à-dire que j’ai été en mesure de me construire une fiction en dehors de la fiction, un Silent Hill hors de Silent Hill. Comme quoi, parfois, l’évitement peut avoir du bon.
Par William Pépin, journaliste multimédiaUn cocktail de phobies Cet été, comme énième exercice d’introspection, j’ai décidé de mettre sur papier l’entièreté de mes phobies. En quelques minutes à peine, j’en avais noté plus d’une vingtaine. Cette activité m’a fait voir à quel point j’ai peur d’à peu près tout : des araignées, des hauteurs, des orages, des requins, des maladies, de la mort, des manèges, des profondeurs sous-marines, des clowns, des tueurs en série, des foules, du bruit, du fait de m’échapper un sabre laser allumé sur le pied, des avions, du nombre 13, de l’espace, de voyager dans le temps pis de rester pogner à l’école de la Peste noire, des seringues, des harpies, de l’idée que Voldemort choisisse des objets randoms pour ses horcruxes, de Mariepier Morin (surtout la manière d’écrire son prénom), des changements climatiques, des tornades au Québec en plein mois de mai, des arbalètes, des énigmes dans les jeux vidéo, du London Jack, d’oublier de faire un vœu à 11 h 11, de Darth Maul et de Charlie et la chocolaterie (version Tim Burton). Le constat est implacable : je suis peureux. Toutefois, il ne faut pas croire que cette longue énumération m’empêche d’être courageux par moments. Par exemple, même si j’ai peur des manèges, cela ne m’a pas privé, une fois, d’aller
à La Ronde pour y expérimenter Le Goliath, Le Vampire, Le Titan et cette terrible invention qu’est le Vol Ultime. J’en suis sorti encore plus terrifié que jamais, mais c’est l’intention qui compte (j’imagine). De plus, cette anecdote m’a permis de constater – sans tout à fait le comprendre – le mécanisme de fascination-répulsion derrière certaines peurs. Ce mécanisme, je le retrouve notamment dans la série vidéoludique Silent Hill
« Dans mes rêves agités, je vois cette ville… Silent Hill. Tu m’avais promis de m’y reconduire un jour… mais tu ne l’as jamais fait. Eh bien, je suis seule là-bas maintenant, dans notre endroit spécial... » – Marie, Silent Hill 2
Silent Hill est une licence de jeu d’horreur psychologique créé par Keiichiro Toyama, éditée par Konami et dont le premier opus (Silent Hill) est paru en 1999 sur PlayStation. Jusqu’à présent, la série compte huit jeux principaux et plusieurs dérivés. Depuis 2006, deux films (Silent Hill et Silent Hill : Revelation 3D) ont vu le jour. La série appartient au genre des survival horror (ou jeux de survie). Si celui-ci peut être caractérisé de bien des manières, on garde
souvent en tête le sentiment claustrophobe que l’on peut y éprouver et la constante impuissance qui peut nous habiter, notamment en ce qui concerne les cutscenes, qui ne peuvent être évitées, le parcours majoritairement linéaire, les munitions restreintes ou encore les documents inaltérables trouvés en cours de route (Kirkland, 2009). Le genre se construit donc par cette tension entre ce qu’impose le jeu, d’une part, et ce qu’en font les joueur.euse.s, d’autre part. Des chercheur.euse.s dans le domaine vidéoludique, Egenfeldt-Nielsen, Smith et Tosca ajoutent d’autres critères pour circonscrire ce qu’est le survival horror : « the player controls a character who has to get out of some enclosed place solving puzzles and destroying horrific monsters along the way / le.a joueur.euse contrôle un personnage qui doit s’échapper d’un lieu clos en résolvant des énigmes et en éliminant des créatures monstrueuses en chemin (traduction libre) ». Plus spécifiquement, iels mentionnent la séquentialité imposée par ce genre de jeu : « a scripted succession of events that the player has to perform in a specific order / une succession d’actions scriptés que le.a joueur.euse doit effectuer dans un ordre spécifique (traduction libre) » (Kirkland, 2009). Même si le genre a tendance de plus en plus à se décloisonner pour exploiter la mécanique des mondes ouverts, cette idée de la séquentialité contrainte est inhérente au survival horror, lui-même sous-genre du jeu d’aventure : « [a]dventure games characteristically refuse player progression until certain actions have been completed in a particular order/
les jeux d’aventure refusent aux joueur.euses de progresser jusqu’à ce que certaines actions soient complétées dans un ordre particulier (traduction libre). » (Kirkland, 2009). Dès lors, je vois dans ces explications un problème que l’on ne retrouve pas dans les jeux en monde ouvert : comment, en tant que joueur, pourrais-je faire de l’évitement, comment pourrais-je contourner mes peurs et les balayer sous le tapis, si celles-ci me sautent à la figure sans que je puisse y faire quoi que ce soit pour les en empêcher? Comment pourrais-je un jour me vanter d’avoir complété un Silent Hill si je n’arrive pas à affronter mes craintes? Si je veux pouvoir un jour vivre Silent Hill, je dois trouver une astuce. Pour ce faire, je dois poursuivre mes recherches.

C’est bien beau tout ça, mais c’est quoi, Silent Hill? Au-delà des considérations techniques et terminologiques, il convient de faire un léger détour pour comprendre, au fond, ce qu’est Silent Hill. Parce que oui, s’il s’agit bel et bien d’une série appartenant à la catégorie des survival horror, elle consiste toutefois en bien plus que cela. Sur le plan thématique, l’univers explore la peur viscérale, s’écartant de la violence graphique que l’on pourrait retrouver dans un Resident Evil, par exemple (rassurezvous : j’écris ces lignes sans être réducteur). Les thèmes abordés dans la plupart des jeux de la série traitent de la culpabilité, de la folie ou encore du sectarisme. Dans la majorité des cas, nous y incarnons un protagoniste prisonnier de la ville de Silent Hill dont l’objectif est de


comprendre les mystères qui l’entourent, mystères souvent liés à son passé et à un profond sentiment de culpabilité enfouie. Dans ces jeux, tout est fait pour faire naître en nous un malaise : l’ambiance (visuelle et sonore), la psychologie des personnages, les monstres (nous y reviendrons) et, surtout, les vices purement humains. Oui, il y a des jump scares, de la violence et du sang, mais ces procédés si fréquents dans le paysage vidéoludique pourraient, à mon sens, aisément disparaître sans que l’essence de Silent Hill en soit altérée.
Le film de Gans comme compromis : vivre Silent Hill sans la manette en main Plus jeune, j’ai d’abord rencontré cet univers par le cinéma avec Silent Hill (premier du nom), film réalisé par Christophe Gans (Crying Freeman, Le Pacte des loups, La Belle et la Bête). J’y vois une sorte de compromis : n’étant pas partie prenante d’un quelconque dispositif vidéoludique, je n’avais qu’à fermer les yeux si l’horreur devenait insoutenable. De plus, le film étant réalisé par un véritable passionné de la saga, je savais que la mythologie du jeu ne serait pas trop
altérée, que l’expérience serait somme toute similaire à celle des jeux, ou presque. Lorsque l’équipe d’Écran Large interroge Christophe Gans en 2006 quant à sa vision de Silent Hill, le réalisateur met aussitôt en lumière le caractère unique de chaque expérience de jeu : « je pars de l’hypothèse que chaque personne ayant joué à Silent Hill a fait un voyage avec sa façon de le vivre, ses peurs et son rythme à lui, et que, par conséquent, ce qu’il en a ramené est forcément la vérité […] Il n’y a pas une façon de jouer à Silent Hill, mais des millions qui sont autant de


joueurs. » (Ferry, 2006) Sa réponse est intéressante, notamment parce que j’y vois un paradoxe : si le jeu impose une certaine rigidité sur le plan de sa séquentialité et de ses mécanismes, celle-ci ne semble pas se traduire dans l’expérience reçue par les joueur.euse.s. Selon Gans, les expériences sont plurielles, malgré la linéarité que l’on retrouve généralement dans la série. Cette contrainte du scénario n’est donc pas gage d’expériences univoques. Au passage, il a affirmé au festival de Gérardmer 2020 qu’il travaille en ce moment sur une nouvelle adaptation du jeu : « Le projet sera toujours ancré dans cette ambiance de petite ville américaine, ravagée par le puritanisme. Je pense qu’il est temps d’en faire un nouveau » (Desroches, 2020).
D’ailleurs, Christophe Gans a le mérite de mettre les mots sur ce qui, je crois, me terrifie le plus avec cette saga vidéoludique, c’est-à-dire ses monstres : « De fait, si on conçoit que la dimension de Silent Hill est l’enfer, alors ces monstres sont des damnés au sens poétique du terme : ils sont un peu comme les fantômes japonais, c’est-à-dire

des résidus de sentiments oubliés aussi forts que la haine ou la culpabilité. Les monstres nous mettent mal à l’aise, car ils nous rappellent des souvenirs enfouis. » (Ferry, 2006) Cette idée d’irrésolution sournoise cristallisée par un amas de chairs monstrueux me trouble profondément. Pourtant, malgré mon malaise, je ne peux m’empêcher d’être attiré par la manette, sachant qu’un jour ou l’autre je n’aurai d’autres choix que de m’y mettre. Mais pourquoi donc ?
La peur : un jeu d’attraction-répulsion Aborder en diagonale les jeux Silent Hill m’amène à parler du sentiment d’attraction-répulsion que j’éprouve envers cette franchise. Dès lors, une question s’impose : pourquoi, si j’ai tant peur d’un jeu, m’efforcerais-je d’entrer en contact avec lui et sa diégèse? D’où vient donc cette attraction? Plusieurs pistes de réponses sont possibles, dont celle de Dominique Sipière, qui compare dans ses travaux le visionnement d’un film d’épouvante avec la pratique d’un sport extrême : « Être immergé presque physiquement dans un univers qu’on sait pourtant irréel et inoffensif
s’avère à la fois stimulant et valorisant, comme un sport dangereux pratiqué avec un filet ». (Sipière, 2010) Toutefois, cette analyse ne convient qu’en partie, car, dans le cas d’une œuvre vidéoludique, l’immersion est parfois si totale qu’on en oublie ce fameux filet. Guillaume Baychelier parle quant à lui d’une nécessaire « fréquentation de plaisirs négatifs, à savoir, de plaisirs ne pouvant s’exprimer que par la médiation d’un déplaisir » (Baychelier, 2014), dans l’idée que le plaisir doit d’abord passer par une émotion négative. Selon lui, les survival horror « ne [peuvent] être vécue que sur le mode de la survie, d’une expérience limite répondant à une économie stricte de carence […], plaçant bien souvent le joueur du côté de la proie vulnérable ». (Baychelier, 2014) Il avance que, dans ces jeux, le plaisir naît du manque, d’une contrainte forte et donc d’une négation (Baychelier, 2014). Ainsi, la sensation de plaisir suscité par la médiation d’un déplaisir représente, d’une certaine manière, ce filet que mentionne Sipière, cette confirmation que ce que nous avons sous les yeux est faux, artificiel. Encore une fois, ces explications ne sont satisfaisantes qu’en partie, puisque je ne serais pas en mesure de qualifier mon expérience de « plaisante », pas même en aval de celle-ci, une fois la télé éteinte et la


manette rangée. Non, ce qui m’amène à vouloir me plonger dans Silent Hill, ce n’est pas la quête d’un plaisir ou celle d’une expérience ludique où mes talents de joueur seraient mis à l’épreuve. En fait, il s’agit davantage d’une fascination qui ne s’estompe pas, d’un intérêt pour la mythologie du jeu qui ne faiblit pas avec le temps. Baychelier poursuit d’ailleurs son analyse en ce sens : « La relation des joueurs aux jeux horrifiques est soumise au régime de la peur mais elle est surtout conditionnée par une certaine attirance pour l’irregardable s’articulant à un dégoût ne pouvant être feint, révoltant véritablement notre sensibilité, directement incarné par ces monstres. » (Baychelier, 2014)
Nous y sommes presque. Le phénomène que présente Baychelier n’est pas nouveau, mais il a le mérite d’expliciter mon rapport à la peur, qui s’inscrit bel et bien dans ce régime d’attraction-répulsion tel que postulé ci-haut. Donc, à défaut d’avoir le courage de me lancer pour de bon, ma peur chronique m’amène à créer une fiction hors de la fiction pour satisfaire ma curiosité et le besoin de vivre une expérience horrifique, aussi édulcorée soit-elle.
Si j’ai présenté plus haut le film de Christophe Gans comme un compromis, comme un premier pas pour aborder Silent Hill, ce n’est toutefois pas la seule porte que j’ai empruntée pour entrer dans cet univers. En effet, sur le site communautaire Reddit, je suis abonné depuis longtemps à la page (ou subreddit ) r/silenthill , qui compte plus de 100 000 abonné.e.s. La page existe depuis 2010 et les internautes peuvent y partager leur passion de la saga en y publiant du contenu de diverses natures, comme des memes , des images d’archive, des nouvelles, des discussions ou encore des œuvres. En ce qui me concerne, c’est surtout les discussions qui m’intéressent, puisqu’elles me permettent de me construire une perception des jeux sans avoir à passer par la peur viscérale qu’imposent les jeux. Au passage, voici quelques questions d’internautes que l’on peut retrouver sur cette communauté :
« What do you find most intriguing or interesting about the
world of Silent Hill ? /Qu’est-ce que vous trouvez le plus intriguant ou le plus intéressant à propos de l’univers de Silent Hill? (traduction libre) » – TharKoffeeBurns, membre de la communauté r/silenthill
« You get the option to go to Silent Hill in person… do you take it ? /Vous avez la possibilité de vous rendre à Silent Hill en personne… vous l’acceptez ? (traduction libre) » – mewlax84, membre de la communauté r/silenthill

« Am I the only one who thinks that OG Silent Hill (1999) is the best game in the series ? /Suis-je le seul à penser que le premier Silent Hill (1999) est le meilleur jeu de la série? (traduction libre) » – Neon_Pigeon, membre de la communauté r/silenthill
Ainsi, au fil de mes lectures et des nombreux walkthrought que j’ai eu l’occasion de visionner – seulement en partie, les passages plus terrifiants m’empêchant de poursuivre —, j’ai pu me concevoir une vision personnelle de Silent
Hill qui, paradoxalement, n’a pas été influencée par une expérience de jeu personnelle. Parfois, lorsque je tente un énième visionnement de walkthrought animé par un streamer dont l’humour aide à détendre l’atmosphère, je constate ironiquement que « mon » Silent Hill n’a finalement rien à voir avec « le » Silent Hill, que l’idée que je m’en suis fait n’est qu’une altération, voire un spin-off. D’un certain point de vue, j’ai donc construit mon propre univers à partir d’un univers existant, et ce, à l’aide d’une communauté de fans.
Puis-je me considérer comme un fan même si je n’ai jamais joué à un seul Silent Hill ? Cette réflexion m’amène à m’interroger sur le comportement des internautes en rapport à une œuvre ou une franchise. En ce qui me concerne et pour définir mon rapport à Silent Hill, Julien Falgas emploierait sûrement le terme de lurker: « Le lurking consiste à lire les messages échangés sur une liste de discussion, un réseau social numérique ou un forum en ligne sans en publier soi-même. » (Falgas, 2016). C’est d’autant plus vrai qu’en plus de ne rien publier et de ne participer à aucune discussion, je ne joue même pas au jeu en question. Est-ce que ce comportement fait de moi quelqu’un de passif pour autant ? En ce sens, Falgas cite les travaux de Le Guern : « de nombreux auteurs ont

élaboré une vision beaucoup plus valorisante des fans, s’inscrivant dans une tradition de recherche qui brosse le portrait d’un public actif, coproducteur du sens des œuvres, engagé dans une véritable dynamique d’appropriation, et participant à des sociabilités et des interactions qui débordent le simple moment de la réception » (Falgas, 2016). Si j’hésite encore à m’approprier totalement le terme de « fan », il est vrai que j’ai su investir l’œuvre, que j’ai réussi à y insérer un sens, même en diagonale.
Un jour ou l’autre, il va bien falloir s’y mettre Ce texte avait deux visées : la première consistait à comprendre un peu mieux la peur dans un contexte vidéoludique et la seconde à considérer le rapport à une œuvre ou une franchise sous un jour nouveau, c’est-à-dire en se penchant sur la question de l’investissement des fans envers une œuvre qui mène à une réappropriation, à une co-construction et, dans mon cas, à un remodelage quasi total d’un univers que j’ai si souvent évité. Un sentiment d’incomplétude demeure : je sais qu’un jour ou l’autre, il va bien falloir que je m’y mette, que je cesse de repousser l’inévitable. Un jour, je devrai, manette en mains, entrer dans Silent Hill , ne serait-ce que pour comparer l’œuvre au monde que j’ai construit autour d’elle.
Baychelier, G. (2014). Jeux vidéo horrifiques et artialisation des émotions extrêmes. Dans Nouvelle revue d’esthétique (vol. 2, no 14, p. 81-92). Presses Universitaires de France.
Desroches, T. (2020). Gérardmer 2020 : un nouveau Silent Hill, le fantastique, les séries… Christophe Gans nous dit tout. https://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18687475.html (Page consultée le 11 octobre 2022).

Falgas, J. (2016). Et si tous les fans ne laissaient pas de trace. Le cas d’un feuilleton de bande dessinée numérique inspiré par les séries télévisées. Dans Études de communication (no 47, p. 151-166). Université Lille-3.
Ferry, I. (2006). Master Class Silent Hill. https://www.ecranlarge.com/films/interview/900969-master-class-silent-hill(Page consultée le 11 octobre 2022).
Kirkland, E. (2009). Storytelling in Survival Horror Video Games. Dans Bernard Perron (dir.), Horror Video Game : Essays on the Fusion of Fear and Play (p. 62-78). MacFarland & Compagny, Inc., Publishers.
Sipière, D. (2010). L’instant monstrueux au cinéma : réversibilité, trajectoires et usages de la peur. Dans Revue française d’études américaines (vol. 3 no 125, p. 111-123). Belin éditeur.

Du hockey au tennis, de la NFL à la MLB, une gang d'animateur.ice.s capoté.e.s passent en revue le meilleur (mais aussi le pire) de l'actualité sportive. À tous les jours de la semaine, ou presque, de 15h à 16h. PLAYBALL !

Chaque vendredi, entre 9h et 10h, ne manquez pas l'émission Palmarès CHYZ. Notre directeur musical Guillaume Pepin vous dévoile les tops 10 francos et anglos avec une pièce de chaque album pendant l'émission. Bonne écoute !
Y’en Aura Pas De Facile
Habitué par l'analyse d'actualité, Félix rêvait d'animer une émission de divertissement. Virginie, scientifique, travaille dans des laboratoires, mais elle a toujours admiré les humoristes.
Y'en aura pas de facile est né de cette idée de changer de bord, de parler de ses deuxièmes choix. Des chroniqueur.se.s de tous horizons nous parlent des sujets qui les ont toujours secrètement passionné.e.s. Le tout accompagné d'une pointe de critique sur l'actualité qui nous rappelle que chaque début de semaine a son lot de difficultés.
Tous les lundis de 9h à 10h.



Une émission de radio de type culturelle à plusieurs segments, incluant discussions, analyses, invité.e.s, interviews et défis de la semaine.
Une émission d’artistes pour les artistes dans laquelle on soutient les émergences locales et on explore différents points de vue par rapport à l’Art et sa création. Différents médiums de racontage d'histoires seront discutés pendant la saison. Nos invité.e.s seront varié.e.s et seront des gens passionnés par un ou plusieurs “craft” moyens de communications/transmissions.
En compagnie de Louis-David Gingras et Cédric Ndzouli, une saison qui s’annonce riche en apprentissages et découvertes!
Rock ta case, c’est une émission actuelle qui raconte l’histoire oubliée du rock. On vient « rocker » ta perception de ce style musical, en mélangeant nos artistes québécois.e.s et les piliers du passé qui ont construit le son qu’on connaît aujourd’hui, une note à la fois. Si toi aussi tu as horreur de l’expression « chick rock », sors de ta case et ouvre tes oreilles au rock qu’on veut offrir aux futures générations. « Listen out of the box » et branche-toi à CHYZ tous les mardis, de 13h à 14h.











Pömm Magazine est la toute nouvelle émission culturelle de Gala Dionne, étudiante en journalisme au baccalauréat en communication publique. L’émission, complémentaire au futur magazine papier de Pömm, abordera des nouveautés culturelles, plus particulièrement celles de la ville de Québec. Attendez-vous à beaucoup de musique émergente, à des entrevues, à des chroniques hebdomadaires ainsi qu’à des réflexions sur les principaux enjeux culturels de notre société. Tous les mercredis, de 14h à 15h !

Sur le divan _ François Ruel - Côté _ Les éditions de Ta Mère
Quatrième de couverture : Samuel et Philippe sont deux chums de gars qui passent leurs journées à fixer le vide du fond de leur divan tout en ressentant le poids de l’individu dans l’univers. Ces véritables Sisyphe du quotidien luttent contre la monotonie à coups de joints, de bières et de réflexions aussi existentielles que ridicules. Au travers de ce dialogue se dessine l’une des plus belles et tragiques bromances du XXIe siècle.

Corps vivante _ Julie Delporte _ Éditions Pow Pow
Quatrième de couverture : En 1990, Julie Delporte n’a encore jamais vu de butch, mais sa tante préférée chasse et fume le cigare. Presque vingt ans plus tard, elle publie un livre sur Tove Jansson dans lequel elle raconte avec joie que cette artiste finlandaise est la première femme à qui elle s’identifie, seulement elle était lesbienne et pas Julie. À 35 ans, après avoir surligné de toutes les couleurs son exemplaire de La pensée straight de Monique Wittig, Julie Delporte arrête de porter des robes et prend son avenir en main.

La fabrique du noir _ Virginie Chaloux _ Gendron _ Éditions Le Noroît

Quatrième de couverture : J’ai écrit ce livre sur le chemin du retour entre ma fin et demain. En suivant mon ombre, j’ai retrouvé ma voix, lavée à grande eau. Elle semblait m’attendre. Je l’ai regardée. J’ai eu peur de m’y mettre les pieds. Le temps s’est suspendu. Le tableau est devenu solide. Je m’y suis accrochée. Puis j’ai compris. Parler. Voilà le voyage auquel je me suis conviée. - VCG

L’or des mélèzes - Carole Labarre - Mémoire d’encrier
Quatrième de couverture : Pishimuss, une aînée, revient sur sa vie au sein de sa communauté. Elle raconte les amitiés, les amours, la chasse au caribou, le fleuve et la forêt. L’or des mélèzes est une série de tableaux, de moments de vie, d’instantanés. Sophie, la meilleure amie. Mathias, le fils qui meurt sans jamais mourir. Adeline, l’adolescente révoltée. Et puis, il y a Xavier, l’amour de sa vie. Xavier, dont l’histoire est portée sur le dos d’une rivière. Roman familial à l’écriture épurée, L’or des mélèzes capte des scènes des vies à la fois lumineuses et poignantes, sans pathos ni ressentiment.
Longtemps, les personnages homosexuels au cinéma ont été représentés par des archétypes comme le gay psychopathe, l’androgyne séducteur et la femme vampire. Et si cette dernière tend à se décaricaturer avec le temps, la part de monstruosité peine à être complètement évacuée. Survol de quatre cas de figure.
Par Emmy Lapointe, rédactrice en chefCeux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l’Éternel.
Bible, Proverbes, XI, 20
Les personnages homosexuels au cinéma n’ont pas toujours porté les visages de Jake Gyllenhaal (Brokeback Mountain) ou d’Adèle Haenel ( Portrait de la jeune fille en feu ); ils ont d’abord et avant tout été les monstres de leurs récits. Dans l’Histoire de la sexualité I, Michel Foucault – attention aux féru.e.s du philosophe cranio-infini, vous trouverez ma vulgarisation de sa pensée dangereusement simpliste – plaide que la mise en discours du sexe a eu pour effet, entre autres, de normaliser le développement sexuel et donc, de définir a contrario tout un spectre de déviances possibles. Ces « irrégularités sexuelles », c’est-à-dire tout ce qui dévie de la poursuite de l’orgasme par pénétration vaginale entre partenaires de sexes opposés, ont été annexées aux ouvrages sur la maladie mentale. Et pendant des années, pour freiner ces « fantaisies sexuelles », cette perversion, on offrait tantôt des cures médicales, tantôt des condamnations judiciaires, mais surtout, on les dépeignait avec un vocabulaire excessivement connoté : le pervers était un monstre.
« L’homosexualité est apparue comme une des figures de la sexualité lorsqu’elle a été rabattue de la pratique de la sodomie sur une sorte d’androgynie intérieure, un hermaphrodisme de l’âme. Le sodomite était un relaps, l’homosexuel est maintenant une espèce. » (Foucault, 1990 : 57)

Le trope de la vampire lesbienne Né dans le poème « Christabel » de Samuel Taylor Coleridge et cristallisé dans une novella de Sheridan Le Fanu, le trope (motif répété dans plusieurs œuvres) de la vampire lesbienne a, comme plusieurs figures féminines au cinéma, d’abord été sous l’emprise du male gaze – regard masculin au cinéma – avant de finalement voir des cinéastes féministes se le réapproprier.
Si l’on rajoute la question de l’homosexualité ou de la bisexualité à la figure de la vampire déjà largement sexualisée, il est impossible de penser les films dans lesquels elles apparaissent autrement que comme participant à la fois au genre de l’horreur qu’à celui du pornographique. En fait, le plus souvent, les scènes articulées autour des vampires lesbiennes allient sexualité et violence – ce qui rappelle une pratique courante dans le film de slasher d’ailleurs – et les rendent quasiment indissociables l’une de l’autre. Cette association tend à renforcer l’idée que le lesbianisme et la bisexualité s’ancrent dans la décadence et qu’ils se « répandent ».
Puis, peu à peu, sous le regard de réalisatrices, la vampire a développé – sans être complètement désexualisée – une agentivité narrative qui dépasse la question de la sexualité et qui, par la force des choses, a permis à la vampire de ne plus être que le monstre à éliminer et de plutôt devenir celle qui les élimine.
Rebecca – Hitchcock
Récemment mariée à un riche veuf, Maxim de Winter (Laurence Olivier), la nouvelle madame de Winter (Joan Fontaine) emménage avec son époux dans sa demeure de Manderley. Elle se voit alors attribuer madame Danvers (Judith Anderson), l’ancienne gouvernante de la première épouse, Rebecca, dont le souvenir hante encore le château. Froide et distante, madame Danvers n’accepte pas la présence de celle qu’elle considère comme une intrue; rien ne remplacera Rebecca de qui, visiblement, elle était passionnée.



Allures rigides, froideur apparente, coiffure serrée, souvenir constant d’une figure disparue : madame Danvers représente l’archétype lesbien par excellence dans le film noir (Dyer, 1977). Dans une scène particulière, on voit madame de Winter (la seconde épouse) être tourmentée par des rappels incessants de l’absence de la première épouse et se risquer à explorer l’aile interdite du château, aile jadis occupée par Rebecca et monsieur de Winter. Et alors qu’elle se retrouve dans la chambre de la défunte, Danvers se matérialise derrière elle. Cette dernière caresse du bout des joues la manche d’un manteau de fourrure, lui parle des cheveux de Rebecca, lui montre un déshabillé au travers duquel elle passe sa main disant « Avez-vous déjà vu quelque chose d’aussi délicat ? Regardez, vous pouvez voir ma main à travers. » Cette scène, portée par une musique lancinante, agit comme un pivot dans la narration; à partir de ce moment, madame Danvers est montrée comme une prédatrice souhaitant faire de madame de Winter sa prochaine victime. Or, en vertu du Code de production (normes cinématographiques morales à l’époque), si un personnage moralement digressif apparaît à l’écran, celui-ci doit être puni. Danvers brulera donc sous les flammes qu’elle aura elle-même allumées.
Ainsi, le film noir met en scène négativement l’homosexualité, mais il n’en demeure pas moins qu’il le fait apparaître. Un monstre, mais un monstre visible.

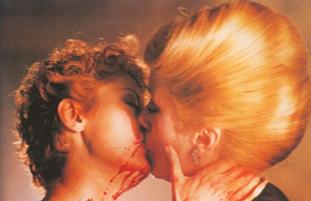

Dans le New York des années 80, Miriam (Catherine Deneuve), une vampire de 4000 ans originaire d’Égypte, et son partenaire depuis trois siècles, John, se nourrissent d’amant.e.s pour le moins malchanceux.se.s qui croisent leur chemin. Mais un matin, John se sent vieillir d’un coup. Pris de peur, il tente de consulter la spécialiste Sarah Roberts qui ne fera finalement rien pour lui. À la fin de la journée, John est un vieillard qui, dans un dernier espoir de renverser le cours des choses, assassine Alice, la voisine du couple. Il n’en est rien : John meurt, Miriam le pleure, puis, le remise au grenier avant de jeter son dévolu sur Sarah Roberts qu’elle attire chez elle pour en faire sa nouvelle partenaire. Miriam, tout comme son compagnon d’ailleurs, tue pour survivre, sauf qu’à l’inverse de la figure classique de la vampire lesbienne, le sang qu’elle boit est celui des hommes. Néanmoins, si ces meurtres semblent lui apporter un certain plaisir ne serait-ce que parce qu’ils lui permettent de survivre, le meurtre en dehors de son alimentation semble la peiner, du moins c’est ce que l’on semble déceler lorsque sur le bord de la mort, son compagnon assassine Alice, leur jeune voisine, et que Miriam retrouve son corps en hurlant. Une fois John redevenu poussière, Miriam tentera d’attirer chez elle Sarah Roberts, qu’elle séduira finalement avant de la transformer elle aussi en vampire lors d’une relation sexuelle pour en faire sa nouvelle partenaire. La transformation se substituera au meurtre, ce qui, bien qu’extrêmement possessif, demeure moins violent, conférant ainsi à Miriam un statut de monstre-humain, une figure de l’entre-deux, figure de l’entre-deux renforcée par sa bisexualité. Mais, comme dominée par une nature inaltérable, Miriam finira par tuer Sarah lors d’un rapport sexuel. Ce dernier geste sera à la fois celui qui restituera son statut de monstre que celui qui la punira, parce qu’il la condamnera à la solitude.
Bien que diamétralement opposées, Needy (Amanda Seyfried) et Jennifer (Megan Fox) sont, depuis l’enfance, des meilleures amies. Après un concert dans un petit bar de leur région, un incendie éclate, et Jennifer quitte les lieux avec les musiciens dont on devine ostensiblement les intentions. Pendant la nuit, Jennifer, couverte de sang, retrouve Needy chez elle, et celle-ci s’inquiète du comportement anormal de son amie. Quelques jours après les événements, une série de meurtres débutent : plusieurs adolescents seront assassinés, et Needy comprendra que la responsable de ces meurtres, c’est Jennifer qui a été victime d’un rituel satanique qui a échoué et qui l’a transformée en vampire tueuse d’hommes.
Film résolument second degré, Jennifer’s Body met en scène des personnages adolescents dangereusement archétypaux et embrasse les codes des films des années 80 et de série B, mais surtout, le long métrage de Karyn Kusama joue avec le male gaze et le trope de la vampire lesbienne. Jennifer, un peu comme Miriam dans The Hunger, oscille entre « l’héroïne » et le « monstre », les homicides de Jennifer étant toutefois beaucoup plus vindicatifs. La nature de la relation entre Needy et Jennifer semble elle aussi plutôt ambigüe en ce qu’elle revêtit tantôt les allures
de l’amitié, voire de la sororité, tantôt celles d’une relation intime aux traits toxiques. Pourtant, c’est la solidarité qui semble vouloir triompher lorsqu’après le meurtre de son amoureux par Jennifer, Needy décide tout de même de partir à la recherche du boy’s band à l’origine de toute cette violence et de venger son amie d’enfance
girl walks alone at night - Ana Lily Amirpour


À Bad City, une ville aux allures de ruines, la violence du trafic de drogue et de la prostitution bat son plein. Mais la nuit, une jeune vampire sur sa planche à roulettes débarrasse la ville de ses hommes violents.
Dans le western-noir-vampirique d’Ana Lily Amirpour, bien que la vampire n’ait pas ouvertement de sexualité, celle-ci cultive une intimité qui semble s’inscrire dans une logique hétéronormative, dans la diégèse du moins. Néanmoins, si j’ai choisi de quand même glisser quelques mots sur cette œuvre malgré l’absence de relation intime avec d’autres femmes, c’est qu’elle semble achever la métamorphose du trope de la vampire lesbienne en ce qu’elle décentre la sexualité/l’intimité de la vampire pour en faire un élément secondaire de la trame narrative. Pourtant, son rapport aux femmes, lui, demeure central, c’est seulement qu’il est maintenant basé sur leur défense plutôt que sur leur mise en danger; la vampire d’Amipour protège ses sœurs.

Abdi, S., & Calafell, B. M. (2017). Queer utopias and a (Feminist) Iranian vampire : A critical analysis of resistive monstrosity in A Girl Walks Home Alone at Night. Critical Studies in Media Communication, 34(4), 358-370.


Dyer, R. (1977). Homosexuality and Film Noir. Jump Cut, 16, 18-21.
Foucault, M. (1990). L’histoire de la sexualité I : La volonté de savoir. Gallimard.
11:11
J’attends les doigts croisés. Empilés les uns sur les autres parce que j’ai lu qu'hypothétiquement ça aide. Je n’ai jamais compris le principe des molécules ni les calculs plus avancés que Pythagore, mais j’ai trouvé refuge dans la complexité des alignements cosmiques. L’association entre Mercure, Jupiter, la Lune, le Soleil et mes émotions fut si simple que j’en ai oublié ma raison, ma compréhension des connaissances tangibles.

Faire fondre des bougies au même rythme que mon cœur expliquait ce que mes mots n’en étaient pas capables. Comme si la comparaison entre deux flammes pouvait parler pour toi et pour moi. L’image fuyante, chaude et coulante de la cire rendait le moment plus éphémère que les nôtres.
Je ne suis pas à la recherche de codes, ils me trouvent. Par magie, je suis devenue bonne avec
les chiffres, avec le codage numérique. Je paie des bougies et je regarde l’étiquette que pour y voir 999. Tout juste pour me rappeler de me concentrer sur mes émotions, sur mes sentiments. Mais comment je me sens ?
La réponse se trouve peut-être dans une constitution angélique de chiffres, à elle de me le dire. Superstition l’une après l’autre, je lègue ma vie à la numérologie. 555, l’amour en abondance, le signe que notre amour croissant aboutisse enfin. Mon algorithme joue avec mes croyances tirage après tirage, cette personne est la bonne. Mais laquelle ? Voir 222 ne m’aidera plus.


Je dois arrêter de chercher des réponses dans les cartes bien décorées ou dans les étiquettes de prix. Rien n’arrive pour rien, mais rien n’arrive par magie. Ce n’est pas de la magie, c’est de la manifestation, de la cosmologie.
J’ai cessé de regarder les heures, car elles miroitaient tout le plus beau sans jamais me l’apporter. Sauf qu’en ce moment il est 11h11 et tu m’as écrit pour la première fois en 3 mois. Coïncidence ou alignement des étoiles ? Mercure en rétrograde ou retour à la case départ ? Comment expliquer l’inexplicable, les anges avaient peut-être raison au final.
Mon 11 h 11 à moi : donner vie à ce qui est déjà parti
2022
Le cadran affiche 4 h 14.
À 4 h 33, le monde va s’écrouler pour la 365e fois.
Cela fait un an que les nuits s’accélèrent jusqu’au moment fatidique. Quand tout s’arrête, à l’heure où d’autres dorment, je me perds.
Comme si tout continuait, sans moi ; que ma présence s’isolait dans une craque de souvenirs étanches au moment présent.
Comme si pour un instant, je n’appartenais plus à ce qui subsistait, que ma survivance se décidait, finalement, À me laisser te rejoindre.
Je ferme les yeux en espérant ne pas revivre ce moment, mais l’univers se décide une fois de plus à me rappeler le passé.
2021
4 h 17 : l’alarme portative que nous avons achetée pour toi sonne dans le salon. J'ouvre la porte de ma chambre pour me retrouver dans le couloir. Papa est déjà dans l’escalier. Ta chambre à toi se trouve en bas.
Ce sera plus simple pour les infirmières et le coroner, avait dit le technicien qui avait apporté ton lit d’hôpital.
4 h 21 : On te tient la main, papa d’un côté du lit, moi de l’autre. Personne n’a voulu allumer la lampe de chevet. On observe le silence et l’obscurité.
4 h 25 : Papa ose enfin me parler. Il me dit qu’il m’aime. Je ne pense pas que tu nous entends, tu es endormie ou presque, la douleur s’étant finalement calmée.
4 h 27 : Il faut que j’aille aux toilettes, pour pleurer ou me noyer dans la cuvette. C'est une image qui me vient parmi tant d’autres. Je me lève sans me retourner.
4 h 29 : Quand je reviens dans ta chambre, je sais ce qu’il va arriver. Le lampadaire devant chez nous ne fonctionne plus, j’ai un goût de fin de tout dans la bouche et la maison se tait. Les craquements habituels ont laissé place à un silence endeuillé.
Je ne me souviens plus de 4 h 30, 4 h 31, 4 h 32,
Je ne me souviens plus de ces derniers moments avec toi. J'aimerais leur inventer une force testimoniale qui me supporterai à travers les anniversaires-solitaires ; pouvoir revisiter tes traits, ta main, ton cœur dans ces quelques secondes avant
L’évènement.
Je ne me souviens plus de rien, seulement de la maladie, du corps, de l’après et de ce besoin pressant d’ouvrir la fenêtre, de fuir comme de rester.
Je ne me souviens plus de ces trois minutes-là, je ne me souviens plus et pourtant chaque nuit depuis, je me raconte le tout sans pouvoir démêler la réalité du cauchemar.
Dans ces trois minutes, j’imagine que ta respiration s’est accélérée
Peut-être qu’elle a ralenti.
Dans ces trois minutes, tu devais être belle
Ou déjà décomposée de ta vie.
Dans ces trois minutes, tu devais me serrer fort la main
Ou ne plus avoir la force de rien.
Je ne sais pas, mais je vis toutes ces possibilités comme autant de vérités.
2022
Ça fait un an que l’obscurité te rappelle à moi, un an que je cherche des signes de toi.
Un an que je cherche sans rien trouver. 4 h 37 : La 365e nuit est plus douloureuse que les autres. Je descends ouvrir ta fenêtre, comme à mon habitude. De là, j’aperçois la rue engorgée de silence. Il y a, sur le bord du trottoir, une chose scintillante que je n’avais jamais remarqué avant, de jour ou de nuit. À la lumière du lampadaire, elle m’appelle à venir la chercher. Je me décide à sortir, mes pieds nus sur le sol gelé. Dehors, l'objet m’attend. Un médaillon que tu n’aurais jamais porté. Il n’est ni très beau, ni très intéressant à regarder. En le prenant dans ma main, je vois un fermoir sur le côté. Je l’ouvre.
Pour maman L’inscription est gravée à l’intérieur, suivie d’un cœur. C’est tout. Ça me suffit. Je décide à cet instant de te laisser vivre à travers les hasards. Je décide de traduire ce médaillon comme le signe que tu es toujours là avec moi.
Cette nuit, je choisis de croire. Je retourne dans la maison, le médaillon à la main. Et je m'endors jusqu’au matin.


ta slim ton cartoon la chaise berçante celle dans l'entrée celle qui t'accueille comme si t'étais la réincarnation de Bowie tu transpires la vedette le jetset on te le dit (trop) souvent dans un autre tantôt t'étais hot t'étais big à Vegas à Hollywood

Saviez-vous que l’Université Laval possède son propre programme de compensation volontaire des gaz à effet de serre (GES)? Compenser, c’est neutraliser l’incidence de nos transports sur les changements climatiques. En participant au programme, vous aidez l’environnement et vous contribuez au financement de projets innovants en action climatique dans notre communauté universitaire.
