

NOUS SOMMES
Rédactrice en chef

Emmy Lapointe (elle) redaction@impactcampus.ca
Cheffe de pupitre actualités

Jade Talbot (elle) actualites@impactcampus.ca
Cheffe de pupitre aux arts
Frédérik Dompierre-Beaulieu (elle) arts@impactcampus.ca

Chef de pupitre société

Ludovic Dufour (il) societe@impactcampus.ca
Journaliste multimédia
William Pépin (il) multimedia1@impactcampus.ca
Journaliste multimédia
Sabrina Boulanger (elle) photos@impactcampus.ca
Directeur général

Gabriel Tremblay dg@comeul.ca
Représentant publicitaire



Simon Rodrigue publicite@chyz.ca
Journalistes collaborateur.rice.s
Sarah-Kate Dallaire et Myriam Coté
Conseil d’administration
François Pouliot, Émilie Rioux, Élise Thiboutot, Daniel Fradette, Ludovic Dufour, Charles-Émile Fecteau, Antoine Chrétien et David Tardif
Réviseures linguistiques
Andrée-Anne Desmeules et Érika Hagen-Veilleux
Impression
Publications Lysar inc. Tirage : 2000 exemplaires Dépôt légal : BAnQ et BAC
Impact Campus ne se tient pas responsable de la page CADEUL et de la page ÆLIÉS dont le contenu relève entièrement de la CADEUL et de l’ÆLIÉS. La publicité contenue dans Impact Campus est régie par le code d’éthique publicitaire du journal, qui est disponible pour consultation au : impactcampus. qc.ca/code-dethique-publicitaire
Impact Campus est publié par une corporation sans but lucratif constituée sous la dénomination sociale Corporation des Médias Étudiants de l’Université Laval.
1244, pavillon Maurice-Pollack, Université Laval, Québec (Québec) G1V 0A6
Téléphone : 418 656-5079
ISSN : 0820-5116
Découvrez nos réseaux sociaux !

Directrice de production
Paula Casillas (elle) production@impactcampus.ca
Autour du Rose enfer des
BILLETS : lepointdevente.com
BILLETS : lepointdevente.com

ACTUALITÉS
Le campus : retour sur cet été
Après une session marquée par le retour en classe, la levée de la quasi-totalité des restrictions sanitaires a permis à l’Université Laval de vivre un été sous le signe du retour à la normale. Ainsi, plusieurs événements ont pu accueillir étudiant.e.s et visiteur.se.s sur le campus, dont les célébrations du 100e anniversaire de la Faculté de musique ou encore le 89e Congrès de l’Acfas. Voici donc un bref résumé des nouvelles que vous auriez pu manquer.
Entre congrès et recherche
Du 9 au 13 mai se tenait sur le campus le 89e Congrès de l’Acfas (Association francophone pour le savoir) qui fait rayonner la recherche en français. Abordant des thèmes variés comme les changements climatiques, en passant par les sciences laitières et la santé mentale, « c’est près de 800 membres du corps professoral, chargées et chargés de cours ainsi qu’étudiantes et étudiants aux cycles supérieurs de l'Université Laval [qui ont présenté] les résultats de leurs recherches récentes » (Équipe des Affaires publiques, Université Laval, 2021).
Avec un financement du ministère de l’Éducation de 1,25 million de dollars sur cinq ans, un nouveau laboratoire de recherche, le Laboratoire pour la progression des femmes dans les sports au Québec (PROFEMS), a été créé. Ce laboratoire « permettra de documenter en temps réel la situation de l’équité des genres dans les sports au Québec » (Équipe des Affaires publiques, Université Laval, 2021).

Une nouvelle chaire de recherche a également été annoncée au cours de l’été. Celle qui se nomme Chaire de recherche sur les nouveaux enjeux de la mondialisation économique « aura pour mission de mener des recherches juridiques et pluridisciplinaires qui permettront de mieux comprendre les causes et les répercussions des différentes formes de libre-échange et d’intégration des marchés pratiquées dans le monde » (Équipe des Affaires publiques, Université Laval, 2021).

L’université en chiffres Après avoir occupé la 70e position en 2021, l’Université Laval obtient le 36e rang au classement du Times Higher Education qui évalue l’impact global des universités dans le monde. Au Canada, elle se classe au 8e rang. Les critères « reposent sur
la contribution scientifique des équipes de recherche, sur la formation, de même que sur l’ensemble du fonctionnement de l’Université et sur l’impact des personnes diplômées » (Équipe des Affaires publiques, Université Laval, 2021).
Pour l’année 2021-2022, ce sont 13 350 étudiant.e.s qui se sont vu remettre un diplôme. Les cérémonies de collation des grades se sont d’ailleurs déroulées du 20 au 23 juin au Centre des congrès de Québec avec un retour à la normale, sans mesures sanitaires. Sur l’ensemble des diplômes, « 72,7 % sont décernés pour des programmes de 1er cycle et 61,1% sont remis à des femmes. Une proportion de 10,3% des diplômes est attribuée à des étudiantes et étudiants de l’international ou à des résidentes et résidents permanents » (Équipe des Affaires publiques, Université Laval, 2021).
Les dernières années ont vu une augmentation de la population étudiante à l’Université Laval, pour finalement atteindre un sommet pour l’année 2021-2022 avec 56 272 personnes inscrites (une hausse de 11,6% en cinq ans). Cette croissance s’observe également dans les inscriptions des étudiant.e.s internationaux. le.s pour cette session avec une augmentation de 20% comparativement à l’automne 2021. Cette année marque également l’atteinte d’un record des fonds consacrés à la recherche avec 515 millions de dollars.
Finalement, plusieurs chantiers et défis sont à prévoirs dans les mois à venir avec « la construction du Centre de tennis, du Carrefour international Brian Mulroney et des résidences étudiantes, en plus de l’implantation du tramway, de l’ensemble du réseau de transport structurant et du plan En action avec les Premiers Peuples » (Équipe des Affaires publiques, Université Laval, 2021).
Rouge et Or : Récapitulatif d’un début de saison à la hauteur de l’excellence

La fin des vacances d’été, en plus d’un retour sur le campus, annonce le début d’une nouvelle saison pour les étudiant.e.s-athlètes du Rouge et Or. Cette saison, plusieurs équipes tenteront de conserver leurs titres de champion.ne.s RSEQ et canadien.ne.s, alors que d’autres essaieront de se classer en haut du podium pour la première fois depuis des années. Voici un bref aperçu des performances de chaque équipe en ce début de saison. NDLR : Les événements couverts ont été tenus avant le 19 septembre, date où ce magazine est entré en impression.


Par Jade Talbot, cheffe de pupitre actualités
Cross-country

Cette année, les membres de nos deux équipes auront à défendre leur titre de champion.ne.s nationaux.ale.s. L’équipe masculine tentera également d’obtenir une 11e bannière consécutive du RSEQ. Le 17 septembre dernier, lors du premier événement de la saison qui se déroulait à Montréal, l’équipe féminine s’est classée première avec 35 points, loin devant la deuxième place occupée par Western (106 points). Jessy Lacourse s’est positionnée première avec un temps de 28:25.5 minutes, alors que Beauchemin, Comeau, Bérubé et Paquet se sont classées respectivement au 3e, 4e, 9e et 13e rang. Chez les hommes, Thomas Fafard a terminé deuxième (temps de 24:28.6 minutes). En ajoutant les performances de Desgagnés (3e), Tedeschi (11e), Morneau-Cartier (21e) et Lepage (25e), l’équipe a réussi à se classer au premier rang (62 points). Le 8 octobre prochain, à 8 heures, sur les plaines d’Abraham, aura lieu le seul événement de la saison se déroulant à domicile.
Football Après deux défaites consécutives contre les Carabins de Montréal en finale de la Coupe Dunsmore, les hommes de Glen Constantin ont pour objectif la conquête de la coupe, mais également celle du titre de champions canadiens. Après trois rencontres, le Rouge et Or présente une fiche de deux victoires et une défaite, les Carabins ayant pris les devants avec un botté de placement à quelques secondes de la fin de la partie. La performance du receveur Kevin Mital lors de l’affrontement contre McGill est à souligner avec un record de quatre touchés par la passe en un match. Le duo Desjardins-Mital sera certainement à surveiller, notamment lors du prochain match à domicile qui se déroulera le 16 octobre à 13h contre les Carabins. Il s’agira pour l’équipe d’une occasion de reprendre la première place au classement du RSEQ. D’ailleurs, cette saison, l’organisation du Rouge et Or a décidé de miser sur des rendez-vous thématiques pour ses matchs à domicile, où le premier reprenait la tradition du match en blanc de l’Université Penn State. Les partisan.ne.s ont également pu assister à des matchs sous les thématiques rétro et de la famille. Ils sont d’ailleurs invités à porter des bandes noires sous les yeux, des eye black, qui seront données par l’organisation, et à éviter de se vêtir en bleu lors de la rencontre qui aurait lieu sous le thème de la rivalité le 16 octobre prochain.

Golf
Après une année de pandémie où les tournois se jouaient en une ronde, la saison 2022 annonce le retour à la normale avec trois rondes par tournoi. Le premier de la saison a eu lieu au club de golf Milby à Sherbrooke, où les deux équipes du Rouge et Or se sont classées au premier rang (total de 876 pour les hommes et de 717 pour les femmes). Cette saison, les hommes tenteront d’obtenir une 20e bannière consécutive du RSEQ. Au niveau individuel, ils se sont démarqués en positionnant cinq joueurs dans le top 10, où David Tweddell occupe la première place avec un cumulatif de –7. Chez les femmes, Sarah-Maude Martel s’est classée au deuxième rang avec un cumulatif de +9, alors que les autres membres de l’équipe se sont classés aux 5e, 8e et 13e rangs.


Rugby
Avec une séquence de dix-huit victoires consécutives avant le début de la saison, l’équipe de rugby féminine du Rouge et Or poursuit sa lancée. Après trois rencontres en saison régulière, les invaincues affichent 253 points pour et aucun point contre. C’est dans un match que l’on pourrait qualifier de parfait que l’équipe, présentement troisième au classement canadien, a marqué 117 points contre le Vert et Or de Sherbrooke. Championnes du RSEQ en 2021, elles visent cette année à décrocher le titre national après avoir obtenu une médaille de bronze en 2021. Le prochain match à domicile aura lieu le 8 octobre à 13h contre les Gee-Gees d’Ottawa qui sont présentement deuxième au classement du RSEQ.


Soccer extérieur

L’équipe de soccer féminin est présentement en première position du classement avec une fiche de cinq victoires en cinq matchs, avec 14 buts pour et 3 buts contre. Cette année, elles tenteront de conserver leur titre de championne du RSEQ et d’obtenir celui de championnes nationales, elles qui ont remporté la médaille de bronze l’an passé. Les hommes, quant à eux, possèdent une fiche d’une victoire et de trois nulles. Défaite en finale du RSEQ l’an passé, l’équipe vise un premier championnat RSEQ depuis 2013. Les prochains matchs à domicile se dérouleront le 14 octobre au PEPS, à 18h pour les femmes et à 20h15 pour les hommes.




ÉDITORIAL
Emmy Lapointe, rédactrice en chefÇa y est, on recommence déjà. À peine nous remettons-nous de notre dernier festival, de notre dernier coup de chaleur que nous sommes déjà tiré.e.s sur le campus. On fait comme si on voulait que l’été s’étire, que l’école ne recommence pas, mais la vérité, c’est qu’on attend la rentrée comme on attend le printemps. On s’étonne de trouver les matins froids de septembre plus réconfortants que les soirées chaudes d’été. Puis, on retrouve le campus, le plus habité qu’on ait connu depuis longtemps. On retrouve ses ami.e.s ou on se retrouve seul.e.s et on marche sur le campus avec cette sensation qui est celle des premières fois.
Pourtant, plusieurs d’entre vous vivront, cette année, leur dernière rentrée. Vous aurez occupé le campus pendant trois, cinq, dix ans, et sans vous en rendre compte peut-être, au lendemain d’une prochaine fête du Travail, vous ne retrouverez plus les salles de classe. Vous aurez laissé votre place à quelqu’un d’autre. Qu’est-ce que vous aurez gardé de votre passage ici ? Qu’est-ce que vous aurez laissé ? Aurez-vous seulement pris ce que vous souhaitiez ou, malgré vous, l’université aura laissé certaines traces non désirées sur vous ? Et si vous conservez de votre passage à l’université une façon d’être et de faire, une façon d’appréhender les dates butoirs, conserverez-vous aussi votre capacité à mémoriser, votre vitesse de rédaction ?
Pourquoi héritons-nous de certaines choses plus que d’autres ? Pouvons-nous transmettre sans en être conscient.e.s ? Que faisons-nous de ce qu’on nous lègue, mais dont on ne veut pas ?
Le sombre
Des souris mâles ont été soumises, plusieurs fois par jour pendant trois jours, à des charges électriques après avoir senti une odeur se rapprochant de la fleur de cerisier. La suite est ici prévisible : à la seule manifestation de l’odeur, même s’il n’y avait plus de décharges qui suivaient, les souris mâles étaient terrifiées.
Ces souris se sont reproduites par fécondation in vitro – les souriceaux n’ont donc jamais été en contact avec leur père – et, pourtant, les petits craignaient tout autant l’odeur de la fleur de cerisier. Quand les petits ont

eu à leur tour des souriceaux, ces derniers étaient eux aussi terrifiés par l’odeur de fleur de cerisier. Évidemment, l’épigénétique et la génétique tout court m’échappent, mais ce qu’il faut en retenir, c’est que les peurs, les traumas peuvent modifier l’expression génétique et donc être transmis.
Après, je ne sais pas ce qu’on fait du sombre dont on hérite et encore moins ce qu’on fait du sombre qu’on ne veut pas transmettre malgré nous, mais il me semble que de savoir ça, que de savoir que la violence se transmet, c’est déjà savoir qu’il nous faut être empathiques avec celleux qui portent des douleurs qui nous semblent lointaines.
Le clair
Les love langages – concept hyper contestable lorsqu’on connaît ses origines théoriques, mais pour cette fois, je ferai comme si – diffèrent d’une génération à l’autre. J’ai l’impression que les gens de la génération de mes grands-parents ont l’amour prude même s’ils ont l’amour fort. Ils aiment par l’inquiétude de l’éloignement, par le Crisco déversé dans toutes les recettes, par les 20 $ dans les cartes Jean Coutu.
Ma grand-mère, en tout cas, elle aime comme ça (et par les pyjamas en flanelle), et il y a quelque chose d’extrêmement émouvant dans l’amour des gestes, parce que contrairement à ce qu’on pense, les gestes ne restent pas tant que ça, parce qu’on ne les voit pas toujours, et si on ne les voit pas, s’ils passent et disparaissent, comment on fait pour les garder en mémoire, pour suivre leur trace. Et ma grand-mère vieillit et ça me terrifie, parce que si elle part sans que j’aie appris ses gestes d’amour, je ne pourrai pas m’en souvenir autant qu’il le faudrait.
Il y a quelques années, j’ai demandé à ma grand-mère ses recettes. J’ai donc reçu un cartable de recettes sur lequel il était écrit « Les recettes de ma grand-mère Lapointe ». Je sais que ça ne suffira pas à tout garder en tête et en corps, mais il restera quelque chose et ça suffit à calmer mon angoisse de la perte.

Héritage : ce qui nous appartient, ce qui ne nous appartient pasMagella et Olivette
Le toi en moi

Nous sommes enfant, adelphe, parent, nous sommes cousin.e, marraine, partenaire. Nous sommes lié.e.s à celleux qu’on appelle notre famille à la façon d’une courtepointe qui unit bon nombre d’éléments décousus. Le milieu familial est l’un des environnements auxquels nous sommes longuement exposé.e.s au cours de notre jeunesse, l’un de ceux qui nous forgent en tant que petits humains – c’est donc dire que nous en absorbons beaucoup : valeurs, traumatismes, savoirs, rêves, secrets. Je vous invite ici à visiter une collection de récits d’héritages familiaux, un échantillon de ces histoires qui nous constituent.

Paris-brest aux oubliettes
Longue histoire courte, j’ai une famille de beurre et de farine. Mon grand-père paternel était boulanger-pâtissier et a appris le métier à mon père, dont le frère est pour sa part devenu chef. Mon grand-père maternel était chocolatier-pâtissier, et l’aîné a aussi suivi la voie. Ah oui, et tous ces gens sont belges. Comme beaucoup d’autres, ma famille a été bousculée par les guerres, arrachée et rapiécée. Pépère, qu’on l’appelait – le boulanger-pâtissier – était un Allemand dont le remaniement des frontières, après la Première Guerre mondiale, a redéfini la citoyenneté. Les traités ont tracé la ligne à quelques pieds de chez lui : désormais, vous et votre maisonnée êtes belges. Certains membres de sa famille sont donc devenus belges, d’autres sont restés allemands. En ces temps de destruction et de misère, plusieurs ont immigré. Pépère et Mémère se sont beaucoup promenés, suivant travail, santé et opportunités. Le temps a fini par les poser pour de bon sous le soleil de la Californie. Parmi toutes les recettes qui ont cueilli des saveurs belges, anglaises, allemandes, québécoises et californiennes, le pain à la cannelle, la tarte au sucre belge et le fraisier étaient celles au plus grand succès, tout le monde en raffolait. Mais Pépère, en homme secret qu’il était, a fermé les yeux pour la dernière fois avant de léguer un livre de recettes. Une seule lui a survécu, et son fraisier est, aujourd’hui encore, servi au restaurant familial.
Le côté maternel de ma famille n’a pas connu plus de chance. Bon papa, qu’on l’appelait, descendant de Prussiens commerçants, faisait les meilleures truffes au chocolat de la planète. Ses deux aînés ont appris à les confectionner avant que Dieu ne rappelle à lui Bon papa. Les temps rudes ont étiolé la famille dans différents recoins de l’Europe et de l’Amérique, à une époque où on ne faisait pas des Facetime pour s’envoyer des recettes. Les truffes sont à leur tour tombées aux oubliettes.
Je pensais que j’aurais pu apprendre de mon père son fameux paris-brest, celui qu’on mangeait toujours en famille pour les grandes occasions. Après tout, il a eu le temps de montrer à mon frère comment faire son cramique et sa tarte au riz. Mais la mort surprend toujours, peut-être parce qu’on ne veut pas la voir arriver. Alors aujourd’hui, je n’ai qu’un gribouillage de la recette.
- Pâte à choux
- Lait, sucre, oeufs, farine et Nutella pour la crème pâtissière
- Crème fouettée
Oui mais Papa, comment la fais-tu, ta pâte à choux ?

J’aurais pu être Guy Lafleur
Maman était une femme discrète et silencieuse, mais très fière, aussi. On vivait pauvrement, mais ça ne l’empêchait pas de vouloir être coquette et de bien nous coiffer avant de nous laisser partir pour l’école. Et Maman ne me l’a jamais dit, mais je la savais fière de moi quand je marquais un but, quand je me faisais des ami.e.s, quand je recevais le premier diplôme universitaire de la famille. Au plus, elle affichait un sourire en guise d’approbation. Parfois, un câlin.
Maman d’amour silencieux, Maman de fierté muette, Maman de peurs poignantes. Elle craignait les orages et elle venait nous réveiller la nuit pour qu’on soit toustes ensemble dans le salon, en attendant que ça passe. Maman avait peur des orages, et de tellement d’autres choses : prendre la voiture, sortir le soir, donner son opinion. Maman qui a
enseigné la modestie et la patience a finalement vu grandir un enfant ambitieux et fougueux. Un enfant contraire à elle, un enfant rebelle à l’image du père qu’il s’imaginait. Papa est mort quand j’étais enfant, et j’ai construit son portrait à partir des fragments contés par Maman, des photos dans les vieux albums et des histoires de mes grandsparents. Tu ressembles tellement à ton père. J’aimais entendre ça, j’avais envie de devenir comme cet absent de ma vie, celui qui m’aurait encouragé à m’inscrire au hockey, celui qui aurait joué avec la puck avec moi jusqu’à ce que je devienne redoutable. J’aurais pu être Guy Lafleur, si j’avais eu Papa.
Quand tu n’as qu’une photo comme père, tu as le loisir de l’imaginer au gré de tes préférences, de piger les qualités des différents modèles autour de toi pour confectionner un papa parfait. Le hic, par contre, c’est que tu le sais, au fond, qu’il est fictif, ce personnage. Et son absence n’en est pas moins douloureuse.

Rendez-vous dominicaux

Il y a une dizaine d’années, j’ai hérité de la crèche de bûchettes faite par mon grandpère, après une longue dormance dans un coin du sous-sol de ma tante. La crèche pouvait bien ramasser la poussière : elle est lourde, trop encombrante pour être posée sous le sapin et puis… elle est vide. Une crèche, ça ne peut pas être inhabité! Ça symbolise la vie, la famille, la chaleur du foyer. J’ai longtemps cherché des personnages qui l’occuperaient pour recréer la scène chrétienne habituelle, mais son format inusité complique la tâche.
Quand je sors la crèche pour Noël, je la déballe avec son odeur de vieux bois. Mon grand-père était un monsieur taquin et attachant, il charmait les enfants en leur donnant friandises, jouets et surprises de toutes sortes qu’il fabriquait lui-même. La cave de la
maison était sa caverne d’Ali Baba, entièrement tapissée de bran de scie – jamais ma grand-mère n’aurait osé y descendre son aspirateur, il aurait rendu l’âme en moins de deux.

Plus que l’étable du petit Jésus, j’y vois la maison de mes grands-parents. Une maison modeste dont les portes grandes ouvertes accueillaient joyeusement la famille et les passager.ère.s chaque dimanche. Les fourneaux de ma grand-mère s’activaient pour préparer le souper dominical, sous le regard bienveillant de mon grand-père qui s’assurait que chacun.e ait quelque chose sous la dent avant de se servir lui-même.
J’ai finalement déniché des figurines qui devraient être à la taille de ma crèche, cette semaine. J’ai abandonné l’idée des classiques religieux – après tout, chez nous, il y avait bien des gens, mais jamais de Rois mages. Poste Canada devrait donc livrer à ma porte un mix and match de bonshommes funky et désagencés, des personnages comme j’en trouvais chez mes grands-parents aux soupers dominicaux.
La terreur aux entrailles
Chez moi en Amérique latine, on vit avec des fantômes. Il y a le gnome, et il y a tous les autres. Ils existent dans les récits populaires, dans les histoires des parents pour qu’on ne rentre pas trop tard le soir. Petite, ça me faisait tellement peur! Ne vire pas fou avec ça, te dis-tu peut-être. Mais ils existent, je te le jure. Comment je sais? Eh bien parce que tout le monde connaît quelqu’un qui connaît quelqu’un qui en a vu un. Ou qui a interagi avec. Ne vire pas fou, c’est aussi ce que je me disais : voyons, je ne vais quand même pas vivre angoissée sans certitude aucune. Petite moi a donc questionné une source fiable : Abuelita. Et Abuelita a confirmé toutes mes pires craintes – elle aussi, elle a des histoires avec des fantômes.
Un jour, un homme de son village est mort. C’était un campagnard anonyme, personne ne le connaissait bien. Mais tout le monde savait qui il était. Et à qui incombe le devoir de prendre soin de ce mort, dans ces circonstances? Abuelita a pris à charge le dossier – on mérite toustes de mourir dignement, disait-elle. Et c’est ainsi qu’elle a embaumé le corps et accompagné l’homme sur le chemin de la mort. Après les rites, grand-mère est rentrée chez elle, la nuit était déjà tombée. Chez nous, c’est la campagne – il n’y a pas un lampadaire à tous les 50 mètres, la nuit aveugle complètement. Abuelita faisait donc la route guidée par son cheval, la bête connaissant le chemin mieux qu’elle dans la nuit noire. Abuelita a laissé le cheval à la grange et est entrée se coucher dans la maison. C’est alors que toutes les portes et tous les volets de la maison se sont mis à claquer, à s’ouvrir et à se refermer. Abuelita dit que c’était le fantôme du corps qu’elle venait d’enterrer, il venait la remercier.

Quoi! Le fantôme venait la remercier en lui foutant les jetons? Comment savoir s’il n’était pas fâché, s’il n’aurait pas préféré un enterrement avec tout le village? Il va la hanter à tout jamais? Et c’est Abuelita ou la maison, qu’il hante?
Moi, depuis ce jour où Abuelita m’a raconté cette histoire, je prie très fort pour que jamais un fantôme ne se manifeste à moi. Je lirais mal ses intentions, je le provoquerais par accident. J’aurais peur peu importe le scénario, en fait. Et même si je n’en ai jamais vu, je traîne depuis que je suis toute petite la terreur des fantômes dans mes entrailles.

Croix de bois, croix de fer
Une fois par an, le curé faisait la visite des paroissiens.ne.s. Et quand il venait à la maison, c’était un moment stressant je vous dis, il fallait se tenir droit et les fesses serrées! On était repassé.e.s-léché.e.s-lissé.e.s de la tête au pied, et hors de question d’oser penser à faire les fous! Môman nous surveillait du coin de l'œil de toute façon, elle aurait vu clair dans notre jeu.
Puis toutes les semaines, il y avait la messe. Le dimanche, comme tout le monde, on s’y rendait et on écoutait ce que notre curé avait à nous raconter. Elle devait lui être particulière, la bible, pour lui inspirer tant de discours et de morales. Adolescente et familière avec la ritournelle, j’avais pris l’habitude de m’asseoir sur le banc du fond,

histoire de m’éclipser discrètement de la messe le temps d’une balade. Je revenais à temps pour clâmer le amen final en chœur avec Mme Tremblay et Mme Saint-Onge pour qu’elles confirment ma présence à Môman, pour qui c’était important.
Et tous les jours, Môman venait me mettre au lit et faisait la dizaine avant le dodo. On s’agenouillait au pied du lit, puis on récitait dix prières sur le chapelet. Chaque fois, ça m’alourdissait les yeux, et j’étais juste à la bonne hauteur pour m’assoupir avec la tête déposée sur le matelas. Ma mère cueillait alors mon petit corps mou de sommeil et l’enroulait dans les couvertes.
Qu’est-ce qu’il en reste, de toutes ces heures, où sont-elles passées? Je n’ai pas gardé toutes ces habitudes annuelles, hebdomadaires et quotidiennes de ma pieuse mère, mais cette jeunesse chrétienne a infusé en moi. Mes enfants sont baptisées, elles ont fait leur catéchèse et elles ont grandi sous les croix de bois clouées au-dessus du cadre de la porte de leur chambre. Et puis, c’est plus fort que moi, je marmonne comme ma mère des prières de protection à l’attention de la Sainte Vierge. Je ne le fais pas par adoration comme Môman, mais comme elle, ces prières sont portées par tout l’amour du monde pour mes enfants. Je te comprends mieux Môman, maintenant.

À la recherche du je
Il y a quelques semaines, c’était la fin du concours pour la bourse Vanier. J’avais peu de temps pour structurer mon idée de projet pour le doctorat, et j’avais encore beaucoup de lectures à faire pour y arriver. En lisant un assez vieil article (début 2000 disons), je suis tombée sur une citation de Barbara Hammer, une cinéaste et critique féministe, et j’ai cherché à savoir d’où elle provenait. La citation venait d’un article publié dans la revue Vlasta, une revue qui n'a connu que quatre numéros en 1983 et 1984. Je me suis alors retrouvée dans une situation que j’avais connue cent fois en fréquentant des œuvres de femmes : le texte était introuvable. Pas à la BAnQ, pas à la bibli, pas dans une de la province, pas sur Érudit, MLA, JSTOR, Persée, nulle part. Alors, j’écris à une amie : « Hey, j’ai une drôle de question. Aurais-tu le courriel de Nicole Brossard, elle a collaboré dans un numéro de revue que j’arrive pas à retrouver ? ».
J’ai eu les coordonnées finalement. J’attends de voir si je réussirai à mettre la main sur l’article ou si je devrai me contenter du paragraphe cité. J’attends.
Par Emmy Lapointe, rédactrice en chefRetrouver le je Si les écrivains ont conquis les feuilletons, les canons, les prix littéraires et les plans de cours des universités, il y a très peu de temps encore, on pouvait suivre des cours comme Histoire de la littérature moderne française ou Histoire de la littérature québécoise sans voir apparaître le nom d’une seule autrice.
À la recherche du temps perdu est une œuvre qui révolutionne le genre romanesque. Le père Goriot est un roman pivot du romantisme et du réalisme. Les poètes québécois ont nommé le territoire pour se l’approprier (comme s’il fallait se l’approprier encore). Rien sur Colette, sur Gabrielle Roy, sur An Antane Kapesh, sur Marie Uguay.
À l’automne 2017, alors que j’étais encore à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR), j’ai suivi mon premier cours de littérature des femmes. Donc, par contraste sans doute, j’ai constaté l’immense absence – l’absence prend toujours du temps à se révéler – des autrices dans tous les autres cours. Alors quand on s’est adressées au conseil de module pour réclamer une représentativité plus décente dans les corpus, on nous a dit « qu’un effort serait fait », mais qu’iels ne pouvaient pas réécrire la littérature et que des romans du début du 20e siècle, écrits par des femmes, au Québec, il n’y en avait pas. Pourtant, si nous
n’avions pas de difficultés à concevoir que la littérature canadienne-française ait pu commencer par des genres comme le récit de voyage, on demandait à la littérature des femmes d’apparaître là où elle ne pouvait pas être.

C’est ainsi qu’on m’a appris, cette session-là, qu’il fallait chercher la littérature des femmes là où on ne l’attendait pas, que les écrivaines avaient pris les marges, les détours, qu’elles nous ont beaucoup échappées et nous échappent encore; et tout cela, parce qu’emprunter les marges ou les « genres mineurs », c’est risquer d’échapper à la pérennité.
Dans son essai De Marie de l’Incarnation à Nelly Arcan. Se dire, se faire par l’écriture intime –ouvrage duquel je tire l’essentiel de cet article –, Patricia Smart raconte qu’à l’origine, elle souhaitait écrire sur l’autobiographie féminine au Québec, mais qu’entre 1654, « année de la rédaction de l’autobiographie spirituelle de la grande mystique Marie de l’Incarnation, fondatrice du

couvent des Ursulines à Québec, et 1965-1966, quand parurent les mémoires d’enfance de Claire Martin » (Smart : 11), aucun autre ouvrage de ce genre n’avait été publié. Ainsi, elle se retrouvait devant un corpus inexistant ou à tout le moins, devant l’écriture d’un je au féminin absent des institutions. Il fallait alors le chercher, le retrouver ce je qui avait été « intronisé, nié, brûlé, ressuscité » (Hébert : 16).

Au nom du Père Après avoir rêvé de l’Amérique, Marie de l’Incarnation quitte, en 1639, le Royaume de France et son fils Claude avec qui elle entretiendra plus tard une correspondance importante – évidemment, l’histoire est plus complexe que ça – pour rejoindre Québec et y « instruire » les filles des communautés autochtones.
Les anales et les chroniques de Marie de l’Incarnation ne laissent pas de doute sur l’articulation de son je autour de la figure de Dieu et sur le fait que le sentiment d’abnégation pour le « Nouveau monde » était tel, qu’on voyait, dans son écriture, « fondre [son] moi dans Dieu ». (Smart : 14). Néanmoins, même si on associe
aux annales l’impersonnel, il va sans dire que les textes de Marie de l’Incarnation portent une attention accrue à la vie intérieure et aux détails du quotidien contrairement aux écrits des Jésuites.

« Je passais d’un abîme de lumière et d’amour en un abîme d’obscurité et de ténèbres douloureuses, me voyant comme plongée dans un enfer, qui portait en soi des tristesses et amertumes provenantes [sic] d’une tentation de désespoir. » (Marie de l’Incarnation, 1654 : p. 265-266.)
Pour Patricia Smart comme pour plusieurs théoriciennes de l’autobiographie féminine, « les frontières du moi féminin seraient plus floues, plus perméables que celles du moi de l’homme. Ainsi, le je féminin, souvent caché ou effacé dans le récit autobiographique, se révèle et disparaît tour à tour, absorbé dans sa relation avec un Autre : mère, enfant, époux, ami ou divinité» (Smart : 14).
Des anales et des chroniques jusqu’aux lettres, la figure du divin a tranquillement laissé sa place à d’autres au travers desquels, le je se manifestait tantôt discrètement, tantôt plus fortement. Forcément, l’épistolaire positionne toujours le sujet écrivant par rapport aux autres ne serait-ce qu’avec son destinataire. C’est ainsi que des épistolières comme Élizabeth Bégon (1696-1755) et Julie Papineau (1795-1862), en plus de critiquer certains
événements de la vie publique de la Conquête à la rébellion des Patriotes, ont fait état de leur « enfermement progressif dans les rôles familiaux » (Smart : 14). On perçoit dans leurs écrits à la fois la figure de la femme forte et celle de la femme passablement malheureuse. Dans une lettre de mai 1823 envoyée à son marie, Julie Papineau écrit : « Je ne suis bien qu’où je ne suis pas. » Ainsi, si les relations épistolaires sont marquées de stratégies discursives passant du repentir à la critique, c’est que les épistolières se doivent de composer avec certaines normes qui s’imposent selon le destinataire.
On peut penser que l’absence de destinataire clair dans le journal intime a permis aux diaristes d’écrire et d’explorer les « contours de leur soi » (Smart : 15) même si, forcément, il y avait une dissonance entre les aspirations des je et les diktats de la société catholique et patriarcale. Dans le premier cahier de son journal de 1874-1876, Henriette Dessaulles écrit : « Oh ! petite moi, tu seras reluquée, surveillée, gardée, couvée ! On voudra t’emmouler, te pétrir, te perfectionner ! On te prendra tout de toi, ton temps, ta volonté, tes goûts, on cherchera à voler tes impressions, à diriger tes affections, à assouplir ton caractère […] À quoi cela aboutira-t-il ? […] Hélas ! Si on réussit, tu ne seras plus toi, et si on échoue, tu seras la plus malheureuse des petites filles, parce que tu seras la plus persécutée ! »
Puis d’Henriette Dessaulles à Michèle Lenormand en passant par Joséphine Marchand, on assista à la naissance, plus de trois siècles après Marie de l’Incarnation, d’une nouvelle autobiographie, celle de Claire Martin : Dans un gant de fer . L’ouvrage paraît en deux parties, La joue gauche et La joue droite, et fait couler beaucoup d’encre. Dans son texte, Claire Martin y relate la violence du père et celle des pensionnats pour jeunes filles. On y lit des passages qui montrent, pour reprendre les mots de Pierre Vadeboncoeur, « des enfants qu’un père autoritaire écrase » (Vadeboncoeur : 171-173) au profit d’une pseudocommunauté qui finalement ne fait qu’aspirer toute volonté de s’individualiser en plus de reproduire des schèmes violents.
Le corps assiégé À partir des années 60, les je au féminin se sont multipliés avec des autrices comme Lise Payette, Denise Bombardier, France Théôret, Marcelle Brisson, Paule St-Onge et Francine Noël. Évidemment, tous ces textes portent en eux une littérarité unique, mais partagent aussi des thématiques qui reviennent encore et encore, et au centre de celles-ci : la mère et le corps.
À la fin de son ouvrage, Patricia Smart écrit : « Des pages rédigées par l’aïeule mystique aux cris du cœur de celle qui s’est identifiée à son métier de putain, les récits de femmes […] témoignent de la difficulté d’être soi-même, d’être femme dans
un monde qui ne reconnaît pas l’existence de la femme-sujet. Est-ce une pure coïncidence si l’histoire racontée dans ces récits de femmes commence et se termine par le double constat de l’insuffisance du moi et du besoin de punir le corps et de se sacrifier sur l’autel de l’Autre ? » (Smart : 397) Parce qu’il soit question de Marie de l’Incarnation ou de Nelly Arcan, le corps – qui se présente bien plus sous le spectre de la douleur que celui de la jouissance – représente le siège du mal qu’elles se doivent pourtant de transcender. Ce corps est aussi toujours le premier lien avec la mère. Il s’agit là d’un lien ou d’un nœud qu’il est difficile de défaire pour les autrices et leurs narratrices que ce soit à cause d’un « amour trop grand, [du] rejet, ou [du] sentiment de culpabilité associée au fait d’aller là où la mère n’a pas été capable de s’aventurer » (Smart : 400).
Toujours est-il que le je féminin, qu’il prenne racine ou non dans le ventre ou les bras de la mère, qu’il s’incarne ou se désincarne par le carcan du corps et des esprits, s’il s’enfonce, il « [ressurgira] avec force » (Hébert : 16).
Dans l’ombre de l’ombre
En rédigeant cet article, que ce soit par l’évocation de Marie de l’Incarnation ou de la violence du père par Claire Martin, j’avais l’impression de moi aussi reproduire la violence de l’invisibilisation si j’excluais de parler des questions d’héritage ou de l’écriture du je en littérature autochtone des femmes au Québec. Et si je parle plus facilement de la situation des autrices allochtones, c’est que je me place dans une position similaire à la leur alors que lorsqu’il est question de littérature autochtone, je suis coupable des mêmes biais que ceux que je reproche à mes homologues masculins : je prends ce qu’on me donne sans chercher ce qu’il manque.
Mais ce printemps, le département de littérature, théâtre et cinéma a engagé Marie-Ève Bradette comme professeure de littérature autochtone, et j’ai eu le privilège de discuter avec elle de l’héritage en littérature autochtone des femmes au Québec et plus largement de notre rôle comme allochtone dans le travail de revalorisation des œuvres.

D’entrée de jeu, elle me dit que comme allochtone, nous sommes dans un rôle d’apprenant.e et que parce que nous sommes formé.e.s à certaines traditions intellectuelles, ça demande de
remettre en question beaucoup de choses, de savoir être ébranlé.e, d’être conscient.e que la parole, il faut laisser à d’autres. Comme professeure, elle souhaite aussi offrir le plus d’outils possibles à ses étudiant.es afin qu’iels puissent approcher les textes autochtones avec des cadres théoriques pertinents qui ne viennent pas les recoloniser. Donc tout ça, ça demande évidemment du temps et de l’attention tout comme ça demande de travailler le plus souvent possible en collaboration, mais travailler en collaboration, c’est aussi travailler avec les textes, parce que comme le mentionne Marie-Ève Bradette : « les textes sont des dépositaires des savoirs autochtones, ce sont des agents textuels. »
Néanmoins, pour que l’enseignement de ces textes soit possible, il faut qu’on puisse leur accéder. Or, entre les violences éditoriales des maisons d’édition qui ont conservé les droits d’auteur.rice sans réimprimer les textes ou qui les sont modifiés et le manque de traductions – la question linguistique en étant une épineuse –, ça n’a pas toujours été simple de mettre la main sur des œuvres autochtones. Heureusement, des maisons d’édition comme Mémoire d’encrier et les Éditions Hannenorak (qui est aussi une librairie) ont pu remettre la main sur d’anciens textes et surtout en promouvoir de nouveaux.
Une fois passée l’énorme question de la matérialité qui taraude la littérature autochtone des femmes (la littérature autochtone et la littérature des femmes aussi en fait), il faut savoir que la mémoire y prend une place centrale. D’une part, il y a la mémoire traumatique – Marie-Ève Bradette donne d’ailleurs un cours de premier cycle cet hiver sur la littérature du trauma –, mais d’autre part, il y aussi la résurgence, la mémoire qui s’oriente vers l’avenir, parce que la temporalité s’y déploie autrement. Alors si on y voit les traumas inscrits par l’héritage des violences coloniales et des violences genrées (pensionnats, la Loi sur les Indiens, etc.), on y voit tout autant la mémoire des savoirs féminins que l’interrelation qui s’opère entre les temporalités, les êtres animés et inanimés.
Et quand je finis mon entretien avec Marie-Ève Bradette (qui contenait beaucoup plus que ce que j’ai pu mettre ici), je regrette de ne pas être de la cohorte qui aura à fréquenter des œuvres des littératures autochtones, mais je passe quand même une commande sur le site des Libraires en sachant très bien que ce ne sera pas suffisant, mais qu’une fois qu’on apprend, qu’on constate, on ne peut plus comme allochtone, comme blanc ou comme homme dans d’autres cas, désapprendre, parce que connaître vient avec une responsabilité certaine.

Des suggestions de lecture
Burqa de chair – Nelly Arcan – Seuil

Journal, Deuxième, Troisième et Quatrième Cahiers 1876-1881 – Henriette Dessaulles – Bibliothèque québécoise

Je suis une maudite sauvagesse – An Antane Kapesh – Mémoire d’encrier



Comme une enfant de la terre – Jovette Marchessault – Leméac
Dans un gant de fer. La joue gauche – Claire Martin – Bibliothèque québécoise

Une femme patriote : Correspondance, 1823-1862 – Julie Papineau – Septentrion

Andatha – Éléonore Sioui – Disponible en ligne sur le site de la BAnQ

Sources
Dessaulles, H. (1999). Journal / Henriette Desssaulles. 1 : 1874 - 1876 / Henriette Dessaulles. Texte établi, ann. et présente par Jean-Louis Major (J.-L. Major, Éd.). BQ.
Hébert, P., & Baszczynski, M. (1988). Le journal intime au Québec : Structure, évolution, réception. Editions Fides.
Smart, P. (2014). De Marie de l’Incarnation à Nelly Arcan : Se dire, se faire par l’ écriture intime. Boréal.
Vadeboncoeur, P. (1993). La ligne du risque. Fides.

Jeanne Lapointe : héritage d'une intellectuelle oubliée
Parce qu’au-delà de la posture de littéraire que certain.e.s intellectuel.le.s tentent encore de lui coller à la peau – comme si cette boîte de concentré suffisait à rendre compte de la diversité de son œuvre et de ses accomplissements, plus encore de son legs à la société québécoise – Jeanne Lapointe s’est dotée d’une mission nettement plus ambitieuse. C’est qu’il y a, dans cette introduction plus ou moins formelle qu’il me plaît à présenter, une sorte de mise en garde : considérez-la dans son entièreté et sa complexité, ou pas du tout. Son œuvre est éparse et fragmentée, certes, mais c’est justement cette constellation des expériences, des idées et des transgressions qui montre l’impertinence de ce cherry picking dangereux et réducteur. Jeanne Lapointe, c’est aussi donner sens à ce morcellement qui contribue encore aujourd’hui à l’édification de cette figure marquante ayant profondément changé le Québec moderne – rien de moins. Portrait d’une visionnaire avec un e.

Par Frédérik Dompierre-Beaulieu, cheffe de pupitre aux arts
Portrait : femme(s), laïcité et plafond de verre Pour entrer dans le vif du sujet, on peut dire que Jeanne Lapointe est une femme québécoise. Pas de quoi s’exciter jusqu’à présent. On continue.
Jeanne Lapointe est aussi une femme de lettres – et c’est probablement d’où provient cette manie de ne la voir qu’ainsi. Elle est, en 1938, la première femme diplômée de la Faculté des Lettres à l’Université Laval. En 1939, elle devient la première professeure de littérature de cette même faculté. Elle a dû se tailler une place au sein d’un milieu d’hommes, patriarcal dans sa structure. D’ailleurs, la plupart des hommes avec qui elle a collaboré ou avec qui il y a eu confrontation sont devenus célèbres, ont été enseignés, ont franchi l’étape ultime de la consécration, bref. Pourtant, Jeanne Lapointe semble parfois avoir sombré dans l’oubli, et ce, malgré le fait que sa contribution à la modernisation du Québec ait nettement égalé celles de ses homologues masculins. Pourquoi? Peut-on uniquement l’attribuer à sa tendance à travailler dans l’ombre? Oui, en petite partie, mais pas exclusivement. En fait, cet effacement se veut inévitablement une manifestation des inégalités et des rapports de domination genrés au sein de l’institution littéraire et de l’espace public québécois plus largement. Les gens ne la connaissent peu ou pas, même si c’est une tendance qui tend à s’estomper au fur et à mesure que l’on s’y intéresse et qu’on en parle.


J’ai eu la chance de m’entretenir avec Claudia Raby (quelle expérience enrichissante, d’ailleurs), professeure de lettres au Cégep de Lévis et doctorante en études littéraires à l’Université Laval, dont la thèse consiste à écrire la biographie intellectuelle de Jeanne Lapointe. Selon celle qui a consacré son mémoire de maîtrise au parcours critique de Jeanne Lapointe (2007), « plusieurs chercheuses universitaires ont travaillé à la faire connaître depuis une vingtaine d’années. Chantal Théry (U. Laval), Mylène Bédard (U. Laval), Nathalie Waytten ( U. de Sherbrooke), moi-même et quelques autres, essayons de rendre Jeanne Lapointe à l’Histoire. Mais pourquoi en sommes-nous actuellement à devoir réhabiliter des figures oubliées de femmes influentes? C’est vrai que Jeanne Lapointe avait une volonté de rester dans l’ombre, mais ce serait un peu de l’accuser ellemême, et donc en faire un cas singulier, que d’attribuer son effacement à sa seule humilité, bien qu’elle soit réelle. Elle prenait la parole et investissait des plateformes au nom de ses idées et des femmes, et elle ne se gênait pas pour aller de l’avant mener des batailles.» Il faut donc faire attention à ne pas confondre son humilité avec une dissimulation volontaire. Cette
autre responsable, celle qu’on doit pointer du doigt avec insistance et d’un ton accusateur, c’est l’institution. L’institution, qui, encore aujourd’hui, force les femmes à emprunter des chemins et des voies de contournement, à mettre en place des techniques, des stratégies et des réseaux en marge pour en arriver à leurs fins. Au sein d’un champ littéraire androcentré, les femmes apparaissent toujours comme autres ou nouvelles, et c’est une tradition, un mode de pensée qui continue d’agir et qui les force à constamment négocier avec les normes de genres : « Moins bien placées dans ces espaces, les femmes ne sont pas créditées pour leurs inventions, voire en sont dépossédées, et sont, en conséquence, invisibilisées. À cet égard, les apports de la critique littéraire féministe et de la sociologie des rapports sociaux de sexe appliqués à la littérature renouvellent ainsi l’historiographie littéraire et interroge la participation des femmes aux élites culturelles et intellectuelles. » (Naudier, 2010). Nécessairement, les femmes en sont venues, Jeanne Lapointe incluse, à être plus créatives pour faire valoir leur travail. Claudia aborde justement ces difficultés.
« La publication du livre, qui reste une voie principale de consécration en littérature, n’est devenue plus facile d’accès pour les femmes que tardivement dans l’histoire, comme en témoignent les travaux de Chantal Savoie (UQAM). Jeanne Lapointe, d’ailleurs, n’a jamais publié de livre. Son premier et unique ouvrage est son anthologie parue en 2019, plusieurs années après son décès. Elle a plutôt publié des articles ou des petits textes ici et là, stratégie que les femmes ont souvent utilisé parce que les grandes plateformes ne leur étaient pas si facilement accessibles, ce qui fait en sorte que son œuvre est éparse et a été difficile à réunir. Je trouve encore des nouveaux textes de Jeanne Lapointe, et je suis convaincue qu’on continuera d’en découvrir d'autres. Son œuvre écrite se révèle d’ailleurs plus vaste qu’il n’y paraissait au début de mes recherches en 2003. En fait, la façon étendue mais disséminée dont Jeanne Lapointe a pris la parole reflète sa façon de travailler «politiquement» en coulisses, en ce sens où elle entrait dans les institutions pour transformer les règles afin de rendre notamment l'éducation, la publication et la prise de parole plus accessibles à tous et toutes.
Il y a aussi tout le phénomène de décrédibilisation de la parole des femmes qui est encore actuel. La parole et l’expertise des femmes sont moins prises au sérieux. C’est un triste héritage de la tradition, un legs historique à effacer.
on l’associe aurait très bien pu lui être imposée. C’est une autre des stratégies à laquelle les femmes peuvent recourir pour contrebalancer ou même camoufler la subversion qu’elles opèrent et le dérangement qui en résulte.
Une littéraire donc. Et après ? Jeanne Lapointe portait aussi en elle les germes de la pensée moderne, ce qui contribuait non pas nécessairement à la placer en marge, mais à ce qu’elle se démarque : « Elle voulait opter pour une pédagogie plus axée sur le dialogue avec les étudiant.e.s. Elle enseignait aussi, très tôt dans sa carrière, une approche littéraire axée sur la psychologie du texte et les symboliques, elle refusait de suivre la voie dominante qui aurait consisté à en faire une lecture plus nationaliste », m’explique Claudia Raby. « Dans les années 1940 et 1950, elle faisait partie d’une nouvelle génération d’étudiant.e.s et de professeur.e.s à l’Université Laval, et elle était en relation de complicité avec certaines de ces personnes, notamment JeanCharles Falardeau, Arthur Tremblay et plus tard Fernand Dumont. Ces jeunes gens avaient une vision très moderne de la société québécoise et de la liberté de pensée. »
Ce qui est étonnant avec Jeanne Lapointe, si l’on regarde, par exemple son parcours dans les années 1950 chez Cité Libre, c’est que sa parole a tout de même été tenue en haute estime par ses contemporains masculins, même si la postérité en a peu retenu de sa contribution à l’histoire intellectuelle au Québec. Elle tenait très tôt des discours sur des sujets généralement réservés aux hommes, comme la culture nationale, l’importance de la langue française, la liberté. À ce que je sache, elle n’a pas été muselée ou insultée sur la place publique pendant cette période. Il faut dire que son statut de professeure à l’université lui octroyait une certaine légitimité, c’était une situation privilégiée. Malgré tout, elle est longtemps restée dans l’ombre et on a souvent justifié ce phénomène par son humilité, mais ce s’explique aussi par le caractère parallèle des voies qu’elle a parfois été forcée d’emprunter et, plus largement, par la tendance historique à marginaliser les accomplissements des femmes. » Il y a ici trois facteurs à prendre en considération dans leur ensemble, d’autant plus que cette fameuse humilité à laquelle
C’est une manière de percevoir les choses qui s’est aussi étendue à leur conception de l’enseignement et à son rapport aux grands maîtres, dont l’aura un brin mythique semblait plus souvent qu’autrement masquer l’essentiel de leurs contributions, et surtout le besoin de renouvellement et de réactualisation de ces dites contributions. Il y avait là un rejet de cette idée des plus grands que soi à l’autorité absolue, du savoir tout puissant venu de la main de Dieu qui devait être gobé sans trop de questionnements ni de réflexions de la part des étudiant.e.s. La question du dialogue s’y retrouve tout de suite centrale. Ce n’est ainsi pas pour rien qu’elle a siégé sur la Commission Parent, par laquelle elle a valorisé la mixité et l’inclusion des filles à l’école et la laïcisation des professeur.e.s, ou sur la Commission Bird, commission féministe fédérale sur la condition des femmes au Canada, commissions sur lesquelles nous reviendrons plus tard :
« La commission Bird a énormément déterminé son féminisme. Il s’agissait de faire une enquête pour cibler et comprendre les problématiques de la vie et de l’éducation des femmes. L’enquête l’a sensibilisée elle, mais le rapport Bird a aussi eu un impact sur toutes les femmes au Canada. Plus tard, Jeanne Lapointe en est venue à former des groupes de femmes à l’Université Laval, elle a donné les premiers cours de littérature dans une perspective féministe. Quand elle a pris sa retraite en 1987, elle a absolument tenu à ce qu’un poste de professeure de littérature dans une
perspective féministe soit créé. C’est Chantal Théry qui est devenue cette professeure après le départ de Jeanne Lapointe. Aujourd’hui, c’est Mylène Bédard qui occupe ce poste toujours aussi essentiel. C’est une forme professionnelle de filiation et de transmission. »
Ce sont de grandes répercussions que Jeanne Lapointe a eues sur la société et qui ne sont certainement pas à négliger. Dans cette même veine de pensée moderne et pour nommer un autre accomplissement, elle a également été l’une des premières femmes à contribuer à la revue Cité Libre (mention spéciale à Andrée Desautels), espace de débats intellectuels et politiques.
Avant les années 1960, être l’une des pionnières qui ont participé d’un décloisonnement des sphères masculines et féminines au Québec en intervenant en tant qu’experte dans l’espace public n’est pas rien : « La décennie 1950 est le moment où Jeanne Lapointe a été le plus médiatisée. Elle a été présente sur plusieurs plateformes comme Radio-Canada, Cité Libre ou Le

Devoir, de façon assez récurrente. Par sa présence et le contenu de ses discours, elle venait déconstruire la ségrégation qui existait dans les médias à ce moment-là. La parole des femmes était généralement limitée aux pages féminines et aux genres de l’intime, et elles devaient se restreindre à des sujets désignés, comme l’éducation des enfants, la moralité, la domesticité. C’était ça, leur lieu, qui était une sorte d’espace parallèle, comme si elles n’existaient pas vraiment. Il ne fallait pas qu’elles se mêlent de repenser l’enseignement, voire le système d’éducation, ou de décoder la société canadienne-française, mais c’est exactement sur ces sujets que Jeanne Lapointe se prononçait.» En s’inscrivant de la sorte dans l’espace public, elle réussissait à briser les frontières entre le masculin et le féminin et donnait, d’une certaine manière, le droit aux femmes de s’exprimer sur des sujets qui leur étaient jusqu’à lors interdits et qui concernent la société dont elles font partie.
À celleux qui ne connaissent pas Jeanne Lapointe, on pourrait aussi mentionner qu’elle était laïque. Point important. La

transgression opérée par Jeanne Lapointe au cours de sa carrière est donc double : d’une part, par sa posture d’intellectuelle femme qui non seulement se taille une place dans un milieu machiste, mais participe d’une agentivité et d’une confrontation, et d’autre part par sa laïcité et sa volonté d’attaquer l’angle religieux de la lecture de textes et le dogmatisme de la religion, d’autant plus qu’à l’époque, une bonne partie du corps professoral de l’Université Laval y est affiliée d’une manière ou d’une autre. Certains débats à cet égard ont eu lieu, quoique pas systématiquement envenimés :
« On note une tension amicale et respectueuse entre elle et Félix-Antoine Savard, le doyen de la Faculté des lettres, avec qui elle publie un débat d’idées sur la littérature, la critique littéraire et l’enseignement dans Cité Libre en 1954. Pour FélixAntoine Savard, la vision de Jeanne Lapointe, qui est plus moderne et plus axée sur le contact avec les étudiant.e.s, est quelque chose d’un peu inquiétant. Pour lui, qui reste associé à son allégeance cléricale, il faut enseigner les droits naturels, ce qui est bon ou l’est moins et la moralité religieuse, mais notons qu’il ne se situe pas non plus dans le dogmatisme que dénonce

Jeanne Lapointe. Elle était anticléricaliste, mais pas irrespectueuse envers les membres du clergé. Ce qu’on trouve dans leurs échanges, c’est une très grande politesse et une estime réciproque. D’un côté, Savard reconnaît constamment la grande expertise de Lapointe; de l’autre, elle témoigne d’un profond respect pour le jugement et l’ouverture de son collègue. C’est même Jeanne Lapointe qui a eu l’idée de publier leur échange chez Cité Libre pour montrer qu’on peut ne pas être en accord et tout de même dialoguer pour enrichir une réflexion commune. C’est une dynamique qu’on a appelée l’« éthique du dialogue » chez Jeanne Lapointe, cette idée qu’il est fructueux de confronter des points de vue divergents. Là où Jeanne Lapointe a eu des affrontements plus vigoureux, c’est pendant sa période féministe dans les années 1970. Là, ça a joué beaucoup plus dur.»
En d’autres mots, Jeanne Lapointe a occupé une place marquée tant en littérature que sur le plan social au Québec, pouvant être considérée comme une pionnière qui a brisé plusieurs plafonds de verre au cours de sa carrière et qui a transformé la société québécoise dans une optique de démocratisation.
LETTRE DE JEANNE LAPOINTE EN RÉPONSE À FÉLIX-ANTOINE SAVARD
Le 25 février, 1954
Monseigneur Félix-Antoine Savard, Doyen de la Faculté des Lettres, Université Laval.
Monseigneur, Les directeurs de Cité Libre me disent que mon article est déjà sur les galées, mais que la publication de la revue est retardée parce qu’un de leurs collaborateurs leur fait défaut pour le moment.
Je voudrais profiter de ce délai pour leur faire une proposition, si elle vous agrée. Je serais étonnée que, de leur côté, ils ne l’accueillent pas avec le plus grand intérêt.
Consentiriez-vous à laisser publier, à côté de l’article dont vous ne partagez pas les opinions, la lettre que vous m’avez adressée à ce propos ; s’il est vrai que l’article en question puisse faire tort aux lecteurs de Cité Libre – ce que je ne pense pas – votre lettre apportera d’elle-même les correctifs nécessaires. On y verra en outre que des gens d’opinion contraire peuvent se parler avec amitié et respecter les idées les uns des autres.
J’exigerais que la lettre soit publiée sans commentaire, mais que l’on mentionne simplement que vous avez permis la publication et que je l’ai demandée. Il me serait égal, personnellement, qu’elle soit publiée au complet ; mais il est sans doute préférable qu’on y supprime les paragraphes concernant ma situation à la Faculté, qui pourraient être malicieusement interprétés comme des tentatives d’intimidation, par des lecteurs qui ne vous connaîtraient pas.
Je vous envoie copie de ce qui resterait ainsi de la lettre, et, à part, copie des passages qui pourraient être omis, afin que vous puissiez relire le tout avant de me donner votre réponse.

Quant à ce qui concerne le cours sur la critique, Dieu m’est témoin que je n’ai pas demandé à le faire et que je ne serais nullement vexée de le voir supprimer. Mais je crois que les cours que je fais sont tout à fait ad usum delphini, bien que j’aie le droit, en dehors de la Faculté et en matière d’opinion, de m’exprimer plus librement. Je tenais à vous soumettre l’article en question parce que vous étiez l’un des écrivains dont je parlais un peu longuement, et non pas parce que les professeurs de la Faculté ont l’obligation de soumettre tout ce qu’ils écrivent au Doyen de la Faculté.
Pour revenir au cours sur la critique, vous pourrez interroger à ce propos un religieux bénédictin qui a suivi le cours que je donnais l’an dernier sur la critique aux candidats à la maîtrise : c’est un franco-américain, le Père Léon Bourque, qui est encore ici pour quelques semaines (chez les Franciscaines, sur la Grande Allée, son numéro de téléphone est 3-2334) ; je ne le préviendrai d’aucune manière et il vous parlera ainsi en toute liberté. Le cours, comme tout autre cours d’histoire littéraire, consistait à faire connaître les critiques d’aujourd’hui, et à dire honnêtement quel est le contenu de leur oeuvre. Les opinions sur l’orientation culturelle ou politique du Canada français n’ont rien à y faire, me semble-t-il.
Je vous suis très reconnaissante, Monseigneur, de m’avoir exprimé votre point de vue avec autant de sincérité et d’amitié. C’est la seule manière, probablement, de garder quelque humanité aux relations entre les êtres et les peuples, dans un monde qui menace à tout moment de se replonger dans la barbarie. Il me semble, pour ma part, qu’on est beaucoup plus proches les uns des autres, après s’être parlé aussi franchement.
Croyez bien, Monseigneur, à mes sentiments les meilleurs.
Jeanne Lapointe, 36, rue Sainte-Ursule, Québec
Legs, apports et implications
On a déjà, au fil de cet article, mentionné l’ampleur de Jeanne Lapointe au Québec, figure intellectuelle majeure, entre autres durant la Révolution tranquille. Son influence s’est fait ressentir de diverses façons, s’incarnant à travers son implication au sein de la Commission Parent sur l’enseignement au Québec et de la Commission Bird sur la situation des femmes au Canada, sur lesquelles nous avons assez rapidement attiré l’attention. La première, ayant lieu de 1961 à 1966, se voulait une commission d’enquête mise en place par le gouvernement libéral de l’époque qui a notamment mené à la création des cégeps : « Elle n’avait pas peur de l’ouvrage, c’est certain! Elle continuait à donner ses cours à l’université en même temps qu’elle travaillait assidûment à la commission Parent. Les commissaires se voyaient toutes les semaines, presque sans exception, à Québec et à Montréal, et voyageaient à travers le monde pour explorer d’autres systèmes d’éducation. Après le dépôt du rapport Parent, Jeanne Lapointe a tout de suite accepté de siéger à la Commission Bird au début de 1967, jusqu’à la fin en 1970. C’était étonnant, parce que c’était aussi très demandant. En fait, toute la décennie 1960 s’est passée en commissions d’enquête pour Jeanne Lapointe. Grâce aux témoignages de Guy Rocher, seul membre encore en vie de la commission Parent, on comprend de mieux en mieux le legs de Jeanne Lapointe au Québec moderne et on cerne plus précisément le rôle prépondérant qu’elle a joué dans cette commission. Elle et lui ont rédigé de larges pans du rapport, c’est-à-dire la majorité des recommandations. Jeanne Lapointe


était de ceux et celles qui tenaient à ce que les commissaires rédigent le rapport, dans une langue claire et précise, de façon à se donner aussi le contrôle sur leur étude. D’un point de vue esthétique, c’est un des grands apports de Jeanne Lapointe à la commission Parent. Du côté du contenu, elle a orienté plusieurs recommandations, comme celles qui concernent la laïcisation du système scolaire, la mixité à l’école, un meilleur accès des filles à l’éducation supérieure, la démocratisation de l’enseignement pour que les personnes de tous les milieux socioéconomiques y aient accès. C’est aussi elle qui aurait rédigé tout le tome III de ce rapport, qui porte directement sur les contenus enseignés en classe.» On jase, on lit une liste de réalisations : vite comme ça, ça peut paraître encore abstrait, difficile à s’imaginer quand on n'est pas dans le domaine, pas « dans la gang ». Je le redis, parce que ce n’est pas à minimiser : cette commission a grandement contribué à façonner le Québec tel qu’on le connaît actuellement. C’était un exploit incroyable que de faire tomber le clergé de l’éducation. Si j’use de cette circularité dans mon propos, c’est parce que l’accès pour toustes à l’éducation est réellement venu changer le visage de la société québécoise. C’est une des valeurs que, collectivement, on a choisi de protéger et de mettre de l’avant. Cet apport à l’éducation et aux avancées féministes, cette passion plutôt, elle a également pu les mettre à profit lors de sa participation à la Commission Bird, en militant, par exemple, pour une meilleure représentation des femmes dans les manuels scolaires et les documents gouvernementaux. Encore une fois : chapeau. Jeanne Lapointe
est initialement nommée sur cette commission parce qu’elle ne se disait pas encore féministe : elle devait en fait contenir les féministes et limiter leur impact dans la commission. Finalement, elle devient la féministe la plus radicale à y siéger. Cette agentivité des femmes qu’elle souhaitait si ardemment voir s’accroître et s’épanouir, Jeanne Lapointe en était l’incarnation.
D’ailleurs, en analysant de plus près le parcours d’écrivaines telles Gabrielle Roy, Anne Hébert ou Marie-Claire Blais, on réalise rapidement que Jeanne Lapointe, durant la période moderne, a joué un rôle de mentorat important, quoiqu’encore une fois en restant dans l’ombre. Chez Cité Libre , elle tente même d’attirer l’attention sur certain.e.s auteur.rice.s, comme Hector de Saint-Denys Garneau, qui appartiendront éventuellement au canon littéraire et seront considéré.e.s comme des classiques. Mais pour les femmes qu’elle a accompagnées, ce n’était pas gagné d’avance : pour ces autrices mentorées, ayant été parmi les premières à être reconnues à l’international et à vivre de leur écriture, la pression de maintenir cette réussite était très forte suite à leur succès. Il y a ce travail en aval, oui, mais on peut supposer que sans femmes agentives comme Jeanne Lapointe dans le corps professoral de l’université et dans la sphère publique, la consécration de ces autrices mentorées aurait été plus lente. Son impact était considérable : « En ce moment, des chercheuses comme Mylène Bédard et Nathalie Watteyne déterrent beaucoup d’archives et mettent au jour ce travail de mentorat accompli par Jeanne Lapointe, qui était encore inconnu jusqu’à récemment. Ça éclaire une grosse partie de la carrière de Jeanne Lapointe qui se réalisait dans l’ombre, car le mentorat, c’est avant tout valoriser l’autre personne. Et ce n’est pas anodin que Jeanne Lapointe ait été la mentore de beaucoup d’écrivaines et de peu d’écrivains : elle avait le souci de favoriser des conditions de création qui permettraient aux femmes de se faire une place dans le paysage culturel. Ses archives révèlent qu’elle a travaillé sur le manuscrit de Pierre le magnifique de Roger Lemelin au début des années 1950, mais ses affiliations se sont davantage tissées avec des femmes. Son mentorat auprès d’elles touche plusieurs dimensions. Elle a commenté leurs manuscrits, beaucoup travaillé le style et la langue. C’était sa spécialité, comme en témoigne son titre officiel de professeure de grammaire française, même si son enseignement de la littérature a largement dépassé les aspects stylistiques et linguistiques. On sait aussi, grâce aux recherches de Nathalie Watteyne, qu’elle travaillait à la diffusion des œuvres, un peu comme une agente, notamment pour Anne Hébert. Elle
accomplissait un travail de pré-édition, d’une certaine façon. Elle établissait des liens avec les éditeurs, avec des intellectuel.le.s, elle en convoquait même pour l’écriture de préfaces. Les travaux de Mylène Bédard montrent que tout le réseautage, particulièrement celui entre femmes – des écrivaines, des artistes, des intellectuelles, des professeures, est un des aspects prépondérants du mentorat et de l’influence de Jeanne Lapointe. On peut penser qu’elle était sensible à un manque, aux obstacles vécus spécifiquement par les femmes, à cette occultation systémique dont son travail a lui-même fait l’objet. Et cette sensibilité, elle était visiblement présente chez elle bien avant la Commission Bird.»

Jeanne Lapointe et l’Université Laval aujourd’hui Il existe, à l’Université Laval, le Fonds Jeanne-Lapointe en études féministes, créé suite au décès de Jeanne Lapointe survenu en 2006. Il « a pour objectif de favoriser la formation, la recherche et son rayonnement, et les services à la collectivité en études féministes. Il pourra ainsi servir à l’attribution de bourses d'excellence, à soutenir l'émergence de nouveaux projets de recherche ou de services aux collectivités féministes et à soutenir des activités de formation et de rayonnement des études féministes. » (Fonds Jeanne-Lapointe, Site de la Chaire ClaireBonenfant de l’Université Laval). On y retrouve également plusieurs documents et objets de toutes sortes, dont certains légués par la famille de Jeanne Lapointe, qui portent sur sa vie en tant qu’intellectuelle et qui témoignent de son parcours.
Plus sérieusement, j’ai des questions pour l’Université Laval. On change de ton. Depuis quelques années, on milite pour que le pavillon des sciences de l’éducation soit nommé en l’honneur de Jeanne Lapointe, les femmes étant en plus sous-représentées en ce qui concerne la toponymie des pavillons de l’université. Des hommes comme Alphonse-Marie Parent, Félix-Antoine Savard, Jean-Charles Bonenfant ou Charles De Koninck nomment presque la totalité du campus. Ce sont des hommes aux côtés desquels Jeanne Lapointe a travaillé ou même débattu. Pourquoi si peu de femmes, sachant par exemple qu’en 1983, elle publie Le meurtre des femmes chez le théologien et le pornographe (Lapointe, 1983) dans lequel elle exhibe les notes tirées du cours « La philosophie des sexes » donné par Charles De Koninck à l’Université Laval en 1937. Ce qu’on y trouve, c’est une misogynie très directe et violente, comme quoi le discours de domination n’est certainement pas une exagération de sa part et des féministes plus largement. Pourquoi lui, intellectuel certes, pourquoi eux et pas elle? Pourquoi l’université tarde-t-elle autant à nommer le pavillon de sciences de l’éducation en son nom ? Outrepassé la question administrative, il est où, le blocage? La résistance? Ce n’est pas comme si on devait retirer un nom d’un pavillon : le concerné n’en a même pas. Jeanne Lapointe a porté l’éducation du Québec moderne à bout de bras, mais plus encore l’éducation des femmes et des filles en leur ouvrant un monde des possibles au sein de l’espace public. Son héritage s’inscrit dans une filiation, dans un désir de transmission et de continuité, dans une ouverture et un dialogue avec l’autre, et ce, dans cet objectif de projection vers l’avant. Tous des éléments, qui, me semble-t-il – à moins que ce ne soit que moi qui soit à ce point déconnectée – concordent par.fai.te.ment avec notre vision de
l’éducation au Québec, du rôle qu’elle devrait recouvrir. N’est-ce pas assez? Et que dire de la symbolique si un pavillon – celui de sciences de l’éducation, je vous le rappelle – portait son nom et se trouvait aux côtés du pavillon Félix-Antoine Savard? Il y a anguilles sous roche. On exige des réponses. Des vraies.
Références
1. Fonds Jeanne-Lapointe, Chaire Claire-Bonenfant de l’Université Laval, https://www.chaireclairebonenfant.ca/fonds-jeanne-lapointe/
2. Lapointe, J. (1983). Le meurtre des femmes chez le théologien et le pornographe. Les cahiers du GRIF (26), p.43-53. https:// www.persee.fr/doc/grif_0770-6081_1983_num_26_1_1368
3. Lapointe, J. Savard, F.-A. (2020). Échange épistolaire. Études Littéraires, vol. 49 (1), p. 89-94. https://www.erudit.org/fr/revues/ etudlitt/2020-v49-n1-etudlitt04943/1065518ar/

4. Naudier, D. (2010). Genre et activité littéraire : les écrivaines francophones. Sociétés Contemporaines, vol.2 (78), p. 5-13. https:// www.cairn.info/revue-societes-contemporaines-2010-2-page-5.htm
5. Bédard, Mylène, « Jeanne Lapointe, mentore et amie », Études littéraires, vol. 49, no 1 (2020), p. 65-80.
6. Lapointe, Jeanne, Rebelle et volontaire. Anthologie 1937-1995, sous la direction de Marie-Andrée Beaudet, Mylène Bédard et Claudia Raby, avec la collaboration de Juliette Bernatchez, Montréal, Leméac, 2019, 253 p.
7. Raby, Claudia, Le parcours critique de Jeanne Lapointe, Québec, Université Laval (mémoire de maîtrise en études littéraires), 2007, 133 p.

Aux fourneaux !
La cuisine, c’est un espace particulier dans une maison. Il s’y concocte des sauces à spag, s’y partage des verres de vin, s’y cache des sucreries en cas de craving. Les fourneaux ronronnant ont ce quelque chose qui évoque le familier et le confortable – le pouvoir rassembleur de la nourriture n’est plus à prouver. Et puis c’est sur nos comptoirs de granite ou de mélamine qu’on expérimente les différentes croustades aux pommes : celle que Ricardo annonce comme la meilleure; la plus instagrammable bien entendu proposée par Trois fois par jour, la seule végane signée La cuisine de Jean-Philippe. Reste que notre vraie préférée, celle à laquelle on retourne inévitablement, c’est celle de notre enfance, celle aux épices de nostalgie et d’amour. L’équipe d’Impact Campus désire partager avec vous sa petite sélection de recettes en provenance directe des cartables familiaux qui, on l’espère, saura alimenter les séances de cannage et de commérage dans l’automne de vos cuisines.
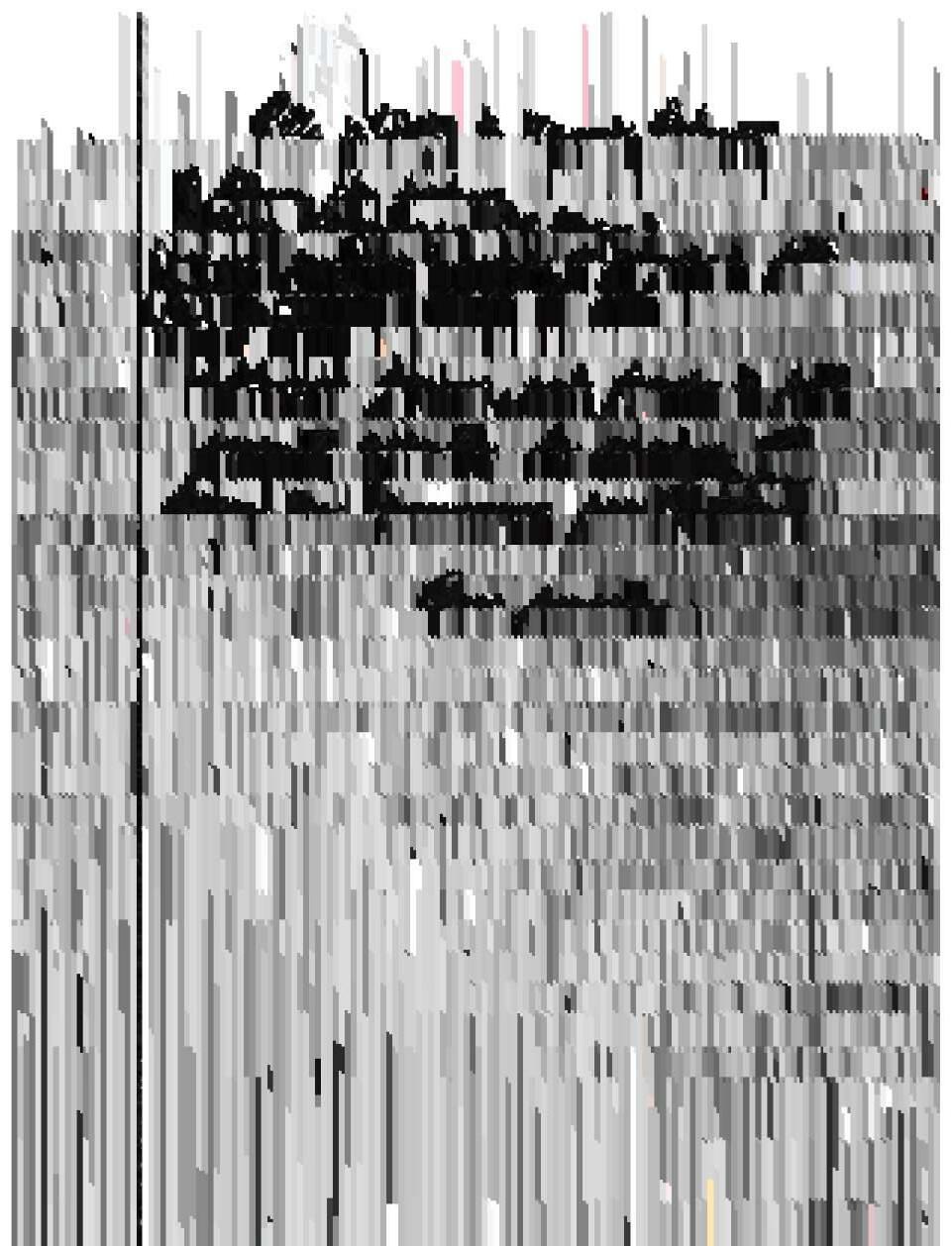
Par toute l'équipe d'Impact Campus, intro par Sabrina Boulanger




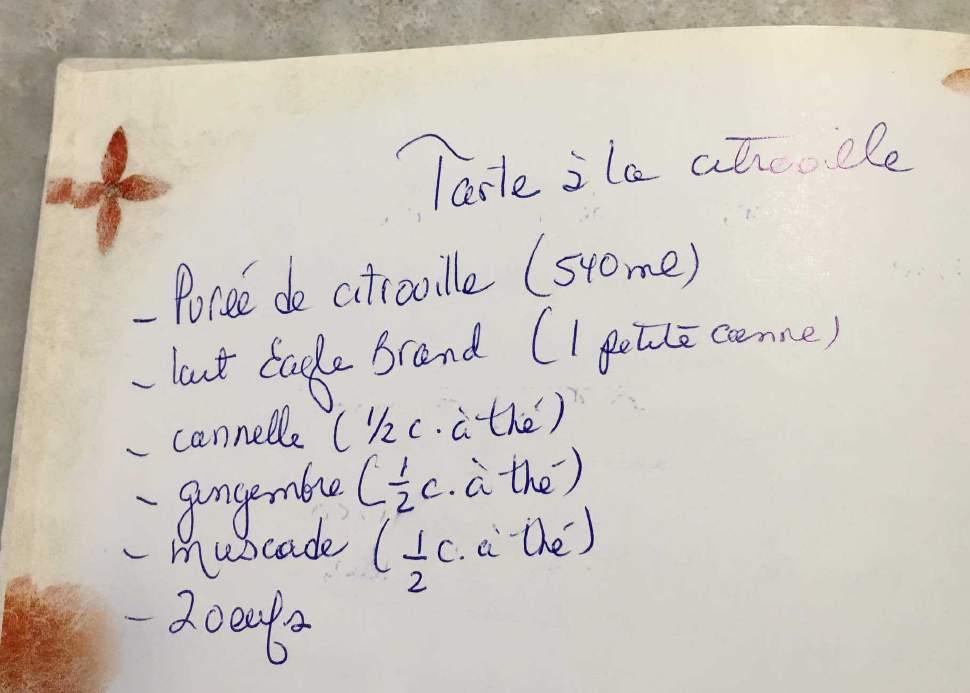

SOCIÉTÉ ET SCIENCES
Gorbatchev : les trois visages de l’homme
Le 3 septembre dernier, à Moscou, on enterrait l’ultime dirigeant de l’Union soviétique, Mikhaïl Gorbatchev. Homme de paix, artiste du rapprochement entre l’URSS et les États-Unis, démolisseur du mur de Berlin et porteur de liberté : en Occident, les hommages sont nombreux. Pourtant, du côté russe, pas de funérailles officielles, pas de jour de deuil national. Le président Poutine brille par son absence et l’État n’accorde que quelques gardes d’honneur et un orchestre militaire en guise d’ultime adieu à Gorbatchev. Pour expliquer ces réactions divergentes, il faut s’attarder au souvenir que l’homme a laissé derrière lui : la paix, le sentiment d’oppression et la défaite.
Gorbatchev homme de paix
Les Occidentaux se remémorent principalement Gorbatchev de façon positive. D’abord, on s’en souvient comme celui qui a œuvré pour réduire les tensions entre les deux blocs de la guerre froide. Maxime Philaire, étudiant à la maîtrise en science politique, élabore sur le sujet : « au début des années 1980, on a une relance de la guerre froide et une crainte d’un conflit qui pourrait s’étendre vers un affrontement nucléaire ». Or, le dirigeant soviétique vient apaiser ces craintes. Les négociations avec le président Reagan portent leurs fruits et on arrive à des accords de réduction d’armements. Progressivement, les relations entre Washington et Moscou deviennent plus cordiales. Durant l’invasion du Koweït, les Soviétiques votent même pour des propositions américaines à l’ONU sur l’utilisation de la force pour faire reculer l’Irak. Les deux pays semblent enfin s’entendre quant à des conflits régionaux. Les politiques d’ouverture et l’influence pacificatrice sur l’ordre mondial valent à Gorbatchev le prix Nobel de la paix.

Au-delà de ses efforts à l’international, Gorbatchev instaure également des réformes internes qui font sa réputation, dont des changements économiques introduisant des mécaniques du modèle capitaliste. Bien que l’État gardait beaucoup de contrôle sur l’économie, ses réformes laissaient plus d'espace au libre marché, à la compétition et à l’entrepreneuriat, ce qui allait en désaccord complet avec l’idéologie du parti communiste. Au même moment, il met en place de nouvelles politiques de transparence dans un effort de lutte contre la corruption, tout comme des mesures réduisant la censure des médias, permettant même aux critiques du régime de s'exprimer.
Finalement, en Occident, on se souvient de son rôle dans la fin de l’URSS – une transition qui s’est faite avec peu de violence en tolérant la séparation des républiques soviétiques – puis dans l'effondrement du régime communiste sans conflit, mettant ainsi terme à la guerre froide de manière relativement paisible. Reneo Lukic, professeur titulaire de relations internationales au
Département d’histoire de l’Université Laval, souligne le rôle de Gorbatchev dans la fin de la guerre froide comme une « contribution majeure de son héritage politique » ce qui le place « parmi les plus grand.e.s politicien.ne.s du XX siècle ». Il note également l'influence positive qu’a eue Gorbatchev dans la construction des États nationaux en Europe de l’Est.
Gorbatchev tyran
Il ne faut cependant pas perdre de vue que ces réformes ne sont pas que des actes de bonne volonté désintéressée. Après tout, Gorbatchev veut préserver la puissance de l’Union soviétique et c’est bien malgré lui qu’il en arrivera à la fin. Quand il se retrouve à la tête du pays, l’URSS traverse une période difficile. L’économie est dans une situation « critique, pour ne pas dire catastrophique », explique M. Philaire. Les mesures économiques et politiques d’ouverture et de libéralisation sont avant tout des tentatives de remettre sur pied l’état des finances, mais elles sont insuffisantes. Progressivement, le peuple se retourne contre lui, d’abord en Europe de l’Est, puis en Russie.

Dans les pays baltes, le souvenir du dernier dirigeant de l’URSS est bien plus amer qu’en Occident. Pendant que les troupes russes se retirent de plusieurs pays d’Europe de l’Est, le désir d’indépendance de la Lituanie, de la Lettonie et de l’Estonie se fait sentir. En 1991, Gorbatchev demande la fin des réformes indépendantistes en Lituanie et les violences éclatent. On dénombre 15 morts dans la capitale après l’occupation de plusieurs bâtiments par l’armée soviétique. Le rôle du dirigeant russe dans l’intervention de l'armée reste un mystère, mais pour plusieurs, Gorbatchev évoque l’image d’un dictateur, bien qu’il ait nié son implication dans ces événements.
Finalement, il faut rappeler que l'accident de Tchernobyl a lieu alors qu’il est pouvoir et que, malgré ses politiques de transparence, son régime tarde à reconnaître l’ampleur de la catastrophe et de ses conséquences, tant pour sa population que pour l’Europe. Son portrait d’homme honnête en ressort taché.
Gorbatchev vaincu En Russie, la perception du dernier dirigeant soviétique est toute autre. M. Lukic avance que « la grande majorité des Russes considère le bilan politique de Gorbatchev comme étant un désastre pour la Russie », alors que M. Philaire note que beaucoup s'en souviennent comme ayant été naïf envers l’Occident et qu’il représente globalement un échec.
Pour les critiques les plus acerbes, Gorbatchev serait également le responsable des catastrophes économiques des années 1990 en Russie, une période difficile et traumatisante pour le peuple russe. Pourtant, comme le rappelle l’étudiant à la maîtrise, il ne cause pas vraiment tous ces problèmes, d’autant plus que le gouvernement de Boris Eltsine qui lui a succédé n’a guère fait mieux.
De plus, à la suite de la chute du régime, le bloc de l’Occident s’avance dans les anciennes républiques soviétiques en étendant l’OTAN. Cet élargissement perçu comme hostile par le président
Poutine est aussi critiqué par les Russes les plus ouverts, précise de nouveau monsieur Philaire. Bien que ce soit une alliance défensive et que ce processus soit démocratique, nombreux sont celleux qui considèrent cette alliance agressive et dangereuse, surtout lorsqu’elle inclut des pays précédemment sous le contrôle de l’URSS.
En bref, pour la plupart des Russes, le régime de Gorbatchev signifie la fin de la guerre froide, mais surtout la fin de l’empire russe et le début d’une crise économique et politique majeure.

Gorbatchev oublié
M. Lukic analyse cette perception de l’échec de Gorbatchev comme l’un des éléments expliquant la popularité du régime de Vladimir Poutine. Voilà un homme qui n’a pas peur de secouer l’Occident, qui veut réaffirmer la puissance russe et lui redonner sa gloire. À la différence de l’URSS, cette nouvelle puissance russe n’est plus communiste, l’idéologie est remplacée par le nationalisme ethnique.
Les mesures contre la propagande et la censure s’effacent également. En particulier depuis l’invasion de l’Ukraine, les journalistes et autres critiques sont muselés. Du souffle de liberté apporté par Gorbatchev, il reste aujourd’hui bien peu. Symbole particulièrement parlant, le 5 septembre, deux jours après son enterrement, le journal qu’il avait financièrement contribué à fonder, Novaïa Gazeta, s’est vu révoquer sa licence de publication imprimée en Russie. Le 15 septembre, il perd également sa permission de publication en ligne, le rendant du même coup indisponible en Russie.
La montée des tensions entre Moscou et l’Occident enterre définitivement ce qui reste de Gorbatchev avec la guerre en Ukraine. Si M. Philaire se fait plus prudent dans ses affirmations quant à un retour à la guerre froide, bien qu’il concède que le climat est tendu et que l’on pourrait y retourner dans les prochains mois, M. Lukic est plus direct « nous sommes retourné.e.s à la guerre froide », et qu’elle prend « sa forme la plus dangereuse pour la sécurité de la communauté euro-atlantique ». Nous sommes même, à ses dires, à un point tournant de l’histoire. « La mort de Gorbatchev coïncide avec la fin d'une époque historique qui commence avec la chute du mur de Berlin et se
termine avec la guerre en Ukraine, une époque d'une prospérité touchant l'ensemble de l'Europe. Durant ces 30 ans de coexistence pacifique, la Russie était traitée par l'Occident comme un partenaire, contrairement aux affirmations de Poutine. »
Alors que reste-t-il aujourd’hui de Gorbatchev ? Presque rien, peu importe l’opinion que nous avons de cet homme. Sa paix nous semble bien éphémère, la liberté russe recule, l’empire qu’il a tenté de sauver a éclaté, il ne demeure que l’amertume de ses critiques, nostalgiques de la puissante URSS, qui maudissent son échec.


Le roi Charles III : l’homme derrière la couronne
Le 8 septembre dernier, la reine Elizabeth II s’éteignait, passant ainsi le flambeau au roi Charles III. Son fils aîné de 73 ans, Charles Philip Arthur George, fut assermenté dans les jours suivants au titre de roi d’Angleterre. Portrait du nouveau monarque.
devenir pilote du Royal Air Force. C’est ainsi que commence sa carrière navale, inspirée de celles des hommes de la famille royale qui l’ont précédé. Il a ensuite servi sur le contre-torpilleur lance-missiles HMS Norfolk avant de devenir pilote d’hélicoptère pour l’escadron 845 de la force navale aérienne. À son retour de la force navale, le prince se consacre à des activités communautaires et sociales et devient notamment dirigeant de plus de 400 organisations principalement liées aux groupes militaires, au golf et à l’opéra (un vrai corpo).
Récemment, on le voyait surtout au chevet de sa mère ou aux activités de charité auxquelles elle n’était plus en mesure d’assister, ce qui a d’ailleurs facilité la transition, le fils étant de plus en plus visible dans la sphère publique avant de prendre le trône.
Ce qui le distingue
Pendant plusieurs années, le roi Charles III a été critiqué pour la transparence de ses positions concernant certains enjeux politiques. Ce ne sont pas les sujets en question qui semaient la controverse, c’est plutôt le fait de prendre position qui l’est, allant à l’encontre des principes de la famille royale réservée et prudente. Souvent considéré comme « activiste », il a d’ailleurs ouvertement soutenu la lutte aux changements climatiques et à la chasse au renard, l’armement des troupes en Irak tout en soutenant la démocratisation de la médecine alternative au Commonwealth et l’amélioration du système de santé anglais.
possession du roi Charles III jusqu’à la fin de son règne. Parmi ces actifs, on retrouve entre autres une multitude de domaines et palais valant de 72 millions à 4,9 milliards de dollars.
Ainsi, si l’Angleterre n’est pas épargnée par la crise du coût de la vie qui frappe le monde entier, le roi, lui, vient d’hériter d’une des plus grosses fortunes au monde, héritage sur lequel il ne paiera pas d’impôts. En effet, en raison d’un accord sur les transferts de propriété d’un souverain à un autre signé en 1993 avec le gouvernement britannique, la royauté y échappe.
Nous nous tournons finalement vers le roi, lui qui a jusqu’à présent vécu plutôt discrètement, et attendons de voir ce que son règne nous réserve avec comme seule certitude l’impossibilité que Charles III dépasse en terme de longévité celui de sa mère. Semblerait-il qu’elle ait emporté avec elle la pierre philosophale.
Références

UK Government. (s. d.). HRH the Prince of Wales. The Prince of Wales and the Duchess of Cornwall, https://www.princeofwales. gov.uk/biographies/hrh-prince-wales
UK Government. (s. d.). The Prince of Wales’s Patronages. The Prince of Wales and the Duchess of Cornwall, https://www. princeofwales.gov.uk/prince-waless-patronages?title=&page=8
Royal UK. (s. d.). The King. https://www.royal.uk/the-king
Son parcours
D’abord fils d’Elizabeth II, puis époux de la populaire Lady Diana Spencer et enfin père des princes William et Harry, le roi Charles III et maintenant roi, Charles III porte plusieurs nouveaux titres, tels que gouverneur suprême de l’Église d’Angleterre et chef du Commonwealth. Le roi est habitué aux multiples titres; dès l’âge de trois ans, il devient l’héritier de la nouvelle reine couronnée, Elizabeth II. Au même moment, le jeune prince devient le duc de Cornouailles, conformément à la charte royale établie par le roi Edward III (1312-1377).
Contrairement à plusieurs membres de la royauté qui préféraient faire l’école à la maison – ou plutôt, au palais – le jeune prince
a quant à lui suivi les traces de son père, et a fréquenté plusieurs écoles telles que la Hill House School dans l’ouest de Londres et le pensionnat de Cheam School à Berkshire. C’est d’ailleurs lors de son passage à Cheam que la reine l’a couronné prince de Galles, alors qu’il n’était âgé que de neuf ans – ce n’est toutefois qu’à l’âge de 20 ans qu’il fut officiellement investi de ce titre. Au même moment, il s’inscrit à l’Université de Cambridge pour y étudier l’archéologie et l’anthropologie, mais décide finalement de changer de domaine d’étude pour terminer son diplôme en histoire.
Par la suite, puisqu’un service militaire était obligatoire dans le cadre de ses fonctions de prince de Galles, Charles s’inscrit pour
Le roi Charles III est aussi sensible aux questions qui touchent l’architecture, à l’art en général, aux communautés rurales et à l’environnement. Ses positions lui ont d’ailleurs valu le titre de lobbyiste auprès du gouvernement britannique, grâce à ses mémos d’influence adressés aux dirigeant.e.s, ministres et politicien.ne.s britanniques. À ce propos, il s’est défendu en soutenant que, même si cela pouvait ressembler à de l’ingérence - ce qui, entre vous et moi, en est probablement -, il avait l’habitude de contester la « sagesse acceptée ».
Un héritage controversé
En plus d’être l’un des membres de la famille royale faisant le plus d’argent, le nouveau roi hérite de la fortune de sa mère, soit environ 500 millions de dollars. Cela ne représente qu’une infime partie de la fortune royale estimée à 28 milliards, sans compter la partie du patrimoine personnel des membres de la famille royale qui demeure privée. Le roi hérite également de plusieurs biens et actifs d’une valeur cumulée d’environ 42 milliards de dollars. Bien que ces actifs ne lui appartiennent pas personnellement, étant le « chef de la couronne », ils seront en
Tognini, G. (15 septembre 2022). How Rich Is King Charles III ?
Inside The New Monarch’s Outrageous Fortune. Forbes. https:// www.forbes.com/sites/giacomotognini/2022/09/15/how-rich-isking-charles-iii-inside-the-new-monarchs-outrageousfortune/?s h=1a623438757f
Suliman, A. (9 septembre 2022). Britain has a new monarch : What to know about King Charles III. The Washington Post. https://www.washingtonpost.com/world/2022/09/09/uk-kingcharles-iii-what-to-know/
Bradley, J., Ward, E. (13 septembre 2022). King Charles Inherits Untold Riches, and Passes Off His Own Empire
https://www.nytimes.com/2022/09/13/world/europe/king-charleswealth.html?smtyp=cur&smid=tw-nytimes+
Webber, E., Dickson, A. (15 septembre 2022). The tragedy of King Charles III. POLITICO. https://www.politico.eu/article/kingcharles-iii-politics-activism-monarchy-uk-public-service/
LUDIQUE
Rétro gaming, le retour à la bonne vieille époque

L’humain garde toujours une certaine curiosité pour ce qui est nouveau. La découverte de nouvelles expériences nous motive et nous fascine. Le film de l’année, le gadget dernier cri et la série de l’heure attirent les foules. D’un autre côté, l’on recherche également ce qui nous est connu et rassurant. Comme le.la voyageur.se vivant milles aventures en parcourant le monde, mais appréciant en particulier son chez-soi tranquille, le retour en territoire connu et à l’habituel nous apporte réconfort et quiétude. Là où le neuf et l’insolite apportent l’excitation, l’usuel et le familier apporte la paix. C’est pour ces raisons que nous aimons revenir vers ce que nous avons déjà vécu en relisant nos livres préférés ou réécoutant un classique du cinéma. En plus de la nostalgie qui peut l’accompagner et le fait de savoir que ces activités vont nous plaire, elles nous ramènent vers des expériences rassurantes. Dans le monde vidéoludique, rouvrir sa vieille console poussiéreuse pour se refaire un énième marathon de son jeu pixélisé favori, on appelle ça du rétro gaming, ou en français le rétroludique.

Pour plusieurs joueur.se.s, les jeux dont iels conservent les meilleurs souvenirs sont apparus durant une époque moins stressante de leur vie où leurs seules responsabilités consistaient à faire leurs devoirs et se brosser les dents. C’est pendant l’enfance et l’adolescence que l’on développe nos goûts, qu’ils soient littéraires, cinématographiques ou ludiques. Les œuvres avec lesquelles on entre en contact à cet âge sont décisives quant aux genres qui vont nous intéresser par la suite et elles gardent souvent une place spéciale pour nous. Le rétroludique, c’est donc souvent simplement de revivre ces rencontres avec des jeux qui nous semblent si importants, mais il y a plus.
Le rétroludique, en plus de regrouper l’ensemble des nostalgiques du deux dimensions, attire une foule de curieux.ses d’une époque révolue. Nous n’avons pas toustes pu vivre l’ère des bornes d’arcade, tout comme nous n’avons pas toustes eu la chance d’aller voir Les Temps modernes au cinéma. Cela ne nous empêche pourtant pas de pouvoir savourer le film. Nombreux
sont celleux qui s'adonnent donc au rétro pour visiter des jeux qui précèdent leur naissance, tant pour apprécier le jeu lui-même que pour constater l’étendue de son influence dans les médias.
Or, cette expérience est difficilement abordable. Alors qu’il suffit d’aller dans une bonne vieille bibliothèque pour trouver un Victor Hugo ou un Émile Zola, mettre la main sur une Neo Geo1 est bien plus ardu et bien plus onéreux. Bien que certain.e.s se fassent un plaisir à monter leur collection de bornes d’arcade, de consoles et de cassettes, les prix et l’accessibilité en rebutent plusieurs, de plus qu’il faille dénicher des téléviseurs compatibles avec ces antiques systèmes.
1 Consoles de 4e génération développée par la compagnie japonaise SNK en 1990. Disponible à la fois en version borne d’arcade et consoles de salon, c’est aujourd’hui l’une des consoles les plus difficiles à obtenir, les cartouches les plus rares peuvent parfois se vendre à plus de 1000 dollars.
Pour éviter ces contraintes, des joueur.se.s font appel à l’émulation. En utilisant certains programmes informatiques, il
est possible de simuler une console sur son ordinateur ou sur une autre de nos consoles. De cette manière, on peut avoir toutes les vieilles machines que l’on désire facilement. Il suffit ensuite de se procurer la ROM, c’est-à-dire les données d’un jeu. Ces codes sont cependant protégés par le droit d’auteur. Leur distribution est donc illégale, ce qui n’empêche pas plusieurs sites pirates d’offrir des liens de téléchargement aux intéressé.e.s.
Certain.e.s vont encore plus loin en allant reprogrammer la ROM. De cette manière, les fans apportent leur propre touche à leurs
jeux favoris, parfois en traduisant des jeux étrangers ou en proposant des retouches graphiques, d’autres fois en ajoutant des niveaux complets ou une histoire radicalement différente du scénario original. Ces modifications permettent aux joueur.se.s d’aller au-delà de ce que les développeur.se.s avaient prévu et de revisiter des classiques d’une manière complètement nouvelle, tout en gardant la base unique du titre.
Les boites de développement, bien au fait de cette masse avide de rétro, proposent à leur tour de redistribuer leurs meilleurs jeux tirés des anciennes générations. Nintendo, doté d’un long catalogue de jeux rétros dont plusieurs francs succès, offre avec ses abonnements en ligne l’accès à de multiples titres de NES, SNES et, pour un extra, Nintendo 642. On crée aussi de plus en plus de portages et de remake, par exemple celui de Final Fantasy 7 ou de trois premiers Spyro disponibles sur Steam.
2Ces trois consoles marquent tour à tour leur génération. D’abord la NES (Nintendo entertainment system) en 1983. Après un succès retentissant au Japon, elle a droit à son lancement en Amérique du Nord en 1985 où elle revitalise le marché américain qui traverse alors une crise. La SNES (Super Nintendo entertainment system) arrive pour sa part en 1990 et la Nintendo 64, en 1996, marque l’arrivée du trois dimensions.
Nostalgie, certes, mais pas que
On parle de nostalgie en évoquant le rétroludique, oui, mais la vieille époque des bornes d’arcades, du 16-bit puis du début du trois dimensions, c’est bien plus que quelques souvenirs. D’abord, chaque génération de console apporte sa propre esthétique, certainement vieillotte, mais qui sait tout de même garder son charme. Poussé.e.s par les limitations techniques des consoles, les artistes devaient travailler avec des moyens extrêmement réduits pour traduire leur vision, pixel par pixel. Le pixel art est aujourd’hui marginal, les jeux à gros budget préférant se doter de graphiques toujours plus réalistes. Pourtant, réalisme ne rime pas forcément avec beauté : les pixels arts colorés rendent parfois bien mieux que la terne réalité.

La musique suit le même parcours. Les obstacles techniques des premières consoles permettaient peu de son simultanément et poussaient à bout la créativité des compositeur.rice.s. Malgré ces restrictions, plusieurs des thèmes les plus iconiques du jeu vidéo ont fait leur apparition lors de cette période. Bien sûr, personne ne souhaite vraiment troquer les orchestres grandioses que la technologie moderne nous permet d’apprécier pour de modestes chiptunes. Néanmoins, la disparition quasi complète de ce genre est regrettable pour plusieurs.

Toutefois, c’est avant tout l’originalité de ces antiquités qui amène les passionné.e.s à effectuer un retour en arrière. À l’époque, les codes du jeu vidéo ne sont pas encore bien définis. Les dévelopeur.se.s doivent elleux-mêmes inventer les règles entourant leur création. Rien n’est admis d’avance et tout peut être fait. Certes, cela signifie que certains choix de design seront douteux, mais d’autres seront parfaitement uniques. En bref, il n’y a pas de moule et cela force la créativité. Chaque nouvelle sortie peut impliquer la naissance d’un genre inédit ou l’apparition d’une série à succès. Le passage aux trois dimensions apporte à son tour son lot de questions, par exemple comment gérer les mouvements ou où mettre la caméra, mais éventuellement on répond à ces questions. Progressivement, les jeux deviennent semblables, les mécaniques se répètent et les grands studios pariant des millions de dollars sur leurs gros titres n’osent plus prendre autant de risques.
De plus, avec la transition aux trois dimensions, certains genres uniques aux jeux deux dimensions seront laissés de côté par les compagnies. Par exemple, les rails shooter3 ont presque complètement disparu et demeurent confinés à quelques vieilles bornes d’arcades.
3Le rail shooter est un sous-genre du jeu d’action où le ou la joueur.euse ne contrôle que l’arme du personnage en suivant un parcours prédéfini comme s’iel était sur un chemin de fer.
pas plus à Red Dead Redemption 2 qu’aujourd’hui et si on les estime tous deux comme rétro, ce sera dans des cases bien séparées, car ils n’évoquent simplement pas du tout la même ère.
uniques qui ont marqué toute une génération. Le nouveau rencontre le vieux, une sorte de mariage entre classique et moderne, au plus grand plaisir des nostalgiques.
En raison de tout ce qui entoure le rétroludique, on peut avancer que ce n’est pas qu’une question de nostalgie et même que ce n’est pas non plus une question de temps. En effet, on considère que les consoles de sixième génération (Game Cube, Xbox, Playstation 2) sont modernes, alors que celles venues avant sont rétro. On pourrait logiquement s’attendre à ce qu’avec le temps, cette frontière recule et qu’un jour viendra où jouer à Elden Ring sera de l’ordre du rétro ludique. Cependant, considérant les aspects bien particuliers qui enveloppent ces 5 premières générations de consoles, je crois que la délimitation restera assez claire. Dans 40 ans, Mario Bross ne ressemblera
On se rappelle souvent que ces vieilles périodes donnaient naissance à de bien meilleurs jeux que ce qui se fait de nos jours, et c’est l’impression qui peut se dégager de cet article, quoique, bien franchement, ce serait ingrat envers nos créations modernes. Bien que l’on se passerait avec joie de beaucoup d’éléments associés aux titres récents, notamment l’abus de microtransactions, il ne faut pas oublier que la ``bonne vieille époque`` avait aussi ses défauts, même si l’on se souvient plus facilement de l’excellent GoldenEye ou Metroid que de l’exécrable Superman 64. Cela nous amène à une vision idéalisée de ce passé.
Heureusement pour les fans du rétro, les petits studios redonnent vie à certains genres abandonnés par les grand.e.s joueur.se.s de l’industrie. En plus de viser un public de niche négligé, cette approche leur permet d’économiser sur les graphiques et les effets sonores. Cette forme de néo-rétro ressuscite ces éléments
























ÉMISSIONS QUOTIDIENNES
Chéri.e, j’arrive ! Chéri.e, j'arrive! sort les musicien.ne.s indie de l'ombre en plus de dresser la liste des expositions, des films, des pièces ou des spectacles à voir dans les salles de la Vieille Capitale au jour le jour. La scène locale, c'est leur spécialité.
Un rendez-vous à mettre à vos agendas tous les jours en semaine de 16 h à 17 h 30.
Les Affamé.e.s
Les Affamé.e.s, c'est l'émission d’informations concoctée par l’équipe de CHYZ, tous les midis en semaine de 12h à 13h. Au menu : actualités, chroniques et débats. L’occasion idéale pour faire le plein d'informations et ne rien manquer de ce qui se passe à Québec et ailleurs.
Les Arshitechs du son Depuis plus de 20 ans, Les Arshitechs du son représentent la référence en matière de hip-hop à Québec. C'est un rendez-vous dès 17h30 du lundi au vendredi !

NOUVELLES ÉDITIONS
Cabaret du crachoir (émission de lecture) animé par Patrick Couture tous les lundis de 11 h à 12 h.

Popanalyse (émission de discussion) animé par Jessica Poirier-Roy et Zachary Trottier tous les jeudis de 14 h à 15 h.

Boisvert radio (émission sportive) animé par Charles Boisvert tous les mardis de 21 h à 22 h.


Le temps d’un gin to’ (émission de discussion) animé par Rosalie Chabot tous les vendredis de 14 h à 15 h.

Droit de parole (émission sur le droit) animé par Andréanne Lamonde tous les jeudis de 13 h à 14 h.


LSDJ ! set (performance DJ) performance de Léa Mimault tous les derniers dimanches du mois de 21 h à 22 h.


LES VIEILLES DE LA VIEILLE
Écoute local (découvertes et entrevues musicales) animé par Émilie Rioux et Guillaume Pepin tous les lundis de 13 h à 14 h.

Beatnick radio (sélection musicale hip-hop) animé par Nicolas Leclerc tous les lundis de 18 h 30 à 19 h 30. Le backpacker (nouveauté hip-hop) animé par Jean-René Boutin tous les lundis de 19 h 30 à 20 h 30.



Sons de cloches (émission de poésie et de philosophie) animée par Augustin Betchi tous les jeudis de 9 h à 11 h. Le réshow : deuxième service (émission d’actualité) animé par Alex Baillargeon tous les vendredis de 11 h à 12 h.


Jeunes et aînés solidaires (émission de discussion sociétale) animé par Mélina Seymour tous les samedi de 11 h à 12 h.
Démineur (découverte musicale) animé par David Goulet tous les lundis de 21 h à 22 h.

Radio futura (émission musicale et d’information) animé par Israel Alvarez tous les samedis et dimanches de 13 h à 16 h.
Punk détente (émission punk/rock) animé par Émilie Plamondon tous les mardis de 18 h 30 à 19 h 30. Thrashcrowd (émission métal) animé par Mathieu Dallaire tous les mardis de 20 h à 21 h.
Salon bleu (émission politique) animé par Dan Edmunds et Karine Lacoste tous les samedis de 17 h à 18 h. Deep sauce (émission musicale) animé par Dan Edmunds tous les samedis de 18 h à 19 h.


3600 secondes d’histoire (émission sur l’histoire) animé par Alex Tremblay tous les mercredis et dimanches de de 18 h 30 à 19 h 30.
Funk connection (sélection musicale instrumentale) animé par Louis Larochelle–Prégent et Gabriel Mercier-Blouin tous les mercredis de 19 h 30 à 21 h 30.


Des kiwis et des nerds (émission de discussion) animé par Jérémie Thibault tous les dimanches de 12 h à 13 h.

10 entre nous (émission culturelle) animé par Ève et Geneviève tous les dimanches de 20 h à 21 h.

ARTS ET CRÉATION
Sorties littéraires
Par
cheffe de pupitre aux arts
Quatrième de couverture : Alors que les flots sombres et menaçants de la rivière submergent Perdido, une petite ville du sud de l’Alabama, les Caskey, une riche famille de propriétaires, doivent faire face aux innombrables dégâts provoqués par la crue. Mené par Mary-Love, la puissante matriarche, et par Oscar, son fils dévoué, le clan s’apprête à se relever. Mais c’est compter sans l’apparition, aussi soudaine que mystérieuse, d’Elinor Dammert, jeune femme séduisante au passé trouble, dont le seul dessein semble être de s’immiscer au cœur de la famille Caskey.

Quatrième de couverture : La nuit ce ne sont pas les chaleurs qui me réveillent mais la honte, et cela dure depuis des mois. Le plus dur, c’est que je sais qu’elle est là depuis longtemps. Je l’ai combattue. Il y avait en moi quelque chose de vague, une sorte de malaise. Je le savais mais je compensais par le calme apparent, les vêtements bien coupés, même la langue que je parlais. Une sorte de langue beige, sans accent, sortie tout droit du bon parler français évitant à tout prix l’accent régional dont Éli se moquait. Le soir au souper, il imitait les secrétaires, les étudiants. Dans cet autobus, assise seule derrière le banc du chauffeur comme toutes les vieilles dames, je me rends compte que je n’ai plus la force de lutter contre ma honte, ni celle de lutter contre ma haine. Les cinq nouvelles qui composent ce recueil présentent une frappante unité. Elles constituent en quelque sorte autant de variations sur une poignée de motifs : la venue de la vieillesse, la rupture amoureuse, la perspective de la mort, chaque fois vécues et profondément ressenties par des femmes. Cette traversée de ce qu’on conçoit souvent comme le versant sombre de la vie, ce lent et obstiné travail de décodage du renoncement, cet implacable exercice de lucidité, que Lise Tremblay mène à l’aide d’une prose coupante comme un scalpel, agissent sur nous à la manière d’un exorcisme et débouchent, de façon aussi certaine qu’inattendue, sur un profond sentiment de libération, sur une inaltérable sérénité.

Fragile comme une bombe - Catherine Lavarenne - VLB Éditeur

Quatrième de couverture : C'est à la veille des élections que Stéphanie Goyer, écrivaine de métier, a rejoint le parti de gauche qui l'a emporté, contre toute attente. Malgré son inexpérience, on lui a offert le ministère de la Culture. Alors qu'elle cherche ses repères dans le tourbillon de la vie politique, une vague de dénonciations s'abat sur le milieu littéraire, y fustigeant les marques de la culture du viol. Peu à peu, Stéphanie voit se dessiner des liens entre sa propre expérience et celle des survivantes qui osent briser le silence.
On écoutait MusiquePlus - Marie-Josée GauvinDu parc en face
Quatrième de couverture : On n’avait rien d’exceptionnel. On n’était pas wild comme les filles de SainteJeanne d’Arc, ni belles comme les filles de Dolbeau. Sophie drummait en cachette sur Rage Against The Machine, Catherine se sentait invisible, Becca haïssait la Chicane et moi, je voulais aimer comme dans #1 Crush de Garbage. Non, on n’avait rien d’exceptionnel, mais on s’avait, toutes les quatres.
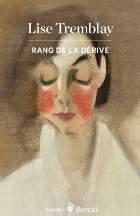
Et le plus clair de notre temps, on écoutait MusiquePlus.

Tout ce que j’ai fait pour ne pas quitter ma chambre –Entretien avec Valérie Roch-Lefebvre

Après son premier roman, Bannie du royaume, Valérie Roch-Lefebvre continue d’explorer le sujet de la maladie mentale avec Tout ce que j’ai fait pour ne pas quitter ma chambre, paru chez La Mèche au cours de l’été 2022. Je l’ai déjà écrit par le passé, mais la lecture de ce roman est tout sauf simple : l’autrice y traite de thématiques fortes, avec une dureté qui vous obligera plus d’une fois à fermer votre livre pour respirer. Malgré sa rudesse de ton, le roman, à mi-chemin entre le fragment et l’autofiction, a le mérite d’être sincère, son autrice abordant l’abîme de la maladie mentale avec sensibilité et justesse. Un bel exercice d’empathie.
Par William Pépin, journaliste multimédia« Dans mon ancienne chambre, je me traitais des pires noms sans en envisager les conséquences. J’aurais voulu disparaître avant le début de l’âge adulte, avant ce point de non-retour où je suis maintenant enfermée. » Ces mots, trônant au sommet de la quatrième de couverture, nous frappent avant même que l’on ait feuilleté la première page. La détresse adolescente donne le ton à ce roman doublement initiatique, où nous sommes confronté.e.s à la fois à l’injustice de l’héritage génétique et à la pleine mesure du portrait que brosse Valérie Roch-Lefebvre de la maladie mentale. Ici, aider l’autre à s’aider est cause perdue : on doit observer, derrière le mur des pages, le poids de notre impuissance. Mon objectif avec ce texte n’est pas de vous imposer un horizon d’attentes particulier ou même de vous aider à avaler la pilule d’une lecture qui fait mal, mais plutôt – et c’est bien égoïste de ma part – d’exprimer une manière bien personnelle d’aborder l’œuvre, d’y reconstituer un sens après qu’elle m’ait happé du poids de ses quelque 123 pages.
Pour reconstituer ce sens, j’ai eu l’immense honneur de m’entretenir avec Valérie Roch-Lefebvre, à peine un mois après ma première lecture de Tout ce que j’ai fait pour ne pas quitter ma chambre. Encore sous le choc, même après plusieurs semaines, l’autrice m’a aidé à y voir plus clair dans sa démarche d’écriture. De plus, je lui ai proposé d’orienter notre conversation autour de la thématique de l’injustice du legs, centrale dans le roman. D’emblée, plusieurs questions complexes s’imposent, questions qui resteront toutefois sans réponse en ce qui nous concerne : si nous n’avons aucun contrôle sur ce qu’on nous lègue dès notre naissance, comment ne pas nous considérer comme déterminé.e.s, comme pensé.e.s? En d’autres mots, est-ce possible de s’extirper d’une condition que nous n’avons pas choisie et qui semble étouffer toute possibilité de libre-arbitre? Qu’est-ce que l’on peut faire de ce qui nous est imparti pour espérer voir un jour la lumière au bout du tunnel? Ces questions, j’en conviens, sont imparfaites, mais elles m’aident à orienter ma lecture de l’œuvre de Valérie Roch-Lefebvre, où la crise d’identité, la bipolarité, les pensées suicidaires et le sentiment qu’il n’y a ni lumière, ni tunnel, se côtoient dans un tourbillon noir qui, rarement, se dissipe pour nous laisser envisager la voie de la guérison.

Impact Campus : D’emblée et parce que je suis curieux : quelles sont tes inspirations littéraires?
Valérie Roch-Lefebvre : Il y en a plusieurs, mais Élise Turcotte et Christine Angot sont, dans mon cas, des écrivaines incontournables; elles sont de celles qui m’aident à la fois à écrire et à vivre. Leurs œuvres, qui dénoncent chacune à leur façon les injustices et les violences, ont sur moi un grand effet de guérison.
Sinon, plus récemment, Grosse de Lynda Dion et Autobiographie de l’étranger de Marie-Eve Lacasse m’ont vraiment fait vibrer. Je sens que ces deux livres me montrent la marche à suivre pour le prochain projet.



« Mes débuts à l’hôpital me manquent. Je m’ennuie de l’époque où je représentais, aux yeux de mes collègues, une simple silhouette en deux dimensions. C’était avant que je marque de mon empreinte l’ensemble des objets sur l’étage – téléphones, claviers, chaises et écrans sur lesquels je crache sept heures par jour, cinq jours par semaine. »
I.C. : Es-tu en mesure de me raconter la genèse de Tout ce que j’ai fait pour ne pas quitter ma chambre ?


V. R.-L. : À la parution de Bannie du royaume, mon premier livre paru en 2019, je suis devenue très honteuse d’avoir pris la parole en public de cette façon. Ça m’a frappée d’avoir aussi honte de moi à l’âge que j’avais. Je me sentais vraiment comme quand j’avais quatorze ans. J’ai ressenti le besoin de me reconnecter à cette période de ma vie par l’écriture. Je dois aussi mentionner que l’image d’une adolescente enfermée dans sa chambre, mangeant dans son lit et dormant avec un couteau me hantait depuis longtemps et que j’avais très envie d’en faire un livre.
Parallèlement à ça, j’occupais un poste de téléphoniste dans un grand hôpital et je m’enfonçais dans l’épuisement professionnel sans le savoir. Le livre s’est donc écrit dans l’urgence, mais aussi dans la pure joie de l’écriture, de la forme qui se déploie.
I.C. : La question de la santé mentale est centrale dans ton roman, tout comme sa dimension héréditaire. Qu’est-ce qui t’a amené à explorer cet aspect plus sombre du legs, aussi injuste et involontaire soit-il? Est-ce que ton roman est une manière de composer avec l’injustice du legs?
V. R.-L. : Penser que des parents transmettent à leurs enfants des maladies alors qu’ils ignorent souvent en être atteints me bouleverse. J’y vois là, effectivement, une grande injustice. Bien sûr, cette injustice est en partie causée par nos structures sociales, peu adaptées aux personnes hors-normes, incapables de travailler à temps plein par exemple. D’un autre côté, la narratrice a l’impression d’être née sale, contaminée et déjà condamnée, comme si rien ne pourrait la sauver. Dans un passage du livre, la maladie est décrite comme une entité ayant pris le père en otage ainsi que sa fille; quelque chose qui a colonisé leur esprit. Au-delà de la psychophobie incrustée dans notre société, il y a quelque chose de profondément injuste dans la maladie elle-même et c’est ce que je voulais mettre de l’avant.
« La maladie de mon père s’est emparée de moi quand j’ai eu douze ou treize ans, après que j’ai eu emménagé dans la chambre au murs blancs. Le trouble bipolaire a pris en charge mon identité et mon avenir. Celui-ci, entre les mains de ma mère, serait resté en suspens, incapable de s’ériger. »
I.C. : Dans ton roman, la figure de la mère est à la fois centrale et en retrait. Comment t’expliques-tu le rapport entre la narratrice et sa mère?
V. R.-L. : La narratrice se méfie constamment de ses pensées, ce qui rend les personnages, notamment la mère, ambigus. Dans ma perception, on a d’ailleurs à faire moins à des personnages qu’à des projections mentales générées par la narratrice, presque des motifs. La narratrice se demande sans arrêt si elle a vraiment vécu ce qu’elle a vécu et diminue sa propre expérience. Je crois que c’est assez commun lorsqu’on a vécu de la violence jeune sans qu’elle ne soit validée. La mère incarne le silence et l’isolement dont souffre la narratrice à l’adolescence mais aussi à l’âge adulte. On devine la mère prise dans une spirale de violence conjugale, mais puisque cette réalité n’a jamais été confirmée à la narratrice, le doute demeure dans son esprit.
Aussi, la narratrice désire fortement l’amour et l’approbation de sa mère tout en étant révulsée par sa seule présence. Je trouvais que l’envie d’être aimée par ses parents tout en les trouvant insupportables rendait bien un certain type de malaise propre à l’adolescence.
« Lorsque j’étais enfant, savoir que je verrais ma mère me permettait de tenir jusqu’à la fin de semaine. Son nouveau conjoint était envahissant, grimpant dans son cou à la manière d’une araignée, mais au moins je n’existais pas pour lui, ce qui me reposait de mon père. »
I.C. : Tout ce que j’ai fait pour ne pas quitter ma chambre est émaillé de référence à The Virgin Suicides, film de Sofia Coppola. Était-ce une manière d’introduire dans le réseau thématique du livre ton propre bagage culturel et si oui, qu’estce que t’évoque ce film ?
V. R.-L. : The Virgin Suicides est probablement l’œuvre qui m’a le plus marquée dans ma vie, tous mediums confondus. J’ai découvert ce film à l’adolescence, à l'instar de ma narratrice et, comme elle, j’ai entretenu un rapport d’identification très fort aux sœurs Lisbon.

Alors que j’avais des idées noires, les voir se tuer un nombre incalculable de fois m’a sûrement aidée à rester en vie, par effet de sublimation.
Je n’étais pas seulement happée par le destin sombre des personnages, mais aussi par le travail de Sofia Coppola : sa façon brillante de laisser parler le silence, son esthétique à la fois léchée et chargée d’affects, les touches d’humour dont elle parsème le film. Elle m’a donné ma première grande leçon de création. L’intégrer à un livre était un grand fantasme d’écrivaine.
« J’ai l’âge de toutes les sœurs simultanément : treize, quatorze, seize et dix-sept ans. Je leur raconte mon arrivée dans cette chambre. C’était hier. J’avais douze ans : une enfant. Elles m’incitent à parler de moi avec indulgence. Je baisse ma garde. »
Dépeindre l’isolement : un dernier retour à mes premières impressions
Pour tenter d’encapsuler l’essence de Tout ce que j’ai fait pour ne pas quitter ma chambre, je dois me référer au premier texte que j’ai écrit sur le roman, où mes impressions de ma lecture étaient encore vives. J’avais écrit que « [l]’esprit de ce roman, c’est l’art de son autrice de nous cloîtrer dans la souffrance en apparence sans issue de sa narratrice. » J’avais alors qualifié ce texte de « huis clos mental », puisque c’est « tout sauf indemne que l’on termine notre lecture, tantôt prisonnier de la chambre d’une adolescente en quête d’une mise à mort à la Virgin Suicides , tantôt du travail de la narratrice toujours à la recherche d’une échappatoire qui l’effacerait à jamais du regard des autres ».
Valérie Roch-Lefebvre, La Mèche, Montréal, 2022, 123 pages.

Coups de coeur littéraires de l’été 2022
Si la rentrée littéraire est un événement où l’on s’attend à une avalanche de nouveautés littéraires, j’ai appris avec les années qu’il ne fallait pas sous-estimer la saison estivale qui, certes, est moins chargée sur le plan littéraire, mais qui fait naître tout de même plusieurs textes sur lesquels je me suis déjà penché dans les derniers mois, mais que j’aimerais lister ici au cas où vous auriez manqué une de ces lectures.
 Par William Pépin, journaliste multimédia
Par William Pépin, journaliste multimédia
Tout ce que j’ai fait pour ne pas quitter ma chambre – Valérie Roch-Lefebvre – La Mèche « Si le roman est plutôt court, dépassant à peine la centaine de pages, j’ai dû m’arrêter à de nombreuses reprises pour respirer, pour prendre la pleine mesure de la réalité que nous partage Valérie Roch-Lefebvre. L’autrice y traite notamment de la question de la maladie mentale, en peignant avec minutie le portrait de cette femme ayant hérité, tout comme son père, du trouble bipolaire. D’autres sujets se mêlent à l’ensemble, comme le suicide ou encore les troubles alimentaires, que l’autrice manie avec une âpreté sans doute nécessaire pour que l’on saisisse avec justesse la douleur de la narratrice. Les mots s’incrustent en nous telle une lame qui nous déchire le ventre de sa pointe sournoise, mais souvent nécessaire pour que l’on puisse s’ouvrir à une réalité qui n’est pas forcément la nôtre. Valérie RochLefebvre nous rappelle ainsi, sans doute sciemment, le rôle fondamental de la littérature : celui d’être avant tout un exercice d’empathie. »

Le chemin d’en haut – J.P. Chabot – Le Quartanier « C’est avec surprise que j’ai parcouru les premières pages de ce chemin d’en haut : rares sont les récits qui vous emportent dans une spirale émotionnelle aussi belle que chirurgicalement décousue. C’est par le sentier sinueux du deuil que Jean-Philippe Chabot nous ramène à la terre, dans cette zone empreinte d’une nostalgie amère, lieu que l’on souhaite souvent quitter pour s’épargner une quelconque souffrance et, paradoxalement, que l’on désire parfois retrouver pour y reconstruire une vie par-dessus les cendres de celles qui précèdent. Difficile, parfois, de ne pas y voir l’héritage d’une prose ferronnienne, à la fois orale, sombre, dense, mais pourtant si lucide.


La narration se déploie par spasmes, avec ces éclats mémoriels qui nous propulse d’une situation à l’autre, avec ce talent qu’a Jean-Philippe Chabot de créer des images à la fois percutantes et lointaines, des échos de vie à notre portée tout en étant souvent insaisissables. C’est d’ailleurs un roman qui gagne à ce qu’on lui accorde une deuxième lecture : l’humanité transpire de ces pages. »
Couchés en étoile dans la combustion lente des jours – Sophie Jeukens – Ta Mère

« Plus qu’un recueil de poésie, Couchés en étoile dans la combustion lente des jours est également une sorte de carnet de voyage, où la poète exploite (entre autres) maintes turbulences affectives tout en y déployant une sensibilité littéraire exceptionnelle.
On y fait doucement le tour du monde : de Marseille à Chicago, de Portland à Sherbrooke en passant par la Martinique, nous terminons notre course dans la cuisine de la poète, dans l’espoir d’un ailleurs sans fumée. Pour ma part, c’est la première fois que je tombe sur une œuvre de Sophie Jeukens, à la fois surpris et un peu coupable d’être passé à côté d’un tel talent. »
Que ceux qui m’aiment me sauvent – Alexandre Dostie – Ta Mère
Le deuil amoureux qui tache juxtaposé à la l’effondrement psychologique d’un condamné à la mélancolie font le charme de ce Que ceux qui m’aiment me sauvent. Véritable Chauffer le dehors claustrophobe, qui troque le rapport au territoire pour une fouille intérieure n’ayant de fond que la médiocrité humaine – mise en mots dans des tournures tout saufs médiocres — Dostie évoque les ténèbres avec intelligence et sensibilité sans toutefois éteindre définitivement la flamme. Cette dernière est là, quelque part au fond des pages, entre deux aigreurs versifiées. Oui, ma comparaison avec le recueil de Marie-Andrée Gill est sans doute plus inopportune qu’audacieuse, mais que voulez-vous : à chacun ses impressions de lecture. Je suis d’avis que deux œuvres peuvent — consciemment ou non — dialoguer entre elles sans avoir (a priori) de liens apparents ou une contiguïté quelconque.
Il s’agirait de parler des mères majuscules, des mères dictionnaires. Le texte (peut-être qu’il prendrait vaguement la forme d’un dialogue) évoquerait la peur, la honte : dirait les grandes plaques de tôles enfoncées par amour dans ma gorge. Il faudrait le titrer de manière équivoque et citer, après le premier paragraphe (qui somme toute serait assez court), quelque ouvrage théorique : brouiller les pistes.
Par Myriam Coté, journaliste collaboratriceDans un entretien accordé à Thérèse Dumouchel et Marie-Madeleine Raoult des Éditions de la Pleine Lune, Luce Irigaray suggérait en 1981 que « si les mères pouvaient être des femmes, il y aurait tout un mode de relation de parole désirante entre fille et mère… qui remanierait complètement la langue qui se parle maintenant ». Contre l’ordre patriarcal et son discours hégémonique, l’établissement avec nos mères « d’un rapport de réciprocité de femme à femme, où elles pourraient aussi éventuellement se sentir nos filles » faciliterait l’émancipation de l’autorité du père (que celle-ci soit réelle ou symbolique), en plus de faire advenir des formes inédites du dire dans une logique textuelle qui leur a toujours été austère.
Si l’entretien en question date d’une quarantaine d’années, l’idée n’est pas étrangère aux écrits ultérieurs de la théoricienne, pas plus qu’elle n’est allochtone à la recherche littéraire contemporaine. À cet effet, on ferait bien de noter que Lori Saint-Martin consacrait il y a un peu plus de vingt ans tout un ouvrage à la triade mère-fille-écriture, ouvrage qu’elle titre Le nom de la mère et dont les premières lignes ont tôt fait de nous rappeler que pendant que « le nom du père… tout le monde le connaît », « celui de la mère est inconnu ». De nom à elle, explique encore Saint-Martin, la mère « n’en a pas » : davantage, elle n’en a jamais eu.
Il s’agirait de parler de la mère (la mienne), de dire qu’elle ne me laisse pas l’appeler par son prénom. Le texte (serait-ce la préface parfaite pour un livre de recettes?) dirait la peau sèche de celles qui s’épuisent, les mains rondes sur les ventres : celles qui très tôt apprennent aux jeunes filles à mettre la table, à faire la vaisselle dans l’appartement des amants pour qu’ils oublient que j’existe.

Quatre ou cinq lignes avant son retour à la théorie, le texte échapperait quelque pronom personnel, égarerait la neutralité. Le cas échéant, il devrait prendre son pouls : se séparer encore du sujet de l’énonciation. Pour mieux lui revenir ?
Question de clarifier cette amorce, on pourrait retracer dans un premier temps le paradoxe bien connu de la femme ayant pour
nom de jeune fille celui de son père, un nom auquel elle ne pourra jamais substituer que celui d’un autre homme – les noms de la famille n’étant peut-être que cela, semble vouloir nous dire Saint-Martin : des noms d’homme transmis puis perdus de mère en fille.
Mais cette carence qu’adresse l’autrice en début d’ouvrage (un défaut nominal, je le répète, qui serait propre au maternel) met également en évidence dans l’allégorique tout le drame qui guette dans une société patriarcale les relations mères-filles. Ainsi, pour Saint-Martin (comme pour Irigaray avant elle), ni les mères, ni les filles ne sauraient spontanément comment s’adresser les unes aux autres : anonymes, elles ne communiqueraient que de manière hésitante, et par le biais toujours d’un troisième terme (ici l’époux ou le père, quand il ne s’agit pas de la loi qui les devance l’un et l’autre et qu’ils finissent, plus souvent qu’autrement, par reconduire).
Pourtant. Bien que défaillant, ce lien à la mère en tant que sujet désirant semble constituer un des prétextes les plus courants à l’écrit féminin – aussi Daria Colonna écrivait-elle l’année dernière que « la main de la mère, c’est le début de l’écriture » et encore que « ce sont les mains des mères qui font écrire leurs filles ». Au sujet de sa propre mère, Saint-Martin conviendra d’ailleurs dans un récit autobiographique qui n’a pas encore deux ans : « Il y a longtemps que je sais que ma vie est issue de son ambition frustrée, de l’ambition qu’elle a injectée dans mes veines comme un poison ou son antidote.... N’est-ce pas sa main, plutôt que la mienne, qui a écrit mon destin? Le vide de ma mère a rempli ma vie. »
Il s’agirait de se demander comment faire, quand de mère en fille on a appris à ne pas faire de bruit. Comment écrire quand je n’ai pas été la sienne, à peine celle de mon père (que font les filles patriarcales sinon s’engendrer elles-mêmes ; que font les filles qu’on viole sinon se fendre selon leurs propres termes).
Peut-être faudrait-il dire (mais qu’est-ce que cela voudrait dire?) que dans le discours, les amants auxquels je retourne bégaient ou hésitent (ce que la Mère ne fait jamais : la mère se corrige, elle est toujours correctrice de quelque chose).
En principe, le texte devrait incarner cette impossibilité ou ce paradoxe : pour dire la mère, pour la dire vraiment, il faut la trahir. Pour dire ma mère, il faut me réclamer de l’hésitation qu’elle m’a refusé : oublier dans quel sens j’écris, dans quelle direction; écrire comme on cherche à tâtons.
Ce texte qui n’en est pas un pourrait se terminer sur une autre citation de Saint-Martin, citation qui en expliquerait en partie le titre: « la fatigue de la mère atteint très vite la fille… conditionne chacun de ses gestes… au mutisme de la fille correspond celui de la mère ».
Ce silence qui ne m’appartient pas porte sans doute le nom de ma mère
Mettez du développement durable dans votre formation

Apprenez comment intégrer le développement durable dans votre domaine et dans votre future carrière.
Devenez un vecteur du changement.
Pour en savoir plus ulaval.ca/developpement-durable/enseignement-et-recherche
