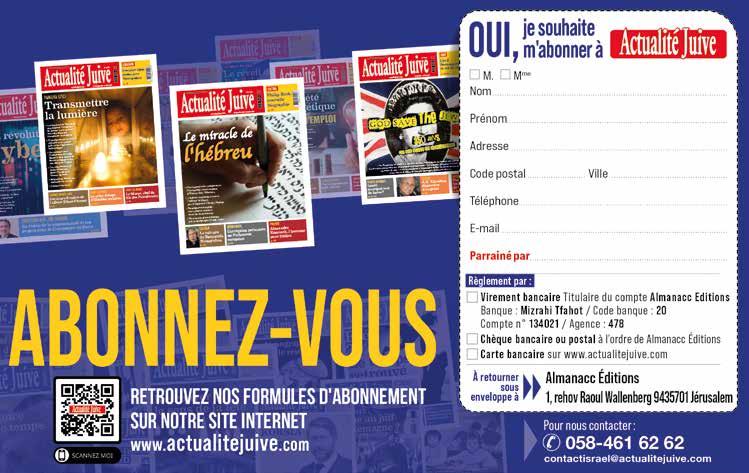Jeudi 5 décembre 2024
4 Kislev 5785
Nº 1015 | Mensuel
INTERVIEW
QUI EST LA DÉPUTÉE
CAROLINE YADAN ?
DOSSIER
LE CINÉMA
ISRAÉLIEN : RÉTROSPECTIVE ET AVENIR
GRAND ANGLE
GRAND-RABBIN
D'ISRAËL : FONCTION OU MISSION ?
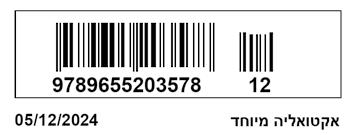


Jeudi 5 décembre 2024
4 Kislev 5785
Nº 1015 | Mensuel
INTERVIEW
QUI EST LA DÉPUTÉE
CAROLINE YADAN ?
DOSSIER
LE CINÉMA
ISRAÉLIEN : RÉTROSPECTIVE ET AVENIR
GRAND ANGLE
GRAND-RABBIN
D'ISRAËL : FONCTION OU MISSION ?
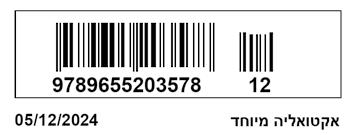

Sur les terres brûlées du Liban, du côté israélien de la frontière, on observe cet arc-en-ciel. Rappel de la destruction et promesse d’un avenir plus serein. On n’ose y croire. Laminés par la guerre, jamais les Israéliens n’ont été aussi suspicieux face à la paix. Comment en sommes-nous arrivés là ?
Même l’idée de voir revenir nos valeureux combattants ne suffit pas à nous emplir totalement le cœur d’allégresse.
Se dire que le Hamas, abandonné par le Hezbollah – sous-fifre de l’Iran –, doit se sentir seul et déçu nous procure juste une méchante petite joie. En notre for intérieur, nous sommes bien trop échaudés pour accorder une quelconque confiance à ces lâches ennemis qui ont pilonné des cibles civiles pendant un an.
Bien trop meurtris, aussi, pas les embargos non officiels de l’Amérique. Et les déclarations soufflant le chaud et le froid (plus souvent le froid) de la France qui s’est imposée dans la conclusion de ce cessezle-feu pour se prouver qu’elle a encore un poids dans la balance internationale, vieille réminiscence de son ancienne splendeur au Moyen-Orient – et ce, alors qu’elle n’a pas réussi à arracher un seul otage aux terroristes voleurs et tueurs d’enfants.
On ne parlera pas de la Cour Pénale de l’Injustice (dernière une d’Actualité Juive)…
Reste donc à se concentrer sur les couleurs de ce timide arc-en-ciel. Un phare dans l’obscurité, une direction vers laquelle s’orienter pour espérer et comprendre que finalement nous ne comprenons rien. Après, tout, n'est-il pas surnaturel d’imaginer la vive lumière du soleil au plus profond de la nuit ? C’est pourtant le mot d’ordre du peuple juif qui, la nuque raide, têtu, obstiné, s’est toujours fixé comme mantra que « tout est pour le bien » et qu’avec un peu de lumière il peut repousser les ténèbres.
Nous sommes cette lumière qui combat sur tous les fronts ; et s’il est parfois difficile d’y voir clair, il suffit de regarder tout le chemin parcouru depuis quatorze mois. L’ultime étape est de voir rentrer nos frères et sœurs détenus à Gaza. N'est-ce pas le miracle de 'Hanouka que tout le peuple juif espère ?
Anne-Caroll Azoulay

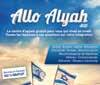



5 CARTES SUR TABLE
Au-delà des frontières
6 INTERVIEW
Portrait : qui est Caroline Yadan ?
14 ÉCONOMIE
L’ombre de la guerre pèse sur le budget 2025
16 DOSSIER
ISRAËL, SILENCE, MOTEUR, ÇA TOURNE !
l Sophie Dulac : une voix pour Israël, une vision du cinéma d’auteur
l Hélène Schoumann, au nom du cinéma israélien
l Marcelle Lean, l’entre-deux-mondes
l Élisa Tovati, la vérité si elle aime
l Jérémie Abessira, l’expert du cinéma juif
l Nelly Kafsky, produire à travers les cerceaux enflammés





34 DÉCOUVERTE D'ISRAËL
Peu de lumière chasse beaucoup d’obscurité
36 SANTÉ
La médecine hyperbare : médecine de demain ?
38 SOCIÉTÉ
Mouvements de jeunesse : le creuset des héros d’Israël
40 GRAND ANGLE
Grand-rabbin d’Israël : fonction ou mission ?
44 LIVRES ET VOUS
l Place des otages de Valérie
Abécassis : un témoignage unique sur le 7 octobre
l Pierre Lurçat : « Il faut revenir aux pères fondateurs »

52 LE KLING DU MOIS
On a eu chaud !
ET AUSSI... Tribune (49), Judaïsme (54), Recette (57), Jeux (58), Immobilier (61)…

Depuis la catastrophe du 7 octobre, de nouveaux phénomènes ont éclos en France. Ils ne ressemblent en rien aux situations du passé, pas même à celles vécues lors des attentats de Toulouse et de l’Hyper Cacher qui avaient entraîné l’Alya de dizaines de milliers de personnes. Les phénomènes sont les suivants :
L'antisémitisme n'a jamais été aussi décomplexé.
L'antisémitisme n'a jamais été aussi présent dans l'espace public depuis la Shoah.
L'antisémitisme est devenu un argument politique qui amène les électeurs à voter pour un parti. Beaucoup d'étudiants juifs ne veulent plus aller à l’université par peur d'être agressés physiquement.
Ces phénomènes et peut-être d'autres expliquent l'augmentation de centaines de pourcents de l'intérêt porté à l’Alya. Et pourtant, les chiffres de l'été 2023 n'ont pas été équivalents à ceux de la vague d'Alya d'il y a dix ans. Pourquoi ? La réponse se trouve sûrement dans le fait que le gouvernement israélien n'a pas fixé un programme clair qui encouragerait les Juifs de France à monter en Israël. Suite à la guerre, l’Alya doit être un des volets de la reconstruction physique et psychologique du pays. Reconstruction psychologique, car tout geste de solidarité, comme une Alya massive, aidera les Israéliens à surmonter les difficultés. Reconstruction physique, car l’Alya de France a les moyens de s'implanter en Israël dans certains endroits stratégiques : Jérusalem, le Sud, le Nord, qui peuvent et doivent attirer à eux le maximum d’olim. Le renforcement de la démographie sera la plus forte réponse que nous apporterons à nos ennemis. Il faut donc combler le grand fossé et exiger du gouvernement que l’Alya massive soit un des buts post-guerre. La nature détestant le vide, la non-existence d'un programme de ce type condamnera la majorité des Juifs de France à y rester. Nous, en Israël, pourrions penser que cela ne relève pas de notre responsabilité mais de celle des Juifs de France qui devraient le plus vite possible monter dans un avion. Mais non. Nous devons être solidaires, responsables, et continuer à montrer
le chemin comme nous le faisons, nous les Israéliens venus de France. Notre participation au combat et à l'élan de solidarité doit se poursuivre. Nous ne pouvons penser ou dire que nous n'avons aucune responsabilité dans la non-Alya de nos frères. À chacun de convaincre une personne de venir. Notre participation au développement du peuple juif sur sa terre ne peut pas s'arrêter aux frontières de celle-ci. Notre effort doit aller au-delà et impacter les Juifs de Diaspora pour les soutenir dans leur désir de nous rejoindre et de réaliser leur rêve. n
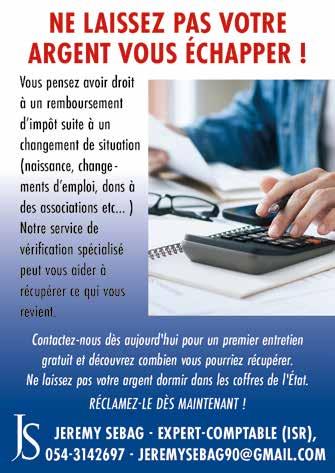

Avocate, députée, militante associative, mère de famille… Caroline Yadan est un peu tout cela et bien plus encore. Elle est entrée discrètement en politique avant de s’installer durablement dans la fonction d’élue parlementaire. Elle nous dévoile aujourd’hui quelques pistes concernant son parcours et sa personnalité.
AJ MAG : Êtes-vous une femme engagée ?
Caroline Yadan : Effectivement, depuis mon adolescence, d’abord comme militante associative, ensuite en tant qu’avocate en droit de la famille et médiatrice, puis en politique depuis 2017. Ce qui me définit le mieux est sans doute l’œuvre de Miss.Tic : Juste une justice juste. Je hais les injustices. Mère de trois grands enfants, je suis une républicaine dans l’âme, qui mène des combats sans relâche pour tous et au nom de tous, du fait de mon attachement viscéral aux valeurs universalistes qui constituent le socle de notre pacte républicain. Mue par la volonté de défendre ces valeurs universelles, j’ai dirigé pendant plusieurs années le pôle antisémitisme du think tank de la Ligue internationale contre le racisme et l’antisémitisme (Licra).


Femme de terrain, je me suis par ailleurs engagée dans la lutte contre les violences faites aux femmes, l’accompagnement des jeunes collégiens et lycéens pour leur trouver des stages durant leurs études, la défense des familles monoparentales, la haine en ligne, mais aussi en tant que cofondatrice d’un groupe d’entrepreneurs fondé sur la recommandation d’affaires réciproque.
Durant mes deux années de députation, j’ai également été vice-présidente du groupe d’études sur l’antisémitisme et secrétaire générale du groupe d’amitié France-Israël à l’Assemblée nationale. Après la dissolution de 2024, mes convictions personnelles et mon désir de poursuivre mes combats m’ont amenée à me présenter dans la huitième circonscription des Français établis hors de France, où j'ai été élue le 7 juillet 2024. Je fais partie de la Commission des lois à l’Assemblée nationale, qui examine tous les textes régaliens. Aujourd’hui, je me sens vraiment à ma place !
Parlez-nous un peu de vous : quels ont été vos premiers pas ?
Née à Boulogne-Billancourt, j’ai vécu à Paris dans le 15e arrondissement durant toute mon enfance, avec ma grande sœur, au sein d’une famille modeste, aimante et unie. Mon père, Juif tunisien, était représentant, il faisait « les trousseaux » et s’absentait chaque semaine. Il connaissait toutes les routes de France et les moindres lieux-dits. Il était passionné par les films et les artistes américains des années 1950. Ma mère, d’origine polonaise, était une enfant cachée. Mon grand-père maternel a été assassiné à Auschwitz et ma grand-mère a sauvé ses enfants pendant la guerre. Ils ont été cachés un an dans un appartement rue Gustave Rouanet qui, par le plus grand des hasards, se situe dans la circonscription qui était la mienne précédemment.
Mes parents tenaient un magasin de prêt-à-porter de vêtements pour enfants à Paris. Je suis aussi une ancienne EEIF [Éclaireuses et Éclaireurs Israélites de France – ndlr], et j’ai été animatrice et directrice de colonies de vacances à Yaniv pendant plus de dix ans.
On sent que vous aimez profondément les gens… Lorsque vous aidez les gens à résoudre leurs difficultés, comme avocat ou comme politique, vous contribuez à leur apaisement, et ça, cela n’a pas de prix. Que ce soit à travers ma profession d’avocate ou ma fonction d’élue, en réalité mon objectif est toujours d’être utile
La fonction de députée fait sens pour l'avocate que je suis : être au cœur de la loi et pouvoir agir concrètement pour modifier le quotidien des Français.

à autrui. La fonction de députée a bien sûr une autre dimension, plus nationale, qui est magnifique et qui fait évidemment sens pour l’avocate que je suis : être au cœur de la loi et pouvoir agir concrètement pour modifier le quotidien des Français.
Comment êtes-vous arrivée en politique ?
L’engagement politique n’a jamais fait partie de ma « feuille de route ». Militante associative, je ne me reconnaissais dans aucun parti politique et, surtout, ce monde m’apparaissait inaccessible. En 2017, En Marche a permis à chacun d’entre nous, par un simple clic, d’adhérer à un mouvement qui pouvait, par la construction d’un programme politique, faire bouger les choses tout en dépassant les clivages et en réconciliant l’économique et le social. C’est donc tout naturellement que j’ai commencé à militer, d’abord localement dans le 18e arrondissement de Paris, puis en travaillant avec Jean-Michel Blanquer et son Laboratoire de la République sur le sujet de la laïcité, ainsi qu’avec Marlène Schiappa. La demande de Stanislas Guerini de le suppléer à l’Assemblée nationale a été une très belle surprise et m’a ouvert les portes de la suite. deuxième volet de l'interview page suivante

Élue en juin 2022 en qualité de candidate suppléante de Stanislas Guerini dans la troisième circonscription de Paris, Caroline Yadan a pris ses fonctions de députée quand ce dernier a été nommé au Gouvernement. Deux ans plus tard, le 7 juillet dernier, Caroline Yadan a été élue députée de la huitième circonscription des Français établis hors de France. Une victoire importante pour elle, tant son amour pour Israël est entier. Nombre d’observateurs ne l’ont pas vue venir, considérant cette victoire aux élections législatives comme une surprise. C’était pourtant une évidence, surtout après le 7 octobre. Une personnalité forte, une force tranquille devait désormais s’imposer sur la scène politique, notamment pour toutes les questions liées à l’antisémitisme. Elle nous raconte les dessous de cette campagne électorale très particulière.
AJ MAG : La dernière élection était intense ?
Caroline Yadan : C’est clair : j’ai perdu 4 kg la première semaine ! Je n’avais absolument pas prévu de me présenter au sein de la huitième circonscription des Français établis hors de France. Après la dissolution, qui nous est tombée dessus violemment, je suis repartie en campagne avec Stanislas Guerini, à Paris, mais j’étais redevenue suppléante, avec la quasi-certitude de ne plus être députée, même en cas de victoire, et en sachant que, du fait de mes engagements contre la haine des Juifs en France et la défense de l’État d’Israël, j’allais être la cible de violentes attaques de notre adversaire, une EELV tendance LFI, à l’origine de l’invitation de Médine aux journées d’été de son parti.
Charmant…
Ce n’est rien de le dire. Alors que la situation m’apparaissait un peu compliquée, mon téléphone a sonné et l’on m’a fait cette proposition de me présenter au sein de la nouvelle circonscription des
Français établis hors de France, ce qui m’est apparu en seulement quelques minutes comme une évidence ! C’est pourquoi je me suis lancée, avec confiance. Dans ma tête, une petite voix me disait : « Tu vas gagner », alors même que, dans une circonscription jugée par tous comme imprenable, personne n’aurait misé sur ma victoire.
Vous aviez un programme ? Une équipe ?
Absolument pas. J’ai dû constituer une équipe en vingt-quatre heures, me familiariser avec les enjeux de tous les pays de la circonscription, apprendre tous les acronymes utilisés, créer énormément de contenus, bâtir un programme et une stratégie de communication et de médias, solliciter des dons à une vitesse grand V.
Êtes-vous allée à la rencontre de vos électeurs ? Oui. Sur les deux semaines de campagne, j’ai tenu à me déplacer non seulement en Israël, mais aussi en Grèce et en Italie, où j’ai rencontré beaucoup de monde et de

soutiens. Mon réseau en France a également largement contribué à ma victoire, notamment en Israël : il était impératif de surmonter à la fois mon déficit de notoriété mais aussi mon étiquette « Macron ». C’est la raison pour laquelle j’ai axé ma campagne sur mon bilan, c’est-à-dire sur toutes les actions concrètes que j’avais entreprises comme députée. C’est ce qui a permis de convaincre à la fois de ma sincérité, de mon courage et de mon efficacité.
Face à Meyer Habib, ce n’était pas gagné d’avance… J’ai réussi l’exploit de faire en Israël, au deuxième tour, face à mon adversaire en poste depuis douze ans, un score qu’aucun candidat n’avait réussi à réaliser jusqu’à présent.
Un long fleuve tranquille, finalement ?
Oh que non ! J’ai dû affronter des calomnies, comme le fait que j’aurais été soutenue au second tour par le LFI, ce qui n’a évidemment pas été le cas : bien au contraire, la candidate LFI a écrit noir sur blanc sur son communiqué qu’elle ne pouvait pas appeler à voter pour moi, en arguant que mes prises de positions étaient « intolérables et inacceptables ».
certains sujets récurrents qui préoccupent nombre de nos compatriotes.
Israël a accueilli environ 50 000 olim de France ces dix dernières années. Les difficultés essentielles sont dues à des problèmes économiques et sociaux. Le sujet des retraites est également présent car il est parfois compliqué de faire valoir ses droits.
Je suis aussi mobilisée pour les équivalences de diplômes, notamment des professionnels paramédicaux et médicaux : les infirmiers olim, par exemple, même très qualifiés et expérimentés, sont contraints de repasser un examen ou de faire des stages pendant plusieurs mois, voire des années, avant de pouvoir exercer en Israël. Sur ce sujet, j’ai d’ores et déjà écrit à la ministre des Français de l’étranger afin d’envisager une évolution concernant la réciprocité de reconnaissance de ces diplômes.
Caroline Yadan avec une délégation de députés français reçue par Amir Ohana, président de la Knesset © DR

En définitive, cela s’est bien terminé...
L’engouement autour de ma candidature a été incroyable : je pense avoir vraiment représenté pour les électeurs cette possibilité de changement que beaucoup attendaient, y compris hors d’Israël.
Avez-vous identifié les besoins des Français installés en Israël ? Quels sont-ils ? Et avez-vous des projets pour y répondre ?
Oui, lors de mes déplacements en Israël, qui m’ont permis d’échanger avec les Français vivant sur place, j’ai identifié plusieurs problématiques. Régulièrement, j’organise aussi des permanences en visioconférence, qui me permettent de retrouver
Je suis également intervenue concernant la fiscalité liée à la CSG/CRDS que les Français en Israël doivent payer sur leurs revenus patrimoniaux – immobiliers, par exemple –, alors même que ceux qui résident dans l’Union Européenne n’y sont plus soumis. Il s’agit là d’une rupture d’égalité que j’ai dénoncée dans un récent amendement que j’ai déposé dans le cadre de l’examen du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2025. Enfin, je suis consciente de la situation de nos compatriotes déplacés du nord et du sud du pays, qui commencent malheureusement à perdre espoir. Grâce à ma collaboration étroite avec les consulats sur place, j’ai vérifié que ces personnes avaient pu obtenir des aides sociales adaptées à leur situation et j’ai sollicité un budget supplémentaire les concernant. Enfin, je gère au quotidien les nombreux mails qui me sont adressés et qui portent sur des cas particuliers que je m’efforce de résoudre si je le peux. Être utile, être proche, être efficace, c’est ce que je souhaite apporter à l’ensemble de la communauté française en Israël et dans l’ensemble de ma circonscription ! troisième volet de l'interview page suivante

Entre une (extrême) gauche gangrénée, une (extrême) droite amnésique et un centre vérolé, la politique hexagonale est bien à la peine. Les médecins imaginaires et autres donneurs de leçons, qui ont tant d’avis sur le Moyen-Orient, sont silencieux quand il s’agit de prendre le pouls de la politique française.
À l’Assemblée nationale, certaines séances ressemblent à une cour d’école et l’Arc républicain à un jouet pour adolescents attardés. Au milieu de ce brouhaha, certains députés ont choisi une voie singulière pour honorer leur mandat. Caroline Yadan, accompagnée d'Aurore Bergé, ancienne ministre et députée des Yvelines, a déposé une proposition de loi pour sanctionner « toutes les formes renouvelées d'antisémitisme ».
Soutenue par 90 députés (61 d'Ensemble pour la République, 14 d'Horizons, et 5 socialistes et apparentés), cette initiative pourrait modifier les règles du jeu dans la lutte contre l’antisémitisme et l’antisionisme en France.
Israël est le navire amiral de l’Occident face au fascisme islamiste.
AJ MAG : Qu'est-ce que peut changer votre proposition de loi, si elle passe ?
Caroline Yadan : Cela permettra d’outiller plus facilement les juges dans leurs décisions de constitution des infractions et donc dans les condamnations qu’ils pourront prononcer. Les slogans « From the river to the sea », « Varsovie, Treblinka et maintenant Gaza, on avait dit plus jamais ça » ou encore les cartes géographiques sur lesquelles Israël a disparu pourront être sanctionnés, puisque la volonté du législateur est d’interdire l’incitation à la négation ou à la destruction d’un État et d’étendre le délit de contestation de la Shoah, qui pourra consister en une négation, une minoration, une relativisation ou une banalisation outrancière. Ainsi, cette contestation sera punissable, même si elle est présentée sous une forme déguisée, dubitative, par voie d’insinuation ou de comparaison, d’analogie ou de rapprochement. On a vu par exemple circuler un dessin d’une Maguen David qui se confond avec une croix gammée (photo ci-contre) : cela illustre parfaitement ce que je souhaite voir interdit par la loi. Enfin, les propos qui présenteront tout acte terroriste comme une légitime résistance ou qui porteront un jugement favorable sur un tel acte seront également


sanctionnés. Les élus LFI pour lesquels le Hamas est un mouvement de résistance ne bénéficieront plus d’une quelconque impunité et pourront être lourdement condamnés. Enfin, je pense que cette avancée judiciaire aura aussi une portée sur les esprits : lorsqu’une loi vient ancrer des principes fondamentaux, comme l’avait fait en son temps la loi Gayssot d’interdiction de la négation de la Shoah, la société intègre le caractère inapproprié de tels actes ou propos.
Comment avez-vous vécu les différentes déclarations antiisraéliennes du président Macron ? Comme vous avez pu le constater au travers de mes nombreuses prises de position et de parole, j’ai très mal vécu les dernières déclarations de notre président. J’ai dit, écrit et déclaré en toute liberté et indépendance que les mots avaient un sens, qu’il me semblait totalement inacceptable, voire indécent, d’accuser Israël de barbarie, de boycotter les entreprises israéliennes ou encore de déclarer qu’il fallait limiter la livraison d’armes. Bien au contraire, je pense quant à moi que la France doit faire le choix du courage, de la lucidité et de la fermeté, plutôt que celui des atermoiements, de la faiblesse ou de l’indifférence. La France doit choisir de soutenir sans réserve Israël dans sa volonté d’éradiquer le terrorisme islamiste, car cela concerne évidemment aussi la France et les démocraties occidentales. Israël est le navire amiral de l’Occident face au fascisme islamiste, et il agit courageusement pour nous tous. Le « pas d’escalade » a fait long feu face à la menace stratégique majeure que nous connaissons. De notre absence de capitulation dépend la victoire de notre honneur et de notre dignité. J’ai des échanges réguliers avec le ministre des Affaires étrangères sur ces problématiques et je lui expose mon point de vue. Enfin, il est nécessaire de distinguer le pouvoir exécutif (le président et le Gouvernement) et le pouvoir législatif que je représente avec notre groupe parlementaire. Il

se trouve que je dispose de nombreux soutiens parmi mes collègues députés et que Gabriel Attal, prochain président de notre parti Renaissance, a reçu très récemment dans son bureau de l’Assemblée nationale Joshua Zarka, ambassadeur d’Israël en France. À cette occasion, il lui a réaffirmé sans aucune ambiguïté le soutien et la solidarité de notre groupe ainsi que le droit d’Israël à se défendre contre le terrorisme. Notre parti, dans un communiqué très clair, a fait de même.
Pensez-vous que ces déclarations puissent avoir un impact négatif sur votre proposition de loi ?
Je n’ai aucune crainte de ce point de vue. Il est rare qu’une proposition de loi soit cosignée par autant de députés de différents groupes parlementaires, y compris un ancien président de la République, une ancienne Première ministre et de nombreux anciens ministres. Le texte évoluera sans aucun doute, après examen et auditions. Je m’attends évidemment à une levée de boucliers, notamment de la part de l’extrême gauche, mais cela ne me fait pas peur – au contraire, la haine dont je suis l’objet me motive pour ne pas lâcher ce combat qui est universel. quatrième volet de l'interview page suivante

Le questionnaire de Proust est un célèbre exercice littéraire qui consiste en une série de questions visant à révéler les traits de personnalité et les goûts d'une personne. Popularisé par l'écrivain français Marcel Proust à la fin du XIXe siècle, il invite les participants à répondre à des questions sur leurs valeurs, leurs aspirations, leurs peurs ou encore leurs héros, dévoilant ainsi des aspects intimes de leur caractère.
Ma vertu préférée : le courage
Mon principal trait de caractère : la détermination
La qualité que je préfère chez les hommes et chez les femmes : l’honnêteté
Mon principal défaut : la précipitation
Ma principale qualité : la persévérance
Ce que j'apprécie le plus chez mes amis : leur fidélité et leur confiance
Mon occupation préférée : flâner
Mon rêve de bonheur : l’éradication de la haine de la surface de la terre
Quel serait mon plus grand malheur ? Être privée des miens
À part moi-même, qui voudrais-je être ? Moi, en mieux
Le pays où j'aimerais vivre : celui de l’insouciance
La couleur que je préfère : le bleu
La fleur que je préfère : la pivoine et, depuis le 7 octobre, toutes les fleurs jaunes
L'oiseau que je préfère : le rossignol, qui apaise
Mes auteurs favoris en prose : Albert Camus, Federico García Lorca, Elena Ferrante, Joël Dicker (« Les derniers jours de nos pères est une merveille »), Éric-Emmanuel Schmitt, et tant d’autres…
Mes poètes préférés : Baudelaire (« le meilleur d’entre tous, selon moi »)
Mes héros et héroïnes dans la fiction : Charlot, Cyrano de Bergerac, Eliza Doolittle, Dolly Gallagher Levi et Maria de La mélodie du bonheur (je suis un peu fleur bleue !)
Mes compositeurs préférés : Michel Legrand, Louis Armstrong, Maxime Le Forestier et Charles Aznavour
Mes peintres préférés : Chagall, Picasso, Kandinsky et Orly Ziv
Mes héros dans la vie réelle : mon mari
Mes héros dans l'histoire : Simone Veil et Robert Badinter
Les personnages historiques que je déteste le plus : les dictateurs sanguinaires qui agissent toujours « pour le bien de leur peuple »
Ce que je déteste le plus : la lâcheté et la malveillance
Les faits historiques que je méprise le plus : ceux qui déshumanisent ce que nous sommes au nom de la morale et des droits de l’homme
Le fait militaire que j'estime le plus : le Débarquement
La réforme que j'estime le plus : l’abolition de la peine de mort
Le don de la nature que je voudrais avoir : arrêter le temps
Comment j'aimerais mourir : apaisée, le devoir accompli
L'état présent de mon esprit : préoccupé
La faute qui m'inspire le plus d'indulgence : celle que je comprends
Ma devise : rien n’est impossible n

PUBLIRÉDACTIONNEL
Saviez-vous que vous pouvez prétendre à un remboursement d'impôt ? Le cabinet comptable Jeremy Sebag a mis en place un service de vérification spécialisé qui peut vous aider à récupérer ce qui vous revient. Explication.
AJ MAG : Quel est le principe du remboursement d'impôt ?
Jeremy Sebag : Dans bien des cas, il peut arriver que l'État prélève au salarié plus d'impôt que ce qu'il doit réellement à l'État, et ce, pour de multiples raisons, la principale étant que l'impôt est prélevé à la source sur une base mensuelle et non annuelle. Prenons l’exemple d’un salarié qui a commencé à travailler en juillet 2024 avec un salaire de 10 000 shekels par mois : il sera imposé à la source selon son salaire mensuel de 10 000 shekels, alors que son salaire annuel en 2024 est de 60 000 shekels (10 000 shekels sur six mois), soit une moyenne mensuelle de 5000 shekels par mois. Dans ce cas, l'impôt prélevé est supérieur à l'imposition réelle du salarié et il a droit à un remboursement d'impôt. Il se peut aussi que le salarié, suite à un changement de situation personnelle – naissance d'un enfant en fin d'année, service militaire, immigration, études supérieures, dons à des associations… –, ait droit à différentes réductions d'impôt non réclamées auprès de son employeur.
certains cas, la procédure peut dépasser ce délai, en fonction de la masse administrative dans les différents centres d'imposition.
Peut-on réclamer un remboursement d'impôt rétroactivement ?
Oui, il est possible de réclamer un remboursement d'impôt sur les six dernières années fiscales. Par exemple, en 2024, il est possible de réclamer jusqu’à l'année 2018 incluse.

Cette démarche ressemble à celle du « maanak avoda ». Quelle est la différence ?
Combien coûte la procédure de vérification de remboursement d'impôt ?
La vérification est gratuite. À la fin de la vérification, le client reçoit une réponse lui indiquant s'il a droit ou non à un remboursement d'impôt. Le tarif est fixé selon un pourcentage du remboursement d'impôt.
Combien de temps prend la procédure ?
Pour la plupart des dossiers, la procédure se termine 120 jours après la réclamation. Cependant, dans
C’est tout à fait autre chose. Le « maanak avoda » est une aide de l'État pour les bas salaires. Le principe du remboursement d'impôt, lui, est de récupérer les impôts prélevés sur votre fiche de paie qui sont supérieurs à votre imposition réelle. Ce principe concerne aussi les hauts salaires, et en particulier ceux qui ont commencé à travailler en milieu d'année. Le remboursement d’impôt concerne tous les salaires sans condition de ressources. C’est la raison pour laquelle, il faut y recourir : on n’a rien à perdre et tout à gagner !
Les francophones sont-ils suffisamment informés de cette démarche ?
Pas assez, c’est la raison pour laquelle notre cabinet comptable est à leur disposition pour cette démarche. n
Jeremy Sebag - Expert-comptable 054-3142697 - Jeremysebag90@gmail.com

La proposition de budget 2025, que la Knesset doit approuver d’ici à la fin mars, est placée sous le signe de l’austérité. La hausse d’impôts et la réduction des dépenses risquent de peser sur le revenu disponible de la classe moyenne.
La guerre ne sera pas financièrement indolore pour les Israéliens. En témoigne la proposition de budget 2025 adoptée par le cabinet le 1er novembre. D’un montant de 607,4 milliards de shekels (150 milliards d'euros), il contient une enveloppe de 9 milliards de shekels d'aide aux milliers de réservistes rappelés par l'armée depuis le début des hostilités avec le Hamas. Visant, selon le ministre des Finances Bezalel Smotrich, à « soutenir les guerres qu’Israël mène sur plusieurs fronts » et à « sauvegarder la résilience de l'économie », le budget qui sera soumis au vote de la Knesset en janvier devrait comporter des enveloppes supplémentaires pour la Défense. Mais une chose est sûre : pour financer la guerre, dont le coût est estimé à 250 milliards de shekels, les Israéliens devront se serrer la ceinture. Au total, le budget comprend en effet 40 milliards de shekels de hausses d'impôts et de réductions des dépenses pour tenter de maîtriser un déficit budgétaire qui s'élève actuellement à 8,5 % du PIB.
Certes, le pire a été évité, puisque dans le cadre de l'accord entre les ministres, les prestations versées aux personnes âgées, aux personnes handicapées, aux survivants de la Shoah et aux familles des soldats tombés au combat ne seront pas gelées comme cela avait été initialement proposé. Au lieu de cela, il a été décidé d’augmenter les cotisations à l’Assurance nationale (Bitoua'h Leoumi) d’un montant correspondant. Actuellement, le taux de cotisation salariale est de 3,5 % jusqu’à un salaire de 7522 shekels par mois, et d’environ 7 % sur les revenus supérieurs. Le gouvernement n’a pas encore publié tous les détails de cette augmentation, mais on s’attend à ce qu’elle représente une augmentation de 1000 à 2000 shekels par an pour un ménage moyen.
Par ailleurs, afin de tenir l’objectif de déficit budgétaire fixé à 4,3 % pour 2025 et de maintenir la confiance des marchés, d’autres mesures d’austérité ont été prises. Ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), perçue lors de l’achat de biens et de services, passera de 17 % à 18 %. Or cette disposition nuit

Le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, lors d'un débat à la Knesset sur le budget

davantage aux personnes à faibles revenus et contribue à augmenter le coût de la vie, déjà très élevé en Israël. Enfin, parallèlement à ces hausses d’impôts, le ministère des Finances prévoit, en 2025, de réduire de plusieurs centaines de millions de shekels le budget des ministères et des services publics, notamment dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la protection sociale. À telle enseigne que le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, du parti Force Juive, a voté contre le projet de budget,
en raison des « atteintes au fonctionnement de la Police, du Service pénitentiaire israélien, et des services d’incendie et de secours », tout comme le ministre de la Culture et des Sports issu du Likoud, Miki Zohar, en raison des coupes budgétaires visant son ministère, ou encore la ministre de la Protection de l’environnement Idit Silman.
Last but not least, le gouvernement a laissé en place une somme d’environ 4,1 milliards de shekels pour les fonds de coalition, pour honorer les promesses politiques

faites lors de la lutte pour la formation du gouvernement – un dispositif critiqué par le chef de l’opposition, Yaïr Lapid, qui estime que « [Le budget] donne des milliards de shekels à dix ministères gouvernementaux inutiles » au lieu de les consacrer au bien-être des citoyens israéliens. Après plus d’un an d’attaques du Hezbollah, les conseils régionaux du Nord ont pour leur part dénoncé l’insuffisance des fonds alloués à la réhabilitation du Nord. « Nous avons là l’illustration de l’abandon des habitants de la ligne de confrontation », a fustigé Moshé Davidovich, qui dirige le Conseil régional de Mateh Asher. Si le cabinet israélien a franchi le premier obstacle à l’adoption du budget 2025, ce texte va maintenant entamer son parcours du combattant à la Knesset, sachant que le budget n’inclut pas les ajouts potentiels qui pourraient être apportés après les propositions de la commission Nagel, un groupe spécial nommé par le gouvernement pour faire des recommandations à long terme sur les dépenses sécuritaires au cours de la prochaine décennie. Reste à savoir quelle sera la marge de manœuvre de la coalition, fragilisée par la question explosive des avantages accordés au public ultraorthodoxe échappant à la conscription militaire. À l’heure où le ministère des Finances a réduit les prévisions de croissance pour 2024 à seulement 0,4 %, les débats à la Knesset pour l’adoption d’un budget de nature à réduire le revenu disponible de la classe moyenne, qui paie des impôts et sert dans l’armée, promettent d’être houleux. n
Nathalie Hamou

dossier réalisé par Eden Levi-Campana
Depuis le 7 octobre, des dizaines de films sont en préparation, tournés ou en cours de tournage. Un an après le carnage du chabbat noir, des documentaires, des films de fiction, des séries, des longs et des courts métrages s’apprêtent à entrer en force sur nos écrans et nos tablettes. Le cinéma juif et israélien, à travers ses multiples facettes, a toujours offert un fascinant miroir de l'histoire du peuple juif et de l'État d'Israël. Que ce soit par des récits héroïques des premières années de l'État ou par des œuvres plus critiques et introspectives, ce cinéma, qui s'inscrit dans un dialogue permanent entre l'Histoire et la mémoire, l’émotion et le devoir, n'a cessé de capturer les défis, les espoirs et les complexités d'une société en constante évolution. Il explore les tensions entre tradition et modernité, entre passé et présent, et offre une réflexion souvent poignante sur les réalités humaines. En ce sens, le septième art juif et israélien interroge, provoque et invite à une réflexion sur les grandes questions de l'existence humaine et la spiritualité.

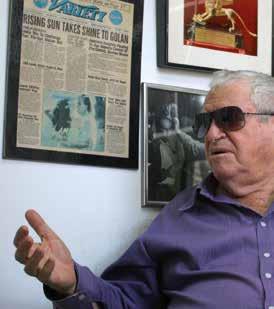



Avant la création de l'État d'Israël en 1948, le cinéma en Palestine mandataire commence à prendre forme. Les films de cette époque sont la plupart du temps des documentaires ou des œuvres visant à encourager l'immigration juive ; ils représentent souvent
la vie dans les kibboutzim . En 1932, Nathan Axelrod fait forte impression avec son film pour enfants Oded HaNoded , qui suit les aventures d'un garçon dans un kibboutz. Idem pour la comédie dramatique Sabra , réalisée un an plus tard par Aleksander Ford, avec Hannah Rovina, Raphael Klatchkin et Aharon Moskin.

lll Jusqu’à la fondation d'Israël, le cinéma juif s'ancre principalement dans la Diaspora, notamment en Europe de l'Est et aux États-Unis. L'un des films les plus emblématiques de cette période est Le Dibbouk (1937), un film polonais en yiddish, adapté d’une pièce de théâtre. Ce film de 122 minutes, réalisé par Michał Waszyński, a été présenté en 2024 à l’Espace Rachi-Guy de Rothschild à Paris, dans le cadre du festival Dia(s)porama. Le Dibbouk capture un moment historique où les communautés juives européennes étaient à la croisée des chemins, entre traditions ancestrales et modernité naissante. En parallèle, aux États-Unis, les studios hollywoodiens, fondés par des pionniers juifs comme Samuel Goldwyn et les frères Warner, contribuent au développement d'un cinéma mondial. Le cinéma hollywoodien illustre la réussite des Juifs aux ÉtatsUnis et leur apport à la culture américaine, mais les personnages juifs y sont rares. Ce paradoxe s'explique par le fait que les fondateurs juifs de Hollywood voulaient principalement s’intégrer à la société américaine. Ils ont construit leur succès en écartant les thèmes liés au judaïsme. De la même façon, au fur et à mesure que se noircissent les pages du septième art, nombreux sont les artistes juifs à faire le bonheur du cinéma grand public, certains sans nécessairement faire état de leur appartenance au peuple du
Livre, comme Daniel Radcliffe, Harrison Ford, Lauren Bacall, Kirk Douglas, Natalie Portman, Scarlett Johansson, Winona Ryder, James Franco, et bien entendu Gal Gadot et Shira Haas. N’oublions pas des cinéastes comme Steven Spielberg, Woody Allen, Joel et Ethan Coen, Darren Aronofsky, Sidney Lumet, Stanley Kubrick ou encore Mel Brooks.
Les années 1970 sont considérées comme un âge d'or du cinéma israélien.
C'est une période où le cinéma local commence à attirer l'attention internationale, souvent grâce à l'exploration des questions d'identité nationale, des conflits israélo-arabes et des tensions internes au sein de la société israélienne.

La Seconde Guerre mondiale et la Shoah amènent le cinéma d’après-guerre à se concentrer sur les survivants de la Shoah et les pionniers sionistes. Des œuvres comme Hill 24 Doesn't Answer (1955), qui marquent les
premières tentatives de créer une mythologie nationale israélienne, célèbrent les sacrifices des martyrs qui façonnent la terre promise. Hill 24 Doesn't Answer raconte les histoires personnelles d'un certain nombre de jeunes soldats qui sont en route pour défendre une colline stratégique surplombant la route de Jérusalem. Ce premier longmétrage produit en Israël est un film de guerre réalisé par Thorold Dickinson. Il a été présenté à la huitième édition du Festival de Cannes (mai 1955). Exodus (1960), réalisé par Otto Preminger, propulse la cause israélienne sur la scène internationale, marquant le début d'une utilisation consciente du cinéma comme outil d’enjeux politiques. Menahem Golan, producteur emblématique, en fera les frais. Golda Meir, soucieuse de préserver l'image du pays, n’apprécie pas son film sorti en 1964, Sallah Shabati – יתבש חלאס –et l’empêche (un temps) de quitter le pays. Sallah Shabati finit tout de même par être nominé, en lice pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère – une première pour une production israélienne. Golan exploite les tensions culturelles des nouveaux immigrants pour donner naissance au genre des « Bourekas ». Sallah Shabati est réalisé dans ce contexte par Ephraïm Kishon. Le film retrace l'intégration d'une famille juive immigrée d'un pays arabe dans les premières années de l'État d'Israël. Chaïm Topol


Scènes du film d'Otto Preminger, Exodus, avec le légendaire Paul Newman et, en médaillon, les réfugiés prêts à se battre pour aller au bout de leur rêve
© DR - Photos issues de la bande-annonce sur You Tube
(Un violon sur le toit) incarne un immigrant séfarade confronté aux défis de la société israélienne du XXe siècle, évoluant entre une maabara (camp de transit) et un kibboutz. Sallah Shabati est une satire sociale qui place Ephraïm Kishon et Menahem Golan parmi les premiers cinéastes israéliens à obtenir un succès international. Les années 1970 sont considérées comme un âge d'or du cinéma israélien. C'est une période où le cinéma local commence à attirer l'attention internationale, souvent grâce à l'exploration des questions d'identité nationale, des conflits israélo-arabes et des tensions internes au sein de la société israélienne. Le cinéma israélien devient plus introspectif et critique. Les guerres successives et les tensions internes trouvent un écho dans des films qui interrogent les réalités politiques et sociales de l'époque, à l’instar de Kazablan (1974), un film musical qui met en

lumière les tensions entre les Juifs ashkénazes et séfarades. L’œuvre, réalisée par Menahem Golan, et écrite par Golan et Haïm Hefer, obtient un très mérité Golden Globe de la meilleure chanson originale pour Yehoram Gaon et un Golden Globe du meilleur film étranger. Le film est produit par la Metro-Goldwyn-Mayer et diffusé par United Artists. Les guerres ravivent les valeurs viriles du sionisme mais la guerre de Kippour, en 1973, déstabilise le moral du pays. Avec l'arrivée du Likoud au pouvoir en 1977, le cinéma israélien s’interroge sur le
rêve sioniste à travers les yeux des exclus : les femmes, les LGBTQ, les marginaux, les personnes âgées et surtout les Arabes. Les relations entre Juifs et Arabes émergent comme un thème central des années 1980. Des films comme Beyond the Walls (1984) et On a Narrow Bridge (1985) invitent au dialogue, posant les jalons d’une vision alternative du conflit israélo-palestinien. Avant la première Intifada, l’époque accepte ce genre de films. En 1987, l’Intifada ravive les tensions et le cinéma s’écrit autrement.

lll אפגא יפ לע םייחה – La vie selon Agfa (1994), œuvre d’Assi Dayan, incarne ce désenchantement, dépeignant une société où l’armée, autrefois symbole de la morale sioniste, apparaît comme un agent de violence gratuite.
Le cinéma israélien, longtemps absent des grandes scènes internationales, connaît un renouveau au tournant du millénaire, avec des budgets de plus en plus importants. Cette évolution conduit à la production d’œuvres ambitieuses, dont plusieurs bénéficient de prestigieuses distinctions dans des festivals internationaux.
Des réalisateurs comme Amos Gitaï, Eytan Fox, Shira Geffen et Etgar Keret continuent à explorer des thèmes allant de la vie quotidienne d’un couple orthodoxe dans Kadosh à la représentation de la communauté LGBTQ à Tel Aviv dans The Bubble – העובה Chaque film aborde des sujets intimes ou des problématiques sociopolitiques, témoigne d’une société en constante évolution, cherchant à interroger son identité et sa conscience collective. De nombreuses œuvres de qualité vont être des marqueurs de l’époque récente.
Le cinéma juif, bien qu’il se distingue parfois du cinéma israélien, continue à explorer des thèmes liés à la mémoire de la Shoah, à la Diaspora et à la religion. Des films comme La Liste de Schindler (1993) de Steven Spielberg et Le Pianiste (2002) de Roman Polanski ont joué un rôle important dans la représentation de la Shoah et de l’histoire juive au cinéma. Depuis une dizaine d’années, les séries israéliennes connaissent un succès international grandissant, avec des storytellings percutants

et des performances d’acteurs saisissantes, tout en abordant des thématiques universelles avec une authenticité inégalée. Elles attirent l’attention des critiques et des spectateurs du monde entier. Suite au pogrom du 7 octobre 2023, le cinéma juif et israélien a intensifié ses efforts pour raconter les récits poignants des victimes et des otages, mettant en valeur la douleur et la résilience des familles touchées. Ces films témoignent de l’horreur des enlèvements et des violences, tout en soulignant le combat pour la survie et l’espoir. En se concentrant sur les histoires des otages et des victimes, ces œuvres cherchent à préserver la mémoire collective et à humaniser les chiffres souvent abstraits des tragédies. Les producteurs, les distributeurs et les professionnels du cinéma sont d’accord sur le fait qu’il est encore trop tôt, que nous sommes trop près de l’événement ; mais ces créations arrivent sur nos écrans
et marqueront tristement l’histoire d’Israël et du monde libre. Pour conclure cette odyssée au cœur du septième art juif et israélien, nous vous proposons de noter dans vos agendas quelquesuns des films les plus attendus autour du 7 octobre : Of Dogs and Men, réalisé par Dani Rosenberg, בוש דוקרנ ונחנא (Nous danserons encore), réalisé par Yariv Mozer, רבוטקואב םימי השולש (Trois jours en octobre), réalisé par Ronen Israelski, רבוטקואב דחא םוי (Un jour d’octobre), réalisé par Daniel Finkelman et Oded Davidoff, םודא חרפ (Fleur rouge), réalisé par Haïm Bouzaglo, הריס התואב (Dans le même bateau), réalisé par Michael Veksel et Alexandra Petrova, םיקפואמ לחר (Rachel d’Ofakim), réalisé par Zohar Wagner, דליה (Le garçon), réalisé par Yahav Winner, המחלמה תודוס (Secrets de la guerre), réalisé par Avi MaorMarzuk, Looking for Yotam, réalisé par Caroline Bongrand et Georges Benayoun. n



Sophie Dulac (ci-dessus) est une figure incontournable du cinéma, en particulier pour son rôle dans la distribution, la production et la promotion de films d'auteurs indépendants, y compris israéliens. En tant que fondatrice de Dulac Distribution avec Michel Zana, elle vise la distribution de long-métrages, de fictions et de documentaires dans les salles de cinéma françaises ainsi que sur tous les autres supports en France. La société s'intéresse principalement au cinéma d'auteur français et international, ainsi qu'aux films de répertoire.

Avec plus de 150 films distribués depuis 2003, Dulac Distribution s’est imposé comme un distributeur exigeant et ambitieux, donnant aux films un large écho sur un marché difficile. Sophie Dulac, c’est aussi cinq cinémas indépendants (treize écrans à Paris) : l'Arlequin, le Reflet Médicis, l'Escurial Panorama, le Majestic Bastille et le Majestic Passy.
La carrière de Sophie Dulac témoigne de son engagement pour un cinéma d'auteur accessible, culturellement diversifié et porteur de messages forts. Elle a contribué à la diffusion d'œuvres israéliennes en France et à l'international, favorisant la visibilité des cinéastes israéliens et une meilleure compréhension des réalités et des enjeux sociaux, politiques et culturels en Israël. En sélectionnant et en distribuant des films israéliens aux thèmes parfois sensibles, elle a joué un rôle de médiatrice, ouvrant un espace pour le dialogue et permettant au public de découvrir la richesse et la complexité du cinéma israélien. Son influence s'étend au-delà de la distribution : elle soutient également la création cinématographique. Cette implication fait d'elle une ambassadrice essentielle pour le cinéma israélien en France, mais aussi pour le cinéma mondial.
AJ MAG : Qu'est-ce que le cinéma juif ?
Sophie Dulac : C'est une vaste question. C'est comme si vous me demandiez ce que c’est qu'être juif. D'abord, je ne sais pas si l’on peut qualifier un cinéma avec un adjectif. Le cinéma juif, pour moi, cela n'existe pas ; en fait, cela catégoriserait une forme de cinématographie, ce que je trouverais dommage. En revanche, il y a de très beaux films israéliens ; il y a de très beaux films faits par des Juifs ; il y a de très beaux films faits par des gens qui parlent de tout ce qui est yiddish. Par exemple, moi, j'ai un ciné-club qui s'appelle « Yiddish pour tous », au Majestic Passy : on est dans une culture particulière, qu'on apprécie ou non, mais qui en tout cas, de la comédie au drame, traite d'une certaine manière, avec une certaine vision
des choses, de nombreux sujets assez sensibles. J'ai envie de dire cela ainsi.
Depuis le 7 octobre, le cinéma israélien est-il plus difficile à diffuser ? Oui et non. Cela dépend du sujet. Il est vrai que Le déserteur, l'année dernière, cela n'a pas été évident au niveau des exploitants, mais nous avons quand même trouvé des gens qui avaient envie de diffuser le film. Le problème, ce sont les gens qui jugent sans savoir, sans voir, sans connaître, sans regarder. Parce qu'il y a une espèce d’atmosphère générale qui fait que tout ce qui peut venir d'Israël est mauvais. C'est cela qui, moi, m'exaspère. Parce que cela vient d'Israël, c'est plus compliqué ? Je pense qu'il faut fournir un peu plus d’efforts, c'est vrai, mais le travail est fait, nous trouvons des salles. lll

lll Comment choisissez-vous les films israéliens que vous diffusez ?
Cela dépend. D'abord, je trouve que le cinéma israélien, depuis quelques années, à part certains films, a un peu baissé en qualité. Dans les années 2004-2005-2006, à l'époque où j'ai sorti La visite de la fanfare ( תרומזתה רוקיב, Bikour HaTizmoret), par exemple, on était sur une espèce de vague, et nous avons beaucoup surfé sur cette vague du cinéma israélien qui parlait enfin d'autre chose que du conflit israélopalestinien, notamment des problèmes de société, justement – parce qu’Israël est un pays « comme un autre ». Dans ces années-là, on a eu un cinéma israélien complètement différent, plus comédie, plus sociétal, parfois plus dur sur ce qui se passait dans le pays. Les Israéliens qui faisaient du cinéma avaient envie de montrer que leur pays avait aussi les mêmes soucis que les autres, et c’était intéressant. Depuis quelques années, c'est moins qualitatif.
Aujourd’hui, nous sélectionnons nos films dans les festivals, on nous envoie des films terminés. Michel Zana, qui travaille avec moi en distribution, fait beaucoup de festivals, notamment à Jérusalem et à Haïfa ; c'est là qu'il rencontre pas mal de réalisateurs. Et puis, nous connaissons beaucoup de producteurs et de réalisateurs en Israël, et ils nous proposent leurs films.
Voyez-vous des changements au fur et à mesure des conflits ?

Fauda est vraiment une
Men, que j'ai trouvé trop proche de ce qui s’est passé ; donc je ne l’ai pas retenu. Pour l'instant, à part ce film, on ne m'a pas proposé grand-chose qui traite du sujet – j’en suis d’ailleurs surprise. Mais très honnêtement, je ne suis pas certaine qu’aujourd’hui je prendrais des films sur ce sujet, parce que nous n’avons pas encore assez de recul pour replonger dedans ; des gens ont trop souffert et continuent de souffrir ; il y a encore des otages qui ne sont pas libérés. C’est pourquoi je trouve que c’est trop tôt. Je pense que les gens n'iraient pas voir un film sur le 7 octobre, d’abord parce qu’ils n'ont pas envie de se retrouver dans des horreurs monstrueuses et puis parce que malheureusement, ce n'est pas leur combat. Je dois dire qu’il est assez terrifiant de voir à quel point il y a encore une forme de déni de ce qui s'est passé.
Quel est votre regard sur les séries israéliennes ?
très grande série israélienne, c'est une espèce de modèle à maints égards.
Oui, il y en a eu, beaucoup de documentaires – mais pas tant que ça. Je pense que les Israéliens en ont assez de tout cela. C'est vrai que le cinéma est un exorcisme pour eux et que cela leur permet de traiter des choses difficiles à vivre. Mais je pense qu'ils ont surtout envie d'être comme tous les peuples du monde, c'est-à-dire d’avoir une vie normale. Il y a toujours eu, dans le cinéma israélien, des films qui, de toute façon, quoi qu'il arrive, traitaient de ce conflit. Même dans La visite de la fanfare, qui a priori ne parlait pas de cela, il y avait ici et là de petites touches, subtiles mais malgré tout présentes. Je crois que les Israéliens en ont besoin.
Et après le 7 octobre ?
J’ai vu le dernier film de Dani Rosenberg, Of Dogs and
Je suis une grande fan des séries israéliennes, je les trouve incroyablement bien ficelées, passionnantes. Là, pour le coup, je suis presque addicte ; dès qu’il y a une série israélienne qui sort, je la regarde tout de suite ! Que ce soit sur le Mossad ou sur des femmes qui veulent s'échapper de leur famille, de leur milieu, je trouve que c'est toujours très bien représenté. Fauda, par exemple, est vraiment une très grande série israélienne, très bien faite, on a envie de voir la suite ; pour moi, c'est une espèce de modèle à maints égards.
Un jour, je me suis amusée à demander à ChatGPT ce qui se passerait si Israël était détruit et n'existait plus – puisque le monde entier veut la destruction d'Israël et qu’on ne parle que de cela. Je me disais que ChatGPT allait refléter cette haine – mais non, sa réponse a été : « Ce serait une catastrophe absolue à tous les niveaux : économique, humanitaire, financier, social, technologique. » Les Israéliens sont des gens qui sont à la pointe de tout – mais vraiment de tout ! Ils font du cinéma et des séries, ils inventent des tas de choses… Alors moi, j'adore, je trouve cela vraiment génial, et quand le Festival du Film israélien d'Hélène Schoumann, à Paris, passe quelques épisodes de nouvelles séries, cela marche extrêmement bien. n



Hélène Schoumann est une journaliste, critique de cinéma, largement reconnue pour son rôle dans la promotion du cinéma israélien en France. Elle est la fondatrice du Festival du Film Israélien de Paris, un événement majeur qui vise à faire découvrir au public français la richesse et la diversité de la production cinématographique israélienne. Depuis sa création, ce festival est devenu un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles et les professionnels, attirant des réalisateurs, des acteurs et des critiques du monde entier. Hélène Schoumann est également l’autrice du Dictionnaire du cinéma israélien. Reflets insolites d'une société, un ouvrage de référence préfacé par Jérôme
Clément, figure influente du monde culturel français. Ce dictionnaire explore le cinéma israélien comme miroir de la société, mettant en lumière la complexité des sujets abordés par ses réalisateurs, des questions politiques aux problématiques sociales et identitaires.


Le cinéma israélien, un miroir de la société
À la question de savoir ce qui définit un « film juif », Hélène Schoumann n’a pas vraiment envie de répondre – et quand elle ne veut pas, elle ne veut pas ! Son label, c’est le cinéma israélien ; et pour elle, un film israélien ne peut se réduire à une simple étiquette. Bien que la communauté juive y soit largement représentée, le cinéma israélien embrasse des récits qui dépassent les frontières religieuses et culturelles, reflétant une société complexe où se croisent Juifs, Musulmans, Chrétiens, Bédouins… Hélène Schoumann souligne que le cinéma israélien couvre des sujets variés, comme l'armée, un thème peu familier aux Juifs de la Diaspora. « Dans le cinéma israélien, on aborde aussi de nombreux aspects de la société qui ne sont pas uniquement d'ordre religieux ou communautaire », affirme-t-elle. Ainsi, des films comme Pink Lady, de Nir Bergman, plongent dans l'univers ultraorthodoxe, évoquant les dilemmes et les contradictions de cette communauté, sans pour autant se limiter à un public juif. Ce qui intéresse avant tout Hélène Schoumann, c'est de promouvoir des œuvres qui témoignent des réalités israéliennes sous tous leurs aspects.
Un festival engagé, témoin d'une réalité complexe
Le Festival du Film Israélien de Paris, organisé chaque année en mars, est un rendez-vous de choix pour les amateurs de cinéma israélien. Pendant huit jours, trois catégories sont mises en avant : les films de fiction, les documentaires et une sélection de courts-métrages issus d'écoles

de cinéma israéliennes réputées, telle que celle de l'Université de Tel Aviv et la Sam Spiegel Film School. Ce festival n'est pas qu'une vitrine pour le cinéma israélien, c’est un espace de débat, de réflexion et de rencontre entre le public et les artistes. Des courts-métrages réalisés par des étudiants sont projetés avant chaque long-métrage, car pour Hélène Schoumann ces œuvres « représentent les talents de demain ».
Lors de l'interview, Hélène Schoumann a aussi évoqué l'impact des événements récents du 7 octobre, rappelant que les œuvres liées à cette date seront rares cette année. « C'est encore trop tôt », explique-t-elle, car les projets en cours datent d'avant ces événements. Cependant, elle prévoit des œuvres à venir abordant cette thématique dans les prochaines années. Cette année, le festival montrera toutefois
déjà deux films inspirés par le 7 octobre.
Hélène Schoumann confie également la raison personnelle qui l'a motivée à créer ce festival. Passionnée de longue date par le cinéma israélien, elle a réalisé ce rêve en 2001 avec le soutien de son amie Sophie Dulac, directrice du cinéma Majestic Passy. En plus de leur relation professionnelle, leur amitié a contribué à faire du festival un projet solide et durable. « Parfois, il faut mettre sa vie à la hauteur de ses rêves », déclare Hélène Schoumann. Avec la vitalité qu'elle insuffle à son festival et sa persévérance à promouvoir les créations cinématographiques israéliennes, Hélène Schoumann continue à rendre le cinéma israélien accessible, permettant au public français de découvrir une culture aussi riche que complexe. n


Fondatrice et directrice artistique de Cinéfranco, le plus grand festival de films francophones en Ontario, Marcelle Lean évolue entre deux cultures, entre deux mondes. D'origine marocaine et juive séfarade, elle a grandi à Casablanca puis en France, avant de poursuivre des études en anglais à la Sorbonne et de résider à Liverpool. Son attrait pour les cultures anglophones l’a conduite au Canada où elle vit depuis plus de cinquante ans, ayant choisi Toronto pour sa famille et ses aspirations professionnelles. Mariée à un Juif ashkénaze, elle évoque avec humour les défis d'une union entre deux cultures. Cinéfranco est né du désir de Marcelle Lean de créer une vitrine pour le cinéma francophone, perçu comme trop élitiste au Canada. Inspirée par son expérience, notamment chez Téléfilm Canada, elle a fondé en 1998
à Toronto ce festival destiné à démocratiser le cinéma francophone, incluant le cinéma québécois, français et nord-africain. Les thèmes abordés – identité, racisme, féminisme, colonialisme – font ressortir ses valeurs de diversité. Malgré la pandémie, le festival a persévéré. Cinéfranco entretient un partenariat de longue date avec le Festival du Film juif de Toronto, bien que variable en fonction des thématiques partagées. Marcelle Lean, attachée à ses racines juives marocaines, y voit une opportunité d'échanges culturels, renforçant ainsi la communauté francophone de Toronto. Malgré les récents événements géopolitiques, Marcelle Lean se réjouit de la diversité des membres de Cinéfranco, qui regroupe des bénévoles de toutes origines. Ses valeurs d'ouverture et de dialogue interculturel sont au cœur de Cinéfranco, qui continue à célébrer la francophonie sous toutes ses formes, sans exclusivité ni préférence. n

Élisa Tovati est une artiste au parcours riche et diversifié, révélée au grand public en France dans son rôle mémorable de Shoshana dans la comédie culte La vérité si je mens en 1997. Le succès de ce film, qui a conquis plus de 8 millions de spectateurs, a marqué un tournant dans sa carrière. Pour Élisa, qui joue depuis qu’elle a 15 ans, cette expérience reste inoubliable : « C'était mon premier grand rôle, donc c'était fantastique », confie-t-elle. Incarnant une jeune femme haute en couleur, ce personnage lui a ouvert les portes du succès et permis de se faire connaître du grand public.
Après ses débuts remarqués, Élisa Tovati ne s'est pas limitée au monde du cinéma. Elle a également développé une carrière musicale en parallèle et se réjouit de ce cheminement singulier. Pour elle, le véritable plaisir ne réside pas seulement dans la notoriété mais dans le processus de création, à travers lequel elle peut donner vie à des projets personnels tout en se laissant inspirer par l'univers des autres.
Élisa Tovati se dit admirative de la capacité des artistes israéliens à capturer la réalité et les événements marquants avec une sincérité poignante, soulignant la puissance de ce cinéma « qui colle le plus possible à l'actualité ». Elle est d'ailleurs fan de la série Fauda et rêve de pouvoir un jour y participer : « Fauda, donc Lior, si tu lis cet article, on travaille ensemble quand tu veux ! », lance-t-elle avec enthousiasme.


Directeur des opérations et responsable de la programmation du Toronto Jewish Film Festival (TJFF), Jérémie Abessira, ancien kibboutznik, travaille dans le saint des saints des festivals juifs. En effet, le TJFF, bien plus qu'une simple célébration cinématographique, est un voyage captivant au cœur de la culture, de l'histoire et des multiples facettes de l'expérience juive, présenté avec une sensibilité artistique unique. Depuis sa fondation en 1993, le TJFF est devenu un pilier de la scène culturelle torontoise et un rendez-vous incontournable pour les cinéphiles de tous horizons, attirant des spectateurs curieux et passionnés. Le parcours de Jérémie Abessira se mêle intimement à l’histoire du TJFF.
AJ MAG : Qu'est-ce qui vous a amené à Toronto ?
Jérémie Abessira : À l'origine, j'étais venu pour effectuer mon stage de fin d'études dans un festival de films francophone : Cinéfranco. Très vite, d'autres opportunités dans le milieu des festivals se sont présentées, car Toronto est la ville où l'on trouve le plus de festivals de films au monde – environ 120. Finalement, j'ai rejoint le Festival du Film juif, le tout premier festival que j'avais contacté avant même mon arrivée et celui où je souhaitais initialement faire mon stage. C'était pour moi l'endroit idéal où allier ma passion pour le cinéma et mon intérêt pour l'identité juive. Il n’a pas d'équivalent en France. Ma passion remonte à mon enfance. Je passais mes weekends et mes soirées au cinéma, souvent en solo. En France, je travaillais pour un mouvement de jeunesse, l’HaShomer HaTzaïr, où j'organisais des projections de films pour faire découvrir de petites pépites cinématographiques à mon entourage et au-delà. Une révélation s'est produite lors d'un festival en Nouvelle-Zélande où j'ai passé une semaine à enchaîner les séances. Je me suis alors dit que j'adorerais être cette personne qui présente un film avant la projection. C'est ce qui m'a poussé vers ce métier. Parallèlement à mon travail pour le festival francophone, j'ai commencé comme bénévole pour
le Festival du Film juif, car je tenais absolument à m'impliquer. En France, il n'existait alors aucun festival de films juifs, donc se retrouver dans une ville où l'on projetait 100 films juifs en une semaine était une expérience inédite pour moi. Ce bénévolat m'a permis de faire mes preuves et peu à peu j'ai pris des responsabilités au sein de l'organisation, jusqu'à devenir directeur des opérations et en charge de la programmation. Aujourd'hui, je visionne environ 150 à 200 films sur les 800 que nous recevons chaque année, toujours avec la même excitation.
Comment définiriez-vous le cinéma juif aujourd'hui ? C'est une question que l'on nous pose souvent. Pour nous, un film juif ne dépend pas de l'identité des réalisateurs ou des acteurs, mais bien de son contenu. Il peut s'agir de tout film abordant l'histoire, la culture ou la vie contemporaine de la communauté juive dans toute sa diversité. Par exemple, un film israélien est presque toujours perçu comme juif, sauf s'il n'aborde pas la thématique du judaïsme. Les sujets peuvent varier, allant de la comédie avec une scène de chabbat à des documentaires plus pointus sur la Shoah ou la vie des communautés juives actuelles. lll



lll
Nous recherchons un équilibre thématique, sans surreprésenter un sujet particulier, pour proposer une programmation riche et variée.
Quel est votre regard sur les événements récents et leur impact sur la programmation ?
Les réalisateurs se sont rapidement emparés du 7 octobre et nous recevons déjà des films abordant cette date. Cependant, nous ne souhaitons pas centrer le festival autour de ce sujet, préférant le traiter avec parcimonie pour ne pas saturer notre programmation et pour continuer à attirer un public diversifié. Nous présenterons un ou deux films sur le sujet, mais nous voulons rester sur une ligne éditoriale équilibrée.
Pouvez-vous nous dire un mot sur le festival Dia(s)porama de Paris ?
Pendant le Covid, j'ai travaillé pour plusieurs festivals internationaux de films juifs. Avec Fabienne CohenSalmon, nous avons cofondé le Festival Dia(s)porama en France, car il n'y en avait aucun de ce type dans le pays, malgré une communauté juive importante. Nous avons pensé qu'un lancement en ligne serait une première transition idéale, capable d'atteindre un large public et de surmonter certains obstacles logistiques. Aujourd'hui, le festival existe toujours. Même si je n'y suis plus impliqué directement, je suis très fier de son développement.
Comment voyez-vous l'évolution du Festival du Film juif de Toronto ?
Aujourd'hui, avec environ 35 000 entrées annuelles et une équipe de six permanents, le festival est l'un des trois plus grands festivals de films juifs au monde, et le troisième plus important de Toronto. Grâce à une programmation variée et des projections dans différentes zones de la ville, nous touchons un public à la fois juif et non juif. Nous proposons également des projections et des discussions qui nourrissent la réflexion et créent du lien. C'est un espace où la communauté peut se rassembler, où le cinéma devient un moyen de communion et de partage, encore renforcé par les événements récents qui suscitent le besoin de se retrouver ensemble.
Cela fait trente-trois ans que ce festival existe, et c'est aussi grâce à la vision de notre fondatrice, Hélène Zuckerman, qui a puisé son inspiration du festival de San Francisco. Sa persévérance a permis au festival de grandir pour devenir un rendez-vous incontournable dans le paysage culturel de Toronto. n
Nelly Kafsky, avec une formation en lettres, a d'abord été attirée par la scène avant de se tourner vers la production pour adapter son roman Le rêve d'Esther. Elle a produit des séries à succès comme Terre Indigo et Les Cordier, juge et flic, avant de fonder Nelka Films et Mazel Productions dans le cadre desquels elle a lancé des sagas télévisées et des films de grande qualité. Sa dernière production sort bientôt au cinéma : Le choix du pianiste, réalisé par Jacques Otmezguine. À notre demande, elle évoque son métier, et le lien avec le 7 octobre.


Lorsque j’étais petite, un proche de ma famille revenu des camps, qui me terrorisait, m’a beaucoup marquée en me racontant « l’indicible ». Bien des années plus tard, je me suis souvenue de ce qu’il m’avait transmis en me répétant sans cesse : « N’oublie jamais, tu m’entends ?! » Il m’a fait découvrir l’envers du décor de la première mort organisée industriellement, acte unique et inique. C’est sans doute pour cette raison que la plupart des films que j’ai envie de produire traitent de la Shoah ou/et de la condition des Juifs à travers le temps et le monde. Mais raconter l’histoire des Juifs par le biais du cinéma ou de la télévision devient de plus en plus compliqué. C’est un véritable sacerdoce.
Les histoires imaginées par des auteurs dans mon bureau
prennent forme. Produire de tels films représente un véritable défi qu’une productrice indépendante et juive comme moi doit à tout prix relever. Nous sommes les héritiers d’une riche culture. Nous essayons de transmettre notre histoire par l’humour et par les sentiments, aussi abondante et « lourde » soit-elle, afin de pallier l’amnésie générale et de raviver ce qu’on appelle le devoir de mémoire. C’est également répondre aux questions par des questions : pourquoi ? Pourquoi tant d’antisémitisme depuis des siècles ? Pourquoi cette violence encore plus importante envers les Juifs dès le lendemain du massacre du 7 octobre en Israël ? Nombreux sont ceux qui continuent à créer, à s’exprimer au péril de leur vie, utilisant leur art
pour témoigner de la souffrance du monde. Ils entretiennent l’espoir et l’humanité dans des moments de grand tourment. Malgré le siècle qui nous sépare de celui de certains de nos héros, on constate que ces sujets demeurent malheureusement particulièrement actuels.
Pour ma part, entre les mots « n’oublie jamais » de mon enfance et le perpétuel slogan de ma mère répétant à l’envie « intègre-toi, ma fille ! », j’essaie de me tenir debout et de trouver ma place. Très modestement, je crois que j’ai respecté ces deux injonctions. Je me suis intégrée dans cette France que j’aime tant et je n’ai jamais oublié. Je vis et je produis le mieux possible, mais en sautant de plus en plus à travers les cerceaux enflammés. n

À l’approche de 'Hanouka, cette fête emblématique d’un combat qui dépasse le domaine matériel pour se concentrer sur un affrontement idéologique, replongeons dans les événements marquants qui en sont à l’origine et les figures héroïques qui ont façonné l’histoire, tels les Maccabées, jusqu’à la libération de Jérusalem des mains de l’Empire séleucide.
Après la destruction du Premier Temple, le peuple d’Israël est retourné sur sa terre et a reconstruit le Second Temple. Les prêtres, qui gèrent les rituels sacrés, y assument également le rôle de dirigeants politiques du peuple. Même lorsque, dans la foulée d’Alexandre le Grand, la région est conquise par les Grecs, la Judée conserve une certaine autonomie. L’idolâtrie, pourtant omniprésente dans le monde hellénistique, y demeure interdite. Toutefois, la culture hellénistique s’infiltre peu à peu en Terre d’Israël. De nombreux habitants s’« hellénisent »,

adoptant les coutumes et les croyances grecques. Cette influence grandissante crée une fracture au sein du peuple entre ceux qui restent fidèles à leur religion et les hellénisants. Parmi ces derniers, certains prêtres corrompus pactisent avec les Grecs, évincent le grand-prêtre légitime et achètent leurs fonctions. Ainsi, ils transforment le culte du Temple en une institution politique imprégnée de la culture idolâtre hellénistique.
Une époque troublée
Les tensions atteignent leur paroxysme au IIe siècle avant notre ère. La Terre d’Israël tombe sous la domination des Séleucides, un puissant royaume grec s’étendant jusqu’à l’actuel Irak, la Turquie et le Pakistan. Antiochos IV Épiphane, alors souverain, impose de sévères sanctions aux Juifs fidèles à la Torah : interdiction de l’étude de la Torah, de la circoncision, de l'observance du chabbat, et arrêt des sacrifices au Temple. Pire encore : il installe même une statue du dieu grec Zeus dans le Temple et contraint les Juifs à


lui offrir des sacrifices. Les huiles pures nécessaires à l’allumage de la menorah sont profanées, menaçant la continuité des rituels sacrés.
Une révolte inspirée par la foi
Face à ces persécutions, Mattathias, un prêtre de Modiin, refuse de se soumettre aux décrets du roi. Il tue un officier séleucide et un Juif prêt à sacrifier aux idoles, puis appelle à la révolte en proclamant : « Qui est pour l’Éternel, qu’il me suive ! » Accompagné de ses cinq fils, dont Judas, il se réfugie dans les montagnes, et mène une guérilla contre les forces séleucides et les hellénisants. Les acteurs de ce soulèvement sont connus sous le nom de « Maccabées », un acronyme tiré du verset : « Mi Kamokha baElim HaChem ? » – « Qui est comme Toi parmi les dieux, ô Éternel ? »
Après la mort de Mattathias, Judas prend la tête de la révolte. En 164 avant notre ère, les Maccabées entrent à Jérusalem et purifient le Temple. Ils n’y trouvent qu’une petite fiole d’huile pure, suffisante pour un jour
seulement. Mais un miracle se produit : l’huile brûle pendant huit jours, le temps nécessaire pour préparer une nouvelle huile pure. Les Maccabées poursuivent leur combat jusqu’à reprendre le contrôle total de la ville, établissant une souveraineté juive sous la dynastie hasmonéenne.
L’héritage hasmonéen
La période hasmonéenne dure environ 77 ans, de 140 à 63 avant notre ère, jusqu’à ce que le général romain Pompée conquière Jérusalem et transforme la Judée en province romaine.
Aujourd’hui, en visitant la Vieille Ville de Jérusalem, on peut voir de fascinants vestiges de l’époque hasmonéenne, témoins d’un passé glorieux. Parmi les découvertes les plus remarquables figurent des pièces de monnaie ornées de symboles juifs comme la menorah et d’antiques inscriptions découvertes au Centre Davidson, où figure l’ancien nom de Jérusalem : « Yeruchalem ».
Des fouilles dans le Cardo, situé entre les quartiers juif et arabe de la Vieille Ville, ont révélé des murs et des fortifications attestant des efforts des Hasmonéens pour protéger Jérusalem. De plus, des balles de baliste trouvées dans le fossé de la citadelle de la Tour de David témoignent des combats acharnés sous le règne de Jean Hyrcan Ier (135-104 avant notre ère).
Une guerre de civilisation qui perdure
L’histoire des Hasmonéens et des Maccabées n’est pas seulement un ancien récit de résistance. Elle symbolise le combat d’un peuple pour préserver son héritage face à des forces cherchant à l’effacer. Depuis plus de deux mille ans, les Juifs défendent leur identité, leur foi et leurs valeurs. Aujourd’hui encore, ce combat se poursuit, face à des idéologies qui glorifient la haine et la violence. Mais en réponse, le peuple juif choisit d’illuminer le monde par la vie, la solidarité et l’espoir. Dans quelques semaines, des milliers de foyers allumeront les lumières de la 'hanoukia, rappelant que même une petite flamme peut repousser les ténèbres les plus profondes et offrir un exemple universel de bonté et d’humanité. n
Chmouel Bokobza Guide touristique diplômé du ministère du Tourisme
Visite culinaire guidée tous les vendredis matin à Mahane Yehouda Inscription un jour à l'avance - Tél. : 050-3553811

La chambre hyperbare ou le caisson de décompression : deux appellations différentes de ce qui ressemble à un sous-marin, où les patients sont exposés à une pression supérieure à la pression atmosphérique. C’est dans le centre médical Shamir, également connu sous le nom d’Assaf HaRofé, que se trouve le Mercaz Sagol. Créé en 1997, c’est le plus grand et le plus sophistiqué centre de médecine hyperbare au monde. Plus de 300 patients y sont traités chaque jour. Nous avons rencontré le professeur Shai Efrati, directeur de cette institution de renommée internationale.

AJ MAG : Comment la médecine hyperbare fonctionne-t-elle et en quoi est-elle différente de la médecine conventionnelle ?
Shai Efrati : Nous sommes habitués à être soignés soit avec un scalpel, soit avec des substances chimiques sous forme de médicaments. Dans la médecine hyperbare, avec l’aide de la pression et des concentrations de gaz, nous modifions les conditions environnementales pour obtenir un effet biologique. Dans certains cas,
augmenter la pression et la décompression permet par exemple de traiter des personnes ayant eu des accidents de plongée. En montant rapidement dans l'eau, une bulle se forme. Nous réduisons la bulle par pression. Dans d’autres cas, nous utilisons l'oxygène comme médicament. Cela se fait par la compression de l'air, pour qu'il y ait plus de molécules par unité de volume et ainsi plus d’oxygène qui arrive aux poumons et, de là, dans le sang. Cette technique sera utilisée pour les intoxications au monoxyde de carbone (aspiration de fumée). Pour un grand groupe de patients, la médecine hyperbare a pour objectif de régénérer les cellules, ce qui active le processus de guérison.
Comment parvient-on à régénérer des cellules ?
En doublant la pression de l’atmosphère avec 100 % d'oxygène, on augmente la quantité d'oxygène dans le sang de 100 à 1600/1700 mmhg. À ce niveau, la concentration d'oxygène est suffisante pour tous les besoins vitaux. Pendant ce traitement, toutes les vingt minutes, nous demandons aux patients de retirer leur masque, donc l'oxygène descend d'une valeur très élevée jusqu’à la normale. Cette diminution est interprétée par le corps comme un manque d'oxygène alors qu'il y a un excès d'oxygène, ce qui pousse le corps

à activer des processus de guérison qu'il n'active généralement qu'en cas de manque. Les cellules souches commencent à proliférer et à migrer. De nouveaux vaisseaux sanguins se forment, ce qui active tous les processus de guérison du corps.

Le centre renferme une aile dédiée au PTSD, le syndrome de stress posttraumatique : de quelle façon la médecine hyperbare peut-elle agir sur les personnes qui en souffrent ?
Nous savons aujourd’hui – grâce aux IRM fonctionnelles, aux cartographies cérébrales et aux imageries métaboliques du cerveau – que de sévères traumatismes psychologiques peuvent également causer des dommages biologiques. C'est pourquoi de nombreux patients sont résistants aux traitements psychologiques. Chaque fois que nous voyons une lésion biologique cérébrale avec une caractérisation du tissu correspondant à une plaie biologique, nous pouvons administrer un traitement qui va soigner la plaie.
L’efficacité du traitement est-elle liée au laps de temps écoulé depuis le traumatisme ? Il est toujours préférable d'arriver le plus rapidement possible après un traumatisme mais nous soignons aussi des patients souffrant d’un syndrome de stress posttraumatique depuis la guerre de Kippour. Des gens du monde entier viennent se faire traiter dans notre centre.
Quelles autres maladies peuvent être traitées ?

Que recommanderiez-vous à la population vieillissante ?
De même qu’on fait des analyses de sang pour vérifier le cholestérol, les reins, le foie, ou qu’on procède à des coloscopies, il faut faire un examen périodique du cerveau pour contrôler l’état des fonctions cognitives. Si nous identifions les problèmes à un stade précoce, nous pouvons les traiter.
La médecine hyperbare en Israël est-elle remboursée par les caisses de santé ou est-ce un traitement privé ?
Certaines indications – pas toutes – sont remboursées par les koupot 'holim. Le traitement du PTSD pour les soldats est couvert par le ministère de la Défense s'ils sont jugés éligibles. Même les civils affectés par les événements du 7 octobre peuvent bénéficier d'un traitement grâce à un programme financé par des dons.

Certains AVC, des traumatismes crâniens, des COVID longs, des fibromyalgies… Nous pouvons également agir sur le déclin fonctionnel lié à l’âge – principalement pour des personnes vieillissantes en bonne santé qui souffrent d'un léger déclin cognitif. Dans certains cas, il est possible de régénérer des neurones et des vaisseaux sanguins, et d'améliorer les fonctions cognitives. Mais dans d’autres, comme la maladie d'Alzheimer avancée, il est trop tard car le tissu cérébral n'existe plus.
Il faut toutefois signaler qu’il y a beaucoup de charlatans dans ce domaine, avec des cellules privées illégales qui fonctionnent avec un compresseur, sans l'approbation du ministère de la Santé. C'est une escroquerie et c'est très dangereux !
En tant que médecin et chercheur spécialisé en médecine interne et en néphrologie, comment êtes-vous arrivé à la médecine hyperbare ?
C'est une longue histoire que je raconte dans mon livre qui vient de sortir sur Amazon : Beyond Normal. Tout a commencé par une recherche que nous avions mise en place sur les neurones, où nous avons découvert qu'ils se renouvellent… C'était très excitant et émouvant.
L'innovation vient toujours de quelque chose qui n’était pas prévu au programme… n
Propos recueillis par Anne Da Costa

À chaque soldat tombé, notre cœur se serre un peu plus ; et quand le nom « autorisé à la publication » a une consonance familière, la peine est encore plus vive. C’est ce qui s’est passé avec l’annonce du décès de Ronny Ganizate, d’Elie Amsellem, de Sivan Weil… et de tant d’autres soldats franco-israéliens tombés au combat cette année. Un dénominateur commun unit ces héros de la nation : leur amour inébranlable pour Eretz Israël. Cet attachement à la terre, même s’il est le fruit de l’éducation parentale, est souvent renforcé par les mouvements de jeunesse juifs. Retour sur ces mouvements qui ont façonné l’identité sioniste de plusieurs générations de Juifs français.
Les mouvements de jeunesse juifs en France sont synonymes de rencontres hebdomadaires et de colonies de vacances. Pour certains Juifs français non scolarisés en école juive, ces mouvements de jeunesse représentent le seul lien avec leurs racines, leur offrant l’occasion de découvrir l’hébreu, l’histoire juive, ainsi que les valeurs et les lois de la Torah. En somme, ils jouent un rôle essentiel dans la construction de l’identité de la jeunesse juive française. Fondés en 1923 par Robert Gamzon, les Éclaireuses Éclaireurs Israélites de France (EEIF) comptent aujourd’hui près de 5000 membres répartis dans plus de 25 villes en France, et 250 membres en Israël (principalement à Jérusalem,
Raanana et Tel Aviv). Véritable « fabrique » de l’amour d’Israël, les EEIF encouragent chaque dimanche la transmission des valeurs millénaires du judaïsme au travers de chants, de récits, de messages inspirants, toujours dans le jeu et la bonne humeur. Lors des camps de vacances organisés en été et en hiver, il règne une atmosphère unique. « On rentrait chaque été avec des étoiles plein les yeux, des souvenirs extraordinaires. Je me rappelle des chants en hébreu qu’on apprenait dans les camps. Je n’avais qu’une envie : m’installer en Israël et, grâce à Dieu, c’est chose faite », se remémore Juliette, ancienne EEIF du groupe local de Versailles aujourd’hui installée à Jérusalem.
David Sultan, président des EEIF en Israël, ajoute : « Ces mouvements
offrent un cadre unique pour apprendre des choses sur la société, sur les autres, et surtout sur soimême. Ils permettent également de développer des compétences fondamentales comme le leadership, le travail en équipe et la résilience, qui préparent naturellement à des étapes importantes comme le service militaire. On peut en voir l’impact positif non seulement sur l'identité des jeunes et le réseau qu’ils bâtissent pour leur avenir, mais aussi sur leur confiance en eux. »
Un autre mouvement « phare » dans le paysage sioniste, ce sont les Bnei Akiva. Fondé en 1929 au sein du mouvement Mizrahi, ce mouvement de jeunesse sioniste-religieux prône l'idéal de « Torah veAvodah » (Torah et travail), qui allie vie spirituelle et contribution au développement


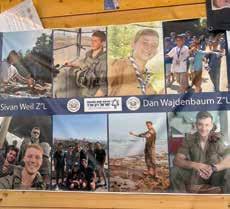

de la société israélienne. À travers des activités régulières et des camps de vacances, le mouvement transmet un fort attachement à Eretz Israël, aux valeurs de la Torah et à la culture hébraïque. Chaque rencontre, au sein des groupes locaux, vise à inspirer les jeunes à vivre leur judaïsme en harmonie avec un engagement sioniste actif, et donc à faire leur Alya. Avant Yom Kippour, l’un de ses anciens membres, le soldat Ronny Ganizate, za''l, est tombé au combat. Son frère Raphaël témoigne : « Ronny vivait pleinement le Bnei Akiva jusqu’à aujourd’hui. Il a fait son Alya en 2007 avec la " hakhchara " du mouvement et il est resté très impliqué, organisant des rencontres avec les anciens. Son sionisme, fidèle aux valeurs du Bnei Akiva, était celui de " Torah et travail ". Il a toujours gardé son âme d’enfant : lors des rencontres familiales, il
passait des heures à jouer avec les enfants.
altruisme
amour pour Israël étaient faisait toujours tout avec le sourire, nous encourageant à faire de même. » Il existe également d’autres mouvements, comme le Beitar et Moadon Israël, eux aussi très actifs et éveillant l’identité sioniste des jeunes qui en font partie.
De la France à Israël : un choix de cœur et de conviction
C’est donc naturellement que de nombreux jeunes ayant fréquenté ces mouvements développent un profond amour pour la Terre d’Israël et choisissent de faire leur Alya. Lors des rassemblements des « anciens » en Israël, les salles sont pleines : laïques, kippot crochetées ou orthodoxes… Un public d’une diversité saisissante, reflet de la richesse du judaïsme français, uni dans sa diversité. Et c’est avec le même élan que ces jeunes rejoignent les rangs de Tsahal. David Sultan précise : « Fidèles à la méthode scoute, les EEIF ont pour but d’aider les jeunes à former leur caractère et construire leur
personnalité, et de contribuer à leur développement physique, mental et spirituel afin qu’ils soient des citoyens actifs dans la société israélienne. » Cette année, malheureusement, un nombre inhabituel de jeunes ont fait le sacrifice ultime pour défendre Israël. Le 30 octobre dernier, lors d’une soirée d’hommage à Jérusalem, dans le quartier de Baka, les anciens EEIF installés en Israël ont honoré ceux qui ont disparu en 2023. Habituellement, ces cérémonies annuelles commémorent davantage la mort de personnes âgées. Mais cette fois, la mémoire de jeunes soldats a été célébrée, parmi lesquels Sivan Weil et Dan Wajdenbaum, anciens EEIF. Tous portaient fièrement les valeurs d’entraide et de don de soi inculquées par le mouvement. Les initiatives à leur mémoire continuent à voir le jour, comme le rapporte David Sultan : « Depuis le 7 octobre, les actions des EEIF d'Israël envers les soldats franco-israéliens ont été très nombreuses : récolte de dessins d’enfants israéliens et français transmis aux soldats sur le front, actions pédagogiques sur les camps de vacances en France et en Israël à la mémoire des soldats EEIF Dan et Sivan… Nos anciens EEIF ont aussi répondu présent, notamment avec la gestion d’un centre de distribution de repas (" 'Hamal ") à Jérusalem, des collectes de dons pour du matériel, et des envois hebdomadaires de 'halot et de douceurs à plusieurs dizaines d'unités. »
Le sacrifice de ces jeunes nous rappelle que l’attachement à Israël est bien plus qu’une valeur : c’est un héritage et une mission, que chaque génération s’efforce de transmettre. n
Sarah Dray

La récente élection des deux nouveaux grands-rabbins d’Israël a suscité de vraies polémiques. L’occasion de rappeler les tenants et les aboutissants de cette fonction, dans les faits et dans la réalité.
Au XVIIe siècle déjà, la communauté juive de Jérusalem possédait un grand-rabbin à sa tête, appelé le « Rishon leTzion ». Lorsque, au début du XXe siècle, la Palestine est passée sous mandat britannique, Sir Herbert Samuel, le premier Haut-Commissaire britannique en Palestine, a instauré une commission qui a recommandé la création d'un Conseil du grandrabbinat de Palestine avec deux grands-rabbins élus à sa tête, l'un séfarade, qui a gardé le titre de « Rishon leTzion », l'autre ashkénaze. Le grand-rabbinat d'Israël est donc né en 1921 et ce sont les rabbins Avraham Itzhak haCohen Kook et Yaakov Meïr qui ont été les premiers grands-rabbins d'Israël.
Quel est le rôle des grands-rabbins d'Israël ?
Le grand-rabbinat d'Israël est la plus haute autorité religieuse de l'État d'Israël, et son influence s'étend sur le monde juif en Israël et dans la Diaspora. Il est aujourd’hui dirigé par les grands-rabbins d'Israël : le « Rishon leTzion », le rav David Yosef, et le grand-rabbin d'Israël, le rav Kalman Ber.
Le visage de cette institution a été défini par le rav Kook qui a tenu à en faire un corps apolitique ayant pour rôle de rassembler et de représenter tout le peuple. Ainsi, elle remplit une mission non seulement dans les domaines de la loi juive, mais aussi relativement à des questions sociétales, d' Alya , de sécurité ou d'agriculture, considérant que tous les domaines, mêmes profanes, deviennent des sujets juifs dans l'État juif.
L'autorité des grands-rabbins d'Israël influe directement sur la vie personnelle des citoyens juifs de l'État d'Israël puisqu'elle s'étend aux domaines concernant le statut de l'individu au regard de la loi juive (brit mila, mariage, divorce, enterrement, conversion…), au domaine de la cacherout ou encore à l'octroi du statut de rabbin et de juge rabbinique. Les grandsrabbins prennent leurs décisions en coopération avec le Conseil du grand-rabbinat. Le rôle des grands-rabbins est encadré par la loi sur le grandrabbinat votée par la Knesset en 1980, qui traite des pouvoirs et des modalités d'élection des grandsrabbins et du Conseil du grandrabbinat.
Existe-t-il une différence entre les rôles des deux grands-rabbins ?
L'un est le président du Conseil du grand-rabbinat, qui compte 17 rabbins (dont les deux grandsrabbins). En cette qualité, il détermine l'ordre du jour et dirige les réunions de ce conseil.
Le second est le président du Haut tribunal rabbinique, la plus haute instance juridique religieuse. En cette qualité, il peut influencer la politique concernant des sujets traités par les tribunaux rabbiniques, comme les divorces, la conversion, etc.
Quel est l'ordre du jour des grands-rabbins d'Israël ?
Les grands-rabbins participent à diverses réunions sur les sujets qui les concernent ainsi qu'aux réunions du Conseil rabbinique, afin de répondre à des questions concernant la loi juive dans différents domaines. Par ailleurs, ils vont à la rencontre de publics variés de toutes tendances, mais aussi des soldats de Tsahal, et ils donnent des cours.


Le président israélien Itzhak Herzog avec le grand-rabbin ashkénaze Kalman Ber lors de la cérémonie de prestation de serment à la résidence présidentielle à Jérusalem, le 4 novembre 2024 © Flash90


lll Leur emploi du temps contient également des rencontres interconfessionnelles, lors desquelles ils s'entretiennent avec les dirigeants des autres religions représentées en Israël. Ces relations s'étendent même au-delà des frontières israéliennes, notamment avec le pape et les chefs de l'Église anglicane.
Qui peut être candidat au poste de grand-rabbin ?
Pour pouvoir se présenter au poste de grand-rabbin d'Israël, il faut être reconnu comme un rabbin important et remplir deux conditions principales :
1. Être juge rabbinique ou rabbin de ville, ou être apte à exercer l'une de ces deux fonctions, ou encore avoir
été considéré comme « un Grand en Torah » par le Conseil du grandrabbinat.
2. Être âgé d'au moins 40 ans et d'au plus 70 ans.
Comment sont désignés les grands-rabbins ?
Les deux grands-rabbins sont désignés par un corps électoral de 150 personnes lors d'un vote direct, secret et individuel. Les 150 électeurs sont 80 rabbins et 70 représentants du public. Parmi les rabbins, on trouve des rabbins de ville ou de quartier, des juges rabbiniques, mais aussi le grand-rabbin de Tsahal. Parmi les représentants du public se trouvent des maires, des chefs de
conseils locaux, des ministres, des membres de la Knesset. Chaque membre du collège électoral vote pour trois à cinq candidats au poste de grand-rabbin séfarade et trois à cinq candidats pour le poste de grand-rabbin ashkénaze. Sont élus ceux qui obtiennent le plus de voix. En cas d'ex aequo, un second tour départage les candidats. Les grandsrabbins sont élus pour un mandat de dix ans non renouvelable.
Une institution devenue controversée
L'institution du grand-rabbinat d'Israël, qui se voulait apolitique et qui devait rassembler tout le peuple d'Israël, s'est peu à peu politisée et éloignée d'une partie du peuple.

Ce constat est d'abord lié à la manière dont les grands-rabbins sont élus. En effet, les hommes politiques jouent un rôle déterminant dans la désignation des deux grands-rabbins. Ces deux personnalités sont, en général, convenues entre les différents partis politiques religieux avant que le vote n'ait lieu. Ainsi, traditionnellement, le grand-rabbin ashkénaze est choisi par le parti orthodoxe lituanien Yahadout HaTorah et le « Rishon leTzion » (le grandrabbin séfarade) par le parti orthodoxe séfarade Shas.
Ces dernières années, de nombreuses voix s'élèvent au sein du sionisme religieux pour exiger qu'au moins un des deux grands-rabbins représente ce courant. Lors des dernières élections, cela a donné lieu à des tractations entre
les partis politiques qui ont abouti à un ex æquo entre les deux candidats au poste de grand-rabbin ashkénaze. Finalement, après un second tour pour les départager, le candidat soutenu par le parti sioniste religieux HaTzionout HaDatit a été battu.
Ces arrangements contribuent à faire du grand-rabbinat une institution qui est perçue comme noyautée par la mouvance orthodoxe, rejetant toute autre manière de penser ou de pratiquer. C'est d'ailleurs ce qui a donné naissance à des instances religieuses parallèles comme Tzohar, initiée par des rabbins sionistes religieux, qui délivre des certificats de cacherout ou encore célèbre des mariages.
Toute tentative de limiter le monopole du grand-rabbinat dans des domaines
comme la cacherout ou la conversion se heurte à une féroce opposition des partis orthodoxes, même si les projets proposés respectent scrupuleusement la loi juive. Et comme tout monopole, il suscite la méfiance d'une partie du public qui accuse désormais l'institution d'être mue par des considérations de pouvoir et d'argent plutôt que par des impératifs strictement religieux. Aujourd'hui, l'un des principaux défis de cette institution centenaire est de regagner la confiance de toute une partie de la population israélienne, regroupant aussi bien des laïques que des religieux qui ne se reconnaissent pas dans son fonctionnement ni dans l'approche qui prévaut depuis des décennies. n
Guitel Ben-Ishay


La journaliste Valérie Abécassis, ancienne rédactrice en chef du magazine Culture sur i24NEWS, était l’invitée de Cathy Choukroun dans Studio Qualita pour parler de son livre Place des otages, un ouvrage qui porte un autre regard sur le 7 octobre. Interview.
Cathy Choukroun : Comment est née l’idée de ce livre ?
Valérie Abécassis : Le 8 octobre, j’ai délaissé la culture pour investir le terrain. Je suis devenue reporter de guerre – ce que je n’avais jamais fait – par la force des choses. Le contexte était évidemment terrible et j’ai enchaîné les journées de travail sans avoir le loisir de réfléchir ; j’ai été prise dans un tourbillon. Et puis un jour, une amie à qui je racontais ce que je vivais et qui me voyais quotidiennement m’a suggéré d’écrire. J’ai alors contacté un éditeur qui m’a aussitôt donné son feu vert en me disant qu’il n’avait jamais entendu parler d’Israël de cette manière. À partir de ce moment-là, écrire est pour moi devenu une nécessité. J’avais besoin que les choses sortent.
Quand on vous lit, on comprend la complexité de la société israélienne d’une autre manière. C’est aussi ce que vous vouliez raconter ? Oui, à travers toute cette douleur je voulais parler de la société israélienne de l’intérieur et raconter de quoi elle est faite, et ce à quoi elle est confrontée. Je voulais notamment raconter la détresse des familles d’otages, le chaos mais aussi l’espoir. Pour cela, je me suis attachée à prendre des notes sur ce que je voyais et entendais : beaucoup d’horreurs, mais aussi de belles choses. Le

pays est pétri de paradoxes. C’est un pays à la fois très jeune et très vieux, et qui semble voué au « presque » : il est presque en paix, presque homogène, presque tout… Ce sont toutes ces facettes que je voulais transmettre, aussi bien aux lecteurs franco-israéliens, qui peuvent découvrir des choses qu’ils ne savent pas encore, qu’aux lecteurs de France qui ignorent cette réalité du pays. Je suis heureuse des très bons retours que j’ai par rapport au livre : les gens me disent qu’ils ont été happés par mon récit, qu’ils l’ont trouvé fort, bouleversant et porteur d’un regard original sur la société israélienne.

Avec la parution de votre livre et l’écho médiatique qu’il reçoit, vous êtes devenue une sorte de porte-parole informelle d’Israël. Comment vous sentez-vous dans ce rôle ?
J’ai l’impression de vivre ce que les Juifs de France vivent depuis plus d’un an. À chaque fois que je suis invitée par un média, on me demande des comptes sur la politique israélienne, on me demande de parler au nom du gouvernement israélien. Je me retrouve dans des situations parfois inconfortables, avec des « coureurs de plateaux » souvent de gauche, assez rarement de droite. Je me suis même retrouvée dans une émission en train de dire pour qui j’avais voté…
On a le sentiment que quelque chose a changé en vous depuis le 7 octobre, que votre regard sur la résolution du conflit israélopalestinien n’est plus le même… Pendant longtemps, j’ai voulu croire que la paix était possible ; mais aujourd’hui c’est terminé, du moins avec cette génération de Palestiniens. Je ne vois pas comment des ponts pourraient être créés. Comment y croire après la barbarie des attaques et les sondages qui font état du soutien de la grande majorité des Palestiniens au Hamas ? Je reste également très marquée par les crachats et les jets de pierre sur les ambulances qui transportaient les otages libérés de Gaza jusqu’à la frontière égyptienne, des expressions de haine pure.

« Le 8 octobre, j’ai délaissé la culture pour investir le terrain. Je suis devenue reporter de guerre – ce que je n’avais jamais fait – par la force des choses. » © DR
Le 7 octobre vous a-t-il définitivement attachée à ce pays ?
C’est évident. Mon rapport à ce pays a changé, sur un plan non pas politique mais charnel. C’est un pays compliqué, un pays qui parfois rend fou, mais c’est un
pays qui vous habite. Le lien est indéfectible, vous ne pouvez plus vous en séparer. n
Place des otages, de Valérie Abécassis Éditions du Cerf, septembre 2024
Entretien retranscrit et mis en forme par Johanna Afriat

Pierre Lurçat, enseignant et auteur, vient de publier en français dans la collection « Bibliothèque sioniste » un recueil de textes inédits de David Ben Gourion qui révèlent une facette méconnue du premier dirigeant d’Israël, réputé laïque convaincu : En faveur du messianisme. L’État d’Israël et l’avenir du peuple Juif. Pierre Lurçat démontre que l’idée de la rédemption était très présente chez David Ben Gourion. Contre toute attente, le messianisme faisait partie intégrante du processus qui a permis la renaissance de l’État hébreu moderne.
AJ MAG : Parlez-nous de ces livres que vous éditez à compte d’auteur…
Pierre Lurçat : Le but de la « Bibliothèque sioniste » est de faire découvrir au public francophone les fondateurs du sionisme. J’ai commencé par Jabotinsky que je connais bien, puis je suis tombé par hasard sur la première autobiographie de Golda Meir – écrite avant la très grosse autobiographie qu’elle a rédigée quand elle a pris sa retraite –, qui n’avait jamais été traduite et que j’ai trouvé intéressant de traduire. Chaque fois,

l’idée est de montrer que tous ces grands hommes et femmes sont un peu différents des clichés qu’on a d’eux. Je réunis souvent des articles méconnus parus dans la presse et que je traduis autour d’un thème. Pour ce dernier livre, j’ai eu fortuitement accès à un article intitulé « L’État d’Israël : l’avenir du peuple juif », paru dans un gros livre rédigé par un historien sur le débat entre Ben Gourion et les intellectuels dans les années 1950. C’est là que j’ai découvert la vision « messianique » de Ben Gourion. J’en ai été étonné et j’ai vite eu envie de faire connaître cet aspect de sa pensée.
Quelle est la ligne conductrice des ouvrages de la « Bibliothèque sioniste » ?
Elle est simple : il faut revenir aux pères fondateurs. Depuis le 7 octobre, on redécouvre la notion de guerre d’indépendance, qui a présidé à la naissance de notre État. Car il s’agit en effet de se battre pour notre survie, et nous avons besoin de revenir à des fondamentaux. La guerre du 7 octobre a mis fin à la parenthèse postsioniste qui a commencé dans les années 1990 et qui nous a plongés dans une illusion collective qui n’a plus cours désormais.
Êtes-vous sûr que ce soit le cas pour tout le monde ?
Selon moi, oui. Mais les intellectuels sont toujours les derniers à se remettre en question car il leur faut reconnaître publiquement leurs erreurs de jugement, ce qui est très incommode pour eux.


Pourtant, quand on lit dans votre livre ce qu’écrit Ben Gourion, on se dit qu’aujourd’hui des déclarations de ce genre ne passeraient pas et seraient presque qualifiées de "messianistes", dans le sens négatif que la gauche israélienne attache à ce terme. Ainsi, selon Ben Gourion : « Le nom Juif n’est pas seulement antérieur au nom sioniste, mais il exprime aussi beaucoup plus. Le judaïsme est plus grand que le sionisme [...]. Il faut donc honorer l’État d’Israël. Ce n’est pas seulement un instrument… C’est le début de la rédemption, une petite partie de la rédemption. » Qu’en pensez-vous ? Pour moi, ces déclarations sont justement d’actualité ; et si elles semblent décalées aujourd’hui, c’est précisément parce que nous nous sommes bien trop éloignés des vérités premières qui ont

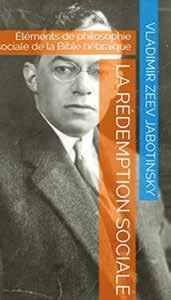
présidé à la renaissance de l’État d’Israël en 1948. Il est nécessaire de s’en imprégner à nouveau. Le messianisme est le fondement de la foi juive et, comme l’explique David Ben Gourion, c’est le secret qui nous a permis de revenir en Israël. Ce n’est pas une idée extrémiste ou de droite. Ceux qui l’assimilent au suprématisme commettent une grave erreur de jugement, souvent propagée par ceux qui se définissent comme intellectuels, et cette erreur est reprise à souhait par les médias anti-israéliens qui en font leurs choux gras.
Mais finalement, que veut dire « messianisme » ?
Gershom Scholem est un des premiers opposants à ce terme. Spécialiste du faux messie Sabbataï Tsevi, il craignait le messianisme politique comme la peste et, par extension, il a mis en garde contre l’idée que le sionisme puisse être une version moderne du messianisme. C’est assez incroyable de constater que les débats n’ont pas changé depuis cent ans ! Ces débats n’ont souvent rien de rationnel mais, pour beaucoup, ils légitiment les positions contre le gouvernement, notamment à l’étranger. Car malheureusement, sous ce terme, on amalgame la colonisation, Ben-Gvir, les religieux, Bibi… – ce qui fait du messianisme une notion fourre-tout pratique qui démonise tout ce qui contredit la philosophie postsioniste. Et, fait surprenant, on reproche presque à Bibi ce qui était reproché par les intellectuels à Ben Gourion : autoritarisme et messianisme. lll

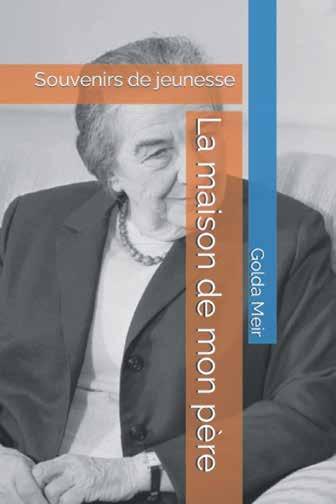
lll Tous les pères fondateurs étaient-ils habités par un idéal messianique ?
Oui, y compris Herzl. Contrairement à ce que l’on pense, la plupart étaient marqués par la Bible et avaient reçu un enseignement juif ; ils avaient une forte conscience juive et ils ont fait régulièrement le lien entre le retour à Sion et la tradition biblique. D’ailleurs, comment faire autrement pour expliquer le retour des Juifs sur leur terre ancestrale après deux mille ans d’exil ?
Si, comme vous le dites, les intellectuels ne veulent pas remettre en question leurs postulats, la classe politique, elle, paraît sclérosée par la course au pouvoir. Il y a aussi le pouvoir des juges et celui de l’establishment militaire. Toutes ces forces semblent freiner considérablement l’émergence d’une vérité post-7 octobre, capable de rompre avec des mécanismes de pensée obsolètes. Comment, selon vous, un changement pourra-t-il donc s’opérer ?
Je pense que c’est la réalité même de ce que l’on vit qui va s’imposer à nous – et qui s’impose déjà à nous par-delà les clivages politiques et les débats idéologiques. Les vrais changements prendront le temps nécessaire mais finiront par arriver. Après le traumatisme et le choc, l’espoir fait son chemin. D’abord parce que cette guerre permet d’affronter des problématiques auxquelles Netanyahou et les gouvernements précédents n’ont pas osé se mesurer mais qui vont modifier la donne géostratégique. Et puis, pour résumer grossièrement, on a compris que le sionisme, ce n’était pas que la high-tech. On a compris qu’il fallait une armée forte, des forces de sécurité entraînées, des villages équipés pour se défendre, etc. On est en train de refermer la parenthèse du doute et de l’autodénigrement national ; on le constate quand on entend les soldats héroïques qui disent combien ils considèrent le combat qu’ils mènent comme juste et nécessaire.
À la lumière de votre connaissance approfondie des pères fondateurs, que diraient-ils de la situation dans laquelle nous sommes ?
Vaste question… Je pense qu’ils seraient à la fois effarés de constater que l’existence d’Israël a été à ce point menacée après soixante-quinze ans d’existence, et en même temps rassurés de voir qu’une jeune génération est à ce point prête à prendre les armes pour défendre son pays à ses risques et périls. Cela veut dire que le sionisme a réussi. n
Propos recueillis par Caroll Azoulay
Le dernier livre de la « Bibliothèque sioniste », consacré à David Ben Gourion, est disponible à la Librairie du Foyer de Tel Aviv et peut être commandé dans toutes les librairies de France (en précisant qu’il est publié sur Books on Demand).

Travaillant depuis de longues années avec le judaïsme mondial en général et la communauté juive de France en particulier, la question du « départ des Juifs de France » m’a souvent été posée, sous des formes et en des termes plus ou moins tranchés (« Le moment est-il arrivé ? », etc.), concernant l’Alya, l’établissement en Israël, mais aussi l’émigration au Canada, en Angleterre ou… en Australie ! À différents postes, assumant diverses missions, travaillant pour des organisations communautaires ou israéliennes, j’ai eu à répondre à des questions à ce sujet ; et avec le temps, nous avons pu aborder ce questionnement de diverses manières. Nous savons depuis longtemps que ce magnifique peuple d’Israël est un peuple étonnant, cherchant toujours ailleurs un nouveau chez-soi et s’étonnant toujours des réactions des pays traversés. Comme le disait Manitou, les Juifs sont des citoyens comme les autres dans les pays où ils se trouvent, mais « plus » : les Juifs d’Allemagne se voulaient plus allemands que les Prussiens, les Juifs d’Algérie plus français que les Bourguignons ! Seulement voilà : l’espace juif à travers le monde se réduit de plus en plus, et il devient difficile de trouver un lieu tranquille sur cette planète. Peut-être que le futur nouveau ministre de Donald Trump, monsieur Musk, va nous permettre, en allant sur Mars, de trouver un havre de paix, mais même cela n’est pas sûr !

Ayant eu à rencontrer de nombreux Juifs de tous âges, tendances et milieux lors de mes derniers déplacements en France pour des conférences, ou pour participer aux salons de l’Alya organisés à Paris, Marseille ou Lyon, j’ai pu constater que la formulation de ces questions était à présent plus radicale : faut-il fuir la France, le pays de l’égalité, de la liberté et de la fraternité, où les Juifs ont de plus en plus de mal à se situer entre un parti d’extrême gauche antisémite, un président de la République « instable » et une extrême droite hier honnie mais apparaissant aujourd’hui dans les discours comme le seul parti soutenant les Juifs en France et Israël dans sa guerre ?
Encore une fois, le Juif errant est sur les routes du monde, devant fuir tant qu’il en a la possibilité – mais pour aller où ? Certains dirigeants communautaires, ne voulant pas porter la responsabilité de cet avenir flou et menaçant, installent leurs enfants en Israël et, dans des forums privés, se montrent forts réalistes, voire pessimistes, au sujet des événements actuels. D’autres, réitérant les erreurs de certains à la veille de la Seconde Guerre mondiale, calment les inquiétudes, s’appuyant sur les déclarations de dirigeants locaux – « Mais non, tout cela n’est qu’un mauvais moment, difficile, certes, mais cela va passer… » J’aurais aimé, souhaité, préféré, que les Juifs du monde viennent rejoindre leur Terre par « amour » et non par « crainte », par « ahava » et non par « yrha », ce qui devrait d’ailleurs caractériser notre relation avec le Tout-Puissant. Mais l’histoire des différentes vagues d’Alya semble nous dire le contraire. Alors peu importe : aujourd’hui, ils fuiront ces pays qui semblent les rejeter, puis, petit à petit, eux-mêmes ou leurs descendants vivront en Israël dans une totale réalisation de ce rêve porté par notre peuple et nos textes les plus sacrés depuis des générations. Et cette fuite deviendra une montée, une Alya, pour rejoindre le rêve devenu réalité, et pour être – enfin – des citoyens d’un pays libre, autonome et démocratique. n
Jean-Charles Zerbib

Ahiya,
C’est un peu étrange de t’écrire une lettre, mais j’ai pensé que ce serait la meilleure manière, la plus facile peut-être, pour te décrire ce que je ressens. Les lettres permettent d’intégrer les choses à notre rythme, de lire certaines phrases avec une mélodie un peu plus douce. Elles permettent de relire ce qu’on a besoin d’entendre plusieurs fois et de s’arrêter lorsqu’on en éprouve le besoin.
En vérité, je ne sais pas trop comment m’exprimer. J’ai peur de te faire de la peine, que tu te sentes oppressé. C’est pour cela que je préfère laisser les mots parler à ma place.
Mardi, lorsque tu es rentré, fatigué et heureux, rempli de poussières de guerre, j’ai enfin ressenti que je pouvais respirer à mon rythme. Ce grand combat est derrière nous, on peut se relâcher, cesser d’essayer de tout maîtriser pour que rien ne s’écroule. Les enfants t’ont sauté au cou, parlant tous en même temps. Tu n’entendais pas grandchose mais tu les écoutais, essayant de rattraper tout ce que tu avais manqué.
Les jours passent, la vie continue. Tu essaies de toutes tes forces de reprendre la cadence, pour que tout redevienne comme avant, comme avant Sim'hat Torah : une maison, une famille, des enfants.
Je voulais que tu saches que je vois tes efforts, ton comportement avec les enfants, avec moi. Je voulais aussi que tu saches que je te vois. Je vois ton corps crispé, je vois les
bruits qui te font sursauter, je vois tes gestes brusques et tes yeux qui ne sont plus les mêmes. Je sais que tu ne partages pas ce que tu ressens, par peur de me faire de la peine, par peur que je pense que tu n’es pas heureux d’être rentré. Tu sais, pour moi aussi c’est un peu bizarre, après tant de mois seule où j’ai dû tout gérer, de retrouver ma place, de me laisser aller et de te laisser reprendre la tienne, celle que j’ai dû occuper tout ce temps, malgré moi. Moi aussi, j’essaie de réapprendre à marcher, doucement. Hier soir, je tentais d’imaginer ce que tu pouvais ressentir. La chose la plus proche à laquelle j’ai pensé, c’est à mes accouchements. Je me souviens qu’après mes accouchements, je me sentais comme menacée par le bruit de la circulation, qui me mettait mal à l’aise, moi qui avais vécu une des choses les plus fortes qui soient, entourée de tous ces infirmiers, ces nouvelles vies, ces bébés. Même les gens venus de l’extérieur portaient un bracelet leur permettant de pénétrer quelques instants dans ce monde qui m’appartenait. À peine quelques heures plus tôt, je me trouvais comme suspendue entre le ciel et la terre. Je me souviens de cette peur de mourir, et de cette force de sainteté et de vie qui se mêlaient en moi, m’associant à Dieu qui amenait une nouvelle âme dans ce monde.
Je me souviens de la discussion que nous avions eue. Tu m’expliquais que c’était normal, qu’il fallait un certain temps pour s’adapter à cette nouvelle vie après un accouchement, un certain laps de

temps avant de retrouver la vie de tous les jours, un quotidien dans son cœur.
Je ne connais pas grand-chose sur la guerre et l’armée. Je ne sais pas ce que c’est de dormir tête-bêche avec un soldat que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que signifie un froid qui pénètre les os. Je ne sais pas comment on fait pour éloigner sa


famille de son cœur afin de pouvoir continuer à combattre, alors qu’on s’en languit. Je ne sais pas ce que c’est de perdre des amis sans avoir le temps de pleurer. Je ne sais pas ce que c’est de marcher dans les rues, prêt à réagir à tout moment pour protéger ses soldats.
Je ne veux même pas imaginer ce que c’est d’écrire une lettre d’adieu
à sa famille, à ses enfants, à ses parents ; avoir peur de la mort tout en étant prêt à l’affronter, et tout faire pour rester en vie.
Je ne sais pas ce que c’est de ressentir que chacun de tes pas est gravé dans l’histoire, toi qui es prêt à tout donner pour sauver ta famille, tes amis, tes otages. Je ne connais pas ce passage entre le
champ de bataille, où l’on combat au nom d’ HaChem et du peuple d’Israël pour exterminer le mal, pour effacer le souvenir d’Amalek, et la vie de tous les jours. Je ne sais vraiment pas comment vivre cette transition entre les moments extraordinaires que tu as vécus làbas et la simplicité du quotidien.
Je ne sais pas comment on fait pour tout intégrer et continuer à vivre.
Je voulais juste que tu saches que je ne m’attends pas à ce que cela arrive du jour au lendemain. Prends ton temps, pour comprendre et intégrer doucement tout ce que tu as vécu ces derniers temps.
Je prie pour trouver moi aussi ma place, pour réapprendre à m’appuyer de nouveau sur toi, pour apprendre à lâcher prise sans avoir peur que tout s’écroule, sans avoir peur de ne plus parvenir à redevenir l’héroïne que j’ai été tout ce temps, malgré moi.
Je serai ce pont qui te permettra de traverser le chemin entre cette guerre de survie et la vie. Je serai ce pont que nous traverserons ensemble pas à pas, un peu comme au début, quand nous nous sommes connus.
Je voulais que tu saches que je suis fière de toi ! Je remercie HaChem d’avoir le mérite de vivre à tes côtés. Je prie pour que tu continues à revenir en paix, pas à pas, à ton rythme, au rythme des héros qui ne savent pas qu’ils le sont, au rythme des soldats qui reviennent du champ de combat.
Je ne peux pas terminer sans cette phrase du rav Kook que tu aimes tant : « Le peuple de l’éternité n’a pas peur d’un long chemin. » Avec toute mon admiration, Ta femme qui t’aime n
Hanna Sellam

Dites, on l'a échappé belle, quand même ! Imaginez un instant que nos Sages aient fixé la Halakha selon Beth Shammaï et non selon Beth Hillel : quelle angoisse ! Au lieu d'allumer chaque jour de 'Hanouka une bougie supplémentaire et de finir la fête avec la 'hanoukia entièrement allumée, nous aurions fait l'inverse : le premier jour, nous aurions allumé les huit bougies, et chaque jour nous aurions éteint une bougie supplémentaire, de telle sorte que le huitième et dernier jour, notre belle 'hanoukia n'aurait été illuminée que par une simple et malheureuse bougie. De quoi nous attrister progressivement jusqu'à la déprime totale ! Un truc à nous faire passer l'envie de manger des beignets ! Mais pourquoi donc les éminents docteurs de l'École de Shammaï désiraient-ils nous faire ainsi diminuer chaque jour davantage le nombre de bougies, au risque de nous saper le moral ? C'est qu'ils tenaient à représenter symboliquement le miracle le plus fidèlement possible. Or que s’est-il passé ? Les courageux combattants, sous la direction de leur chef Yéhouda HaMaccabi, venaient de bouter les Grecs hors de Jérusalem, après de durs combats. Et au lieu de prendre un repos bien mérité sur les marches du Temple, les voici transformés en personnel de nettoyage, ôtant les statues grecques qui souillaient l'endroit, remettant les objets sacrés à leur place et recherchant passionnément de l'huile pure afin de rallumer la menorah à sept branches. Ému (si l'on peut s'exprimer ainsi) par tant de courage et d'abnégation, Dieu décida de les aider : la fiole d'huile qui aurait dû suffire à l’allumage d’un seul jour fut animée d'une énergie particulière et la combustion dura huit fois plus longtemps que prévu, jusqu'à ce qu’une nouvelle huile pure ait été produite. Ainsi, le vrai miracle, la décision divine d'intensifier l'énergie contenue dans la petite fiole, eut lieu le premier jour ! Ensuite, cette énergie diminua progressivement jusqu'à son terme. C'est pourquoi Beth Shammaï symbolise cette perte d'énergie ou, si vous préférez, la diminution, chaque jour, d'un huitième de la quantité de l'huile restante, en diminuant chaque jour le nombre de bougies. Ce à quoi Beth Hillel répond : il est exact qu’objectivement, le miracle s'atténua de jour en jour. Mais par notre allumage, nous ne symboliserons pas ce que fut objectivement le miracle divin. Nous

symboliserons la manière dont, subjectivement, les Juifs le perçurent. Or, de ce point de vue-là, il est évident que chaque jour qui passait, alors que la flamme brûlait toujours, rendait à leurs yeux le miracle plus grand, et leur enthousiasme et leur joie augmentaient en fonction.
Finalement, si la Halakha a été fixée selon Beth Hillel, c'est sans doute pour nous enseigner que bien souvent, dans la vie, ce qui compte, c'est moins la réalité objective des choses que la perception subjective que nous en avons.
D'ailleurs, si les Maccabim avaient mesuré uniquement leurs chances objectives de succès avant de se révolter contre les Grecs, auraient-ils osé lever l'étendard de la révolte ? Et si les membres du premier Congrès Sioniste réunis à Bâle avaient conditionné leur engagement


au mouvement uniquement en fonction des chances objectives de créer un État juif, Herzl serait resté toute sa vie un obscur journaliste viennois ! Et si Ben Gourion, en 1948, avait décidé de la création de l'État en fonction des chances objectives de gagner la guerre qui s'annonçait, en ne prenant en considération que le nombre de tanks, d'avions ou de soldats se trouvant de chaque côté, il n'aurait jamais déclaré l'indépendance !
Les grandes révolutions réussies de l'Histoire doivent davantage leur succès aux convictions de leurs acteurs qu'aux conditions réelles du moment de leur naissance : la Halakha de l'Histoire donne raison à Beth Hillel. Arrêtez-moi si je dis des bêtises… n
klingelie@gmail.com
CHABBAT VAYÉTSÉ
6 DÉCEMBRE 2024-5 KISLEV 5785
Jérusalem 15h55 17h15
Tel Aviv 16h14 17h16
Netanya 16h13 17h16
CHABBAT VAYICHLA'H
13 DÉCEMBRE 2024-12 KISLEV 5785
Jérusalem 15h56 17h17
Tel Aviv 16h15 17h18
Netanya 16h14 17h17
CHABBAT VAYECHEV
20 DÉCEMBRE 2024-19 KISLEV 5785
Jérusalem 15h59 17h20
Tel Aviv 16h18 17h21
Netanya 16h17 17h20
CHABBAT MIKETZ – 'HANOUKA
27 DÉCEMBRE 2024-26 KISLEV 5785
Jérusalem 16h02 17h24
Tel Aviv 16h21 17h25
Netanya 16h21 17h24
ROCH 'HODECH TÉVET – 'HANOUKA
1ER JANVIER 2025-1ER TÉVET 5785
CHABBAT VAYIGACH
3 JANVIER 2025-3 TÉVET 5785
Jérusalem 16h07 17h29
Tel Aviv 16h26 17h30
Netanya 16h25 17h29
C’est dans le passage à l’acte que se révèle la qualité de ce qui était en tendance. Rav Léon Askénazi-Manitou

La Maguen David est aujourd’hui le symbole universellement reconnu du peuple juif et d’Israël. Elle flotte fièrement au centre du drapeau de l’État hébreu, se retrouve au cou de jeunes du monde entier. Jaune et en tissu, elle évoque la douloureuse mémoire de la Shoah ; taguée sur un mur, la haine irréductible des antisémites de tout poil. Par le passé, d’autres civilisations l’ont utilisée à différentes fins, comme les brasseurs de bière allemands dont elle est l’enseigne ou les shérifs du Far West dont elle reste le symbole. Histoire de l’autre étoile du berger.
L'étoile à six branches est une figure géométrique composée de deux triangles équilatéraux superposés, ou plutôt entrecroisés : l’un dirigé vers le haut, l’autre vers le bas. On la retrouve sur le site antique de Megiddo, qui date de l’époque du roi Achab, septième roi d’Israël, quelque 850 ans avant notre ère, mais aussi sur le linteau de synagogues galiléennes du IIe siècle, comme celle de Kfar Nahum – Capharnaüm –, ou encore sur une pierre tombale juive du IIIe siècle à Tarente, dans les Pouilles italiennes.
L’étoile : bouclier de David ou sceau de Salomon ?
Littéralement, « Maguen David » se traduit par « bouclier de David », référence poétique à Dieu. L’expression est employée dès le
XIe siècle dans un Sidour (livre de prières) : elle renvoie à la protection divine du roi David et s’appuie sur le Psaume 18 dans lequel Dieu est comparé à un bouclier. On raconte en effet que le jeune berger David, caché dans une grotte, aurait été protégé de soldats le poursuivant par une toile en forme d’étoile à six branches, tissée par une araignée bienveillante. Reconnaissant, David, une fois devenu roi, aurait ajouté ce symbole sur les boucliers de ses hommes pour les protéger. De plus, lorsque le roi David allait en guerre, il portait un drapeau composé de deux triangles posés l’un sur l’autre : l’un, pointant vers le haut et l’autre vers le bas. Ce drapeau avait donc six branches, ce qui fait allusion au règne du Créateur présent en tout lieu : 1. en haut ; 2. en bas ; 3. au Nord ; 4. au Sud. 5. à l’Est. 6. à l’Ouest.
Mais l’étoile à six branches est également apparentée au fameux « sceau de Salomon », dont le Talmud fait état. La Kabbale confère à l’hexagramme un sens religieux ; il est repris sur des amulettes et des talismans – ségoulot –, mais sans être expressément nommé. Dans le Zohar, le double triangle de l’Étoile de David symbolise le lien des deux dimensions présentes en Dieu : la Torah et Israël. Le niveau extérieur de l’âme se connecte à l’expression extérieure de Dieu par l’intermédiaire de l’étude des éléments ésotériques de la Torah ; l’essence de l’âme se connecte à l’essence de Dieu à travers l’étude et l’application des enseignements de la Kabbale.
La Maguen David est utilisée dans les manuscrits hébreux, comme le Codex de Leningrad de 1008 et les livres de prières qui se répandent au Moyen-Âge, notamment avec le


développement de l’imprimerie. En Espagne, jusqu’au XIIIe siècle, l’étoile à six branches est désignée par les Juifs sous le nom de « sceau de Salomon » et conserve des vertus protectrices. Ailleurs, jusqu’au XVe siècle, les deux appartenances – David ou Salomon – sont utilisées indifféremment, jusqu’à devenir, sous le nom de « Maguen David », le symbole de la communauté juive de Prague et, deux siècles plus tard, la marque de la séparation, à Vienne, entre le quartier juif et le reste de la ville. À la fin du XIXe siècle, la Maguen David est utilisée à la fois par le jeune mouvement sioniste et par les antisémites pour stigmatiser les Juifs : le journal de Theodor Herzl, Die Welt, dans sa première édition en 1897, porte l’Étoile de David comme emblème. Un an auparavant, Herzl a proposé dans Der Judenstaat de créer un drapeau blanc frappé de sept étoiles dorées. Le sioniste David Wolffsohn suggère plutôt de
« dérouler » un talit (châle de prière) avec, en son centre, le bouclier de David. L’Étoile de David, symbole mystique et religieux, prend une dimension politique et nationale. Le drapeau d’Israël, représentant une Étoile de David bleue sur fond blanc entre deux bandes bleues horizontales, est adopté le 28 octobre 1948, cinq mois après la création de l’État. Depuis cette date, l’Étoile de David possède une double signification : elle représente à la fois l’État d’Israël et l’identité juive en général.
Les symboliques de l’étoile
Pour les docteurs de la Torah, l’étoile à six branches symbolise les six jours de la semaine, le septième jour, le shabbat, se trouvant au centre. Dans L’Étoile de la Rédemption, Franz Rosenzweig attribue à chaque sommet une notion fondamentale : la création, la rédemption, la révélation, l’humanité, le monde et Dieu.
Pour d’autres, l’étoile représente le Messie, selon la prophétie de Balaam : « Un astre issu de Jacob devient chef, un sceptre se lève, issu d’Israël. » Ce verset extrait du Livre des Nombres annonce la venue d’une étoile messianique issue de la maison de David, d’où son nom. Pendant la deuxième révolte juive contre les Romains, Rabbi Akiva croit voir le sauveur d’Israël dans le chef des insurgés : Bar Kosiba, qui changera son nom en Bar Kohba, c’est-à-dire… le « fils de l’étoile ». Selon des commentaires ésotériques, les six points aux extrémités et les six points d’intersection représenteraient la disposition, par Josué, des douze tribus d’Israël autour de Jérusalem. Le triangle du bas symboliserait l’aspiration de l’homme vers Dieu, et l’autre, celle de Dieu vers l’homme. À moins que l’origine de l’Étoile de David ne soit associée à la menorah du Temple et ne représente, de façon stylisée, une fleur de lys ?
Paradoxalement, ce qui a donné à l’Étoile de David sa force de symbole éternel est son utilisation par les nazis qui ont obligé les Juifs à la coudre sur leurs manteaux pour les identifier comme tels. Sous ce signe, ils ont été humiliés, martyrisés, assassinés, détruits. Sous ce signe, ils se rassemblent aujourd’hui, fièrement, sous le drapeau de leur pays. n
Cet article est tiré du site Yedia, média dédié au judaïsme, à sa culture, son patrimoine, et à son identité, témoin de sa richesse et de sa diversité.



La Terre sainte est communément appelée la Terre promise. Qui l'a promise à qui ?
Question fondamentale et inévitable, question grave qui traverse les siècles de l'histoire et réapparaît de nos jours avec force, en vue de l'aboutissement de la finalité du projet de la Création. Le premier à bénéficier de cette promesse, qui est gravée en toutes lettres dans la Torah, est Avraham : « L'Éternel apparut à Avram et dit : C’est à ta postérité que Je destine ce pays. » (Berechit 12, 7)
Pourquoi faire déjà cette promesse à ce moment-là, alors qu'il faudra encore cinq siècles pour la réaliser ?
Pourquoi ne pas attendre que s'accumulent, avec les générations qui vont descendre d'Avraham, tous les mérites nécessaires à l'obtention de cette terre où « coulent le lait et le miel » ? Et surtout, pourquoi y installer auparavant les enfants de Canaan, qu'il faudra déloger par la force une fois arrivé le temps de la réalisation des promesses – démarche qui sera vivement reprochée à Israël (voir le premier Rachi sur la Torah) – ?
L’étude de l'ensemble de ces questions nous amène à la conclusion qu'il ne s'agit pas ici d'un développement historique rationnel humain habituel, mais en fait d'une stratégie divine bien particulière.
Depuis Berechit, cette terre attend Avraham. Elle n'a été créée que pour lui et depuis toujours elle n'appartient qu'à lui. Ce n’est qu’à lui qu’elle révélera ses qualités. C’est une terre qui, en fait, n'a pas
d'adresse avant Avraham.
« Telles sont les origines du ciel et de la terre lorsqu'ils furent créés » (Berechit 2, 4). Le Midrach fait remarquer que le mot « créés » – « beHibarham » – est composé des mêmes lettres que le nom « Abraham » (Berechit Rabba 12, 9), ce qui vient nous enseigner que c'est grâce à Avraham que le monde va pouvoir engendrer l'histoire, les toladot. Ce n'est que par la présence de cet être qui porte et révèle la véritable identité humaine, celle qui est capable de témoigner de la dimension divine de la nature et de l'histoire, que la Création peut oser se présenter devant son Créateur. Cette terre s'appelle « la terre que l'on montre » (Berechit 12, 1), une terre que l'on fait voir à celui qui veut s'y laisser conduire pour la voir et la découvrir, en faisant confiance à Celui qui l'y amène. Cette terre, qui va porter le nom de Canaan parce que les enfants de Canaan s'y sont installés de force, ne leur a jamais été promise ni donnée. Nahmanide nous enseigne qu'« elle a été mise en dépôt chez le serviteur du maître des lieux, jusqu'au moment où le maître viendra lui-même en prendre possession » (Ramban sur Berechit 10, 15). Ceci se réalise avec Avraham. D'ailleurs, le serviteur d'Avraham, Éliezer, est un homme de Canaan ; il surgit dans l'histoire de son maître pour l'aider à réaliser ses projets d'ordre divin. C’est sa seule chance d'échapper à sa condition d'esclave maudit : devenir le fidèle serviteur de l'homme le plus noble sur terre. Paradoxalement, c'est en résidant sur cette terre que les sept
peuples qui descendent de Canaan font naître la civilisation la plus dépravée – « les pratiques du pays de Canaan où je vous conduis, ne les imitez pas et ne vous conformez point à leurs lois » (Vayikra 18, 3). Les forces qui surgissent de ce sol particulier vont renforcer de façon exacerbée la tendance de ces peuples qui ont opté pour une âme esclave de la matière, pour l'esprit au service du corps (voir Guevourot HaChem du Maharal de Prague, chapitre 4) : non plus l'homme à l'image de Dieu, mais les dieux à l'image de l'homme.
Avraham et ses enfants vont être ceux qui mettront le corps au service de l'âme pour une vie de pleine harmonie. C'est pourquoi cette terre va pouvoir leur révéler le secret de leur essence et leur permettre d’accéder à l'idéal du Kodech, en accord total avec la nature créée. En y arrivant, Avraham va engendrer un « goy gadol », une « grande nation ». De nos jours, ce projet se concrétise. Le retour d'Israël à sa terre ramène progressivement l'humain à sa noblesse et sa morale. n



INGRÉDIENTS
Pour 12 personnes
• 500 g de farine tamisée
• 3 œufs
• ¼ c. à c. de sel
• 1 verre d'eau tiède
• 2 c. à s. d'huile
• 1 carré de levure fraîche
• 3 c. à s. de sucre
Pour la garniture et la décoration
• confiture de fraises ou crème pâtissière, chocolat...
• sucre glace
l Mélanger tous les ingrédients pour obtenir une pâte élastique (si vous utilisez de la levure fraîche, délayez-la dans un peu d'eau tiède ; si vous utilisez de la levure instantanée, mélangez-la directement à la farine).
l Couvrir la pâte et la laisser lever dans un endroit chaud une heure ou plus – elle doit doubler de volume.
l Poser la pâte sur un plan de travail fariné et l'abaisser à 2 cm d'épaisseur environ.
l Découper des cercles de 5 cm de diamètre à l'aide d'un verre ou d'un emporte-pièce.
l Saupoudrer de farine et recouvrir d'un torchon. Laisser reposer 20 minutes environ, jusqu'à ce que les cercles de pâte aient gonflé.
l Préparer un bain de friture à 180°.
l Faire frire les beignets trois à quatre minutes de chaque côté en plusieurs fois. Ne pas en faire frire trop en même temps, sinon la température de l'huile baisserait et les beignets boiraient trop d'huile.
l Sortir les beignets avec une écumoire et les égoutter sur du papier absorbant.
l Remplir une poche à douille de confiture de fraises, de crème pâtissière, de chocolat… – selon votre goût. Quand les beignets ont un peu refroidi, pratiquer une petite ouverture latérale dans chaque beignet et le remplir de la garniture de votre choix.
l Mettre du sucre glace dans un petit plat peu profond et rouler chaque beignet dans le sucre.
'Hag samea'h !


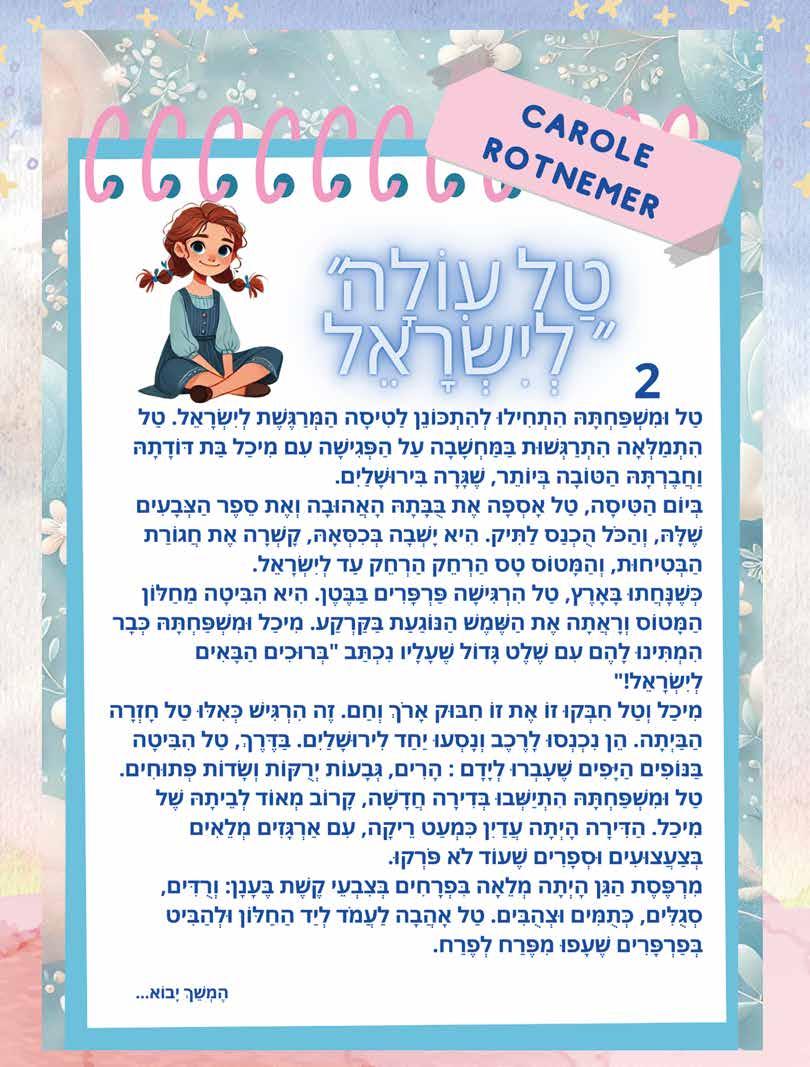


Mots fléchés
Solutions des jeux page 62
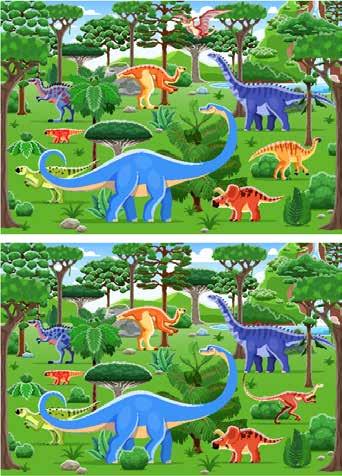
Trouve les 10 différences

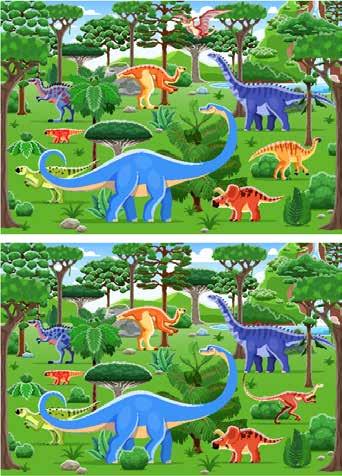



Vente – Jérusalem

COLONIE ALLEMANDE - Une maison privée et unique rue Dor ! Loin de la route, calme, à l'entrée de la maison un immense jardin bien entretenu, un autre jardin à l'arrière de la maison, maison de style arabe. 6 pièces, 219 m², jardin 500 m², hauts plafonds, lumineuse, sol d'origine. Emplacement central près d'Emek Refaim, de l'Hôtel Orient, du complexe de l’ancienne gare, du Théâtre de Jérusalem. Exclusif, Nava 053-5304556
BET HAKEREM rue Barkiho. Libre de suite ! 4 pièces, lumineux, vue verdoyante depuis chaque fenêtre, petit immeuble de qualité, 2ème étage (option sérieuse possible pour un ascenseur), balcon ouvert (soukkah), calme et central, proche centre commercial, tramway et synagogue. Unité d’habitation sur le toit enregistre au cadastre1 ! Potentiel énorme ! Exclusif! 053-4389355
BAIT VÉGAN - Rue centrale et recherchée Rabbi Uziel, 4,5 pièces, entièrement rénové, spacieux, pergola aménageable pour une Soucca, balcon depuis le séjour, parking privé, à proximité des établissements scolaires, services communautaires, jardin public, centre commercial. Transport en commun. Exclusif ! Itsik 053-6389625
ANGLO SAXON JERUSALEM 3 rue Moché Hess - Jérusalem 077-8037351

Spécialiste de la gestion locative : court et long terme à Jérusalem
Vente – Jérusalem
ARNONA - Très beau 2 pces tout rénové, spacieux environ 50m2, balcon, ensoleillé, 3 orientations, calme, excellent emplacement, 1er étage, petite cave et accès au jardin de l'immeuble. 2,280,000 shekels
Michael 058-582-8999
GAMME D'APPTS À LOUER court, moyen et long terme : Centre-ville, Nachlaot, Rechavia, Talbieh, Mamilla, Arnona, Baka, German colony, Katamon. Emmanuel 054-6290632
TZION APARTMENNTS
Emmanuel Lellouch 054-6290632
www.tzion-apartments.com el@tzion-apartments.com

OBJETS DE KODESH YOUDAÏKA - JÉRUSALEM
Mézouzot, Tefillins, Sépher Thorah, Meguilot, Parashat Haketoret, rédigés sur parchemins de première qualité, par des scribes scrupuleusement sélectionnés, puis contrôlés et approuvés par le Gaon Hatsadik Hamekoubal Rav Ran Sillam Chlita. Toutes nos réalisations peuvent être ornées par des motifs artistiques sur mesure. Contactez-nous : 054-8415213
E-mail : DORONYOSSEF26@GMAIL.COM
TIKOUN OLAM JÉRUSALEM
Entretien, maintenance et réparation : électricité, plomberie, volets, menuiserie, étanchéité. Professionnalisme et amabilité assurés. MEIR KATZ (LAUFGRABEN) : 053-431 04 14
ASSISTANCE RANGEMENT
Réorganise votre intérieur (rangement de cuisine, d'armoires et de placards) lors de votre Alya ou déménagement. Odile et son équipe prépare déballe les cartons et range votre maison. Travail rapide et soigné !
ODILE 054-625 44 41
MASSAGE BY HAÏM - HAÏM BERREBI
Masseur professionnel, sur Jérusalem et alentours en clinique ou à domicile. Massage suédois aux huiles essentielles, aux pierres chaudes, à la soie, à la bougie, massage spécifique pour la fibromyalgie, drainage lymphatique, Vacuothérapie : massage aux ventouses. 058-62 72 520



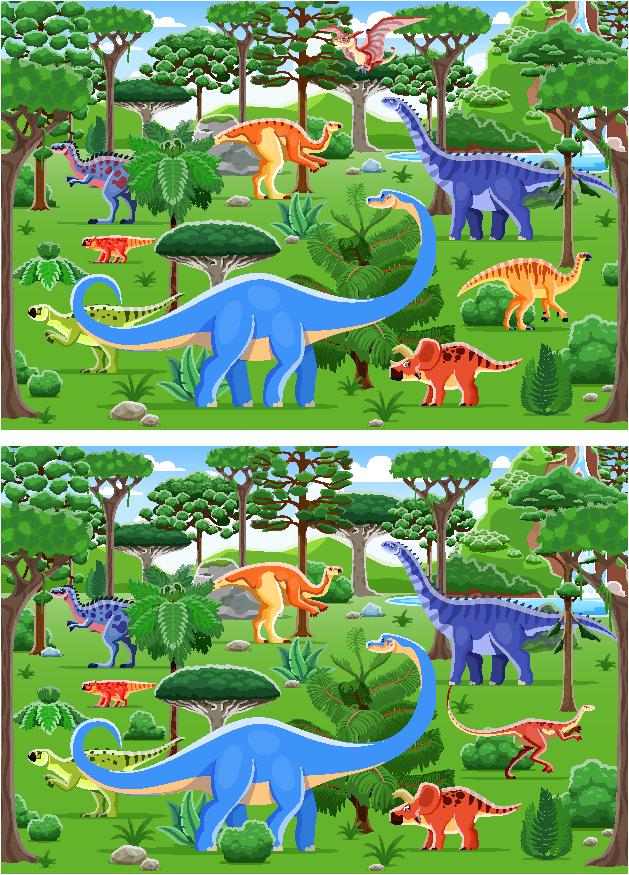

Une mère juive se confie à une amie :
– Mon fils a raté ses deux mariages !
– Ah bon ? Qu'est ce qu'il lui est arrivé ?
– Pour le premier, sa femme est partie.
– Et pour le second ?
– Elle est restée !
Deux étudiants de yechiva rentrent chez eux. La route est longue et ils n'ont pas emporté de nourriture. Soudain, ils découvrent une miche de pain sur la route. L'un d'eux se jette dessus, mais l'autre le retient :
– Chaque objet compte pour deux en ce monde, car il y a l'objet et sa représentation. Considère donc que nous avons deux pains.
Il part se laver les mains dans le ruisseau et quand il revient, il n'y a plus de pain !
– Où est passé le pain ? s'étonne le garçon.
– Ben, tu m'as dit que nous avions deux pains, alors j'en ai mangé un et je t'ai laissé l'autre !
Une mère juive crie dans un bus :
– Y a-t-il un médecin ? Viiiiite ! Un médecin !
Un trentenaire se faufile parmi les passagers et se présente :
– Bonjour, je suis médecin, en quoi puis-je vous aider ?
– Ah, Docteur, est-ce que vous êtes marié ?

– Mais enfin, quelle idée ?! Pourquoi veux-tu épouser une femme pareille ?
– Laisse-moi t'expliquer. J'ai fait beaucoup de péchés dans ma vie. Un jour, j'ai lu dans le Talmud qu'on ne peut pas être deux fois en enfer. Et le Talmud dit aussi qu'une mauvaise femme, c'est pire que l'enfer. Donc j'ai décidé de vivre avec une mauvaise femme. Elle me fera subir l'enfer sur terre et ainsi je serai sûr d'aller au paradis.
– Bon, eh bien je vais te la présenter. Elle attend à côté.
Huit jours après, on célèbre le mariage. Quinze jours plus tard, Nathan vient voir le marieur et lui dit :
Nathan va voir un marieur et lui dit simplement :
– Je voudrais me marier.
– D'accord. Quel type de femme cherches-tu ?
– Une femme insupportable. Une vraie mégère, si possible.
– Mais tu es fou ?
– C'est comme ça. Je veux une mégère.
– Bon, je vais chercher. Je te tiens au courant. Au bout d'un mois, le marieur viens voir Nathan et lui dit :
– Je crois que j'ai trouvé la perle rare ! C'est une vieille fille de cinquante ans. Sa maison est repoussante, personne n'ose entrer chez elle. Elle ne se lave jamais. Elle passe son temps à dire du mal des gens…
– Bon, présente-la moi, je vais l'épouser.
– Qu'est ce que c'est que cette histoire ? Tu t'es fichu de moi ? Tu m'avais présenté cette femme comme une épouvantable mégère. Tu m'avais dit qu'elle ne savait pas cuisiner, qu'elle était repoussante, méchante, sale… Mais je vis avec elle comme un coq en pâte !
C'est un cordon bleu, et du matin au soir ce n'est que bisous et câlins… C'est sûr que je vais finir en enfer !
Le marieur, qui ne comprend rien à ce qui arrive, convoque la femme et lui demande des explications.
– Écoutez, lui dit-elle, tout le monde sait que je suis une épouvantable mégère. J'assume ! Mais voilà ce type qui veut m'épouser ! Ça m'a étonnée. Et puis je vous ai entendus et j'ai tout compris… Ah, il veut que je l'envoie au paradis ? Eh bien il ira brûler en enfer !
Les blagues sont issues du livre de Josy Eisenberg, Ma plus belle histoire d'humour. Avec l'aimable autorisation de la famille.

ל''כנמ
Directeur de la publication
Ariel Kandel
תישאר תכרוע
Rédactrice en chef
Anne-Caroll Azoulay caroll@actualitejuive.com
Journalistes :
Esther Amar
Anne Da Costa
Eden Levi-Campana
Nathalie Hamou
Guitel Ben-Ishay
Béatrice Nakache
Nathalie Sosna-Ofir
Contributeurs :
Hagit Bialistoky
Ariela Chetboun
André Dan
Avraham Dray
Yoel Haddad
Elie Kling
Orli Nabet
Carole Rotneimer
Daniel Saada
Yehouda Salama
Correctrice
Carine Brenner
Direction artistique
Studio Actualité Juive
Service iconographique
Istock – Flash 90
Secrétariat (abonnements, contact commercial et publicitaire, petites annonces AJMAG et Actualité Juive) contactisrael@actualitejuive.com 058-461-6262
AJ MAG est le supplément mensuel de l’hebdomadaire Actualité Juive Adresse
1 rehov Raoul Wallenberg, 9435701 Jérusalem
Liste des points de vente : www.lphinfo.com/points-de-vente Lire AJ MAG sur le net :
https://lphinfo.com/lire-aj-magazine/

La direction décline toute responsabilité quant au contenu des textes et des publicités, qui n'engagent que leurs auteurs.
EN COUVERTURE : © Flash90