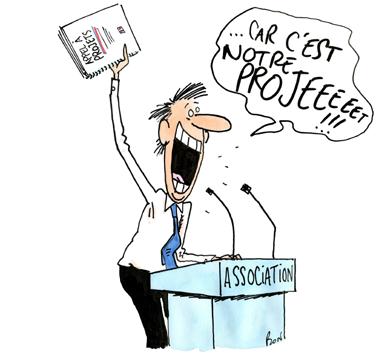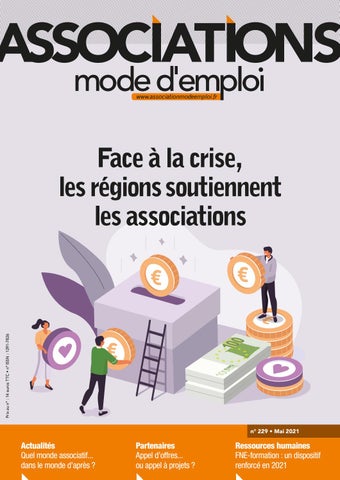6 minute read
Toutes les subventions ne sont pas des aides « de minimis
Au sein de l’Union européenne, les aides publiques allouées aux entreprises et aux opérateurs économiques sont réglementées afin qu’elles ne faussent pas la concurrence en avantageant leurs bénéficiaires par rapport à leurs concurrents. Cette réglementation dite des « aides d’État » concerne aussi les aides publiques allouées aux associations même si celles-ci n’ont pas de but lucratif. Cependant, toute aide publique n’est pas automatiquement soumise à la réglementation des aides d’État.
Advertisement
La réglementation européenne des « aides d’État » s’impose aux collectivités publiques lorsqu’elles attribuent des aides aux entreprises et aux associations si les cinq critères de la notion « d’aide d’État » qui découlent de l’article 107 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne sont réunis : le critère de l’entreprise (activité économique), le critère de la sélectivité des aides, le critère des ressources d’État (fonds publics), le critère de la concurrence potentiellement faussée et le critère de l’affectation des échanges entre les États membres (critères décrits dans la communication de la Commission européenne du 19 juillet 2016 sur la notion d’aide d’État).
Cinq critères
Lorsque ces cinq critères sont remplis, les collectivités publiques peuvent décider d’utiliser comme base juridique pour leurs aides, les règlements européens relatifs aux aides « de minimis ». L’adage latin « de minimis non curat praetor » signifie que le magistrat de la cité ne se préoccupe pas des petites affaires ; en d’autres termes la Commission européenne ne se préoccupe pas des petites aides publiques octroyées par les pouvoirs publics aux entreprises et aux opérateurs économiques. Les aides « de minimis », qui sont limitées à 200 000 euros par entreprise sur une période de trois exercices fiscaux, ne constituent que l’une des possibilités offertes aux pouvoirs publics pour sécuriser juridiquement les aides qu’ils octroient aux associations. Toutes les aides reçues par les associations ne sont pas obligatoirement des aides « de minimis ». En effet, chaque organisme public qui envisage d’attribuer une aide à une association décide souverainement s’il opte pour une aide « de minimis » ou pour une aide d’une autre catégorie.
Notification écrite
Seules constituent des aides « de minimis » les aides publiques qui ont été notifiées par écrit par les pouvoirs publics à l’association comme relevant de cette catégorie, par une référence expresse à l’un des quatre règlements « de minimis » (voir tableau), soit dans la délibération octroyant l’aide, soit dans le courrier de notification de l’aide, soit dans sa convention d’attribution. Cette notification écrite doit mentionner avec précision le montant de l’aide concernée, sa date d’attribution et son caractère « de minimis » (règlement 1407/2013 du 18 décembre 2013, article 6.1, prolongé par le règlement 2020-972).
LE CAS DES SIEG
Dans le domaine des services d’intérêt économique général (SIEG) le montant d’aide maximum autorisé par le règlement n° 360/2012 est de 500 000 euros sur la période des trois exercices fiscaux. Chaque collectivité publique reste seule compétente pour décider si elle octroie une aide « de minimis » relevant d’un SIEG. Ce type d’aide est reservé aux services au citoyen sur lesquels il existe une carence de marché.
Il n’est malheureusement pas possible de dresser une liste des catégories d’activités des associations qui sont susceptibles d’être concernées par la réglementation des « aides d’État », et donc potentiellement par les aides « de minimis », car l’analyse des cinq critères évoqués précédemment doit être faite au cas par cas en fonction des caractéristiques de l’association bénéficiaire de l’aide, de son activité, de son territoire d’implantation, de sa clientèle et de son marché le cas échéant. Ainsi, le fait qu’une association soit soumise à l’impôt sur les sociétés et à la TVA ne signifie pas automatiquement que ses aides seront qualifiées d’aides « de minimis ». A contrario, les aides octroyées aux associations reconnues d’utilité publique poursuivant des missions d’intérêt général pourront être dans certains cas des aides « de minimis ».
Plafonds
Pour savoir si l’association est audessus ou en dessous du montant de 200 000 euros d’aide « de minimis » sur les trois exercices fiscaux, il faut que celleci vérifie sur l’ensemble des documents attributifs d’aides publiques reçues sur cette période, quels sont ceux qui font référence à un règlement « de minimis ». Il suffira alors d’additionner le total des aides qualifiées d’aides « de minimis » pour vérifier si les 200 000 euros sont atteints. Il n’existe pas de plafond absolu d’aides publiques à ne pas dépasser par association. Si un contrôle est effectué sur une aide « de minimis », ce contrôle ne portera que sur cette aide et potentiellement sur les autres aides allouées à l’organisme au titre d’un règlement « de minimis » sur la période des trois exercices fiscaux, mais pas sur les aides qui n’ont pas été qualifiées d’aides « de minimis » par les pouvoirs publics. Le montant de 200 000 euros ne concerne pas toutes les aides publiques mais seulement les aides « de minimis » octroyées par les collectivités au titre du règlement n° 1407/2013. En conséquence, une association peut recevoir des aides publiques au-delà de 200 000 euros (ou 500 000 euros pour les SIEG), dès lors que les aides dépassant ces montants ne sont pas des aides « de minimis ».
« Entreprise unique »
Excepté pour les aides « de minimis » des services d’intérêt économique général (SIEG) relevant du règlement 360/2012 (voir tableau) les aides « de minimis » octroyées aux entreprises et aux associations doivent être consolidées le cas échéant au niveau de « l’entreprise unique ». Cette notion définie à l’article 2 du règlement 1407/2013 correspond à peu près à la notion de groupe. Ainsi, si une association est contrôlée par une autre structure ou contrôle cette autre structure (par la détention de la majorité des droits de vote au sein de sa gouvernance ou en détenant la majorité du capital d’une entreprise) les deux entités constitueront une « entreprise unique » au sens du règlement « de minimis ». Cela signifie que le total des aides « de minimis » reçues par les deux structures ne devra pas dépasser au total 200 000 euros (et non 400 000 euros).
Interroger la collectivité
Attention, certaines collectivités publiques oublient parfois d’informer l’association que l’aide qu’elles viennent de lui allouer est une aide « de minimis ». Aussi en cas de doute sur la qualification d’une aide, l’association doit interroger la collectivité publique qui lui a octroyé l’aide, afin de savoir s’il s’agit d’une aide « de minimis » ou si elle relève d’une autre catégorie. De même, certaines exonérations fiscales sont basées sur le règlement « de minimis ». Les services fiscaux doivent dans ce cas informer par écrit l’association que le montant de l’exonération est une aide « de minimis » au titre de l’un des règlements concernés. Toutes les exonérations fiscales ne sont toutefois pas des aides « de minimis ». Ici également en cas de doute, il conviendra d’interroger les services fiscaux sur la nature de l’aide.
Jean-Pierre Bove, avocat FCAE, www.fcae.eu
QUATRE RÈGLEMENTS DE MINIMIS
Règlement « de minimis » général Règlement « de minimis » agricole Règlement « de minimis » pêche et aquaculture Règlement « de minimis » SIEG
N° de référence du règlement
1407/2013 et 2020-972
1408/2013 et 2019/316
717/2014 et 2020/2008
Date d’adoption du règlement
18 décembre 2013 et 2 juillet 2020 18 décembre 2013 et 21 février 2019 27 juin 2014 et 8 décembre 2020
360/2012 2020/1474 15 avril 2012 13 octobre 2020
Montant d’aide « de minimis » Période
200 000 € 3 exercices fiscaux 20 000 € 3 exercices fiscaux 30 000 € 3 exercices fiscaux
500 000 € 3 exercices fiscaux