CONS TRUCTION & BÂTI MENT
PROJETS ET CHANTIERS
DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Peau neuve pour la tour de la Sallaz
Un nouveau quartier à Sion
Les enjeux de l’enveloppe
Les terrains de jeux en trois projets
La force de la pierre

PROJETS ET CHANTIERS
DES PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

Peau neuve pour la tour de la Sallaz
Un nouveau quartier à Sion
Les enjeux de l’enveloppe
Les terrains de jeux en trois projets
La force de la pierre






10 Les news de l’architecture et de la construction
14 Une première suisse pour la FNE
16 Un immeuble à usages mixtes
24 Les terrains de jeux
TECHNIQUES DU BÂTIMENT
38 Les enjeux de l’enveloppe
56 Pierre naturelle, entre tradition et modernité
64 Les revêtements peintures pour sols
PROJETS
70 Dialogues intergénérationnels aux Plaines-du-Loup
78 Un ensemble durable à Chavannes
86 Le nouvel Hôtel de Police de Nyon
92 Revalorisation d’un îlot à Yverdon-les-Bains
98 Tilia, un projet iconique
106 Préserver l’âme de l’existant
112 Une nouvelle façade sur le Quai de l’Île
116 Peau neuve pour la tour de la Sallaz
122 Densifier le patrimoine des années 1960
128 Un nouveau quartier à Sion
ENTREPRISES
138 Zoom sur les entreprises locales
144 Zoom sur les salons
AGENDA
146 Expos, salons et congrès
Déposé dans le tissu clairsemé de l’extrémité nord de la zone industrielle de Forel (Lavaux), un bâtiment à usage mixte joue à réunir les fonctions d’activités et de logements, en principe difficiles à associer.
texte : Agata Miszczyk



Fruit d’une commande privée visant à valoriser une parcelle classée en zone d’activités, le bâtiment s’étend sur 50 m, le long du Grenet. Au fil des dialogues avec le maître d’ouvrage et les autorités, Samir Alaoui, architecte du projet, parvient à faire passer son idée hardie : proposer des logements au-dessus d’ateliers industriels pour favoriser la mixité et valoriser l’opération. Ainsi, huit locaux accessibles de plain-pied sont organisés sur deux niveaux et deux spacieux appartements sont installés en attique. Trois niveaux pour deux usages opposés.
HABITER DANS L’AIRE INDUSTRIELLE
Au rez, chaque atelier dispose de 4 m de hauteur sous dalle et est relié par un escalier individuel à l’espace dédié à l’administration, au premier. L’attique, étage de logement en retrait de la façade principale, offre une large terrasse sur le pourtour. Celle-ci
est séquencée par deux types de revêtements, tantôt dallettes en béton, tantôt substrats plantés. Cette alternance sépare la coursive d’accès des parties privatives et participe au retrait intime. Les deux grands appartements parfaitement symétriques sont accessibles par un ascenseur central, qui ne dessert que l’étage habité, ou par l’un des deux escaliers situés de part et d’autre du bâtiment, chaque appartement disposant du sien. Ces escaliers monumentaux en béton ceignent les parties courtes de la façade, 16 mètres tout de même. Ils constituent une longue entrée individuelle aux murs d’enceinte élevés, comme pour rassurer sur la possibilité d’un espace privé dans cette parcelle ouverte aux mouvements des activités. La paillasse, parfaitement réalisée en crémaillère, dessine un zigzag graphique sur le mur. Les deux logements en attique sont généreux ; d’aucuns diraient qu’ils sont luxueux. Chacun, triple orienté, offre six
Dans un contexte urbain toujours plus dense et complexe, les espaces publics extérieurs dédiés au jeu, à la détente et à la convivialité – qu’il s’agisse de cours d’école, de parcs communaux ou de friches réaménagées – représentent aujourd’hui un véritable enjeu de transformation. Ces lieux doivent être pensés comme des espaces polyvalents, inclusifs et accessibles à tous, favorisant à la fois les pratiques ludiques et les rencontres, tout en répondant aux exigences de durabilité.
L’enjeu est de taille : il s’agit de concilier la nécessaire flexibilité des usages, appelés à évoluer et à s’adapter aux besoins variés des usagers, avec la préservation d’une identité forte, ancrée dans les spécificités du site et de son territoire.
Trouver cet équilibre est au cœur de toute démarche de requalification réussie. Cela implique une analyse fine du contexte local, une compréhension approfondie des pratiques existantes – formelles ou informelles –et un parti pris sensible, qui valorise les qualités propres du lieu, tout en évitant les solutions uniformes ou standardisées.
Lisa Naudin


Le processus de transformation de l’ancienne station d’épuration (STEP) d’Aproz en aire de jeux est aussi significatif que le résultat lui-même. Le projet s’inscrit dans une démarche d’exploration pragmatique, flexible, mais avant tout contextuelle. Tout commence par une demande de l’association de parents de la commune : créer une aire de jeux dans un quartier résidentiel dense, où les espaces libres sont rares. Mandaté par les communes de Sion et de Nendaz, En-Dehors engage une démarche participative pour identifier les besoins et les attentes concernant ce nouveau terrain de jeu.
Face au manque de foncier disponible, le projet initial est abandonné : la parcelle convoitée est finalement réservée pour une possible extension de l’école voisine. Le bureau se tourne alors vers le fond de la parcelle, longeant le Rhône, où se trouve la STEP, un bassin d’épuration à ciel ouvert construit dans les années 1960 et désaffecté depuis le milieu des années 1990. Cette infrastructure en béton brut fait partie du paysage environnant et révèle un potentiel spatial et ludique insoupçonné, une fois explorée de l’intérieur.
En-Dehors choisit d’en faire la matière première du projet. Ils la lisent comme une typologie à part entière, en lien avec le territoire et son histoire. Volumes inclinés, bassins, canalisations, structures métalliques sont requalifiés pour accueillir de nouveaux usages. L’espace lui-même devient un terrain de jeu : parcours
d’eau, toboggan traversant le mur, végétation pionnière, prises d’escalade, le tout structuré par une lecture précise des qualités spatiales du lieu.
Le projet repose alors sur un principe architectural fort : le réemploi des matériaux extraits sur place. Les marches menant au centre de l’espace sont taillées dans l’ouverture principale. Un ancien tirant en béton devient banc. Des blocs de pierre sont intégrés à un mur pour créer une paroi d’escalade. Le chantier s’adapte aux contraintes techniques (homologation des jeux, pollution du sol) et aux savoir-faire des entreprises impliquées. Par exemple, les carottages effectués permettent de comprendre la structure du lieu tout en générant de nouveaux usages : ils accueillent aujourd’hui des plantations de jeunes arbres à croissance rapide, comme des saules, choisis pour leur capacité à ombrager et à tempérer le microclimat du site.
Le projet reste contenu dans l’enveloppe existante, sans toucher aux façades techniques périphériques. Des touches de couleurs primaires signalent les gestes d’adaptation — sciages, scellements, découpes — et deviennent des repères dans le jeu.
Cette intervention, qui valorise un foncier existant et évite la démolition, n’est pas une simple reconversion. C’est une relecture sensible du patrimoine industriel qui tire parti des ressources sur place et repense le rapport entre architecture, territoire et usages.

1 AN - 7 NUMÉROS POUR CHF 38.–2 ANS - 14 NUMÉROS POUR CHF 72.–
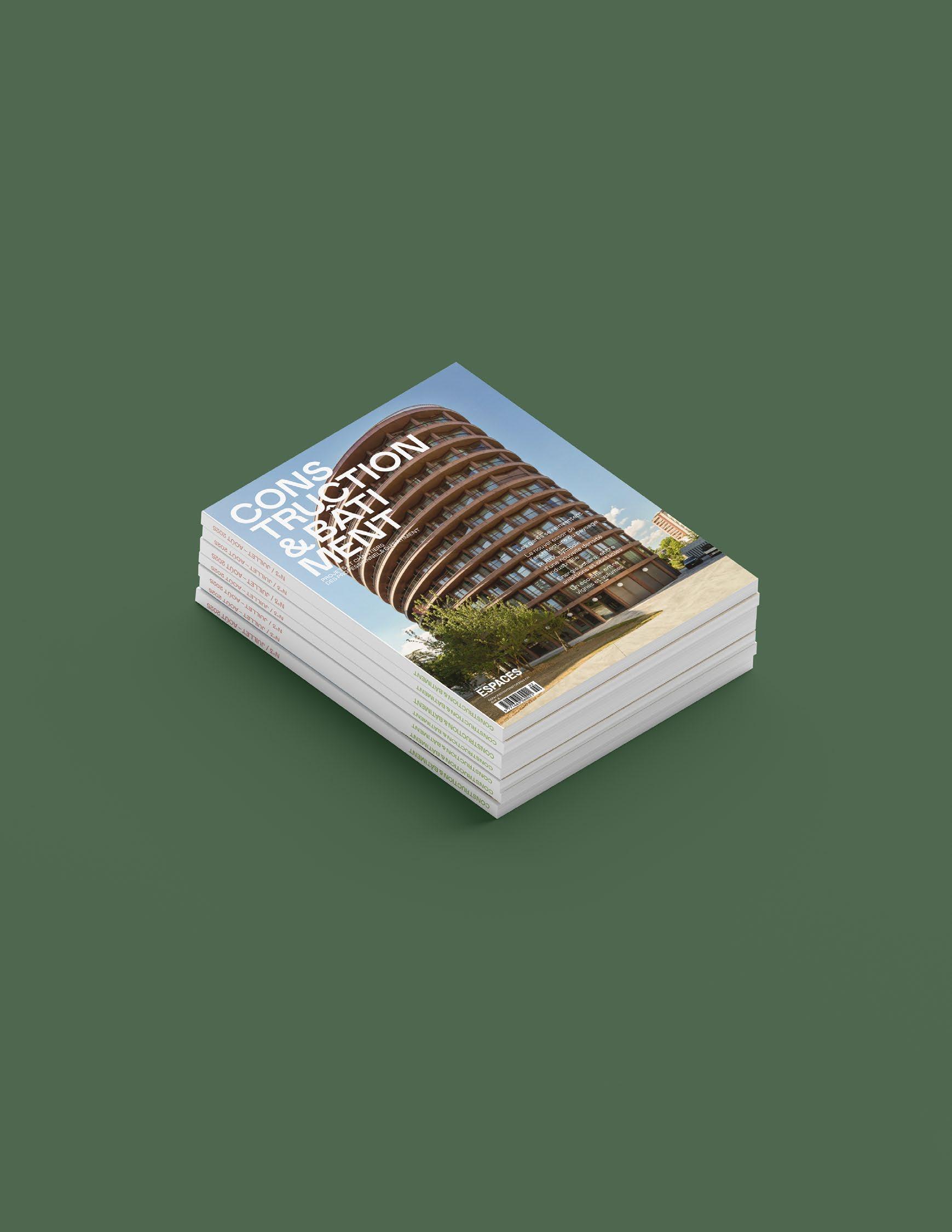
Livraison gratuite en Suisse
30% de réduction par rapport à l’achat au numéro
CONSTRUCTION & BÂTIMENT,
1 hors-série exclusif par année
LE MAGAZINE SUISSE DE RÉFÉRENCE DANS LES THÈMES DU BÂTIMENT
POUR VOUS ABONNER : SHOP.ESPACESCONTEMPORAINS.CH
Restez toujours informés des dernières actualités
UNE ÉDITION


Dans le quartier lausannois des Plainesdu-Loup, le nouvel EMS conçu par AAPA (Atelier Aeby Perneger & Associés) fait écho à l’école réalisée par le même bureau d’architectes deux ans plus tôt.

L’établissement, achevé ce printemps, résulte d’un concours en procédure sélective. Il se distingue par son insertion fine au cœur des Plaines-du-Loup, son ambition programmatique et la richesse de son processus de conception.
Au-delà d’un lieu de vie et de soins, il cherche à se mêler à la ville, à susciter les rencontres avec les habitants du quartier et à privilégier les percées visuelles vers l’école qui lui fait face, ainsi que vers l’emblématique ensemble d’habitation du Pont-des-Sauges (conçu par les architectes Bernard Calame et Jean Schlaeppi dans les années 1960-1970), affirmant la place de nos aînés dans la vie du tissu urbain. Ce projet innovant, tout en produisant une totale unité architecturale, regroupe en réalité sous le même toit deux institutions avec des missions d’accueil complémentaires : l’EMS Blécherette (Fondation Bois-Gentil) avec une mission gériatrique généraliste et l’EMS de l’Orme (Fondation de l’Orme) à vocation de psychiatrie de l’âge avancé. Les deux fondations se partagent ainsi un rez-de-chaussée commun. Chaque entité se déploie ensuite sur deux étages chacune, sur la base d’un plan d’étage type. Cette superposition équilibrée permet une mixité sans confusion et témoigne d’une excellente entente entre les deux maîtres d’ouvrage, qui ont coconstruit
la répartition du programme, en cultivant un processus riche de partages, jusqu’à tester des prototypes de chambre pour en optimiser l’ergonomie. Au total, le projet se voit doté de 120 lits et accueille des résidents depuis le mois de juin dernier.
Le rez-de-chaussée s’ouvre largement vers l’extérieur avec, notamment, un restaurant ouvert au public voué à devenir un point de rencontre entre résidents et voisinage. Sa terrasse généreuse constitue une transition fluide entre l’intimité du lieu de résidence et la vie du quartier. Les deux fondations disposent chacune d’une toiture-terrasse : celle de Bois-Gentil, située au R+4 – à la même hauteur que les salles de sports de l’école voisine – permet une résonance visuelle et ludique entre les deux bâtiments collectifs, ce qui ouvre le champ à des échanges suggérés et à des activités éventuellement synchronisées.
Le projet prend naissance bien en amont du bâtiment luimême. À l’origine du plan partiel d’affectation, qui définit la répartition des programmes et la morphologie des îlots : le même bureau d’architectes, lauréat du concours d’urbanisme pour la pièce urbaine D, caractérisée par une forte concentration

Avec sa tour bois-béton de 85 mètres, ses espaces partagés et ses aménagements paysagers, le projet Tilia articule densification, durabilité et vie collective dans le cadre du renouvellement du quartier de Malley.
texte : Salomé Houllier Binder

Au cœur du quartier en pleine mutation de Malley, Insula SA engage avec Tilia un projet d’envergure. Conçu par les bureaux Itten+Brechbühl et 3XN, avec l’Atelier du Paysage, et réalisé avec HRS Real Estate SA, l’ensemble comprend la plus haute tour du quartier, culminant à 85 m, à laquelle s’ajoutent la transformation du complexe de badminton et un important travail d’aménagement paysager.
Avec ses 223 logements, un coliving de 160 unités, des bureaux et des espaces de sport et de culture, Tilia conjugue intensité programmatique, sobriété constructive et ouverture urbaine. Tour de grande hauteur, structure mixte, performances énergétiques ambitieuses, phasage complexe : Tilia articule des enjeux techniques, architecturaux, environnementaux et organisationnels à toutes les échelles du projet. Son nom, clin d’œil au tilleul pluricentenaire qui se dressait autrefois à Prilly, prolonge une mémoire de convivialité et de rassemblement. Densifier, ici, ne signifie pas empiler, mais créer un repère structurant et un écosystème habité.
UNE ARCHITECTURE POUR FÉDÉRER
Tilia s’organise autour d’un principe clair : fédérer les usages, les habitants et les échelles urbaines. La tour, légèrement resserrée à mi-hauteur puis élargie vers son sommet, se distingue par sa silhouette singulière. Fragmentation des volumes, socle actif, aménagements perméables, tout concourt à en faire une structure ouverte, en continuité avec la ville.
Le socle de la tour accueille une diversité de fonctions : commerces, bureaux, salle de sport, studio de musique, ainsi

qu’un grand lobby traversant de 400 m², conçu pour héberger des événements, notamment des concerts en lien avec l’École de jazz et de musique actuelle (EJMA). Une application digitale dédiée facilitera la communication entre habitants et l’organisation d’événements. Ce programme intensif et ouvert repose sur une volonté forte : introduire une échelle domestique, générer des lieux d’interaction, et sortir de la logique d’une tour monofonctionnelle. En outre, dès l’été 2026, un nouvel espace unique s’ouvrira au cœur de la Tilia Tower – le Montreux Jazz Loft. Il conjuguera l’atmosphère chaleureuse d’un grand appartement à la fonctionnalité d’un lieu événementiel, pour une expérience sur mesure (réception, séminaires d’entreprise). L’architecture même de la tour incarne cette volonté d’interaction. Les façades expriment clairement les fonctions intérieures : largement vitrées pour les bureaux, plus denses pour les logements, elles alternent balcons et loggias disposés de manière intercalée pour éviter les superpositions rigides. Ces dispositifs permettent à la fois de préserver l’intimité et de rythmer les façades. La tour comporte sept types de façades, et douze au total sur l’ensemble du projet. Chacune possède sa propre profondeur, ses éléments spécifiques, et aucune n’est alignée avec les autres. Cette multiplicité, qui reflète la complexité programmatique, constitue aussi l’un des défis techniques majeurs du chantier.
Enfin, les aménagements extérieurs renforcent cette dynamique. La place du Viaduc, les cheminements piétonniers, le parc paysager et les liens vers le futur tram instaurent une continuité entre les bâtiments et le quartier. Deux pavillons (dont

Classée au plus haut niveau patrimonial, l’église
Sainte-Croix de Carouge (GE) fait l’objet d’une restauration de grande envergure.


L’édifice du XVIIIe siècle impose aux architectes et ingénieurs une mission complexe : redonner luminosité et confort à un monument fragilisé par le temps, tout en respectant chaque pierre, chaque détail et chaque couleur de son histoire.
Construite en 1777 et transformée à plusieurs reprises, l’église catholique Sainte-Croix présentait depuis plusieurs décennies un climat intérieur problématique : noircissement des parois dû à l’humidité dégagée lors des offices et concerts qui accueillent 200 à 300 personnes, aggravé par les dépôts de particules liées à une ventilation installée dans les années 1970. Le premier enjeu visait donc à améliorer la circulation d’air. Mais l’intervention actuelle, conduite par CCHE en étroite collaboration avec le Service des monuments et sites, dépasse la simple mise en conformité. Elle entend préserver un édifice emblématique et très fréquenté par une paroisse vivante, tout en l’adaptant aux usages contemporains : renforcement de la charpente, amélioration de la lumière et de l’acoustique, restauration des décors, réhabilitation des espaces annexes – dont l’appartement du sacristain, jamais rénové jusque-là – ainsi que la mise aux normes de sécurité incendie et d’accessibilité.
Prévue comme une réfection classique de la toiture, l’opération a rapidement révélé l’ampleur des défis. Une fois les tuiles déposées, la charpente a montré d’inquiétantes faiblesses statiques. Chaque chevron a été examiné, puis consolidé ou remplacé, selon une procédure validée à chaque étape par des experts du patrimoine. La couverture entière a été refaite et la protection contre la foudre renforcée, indispensable pour le clocher, point le plus élevé de Carouge. La rénovation a également porté sur l’isolation thermique, le remplacement des menuiseries et l’installation d’un nouveau système de chauffage et de ventilation. « Le percement des voûtes pour intégrer les grilles de ventilation a constitué un défi majeur, relevé en concertation avec les ingénieurs et le Service des monuments et sites, grâce à une intervention minutieuse tenant compte de la fragilité statique des combles et du souhait de préserver intacte l’esthétique de l’édifice », souligne Cornélia Volkringer, architecte associée, administratrice de CCHE Genève SA. Un monobloc assure désormais une qualité d’air constante, adaptée aussi bien à un office dominical qu’à un concert de grande affluence.