









































































































































































































































































Un héritage à cultiver La sécu fête ses 80 ans
Culture
L'inclusion s'invite dans les salles
Alimentation
Chocolat et santé sont-ils compatibles ?
Volontariat
Un premier pas pour rebondir











































































































































































































































































Culture
L'inclusion s'invite dans les salles
Alimentation
Chocolat et santé sont-ils compatibles ?
Volontariat
Un premier pas pour rebondir
Construite au fil des décennies, la sécurité sociale n’est pas le fruit du hasard ni une forme de principe de charité envers les plus vulnérables. C’est un acquis social à protéger à tout prix.
La sécurité sociale est bien plus qu’un simple mécanisme de protection contre les aléas de la vie. Elle incarne un droit collectif, garantissant une sécurité minimale face aux imprévus : maladie, accident, chômage, maternité ou vieillesse. En Belgique, ce système repose sur la solidarité sociale : chacun et chacune contribue selon ses moyens et bénéficie selon ses besoins. Ce modèle assure à tous et à toutes l’accès à des soins, des revenus de remplacement, et à une vie digne, indépendamment du statut ou du revenu. Un modèle aussi inclusif a permis de réduire les inégalités et de renforcer la justice sociale, tout en promouvant la solidarité intergénérationnelle (lire en p.8). Il protège contre les risques de la vie, offrant un filet de sécurité indispensable. Pourtant, ce pilier fondamental de nos sociétés est aujourd’hui mis sous pression (lire en p.11).
Les menaces contemporaines
La sécurité sociale, fruit d’un consensus entre syndicats, employeurs, mutualités et l’État, est de plus en plus remise en question. Sous couvert d’impératifs budgétaires, certaines politiques cherchent à limiter l’accès aux prestations, réduire les financements ou privatiser certaines branches du système. Ces attaques affaiblissent l’essence même de la solidarité collective.
Dans les contextes autoritaires, ce modèle est souvent le premier visé. Aux États-Unis, les déclarations récentes visant à réduire Medicaid et les pensions illustrent cette tendance. On oublie que ces institutions ne sont pas périphériques à la société : elles sont ce qui la structure et lui permet de fonctionner.
La sécurité sociale joue également un rôle déterminant dans la réduction des inégalités de santé. Comme l’ont montré les épidémiologistes Wilkinson et Pickett dans "The Spirit Level" (2009), les sociétés plus égalitaires jouissent d’une meilleure santé publique et d’un bien-être global supérieur. De leur côté, l’économiste Amartya Sen (Development as Freedom, 1999) et l’historien Pierre Rosanvallon (La Société des égaux, 2011) soulignent l’importance des systèmes de protection sociale pour garantir les libertés, renforcer la démocratie et assurer la justice sociale.
Au-delà des chiffres, la sécurité sociale protège notre humanité commune. Elle reconnaît notre vulnérabilité et notre interdépendance, en offrant à chacun la liberté de poursuivre ses projets sans craindre que des imprévus ne le plongent dans la précarité La métaphore du "filet" de sécurité sociale illustre parfaitement cette protection indispensable.
Une vision à défendre
La sécurité sociale est le reflet de la société que nous voulons : respectueuse, solidaire et juste. Elle garantit des soins accessibles, des travailleurs protégés et des droits sociaux qui ne punissent pas les personnes pour avoir été malades ou avoir eu des enfants.
Dans un monde marqué par des défis croissants, affaiblir la sécurité sociale, c’est fragiliser les fondations mêmes de notre société. Défendre ce modèle, c’est défendre une vision de la justice sociale où personne n’est laissé pour compte.
Elise Derroitte Vice-Présidente de la MC
Affaiblir la sécurité sociale, c’est fragiliser les fondations mêmes de notre société.

08
La sécu fête ses 80 ans Un héritage à cultiver.
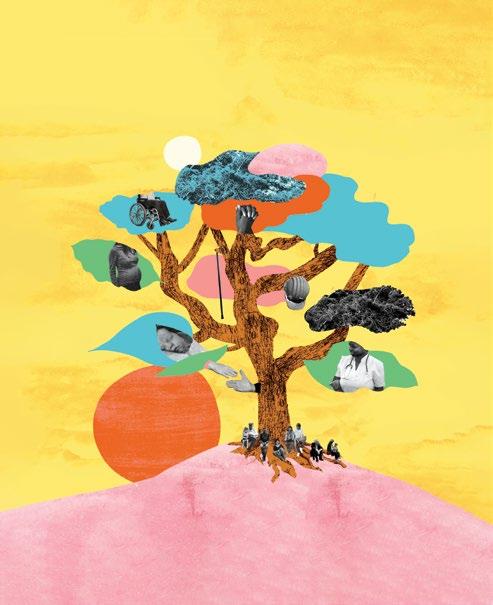


Échos de l'actu 04
Tour d'horizon de la planète santé.
Dossier sécu 08
La sécurité sociale fête ses 80 ans. Une "vieille dame" à protéger à tout prix.
Vos droits 14
Quels délais pour l'assureur après un dommage ?
Incapacité 15
Perte d'autonomie : une allocation supplémentaire.
Chaussée de Haecht 579 - BP 40 1031 Bruxelles 02 246 46 27 enmarche@mc.be - enmarche.be
Besoin de nouvelles vignettes?
Une question liée à votre dossier personnel ?
Contactez la MC au 081 81 28 28 ou via mc.be/contact
Soins de santé 16
Le rôle du "pharmacien de référence".
Société 18
Circé : un refuge pour les femmes sans-abri
Alimentation 20
Chocolat et santé sont-ils compatibles ?
Science à la belge 22
Les dunes, des armes contre le changement climatique.
Editeur responsable : Alexandre Verhamme, chaussée de Haecht 579 BP 40, 1031 Bruxelles
Publié par : Visie in beweging vzw Rédactrice en chef : Sandrine Warsztacki
Affilié à l’Union de la presse périodique UPP - Membre de l’Union des Editeurs de la Presse Périodique. Tirage moyen 375.000 exemplaires
16
Soins de santé
Le rôle du "pharmacien de référence".
18
Société
Circé, un refuge pour femmes sans-abri.
Handisport 23
Moins de compétition pour plus d'inclusion.
Ma santé au quotidien 24
Prendre soin de son périnée.
Culture 26
L'inclusion s'invite dans les salles.
Volontariat 28
Un premier pas pour rebondir.
Votre région 30
Retrouvez les évènements et actualités proches de chez vous.
PARUTION : Mensuel.
COUVERTURE : Marion Sellenet
PHOTOS : AdobeStock.
MISE EN PAGE : Paf!
IMPRIMERIE : Coldset Printing Partners, Beringen-Paal.
ROUTAGE : Atelier Cambier, Zoning industriel, Première Rue 14 - 6040 Jumet. Une erreur dans votre adresse postale ?
Signalez-le via mc.be/journal ou au 081 81 28 28.
L'Agence intermutualiste (AIM) a passé à la loupe les factures des patients admis à l’hôpital en 2023 dans notre pays. À nouveau, elle pointe du doigt la hausse élevée des suppléments d’honoraires.

La pose d’une prothèse de hanche facturée en moyenne 886 € en chambre double et 4.100 € en chambre individuelle. Une intervention du canal carpien qui coûte en moyenne 22 € en chambre double et 761 € en chambre individuelle… Le coût à charge du patient hospitalisé varie fortement selon l’intervention médicale mais aussi selon la catégorie de chambre choisie, explique l’Agence intermutualiste (qui regroupe les mutualités belges) dans son baromètre hospitalier 2024. Pour une admission avec une ou plusieurs nuitées, le patient débourse en moyenne 8 fois plus en chambre individuelle qu’en chambre double. En hospitalisation de jour, c'est 14 fois plus ! De grandes différences de pratiques et de montants existent entre les établissements hospitaliers.
La somme des montants facturés aux patients hospitalisés a augmenté de près de 10 % entre 2022 et 2023, relève l'AIM. À eux seuls, les suppléments d'honoraires (que peuvent facturer les médecins lorsque le patient séjourne en chambre individuelle) ont grimpé de 13 %, bien plus que l'indexation des honoraires officiels donc. Ce constat est d’autant plus interpellant que les hôpitaux ne peuvent plus dépasser le pourcentage de supplément d’honoraires qu’ils pratiquaient en 2022. "Les hospitalisations de jour prennent de plus en plus d’ampleur et c'est là que la hausse des suppléments est la plus forte", s'insurge Elise Derroitte, Viceprésidente de la MC.
Plus de transparence
Cette spirale inflationniste des suppléments d'honoraires, la MC la dénonce depuis des années. "Cette pratique perpétue la médecine à deux vitesses et met une pression déraisonnable sur le système, commente Elise Derroitte. Ce n'est pas tenable financièrement pour les patients. Et l'hospitalisation devient inassurable. Certains assureurs commerciaux ne veulent plus la couvrir."
La Vice-Présidente de la MC s'interroge par ailleurs sur la part des suppléments d’honoraires médicaux versée par les médecins pour financer les hôpitaux. “Il y a un manque total de transparence à cet égard. Il existe encore des médecins et des hôpitaux qui ne facturent pas de suppléments d'honoraires. C'est donc possible." Enfin, l’AIM réclame plus de transparence pour que le patient sache avant l’admission quels montants lui seront facturés. Actuellement, c'est l'insécurité financière qui prédomine, en particulier en chambre individuelle.
"Les coûts hospitaliers à la charge du patient", AIM, rapports 2024 à lire sur aim-ima.be
Créée en 2016 par le Conseil national de l’Ordre des médecins et soutenue par l’Inami, la plateforme indépendante "Médecins en difficulté" offre un soutien psychosocial aux médecins.
Après des débuts modestes, la plateforme enregistre désormais en moyenne 500 appels par an, et a atteint les 600 prises de contact en 2024, selon des chiffres parus dans L'Avenir. Les situations de fragilités psychologiques ne sont pas rares au sein de la profession,
en raison notamment de la nature et de l'organisation du travail.
Selon Pascale Senny, chargée de mission pour la plateforme, les demandes concernent principalement l’épuisement professionnel (et son corollaire, le burn-out), l’organisation du travail et les agressions dont les blouses blanches sont victimes de plus en plus fréquemment.
medecinsendifficulté.be

alimentaires : vers un paiement automatique ?
En Belgique, un parent sur cinq ne perçoit pas, ou pas régulièrement, la pension alimentaire que lui doit son ex-conjoint. Les pensions alimentaires impayées constituent un risque élevé de précarisation, surtout pour les familles monoparentales, composées majoritairement de femmes avec enfants (81 %). Par ailleurs, la pension alimentaire peut être utilisée comme moyen de pression et outil de contrôle de la part de l’ex-partenaire. Une situation doublement violente pour le parent qui en dépend.
Le Service des créances alimentaires (Sécal) peut intervenir auprès du parent débiteur (celui qui doit payer) pour récupérer l’argent et, dans certains cas aussi, avancer ces sommes au parent créancier. La peur de représailles, entre autres obstacles, fait que de nombreuses personnes vulnérables n’osent pas y faire appel.
Devant ces enjeux majeurs, l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes a commandé à la KULeuven et l'UAntwerpen une étude sur la faisabilité de créer un fonds universel et automatique pour garantir le paiement des pensions alimentaires. Ce système éviterait les violences économiques liées au nonpaiement des pensions, mais aussi les violences entre ex-partenaires puisqu'ils ne devraient plus être en contact pour percevoir leur dû. La mise en place du projet, menée dans le cadre du Plan d'action national de lutte contre les violences basées sur le genre (2021-2025), est à présent entre les mains des responsables politiques.
L’étude de faisabilité d’un système universel et automatique de pensions alimentaires est à lire sur igvm-iefh.belgium.be
• Jusqu’à 10 € par séance et 70 € par an
• Pour chaque affilié MC
• Chez un prestataire reconnu par la MC
Comment soutenir son ado ?
L’adolescence est une période charnière marquée par de profondes transformations, tant physiques qu’émotionnelles. Pas toujours simple, pour les parents, de préserver une relation harmonieuse avec leur ado ni de l’accompagner dans cette étape de vie parfois tumultueuse. Pour répondre à ces défis, le site mc.be propose depuis peu une nouvelle page dédiée aux parents d’ados. Vous y découvrirez des conseils pratiques pour favoriser le développement de leurs "compétences psychosociales" : des ressources qui aident à s’adapter et surmonter les défis de la vie et dont l’impact sur le bien-être des jeunes a été démontré scientifiquement. Elles les aident, entre autres, à mieux s'entendre avec les autres, à se connaître, à réduire l'anxiété et le stress, à éviter les comportements dangereux, à s'adapter socialement et à réussir à l'école. La page s’appuie sur une série de vidéos mettant en scène des experts, notamment Bruno Humbeeck, mais aussi des parents et leurs adolescents, qui partagent leurs expériences et astuces.
À découvrir sur mc.be/bien-etre-jeunes



Le dernier rapport du Lancet Countdown, qui suit les effets du changement climatique sur la santé, tire la sonnette d’alarme.
Ce suivi annuel, qui a été mis en place il y a 9 ans dans la foulée des accords de Paris en 2015, s’appuie sur l’expertise de chercheurs de premier plan du monde entier. Le rapport de 2024 révèle les résultats les plus préoccupants jamais obtenus, qui confirment que la crise climatique est aussi une crise sanitaire. La température moyenne annuelle de surface de la terre a atteint un niveau record de 1,45 °C au-dessus du niveau de référence préindustriel en 2023, et de nouveaux sommets de température ont été enregistrés tout au long de 2024. Les extrêmes climatiques qui en résultent font de plus en plus de victimes et impactent les moyens de subsistance
dans le monde entier.
10 des 15 indicateurs surveillés par les experts atteignent des records inquiétants. La mortalité liée à la chaleur chez les plus de 65 ans a notamment bondi de 167 %, tandis que sécheresses, inondations et tempêtes de poussière exposent à des risques accrus d’insécurité alimentaire, de maladies infectieuses et de pollution.
Malgré ces menaces, les mesures d’adaptation restent insuffisantes, soulignent les experts. Et des records ont également été atteints au niveau des émissions de gaz à effet de serre, compromettant l’objectif de ne pas dépasser une augmentation pluriannuelle de 1,5 °C.

Que ce soit par souci économique, écologique, ou les deux à la fois, de nombreux ménages se demandent comment réduire leur consommation d’énergie. Le projet de recherche "SlowHeat" propose une piste pour le moins originale : et si, au lieu de chauffer des pièces, voire des logements entiers, nous chauffions d’abord nos corps ? Pendant trois hivers, une trentaine de familles bruxelloises se sont prêtées à l’expérience. Pour se chauffer, les participants ont utilisé essentiellement des "radiants", sortes de petits dispositifs électriques comme on en voit sur les terrasses des cafés, que l’on peut orienter directement vers soi. En plus des pulls, plaids, pantoufles, bouillottes et traditionnels sous-vêtements thermiques, ils ont aussi testé des méthodes plus surprenantes comme les couvertures électriques, mitaines et dessous de clavier chauffant pour les journées de télétravail hivernal. Les chercheurs leur ont également proposé de rester en mouvement dès que possible, par exemple, en se levant pour se faire une tasse de thé ou en installant un petit pédalier sous leur bureau…
En moyenne, les participants ont enregistré une économie d’énergie de 60 %. Sans injonction ou approche dogmatique, avec cette expérience de recherche participative, les chercheurs veulent montrer que la question de l’énergie dépasse les questions d’isolation et interroge nos habitudes. Et que, chacun selon ses moyens et sa motivation, on peut atteindre un même niveau de confort sans forcément tourner le thermostat.

Paradoxalement, l’engagement autour du climat et de la santé décline dans les médias et les politiques gouvernementales. C’est pourquoi les chercheurs appellent la communauté de santé à jouer un rôle clé pour inverser cette tendance et replacer la santé et le climat au cœur des décisions.
Les personnes qui chauffent principalement leur logement au mazout, au gaz propane livré en vrac ou au pétrole lampant acheté à la pompe peuvent bénéficier d'une allocation de chauffage lorsqu’elles se trouvent dans une situation financière précaire (revenus inférieurs à un plafond déterminé…). Cette aide financière est accordée chaque année si les conditions sont rencontrées. Il n’est pas trop tard pour l’obtenir encore pour 2024 en faisant la demande auprès du CPAS de sa commune (dans un délai de 60 jours suivant la livraison du combustible). Pour les combustibles livrés en grande quantité (mazout ou gaz propane) l’allocation est calculée au litre, avec un maximum de 2.000 litres par an. Pour les combustibles achetés à la pompe, l’allocation s’élève à 210 euros par an. Grâce au module de simulation pratique sur fondschauffage.be, il est possible de vérifier par soi-même si l’on remplit les conditions pour bénéficier d'une allocation du Fonds social chauffage.
0800 90 929 • info@fondschauffage.be • fondschauffage.be
C’est le nombre de patients qui, entre le 1er janvier et le 31 août de cette année, ont entamé un "trajet de démarrage diabète" avec l’aide de leur médecin. Nouveau depuis 2024, ce trajet permet aux personnes atteintes de diabète de type 2 d’être suivies par une équipe multidisciplinaire (diététicien, podologue…), rassemblées autour du généraliste. La mesure répond à un véritable enjeu de santé publique: en Belgique, on estime qu’1 personne sur 10 est diabétique.
Pour en savoir plus sur le "trajet de démarrage diabète", rendez-vous sur mc.be/fr/avantagesremboursements/diabete

À l’occasion du 40e anniversaire de la lutte contre le VIH en Belgique, l’exposition gratuite "VI(H)VRE, histoire d’une lutte " se tiendra jusqu’au 8 décembre à la Bourse de Bruxelles. L’événement invite le public à un voyage immersif à travers 40 ans de combats, de solidarité et de résilience face au VIH. Archives et témoignages vidéo, portraits photo, ligne du temps géante… L’exposition se déploie autour de plusieurs espaces thématiques, chacun offrant un éclairage unique sur les différentes facettes de l’histoire du VIH. "VI(H)Vre…" rappelle aussi que le virus du sida est toujours une réalité: en 2023, 665 personnes ont été diagnostiquées en Belgique, une augmentation de 13 % par rapport à 2022. Cette hausse concerne tant les populations hétérosexuelles qu’homosexuelles. La prévention reste dès lors cruciale, mais des obstacles persistent, comme la baisse de l'utilisation des préservatifs et l'accès limité à des traitements préventifs. L'augmentation des autres IST (gonorrhée, chlamydia…) aggrave encore la situation. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour contrôler l'épidémie, notamment par l'éducation et le dépistage régulier, souligne la plateforme Prévention Sida.
"VI(H)VRE, histoire d’une lutte" • Ouvert tous les jours (sauf le 2/12) de 9h à 22h jusqu’au vendredi 8 décembre • Bourse de Bruxelles, Blvd Anspach 80 à 1000 Bruxelles • 02 733 72 99 • preventionsida.org

De 24,6 millions d’euros… 6 millions : le gouvernement wallon prévoit une réduction de 75 % du budget consacré à la protection et la restauration de la biodiversité en Wallonie, soit 18,6 millions d’euros en moins pour des actions déjà sousfinancées. Cette diminution drastique compromet les engagements régionaux et internationaux, comme arrêter la perte de biodiversité d’ici 2030. En Wallonie, 95 % des habitats naturels sont en état défavorable. Pourtant, la nature joue un rôle clé pour atténuer les crises climatiques, purifier l’eau et l’air, et contribuer à notre bonne santé.
Plus de quinze organisations de la société civile, dont la MC, appellent le Parlement wallon à revoir ce budget et à établir un plan de financement réaliste, notamment en réorientant une part des subventions fédérales prévues pour les énergies fossiles. Protéger la biodiversité est une priorité pour préserver la prospérité de nos régions et la santé des générations futures.
natagora.be > actualités
SÉCU
Il y a 80 ans, le projet d’accord de solidarité sociale négocié par des représentants patronaux et syndicaux sous l’Occupation jetait les bases de notre sécurité sociale. Retour sur l'histoire d'un modèle de protection sociale unique, aujourd’hui mis sous pression.
Texte : Joëlle Delvaux, Illustration : Marion Sellenet

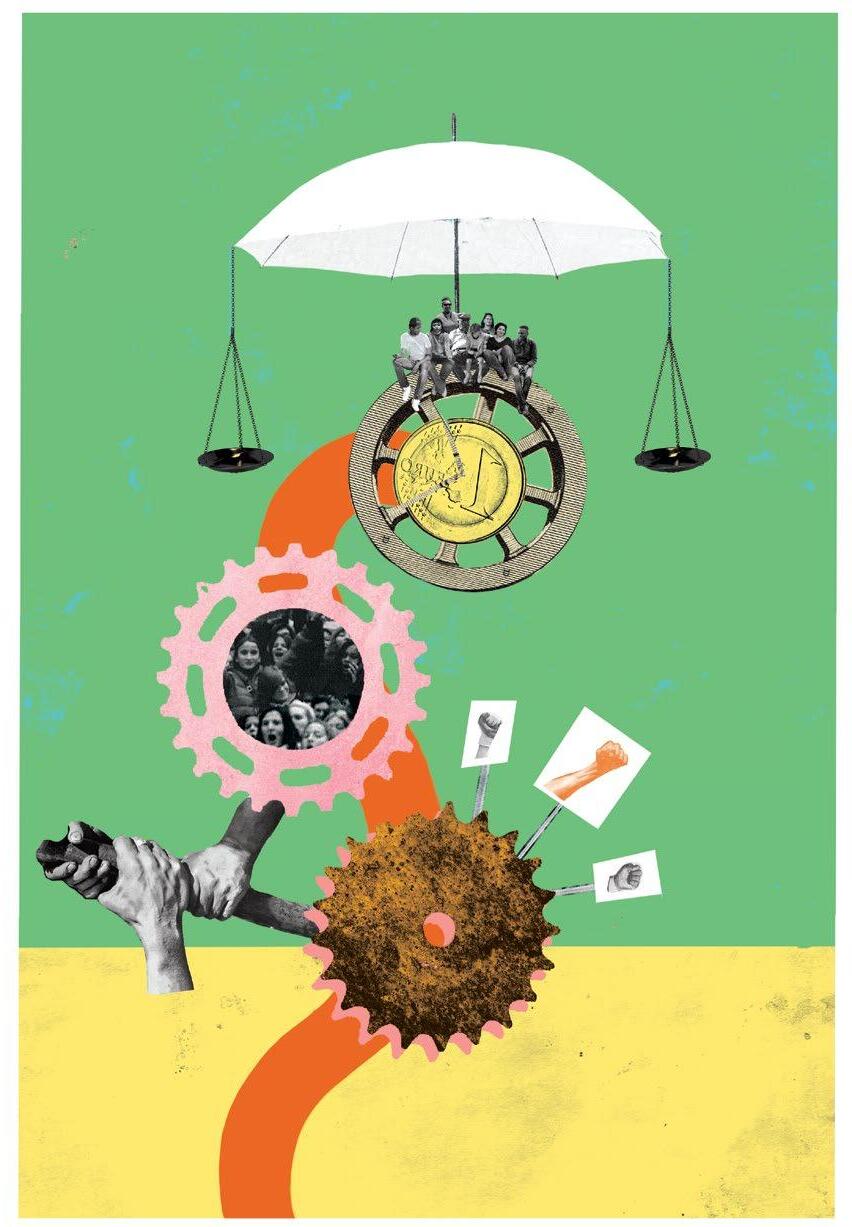
Seconde Guerre mondiale. Alors que la Belgique est toujours occupée par les Allemands, un groupe de fonctionnaires, patrons et syndicalistes se réunit régulièrement dans la clandestinité. Tous sont convaincus par la force de la concertation sociale et par la nécessité de renforcer la protection sociale pour répondre aux besoins de
la population. S’appuyant sur les régimes d’assurances sociales d’avant-guerre (lire encadré), ce comité informel élabore un Pacte social qui se concrétisera le 28 décembre 1944. À cette date, tandis que la Bataille des Ardennes fait rage, le ministre du Travail et de la prévoyance sociale signe l’Arrêté-loi qui rend obligatoire toutes les assurances sociales pour les salariés. Les cotisations sociales prélevées sur les salaires seront versées dans un fonds national (l'ONSS) chargé de les répartir entre les branches (chômage, allocations familiales, vacances annuelles, maladie-invalidité, etc.). La gestion de cette institution est confiée aux organisations syndicales et patronales.
Les trois décennies qui suivent constituent l'âge d’or de la sécurité sociale, porté par un contexte économique favorable et le plein emploi. La protection sociale se développe et se renforce. Les conditions d’indemnisation s’améliorent et les prestations minimales sont régulièrement revalorisées. Petit à petit, la couverture s'étend au-delà du salariat. Les indépendants acquièrent leur propre régime en 1967. Un an après, les jeunes en fin d'études accèdent à l'assurance chômage. Le droit aux allocations familiales s'étend progressivement à (quasi) toute la population. Il en ira de même plus tard pour les soins de santé.
Cette période de prospérité laisse pourtant nombre de citoyens dans la misère. Fin des années 60, les pouvoirs publics introduisent des législations novatrices accordant une garantie de revenus à certaines catégories dans le besoin (personnes handicapées, âgées, etc.). Ces réformes annoncent l’avènement du droit à un minimum de moyens d’existence, consacré par une loi en 1974.
Le tournant néo-libéral
La crise économique née du choc pétrolier de 1973 met à mal le modèle de croissance et de redistribution. Les pertes d'emploi massives plombent les recettes de la sécu tandis que les dépenses du chômage explosent. Les gouvernements qui se succèdent donnent la priorité à la compétitivité des entreprises et à l’assainissement des finances publiques. Ils font passer en force des mesures d’austérité.
En soins de santé, les tickets modérateurs à charge des patients augmentent. Dans l'assurance chômage, une distinction est introduite entre chef de ménage, isolé et cohabitant pour moduler les allocations selon la situation familiale. L’'indexation des allocations sociales est gelée à trois reprises…
Côté recettes, les hauts salaires sont davantage mis à contribution (le plafond de salaire sur lequel sont calculées les
cotisations sociales est supprimé) et des cotisations spéciales sont imposées pour combler le déficit dans certaines branches (les soins de santé essentiellement). C’est le début d’un élargissement du financement de la sécu au-delà du travail (financement alternati f).
Les années 1980 voient monter en puissance les idées néo-libérales. Les pouvoirs publics choisissent de favoriser fiscalement le recours à des assurances privées en matière de pension et de soins de santé.
Des années de modernisation
Dans les années 1990, la Belgique est tenue d'assainir ses finances publiques et d'assurer l’équilibre financier de la sécurité sociale pour réussir son intégration dans l’Union économique et monétaire. Pour augmenter les recettes de la sécu, le gouvernement impose notamment une cotisation spéciale de sécurité sociale. Il décide aussi d'un nouveau mécanisme d’indexation qui ne tient plus compte des prix du carburant, du tabac et de l’alcool (indice santé), ce qui freinera les dépenses en allocations sociales.
Pendant cette période, des changements dans la gouvernance de la sécu confirment ce qui se dessinait dans les années 80. La gestion du système devient globale en 1995. Dorénavant, les interlocuteurs sociaux et le gouvernement fédéral décident ensemble de la répartition de tous les moyens financiers (cotisations sociales, financement alternatif et subventions de l'État) entre les différentes branches. Ce nouveau mode de gestion renforce le pouvoir du gouvernement.
Né dans les pays scandinaves, le modèle de "l’État social actif" est importé chez nous au début des années 2000 (1). Objectifs? Accroître la réinsertion des demandeurs d'emploi, lutter contre l'enlisement dans le chômage et réduire la pauvreté. Les chômeurs indemnisés ne doivent plus pointer mais ils sont tenus de rechercher activement un emploi. Des dispositifs dits "d'activation" sont déployés pour les accompagner et les contrôler.
Un autre grand chantier concerne les pensions. En 1997, le gouvernement décide de faire passer progressivement l’âge de la pension pour les femmes de 60 à 65 ans. Par la suite, les mesures pour augmenter le taux d’emploi des travailleurs âgés et soulager le budget des pensions s'enchaînent : report progressif de l'âge de la pension à 67 ans d'ici 2030, restrictions d’accès au chômage avec complément d'entreprise (ex-prépension) et au crédit-temps fin de carrière...
La sécurité sociale dans les crises
La crise financière de 2008 et la crise sanitaire en 2020 montrent que la sécu joue un rôle crucial, non seulement en assurant la solidarité, mais aussi en contribuant à la stabilité économique. Malgré tout, elle subit des assauts. En 2014, la 6 e réforme de l’État ampute la sécu d'une de ses branches, les allocations familiales. Six ans après, celles-ci
sont transférées aux entités fédérées (2) en même temps que certaines compétences en matière de santé et d'emploi. Cette régionalisation rend les systèmes plus complexes que jamais et affaiblit la solidarité entre les citoyens.
Dans les années 2010, plusieurs mesures mettent à mal le droit à certaines prestations : renforcement de la dégressivité des allocations de chômage (2012), limitations du droit à l’allocation d’insertion (2015), fin du crédit-temps sans motif (2017), etc. Tax-shift, flexi-jobs, jobs étudiant, économie collaborative, avantages extra salariaux, freelance ... Les politiques fiscales et d'emploi privent aussi gravement la sécu de cotisations sociales (3). Les subventions de l'État, quant à elles, restent plus que jamais soumises à l'état des finances publiques et au pouvoir du gouvernement fédéral, singulièrement depuis la nouvelle loi de financement de la sécurité sociale adoptée en 2017.
Pourtant, assurer un financement correct et stable de la sécurité sociale reste un enjeu central si l'on veut qu’elle continue d’incarner un modèle de protection sociale efficace contre les aléas de la vie, et de solidarité contre les inégalités sociales.
(1) "Comprendre la sécurité sociale pour la défendre", P. Feltesse et P. Reman, Couleurs livres, 2006 (2) Régions wallonne et bruxelloise, Flandre et Communauté germanophone. (3) Tous régimes confondus, la part des cotisations sociales dans les recettes ne représentait plus que 55 % en 2024 contre 62 % en 2011.
Obligatoire depuis 1945, la sécurité sociale puise ses racines plus profondément dans une histoire marquée par les luttes sociales du 19e siècle (1). En mobilisant leurs maigres revenus, des travailleurs décident de créer et gérer des mutualités pour atténuer les conséquences financières de la maladie et de l’invalidité. Ils mettent aussi sur pied des caisses de chômage pour pallier provisoirement la perte d’emplois. De leur côté, certains patrons plus ou moins sociaux et des bourgeois plus ou moins conservateurs interviennent sur le terrain de la protection des ouvriers et de leurs familles.
Les années 1880-1920 voient ainsi se déployer de nombreuses initiatives collectives : caisses d’usine, sociétés de prévoyance et de secours mutuels, caisses de chômage, de pension, de compensation d’allocations familiales, etc.
Durant l’entre-deux guerres, la protection sociale offre une image complexe, renforcée par la rivalité entre chrétiens et laïcs (surtout socialistes). Au moment où éclate la guerre de 40-45, seuls les régimes des pensions et des allocations familiales ont été rendus obligatoires par les pouvoirs publics. S’assurer contre le chômage et la maladie restait libre, l’État se contentant de promouvoir l’affiliation des travailleurs en subventionnant les caisses et mutualités.
(1) "La sécurité sociale", Guy Vanthemsche, Ed. De Boeck, 1994.
SÉCU
Avec le jeu de société "Sécuons-nous !", Ocarina adopte une approche ludique pour sensibiliser les jeunes aux droits et mécanismes de la sécurité sociale.
Texte : Sandrine Warsztacki, Illustration : Marion Sellenet
Dans une salle de classe transformée en plateau de jeu, Fanny Debatty, animatrice Ocarina, distribue les cartes de la vie : maladie, accident, perte d’emploi… Autant de coups du sort auxquels les participants à la table devront faire face en jonglant stratégiquement avec leur capital de points "bien-être" et "money". Mais les personnages incarnés par les jeunes joueurs ne partent pas tous avec les mêmes chances : il y a Maurice, modeste retraité ; Richard, médecin bien installé dans la vie ; Abdel, étudiant ; Chantale, maman solo… Et pour corser le défi, chacun de ces personnages se décline en deux versions vivant dans des mondes parallèles. D'un côté celui des "soliDaires", dont les joueurs doivent reverser une partie de leur argent dans la caisse à chaque tour, en contrepartie de quoi ils bénéficient
de divers avantages en cours de partie. De l'autre, celui des "soliTaires", sorte de dystopie dans laquelle la sécurité sociale n'aurait jamais vu le jour.
sécu, un jeu d’enfant ?
En transformant la sécurité sociale en un grand jeu de société, "Sécuonsnous !" fait de ces enjeux complexes un sujet tangible et captivant.
"Rappelez-vous, on n’est pas dans Monopoly ! L’objectif n’est pas de s'enrichir, mais de garder assez de points de bien-être pour survivre", prévient Fanny. Devant les visages concentrés, sa collègue Nathalie Boucher rassure: "Les règles peuvent sembler complexes au début, mais ça devient vite intuitif." Comparée à la complexité de la sécurité sociale, serait-on tenté de commenter, cela semble effectivement un jeu d’enfant... Entre éclats de rire et petits désastres du jeu, les animatrices déroulent patiemment les étapes de ce labyrinthe de droits

sociaux à grands renforts de présentations PowerPoint. "Les jeunes évoquent souvent des expériences personnelles pendant la partie : le chômage d’un parent, la maladie d’un proche… Ils prennent conscience que ces mécanismes, qui peuvent sembler techniques, les touchent dans leur quotidien", commente Fanny. "Cette couverture contre les risques de la vie peut paraître lointaine quand on est jeune, en bonne santé, et qu’on a la vie devant soi. Mais elle nous accompagne depuis toujours, et ce dès la naissance, avec la première facture d’hôpital", illustre sa collègue.
Coups de dés pour la solidarité
Au bout de quelques tours, deux dynamiques bien distinctes se dessinent entre les groupes de joueurs. Chantale T., des "soliTaires", frôle le game over, tandis que la situation de Chantale D., des "soliDaires", s’améliore un peu malgré un départ difficile. Maurice T. doit débourser 100 "money" pour une prothèse de hanche qui n’en a coûté que 10 à Maurice D. Faire appel à la charité des autres joueurs est sa dernière chance. "Je gagne quelque chose si je l'aide ?", hésite une participante. "Juste le plaisir d’avoir accompli une bonne action. On n'a pas prévu de déduction fiscale pour les dons", la taquine Fanny, l’animatrice. En transformant la sécurité sociale en un grand jeu de société, "Sécuons-nous !" fait de ces enjeux complexes un sujet tangible et captivant, que ces jeunes, qui s’apprêtent à plonger dans la vie active, apprendront à connaître et, espérons-le, à défendre. "On fait de la prévention en termes de droits sociaux, avec des conseils très pratiques pour limiter ses frais de santé, etc. Et on fait de la prévention contre les stéréotypes, comme le cliché que tous les chômeurs seraient des profiteurs ", résume Fanny, toujours prête à dégainer un graphique au tableau pour confronter les idées reçues à la réalité des chiffres.
Que souhaiter à la sécurité sociale pour son anniversaire ? Pour répondre à cette question, nous avons échangé avec deux économistes, une syndicaliste et un représentant du patronat. Leurs propos se complètent, se nuancent, divergent parfois, mais tous partagent une conviction : renforcer cette institution est essentiel pour relever le défi du vivre ensemble.
Texte : Joëlle Delvaux, Julien Marteleur, Sandrine Warsztacki, Illustration : Marion Sellenet
Le 28 décembre 1944, un arrêté-loi posait les fondations de notre sécurité sociale (lire article pages 8-9). Aux grands mouvements sociaux et idéaux d’après-guerre ont succédé la mondialisation, les mutations du marché du travail, les politiques néolibérales... La société de 2024 est devenue plus individualiste et, paradoxalement, nous bénéficions plus que jamais de ces dispositifs de solidarité dans notre quotidien. Certains verront le verre à moitié vide: la pauvreté persiste, le décrochage des jeunes en âge de travailler et la précarité des familles monoparentales inquiètent, l’accès aux soins de santé reste inégalitaire. D'autres épingleront davantage les raisons de se réjouir : la Belgique jouit d’une couverture sociale et d’un système de soins solides ! La comparaison avec les pays où les systèmes de santé et de retraites sont laissés aux lois du marché est sans équivoque : la couverture y est plus inégalitaire et coûteuse. "En Amérique du Sud, les fonds de pension privés explosent leurs budgets publicitaires. C’est autant d’argent qui n’est pas investi dans les pensions", prend pour exemple Etienne de Callataÿ, économiste à l’université de Namur et à la London School of Economics. La sécurité sociale contribue aussi à la résilience de nos sociétés, plaide de son côté Pierre Reman, ancien directeur de la Faculté de politiques économique et sociale de l’UCL : "Les pays dotés d’une sécurité sociale robuste traversent les crises avec moins de dégâts économiques et sociaux". Lors de la crise financière de 2008 ou celle du Covid, des dispositifs comme le droit-passerelle et le chômage temporaire ont permis de limiter la paupérisation et de faciliter la reprise économique.
Pourtant, ce bouclier social est de plus en plus vu comme une charge, un frein à la compétitivité des entreprises, voire à la motivation des travailleurs. "À l’origine, la sécurité sociale était perçue par les interlocuteurs sociaux comme un instrument de juste redistribution des richesses pour assurer la prospérité socio-économique du pays", rappelle Anne Léonard, Secrétaire nationale de la CSC. Quel contraste !
Les coûts liés au vieillissement de la population auraient-ils rendu le système insoutenable ? Le défi était prévisible depuis les années 90 ! En 2001, un Fonds pour le vieillissement a été créé, mais jamais financé… De même, investir dans la prévention en santé aurait permis d’atténuer les coûts des maladies chroniques. Et demain, d'autres défis tout aussi prévisibles pour nos systèmes de santé et de protection sociale nous attendent avec la crise écologique.
Les débats sur l’âge de la retraite, la fiscalité, la durée du chômage, l’activation des personnes en incapacité de travail,
etc., sont devenus autant de sujets d’actualité inflammables sur le plan politique. Mais la vraie question, dans le fond, est sans doute ailleurs : "Nous produisons bien assez de richesse en Belgique pour financer la sécurité sociale, assure Pierre Reman. Mais voulons-nous encore redistribuer cette richesse de manière

Retrouvez les interviews de nos experts en page 12 et, dans leur version longue, sur enmarche.be/ securite-sociale

Secrétaire nationale de la CSC

Président de l’Union des classes moyennes (UCM)
"La flexibilité excessive du marché du travail érode l’accès à la sécurité sociale"
Pour Anne Léonard, Secrétaire nationale de la CSC, assurer l’avenir de la sécurité sociale, c’est revenir à ses fondements: être un outil de redistribution des richesses, financé par des emplois stables et de qualité.
Anne Léonard : La sécurité sociale est confrontée à l’ingérence croissante du politique, avec la volonté de certains partis de désinvestir le système. On constate aussi un désengagement du monde patronal qui la considère de plus en plus comme une charge qui entrave la compétitivité. Rappelons-nous qu’à l’origine, la sécurité sociale était considérée comme un instrument de juste redistribution des richesses, permettant d'assurer la prospérité du pays !
La sécurité sociale doit rester aussi adéquate que possible dans ses volets assurantiel et solidaire. Les travailleurs doivent pouvoir bénéficier d’une large couverture en cas de perte de revenus (maladie, licenciement, accident de travail, retraite...). Les prestations sociales doivent offrir une protection efficace contre la pauvreté. D'où l'importance de préserver l’indexation automatique des allocations sociales et de maintenir l'enveloppe bien-être qui permet de revaloriser les allocations les plus basses.
En Marche : Que propose la CSC pour garantir un système solidaire correctement financé ?
AL : La flexibilité excessive du marché du travail érode les droits des travailleurs et l’accès à la sécurité sociale. Nous devons recréer un environnement favorable à la création d'emplois stables et de qualité. Dans le même temps, il faut lutter contre la fraude et les formes d'évasion aux cotisations sociales. Enfin, nous sommes favorables au financement des soins de santé par une cotisation sociale généralisée. Tous les revenus, y compris ceux du capital doivent contribuer à cette couverture universelle. Cela étant, cette branche doit être maintenue dans la sécurité sociale fédérale pour garantir la cohérence du système et conserver le mode de gestion paritaire qui en fait toute sa richesse.
"L’existence des interlocuteurs sociaux ne peut pas être remise en question"
Pour Pierre-Frédéric Nyst, Président de l’Union des classes moyennes (UCM), la richesse de la sécurité sociale réside aussi dans son modèle de concertation sociale, que l’on soit assis sur le banc des syndicats ou celui des employeurs.
Pierre-Frédéric Nyst : Certains partis souhaitent recadrer la concertation sociale. Mais cette concertation est l’expression même d’une société civile "organisée". Cela permet de construire un socle social solide, qui traverse le temps au gré des changements de gouvernements. Quand on nous demande notre avis, on le rend. Le gouvernement peut respecter cet avis mais il peut s'en écarter également. Il faut arrêter de croire que ceux qu’on appelle communément les "corps intermédiaires" prennent toutes les décisions. La sécurité sociale a été créée et doit être gérée avec l’aide des interlocuteurs sociaux, dont l’existence ne peut être remise en question. Nos avis sont des mains tendues vers le monde politique, pas des bâtons dans les roues !
En Marche : Le monde du travail est en pleine évolution. Avec quelles conséquences pour la sécu ?
P-FN : L’arrivée du télétravail et de l’intelligence artificielle d’un côté, et l’augmentation des burn-out et de l’incapacité de travail de l’autre, indiquent qu’il va falloir repenser le monde du travail. La bonne santé de la sécurité sociale repose sur l'expression du salariat. Les nouvelles générations nous disent qu’elles ne travailleront plus comme les précédentes et les patrons doivent pouvoir l’entendre. Si nous faisons la sourde oreille, nous irons droit dans le mur.
La santé de la sécurité sociale dépend majoritairement du nombre de travailleurs actifs. Il faut encourager l'emploi et pour cela, offrir la possibilité à toutes et tous de mettre le "pied à l'étrier" du monde du travail. Certes, les jobs étudiants, les flexijobs, les premiers emplois "zéro cotisation pour l’employeur" ne remplissent pas directement les caisses de la sécurité sociale, mais ce sont des tremplins qui facilitent l’entrée dans la vie professionnelle.

Professeur d’économie à l’université de Namur
"Il faut rendre le système plus efficace pour réduire à la fois les inégalités et les dépenses"
Pour Etienne de Callataÿ, professeur d’économie à l’université de Namur, défendre la sécurité sociale doit passer par la responsabilité individuelle et collective. Etienne de Callataÿ : Il faut sortir de la logique de la "citadelle assiégée" et oser se demander comment rendre le système plus efficace pour réduire les dépenses et mieux répondre aux inégalités. La Belgique n’est pas le pays le plus inégalitaire d’Europe, mais de nombreux indicateurs, à commencer par le nombre d’enfants vivant dans la pauvreté, doivent nous préoccuper. À gauche, on se méfie du mot "responsabilisation", de peur de culpabiliser les plus vulnérables. Il ne s’agit pas de pointer les gens du doigt. Les politiques doivent mieux accompagner le retour à l’emploi. Les difficultés d’accès aux crèches, aux transports… sont de réels pièges à l'emploi. Mais il faut aussi garder en tête qu’en refusant un emploi jugé insuffisamment intéressant ou rémunérateur, on refuse aussi de contribuer à la solidarité. De même, une entreprise qui génère un taux de burn-out élevé doit être sanctionnée… Aujourd’hui, chacun prône la responsabilisation, mais uniquement quand cela ne touche pas ses propres intérêts. Quand la droite parle de responsabilisation, j’ai envie de dire : bravo, allons au bout, et adoptons enfin le principe du pollueur-payeur pour les entreprises. Dans le fond, il n’y a pas principe plus libéral dans sa philosophie !
En Marche : Au-delà de la performance du système, comment assurer son financement ?
EdC : Personnellement, je suis favorable à une baisse des cotisations sociales à condition de lutter contre l’optimalisation sociale et fiscale. Prenons les voitures de société, le travail de nuit… On a baissé les cotisations pour répondre aux revendications salariales sans perdre en compétitivité, mais finalement on encourage des conditions de travail néfastes à la santé et on favorise les multinationales. On dit aux entreprises et aux travailleurs de contribuer, mais on leur offre des portes de sortie qui creusent le déficit et renforcent les inégalités.

Économiste et ancien directeur de la Fopes
"Les pays dotés d’une sécurité sociale robuste traversent mieux les crises"
Pour Pierre Reman, économiste et ancien directeur de la Fopes, la sécurité sociale nous protège des risques à titre individuel, mais aussi en tant que société.
Pierre Reman : La sécurité sociale joue un rôle essentiel dans la redistribution des richesses. Et à ce titre, c’est une institution clé de notre cohésion sociale. Bien sûr, aucune institution n'est parfaite. La précarité des jeunes non qualifiés et des familles monoparentales est un des enjeux auxquels la sécurité sociale doit s'attaquer. Mais on oublie trop vite à quel point les inégalités sociales étaient criantes en Belgique avant son instauration ! Les pays dotés d’une sécurité sociale robuste traversent les crises avec moins de dégâts économiques et sociaux. Elle nous a encore prouvé son efficacité en 2008, lors de la crise financière, puis en 2020, lors de la crise sanitaire. L'extension du chômage temporaire aux salariés, le droit-passerelle élargi pour les indépendants et le maintien du niveau des prestations sociales ont permis de maintenir globalement le revenu disponible des ménages et facilité la reprise économique.
En Marche : Mais cela a aussi eu un coût …
PR : Aujourd’hui, la question n’est pas de savoir si nous pouvons financer la sécurité sociale, la Belgique produit bien assez de richesses pour cela ! Le vrai débat est ailleurs : souhaitons-nous maintenir un modèle fondé sur la redistribution des richesses ? Quelle part de risque acceptons-nous de solidariser ou voulons-nous gérer de façon individuelle concernant notre santé et notre travail ? Malheureusement, l’idée qu’une société égalitaire est meilleure qu’une société inégalitaire ne fait plus consensus. Ce dont la sécurité sociale aurait besoin aujourd'hui, c’est d’un nouveau pacte social, comme celui de 1944. Quel projet voulons-nous en tant que société ? Et comment, collectivement, la voyons-nous évoluer face aux défis modernes ?
Retrouvez la version longue de ces entretiens sur enmarche.be/securite-sociale
Accomplir les actes de la vie quotidienne peut être compliqué pour le travailleur qui se trouve en incapacité de travail prolongée à la suite d’une maladie ou d’un accident. À certaines conditions, une allocation forfaitaire peut compléter l’indemnité versée par la mutualité.
Texte : Service social de la MC
Le travailleur en incapacité de travail qui a besoin d'aide pour certains actes de la vie quotidienne peut bénéficier d'une allocation pour l'aide d’une tierce personne (ATP) à partir du 4e mois d'incapacité. Qu'il soit salarié, chômeur ou indépendant.
Une somme forfaitaire de 28,81 € par jour ouvrable (montant indexé au 1er mai 2024) s'ajoute à son indemnité payée par la mutualité.
Bon à savoir : ce supplément n’est pas imposable, c’est-à-dire que l'ATP n’est pas prise en compte dans le calcul des impôts.
Quelles sont les conditions ?
La personne en incapacité de travail doit :
• bénéficier d’indemnités payées par la mutualité,
• et être en situation de perte d’autonomie
l’empêchant d’accomplir certaines activités quotidiennes.
C'est le médecin-conseil de la mutualité qui évalue le degré d’autonomie de la personne dans les tâches du quotidien. Il se concentre sur ce qu'elle est capable de faire et non ce qu’elle n’est plus en mesure de réaliser. Selon la situation, il prend une décision sur la base des rapports médicaux reçus ou convoque la personne.
Pour évaluer la perte d’autonomie, le médecin-conseil utilise une échelle d’évaluation sous forme de système hiérarchique. Si toutes les réponses d’une catégorie sont positives, le médecinconseil s’arrête là. Si l’une des réponses est négative, il passe à la catégorie suivante. Il attribue des scores en lien avec le degré d’autonomie.
Les fonctions évaluées sont :

En cas d’hospitalisation ou d’hébergement en maison de repos et/ou de soins ou dans un établissement de soins psychiatriques, le droit à la tierce personne est suspendu dès le 1er jour du 3e mois d’hospitalisation ou d’hébergement et ce, jusqu’à la fin de la période. Bon à savoir
• se déplacer,
• absorber ou préparer sa nourriture,
• assurer son hygiène personnelle et s’habiller,
• assurer l’hygiène de son habitat et accomplir des tâches ménagères,
• vivre sans surveillant, être conscient des dangers et en mesure de les éviter,
• communiquer et avoir des contacts sociaux.
Le médecin-conseil tient compte de certains principes. Parmi ceux-ci :
• Les activités doivent pouvoir être effectuées de manière indépendante, sans grands efforts, sans devoir y consacrer un temps exagéré, en toute sécurité, sans danger pour la personne ou autrui.
• La personne doit être capable d’effectuer l’activité sans aucune aide.
Le travailleur en incapacité de travail doit introduire sa demande auprès du médecinconseil de sa mutualité. La démarche peut être faite aussi par un proche, par un assistant social ou par le médecin-conseil lui-même. Il est possible de se faire aider par un conseiller mutualiste ou par le service social de sa mutualité.
L’ATP est octroyée au plus tôt à partir du 4e mois d’incapacité pour minimum 3 mois. La demande peut être renouvelée avant la fin de la période. L'octroi de l'ATP se termine au plus tard lorsque la période de reconnaissance de l’incapacité de travail prend fin.
Le service social à vos côtés
Les centres de service social de la MC sont à votre disposition pour toute question sociale. Appelez le 081 81 28 28 ou consultez les horaires de permanences sur mc.be/social. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous en agence.
Depuis le 1 er octobre, l'assureur doit respecter des délais pour répondre et indemniser la personne demandant l’intervention du contrat. Le paiement devrait être plus rapide à l’avenir.
Texte : Joëlle Delvaux avec l'asbl Droits Quotidiens

Jusqu'à présent, lorsqu'un assureur devait indemniser l’assuré lui-même ou une tierce personne victime d’un dommage (par facilité, nous parlerons de "victime" dans la suite de cet article), il n'existait pas de délais clairs. Seules l'assurance RC auto, l'assurance incendie (habitation) du propriétaire et l'assurance vie avaient leurs règles spécifiques qu’elles conservent en partie.
Dorénavant, les règles sont uniformisées et couvrent les différents types de contrats d’assurance :
• les assurances de responsabilité, comme l'assurance familiale.
• les assurances de choses, comme l'assurance multirisques (omnium), vélo, vol, incendie (en tant que locataire)…
• les assurances non encore règlementées, comme les assurances hospitalisation, l’assurance revenu garanti pour travailleurs indépendants…
L'assureur doit répondre au plus tard 3 mois à partir du jour où la victime lui a transmis par écrit sa demande d'indemnisation. L’assureur doit lui envoyer :
• soit une proposition d'indemnisation avec le calcul du montant de l'indemnité,
• soit une explication sur la raison pour laquelle il ne peut pas proposer une indemnisation (montant du dommage pas fixé, responsabilité pas prouvée…).
L’assureur doit envoyer une proposition d'indemnisation lorsque :
• La police d'assurance est valide et couvre les dommages.
• On sait qui a causé le dommage (la responsabilité est établie, prouvée).
• Le montant du dommage est fixé.
Si la victime accepte la proposition d'indemnisation, l’assureur est tenu de payer dans les 30 jours.
L’assureur n’a pas répondu dans les 3 mois
Une fois le délai de réponse dépassé, l’assureur devra payer en une fois un montant forfaitaire de 300 euros au titre de dédommagement. La victime doit adresser à l’assureur un courrier de rappel par recommandé. Si l’assureur ne réagit pas à l’envoi de ce rappel dans les 14 jours, il devra payer un montant complémentaire de 300 euros par jour de retard jusqu'au jour où la victime reçoit la réponse.
L’assureur n’a pas payé dans les 30 jours
Pour les assurances de responsabilité, si l’assureur ne respecte pas le délai de paiement, il devra payer des intérêts légaux calculés sur le montant dû. En 2024, l’intérêt légal s'élève à 5,75 %. Pour les autres assurances (assurance revenu garanti, assurance multirisques, etc.), l’assureur devra payer le double de l’intérêt légal.
d’accord avec la proposition de l’assureur ?
Si la victime n’est pas d’accord avec la proposition d’indemnisation, l’assureur doit lui verser au minimum les montants sur lesquels ils sont d’accord, et ce dans les 30 jours qui suivent la proposition de l’assureur.
Pour récupérer les montants contestés, la victime peut faire appel à son propre expert. Les frais liés à cette intervention peuvent être pris en charge dans la garantie protection juridique du contrat d’assurance ou par une assurance protection juridique étendue éventuellement souscrite.
Le délai de 3 mois accordé à l'assureur pour répondre à la victime peut être suspendu dans deux circonstances :
• L'assureur a informé la victime par écrit qu'il ne peut respecter le délai à cause d’une force majeure (un sinistre très complexe ou un litige entre héritiers par exemple).
• La victime doit encore fournir les informations nécessaires pour compléter le dossier ou calculer l'indemnisation.
Depuis le 1er octobre, l’assuré peut mettre fin gratuitement et à tout moment à son assurance à partir de la 2e année. Il doit en informer son assureur par envoi recommandé 2 mois avant la date de fin souhaitée. Même procédure s’il veut mettre fin au contrat à la date prévue. Ces règles s'appliquent aux contrats d'assurance qui couvrent des consommateurs (pas des professionnels) et qui sont signés ou automatiquement renouvelés depuis le 1er octobre. Avant cette date, il fallait informer son assurance au moins 3 mois avant l'échéance du contrat. Mettre fin à un contrat d’assurance

Chaque patient peut bénéficier d’un accompagnement spécifique et intégralement remboursé pour l'aider dans sa prise de médicaments. Comment ? En demandant à son pharmacien attitré de devenir son pharmacien de référence. Explications.
Texte : Julien Marteleur
Quand on est malade, un traitement efficace et sûr est essentiel pour se soigner dans les meilleures conditions possibles. Parallèlement au rôle du médecin traitant, la fonction de pharmacien de référence a été créée. Le pharmacien de référence, c'est un pharmacien de confiance, désigné par le patient. Il est là pour aider le malade à bien utiliser le traitement prescrit et à en tirer le maximum de bénéfices. C'est aussi la personne que les autres prestataires de soins contacteront s’ils ont besoin d’informations sur les médicaments du patient.
Comment désigner un pharmacien de référence ?
En signant une convention "pharmacien de référence" avec le pharmacien choisi. Au préalable, celui-ci aura pris le temps d'informer le patient, lui expliquer ce qu'il peut attendre de ce service et quels sont ses droits en la matière. La signature du patient autorise le pharmacien à devenir pharmacien de référence, et ainsi : → faire le suivi des
Le pharmacien de référence est la personne que les autres prestataires de soins contacteront s’ils ont besoin d’informations sur les médicaments du patient.
soins pharmaceutiques. Le pharmacien de référence enregistre ses conseils dans le dossier pharmaceutique du patient et, au besoin, peut proposer un entretien d’accompagnement pour un bon usage des médicaments. → partager électroniquement les données de santé du patient entre les différents professionnels de santé qui le suivent pour améliorer l’accompagnement Ce "consentement éclairé" peut être accordé en
ligne par le patient sur masante.belgique. be. Le pharmacien, un médecin ou encore la mutualité peut également effectuer cette démarche pour lui.
Concrètement, que fait le pharmacien de référence ?
• Il a une vue globale sur les médicaments pris par le patient
Quand le patient va chercher ses médicaments à la pharmacie, le pharmacien de référence les enregistre dans son Dossier pharmaceutique partagé (DPP). Il y consigne aussi les autres produits de santé susceptibles d’influencer l’efficacité de son traitement (les compléments alimentaires, par exemple). De cette façon, le patient ne risque pas de recevoir deux produits qui ne doivent pas être pris en même temps.
Via le DPP, ces informations sont partagées aux autres pharmaciens. Si le patient doit se rendre dans une pharmacie de garde, par exemple, ce pharmacien pourra aussi faire ces vérifications.
• Il garde le schéma de médication à jour et le met à disposition du patient
Le schéma de médication est un aidemémoire très pratique. Ce document se présente sous la forme d’un tableau reprenant l’ensemble des médicaments et des produits de santé qui ont été prescrits au patient (par son généraliste, son dentiste, d’autres médecins, etc.) ou pris sans ordonnance. Il contient toutes les informations utiles à la prise correcte des médicaments : le dosage, le moment de prise, des instructions éventuelles... Le pharmacien de référence peut aussi partager, via le DPP, le schéma de médication du patient avec les autres professionnels de santé qui l’accompagnent (le médecin traitant, par exemple, ou des spécialistes à l’hôpital).
Ils auront ainsi connaissance des médicaments utilisés et pourront proposer le meilleur traitement possible. Le patient peut d'ailleurs emporter son schéma de médication à chaque rendez-vous médical. C’est tout bénéfice pour sa santé ! • Il offre un accompagnement adapté et personnalisé
Le pharmacien de référence doit être disponible pour répondre aux questions portant sur les médicaments et proposer des solutions adaptées si le patient rencontre des difficultés avec son
traitement. Par ailleurs, il s'engage à devenir la personne de contact pour tous les autres prestataires de soins qui auraient des questions sur les médicaments utilisés par le malade.
ça coûte ?
Le patient ne doit rien payer pour ce service. La mutualité versera un montant annuel au pharmacien de référence (37,86 euros en 2024) si le patient ne réside pas en maison de repos et qu'il a pris, au cours de l’année écoulée, au moins 5 médicaments (remboursables) différents, dont au moins un de façon chronique (sur une durée de plusieurs mois, NDLR), en s'adressant à la même pharmacie.
Comme pour le médecin de famille, le choix d’un pharmacien de référence
est totalement libre. Si le pharmacien est absent, un autre pharmacien travaillant dans la même officine peut assurer le suivi. Le patient peut mettre fin à la convention à tout moment ou changer de pharmacien de référence, simplement en en désignant un nouveau. Par ailleurs, le patient reste libre de se rendre dans d'autres pharmacies pour faire exécuter son ordonnance. Grâce à son Dossier pharmaceutique partagé, celles-ci auront accès aux données nécessaire pour délivrer les médicaments dont le patient a besoin, en toute sécurité.
Pour davantage d'infos sur le pharmacien de référence, rendez-vous sur inami.fgov.be (Professionnels > Pharmaciens) ou sur pharmacie.be (rubrique "Notre expertise").
La "revue de la médication", kézako ?
En Belgique, près de 300.000 patients prennent de façon chronique au moins 5 médicaments par jour. La collaboration entre généralistes et pharmaciens en vue de rendre l’utilisation de ces médicaments "chroniques" la plus efficace possible est une priorité de santé publique pour le gouvernement. Pour œuvrer dans ce sens, les patients malades chroniques qui prennent plus de 5 médicaments remboursés par jour peuvent bénéficier d’une revue de la médication. Cette sorte de carnet de bord est une analyse structurée du traitement médicamenteux, qui a pour but d'optimiser l'utilisation des médicaments, de réduire les problèmes liés aux médicaments (PLM) et d'améliorer les objectifs de santé. Ceci comprend tant la détection des PLM, que la proposition et la mise en œuvre d'interventions spécifiques pour le patient. Cet accompagnement personnalisé comprend deux entretiens avec le pharmacien de référence. Lors du premier rendez-vous, patient et pharmacien passent en revue l’usage des médicaments. L’occasion de vérifier si tous les médicaments utilisés agissent correctement, s’ils sont encore nécessaires, etc. Suite à cet entretien, le pharmacien analyse ces informations en détail afin de formuler, si nécessaire, des propositions pour optimiser les effets de la prise des médicaments, notamment par une mise à jour du schéma de médication.
Annie, 55 ans, a du mal à avaler ses cachets. " C’est une punition de les prendre chaque matin ", confie-t-elle à Maryse, sa pharmacienne de référence. Celle-ci contacte alors le médecin traitant. Avec son accord, elle va préparer elle-même un sirop contenant la même substance que les cachets. Annie pourra ainsi poursuivre son traitement sans risque de l’abandonner. Quelques jours plus tard, son sourire en dit long : la solution proposée par Maryse est la bonne. Diabétique, Gérard, 87 ans, prend plusieurs médicaments pour ses "pépins de santé", comme il dit. Un soir, il fait une lourde chute. À l'arrivée de l’ambulance, sa femme a la présence d’esprit de prendre le schéma de médication que son pharmacien de référence leur avait remis. À l’hôpital, l’équipe médicale voit tout de suite les médicaments que Gérard doit prendre.
Source : pharmacie.be
Des femmes sans logement ou mal logées ont trouvé un lieu de sécurité et d'émancipation après avoir essuyé de multiples violences : Circé, le premier et seul centre d'accueil de jour pour femmes à Bruxelles et créé par l'asbl L'Ilot, a soufflé sa première bougie. Reportage.
Texte : Soraya Soussi, Photos : Marie Thion
Sur le Parvis de Saint-Gilles, une voix attire l'attention. Devant la maison d'accueil de jour Circé dont la porte imposante en fer forgé est coincée entre une friterie et un bar, une femme en interpelle une autre. Elles parlent fort, rient aux éclats, fument ensemble. À l'intérieur, des collages et des pancartes aux slogans féministes ornent les murs. Circé, la sorcière de la mythologie grecque, a donné son nom à ce "centre communautaire inclusif révolutionnaire et créateur d'émancipation féminine". Un véritable refuge pour les femmes ou personnes se considérant comme femmes sans logement ou en situation de grande précarité. C'est le premier et le seul dans son genre à Bruxelles où elles peuvent cultiver l'estime de soi et se reconstruire après avoir subi de multiples violences.
Un escalier mène au sous-sol où se trouvent les douches, la laverie et la "boutique" de vêtements. Ici, les femmes accèdent librement aux commodités et disposent de produits de toilette, de maquillage, de vêtements, de serviettes hygiéniques, etc. Lola, travailleuse sociale du centre précise : "On ne surveille pas ce que prennent les femmes. On les laisse choisir ! C'est très important car on promeut l'autonomie. Contrairement à certaines structures qui distribuent tout cela, nous les laissons gérer. C'est une relation de confiance qu'on a instaurée avec elles et ça marche", se félicite-t-elle.
"Pour pouvoir reprendre sa vie en main, il faut croire qu'elle en vaut la peine. Notre boulot est de les accompagner sur ce chemin."

Lorsque Circé a été pensé, des expertes du vécu (des femmes sans-abri ou très précarisées) et des professionnelles des secteurs du sans-abrisme, des assuétudes et des droits des femmes ont mis en place, ensemble, un programme d'émancipation. Une série d'activités pensées par et pour les futures usagères ont été proposées. Exemple : des ateliers d'art-thérapie pour regagner en estime de soi. "Pour pouvoir reprendre sa vie en main, il faut croire qu'elle en vaut la peine, insiste Lola. Notre boulot est de les accompagner sur ce chemin." La plupart des activités sont organisées à la demande des usagères, ce qui rend Circé encore différent d’autres centres d'accueil. "Elles nous font part de leurs envies, des activités qu'elles souhaitent faire et nous les écoutons. Nous avons, par exemple, organisé une journée à la mer." Se sentir vivante à nouveau, créer des liens, être accompagnée permet cette reconstruction de l'estime de soi.
Lisette Lombé, poétesse et marraine de Circé anime de temps à autre des ateliers d'écriture et de slam. Un autre moyen de poser des mots sur ses maux. Vient ensuite le moment de les proclamer à haute voix. Parfois une participante n'ose pas. Elle est alors encouragée par ses paires et c'est en chœur que les femmes clament avec puissance : "Je ne suis pas seule. J'ai confiance en moi !" L'émotion et la sororité sont alors palpables dans la salle.
La précarité ne cesse de gonfler les rangs de la population vivant en rue ou n'ayant pas de "chez soi", c'est-à-dire sans logement à soi mais ne vivant pas à la rue pour autant. À Bruxelles, on dénombre 7.134 personnes sans logement en 2022 (1). Et en Wallonie, elles sont près de 19.000. Selon les chiffres officiels (2), les femmes représentent près de 21 % des personnes qui vivent en rue. Mais pour
Ariane Dierickx, directrice de L'Ilot, ce pourcentage est totalement sous-estimé pour diverses raisons : de nombreuses femmes dorment dans leur voiture, chez des amis, des connaissances… Souvent, "en échange d'un repas chaud, d'une douche et d'un lit, on 'accepte' des rapports sexuels avec celui qui nous héberge", confie une usagère. Certaines marchent toute la nuit pour ne pas risquer de se faire violer ou voler. Parce que l'espace public est dangereux, elles se rendent invisibles. Isabelle, la cinquantaine, fait partie des femmes "expertes du vécu", à l'origine de Circé. Son histoire est édifiante et représentative de la situation des femmes qui passent par Circé. "Pendant 6 ans, j'ai vécu dans un buisson du Jardin Botanique. C'était ma maison. J'ai pris de la drogue pour supporter la vie en rue et les violences que j'ai subies de la part de mon ex-mari, souffle-t-elle la gorge serrée. On n'a pas accès à des toilettes, se soigner est quasiment impossible. Aujourd'hui, je dépends de la mutuelle car j'ai développé une maladie cardiaque très grave. La rue m'a rendue malade."
Ces situations de violence sont systémiques, structurelles et spécifiques aux femmes, dénonce Lola, travailleuse de Circé. Pour ces raisons, les structures d'accueil classiques, non équipées et formées à ces questions, ne sont pas adaptées. Malgré tout, les femmes n'ont souvent pas d'autres choix que de s'y rendre.
Un avenir à assurer
14h. L'équipe se mobilise, téléphone en main et au taquet pour tenter de trouver une place au Samu pour la nuit à quelques femmes. " Je n'ai pas de téléphone, commente Sarah, usagère régulière du Circé. Et demander aux passants de me prêter le leur pour rester parfois 20 minutes en attente n'est pas possible". Le centre offre un service d'accompagnement psycho-social. L'équipe soutient les femmes dans leurs démarches administratives ou les oriente vers des structures adaptées à leurs besoins.

Ancienne femme sans-abri, Cindy exerce la fonction de pair-aidante depuis la création de Circé.
L'émancipation des femmes passe aussi par la lutte pour leurs droits ! Les usagères se mobilisent lors des manifestations féministes (8 mars, 25 novembre contre les violences faites aux femmes…), antiracistes, etc. Le jeudi 7 novembre, c'est pour les travailleuses qu'elles ont battu le pavé lors de la manifestation du secteur non-marchand. "Les conditions de travail sont de plus en plus difficiles dans le secteur du social et des soins, déplore Lola. Nous ne sommes pas épargnées à Circé et les premières qui en subissent les conséquences, ce sont les usagères." Pour l'instant, l'équipe se bat pour assurer un accompagnement essentiel aux femmes. Depuis sa création en septembre 2023, Circé a ouvert ses portes à près de 200 femmes sans abri sur les 1.500 que compte Bruxelles, selon les estimations. Isabelle qui est sortie de la drogue il y a un an et vit dans son propre appartement depuis un mois soutient les équipes et le projet, car c'est aussi grâce à ces travailleuses qu'elle a pu reprendre soin d'elle. Aujourd'hui, elle "rend" ce qu'elle a reçu en étant volontaire pour une association d'aide et de soutien aux personnes sans-abri.

Saison 1 EPISODE 2
Cindy : sortir du sans-abrisme
Pour en savoir plus sur la situation des femmes sans abri, retrouvez l'épisode de Cindy, dans la première saison du podcast "inspirations". Aujourd'hui, Cindy travaille chez Circé et accompagne les femmes en situation de grande précarité.
Que ce soit à cause d’un diabète ou pour perdre du poids, de nombreuses personnes essayent de contrôler leurs apports en sucres. Pour bien faire, tout le monde devrait faire pareil ! Cela signifie-t-il renoncer aux douceurs comme le chocolat ? Pas forcément…
Texte
: Candice Leblanc
Aliment plaisir par excellence et fleuron de la gastronomie belge, le chocolat est emblématique de notre rapport parfois compliqué — et façonné de (fausses) croyances — à la nourriture. On lui prête de multiples vertus santé, analysées par des études scientifiques plus ou moins fiables. Qu’en est-il réellement ? Certes, le cacao — ingrédient principal du chocolat — contient de bons nutriments, notamment des flavanols, bénéfiques pour la santé cardiovasculaire. Mais hormis le chocolat à 100 % de cacao, tous les produits chocolatés contiennent aussi des sucres ajoutés ou des édulcorants.
Les sucres : amis ou ennemis ?
Ne diabolisons pas d’emblée la grande famille des sucres (glucides). Pendant la digestion, ces différents glucides sont libérés sous forme de glucose dans le sang. C’est le principal carburant de nos muscles et de notre système nerveux :
notre cerveau ne "mange" que ça ! Pas question, donc, de bannir tous les sucres.
Mais une consommation excessive de sucres dits "ajoutés" est déconseillée, a fortiori aux personnes présentant des caries, un surpoids, de l’hypertension et/ ou du diabète. Cela dit, limiter les apports en sucres reste plus facile à dire qu’à faire ! Et pour cause : notre appétence pour le gout sucré est naturelle, profondément ancrée — le lait maternel nous habitue déjà à cette saveur douceâtre — et fortement associée au plaisir et au réconfort. Se passer de sucre, pour beaucoup, c’est se frustrer. Or, la frustration est l’ennemi numéro 1 d’un comportement alimentaire équilibré. Pour manger correctement et sainement sur le long terme, se faire plaisir reste indispensable.
Le sirop d’agave et le sucre de coco apportent aussi des calories et impactent aussi la glycémie.

"Le sucre, même ajouté aux aliments qui n’en contiennent pas naturellement, n’est pas un problème quand il est consommé avec modération, même en cas de diabète, assure Laurence Dieu, cheffe du service de diététique du groupe hospitalier montois Hélora. D’ailleurs, les recommandations nutritionnelles sont les mêmes pour la population générale que pour les diabétiques : à savoir maximum 10 % de sucres ajoutés de l’apport calorique total." Pour une personne dont les besoins s'élèvent à 2.000 kcal par jour, par exemple, cela représente 200 kcal, soit huit morceaux de sucre (environ 50 g). Le hic, c’est que la majorité d’entre nous en consomment (bien) davantage ! Car ça va vite : une canette de soda contient déjà sept morceaux de sucre. Sans oublier les sucres cachés, comme le sirop de glucose, que l’industrie agroalimentaire a tendance à ajouter partout, y compris dans des aliments salés aussi improbables que les lardons ou les chips ! Or, pour de nombreuses personnes, notamment les diabétiques, ne pas dépasser le quota de 10 % de sucres ajoutés par jour est nécessaire pour espérer garder sous contrôle sa glycémie, c’est-à-dire son taux de sucre dans le sang.
Les sucrants alternatifs "Diabétique ou pas, tout le monde devrait avoir une alimentation équilibrée, estime Laurence Dieu. Notamment en privilégiant les aliments à index glycémique (IG) bas – c’est-à-dire qui font monter moins vite la glycémie – et limiter ceux à IG haut, qui la font rapidement grimper (1)." Revenons à nos chocolats. Afin de limiter la quantité de sucres ajoutés, nous
pouvons privilégier les noirs à minimum 70 % de cacao ou, mieux, 85 %. Encore faut-il aimer ça ! Car, qui dit moins sucré dit aussi plus amer.
Une solution consiste donc à remplacer le sucre classique (saccharose) par des alternatives. Il en existe plusieurs et toutes ne se valent pas (voir encadré). Contrairement à ce que d’aucuns croient, le sucre de coco ou le sirop d’agave, très à la mode et réputés plus "sains" que le sucre blanc, apportent aussi bon nombre de calories et impactent la glycémie. Certains fabricants de chocolat utilisent donc des édulcorants basses calories. Avantages : ils ont un pouvoir sucrant très supérieur au saccharose, mais sans réel impact sur la glycémie. Ils sont donc recommandés aux diabétiques. Problème : leur saveur ne convainc pas tout le monde. La stévia pure, par exemple, apporte un léger gout anisé. Quant à l’aspartame, un nombre croissant de personnes s’en méfie. À dose élevée, d’aucuns le suspectent d’avoir un potentiel cancérigène (lire aussi "Édulcorants : l’aspartame cancérigène ?", En Marche, novembre 2023).
Un gout sucré
Il y a donc une vraie demande pour des chocolats et autres douceurs sans sucres, mais qui gouteraient "comme" avec du sucre. Pour ce faire, certains chocolatiers utilisent des édulcorants de masse, qui apportent des calories, mais moins que le saccharose et, surtout, qui ont nettement moins d’impact sur la glycémie. C’est le cas, par exemple, de la Maison Lavoisier, une petite pâtisserie-chocolaterie basée à Jette. "Mon père a un diabète de type 2 plutôt sévère, raconte Amel, la fondatrice. Il adore le chocolat et les viennoiseries, mais il ne pouvait quasi plus y toucher. Et, comme beaucoup de gens, il déteste le gout des édulcorants, qu’il trouve 'chimique' et trop éloigné du sucre classique." En 2015, Amel a donc une idée : créer des pralines et pâtisseries aux qualités gustatives haut de gamme, mais à IG plus bas. En collaboration avec la diététicienne Laurence Dieu, qui l’informe sur les édulcorants, Amel teste et combine différents sucrants à IG bas, qui puissent à la fois donner un bon gout sucré et être utilisés en pâtisserie. Une gageure, car certains édulcorants réagissent mal à la cuisson ou la réfrigération, ne se caramélisent pas ou ne donnent pas un gout ou une texture satisfaisante.
Au bout de plusieurs mois, à coup d’essais et erreurs, Amel finit par mettre au point une combinaison de dérivés de blé, de riz, de malt et de chicorée, qui coche toutes les cases de son projet. Elle teste ses premières douceurs sur elle-même, en mesurant plusieurs fois sa glycémie après les avoir absorbés.
Bingo ! Son taux de sucre ne bouge pas ! Le test du papa est tout aussi concluant: "Non seulement sa glycémie n’est que très peu montée, mais la saveur est si proche du sucre classique qu’il peinait à croire que mes préparations n’en contenaient pas !" De fait, la différence de goût par rapport à des produits sucrés de façon traditionnelle est subtile. Aujourd’hui, la Maison Lavoisier propose une centaine de produits "sugar free" et "diabetic friendly" : pralines, biscuits, viennoiseries, gâteaux, glaces, etc. Pour le plus grand bonheur d’une clientèle, diabétique ou non, soucieuse de réduire ses apports en sucres. Cela dit, Amel rappelle que ses produits "ne font pas maigrir. Je suis pâtissière, pas magicienne! Pour les viennoiseries, les biscuits et les
Les différents sucrants
gâteaux, il faut bien que j’utilise des farines et des matières grasses (2)." Surveiller la quantité, toujours !
Diabétique ou pas, tout le monde devrait surveiller ses apports en sucre.
En outre, "il n’y a pas de sucre miracle", précise Laurence Dieu. En effet, la Maison Lavoisier combine plusieurs produits et techniques pour réduire la charge glycémique de ses préparations : des édulcorants à fort pouvoir sucrant — ce qui permet d’en mettre moins — associé à un mélange de farines présentant des IG plus bas. Mais attention : "Chaque métabolisme réagit différemment ! rappelle la diététicienne. Si ses chocolats et glaces n’influencent pas trop la glycémie, les pâtisseries et biscuits peuvent malgré tout la faire monter. Je recommande donc à chaque diabétique de vérifier la sienne après avoir consommé de tels produits. Et à tout le monde de rester raisonnable sur les quantités." Car, comme toujours en matière d’alimentation, l’excès nuit en tout !
(1) Un IG est considéré comme élevé à partir de 70 et bas en-dessous de 55.
(2) Le chocolat contient notamment du beurre de cacao qui est une matière grasse. Ce qui explique pourquoi même du noir sans sucres ajoutés apporte généralement plus de 500 kcal par 100 grammes…
• Les sucres "classiques" de base sont composés d’une ou deux molécules de sucre. Le saccharose (glucose + fructose) est le sucre cristallisé de betterave ou de canne que nous connaissons bien. C’est le sucre ajouté par excellence (4 kcal/g). Le maltose (glucose) et le lactose (glucose + galactose) sont aussi des sucres. Le premier est dérivé de l’amidon des céréales et le second du lait des mammifères.
• Les sucres "naturels " englobent le miel, le rapadura, le sucre de coco, les sirops d’agave, d’érable, de blé, de riz brun ou encore de dattes. Ils apportent 3 à 4 kcal par gramme. Outre leur gout et leur prix plus élevé, ce qui les différencie, c’est le type et la proportion des molécules de sucres qui les composent (glucose ou fructose), leur index glycémique et leur fort pouvoir sucrant.
• Les édulcorants de masse (des polyols ou alcools de sucre pour la plupart) contiennent moins de calories que le saccharose (2,4 kcal par gramme en moyenne) et n’augmentent pas ou très peu la glycémie, mais ils sont souvent moins sucrants. Exemples : maltitol, sorbitol, érythritol, xylitol, isomalt, etc.
• Les édulcorants basses calories permettent d’obtenir une saveur sucrée avec de très faibles quantités et une valeur calorique presque nulle. L’Union européenne en autorise actuellement dix parmi lesquels l’aspartame, la stévia ou encore le cyclamate.
Source : edulcorants.eu
La recherche scientifique belge est particulièrement performante. Un numéro sur deux, En Marche met un coup de projecteur sur une découverte made in Belgium qui, peut-être, révolutionnera la santé de demain.
Pour faire face au changement climatique et protéger la côte belge de la hausse du niveau de la mer, le projet Duin voor Dijk étudie la réimplantation de dunes sur les plages.
Texte et photo : Valentine De Muylder

Et des vagues de dunes, Pour arrêter les vagues…
Après avoir lu cet article, vous n’écouterez peut-être plus Le Plat Pays de la même manière. Car oui, comme le chantait Jacques Brel, les dunes protègent les terres des assauts de la mer. Et elle monte, la mer. À un rythme qui s’accélère. Sous l’effet du réchauffement de l’eau et de la fonte des glaces, des phénomènes liés au changement climatique, son niveau pourrait augmenter de 25cm à 1m40 d’ici 2100, et de 36cm à plus de 5 mètres d’ici 2150 (1).
Pour faire face à ces prévisions, la Flandre développe un plan stratégique pour l’avenir de la Côte (kustvisie) qui mise, entre autres, sur la reconstitution de la barrière naturelle des dunes. "Les conclusions des études qui ont été menées, c’est que la meilleure défense de la côte belge, c’est d’avancer de plus ou moins 70 mètres vers la mer et de recréer progressivement des dunes", explique Antoine Geerinckx, échevin de l’Environnement de Knokke-Heist. Les digues seront également renforcées et le niveau des plages réhaussé, précise-t-il.
Mais comment faire renaître des dunes là où elles ont disparu ? Et de quelle manière vont-elles résister aux tempêtes et aux grandes marées ? C’est ce que cherchent à préciser le projet-pilote Duin voor Dijk (littéralement "dune devant la digue"), menés conjointement par la Région flamande, les universités de Gand et de Louvain, et les communes côtières d’Ostende, Middelkerke et KnokkeHeist. Concrètement, il s’agit de planter ou de favoriser le développement de la végétation sur des portions de plage. En grandissant, les plantes vont retenir le sable avec leurs racines, ce qui va entrainer le développement des dunes. À Knokke, deux zones de 30 mètres sur 90 ont été délimitées sur la plage, à hauteur de la place Rubens. Quelques mois après avoir été plantés, les jeunes pousses d’oyat – ces longues herbes, typiques des dunes –ont pris un peu d’ampleur et le sable commencent doucement à s’y accumuler, fait remarquer Antoine Geerinckx. Qui ajoute que l’endroit n’a pas été choisi par hasard, car il s’agit d’un point faible, où le risque d’inondation sera plus élevé.
À l’avenir, on peut donc s’attendre à voir les dunes réapparaitre tout le long de la côte belge, assure-t-il. "L’objectif est de s’inspirer de l’expérience des Pays-Bas, qui ont été confrontés à de bien plus grandes inondations que nous en 1953, et qui ont déjà réimplanté des dunes à plusieurs endroits. Il suffit d’aller jusqu’à Cadzand pour le constater." Mais plus de dunes ne voudra pas dire moins de plages, insistet-il, rappelant que l’idée est de faire reculer le bord de l’eau, en augmentant l’apport de sable d’année en année.
En attendant, les minuscules plants apportent une touche végétale bienvenue sur cette portion du littoral (comme tant d’autres en Belgique) où seules subsistent les fleurs en papier. "Il est trop tôt pour tirer des conclusions, mais je n’ai entendu que des échos positifs sur ces dunes. Ça rend l’endroit un peu plus agréable." Installés tout autour de la zone, les vacanciers semblent bien respecter l’interdiction de s’y aventurer. Peut-être certains s’intéresseront-ils de plus près à la raison d’être du projet…
"L'ampleur exacte de l'élévation du niveau de la mer dépend en grande partie de notre comportement en tant qu'êtres humains au cours des prochaines décennies", apprendront-ils alors en lisant les panneaux d’information. Et de rappeler l’importance cruciale d’agir sur les causes du changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effets de serre : "Ce qu’on fait ici, c’est de l’adaptation. Mais il faut aussi travailler à la prévention et à l’atténuation."
(1) Ces chiffres basés sur les prévisions du GIEC et adaptés à la côte belge sont tirés du Kennisrapport Zeespiegel Vlaanderen, Vlaamse overheid, 2023.
Sport en club et compétition vont de pair. Mais le sport peut aussi être un simple loisir, un allié pour sa santé, une manière de sociabiliser... Altéo le rappelle et encourage les clubs et centres sportifs à rendre la pratique plus inclusive en mettant à leur disposition un nouveau guide.
Texte
: Soraya Soussi
Lara Bayekula et Maxime Carabin, deux para-athlètes belges, ont brillé aux Jeux paralympiques 2024, en remportant chacune et chacun une médaille d’or en athlétisme. Si ces deux noms restent peu connus du grand public, on ne peut nier un intérêt grandissant de la part des médias pour les athlètes en situation de handicap. Mais sport et handicap ne se conjuguent pas uniquement sous l’impératif de la performance. "La plupart des personnes en situation de handicap ne peuvent accomplir de tels exploits", rappelle Lionel Dauby, animateur sportif chez Altéo, le mouvement social des personnes malades, valides et en situation de handicap de la MC. Erigée en modèle, la compétition peut alors devenir un frein à l'inclusion des personnes en situation de handicap au sein des structures sportives sur le terrain : "À force de valoriser la compétition, le fossé entre 'valides' et 'moins valides' se creuse."
Exercer une activité sportive permet à quiconque d'améliorer sa santé cardiaque et respiratoire, garder un poids de forme, ralentir le vieillissement osseux et musculaire, etc. Le bénéfice est d’autant plus important pour les personnes en situation de handicap, davantage sujettes à la sédentarité et l'isolement. Participer à une activité sportive est l'occasion de sortir de son quotidien, de changer d'environnement, de voir et d'échanger avec d'autres personnes. "Nous organisons des activités de bienêtre physique mais ce sont surtout des moments sociaux, psychiques et affectifs précieux qui améliorent radicalement la santé des participants", observe l'animateur.
Au-delà de l'intégration, l'inclusion
En Belgique, deux fédérations se partagent la promotion et l’intégration
du handisport : la Fédération multisports adaptés (Féma) dont les associations comme Altéo font partie, compte 120 clubs sportifs affiliés et 3.500 membres en Fédération Wallonie-Bruxelles. Plus connue, la Ligue handisport francophone (LHF) chapeaute les clubs sportifs au sein desquels les para-sportifs de haut niveau, notamment, sont membres. Au total, 200 clubs y sont affiliés.
Aujourd'hui, de nombreux clubs ont intégré une équipe d’handisport, composée uniquement de personnes en situation de handicap qui participent de leur côté à la vie du club. Une avancée majeure pour le monde du sport et du handicap, se félicite Altéo, mais "l’idéal serait que des affiliés 'valides' et non-valides" d'un club fassent du sport ensemble."
Les clubs et centres sportifs manquent aussi d'outils et de ressources pour
organiser des activités adaptées, observet-on chez Altéo. Grâce au soutien de Cap48, le mouvement vient de mettre à jour une série des fiches à destination des structures sportives avec des exemples concrets d’exercices et de matériel pensé pour favoriser l’inclusion des sportifs amateurs quel que soit leur handicap. Ce guide s’adresse aussi aux associations qui travaillent dans le secteur du handicap et cherchent des idées d’activités faciles à mettre en place avec leur public comme la boccia, un sport de lancer de balles, le qi gong, pratique basée sur la gymnastique douce, le pilates, le yoga... Ici, pas de matchs à la clé ou d’objectifs de performance à l’horizon, seulement profiter des bienfaits du sport pour la santé de manière collective.
alteoasbl.be

Zone intime et mal connue, le périnée est un ensemble musculaire entourant la vessie, les organes génitaux et le rectum. De bonnes habitudes au quotidien et un éventuel recours à la kiné permettent d’en prendre soin tout au long de la vie.
Texte : Julie Luong
"Le périnée est la seule zone du corps où l’on retrouve autant de fonctions différentes sur seulement quelques centimètres", commence Ann Pastijn, gynécologue et spécialiste du périnée. Cette membrane constituée de muscles et de ligaments abrite trois compartiments : le compartiment antérieur qui contient la vessie et l’urètre; le compartiment médian qui contient
l’utérus et le vagin ; le compartiment postérieur avec le rectum et l’anus. "C’est une zone qui réunit trois fonctions un peu taboues ! Et pourtant ça fait tellement partie de la vie", commente la spécialiste, qui encourage à se réapproprier cette zone du corps centrale dans le bien-être. "Il faut apprendre à utiliser ces muscles comme quelque chose de mobile." Ainsi le périnée doit être contracté quand on se retient d’uriner, mais se relâcher quand on urine. "Il faut aussi apprendre à serrer son périnée quand on tousse,
quand on porte une charge lourde...", détaille Ann Pastijn, qui constate que les femmes ont souvent du mal à "sentir" leur périnée. "Quand je demande à mes patientes de serrer leur vagin, elles n’ont parfois aucune idée de comment faire... C’est en partie lié à l’éducation des filles qu’on encourage toujours à se tenir bien droites, à rentrer le ventre, ce qui fait que le périnée est aussi 'serré' en permanence. Si vous serriez tout le temps votre bras, il ne serait plus fonctionnel et mobile..."
Compartiment antérieur
5 Vessie et 6 urètre miction : toutes les deux heures.
Compartiment médian
3 Utérus et 4 vagin rapports sexuels et accouchement.
Compartiment postérieur
1 Rectum et 2 anus défécation : tous les jours plus ou moins à la même heure.
" Les problèmes de périnée peuvent commencer très jeune , poursuit Ann Pastijn. Beaucoup d’enfants apprennent par exemple à faire des 'pipis de précaution' avant de prendre la voiture. C’est une mauvaise habitude ! Bien sûr, il faut prendre en compte certaines circonstances mais faire pipi toutes les deux heures est normal et suffisant. Il y a aussi cette fausse information qui voudrait qu’on ne puisse pas se retenir... C’est faux!" Une vessie doit en effet pouvoir contenir 300 à 400 ml. Si on l’habitue à se vider à 50 ml, elle sera "mal conditionnée" et entraînera un besoin d’uriner plus fréquent. Mais se retenir trop longtemps et trop souvent est également délétère pour le périnée. "À l’école, les toilettes sont généralement sales. Les enfants ont donc souvent tendance à éviter d’y aller et donc à ne pas boire... Or quand on ne boit pas, l’urine est plus concentrée, la vessie devient irritable et on risque de développer des incontinences ." Heureusement, même à l’âge adulte, une vessie nerveuse peut être rééduquée avec l’aide d’un kinésithérapeute spécialisé "grâce à des exercices musculaires mais aussi en travaillant sur les habitudes mictionnelles", précise la spécialiste. Ann Pastijn attire aussi l’attention sur l’importance de ne pas se mettre "en position de squat" pour éviter de toucher la lunette des WC. "C’est très mauvais puisqu’on oblige alors la vessie à se vider alors que les muscles sont contractés." Pour préserver son périnée, il est également nécessaire de boire en suffisance – 1,5 l d’eau par jour – et de ne pas abuser du café, qui excite la vessie.
3) Aller à selles quotidiennement
Il est par ailleurs conseillé d’aller à selles tous les jours, plus ou moins à la même heure. Ce que peu d’adultes s’autorisent pourtant à faire. "Malheureusement, dans le monde du travail, beaucoup de toilettes ne permettent pas une vraie intimité... Beaucoup de personnes vont donc se retenir, ce qui peut donner des spasmes du périnée, de la constipation..." Pour préserver son périnée, Ann Pastijn conseille également
d’utiliser un marchepied, afin de faciliter la verticalisation du rectum lors de l’évacuation des selles. "Cela permet de prévenir le risque d’hernies ou de constipation."
4) Rééduquer son périnée après l’accouchement
"L’accouchement est la cause principale des troubles du périnée", souligne Ann Pastijn. En effet, il est fréquent que le passage du bébé endommage les muscles et les tissus de cette zone. La rééducation, qui doit idéalement être entamée 6 semaines après l’accouchement, permet en grande partie de prévenir des troubles futurs. "Il a été prouvé que les patientes qui font une bonne rééducation abdomino-pelvienne vont moins développer de troubles urinaires, de constipation ou encore d’incontinence anale." Si l’incontinence urinaire touche 4 à 6 femmes sur dix, l’incontinence anale – d’autant plus taboue – touche 1 femme sur 10, insiste la spécialiste. "Cela ne veut pas dire nécessairement qu’on porte des langes, mais ça peut vouloir dire qu’on ne peut pas retenir ses gaz ou qu’on retrouve des traces de selles dans sa culotte. Il n’y a aucune raison que des femmes jeunes restent avec ce problème. Il faut absolument en parler car souvent, il y a des solutions ", encourage-t-elle.
Des sports comme les barres asymétriques en gymnastique, le trampoline ou encore le volleyball sont très éprouvants pour le périnée. "Des jeunes athlètes de 2 ans peuvent déjà avoir des fuites urinaires à l’effort parce que leurs muscles ont subi une pression intense et des microdéchirures."
Les meilleurs sports pour le périnée sont la natation et le vélo, de même que les pilates et le yoga, qui permettent de travailler les muscles en profondeur. La course à pied n’est pas à bannir, mais si on a vécu un ou plusieurs accouchements, il vaut mieux prendre conseil auprès d’un kiné. Évitez surtout les abdos types "crunchs", très délétères pour le périnée.
" Il y a encore trop de femmes qui ont mal lors des rapports sexuels et qui pensent qu’il faut ‘mordre sur sa chique ', déplore Ann Pastijn. Alors que s’il y a des douleurs, c’est qu’il y a un problème, que ce soit parce qu’on est trop tendue ou parce qu’on a une infection, un problème de santé... " Or une femme qui persiste à avoir des rapports sexuels avec pénétration tout en ayant mal va développer des muscles spastiques au niveau périnéal. " Par un mécanisme de défense, le périnée va devenir de plus en plus tendu, avec à terme un risque de vaginisme. C’est pourquoi il est important d’intervenir le plus tôt possible. " Ann Pastijn rappelle aussi qu’en cas de douleurs à la pénétration, il est tout à fait possible de recourir à d’autres pratiques. " Culturellement, beaucoup de couples associent encore la sexualité à la pénétration, alors qu’une vie intime est beaucoup plus que cela. "
"Douce révolution" est un spectacle accessible à toutes et tous, conçu pour des publics nécessitant un environnement plus détendu pour se rendre au théâtre.
Texte
: Sandrine
Cosentino, Photo : Hubert Amiel
Nous allons entrer par les coulisses et nous rendre sur la scène", annonce Aline — son prénom figure sur son t-shirt — à l'arrivée des spectateurs. Un accueil pour le moins original. En remettant en question les codes du milieu, les compagnies des Mutants (théâtre jeune public) et Side-Show (cirque contemporain) veulent initier un théâtre plus inclusif. Rester assis longtemps, se taire pendant toute la durée de la représentation ou écouter de la musique à un volume sonore élevé peut relever de l’épreuve pour certains. Rassurer et créer une ambiance plus détendue contribue à rendre la forme théâtrale accessible.
Aline Breucker et Quintijn Ketels, tous deux créateurs dans le secteur des arts de la scène, souhaitent faciliter l'accès des arts vivants à tout un chacun. Parents de deux enfants dont un est atteint d'une forme complexe du syndrome de Gilles de la Tourette, une sortie en famille au théâtre était inenvisageable. Les codes et les normes à respecter étaient trop stressantes et les stimulations extérieures trop fortes. En Europe,
mis à part en Angleterre, il n'existait pas de formats inclusifs pour des profils neuroatypiques. Ils décident de créer un langage théâtral compréhensible par toutes et tous. "Douce révolution" est leur deuxième création et convient aux enfants à partir de 4 ans.
Souriante et pédagogue, Aline prend le temps de présenter le déroulement de l'après-midi. L'histoire du spectacle est également visible sous forme de dessins. Deux manières de tranquilliser les spectateurs pour lesquels l'imprévu est source de stress.
Un campement circulaire composé de plusieurs petites tentes entoure la scène et constitue un coin sécurisant et douillet pour les différents groupes. "Tout le monde est confortablement installé sur une chaise ou un coussin ?", s'enquiert Aline avant d’activer le minuteur suspendu au-dessus de chaque tente, afin de permettre à chacun de garder un œil sur la durée de la séance. Les deux acteurs et l'actrice, Patrick, Mark et Fanny tracent une ellipse avec du sable sur le sol pour délimiter l'espace
Pour les concepteurs du projet, l'inclusion ne doit pas se limiter aux rampes d'accès des salles ou aux toilettes pour personnes en situation de handicap.

de jeu. Lorsqu'ils y entrent, l’histoire commence. Entre réel et imaginaire, les trois protagonistes emmènent l'assemblée dans un monde poétique où se mêle la magie du théâtre jeune public et le cirque contemporain. Ils traversent des forêts, gravissent des montagnes et partagent un bon moment autour d'un feu de camp pendant trois jours et deux nuits. Leurs sacs de voyage sont transparents, on y aperçoit tous les objets utilisés.
Les portes de la salle restent ouvertes pendant toute la durée du spectacle. Les participants se sentent ainsi libres de quitter leur place quand ils en ont besoin et d'y revenir quand ils le souhaitent.
Les acteurs et actrice accompagnent les différentes réactions du public et adaptent leur jeu en fonction. Chaque représentation est unique. De temps en temps, un petit groupe commente l'action en cours. D'autres tapent des mains pour exprimer leur enthousiasme.
Pour les concepteurs du projet, l'inclusion ne doit pas se limiter aux rampes d'accès des salles ou aux toilettes pour personnes en situation de handicap. Grâce aux aménagements proposés, ils espèrent que de plus en plus de spectateurs oseront pousser les portes d'un lieu culturel.
mutants.be/douce-revolution
Prochaines dates
Le dimanche 26 janvier à 15h à l’Espace Columban à Wavre • columban.be
Le dimanche 13 avril à 15h au Centre scénique de Wallonie à StrépyBracquegnies • eklapourtous.be
Le samedi 19 avril à 15h à
La Montagne magique à Bruxelles • lamontagnemagique.be
Le mercredi 11 juin à 14h au Jacques Franck à Bruxelles • lejacquesfranck.be
Les différents lieux proposent également des séances scolaires.
Regarder un film au cinéma peut être une expérience compliquée pour les personnes en situation de handicap. Depuis septembre, le projet La Perche propose des séances accessibles à toutes et tous.
Texte
: Sandrine Cosentino
En l'absence de rampes, d’ascenseurs ou de sièges adaptés, les personnes à mobilité réduite sont bien en difficulté d'accéder aux salles. De plus, peu de lieux offrent des sous-titres spécifiques enrichis ou des équipements d'aide auditive pour pallier un handicap sensoriel. Certains publics sont dès lors exclus des salles obscures à cause de déficits technologiques.
L'objectif du projet La Perche — acronyme de "Projections et rencontres pour cinéphiles en situation de handicap ou d’empêchement" — est de permettre au plus grand nombre de profiter de séances de cinéma. L'équipe est persuadée que mélanger les publics et rendre les espaces culturels accessibles permettront de construire une société plus inclusive.
Besoin d'une paire d'écouteurs ou d'accéder à une place PMR ? Plusieurs bénévoles accueillent les participants sur le chemin entre la billetterie et la salle afin de les aider au besoin.
En fonction des possibilités des lieux et des films projetés, différentes adaptations techniques sont possibles (voir encadré). Les coûts de dispositifs tels qu'une boucle à induction magnétique ou l’audiodescription restent les principaux freins à une plus grande utilisation. Outre la technique, les normes implicites doivent également évoluer. "Les codes habituels des salles obscurs sont levés, précisent le personnel présent. Les spectateurs et spectatrices ont la possibilité d'entrer et de sortir tout au long de la séance. Le son de certains films sont légèrement baissés et une lumière tamisée réchauffe l'atmosphère de la salle."
La séance se termine dans une ambiance décontractée autour d'un verre. Les spectateurs échangent bien sûr leurs impressions sur le film. Mais des commentaires plus spécifiques agrémentent les conversations. "Sans dispositif particulier, ma compagne aurait dû me décrire les différentes scènes, raconte un spectateur malvoyant. Mais grâce à l'audiodescription, nous avons

Encore trop peu de salles de cinéma sont accessibles aux personnes en situation de handicap moteur ou sensoriel.
tous les deux profité de notre séance", se réjouit-il. "Les sous-titres en français ne m'ont pas dérangé et m'ont parfois aidé pour mieux comprendre certains dialogues", ajoute un adolescent. Sans aucun doute, un avenir plus accessible et inclusif se profile pour le cinéma.
la-perche.be
Prochaines dates
"Bernadette" de Léa Domenach, le vendredi 20 décembre à 14h au Quai10 à Charleroi
"Linda veut du poulet" de Chiara Malta et Sébastien Laudenbach, le dimanche 22 décembre à 14h à Cineflagey à Bruxelles (à partir de 6 ans)
"Le voyage de Chihiro" de Hayao Miyazaki, le lundi 3 février à 14h à Plaza à Mons
Les adaptations techniques proposées (différentes en fonction des lieux) sont listées sur le site de La Perche.
Lexique du cinéma inclusif
Accès PMR (personnes à mobilité réduite) : accès à la salle et à des toilettes adaptées mais également à des emplacements de qualité dans la salle.
Sous-titres SME (sourds et malentendants) : retranscription écrite des dialogues et de la source d'où ils proviennent mais aussi des bruits et d'autres éléments non dialogués de la bande son.
Audiodescription : description des éléments visuels d'une œuvre (décors, personnages, actions, gestuelle) pour les personnes aveugles ou malvoyantes afin de leur donner des éléments essentiels pour une bonne compréhension de l'action. Boucle à induction magnétique : permet de mieux entendre le son du film et de diminuer les autres sons. Ce système est utilisable par les personnes équipées de prothèses auditives.
Après un événement de vie difficile ou face à une maladie, le volontariat peut servir de tremplin. S’investir aide à retrouver une vie sociale active, confiance en soi, une place dans la société… Parfois même une nouvelle voie professionnelle. À l’occasion de la Journée internationale du volontariat (le 5 décembre), En Marche a recueilli les témoignages de trois bénévoles.
Texte : Barbara Delbrouck, Photo : Pierre-Laurent Barroo

Réorientation : de l’aviation au foot
À l'âge de 42 ans, Jean-Marc subit un infarctus grave. En parallèle de la pose d’un stent et la prise de nombreux médicaments qui lui causent beaucoup d’effets secondaires, il entame un long processus de revalidation. "Le plus dur pour moi a été la dégradation physique. Impossible de marcher 600 mètres sans me sentir essoufflé, se souvient-t-il. Moi qui ai fait beaucoup de sport dans ma jeunesse, je me suis retrouvé dans un groupe de revalidation avec des gens de l’âge de mes grands-parents !" Bien que sa santé se stabilise un peu, reprendre son ancien poste dans l’aviation serait trop risqué... et il ne possède pas de diplôme à valoriser pour faire autre chose. Son assistante sociale lui propose alors de faire du bénévolat quelques heures par semaine. Après avoir obtenu l’accord de sa mutualité, il se lance comme entraineur dans un club de foot. "Ce n’est pas moi qui courais, mais je pouvais transmettre mes connaissances aux gamins. Et puis être en contact avec les enfants, les parents… Je retrouvais une vie sociale. Depuis mon infarctus, j’avais très vite perdu tout mon réseau. Comme si la maladie faisait peur aux gens. Moment de complicité entre une volontaire et un membre en séjour Altéo à Berck-sur-Mer.

Enseignant dynamique et très investi, Philippe développe la polyarthrite et se retrouve à la pension à 44 ans. Au début, les douleurs et la perte de sa profession le poussent à se replier sur lui-même. Mais il retrouve goût à la vie grâce à son engagement comme volontaire. Clown en clinique, accompagnateur de voyage Altéo, président d’une association de patients... Au final, la maladie l’a mené sur une nouvelle voie où il a trouvé sa place.
Retrouvez cet épisode sur enmarche.be ou en scannant ce QR code.
Sortir physiquement de la maison et des hôpitaux m’a fait du bien. Ça m’a permis de ne plus me voir seulement comme un malade, de ne plus avoir honte de ma maladie... Sans ça je crois que j’aurais sombré." Suite à cette expérience, Jean-Marc se lance dans une formation de trois ans et retrouve un travail dans le secteur sportif. "Si je n’avais pas remis le pied dans le football en tant que bénévole, je n’aurais jamais osé me lancer là-dedans, confie-t-il. Ça m’a permis de reprendre confiance en moi."
De bénéficiaire
Véronique, ancienne aide-soignante, est atteinte de fibromyalgie et se bat depuis de nombreuses années contre une dépression. Il y a 5 ans, elle trouve enfin le traitement qui lui convient et sort la tête de l’eau. Elle rejoint alors le groupe "malades chroniques" d’Altéo, qui se réunit chaque mois pour échanger entre patients. De là naît l’envie chez elle de s’investir. Elle rejoint un atelier d’informatique, où elle apprend à des personnes (avec ou sans handicap) à se servir de tablettes et smartphones. "J’ai vraiment trouvé ma place avec les autres bénévoles et les bénéficiaires, raconte-t-elle. L’aide aux autres fait partie de moi, ça rejoignait ma vocation d’aide-soignante. L’ambiance chez Altéo était comme une bouffée d’oxygène. Je ne me suis jamais sentie aussi écoutée, respectée et en même temps comprise, par rapport à ma maladie." Avec l’envie d’en faire plus, Véronique suit une formation d’aidante numérique et s’investit à d’autres niveaux dans l’atelier. Elle intègre aussi le groupe "Regards différents", qui sensibilise les écoles, depuis les primaires jusqu’aux campus, aux questions d’inclusion. "À la base, je cherchais juste des activités ludiques et finalement j’ai vraiment trouvé ma place, aussi bien en tant que personne en situation de handicap que bénévole. J’ai pu me sentir utile, retrouver une vie active et une place dans la société. Ça m’a permis aussi de ressortir de chez moi pour autre chose que faire des courses ou voir une amie. Tout cela a clairement contribué à l’amélioration de mes symptômes."
Enseignante, Laurence s’est toujours beaucoup investie dans son école, en parallèle à ses cours. Elle a notamment construit une cellule d’accompagnement des élèves à besoins spécifiques, bien avant que ce type de dispositif ne soit mis en place officiellement dans l’enseignement.
Mais après la naissance de son premier enfant, elle commence à développer de la fatigue et des douleurs inexpliquées. Pendant de nombreuses années, elle tombe régulièrement en incapacité à cause de ces symptômes, que les médecins mettent continuellement sur le compte d’un burn-out. Elle apprendra en 2020 que c’est une maladie génétique rare qui en est la cause réelle…
Pendant ses incapacités, Laurence décide de s’investir bénévolement dans un conseil participatif de citoyens. " Ça me permettait de focaliser mon attention sur autre chose que la maladie, de rencontrer des personnes de tous les âges et de tous les horizons. Surtout, des gens qui ne parlaient pas que du boulot, mais de tout et de rien, de choses légères. Quand tu n’as plus de vie professionnelle, tu essaies de camoufler, d’esquiver les questions, mais c’est dur socialement. "
Dans ces conseils participatifs, Laurence est amenée à cotoyer de nombreux élus politiques. Ceux-ci repèrent l’expertise qu’elle a développé à travers les activités bénévoles dans son école
et ils lui proposent à deux reprises un poste de conseillère politique. Laurence poursuit sa carrière dans l’enseignement mais elle doit régulièrement s'arrêter de travailler. Lorsque sa maladie s’aggrave, elle se rapproche d’associations de patients, notamment RaDIOrg, plateforme belge des maladies rares. Elle s’y investit pour sensibiliser les politiques aux problématiques des malades rares et devient "patient expert/partenaire", pour mettre à profit son vécu de la maladie et améliorer la qualité des services de santé. Suite à toutes ces activités, Laurence est à nouveau repérée et engagée cette fois pour participer à la refonte de la plateforme numérique de l'enseignement à distance pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.
"Tout ce qui m’est arrivé de négatif, chaque misère, chaque arrêt, m’a apporté du positif, analyse-t-elle avec le recul. Le bénévolat m’a poussée à développer petit à petit des bouts d’expertise qui font sens aujourd’hui. Plus la maladie évolue, plus je me rends compte que ma pension va arriver de manière prématurée. C’est quelque chose qui me faisait peur. Mais plus maintenant car je sais que le bénévolat me permettra quoi qu’il arrive de continuer à m’occuper et être stimulée. Je pourrai toujours poursuivre à hauteur de mon temps et de mes capacités."
Aux origines…
Les mutualités sont nées de l'engagement solidaire des travailleurs qui ont collecté des fonds, créé des caisses de secours et offert leur aide pour se soutenir en cas d'accident, de maladie, etc. À ce titre, le volontariat a toujours été ancré dans l'ADN de la MC.
Les mouvements sociaux de la MC (Ocarina, Altéo, Énéo, ÉnéoSport) sont également nés de l’engagement de bénévoles qui se sont mobilisés face à un besoin de la population.
Un réseau énorme de bénévoles
Aujourd'hui encore, le volontariat reste un pilier central du fonctionnement de la MC et qui participe au renforcement du lien social au sein de la société. Elle dispose d’un réseau de plus de 6.000 bénévoles !
Il est possible de devenir volontaire au sein de la MC, de ses mouvements ainsi que dans les institutions médico-sociales et socio-éducatives partenaires. Au programme : aide à la personne, au transport, visites, organisation d’activités, accompagnement de voyages, représentation des affiliés dans diverses structures, etc.
Intéressé ?
Rendez-vous sur mc.be/volontariat pour plus d’infos. Vous pouvez y remplir un formulaire d’intérêt et recevoir des conseils sur le type de volontariat qui pourrait vous correspondre. Ou contacter directement la structure qui vous intéresse…
Bon à savoir
Si vous êtes en incapacité, vous avez le droit de faire du volontariat quelques heures par semaine, sans impact sur vos indemnités. Vous pouvez même être indemnisé par l’organisme pour certains frais. Avant de vous lancer, il vous faut toutefois l’accord du médecin conseil.
Infos et formulaire de demande sur mc.be/volontariat-incapacite
Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier, nos conseillers mutualistes et nos travailleurs sociaux vous reçoivent sans rendez-vous aux horaires ci-dessous. Toutes nos agences seront fermées les mercredis 25 décembre et 1er janvier, les jeudis 26 décembre et 2 janvier et les vendredis 27 décembre et 3 janvier.
Retrouvez nos horaires toujours à jour sur mc.be/points-de-contact.
Nous contacter ou prendre rendez-vous :
Conseillers mutualistes
mc.be/contact • 067 89 36 36
Service social
mc.be/social • 067 89 36 83
Conseillers mutualistes
Ouvert les mardis 24 et 31 décembre de 9h à 12h30
Conseillers mutualistes
Ouvert les lundis 23 et 30 et mardis 24 et 31 décembre de 9h à 12h30
Service social
Ouvert les lundis 23 et 30 et mardis 24 et 31 décembre de 9h à 12h30
Conseillers mutualistes
Ouvert les lundis 23 et 30 décembre de 9h à 12h30
Service social
Ouvert les lundis 23 et 30 décembre de 9h à 12h30

Les agences de Court-Saint-Étienne, Jodoigne, Louvain-la-Neuve et Tubize seront fermées du 23 décembre au 3 janvier.
Les volontaires font vivre les valeurs et le projet de la MC au niveau local. Parce que chacun a ses talents et ses aspirations, la mutualité ouvre à ses membres des espaces d’engagement variés.
Des projets de promotion de la santé
Les volontaires et les collaborateurs de la MC mènent localement des projets pour améliorer la santé et le bienêtre de toutes et tous. Par exemple, depuis novembre, les volontaires de la MC et d’Altéo coaniment des groupes avec des psychologues du Réseau 107 (réseau intersectoriel de santé mentale pour adultes) sur la perte d’autonomie. Ce travail de groupe apporte aux participants plus de sérénité et améliore la relation avec leurs aidants proches. Il permet au volontaire de renforcer sa place dans la société en s’engageant personnellement par le partage de son expérience.
Des visites au domicile de personnes isolées À la MC, nous sommes solidaires avec les personnes plus fragiles. De nombreux volontaires s’engagent à nos côtés pour maintenir un lien social et de proximité en particulier avec les plus fragilisés et/ou isolés d’entre-nous. Ce service gratuit est possible grâce à plus de 70 volontaires actifs en Brabant wallon.
Lutter ensemble contre l’exclusion numérique
Les volontaires de la MC coaniment des ateliers pour accompagner les membres dans l’installation et l’utilisation des outils numériques de la MC. Ces outils permettent notamment d’accéder à ses données personnelles, de commander des vignettes ou de faire parvenir un document à la mutualité de manière électronique. Les volontaires se
rendent utiles lors de ces ateliers à la fois pour faire découvrir les services en ligne de la MC et améliorer l’accès au numérique des personnes en difficulté.

Et vous, vous avez envie de rejoindre une équipe locale de volontaires ?
067 89 36 28 • volontariat.bw@mc.be • mc.be/volontariat
Depuis 2015, le pôle Brabant wallon de la MC soutient Aprosoc dans le cadre de son projet de coopération internationale. Cette ONG de droit béninois promeut et encadre le développement de mutualités de santé au Bénin.

En s’engageant dans ce projet, la MC soutient une initiative locale durable qui contribue à améliorer l’état de santé des populations, et en particulier l’accès à des soins de santé de qualité par la création d’un mouvement mutualiste autonome adapté au contexte spécifique de ce pays.
Au Bénin, près de 80 % de la population travaille dans le secteur de l’économie informelle (agriculture, artisanat, moto-taxi, commerce ambulant…) et ne bénéficie pas de protection sociale. Or, rappelons-le, le droit à la santé et à la protection sociale sont reconnus par la Déclaration universelle des droits de l’Homme.
Afin de mesurer les avancées du projet et réaffirmer notre soutien, nous avons reçu en septembre, une délégation béninoise.
Vous souhaitez suivre ce projet de plus près ? Apporter une aide concrète à nos partenaires ? Le comité de partenariat n’attend que vous !
event.bw@mc.be
Vous êtes enceinte et vous voulez être entourée par des professionnels durant cette période unique mais pas toujours simple ? Vous vous interrogez sur la façon de développer le lien avec votre bébé ? Vous êtes parents, en couple, solo, famille recomposée, famille plurielle, etc. et vous vous posez des questions sur
vos compétences parentales, sur votre couple, votre sexualité… ? Vous êtes parent et vous sentez épuisé ?
Chaque personne ou famille mérite un accompagnement adapté à ses réalités, sa situation sociale, culturelle et affective. La Maison Théophile, nouveau

service développé par le planning familial de Wavre, propose une approche globale autour de la grossesse et de la parentalité qui tient compte des besoins variés des familles dès la conception de l'enfant jusqu'à ses premiers mois de vie.
Le service offre un soutien personnalisé, accessible financièrement et rapide lors des trois moments clés de la transition vers la parentalité : la grossesse, l’accouchement (et la naissance) et la période du postpartum.
L'équipe est constituée d’une gynécologue, d’une sage-femme, d’une juriste, de psychologues, d’une sexologue, de conseillères conjugales et familiales et d’assistantes sociales. La Maison Théophile valorise la solidarité et l'entraide, en impliquant des acteurs comme les professionnels de santé, les travailleurs sociaux et les associations locales, pour offrir à chaque enfant un départ dans la vie empreint de bienveillance et d'égalité.
planningwavre.be • 010 22 55 88 • planningwavre@gmail.com
Découvrez la plateforme
Le groupe "réflexion numérique" d’Altéo en collaboration avec l’asbl Premier Contact vous invite à découvrir la plateforme handicap.brussels. Ce site permet de centraliser les aides et services pour les personnes en situation de handicap en Région bruxelloise. Cet atelier permettra de tester et de questionner la pertinence de ce site internet.
Date : le jeudi 5 décembre de 14h15 à 16h30
Lieu : Antenne de Quartier des Étangs noirs, rue Tazieaux 47 à 1080 Molenbeek
Gratuit
Inscriptions : michel.cormond@alteoasbl.be • 081 237 237 (le matin)
Depuis 11 ans, Viva for Life récolte des dons pour venir en aide aux associations qui œuvrent dans le secteur de la pauvreté infantile. La MC soutient l'association en vendant une délicieuse soupe à l’oignon.
Date : le mardi 10 décembre de 11h30 à 13h30.
Lieu : MC Anspach, bd Anpach 117 à 1000 Bruxelles
Prix : 3 €
agir.vivaforlife.be

La MC en collaboration avec Altéo organise une projection de courtsmétrages visant une meilleure compréhension et inclusion des personnes en situation de handicap. L’occasion de découvrir les réalités des déficiences les plus courantes : cécité, surdité, mobilité réduite, handicap mental et handicap invisible. Tantôt en toute légèreté et humour, tantôt à travers une approche plutôt réaliste et percutante.
La séance permettra de se questionner sur l'image du handicap, la question de l'emploi des personnes en situation de handicap et de leurs capacités. Elle sera suivie d'un moment collectif d'échanges et de réflexions.
Cet évènement est accessible aux PMR.
Date : le lundi 9 décembre de 14h à 16h30
Lieu : MC Colignon, rue Royale Sainte-Marie 200 à 1030 Schaerbeek
Gratuit
Inscriptions : mc.be/agenda-societe • 081 237 237 (de 9h à 12h30)
OCARINA
Votre enfant à la découverte de l’art et de Bruxelles

De Bruxelles, votre enfant ne connait que le Manneken Pis et l'Atomium ? Ocarina lui propose de découvrir une autre facette de la capitale avec le séjour "Bruxell’art" qui stimulera sa créativité à travers de nombreux jeux et visites.
Au programme, la découverte du centre historique, une balade mystérieuse où il devra répondre à des énigmes et enquêter, la visite du Musée des instruments de musique (MIM), la découverte de la BD au cœur de la ville et d'autres surprises...
Pour les enfants entre 9 et 12 ans.
Date : du samedi 1er mars au samedi 8 mars
Prix : 335 € • 165 € pour les membres MC • 65 € pour les BIM
Inscriptions : ocarina.be
Le vendredi 29 novembre marque le coup d’envoi de la 53e édition de vente de sapins organisée au profit du Silex et du Ricochet, deux associations de WoluweSaint-Lambert qui œuvrent au quotidien pour l’inclusion sociale et culturelle des personnes adultes en situation de handicap. Vous trouverez des sapins en provenance directe des Ardennes belges et une boutique de décorations pour embellir votre maison durant les fêtes de fin d’année.
Date : tous les jours à partir du vendredi 29 novembre de 10h à 19h
Lieu : Le Silex, rue Voot 82 à 1200 Woluwé-Saint-Lambert
Prix : à partir de 16 € lesilex.be

Séjours au Domaine de Nivezé: une fin d’année conviviale et festive

Pour la fin de l’année, le Domaine de Nivezé, situé à Spa, propose une série de séjours alliant détente et convivialité. Que ce soit pour célébrer Noël ou la nouvelle année, cet établissement familial vous accueille pour des séjours en bonne compagnie dans nos Ardennes bleues.
Tous les séjours, sont conçus pour répondre aux besoins de ceux qui cherchent à se détendre dans un écrin de verdure tout en bénéficiant d’un cadre sécurisé et familial. C’est également l’occasion de faire de nouvelles rencontres tout en dégustant un bon chocolat chaud.
Séjour Noël
Dates : du vendredi 20 au vendredi 27 décembre
Séjour Nouvel An
Dates : du vendredi 27 décembre au vendredi 3 janvier
Prix : 639 € • 852 € (non affilié)
Chaque séjour inclut les nuitées en chambre entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, trois repas par jour, ainsi que des animations sur place (telles que marché de Noël, atelier automassage, projection de films, animations musicales, messes...).
Réservations : promo@niveze.be • 087 79 03 13
Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier, nos conseillers mutualistes et nos travailleurs sociaux vous reçoivent sans rendez-vous aux horaires ci-dessous. Toutes nos agences seront fermées les mercredis 25 décembre et 1er janvier, les jeudis 26 décembre et 2 janvier et les vendredis 27 décembre et 3 janvier.
L'agence d’Uccle sera fermée du 23 décembre au 3 janvier.
ANSPACH
Conseillers mutualistes
Ouvert le lundi et mardi de 9h à 12h30
Service social
Ouvert le lundi de 9h à 12h30
BOCKSTAEL
Conseillers mutualistes
Ouvert le lundi et mardi de 9h à 12h30
Service social
Ouvert le mardi de 9h à 12h30
Conseillers mutualistes
Ouvert le lundi et mardi de 9h à 12h30
Service social
Ouvert le mardi de 9h à 12h30
LA CHASSE
Conseillers mutualistes
Ouvert le lundi de 9h à 12h30
Service social Fermé
Conseillers mutualistes
Ouvert le mardi de 9h à 12h30
Service social Fermé
SAINT-GUIDON
Conseillers mutualistes
Ouvert le lundi de 9h à 12h30
Service social Fermé
Nous contacter ou prendre rendez-vous :
Conseillers mutualistes
mc.be/contact • 02 501 58 58
Service social
mc.be/social • 02 501 58 30
Retrouvez nos horaires toujours à jour sur mc.be/points-de-contact.
Agences fermées
Beaumont, Binche, Chimay, Courcelles, Gosselies, Nalinnes
Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier, nos conseillers mutualistes et nos travailleurs sociaux vous reçoivent aux horaires ci-dessous. Toutes nos agences sont fermées les 25, 26, 27 décembre et les 1er, 2 et 3 janvier.
Nous contacter ou prendre rendez-vous :
Conseillers
071 54 85 48 • mc.be/contact
Service social
071 54 84 28 • mc.be/social
Conseillers mutualistes
Ouvert les lundis et mardis de 9h à 12h30
Sur rendez-vous les lundis 23 et 30 décembre et le mardi
24 décembre de 13h30 à 17h
Service social
Ouvert les lundis et les mardis de 9h à 12h30
Pièce de théâtre Vieillesse ennemie : il reste de la place

La MC Anderlues vous invite à découvrir la pièce de théâtre action "Vieillesse ennemie". Cet événement, ouvert à toutes et à tous et particulièrement aux seniors, aborde avec sensibilité un sujet tabou : la maltraitance envers les aînés.
À travers quatre scènes de vie, le public perçoit le quotidien de personnes âgées, parfois abusées financièrement, psychologiquement, civiquement… souvent de manière insidieuse et pas toujours intentionnelle. Les situations mettent en évidence les souffrances plurielles ainsi que les difficultés relationnelles qui peuvent apparaître entre
Conseillers mutualistes
Ouvert les lundis de 9h à 12h30
Sur rendez-vous les lundis de 13h30 à 17h
Service social
Ouvert les lundis de 9h à 12h30
Conseillers mutualistes
Ouvert le lundi 23 décembre de 13h30 à 17h
Conseillers mutualistes
Ouvert le lundi 23 décembre de 13h30 à 17h
la personne vieillissante, son entourage familial et le personnel soignant.
Après chaque saynète, le public peut interagir avec les personnages afin de débattre sur la dignité des aînés. Cette approche interactive permet de souligner l’importance du dialogue et la complexité des relations humaines.
Une intervenante de Respect Seniors sera également présente pour répondre aux questions du public et faire le lien avec les réalités du terrain.
Date : le lundi 9 décembre de 14h à 16h30
Lieu : MC Anderlues, rue du Douaire 40 (salle 005)
Prix : 4 € pour les affiliés MC • 6 € pour les non-affiliés
Inscriptions :
mc.be/theatre-seniors-anderlues • event.ho@mc.be • 071 23 06 01
Un spectacle d’Alvéole Théâtre à l’initiative de Respect Seniors proposé par la MC du Hainaut oriental.
Conseillers mutualistes
Ouvert les lundis de 9h à 12h30
Sur rendez-vous les lundis de 13h30 à 17h
Service social
Ouvert les lundis de 9h à 12h30
SOIGNIES
Conseillers mutualistes
Ouvert les mardis de 9h à 12h30
Sur rendez-vous le mardi 24 décembre de 13h30 à 17h
Service social
Ouvert les mardis de 9h à 12h30
Retrouvez nos horaires toujours à jour sur mc.be/points-de-contact.
Changement de numéro de téléphone pour Énéo et énéoSport
Le numéro de téléphone pour contacter Énéo et énéoSport en Hainaut oriental (siège d'Anderlues) vient de changer. Vous pouvez à présent nous contacter du lundi au vendredi entre 9h et 12h au 071 23 06 98.

Depuis septembre 2023, Altéo, association engagée pour l’inclusion des personnes malades ou en situation de handicap, a dû adapter son service de transport. En raison de la fin du financement pour les transports privés adaptés, le seul véhicule de l’association est désormais réservé aux activités de groupe d’Altéo. Par conséquent, les membres doivent maintenant se tourner vers des solutions alternatives pour leurs déplacements individuels, souvent en contactant la centrale régionale de mobilité. Malheureusement, ce service présente des limites, surtout dans certaines zones géographiques et pour des horaires spécifiques.
Afin de répondre à cette problématique, nous lançons une initiative citoyenne pour dresser une cartographie des services de transport adapté disponibles dans le Hainaut oriental. Cette démarche a pour objectif d’améliorer les droits et l’accessibilité
Les magasins Qualias, notre partenaire commercial pour la vente et la location de matériel médical, seront fermés le mercredi 25 décembre ainsi que le mercredi 1er janvier. Les mardis 24 et 31 décembre, les magasins fermeront exceptionnellement leurs portes à 13h.
À partir du jeudi 2 janvier, les magasins seront ouverts selon les horaires habituels que vous pouvez consulter sur qualias.be.
Les magasins Qualias vous souhaitent d’ores et déjà d’agréables fêtes de fin d’année.
Les magasins :
Anderlues • Chaussée de Mons 23/3 • 071 15 99 13
Beaumont • Rue Germain Michiels 17 • 071 79 69 65
Charleroi • Boulevard Tirou 165 • 071 30 40 00
Courcelles • Rue Philippe Monnoyer 35 • 071 15 99 14
La Louvière • Passage Michel Degens 1 • 071 15 99 15
Montigny-le-Tilleul • Rue de Gozée 659 • 071 51 90 00
Soignies • Rue du Mons 16 • 067 70 01 01
Thuin • Rue des Fauldeurs 1 • 071 15 99 15
qualias.be
à la mobilité pour toutes les personnes en situation de handicap et consiste à :
• Répertorier les services de transport adapté pour les personnes à mobilité réduite dans le Hainaut oriental.
• Évaluer la qualité des services et identifier les manques.
• Élaborer une cartographie complète des zones desservies et non desservies.
• Constituer un annuaire des services de transport adapté, accessible à tous.
• Formuler un cahier de revendications pour interpeller les futurs élus communaux sur les besoins locaux en transport adapté. Votre expérience personnelle est précieuse pour nous aider à faire progresser ce projet. C’est pourquoi, nous avons élaboré, en collaboration avec nos membres, une fiche d’évaluation sous forme de questionnaire en ligne, accessible via le QR code ci-contre ou ce lien : https://bit.ly/40ZMHpu.
Céline Pattyn, animatrice régionale Altéo • 0476 57 61 52 • celine.pattyn@alteoasbl.be
Besoin d’idées cadeaux pour les fêtes ? Gâtez vos proches grâce à Qualias



Agences fermées :
Comines, Dottignies, Enghien, Frameries, Frasnes, Le Bizet, Lessines et Péruwelz. Les rendez-vous qui ont été fixés durant cette période sont bien maintenus.
Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier, nos conseillers mutualistes et nos travailleurs sociaux vous reçoivent sans rendez-vous aux horaires ci-dessous. Toutes nos agences sont fermées les 25, 26 et 27 décembre et 1 er, 2 et 3 janvier.
Retrouvez nos horaires toujours à jour sur mc.be/points-de-contact.
Conseillers mutualistes
Ouvert le mardi de 9h à 12h30
Service social
Fermé
BOUSSU
Conseillers mutualistes
Ouvert le lundi et le mardi de 9h à 12h30
Service social
Ouvert le mardi de 9h à 12h30
durant les fêtes de fin d’année
Conseillers mutualistes
Ouvert le lundi et le mardi de 9h à 12h30
Opérations rapides
Ouvert le lundi de 13h30 à 17h
Service social
Ouvert le lundi de 9h à 12h30
MOUSCRON
Conseillers et service social
Ouvert le lundi et le mardi de 9h à 12h30
Opérations rapides
Ouvert le lundi de 13h30 à 17h
Les magasins Qualias seront fermés le mercredi 25 décembre ainsi que le mercredi 1er janvier. Les mardis 24 et 31 décembre, les magasins fermeront exceptionnellement leurs portes à 16h.
À partir du jeudi 2 janvier, ouverture habituelle de vos magasins Qualias à Ath, Comines, Mouscron et Tournai, du mardi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30 ; et à Hornu du lundi au samedi de 10h à 18h.
Les magasins Qualias vous souhaitent d’ores et déjà d’agréables fêtes de fin d’année.
Les magasins
Ath • Rue Haute 25 • 068 55 33 55
Comines • Rue de Wervicq 12 • 056 85 32 30
Hornu (Shopping) • Rue de Mons 280• 065 34 24 40
Mouscron • Rue Saint-Pierre 52 • 056 56 12 60
Tournai • Rue Saint-Brice 56 • 069 84 44 84
Le mouvement social des aînés de la MC propose un séjour rando-raquettes du samedi 8 au samedi 15 mars dans la station de Samoëns, en Haute-Savoie.
TOURNAI
Conseillers et service social
Ouvert le lundi et le mardi de 9h à 12h30
Opérations rapides
Ouvert le lundi de 13h30 à 17h
Nous vous recevons également sur rendez-vous :
Conseillers
069 25 62 11 • mc.be/contact
Service social
069 25 62 51 • mc.be/social
Alzheimer Café de Tournai : un rendez-vous mensuel convivial
Échanger, déposer, s’écouter, s’entraider… autant d’actions qui sont au cœur des Alzheimer Cafés. À Tournai, ce lieu de rencontre coordonné par la MC offre un espace de répit pour les personnes concernées par la maladie d’Alzheimer ou une pathologie apparentée, qu’elles soient malades ou aidantes proches.
Chaque troisième mardi du mois de 14h à 16h (hors vacances scolaires), Martine et Marie-France vous accueillent avec un café et un morceau de tarte. Chacun peut y participer, librement, selon son envie ou son besoin, amène la thématique qu’il a envie de traiter ou peut simplement être présent pour écouter.
Dates :
Les mardis 17 décembre, 21 janvier, 18 février, 18 mars, 15 avril, 20 mai, 17 juin, 16 septembre, 18 novembre et 16 décembre de 14h à 16h
Lieu : rue Duquesnoy 19 à Tournai
mc.be/alzheimercafe • 0478 43 62 62 • 0476 90 63 02
Au programme : évasion, air pur, activités sportives, visites culturelles et moments de convivialité dans un environnement naturel exceptionnel qu’offre cette
magnifique région de France.
069 88 37 98 • vacances.hainautpicardie@eneo.be
La MC vous propose une conférence et des échanges animés par Philippe Godin (professeur émérite à l'UCLouvain) afin de mieux comprendre les bienfaits physiques, sociaux et psychologiques de l’activité physique sur la santé.
Si tout le monde sait que bouger permet de brûler des calories, notre intervenant ira plus loin en expliquant l’influence de différents facteurs sur le métabolisme, tels que l’âge ou le genre. Il s’intéressera également à des éléments clés tels que le type d’activité, son intensité et sa régularité, afin d’en optimiser les bienfaits sur la santé.
Dates et lieux
Le mercredi 11 décembre à 19h à Mouscron (Cercle ouvrier, square Cardijn)
Le jeudi 12 décembre à 19h à Mons (FUCAM, chaussée de Binche 151)
Inscriptions : mc.be/agenda-sport • 069 88 37 01
Bougeons suffisamment !
Dans le monde, près de 1,8 milliard d’adultes sont exposés à un risque de maladie en raison d’un manque d’activité physique, soit un adulte sur trois selon les dernières estimations de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS).
En Belgique, deux personnes sur trois ne bougent pas suffisamment, selon Sciensano. Mais que signifie "bouger suffisamment" ? L’OMS recommande aux adultes de pratiquer chaque semaine 150 minutes d’activité physique modérée et 75 minutes d’activité physique intense, ou a minima d’atteindre 10.000 pas par jour. En Belgique, les hommes (36 %) sont plus nombreux à se conformer à ces recommandations que les femmes (25 %). Les habitants de Flandre (37 %) et les personnes ayant un diplôme de l’enseignement supérieur (38 %) aussi.
Chez les plus jeunes, les chiffres sont alarmants : seulement un garçon sur cinq (20 %) et une fille sur huit (13 %) âgés de 11 à 18 ans satisfont aux recommandations de l’OMS. Pour un enfant, il est bon de consacrer 60 minutes par jour à une activité physique modérée à vigoureuse –progressivement à partir de l’âge de 7 ans.
Clotilde de Gastines
Article complet "Inactivité physique : les acteurs se mettent en ordre de marche" sur educationsante.be
Le samedi 12 octobre, la MC fêtait la solidarité internationale pour la 13e édition de sa fête des partenariats ! Concerts, spectacles, animations et village associatif ont jalonné cette journée conviviale et haute en couleur accueillant un grand nombre de participants.
Cette fête est l’occasion, tous les deux ans, de mettre en valeur les partenaires de la MC du Sud-Kivu (réseau de mutuelles de


santé) et du Liban (structures d’accueil pour jeunes porteurs de handicaps). La MC remercie chaleureusement toutes les personnes présentes et vous donne rendez-vous pour l’édition 2026 !
mc.be/cooperation

Les agences de Ans, Fléron, Hannut et Chênée sont fermées du 23 décembre au 3 janvier.
Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier, nos conseillers mutualistes et nos travailleurs sociaux vous reçoivent sans rendez-vous aux horaires ci-dessous. Toutes nos agences sont fermées les mercredis 25 décembre et 1er janvier, les jeudis 26 décembre et 2 janvier, ainsi que les vendredis 27 décembre et 3 janvier.

AYWAILLE
Conseillers mutualistes
Ouvert le lundi 30 et le mardi
31 décembre de 9h à 12h30
Service social
Ouvert le lundi 30 et le mardi
31 décembre de 9h à 12h30
Conseillers mutualistes
Ouvert les lundis 23 et 30 décembre et le mardi 24 décembre de 9h à 12h30

Des ateliers festifs et pratiques pour les familles monoparentales
En cette période de fêtes, le projet des Relais Familles mono propose une série d’ateliers à Waremme, alliant créativité et bien-être. Destinés aux parents et enfants, ces événements visent à renforcer les liens familiaux tout en offrant des outils pratiques pour faciliter le quotidien.
Service social
Ouvert les lundis 23 et 30 décembre de 9h à 12h30
Conseillers mutualistes
Ouvert les lundis 23 et 30 décembre et les mardis 24 et 31 décembre de 9h à 12h30
Service social
Ouvert les lundis 23 et 30 décembre et les mardis 24 et 31 décembre de 9h à 12h30
Conseillers mutualistes
Ouvert le lundi 23 et le mardi 24 décembre de 9h à 12h30
Les familles monoparentales sont souvent confrontées à des défis spécifiques. Le projet des Relais Familles mono à Waremme s’efforce de leur apporter un soutien précieux. Dans ce contexte, deux ateliers ludiques et enrichissants seront proposés en décembre. L'opportunité pour ces familles monoparentales de se rassembler, de célébrer ensemble, d’apprendre et trouver des réponses à leurs besoins.
Atelier Cocorico
L’atelier invitera les participants à explorer ce qui les rend joyeux et motivés. Cet atelier interactif
Conseillers mutualistes
Ouvert les mardis 24 et 31 décembre de 9h à 12h30
Service social
Ouvert les mardis 24 et 31 décembre de 9h à 12h30
WAREMME
Conseillers mutualistes
Ouvert les mardis 24 et 31 décembre de 9h à 12h30
Nous vous recevons également sur rendez-vous :
Conseillers
04 221 74 00 • mc.be/contact
Service social 04 221 74 22 • mc.be/social
Retrouvez nos horaires toujours à jour sur mc.be/points-de-contact.
permettra aux familles de découvrir des outils concrets pour mobiliser leurs ressources et se mettre en action, favorisant ainsi le bien-être personnel et familial.
Date : le lundi 9 décembre de 9h30 à 12h30
Mieux gérer l'administratif
L'atelier sur le Home organising fournira des astuces pratiques pour mieux gérer l’administratif, un aspect souvent complexe pour les familles monoparentales.
Date : le jeudi 12 décembre de 9h30 à 12h30
Lieu : MC Waremme, rue Joseph Wauters 21 0476 97 55 68 (Sara Missen) • sara.missen@mc.be
Pour la fin de l’année, le Domaine de Nivezé, situé à Spa, propose une série de séjours alliant détente et convivialité. Que ce soit pour célébrer Noël ou la nouvelle année, cet établissement familial vous accueille pour des séjours en bonne compagnie dans nos Ardennes bleues.
Tous les séjours sont conçus pour répondre aux besoins de ceux qui cherchent à se détendre dans un écrin de verdure tout en bénéficiant d’un cadre sécurisé et familial. C’est également l’occasion de faire de nouvelles rencontres tout en dégustant un bon chocolat chaud à notre cafétaria.
Séjour Noël
Dates : du vendredi 20 au vendredi 27 décembre
Séjour Nouvel An
Dates : du vendredi 27 décembre au vendredi 3 janvier
Prix à la semaine par personne : 639 € • 852 € (non affilié)
Chaque séjour inclut les nuitées en chambre entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, trois repas par
Depuis 1969, Télé-Service Liège s’engage à aider les personnes dans le besoin, notamment les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées, malades ou précarisées. Grâce à une gamme de services variés, l’association joue un rôle crucial dans la vie de nombreux Liégeois. Parmi ses initiatives, l’asbl propose un service de transport adapté pour les personnes à mobilité réduite, des programmes d’alphabétisation et de formation à la citoyenneté pour
jour, ainsi que des animations sur place (telles que marché de Noël, atelier automassage, projection de films, animations musicales, messes...).

Réservations : promo@niveze.be • 087 79 03 13
les personnes d’origine étrangère, une permanence d’aide sociale pour répondre aux besoins urgents, un service de déplacement à caractère social pour adultes et enfants.
En 2023, 8.496 personnes ont bénéficié du service de transport pour les personnes à mobilité réduite et près de 4.000 déplacements ont été organisés par leurs volontaires permettant à toutes ces personnes d’accéder à des soins médicaux et à des activités essentielles.

• Service de déplacement et enfants malades : 0472 09 14 47 (de 9h à 12h)
• Service de véhicule adapté : 0472 12 17 39 (de 9h à 12h et de 14h à 16h)
• Service social : 0478 87 18 67 (tous les matins de 9h à 12h)
Appel à bénévoles
Pour continuer à offrir ces services essentiels, Télé-Service Liège recherche activement des bénévoles. Si vous êtes disponible, dynamique, ponctuel et serviable, et que vous disposez de votre propre véhicule, votre aide serait précieuse. En tant que bénévole, vous aurez l’opportunité d’accompagner des personnes précarisées ou des enfants ayant besoin de soins, tout en recevant une indemnité kilométrique pour le service rendu.
Votre engagement permettra à ceux qui en ont besoin de se déplacer en toute sérénité.
teleservice.accueil@gmail.com • 0472 09 14 47
FORMATION GRATUITE
Premiers secours pédiatriques
Vous êtes futur ou jeune parent (ou grand-parent) ? Vous avez des enfants en bas âge ? Vous travaillez dans une crèche ou une garderie d'enfant ? Les modules FormAction (FASTraining) vous apprendront les gestes vitaux et les soins d'urgence spécifiques à prodiguer aux "petits cascadeurs".
Dates et lieux :
• le mercredi 11 décembre de 13h à 17h à la MC Arlon, rue de la Moselle 7-9
• le mercredi 18 décembre de 13h à 17h à la MC Libramont, rue des Alliés 2
Gratuit
Inscriptions : mc.be/agenda-parents
• 063 37 31 01
Atelier couture upcycling

Grâce à la couture upcycling, faites des économies en recyclant. Le Relais Familles mono et la MC offrent aux parents solos des ateliers gratuits d’apprentissage. Pour allier créativité et respect de la planète, vos productions seront réalisées à partir de tissus de récupération colorés.
Création d'une trousse de toilette et de cotons-nettoyants
Date : le jeudi 12 décembre de 9h à 12h30
Lieu : MC Libramont, rue des Alliés 2 Gratuit
Inscriptions : mc.be/agenda-parents • 063 37 31 01

Plongez avec vos enfants dans la magie des fêtes de fin d'année. L'occasion de (re)créer du lien mais aussi de (re)découvrir les plaisirs de l'univers de la bibliothèque.
• Fabrication d'un doudou en famille : aucun prérequis en couture nécessaire
Date : le mercredi 11 décembre de 14h à 16h ou de 16h à 18h
• Lecture en pyjama : soirée contes
Date : le vendredi 13 décembre, pour les 3 à 6 ans de 19h à 20h ou pour les 6 à 8 ans de 20h à 21h
• Réveil des doudous : un livre et un biscuit offerts aux enfants participant
Date : le samedi 14 décembre de 10h à 12h.
Lieu : Bibliothèque-ludothèque de Marche-en-Famenne, chaussée de l'Ourthe 74
Gratuit
Inscriptions : info@bilom.be • 084 38 01 90

Reso asbl propose des accompagnements collectifs et individuels pour les personnes souhaitant s’orienter professionnellement et améliorer leurs outils de recherche d’emploi.
Date : à partir de janvier
Séances d’infos : le vendredi 13 ou lundi 16 décembre à 9h
Lieu : rue Ferrero 1 à Arlon
Infos :
Ocarina, l’organisation de jeunesse partenaire de la MC, organise chaque année une formation à l’animation, destinée aux jeunes dès l’âge de 16 ans.
Apprendre en s’amusant
S’inscrire à la formation pour rejoindre cette équipe d’animateurs, c’est :
• S’éclater en apprenant comment animer des groupes d’enfants de 2,5 à 12 ans.
• Découvrir des techniques d’animation variées : jeux, sports, chants, contes et histoires, bricolages…
• Stimuler sa créativité et développer sa relation à l’enfant.
• Se faire de nouveaux amis, s’enrichir tout en s’amusant !
À l’issue de la formation, le participant obtient un brevet d'animateur reconnu qu’il pourra valoriser plus tard sur son curriculum vitae.
Un parcours adapté
Devenir animateur ou animatrice, c’est un parcours en plusieurs étapes sur deux ans. Chaque année se compose d’une semaine
de formation théorique en résidentiel et d'un stage pratique de dix jours pendant les vacances scolaires.
Prochaine formation théorique

Dates : du samedi 22 février au samedi 1er mars
Lieu : Institut Saint-Joseph de Carlsbourg, avenue Arthur Tagnon 1
Prix : 200 € (1re année) • 175 € (2e année)
Le prix comprend la formation, le logement, les repas, les assurances, les supports pédagogiques…
Inscriptions : ocarina.be/se-former • luxembourg@ocarina.be • 063 37 31 30
Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier, nos conseillers mutualistes et nos travailleurs sociaux vous reçoivent sans rendez-vous aux horaires ci-dessous. Toutes nos agences sont fermées les 25, 26, 27 décembre et 1er, 2 et 3 janvier.
ARLON
Conseillers mutualistes
Ouvert les lundis et mardis de 9h à 12h30
Opérations rapides les lundis, mardis et vendredis de 9h à 12h30
Service social
Ouvert les mardis 24 et 31 décembre, le vendredi 3 janvier de 9h à 12h30
ATHUS
Conseillers mutualistes
Fermé
Service social
Ouvert les lundis de 9h à 12h30
BARVAUX
Conseillers mutualistes
Fermé
Service social
Ouvert le mardi 24 décembre de 9h à 12h30
Conseillers mutualistes
Ouvert les lundis et mardis de 9h à 12h30
Service social
Ouvert le mardi 24 et 31 décembre, le vendredi 3 janvier de 9h à 12h30
LIBRAMONT
Conseillers mutualistes
Ouvert les lundis et mardis de 9h-12h30
Service social
Ouvert les mardis de 9h à 12h30
Conseillers mutualistes
Ouvert les lundis et mardis de 9h-12h30
Opérations rapides les lundis et mardis de 9h à 12h30
Service social
Ouvert les lundis de 9h à 12h30
Agences fermées
Bertrix, Florenville, Habay-la-Neuve
Conseillers mutualistes
Fermé
Service social
Ouvert le lundi 23 décembre de 9h à 12h30
VIRTON
Conseillers mutualistes
Ouvert les lundis et mardis de 9h à 12h30
Ser vice social
Ouvert les mardis de 9h à 12h30
Nous vous recevons également sur rendez-vous :
Conseillers
063 21 09 11 • mc.be/contact
Service social
063 21 17 46 • mc.be/social
Retrouvez nos horaires toujours à jour sur mc.be/points-de-contact.
Énéo invite les 50 ans et plus à voyager !
Les volontaires d’Énéo proposent un séjour raquettes au cœur du Jura, du lundi 3 au samedi 8 février. Ce programme est conçu pour accueillir tous les niveaux : des sorties modérées seront proposées aux novices et les plus sportifs ne seront pas oubliés.
Énéo organise également un séjour spécial "Grand Âge" pour les 80 ans et plus, du lundi 14 au vendredi 18 avril. Profitez de quelques jours de détente en bordure de mer. L’équipe d’animation vous proposera des activités adaptées à votre rythme. Ce séjour est réservé prioritairement aux membres Énéo nés en 1945 ou avant. Les personnes qui les accompagnent sont bienvenues.
Inscriptions : vacances.namur@eneo.be • 081 23 67 09 du lundi au mercredi de 9h à 12h • eneo.be/catalogue-vacances

Altéo recherche des volontaires pour ses séjours inclusifs destinés aux personnes malades et porteuses d’un handicap. Ces vacances, en Belgique ou à l’étranger, offrent une variété d'activités, de visites culturelles aux escapades natures, en passant par des ateliers artistiques et des moments plus festifs. Les volontaires fournissent un soutien crucial aux participants, les aidant à surmonter les défis liés à leur handicap.
Témoignage d’une volontaire aguerrie d’Altéo Depuis 9 ans, Marie-Paule Foulon accompagne des personnes en situation de handicap en vacances. Des séjours dont elle sort toujours regonflée à bloc de "vitamines humaines", confie-t-elle.
L’idée d’être volontaire lui est venue à la lecture d’une annonce lancée par Altéo. "J’étais institutrice en primaire, je venais de divorcer, mes enfants étaient grands, c’était l’occasion de faire un peu de bénévolat. J’ai donc postulé. J’avais des a priori, car je n’avais jamais travaillé avec des personnes en situation de handicap. En réalité, ça a été extrêmement joyeux: il faut le vivre pour se rendre compte que c’est de l’oxygène mental." Après presque vingt séjours à son actif, Marie-Paule a l’impression d’avoir beaucoup plus reçu qu’elle n’a donné : "Toutes ces personnes font face, malgré les difficultés. Ça nous permet de remettre nos idées en place sur notre propre vie et de nouer des relations très fortes !" Depuis l’an dernier, Marie-Paule assure
Le service "Accompagnement et Transports" d’Altéo sera fermé du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier inclus. Il ne sera donc pas possible d’introduire de demande d’accompagnement pendant cette période. Pour tout transport devant avoir lieu pendant celle-ci, les demandes doivent donc être introduites pour le mercredi 18 décembre au plus tard (en tenant compte du fait que toute demande doit être introduite au minimum 3 jours ouvrables à l’avance).
081 23 72 37 (du lundi au vendredi de 9h à 12h)
aussi la coordination des séjours. Mais le manque fréquent de volontaires rend l’arithmétique délicate et contraint parfois à limiter le nombre de places ouvertes aux personnes qui pourraient en bénéficier.
Clotilde de Gastinnes

Aidez-nous à rendre les vacances accessibles à tous !
Catherine Rase (Namur) : 0478 71 19 24
Hugues Saudemont (Dinant) : 0475 25 72 94
Hélène Lepère (Philippeville) : 0496 31 59 46

Du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier, nos conseillers mutualistes et nos travailleurs sociaux vous reçoivent sans rendez-vous aux horaires ci-dessous. Toutes nos agences sont fermées les mercredis 25 décembre et 1er janvier, les jeudis 26 décembre et 2 janvier et les vendredis 27 décembre et 3 janvier.
Conseillers mutualistes
Ouvert le lundi 30 et le mardi
31 décembre de 9h à 12h30
Service social
Ouvert le mardi 31 décembre de 9h à 12h30
Conseillers mutualistes et service social
Ouvert le lundi 23 et le mardi 24 décembre ainsi que le lundi 30 et le mardi 31 décembre de 9h à 12h30
Les agences de Andenne,
Conseillers mutualistes
Ouvert le lundi 23 et le mardi 24 décembre de 9h à 12h30
Service social
Ouvert le lundi 23 décembre de 9h à 12h30
Conseillers mutualistes
Ouvert le lundi 30 et le mardi 31 décembre de 9h à 12h30
et
Service social
Ouvert le lundi 30 décembre de 9h à 12h30
Nous contacter ou prendre rendez-vous :
Conseillers mutualistes
mc.be/contact • 081 24 48 11
Service social
mc.be/social • 081 24 48 38
Retrouvez nos horaires toujours à jour sur mc.be/points-de-contact.
sont fermées du 23 décembre au 3 janvier.
Le Domaine de Nivezé, situé à Spa, propose une série de séjours pour la fin d’année, alliant détente et convivialité. Que ce soit pour célébrer Noël ou la nouvelle année, cet établissement familial vous accueille pour un séjour en bonne compagnie dans nos Ardennes bleues.
Les séjours sont conçus pour répondre aux besoins de ceux qui cherchent à se détendre dans un écrin de verdure tout en bénéficiant d’un cadre sécurisé et familial. C’est également l’occasion de faire de nouvelles rencontres tout en dégustant un bon chocolat au chaud à notre cafétaria .
Séjour Noël
Dates : du vendredi 20 au vendredi 27 décembre
Séjour Nouvel an
Dates : du vendredi 27 décembre au vendredi 3 janvier
Prix : 639 € • 852 € (non affilié MC)
Chaque séjour inclut les nuitées en chambre entièrement accessibles aux personnes à mobilité réduite, trois repas par jour, ainsi que des animations sur place (telles que marché de Noël,
atelier automassage, projection de films, animations musicales, messes).
Réservations : promo@niveze.be • 087 79 03 13

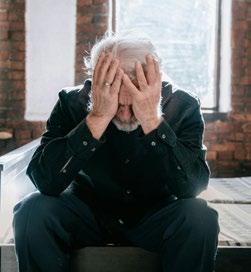
Stop aux préjugés liés à l’âge !
Énéo Namur vous invite à son prochain goûter malin en compagnie de l’asbl Respect Seniors. Nous aborderons les stéréotypes, les discriminations et nos représentations liées à l’âge afin de trouver des pistes pour une société inclusive et intergénérationnelle. De l’âgisme à la maltraitance, il n’y a qu’un pas…
Date : le lundi 16 décembre de 14h à 16h30 • accueil à partir de 13h45
Lieu : MC de Namur, rue des Tanneries 55
Prix : 5 € à payer en liquide sur place, comprenant le goûter
Inscriptions : namur@eneo.be • 081 23 67 08 (du lundi au mercredi de 9h à 12h)

Vous avez envie de vous impliquer au service des autres, de mener un projet de groupe, mais aussi de sensibiliser la population aux droits du patient ?
Investissez-vous aux côtés de nos volontaires MC ! La prochaine journée européenne des droits du patient aura lieu le vendredi 18 avril. Chaque année, la MC participe à cette action en informant les patients de leurs droits au travers de diverses activités.
Rejoignez-nous pour participer à la réflexion sur les actions à entreprendre cette année ! La première réunion aura lieu le jeudi 12 décembre, elle est ouverte à tous.
Date : le jeudi 12 décembre de 13h30 à 15h30
Lieu : MC Verviers, rue Lucien Defays 77
Inscriptions :
0477 89 37 28 (Cédric Hardy) • event.ve@mc.be
Pour en savoir plus sur vos droits en tant que patient, consultez nos pages web : mc.be/vos-droits.
La MC organise régulièrement des activités pour les parents solos, en collaboration avec le Relais
Familles mono de Verviers et avec le soutien du Plan de relance de la Région wallonne. Découvrez les prochaines activités !
Fabriquer ses décors de Noël
En compagnie de votre (vos) enfant(s), construisez un père Noël et ses décorations, avec les conseils de l'asbl Les Débrouillardes.
Date : le mercredi 11 décembre de 13h à 17h
Café papote des parents solos verviétois

Parentr’Aide est un groupe d’entraide bienveillant et dynamique, conçu pour permettre aux familles monoparentales d’échanger ensemble. Différentes thématiques y sont abordées: les relations entre parents et enfants, la place des familles mono dans la société, l’importance des loisirs comme bouffée d’oxygène, le bien-être de l’enfant... Et des activités variées peuvent y avoir lieu : sport, bricolage, ciné-débat... Les parents ressortent aussi de ces rencontres avec des outils concrets pour mieux affronter leur parentalité.
Date : le mercredi 18 décembre de 9h à 11h30
Lieu : MC Verviers, rue Lucien Defays 77
Gratuit
Inscriptions : mc.be/parent- solo-verviers • 0475 82 87 82
Ocarina, l’organisation de jeunesse partenaire de la MC, organise chaque année une formation à l’animation, destinée aux jeunes dès l’âge de 16 ans.
Apprendre en s’amusant
S’inscrire à la formation pour rejoindre cette équipe d’animateurs, c’est :
• S’éclater en apprenant comment animer des groupes d’enfants de 2,5 à 12 ans.
• Découvrir des techniques d’animation variées : jeux, sports, chants, contes et histoires, bricolages…
• Stimuler sa créativité et développer sa relation avec les enfants.
• Se faire de nouveaux amis, s’enrichir tout en s’amusant !
À l’issue de la formation, le participant obtient un brevet d'animateur reconnu qu’il pourra valoriser plus tard sur son curriculum vitae.
Un parcours adapté
Devenir animateur ou animatrice, c’est un parcours en plusieurs étapes sur deux ans. Chaque étape se compose d’une semaine de formation en résidentiel et de deux semaines de stages pratiques durant les vacances scolaires.
Dates : du samedi 5 au samedi 12 juillet (formation théorique)
Lieu : Institut SFX II, rue de Francorchamps 12 à Verviers
Prix : 140 €
Inscriptions : ocarina.be/se-former • verviers@ocarina.be • 087 27 96 60

Durant la période de fin d’année, les horaires de nos agences sont modifiés. Vous retrouverez ci-dessous nos horaires du lundi 23 décembre au vendredi 3 janvier.
VERVIERS
Conseillers mutualistes
Ouvert les lundis 23 et 30 et mardis 24 et 31 décembre de 9h à 12h30
Service social
Ouvert les lundis 23 et 30 et mardis 24 et 31 décembre de 9h à 12h30
Agences fermées
Les agences de Herve, La Calamine, Spa, Welkenraedt, Bullange et Saint-Vith seront fermées du 23 décembre au 3 janvier.
MALMEDY
Conseillers mutualistes
Ouvert le lundi 30 et le mardi 31 décembre de 9h à 12h30
Service social
Ouvert le lundi 30 décembre de 9h à 12h30

Séjours au Domaine de Nivezé : une fin d’année conviviale et festive
Le Domaine de Nivezé, situé à Spa, propose une série de séjours pour la fin d’année, alliant détente et convivialité. Que ce soit pour célébrer Noël ou la nouvelle année, cet établissement familial vous accueille pour un séjour en bonne compagnie dans nos Ardennes bleues.
À l’approche des fêtes, le Domaine de Nivezé invite les visiteurs à profiter de ses séjours conçus pour répondre aux besoins de ceux qui cherchent à se détendre dans un écrin de verdure tout en bénéficiant d’un cadre sécurisé et familial. C’est également l’occasion de faire de nouvelles rencontres !
Séjour Noël
Dates : du vendredi 20 au vendredi 27 décembre
Séjour Nouvel an
Dates : du vendredi 27 décembre au vendredi 3 janvier
Prix : 639 € • 852 € (non-affilié MC)

Chaque séjour inclut les nuitées en chambre entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite, trois repas par jour, ainsi que des animations sur place (marché de Noël, atelier automassage, projection de films, animations musicales, messes...).
Réservations : promo@niveze.be • 087 79 03 13
EUPEN
Conseillers mutualistes
Ouvert les lundis 23 et 30 et mardis 24 et 31 décembre de 9h à 12h30
Service social Fermé
Nous vous recevons sur rendezvous dans certaines agences :
Conseillers
087 30 51 11 • mc.be/contact
Service social 087 30 51 43 • mc.be/social
Retrouvez nos horaires toujours à jour sur mc.be/points-de-contact.
Don de sang : mobilisez-vous à l’approche des fêtes !
À l'approche des fêtes de fin d'année, la Croix-Rouge a toujours besoin de vous ! Dans notre région, plusieurs centres de prélèvement vous accueillent pendant le mois de décembre : notamment à Battice, Dolhain, Herve, Malmedy, Montzen, Ovifat, Pepinster, Spa, Thimister, Trois-Ponts, Verviers ou encore Welkenraedt.
Rendez-vous et lieux de prélèvement : donneurdesang.be

Leur histoire est peut-être la vôtre, découvrez notre podcast sur enmarche.be et les plateformes d'écoute