BRIDONNEAU
Préface
Olivier Hamant
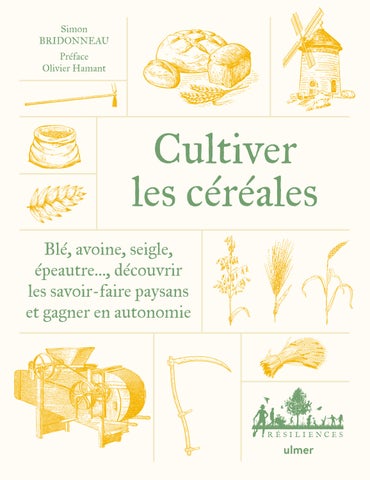
BRIDONNEAU
Préface
Olivier Hamant
Blé, avoine, seigle, épeautre…, découvrir les savoir-faire paysans et gagner en autonomie


Chercheur français en biologie et biophysique, directeur de recherche à l’INRAE
Il y eut une époque où la Terre était une planète bleue, mais pas encore un monde vert. Elle n’avait pas le couvert végétal qu’on lui connaît aujourd’hui. Les premiers végétaux, mousses et lichens, colonisent les terres émergées il y a cinq cents millions d’années. Mais, à cette époque, les plantes n’avaient pas de fleurs. L’essentiel de l’histoire de la Terre (4,6 milliards d’années) est d’ailleurs une histoire sans fleurs. Les plantes à fleurs, et donc à graines, arrivent soudainement il y a quelque 170 millions d’années. Et c’est un succès presque immédiat : elles prolifèrent et se diversifient rapidement. C’est d’ailleurs ce que Darwin appelait « l’abominable mystère ». Cette rupture brutale dans le paysage végétal interpelle d’ailleurs encore aujourd’hui. Notre civilisation est d’abord une civilisation de la fleur, et donc de la graine, et nous, les humains du xxie siècle, n’en prenons pas encore pleinement conscience. Enlevez les fleurs de votre menu, et vous verrez qu’il ne restera que les pignons de votre sauce au pesto — sans basilic donc — et quelques algues autour de vos makis — sans riz donc.
Parmi les plantes à fleurs, les graminées, que l’on nomme aujourd’hui les poacées, figurent au nombre des évolutions plus récentes encore. Elles sont apparues à la fin du Crétacé, avant la disparition des dinosaures donc il y a soixante-six millions d’années. Les graminées, qui comptent quelque 12 000 espèces, comprennent nos céréales cultivées, et elles
ont largement défini la période tertiaire, aussi appelée « Cénozoïque ».
Aujourd’hui, dans l’Anthropocène, nous vivons une inversion brutale dans cette évolution : en un siècle, nous aurions perdu les trois quarts des espèces cultivées. Nous ne faisons donc pas seulement l’expérience d’un effondrement de la biodiversité sauvage, nous activons aussi un effondrement de la biodiversité domestiquée et cultivée. Inutile d’ajouter que cela entraîne également une disparition des savoir-faire associés, donc un effondrement de la technodiversité agricole. Ces pertes sont incommensurables pour notre civilisation sur tous les plans, notamment culturels, tant les céréales forment la cheville ouvrière de notre alimentation, mais aussi de notre histoire, de nos organisations et de nos croyances. Rappelons que l’État naît de l’agriculture — quand il faut gérer les stocks et la distribution de nourriture au Néolithique — et que toutes les religions trouvent des racines dans une forme d’animisme alimentaire — l’hostie en étant un exemple pour les chrétiens, mais on peut aussi penser au pain retrouvé dans les tombes des pharaons. Alors, dans ce paysage, la création de la Maison des semences paysannes Triticum devient un acte révolutionnaire pour dérailler de l’injonction mortifère à la performance. Et finalement atterrir. Être « paysan » donc. Publier, lire ou partager Cultiver les céréales devient un acte de résistance salutaire. Merci donc

à Simon Bridonneau pour ce travail de fond considérable. La pédagogie engageante de ce livre nous invite à un paradoxe fertile : revisiter des traditions souvent oubliées et explorer un nouveau monde. Avec les céréales paysannes, il s’agit finalement de nous relier au succès multimillénaire de ces plantes fascinantes, qui tient d’abord à leur grande robustesse. Les céréales paysannes n’ont en effet pas subi une sélection au service du rendement, mais, au contraire, ont conservé une grande rusticité et une grande diversité, développementale, morphologique, nutritionnelle, etc. Ces qualités sont et seront essentielles pour vivre dans le siècle qui vient, avec ses nombreuses fluctuations. Le livre en trace les contours de façon exhaustive
et amène le lecteur à s’émanciper des cultures dominantes pour inventer de nouveaux chemins plus situés, plus hétérogènes, plus autonomes et donc plus viables. On notera le soin avec lequel les informations ont été collectées et décrites. Il s’agit finalement de repenser la santé, dans une approche systémique, plurielle, préventive et enthousiasmante, grâce à la diversité des variétés, des pratiques, et même des astuces. Participatif, low-tech, agroécologie, modèles économiques, cadre juridique, pédagogie… : de la fourche à la fourchette, Simon Bridonneau nous invite à être acteurs plutôt que consommateurs, à la table plutôt qu’au menu. Une révolution engagée, un manuel pour y parvenir, une ambition joyeuse.
Pains, galettes, pâtes, biscuits, crêpes, bouillies, soupes : les céréales transformées constituent une source essentielle de calories qui a pris une grande diversité de formes dans l’histoire. Depuis cinquante mille ans, ces aliments accompagnent les hommes. Au cœur d’un processus sociotechnique majeur qui débuta il y a douze mille ans, l’agriculture, les céréales sont un élément fondamental. De la cueillette de céréales sauvages, l’homme est passé pour des raisons encore mystérieuses à leur mise en culture, créant sur le temps long les céréales domestiquées. Les semences furent dès le Natoufien — vers le IXe millénaire — associées à trois éléments de la vie des hommes : l’habitat, les sépultures et les symboles. Ces nouveaux usages des semences évoquent un changement dans leur conscience de la vie. Lien avec les défunts, rites de passage, gratitude envers des forces supérieures ou interactions intimes avec le vivant : les mobiles des semeurs de graines sont très probablement divers. Pendant plusieurs millénaires, le quotidien fut rythmé par le calendrier agricole. Les modes de production céréalière apparurent dans différents foyers sur le globe, donnant naissance à de nombreux savoir-faire et à une large diversité d’espèces et de variétés céréalières. Engrains, orges, amidonniers, épeautres, blés, avoines, riz, maïs, millets ou encore seigles étaient cultivés et multipliés dans les terroirs, constituant des variétés et des semences adaptées localement. Les différentes civilisations les firent évoluer, les consommèrent et les associèrent à leurs rites et à leurs croyances.
Aujourd’hui, les céréales restent un élément de base de l’alimentation mondiale. Le blé, tendre comme dur, ainsi que le riz occupent une place prépondérante ; quant au maïs, il nourrit en premier lieu les animaux d’élevage.
Cependant, la grande transformation industrielle de l’agriculture du xx e siècle a altéré de nombreux éléments sociaux et techniques immuables jusqu’alors, causant désormais des dommages systémiques. Alors que l’agriculture industrielle, qui occupe la majorité des terres fertiles au niveau mondial, organise la disparition de ses paysans, 40 % de la population active reste paysanne et travaille dans de petites fermes familiales non industrialisées. Cette agriculture paysanne nourrit la majorité de la population mondiale, mais n’occupe plus qu’un quart des terres cultivables1.
Diversité des paysans et diversité des plantes cultivées semblent liées, les très nombreuses variétés ancestrales ont disparu du système agro-industriel au profit de quelques variétés commerciales à haut rendement. Cet abandon de la diversité variétale s’accentue et touche bien sûr les céréales. L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) estime que, sur près de 250 000 variétés végétales propres à la culture, on n’en cultive aujourd’hui qu’environ 7 000, soit moins de 3 %.
En Occident, les faucilles des moissonneurs sont remisées et l’odeur de cuisson du pain s’échappant de la cheminée du four domestique ne met plus les cœurs en joie : autant de marqueurs d’un changement de civilisation. Le lien entre les hommes et les céréales perdura

si longtemps que nous en avions oublié son origine, sa dimension précieuse, vitale et fondatrice. Il s’est finalement brisé sous le joug de l’industrialisation, provoquant la perte de milliers de variétés paysannes, la disparition des savoirs associés, et des paysans eux-mêmes dans de nombreuses régions du monde. L’agriculture est donc particulièrement touchée, et son maintien est mis en question au xxie siècle. Tel est le triste sort d’une civilisation devenue technologique et « de consommation », entrée dans une crise profonde qui prend des formes multiples : crise anthropologique, crise sociologique, crise des ressources, crise climatique et crise environnementale, qui ne sont pas passagères.
Nous aurions tous dans nos généalogies des ancêtres paysans, et la société serait encore liée à la paysannerie par son attachement aux terroirs de France. Pourtant, l’image semble d’Épinal, et la distanciation entre le vivant, la production de l’alimentation, les consommateurs et les agriculteurs, toujours plus grande. Les paysages arasés des campagnes en témoignent, l’évolution des paysages reflète celle des mœurs2, disait Charbonneau, penseur du xxe siècle, pionnier de l’écologie politique et ardent défenseur de la paysannerie. En effet, nous semblons presque étrangers à ce qu’implique notre appartenance au vivant. À savoir le respecter et cohabiter avec lui pour nous nourrir, car sans lui nous ne pouvons être.
Mais cette distance n’est pas un problème, car nous déléguons ! Il n’y a de fait aucun problème alimentaire, le marketing entretient savamment l’illusion d’une alimentation abondante, diversifiée, peu chère, rentable pour tous les acteurs et qui serait « de qualité ».
La situation alimentaire montre aussi une rupture avec notre histoire agro-pastorale, — mêlant agriculture et élevage —, qui a vu les actes physiquement les plus pénibles classés dans la catégorie « à fuir », la fin de la traction animale et une systématisation de l’usage des
moteurs et des machines pour toutes les opérations agricoles. Ce système renforce l’obsession pour la performance et la rentabilité économique en faisant baisser les prix d’achat aux paysans. Alors que les travaux agricoles étaient le socle d’une vie autonome donnant accès à une forme de liberté, des politiques planificatrices et progressistes sont même allées jusqu’à contraindre de nombreux paysans aux méthodes traditionnelles à arrêter leur activité3. À cela s’est ajoutée l’apparente attractivité du travail à l’usine, qui a créé de nombreux emplois dans les entreprises agro-alimentaires, dont les récoltes agricoles sont la matière première négociée sur le marché mondialisé. Le paysan, rendu dépendant des caprices des saisons par les pratiques agricoles modernes de monoculture, est livré sans recours aux lois du marché, expliquait déjà Bernard Charbonneau en 1969 (voir note 2).
Entre 1900 et 2025, la population agricole et donc compétente pour assurer la production de l’alimentation s’est effondrée, elle est passée de 40 % de la population à 1,5 %4. Drôle d’évolution civilisationnelle : désormais un Français sur 100 produit la nourriture des 99 autres… L’absence de politique de renouvellement des générations, la logique foncière d’agrandissement des fermes et la robotisation qui s’accélère ne présagent rien de très bon. Dans les dix ans à venir, 50 % des agriculteurs vont partir à la retraite. Serait-ce la fin des paysans ?
Le terme de « céréales » regroupe les plantes de la famille des poacées, aussi appelées « graminées ». Ces plantes, dont le cycle de vie est généralement annuel (une sélection bisannuelle est possible), sont principalement cultivées pour leurs grains, riches en amidon, et constituent un aliment énergétique essentiel pour les humains et les animaux d’élevage. Elles représentent un apport calorifique essentiel dans notre bol alimentaire.
Toutefois, s’intéresser aux céréales et à l’agriculture vivrière en Occident peut paraître quasi
incongru à notre époque ; les blés, les orges ou encore les maïs sont cultivés selon des méthodes industrielles, dans des parcelles toujours plus grandes et avec une puissance mécanique sans cesse croissante. Les moissonneuses-batteuses à cabines climatisées sont le symbole de la modernité, les épandages chimiques restent la condition de la bonne santé des cultures5. À la sortie du champ, les céréales sont transformées en farine (1re transformation) puis en aliments (2e transformation). La chaîne technique allant de la semence à l’assiette s’est considérablement allongée et complexifiée depuis 1960, allant même jusqu’à détériorer la qualité des aliments produits. On parle désormais de « système alimentaire industriel ». Ce système produit et rend accessibles nos calories quotidiennes. Pour cela, il mobilise des maillons tous hautement technologiques : laboratoires de biogénétique semencière, semi-conducteurs, raffineries, usines de pesticides, usines d’engrais, pipelines, matériels agricoles, satellites, réseaux routiers, usines d’emballages, usines de transformation alimentaire, supermarchés, trading… La liste est interminable et révèle la complexité du système industriel mondialisé. De plus les acteurs de chaque maillon font l’objet d’un phénomène de concentration par le jeu des rachats d’entreprises, créant des structures géantes. Or, la croissance permanente de la taille, comme nous l’explique le philosophe et mathématicien Olivier Rey, pose alors un problème. On oublie que le bien pour toute chose est qu’elle ait la taille appropriée à sa nature et à sa fonction 6. Mais, dans le système agro–industriel, cette question n’existe plus. La taille croissante et sans mesure des infrastructures induit des mécanismes de plus en plus complexes et insoutenables (longueur des chaînes d’approvisionnement, nombre de composants, taille des usines…).
La contrainte technologique des machines nécessite des matières uniformes pour le bon fonctionnement des outils de production. Si les grains de blé ne sont pas du même calibre, cela détériore le moulin de l’usine à pâtes, me racontait un meunier industriel.
Désormais sous-nourris par un grand nombre d’aliments contaminés, trop raffinés, vidés de leurs calories saines et de leurs nutriments essentiels, les humains sont touchés par diverses maladies chroniques et dégénératives. La liste de produits chimiques utilisés de la graine au pain est vertigineuse… et mérite que l’on se souhaite bonne chance avant le repas s’il n’est pas cuisiné à partir de produits issus de l’agriculture biologique.
Il reste que cette nouvelle façon de produire de la nourriture, basée sur des systèmes complexes intégrés, n’a que peu d’expérience au regard de la longévité des systèmes paysans et artisanaux, dont la durabilité sur plusieurs millénaires est effective. En fort développement depuis 1960, l’agriculture industrielle et l’agro-industrie n’ont, comparativement, que très peu de recul à leur actif, mais elles semblent pourtant vouloir croire en leur viabilité et en leur robustesse quand d’autres voient déjà leur fragilité structurelle.
L’agriculture industrielle, qui induit la production de céréales et aliments associés, présente une caractéristique majeure et non des moindres : sa dépendance à une énergie abondante et bon marché. Le système alimentaire dans son ensemble est particulièrement dépendant des énergies fossiles7. Engrais, acier, chimie, transport, machines nécessitent un apport massif de gaz, de pétrole et de charbon. Le rapport entre le nombre de calories qu’il a fallu engager pour produire des aliments et les calories obtenues s’exprime par le taux de retour énergétique (TRE). En dessous de 1, un TRE est dit « négatif » et devient un puits d’énergie. Par exemple, si la production agricole états-unienne ne dépense « que » deux calories de combustibles fossiles (gaz naturel et pétrole majoritairement) pour produire une calorie alimentaire, en regardant du champ à l’assiette, on observe que 8 à 12 calories fossiles supplémentaires sont dépensées en moyenne pour transformer, emballer, livrer et stocker

sous températures dirigées, et cuisiner une seule calorie d’aliments industriels. La performance relative du maillon agricole est annulée par celle, bien plus médiocre, des maillons les plus gourmands comme la logistique ou la transformation.
À cela s’ajoute l’obsession de la rationalisation des productions et des itinéraires de production, qui vide de sa vie le milieu naturel. Cette tendance, rendue nécessaire par la taille des unités de production, du champ à la transformation, rend la production très sensible à des déséquilibres liés au vivant : invasion de champignons, de ravageurs ou de bactéries présentent un risque destructeur. Faire le vide à l’aide de biocides protège la production alors qu’on devrait rechercher des équilibres et de la résistance. La logique industrielle conduit à nier le fonctionnement de la vie, la santé des
sols, la diversité et la santé des plantes, l’état des écosystèmes et la santé des humains.
L’agriculture par le vide a peur du monde vivant et le détruit.
De nombreuses espèces sauvages voient leur pronostic vital engagé. Cette crise très préoccupante est appelée la « sixième extinction de masse ». La cinquième, celle du Crétacé, remonte à quelque soixante-six millions d’années. S’étalant sur une durée de trentedeux mille ans, elle avait vu disparaître, après l’impact d’un astéroïde, 75 % des espèces, dont les dinosaures. Nous en prenons la direction en à peine trois cents ans d’activités industrielles.
Consomm’acteurs
Le pain et les pâtes arrivent sur nos tables sans discontinuer, depuis des grandes surfaces sous perfusion d’usines et de moulins géants producteurs de « farines améliorées »8.
Il est vrai que déléguer notre approvisionnement alimentaire quotidien nous aura dégagé du temps et donné des perspectives de vie plus modernes. Mais sommes-nous pour autant plus heureux ? Le progrès qui se déploie n’est jamais simple à contourner et nous canalise dans la direction qu’il choisit, quand bien même certains voudraient s’y opposer9. Il façonne la société et les modes de vie. Les systèmes vivriers n’ont que peu de sens à exister lorsque l’opulence alimentaire tend à faire croire que la nourriture n’a plus la valeur d’antan. Tout cela aura eu de nombreux impacts, le premier étant notre dépendance et totale perte de savoir-faire en matière de céréales. Nous devons bien souvent nous orienter dans le fouillis alimentaire des supermarchés, submergés par des aliments fortement transformés qui ne doivent leur salut qu’à un modèle commercial encourageant la transformation des aliments (plats cuisinés, céréales transformées, viennoiseries issues de recettes industrielles complexes pourvues en additifs).
Qui connaît le cracking, pourtant utilisé à très grande échelle ? Non, ce n’est pas une nouvelle recette de cornflakes sur Instagram, mais une méthode de fragmentation industrielle qui permet de décomposer un aliment en plusieurs ingrédients plus petits, procédé très utilisé sur les matières premières agricoles comme le lait, les céréales, le soja, les pois. Technologie usant de hautes températures et d’enzymes très souvent issues d’organismes génétiquement modifiés (OGM), elle permet de diviser les composants du grain de blé en gluten, amidon, isoglucose… pour les réintégrer ensuite dans des aliments industriels ultra-transformés. La situation est littéralement vertigineuse, les humains sont dépossédés de leur lien avec leur nourriture. C’est finalement le lien avec le vivant et la perception de la juste place de l’homme dans le monde vivant10 qui sont détruits. Il est difficile de croire qu’un tel modèle réussira à fonctionner. Comment un modèle sans paysans et sans biodiversité peut-il protéger les populations à l’ère des polycrises, telle que l’a décrite Olivier Hamant, directeur de recherche à l’INRAE11 ?
Une série de questions s’impose pour changer de référentiel et retrouver des marges de manœuvre. Et si nous avions à recommencer ? Et si les céréales redevenaient nos plantes compagnes ? Et si nous cherchions le fil rompu de notre histoire plurimillénaire ? Est-il possible de générer à nouveau une force de subsistance pour l’avenir au sein de collectifs vivants ? Et si la pratique culturale des céréales et leur transformation étaient vectrices d’une nouvelle manière d’habiter le monde, de retrouver l’oikos et l’engagement collectif dans la polis12 ?
Nombreux sont ceux qui ont déjà perçu le sentiment de joie et de liberté que procure l’autoproduction de quelques aliments. Ne sommes-nous pas en France les champions du potager ? La permaculture n’a-t-elle pas (r)éveillé en nous le désir d’autonomie et de subsistance de nos grands-parents ?
Ce guide pratique propose de revenir aux sources, de plonger au cœur de notre alimentation et de son élément premier : les céréales. Recouvrer la connaissance des semences en vue de cultiver des céréales paysannes avec des outils simples, en partie à la main, à une échelle humaine, apprendre à les conserver et à les transformer pour une consommation domestique.
Dès lors, le pain n’aura assurément plus le même goût !
Initiation à l’autonomie
Je viens du bocage vendéen, d’une époque où les zones humides étaient encore nombreuses, habitées d’oiseaux et d’insectes grouillants de vie. Les trognes nous rappelaient qu’avant nous des paysans avaient travaillé à leur autonomie des hivers durant. Les souvenirs de la vie campagnarde de mon enfance sont riches et nombreux, j’ai longtemps cru que grandir entre une ferme paysanne ancienne et un domaine sauvage marqué à l’entrée d’un panneau LPO définissait une vie normale. La ferme était celle de mes grands-parents, quasi autonome au fonctionnement intact depuis les années 1950.
Et si les céréales paysannes redevenaient nos plantes compagnes ? Nous relier à ces plantes millénaires qui ont conservé une grande rusticité et une grande diversité est devenu un levier de la transition agricole et alimentaire. De la fourche à la fourchette, Simon Bridonneau, cofondateur de la Maison des semences paysannes Triticum, nous invite à réhabiliter des variétés ancestrales et à devenir des acteurs de notre autonomie. Il nous propose de redécouvrir les savoirs et les savoir-faire liés aux céréales, de leur culture sur de petites surfaces (50 m2 à 5 000 m2) à la moisson et à leur transformation avec des outils simples, en partie à la main, et des machines à taille humaine. Planter, moissonner, stocker et cuisiner engrain, orge, amidonnier, épeautre, blé tendre, blé Poulard, blé dur, blé Khorasan, avoine, seigle, sarrasin, millet… : un guide pour retrouver le goût du bon pain et semer les graines du changement.
SIMON BRIDONNEAU est cofondateur de la Maison des semences paysannes de Normandie, Triticum, en lien avec les structures du Réseau Semences Paysannes. Il dirige depuis 2019 un programme de recherche participative autour des céréales paysannes en Normandie, en constituant une collection in situ, en lien avec des agriculteurs bio, des paysans boulangers, des boulangers, des chercheurs de l’INRAE et avec le soutien de citoyens invités à participer à des chantiers agricoles. À partir de 2024, le projet Céréales jardinées est lancé par Triticum avec la ferme du Bec Hellouin et d’anciens chercheurs de l’INRAE, il réunit 170 lieux en France et en Europe autour de la culture de céréales sur petites surfaces.