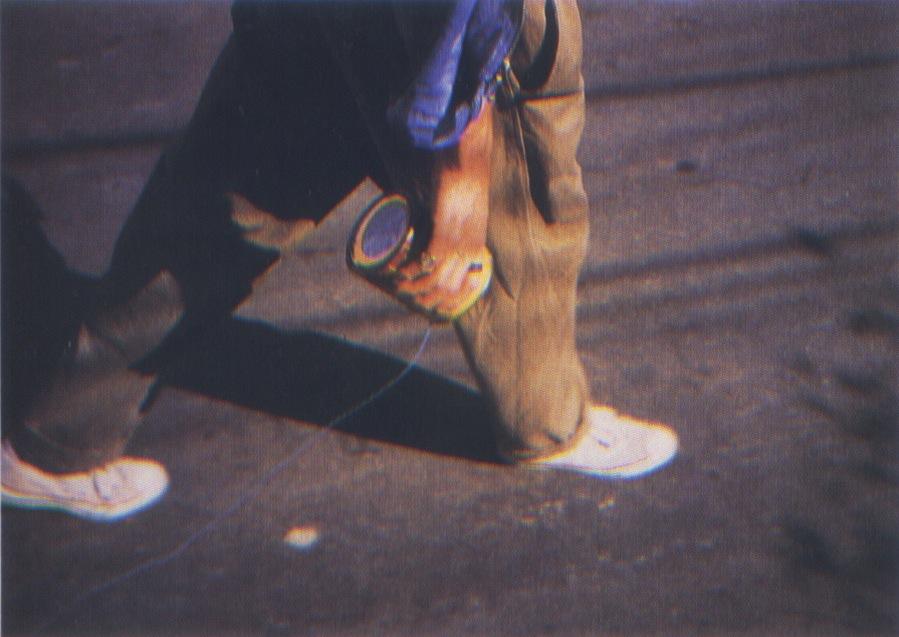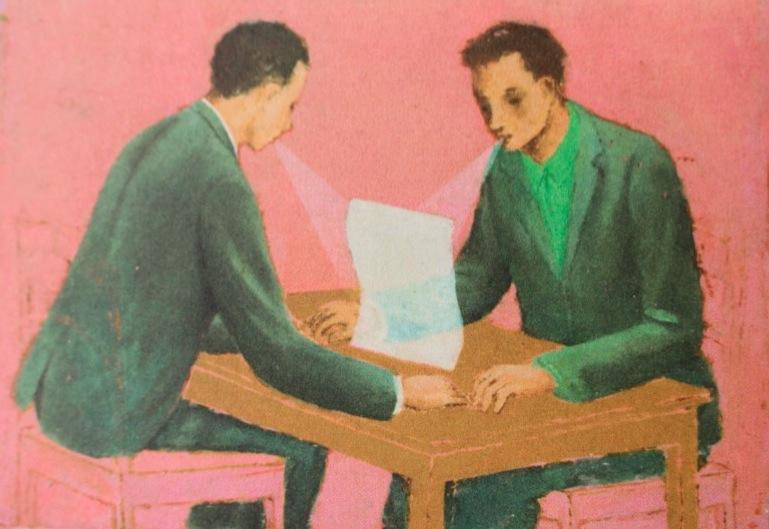INTRODUCTION
Ce mémoire a pour objet la notion d'entre-deux. Il constitue une étape préalable d'une recherche plus large qui tente de répondre en dernière instance à la question de savoir comment la notion d'entre-deux est associée à l'exil dans l'art contemporain.
Ce projet de recherche a pour point de départ des constats issus d'observations empiriques réalisées lors de nos propres expériences artistiques qui visaient à comprendre expérimentalement le phénomène de l'entre-deux. Afin de prendre une distance suffisante pour analyser notre propre pratique artistique, ce mémoire étudiera la notion d'entre-deux à partir de l'étude de quelques œuvres des artistes Francis Alÿs et Adrian Paci, en mettant celles-ci en relation avec des réflexions théoriques de plusieurs auteurs. Le choix des artistes a été déterminé par l'identification d'éléments en commun qui existent entre leurs pratiques artistiques et la nôtre ; ces éléments étant essentiels pour notre réflexion actuelle en tant qu'artiste et étrangère. Ces éléments sont la notion d'entre-deux, la notion de frontière, le voyage et l'exil, lesquels sont reliés entre eux par l'idée du déplacement du corps dans l'espace. Des relations entre ces différents termes, deux questions principales ressortent et forment le fil conducteur de ce mémoire : Comment la notion d'entre-deux estelle travaillée dans l'art contemporain ? Dans quel sens cette notion d'entre-deux peut-elle être reliée à l'exil ?
Afin de comprendre et d'essayer d'appréhender la notion d'entre-deux sur le terrain de l'art contemporain, nous partirons de la définition d'entre-deux donnée, d'une part, par l'artiste albanais Adrian Paci dans son portrait filmé, réalisé dans le cadre de son exposition individuelle Vies en transit au Jeu de Paume en 2013, et de l'autre, de celle donnée par le psychanalyste Daniel Sibony dans son livre Entre-deux : L'origine en partage. En outre, nous examinerons la notion de culture de l'entre-deux dans l'ouvrage collectif Migrations et cultures de l'entre-deux, dirigé par les chercheurs Laurent Muller et Stéphane de Tapia
Ces définitions sont des postulats de base pour notre propre perspective de la notion d'entre-deux.
La notion d'entre-deux est définie par Adrian Paci dans le portrait filmé de l'exposition Vies en transit au Jeu de Paume à Paris, quand il parle de la vidéo Centro di permanenza
4
temporanea. L'artiste nous l'explique de cette façon :
Ces déplacements d'un pays à un autre, d'une société à une autre ont occasionné beaucoup d'expériences inattendues dans ma vie et mon œuvre. Mon travail a été marqué par ces moments de changement. J'ai commencé à m'intéresser aux espaces d'entre-deux, à ces instants où quelque chose perd de son identité en entrant dans une nouvelle dimension sans toutefois changer complètement d'identité. Centro di permanenza temporanea traite de cet entre-deux. Bien sûr il est question de migration, mais pas seulement. C'est sur la condition de l'être, sur ce moment existentiel lorsque tu quittes une forme d'existence pour entrer dans une autre, sans jamais l'atteindre1 .
Dans la citation précédente, l'artiste utilise plusieurs termes qui caractérisent cet entredeux: déplacements, expériences inattendues, moments de changement, instants, identité, dimension, condition de l'être, moment existentiel, forme d'existence. Il utilise ces termes pour préciser que l'entre-deux, ce sont des instants où quelque chose bouge, se déplace, d'une dimension à une autre nouvelle dimension. Plus exactement, l'entre-deux est ici présenté comme une situation, dans laquelle une chose ou un homme se déplace. Dans ce déplacement, elle/il rentre dans un entre-deux : par exemple, entre un lieu et un autre, entre une culture et une autre culture, entre une langue et une autre langue. Dans ce mouvement, la chose perd une partie de son identité, mais elle ne la perd pas entièrement.
Dans ce sens, Laurent Muller, dans son essai « Migrations et déplacements dans l'espace social », reprend l'autobiographie de Tzvetan Todorov intitulée L'homme dépaysé, pour faire référence à « l'expérience d'exil entre deux langues et deux cultures » du philosophe d'origine bulgare. Tzvetan Todorov est né à Sofia en 1939 et, depuis 1963, il s'est installé en France. Il est cependant retourné dans sa ville natale après 18 ans d’exil. Il écrit à ce propos :
Je me sentais pas moins à l'aise en bulgare qu'en français, et j'avais le sentiment d'appartenir aux deux cultures à la fois. […] Mon état actuel ne correspond donc pas à la ''déculturation'', ni même à l'acculturation, mais plutôt à ce qu'on pourrait appeler la ''transculturation'', l'acquisition d'un nouveau code sans que l'ancien soit perdu pour autant. Je vis désormais dans un espace singulier, à la fois dehors et dedans : étranger ''chez moi'' (à Sofia), chez moi, ''à l'étranger2''.
Nous nous demandons, en somme, si l'entre-deux, nommé par Adrian Paci et décrit par Tzvetan Todorov, est un passage entre deux formes d'existence ou si l'entre-deux peut être
1 Adrian Paci, Lives in transit, vidéo couleur, son, 8:42 min, 2013, Jeu de Paume, le magazine: Portraits filmés, 20 mars, 2013. Disponible sur le web <http://lemagazine.jeudepaume.org/2013/03/adrian-pacivies-en-transit/> et <http://www.youtube.com/watch?v=mUEBApzZ_CU>
2 Laurent Muller, « Migrations et déplacements dans l'espace social », in Laurent Muller, Stéphane De Tapia (dir.), Migrations et cultures de l'entre-deux, Paris : L'Harmattan, 2010, p. 97.
5
une situation permanente de vie. Ainsi, dans quel sens y a-t'il, dans l'entre-deux, de la mixité, du mélange, de la superposition ou la cohabitation de ces deux formes d'existence ?
Dans son livre Entre-deux : L'origine en partage, le psychanalyste Daniel Sibony définit l'entre-deux comme une « dynamique », un « opérateur » qui tresse une liaison entre deux termes ou entre deux choses3. Pour l'auteur, la notion d'entre-deux vient remplacer celle de différence, qui est aujourd'hui incapable d'expliquer le passage entre deux termes, entre deux réalités complexes4. Quant à la notion de différence, l'auteur affirme : « Le trait de la différence instaure un rapport trop simple pour les situations vivantes que le mouvement des choses impose : transmission de mémoire, secousses entre collectifs, afflux d'étrangers, quête plurielle d'identité, y compris pour l'individu5 […]. »
De même que dans la définition d'Adrian Paci, Daniel Sibony fait référence aux expériences, aux phénomènes humains plutôt qu'à une opposition de termes. Pour l'auteur, les formes de l'entre-deux, comme l'entre-deux lieux ou l'entre-deux langues, ne sont pas les mêmes mais elles ont en commun le fait qu'elles permettent à l'individu le passage d'un élément à un autre et qu’elles sont des passages « bifurqués6 ». Ainsi, l'entre-deux est défini par Daniel Sibony comme une « coupure-lien7 », comme « un espace de liens ''entre l'un et entre l'autre8'' » où il est possible d'intégrer des éléments divers9. L'auteur précise ainsi la notion d'entre-deux :
L'entre-deux est une forme de coupure-lien entre deux termes, […] chacune des deux entités a toujours déjà partie liée avec l'autre. Il n'y a pas de no man's land entre les deux, il n'y a pas un seul bord qui départage, il y a deux bords mais qui se touchent ou qui sont tels que des flux circulent entre eux10
L'idée de l'entre-deux vue comme « une forme de coupure-lien », formulée par Daniel Sibony, est réexaminée par les chercheurs Laurent Muller et Stéphane de Tapia : ceux-ci la caractérisent comme « un lieu, un trait d'union » ; en revanche, ils ne la considèrent pas comme étant une coupure11 .
Dans l'ouvrage collectif Migrations et cultures de l'entre-deux, Laurent Muller, Stéphane
3 Daniel Sibony, Entre-deux : L'origine en partage, Paris : Éditions du Seuil, 1991 et 2003 pour la préface, p. 7.
4 Ibid., p. 10.
5 Ibid., p. 14-15.
6 Ibid., p. 347
7 Ibid., p. 315.
8 Ibid., p. 343-344.
9 Ibid., p. 315.
10 Ibid., p. 11.
11 Laurent Muller, Stéphane de Tapia (dir.), Migrations et cultures de l'entre-deux, op. cit., p. 26-27.
6
de Tapia et un groupe de chercheurs en sciences humaines ont analysé la notion d'entredeux par rapport aux relations interculturelles et à la migration. Dominique Schnapper a défini la notion de cultures d'entre-deux non pas comme étant le partage d'une même culture entre deux personnes, mais comme les cultures élaborées par les personnes qui « ''n'appartiennent'' pas à deux ou plusieurs cultures, mais qui se réfèrent à deux ou plusieurs cultures12 [...]. » L'entre-deux associé à la migration et à la mondialisation interroge la mobilité13 et le déplacement dans les sociétés actuelles. Les cultures de l'entredeux produites par « […] ceux qui passent d'une nation à l'autre de manière permanente ou provisoire14 [...]», c'est-à-dire par les migrants, exposent un entre-deux largement caractérisé par les auteurs de la manière suivante :
[…], l'entre-deux peut être physique, matériel, érigé en barrière voulue infranchissable ou au contraire flou, immatériel, invisible, plus moral que physique, mais souvent bien plus infranchissable. Mais il peut aussi, comme dans le cas de ces comptoirs ou marchés frontaliers connus dans toutes les périodes historiques et toutes les civilisations, être le lieu de la mixité, de l'échange, voire de l'osmose ou de la symbiose15 . [...]
La notion d'entre-deux est, donc, ici inscrite dans une problématique particulière : celle des migrants qui arrivent dans un « pays d'installation16 » de manière voulue ou non, temporaire ou permanente. Ce migrant est considéré comme l'autre, perçu comme bizarre et menaçant17, celui qui met en relief une nouvelle relation à la nation, laquelle n'est plus, comme elle pouvait l'être auparavant, une relation construite pour relier de manière cohérente les sphères des habitants, de la « culture », du « territoire » et du système politique18, mais une relation qui par la présence de cet « autre19 » donne à voir le fait que les habitants ne partagent pas tous « la [même] manière de vivre ensemble20 » .
12 Ibid., p. 13 et 16.
La question principale abordée dans cet ouvrage est la suivante : « […] que se passe-t-il lorsqu'un individu, ayant élaboré sa personnalité dans un pays et une culture donnés, est amené à quitter ceux-ci pour aller vivre au sein d'un pays associé à une autre culture ? ». Ibid., p. 27.
13 Ibid., p. 17.
14 Ibid., p. 14.
15 Ibid., p. 26.
16 Dans la préface, Dominique Schnapper souligne l'utilisation de l'expression « pays d'installation » au lieu de « pays d'accueil » car elle dit que « les formes de l'accueil sont souvent ambiguës, pour parler en termes modérés. » Ibid., p. 16-17.
17 Ibid., p. 16-17.
18 Ibid., p. 13.
19 J'utilise des guillemets pour insister sur l’emploi singulier de ce terme et indiquer ma distance critique vis-à-vis de celui-ci.
20 Ibid., p. 17.
Okwui Enwezor, commissaire de la Triennale de Paris de 2012, intitulé Intense Proximité, a réfléchi aussi à la question du vivre-ensemble quand il a fait la lumière sur le propos de l'exposition : « […] l'objectif du discours critique d'Intense Proximité n'est pas d'étudier comment les sociétés contemporaines peuvent partager un espace commun ou vivre ensemble. La question essentielle est bien plutôt de savoir comment
7
En somme, la consultation des différentes sources citées précédemment nous permet d'observer que la notion d'entre-deux est reprise par plusieurs disciplines et ne se limite pas uniquement aux domaines des migrations ; elle est aussi employée pour faire référence à d'autres phénomènes de groupes humains, que Laurent Muller désigne comme « d'autres situations d'interface culturelle entre deux milieux dissemblables21 . » En effet, l'entre-deux est compris en tant que « zone de tension22 », « espace intermédiaire23 », « moment de transition24 », état liminal25, « lieu de passage », « zone de flottement26 », « entrecroisement27 », zone de contact et de transition28 entre plusieurs éléments.
Cette révision bibliographique, constituant le point de référence de notre définition de l'entre-deux, nous permet d'articuler dans les pages suivantes cette notion à une réflexion sur la frontière, le voyage et l'exil, en ayant toujours présent à l'esprit l'idée du déplacement du corps dans l'espace.
Pour aborder les questions que nous nous sommes posées – à savoir, notamment, la manière dont la notion d'entre-deux est travaillée dans l'art contemporain et le sens dans lequel cette notion d'entre-deux peut être reliée à l'exil –, ce travail de recherche sera constitué de trois parties, construites de manière personnelle et intitulées « figures de l'entre-deux ». Les trois figures de l'entre-deux sont : l'entre-deux spatial, l'entre-deux comme frontière et l'entre-deux du voyage et de l'exil. Dans la première partie, nous construirons la notion d'entre-deux spatial à partir de l'analyse des œuvres suivantes : Centro di permanenza temporanea (Centre de rétention provisoire) d'Adrian Paci ; Placing Pillows (Plaçant des oreillers), The Leak (La Fuite), Duett (Duo), La leçon de musique, La vivre avec cette disjonction, dans l'épaisseur de nos processus ethnographiques fondés sur l'identité. » Intense proximité : la triennale de l'exposition (commissaire : Okwui Enwezor), guide de l'exposition, Palais de Tokyo et lieux associés, Paris : Artlys, 2012.
21 Laurent Muller, « Migrations et déplacements dans l'espace social », op. cit., p. 101.
22 Entre-deux : Une confrontation entre la photographie féminine d'hier et d'aujourd'hui en Belgique et aux Pays-Bas (commissaires : Inge Henneman, Dominique Somers), Anvers : Provinciaal Museum voor Fotografie, 2000, p. 114.
23 Ibid., p. 114.
24
Marie Fraser et Marta Gili, « Entretien avec Adrian Paci », in Adrian Paci : Transit (commissaires : Marta Gili et Marie Frazer) Paris, Jeu de Paume ; Milan, PAC Padiglione d'Arte Contemporanea ; Montréal, Musée d'art contemporain de Montréal, Milan : Mousse Publishing, 2013, p. 32.
25 Terme composé à partir des réflexions de Edna Moshenson d'après la définition d'entités liminales de l'anthropologue britannique Victor Turner : « […] ne sont ni ici ni là ; elles sont entre les deux [...] » Edna Moshenson, « Sujets en transit », in Adrian Paci : Transit, op. cit., p. 49.
26
Valentine Oncins, « Synthèse : L'entre-deux » (sous la direction de Georges Bloess), thèse : Université Paris 8, Esthétique, Sciences de l'art, Arts Plastiques, 2002, Vol. 1, p. 6.
27 Ibid., p. 4 et 28.
28 Ibid., p 141.
8
Théorie des ensembles et Children's Game #14 : Piedra, Papel y Tijeras (Jeu d'enfants #14 : Pierre, Feuille et Ciseaux) de Francis Alÿs. L'analyse des œuvres sera faite en dialogue avec les notions d'espace, de lieu, de non-lieu et d'ouverture; dans notre argumentation, nous reprendrons les travaux de différents auteurs, tels que ceux de Michel de Certeau, de Marc Augé, de Martin Heidegger et de Didier Franck.
La deuxième partie de notre travail étudiera la connexité entre la notion d'entre-deux et la notion de frontière, vis-à-vis des mutations de cette dernière, en correspondance avec les œuvres Klodi et A Real Game (Un jeu réel) d'Adrian Paci, The Loop (La Boucle) et The Green Line (La ligne verte) de Francis Alÿs et les réflexions d'auteurs tels que Yves Lacoste, Michel Foucher, Philippe Fontaine, Didier Bigo, Karoline Postel-Vinay et Michel de Certeau
Finalement, dans la troisième et dernière partie, nous chercherons à comprendre comment la notion d'entre-deux est liée à l'exil par rapport au voyage et à la situation de l'entre-deux cultures, et ce à partir de l'étude des projets artistiques comme Albanian Stories (Contes albanais), The Column (La Colonne) et Home to Go (Un toit à soi) d'Adrian Paci, When Faith Moves Mountains (Quand la Foi Déplace des Montagnes) et Turista (Touriste) de Francis Alÿs ; notre réflexion prendra appui sur les idées avancées à propos de l'exil et de la notion d'entre-deux par Daniel Sibony, Edward T. Hall, Edward W. Said, Michel Gironde et Cihan Gunes. Les enjeux des œuvres décrites seront examinés à partir des analyses des spécialistes de l'art contemporain tels que les commissaires d'expositions, les historiens et les critiques d'art suivants : Edna Moshenson, Edi Muka, Marie Fraser, Marta Gili et Angela Vettese pour les œuvres d'Adrian Paci ; Mark Godfrey, Bruce W. Ferguson, Russell Ferguson, Cuauhtémoc Medina, Thierry Davila, le sociologue brésilien Laymert Garcia dos Santos et l'architecte et professeur israélien Eyal Weizman pour les œuvres de Francis Alÿs
9
CHAPITRE 1
L'ENTRE-DEUX SPATIAL
1.1 Centro di permanenza temporanea d'Adrian Paci
Centro di permanenza temporanea (Centre de rétention provisoire) est une vidéo en couleur réalisée en 2007 par Adrian Paci, lequel montre un groupe de personnes qui marche sur la piste d'atterrissage d'un aéroport vers l'escalier d'embarquement d'un avion. L'action est présentée à partir de différents types de plans, qui ne laissent pas voir l'absence de l'avion. Seulement à la fin de la vidéo, le spectateur découvre que l'escalier d'embarquement ne conduit nulle part, donc les passagers doivent rester sur la plateforme à la fin des marches et sur l'escalier.
La vidéo montre des actions simples et communes pour n'importe quel passager d'un avion. En revanche ici, ces actions simples comme marcher, monter, s'arrêter, attendre, regarder, s'approcher d'un groupe, rester en silence sont des actions sur lesquelles l'artiste insiste à travers le choix des cadrages des plans et de la vitesse utilisée dans le montage. La vitesse de la vidéo est ralentie dans certains plans. De cette façon elle souligne le fait de marcher sur la piste et de monter sur l'escalier de manière pesante. Elle accentue aussi les gestes des visages et les positions des corps des passagers. La caméra reste fixe, presque tout le temps, en faisant en sorte que les mouvements des personnages émergent dans un paysage qui ne varie pas d'une luminosité également constante où la présence du groupe sur la piste d'atterrissage s'avère quasi irréelle.
C'est dans le deuxième plan de la vidéo, un plan moyen plongé, que les passagers rentrent dans le cadre visuel. Ils forment une queue en marchant vers l'escalier d'embarquement et commencent à monter. Ce sont des passagers particuliers: la plupart
FIGURES DE L'ENTRE-DEUX
10
sont des hommes, de peau obscure, des métis ou des noirs, et leur façon d'être habillés nous indique que ce sont des gens pauvres.
Le soleil brille fortement sur la piste, les ombres courtes se reflètent sur le sol et laissent penser que c'est peut-être midi. Quelques-uns portent des casquettes ou des bonnets ; en revanche, aucun d'eux ne porte de lunettes de soleil et non plus de billet d'avion à la main. Ils marchent d'un pas lourd.
Dès que le premier homme s'approche de l'escalier d'embarquement, la queue de passagers se fait visible avec ses ombres sur le sol. Le premier homme en chemise blanche, gilet noir et casquette commence à monter. Ses pas résonnent sur l'escalier métallique et son ombre n'est plus visible, elle est cachée par les marches. La personne suivante s'approche de l'escalier et ses particularités se révèlent à la caméra ; après son corps est rapidement caché par l'homme qui est devant lui et son ombre aussi disparaît. La vidéo montre six secondes de cette ascension. Pourtant, le spectateur sait déjà que chaque homme disparaîtra visuellement derrière le suivant, même si les bras et les mains des passagers se laissent encore voir sur les rampes de l'escalier.
Le plan suivant montre les pieds de quelques passagers. Ils avancent et la vitesse est de nouveau ralentie. Tous portent des chaussures masculines, de travail, de couleurs obscures et marchent lentement d'un pas lourd. Simultanément, il y a des voix dans lesquelles l'on distingue une certaine diction de l'espagnol. Au cours d'une conversation incompréhensible, le mot 'espera' en espagnol (attend), est dit deux fois.

11
Image 1 : Adrian Paci, Centro di Permanenza temporanea, 2007, Vidéo, 5' 30''
Ensuite, la vidéo montre, dans un plan d'ensemble, l'escalier latéralement avec les passagers qui font la queue et qui montent. Ici, les gestes et les caractéristiques des voyageurs sont spécialement perceptibles; quelques-uns montent en s'appuyant sur les rampes, d'autres le font d'une manière plus dynamique, un autre encore se touche les cheveux en marchant. Il y a aussi deux femmes qui se distinguent clairement par leurs cheveux attachés en arrière.
Cette image est d'une extrême véracité poétique. Véracité dans le sens où elle s'apparente aux images, présentées dans des journaux ou dans des documentaires, des migrants clandestins ou des prisonniers qui font la queue, même si dans ces cas, ce ne sont pas les particularités individuelles des personnes qui se mettent en avant. Poétique dans le sens où l'atmosphère irréelle qui entoure les passagers fait que leurs gestes acquièrent une visibilité augmentée. Le paysage autour est constitué d'un ciel et d'un sol éclairés par une lumière radieuse, c'est pour cela que la piste d'atterrissage de béton ne présente pas d'ombres, d'où les corps des passagers semblent marcher dans le vide.
Le prochain plan, un plan américain plongé, montre à une vitesse ralentie, les passagers qui arrivent à la plateforme au bout de l'escalier. La caméra qui était restée fixe jusqu'à maintenant, bouge vers la droite et présente dans une série de gros plans, les visages des hommes et des femmes. Ils sont tous proches les uns des autres. C'est un groupe de personnes que la caméra individualise. Ce sont des portraits d'anonymes 29, des migrants, 29 L'idée des portraits d'anonymes est proposée par Hervé Joubert-Laurencin comme un aspect en commun

12
Image 2 : Adrian Paci, Centro di Permanenza temporanea, 2007, Vidéo, 5' 30''
peut-être des travailleurs d'Amérique latine. Quelques-uns sourient, ils se sentent examinés par la caméra. D'autres baissent leur regard ou regardent la caméra de côté et en suite leur regard est perdu dans le vide. Tout le monde est en silence.
Soudain, un travelling arrière révèle le groupe sur la plateforme. Ils sont tous entassés sur l'escalier d'embarquement entourés d'avions qui décollent et atterrissent. Après l'escalier, il y a le vide.

La vidéo montre cette dernière image décrite en alternant une vue de front et une vue latérale de l'escalier d'embarquement avec les passagers. Entre la vue frontale et latérale, il y a des plans en noir. L'alternance des plans noirs et le retour à l'image se fait quatre fois. Elle énonce un temps qui ne passe plus pour les passagers, un temps d'attente vers le futur incertain et vers une impossibilité de retour au passé. Après chaque plan en noir, l'image revient et les passagers sont encore là, en attente. Comme s'ils étaient attrapés, comme s'ils demeuraient là indéfiniment.
Le son puissant des moteurs des avions accompagnent cette dernière séquence de plans.
entre Adrian
et Pier Paolo
Herbert Joubert-Laurencin, «
De la permanence temporaire », Jeu de Paume le magazine: La parole à … [en ligne], 15 février 2013 [consulté le 25 septembre 2013]. Disponible sur le web <http://lemagazine.jeudepaume.org/2013/02/adrian-paci-pasolini-herve-joubert-laurencin/>.
13
Paci
Pasolini.
Pasolini chez Paci.
Image 3 : Adrian Paci, Centro di Permanenza temporanea, 2007, Vidéo, 5' 30''
Image
Image


14
5 : Adrian Paci, Centro di Permanenza temporanea, 2007, Vidéo, 5' 30''
4 : Adrian Paci, Centro di Permanenza temporanea, 2007, Vidéo, 5' 30''
1.1.1 La distinction entre lieu et espace pour comprendre l'entre-deux spatial dans l'œuvre d'Adrian Paci
Centro di permanenza temporanea est une vidéo qui éclaircit la notion d'entre-deux spatial dans l'œuvre d'Adrian Paci. Dans le Portrait filmé de l'exposition d'Adrian Paci, intitulé Adrian Paci, Vies en transit au Jeu de Paume à Paris en 2013, l'artiste donne une définition de cette notion : « J'ai commencé à m'intéresser aux espaces d'entre-deux, à ces instants où quelque chose perd de son identité en entrant dans une nouvelle dimension sans toutefois changer complètement d'identité30 »
D'après une autre réflexion, l'artiste parle de deux lieux dans la situation particulière de l'émigrant : « […] qu'un émigrant habite toujours deux lieux en même temps31 »
Les deux citations précédemment énoncées nous proposent les questions suivantes :
Il y a-t-il un lien entre la notion d'entre-deux spatial et l'idée d'habiter deux lieux en même temps ? Est-ce-que ces deux expressions sont des synonymes ?
Premièrement, il faut essayer de comprendre ce que nous entendons par la notion d'espace et par la notion de lieu.
Michel de Certeau fait une distinction entre le mots lieu et le mot espace sans les opposer32. Pour lui, dans un lieu, les éléments sont situés dans un ordre, chacun dans une seule place à la fois et un à côté de l'autre. La notion d'espace est déterminée et animée par des variables comme le temps, la vitesse et les directions des vecteurs. Dans L’invention du quotidien, Michel de Certeau définit l'espace de la manière suivante : « L'espace est un croisement de mobiles. Il est en quelque sorte animé par l'ensemble des mouvements qui s'y déploient. […], l'espace est un lieu pratiqué. Ainsi la rue géométriquement définie par l'urbanisme est transformée en espace par des marcheurs33 »
Marc Augé, dans le chapitre intitulé « Des lieux aux non-lieux », examine aussi les deux notions de lieu et d'espace, pour établir une distinction entre les notions de lieu et de nonlieu.
30 Adrian Paci, Lives in transit, op. cit., [en ligne]
31 Herbert Joubert-Laurencin, « Pasolini chez Paci. De la permanence temporaire », op. cit., [en ligne].
32 Marc Augé affirme cette non-opposition dans son livre et éclaircit encore plus les définitions de lieu et d'espace données par Michel de Certeau : « A cette mise en parallèle du lieu comme ensemble d'éléments coexistant dans un certain ordre et de l'espace comme animation de ces lieux par le déplacement d'un mobile […] » . Marc Augé, Non-Lieux : Introduction à une antropologie de la surmodernité, Paris : Éditions du Seuil, 1992, p. 102.
33 Michel de Certeau, , L'invention du quotidien : 1. Arts de faire, nouv. éd., Paris : Gallimard, 1990, p. 173
15
Pour Marc Augé, le lieu est le lieu anthropologique34, « identitaire, relationnel et historique35 » . Le lieu est rempli de sens, il est social et spatial comme la place publique et le plan de la maison; les gens le parcourent ou l'habitent. Au contraire, l'espace est un terme abstrait qui peut désigner, par exemple, la distance entre deux éléments spatiaux ou temporels. Le mot espace est souvent employé par Marc Augé pour essayer de définir aussi bien la notion de lieu que celle de non-lieu.
Dans la vidéo Centro di permanenza temporanea d'Adrian Paci, l'aéroport et l'escalier d'embarquement sont deux espaces, dans le sens de Michel de Certeau36, significatifs pour comprendre la notion d'entre-deux spatial dans l'œuvre d'Adrian Paci.
L'escalier d'embarquement, sur lequel les passagers se regroupent, est un espace particulier dans cet autre espace qu'est la piste d'atterrissage et l'aéroport. L'escalier est une structure physique stable mais précaire pour abriter indéfiniment ce grand groupe de personnes. Il montre les conditions et les possibilités infimes et bien identifiables de mouvement pour les passagers. C'est comme une espèce d'île 37 pour les passagers du possible avion.
En effet, à la fin de la vidéo tous les passagers sont sur l'escalier d'embarquement, aucun d'eux n'est par terre, pas un pied ne touche le sol. Comme si le fait d'être sur l'escalier, en attendant l'arrivée de l'avion et la probabilité d'embarquer, les rapprochait plus à leur objectif de partir Or, si l'escalier est un espace particulier, de quel type d'espace s'agit-il ?
1.1.2 L'escalier comme un espace qui est un non-lieux
L'escalier nous renvoie, aussi bien que le titre de l'œuvre en italien Centro di permanenza temporanea, à l'idée des migrants en situation irrégulière dans des centres de détention38 et aux zones de contrôle des aéroports. Les aéroports et les camps de réfugiés sont signalés par Marc Augé comme des non-lieux39 .
34 Marc Augé, Non-Lieux, op. cit., p. 104
35 Ibid., p. 100
36 Utiliser ici le mot Lieu dans le sens de Marc Augé pour parler de l'aéroport pourrait être confus car l'auteur définit l'aéroport comme un non-lieu.
37 Une espèce d'île ou un petit bateau car la relation avec les images des migrants traversant la Méditerranée ou le fleuve Meriç (Evros en grec) entre la Turquie et la Grèce est évidente. Voir, par exemple, les images dans le documentaire de Michael Richter, Les secrets de la forteresse Europa, vidéo couleur, son, 52:17 min., Allemagne, 2013. Disponible sur le web <http://www.youtube.com/watch?v=bC7qWaTT8TM>
38 Cette idée est aussi mentionnée par Edna Moshenson dans l'essai « Sujet en transit » in Adrian Paci : Transit, op. cit., p. 53.
39 Marc Augé, Non-Lieux, op. cit., p. 100, 101, 102
16
Les non-lieux se définissent par deux caractéristiques qui se complètent et se différencient : ce sont des espaces disposés pour une finalité spécifique comme le divertissement, le commerce, la circulation – ce sont des voies aériennes, des supermarchés, des chaînes d'hôtels et des autoroutes, entre autres – et ils se caractérisent par le rapport que les personnes ont avec ces espaces40 .
Les non-lieux sont opposés à ce que Marc Augé nomme des lieux, même si l'auteur n'attribue ni à l'un ni à l'autre une condition fixe, « une forme pure41 ».
Les non-lieux sont des espaces de passage, de transit, des « points de transit » et des « occupations provisoires42 » selon les mots de Marc Augé. Par contre, ce passage ne se fait pas de la même façon pour tout le monde. Ce passage est conditionné par le statut que la personne qui passe a dans l'espace spécifique par lequel elle transite. Pour que ce passage soit possible – passage compris comme l'« action de passer dans un endroit sans y séjourner43 » - il faut également passer un contrôle d'identité. Marc Augé parle dans son livre d'une « identité partagée des passagers, de la clientèle ou des conducteurs du dimanche. […] d'une identité provisoire […]44 » créée par les non-lieux. Il précise le sujet de l'identité ainsi :
Le passager du non-lieux ne retrouve son identité qu'au contrôle de douane, au péage ou à la caisse enregistreuse. En attendant, il obéit au même code que les autres, enregistre les mêmes messages, répond aux mêmes sollicitations. L'espace du non-lieux ne crée ni identité singulière, ni relation, mais solitude et similitude45
Normalement, l'escalier d'embarquement permet le passage des passagers à l'avion pour voyager quelque part. Dans la vidéo d'Adrian Paci, cet escalier est un espace de passage bloqué étant donné qu'il n'y a pas d'avion et qu'à la fin de la vidéo, les passagers n'ont pas l'air de pouvoir quitter ni l'escalier ni l'aéroport. Comme nous l'avons déjà décrit, dans la dernière image de la vidéo d'Adrian Paci, les passagers restent entassés sur l'escalier et regardent autour d'eux les avions qui décollent et atterrissent.
L'escalier d'embarquement et l'aéroport, dans la vidéo de Paci, sont des espaces de passage entre la situation présente et la situation future des passagers-migrants, entre ce
40 Ibid., p. 118-119.
41 Ibid., p. 101.
42 Ibid., p. 100
43
Oscar Bloch Walther von Wartburg (dir.), Dictionnaire étymologique de la langue française, Paris : Quadrige/PUF, 2002, p. 466. Dans cette citation du dictionnaire étymologique, j'ai changé le mot lieu du dictionnaire par le mot endroit car ce dernier ne pose pas de problème par rapport à la distinction que Marc Augé fait entre la notion de lieu et la notion de non-lieux
44 Marc Augé, Non-Lieux, op. cit.,p. 127.
45 Ibid., p. 130.
17
qu'ils sont et ce qu'ils deviendront. C'est-à-dire, qu'ils sont des espaces de passage dans un sens physique et existentiel.
Les passagers restent sur cet escalier qu'est un non-lieux particulier, comme suspendus dans le moment présent, avec le vide à ses pieds.
Après cette dernière réflexion, nous pouvons nous demander : De quelle manière la notion d'entre-deux spatial éclaire le rapport qui peut exister entre le pays d'origine et le pays d'accueil pour le migrant ? Est-ce que ces deux lieux se superposent dans le fait de les habiter en même temps ? Est-ce que l'entre-deux est une superposition ? Où se situe l'entre-deux ? Les réponses à ces interrogations, ici énoncées, vont se construire peu à peu dans les chapitres suivantes de ce texte.
1. 2 La notion d'entre-deux spatial dans l'œuvre de Francis Alÿs
Comprendre l'idée de l'entre-deux associée à la notion d'espace dans la pratique artistique de Francis Alÿs, c'est un travail complexe tout d'abord parce que l'artiste utilise une diversité de formes46 et de formats pour réaliser ces projets. Chacune de ces formes établissent un espace d'un nature différente. Par exemple, Francis Alÿs fait des actions, des vidéos, des dessins, des peintures, des collaborations avec des peintres du centre-ville de Mexico, des cartes postales, des animations vidéos, etc. Une action réalisée dans la rue peut donner lieu à une documentation vidéo et photographique, et en même temps, il peut y avoir des dessins préparatoires de cette action ou des peintures qui la précèdent, tout ceci pouvant être recomposé, plus tard, pour faire partie d'un autre projet47. Compte tenu de ces constantes mutations et de cette diversité de médiums de l'œuvre de Francis Alÿs, la nature de la notion d'entre-deux spatial n'est pas fixe et nous n'en construirons probablement pas une seule définition, afin d'éviter de déformer le sens de son travail. D'autre part, Francis Alÿs n'a pas fait de déclaration comme celle faite par Adrian Paci à propos de la notion d'entre-deux en relation à sa pratique artistique. Par conséquent, il nous faut analyser plusieurs projets assez divers de Francis Alÿs et proposer une notion d'entre-deux spatial.
46 À propos de cette énonciation, Mark Godfrey affirme : « Les œuvres d'Alÿs n'ont pas de forme matérielle définitive [...] ». Mark Godfrey, « Politique/Poétique : le travail de Francis Alÿs » in Francis Alÿs : A Story of Deception, Londres, Tate Modern ; Bruxelles, Wiels Centre d'Art Contemporain ; New York, The Museum of Modern Art. Tielt : Lannoo, 2010, p. 10.
47 Par exemple, le projet The Last Clown, réalisé en 2000, est une animation en boucle de 2 minutes 44 secondes et aussi des peintures. En 2005, Francis Alÿs reprend le thème de The Last Clown, une personne qui trébuche sur un chien, dans l'installation vidéo Choques. Ibid., p. 155.
18
Pour pouvoir saisir cette notion d'entre-deux spatial chez Francis Alÿs, il faut, premièrement, essayer de comprendre ce qu'est l'espace dans sa pratique artistique.
Francis Alÿs travaille principalement l'espace de la ville. Concrètement, des villes si diverses et complexes, comme : Mexico, Oaxaca, Tijuana, Istanbul, Jérusalem, Paris, Bruxelles, La Havane, Sao Paulo, New York, Copenhague, Los Angeles, Lima, Londres, Venise, entre autres.
Dans la ville, Francis Alÿs marche et fait des actions, parfois en solitude, par exemple dans l'action The Leak et parfois accompagné, comme dans l'action Duett.
L'espace de la ville bouge, change tous les jours. Les interventions de l'artiste dans la ville viennent s'ajouter à ces mouvements. De ce fait, l'espace chez Francis Alÿs n'est jamais immobile. Le commissaire Bruce W. Ferguson dit à propos de l'espace chez Francis Alÿs : « […] l'artiste cherche un espace nouveau, un nouveau modèle, et sa recherche invente spontanément un espace mobile, nomade, à travers duquel passent les richesses de la ville. Cet espace est une terre pleine de doubles sens et de doubles entrées48 . »
Un exemple de la manière dont les interventions de Francis Alÿs s'insèrent dans l'espace de la ville est l'installation vidéo intitulée Choques, réalisée en 2005. Dans cette œuvre, les mouvements des marcheurs du coin, des rues nommées Calle Cinquenta y siete et Calle República de Cuba à Mexico, se conjuguent avec l'action de l'artiste qui tombe à cause d'un chien. Cet accident a été filmé par neuf caméras cachées pour donner neuf lectures différentes. Comme dans la série Déjà vu du même artiste, Choques propose au spectateur de retrouver petit à petit les neufs écrans qui montrent les neuf points de vue différents de cet accident. Ces écrans sont installés dans un même espace d'exposition mais dans des salles différentes. L'intention de cette œuvre est celle d'interroger l'idée que presque tous nos actes sont enregistrés par notre système de gouvernance avec l'intention de nous surveiller selon une stratégie qui se situe entre le contrôle et l'amusement49 .
Ce qui nous intéresse particulièrement de cette action, est de quelle manière le lieu d'intersection de ces rues est altéré à un moment donné par l'action de l'artiste. Le lieu d'intersection de ces rues est altéré à un moment donné aussi bien que la vie quotidienne des habitants du quartier, lesquels ont vu possiblement l'accident ou ont reçu la nouvelle
48 La traduction en français de cette citation est mienne. Le texte en espagnol dans le catalogue, dit : « […] el artista busca un nuevo espacio, un nuevo modelo, y su búsqueda inventa espontáneamente un espacio móvil, nomáda, a través del cual pasan las riquezas de la ciudad. Este espacio es una tierra llena de dobles sentidos y dobles entradas. » Bruce W. Ferguson, « Creaciones inquietas » in Francis Alÿs : Walks = Paseos : travesías, nuevos escenarios, los 90, Mexico : Museo de arte moderno, 1997, p. 60.
49 Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 155.
19
par un voisin qui est venu pour la leur raconter. La rumeur est un autre élément qui traverse l'espace de la ville dans l'œuvre Francis Alÿs et sur lequel nous reviendrons plus tard50 .
Ainsi, les actions de Francis Alÿs intensifient le tissu de l'espace de la ville intervenu. Sur ce point, l'action Placing Pillows, peut nous orienter pour analyser comment les interventions de Francis Alÿs intensifient le tissu de l'espace de la ville.


20
50 Chapitre 3 « L'entre-deux du voyage et de l'exil ».
Image 7: Francis Alÿs, Choques, Mexico 2005
Image 6 : Francis Alÿs, Choques, Mexico 2005, Installation vidéo à neuf canaux
1.2.1 Placing Pillows
Sur Placing Pillows (Plaçant des oreillers) il y a peu d'information. Même si la description de cette œuvre dans ce texte se limite à la seule photo connue, nous considérons que cette action est un élément d'appui significatif pour commencer à construire l'idée de notion d'entre-deux spatial dans la pratique artistique de Francis Alÿs Placing Pillows est une action réalisée par Francis Alÿs dans le cadre d'une de ses promenades dans le centre de la ville de Mexico, en 1990. Dans cette intervention, l'artiste a placé des oreillers dans les trous sans vitres des fenêtres brisées par le dévastateur tremblement de terre de 1985 à Mexico. L'action de Francis Alÿs a été recueillie par le moyen d'une documentation photographique, laquelle se réduit à une seule photo en noir et blanc, accompagnée d'un texte écrit par l'artiste qui dit : « Pendant que je marchait par le centre de México, j'ai placé des oreillers dans les cadres des fenêtres casées. Mexico, D.F., 199051 ».
La documentation photographique de Placing Pillows montre des oreillers52 qui bouchent littéralement certains trous des vitres brisées par le tremblement de terre. Il y a une fenêtre avec quelques vitres, il y a aussi un trou et un oreiller qui bouche un autre trou. A partir de cette photo, nous pouvons imaginer être à l'intérieur et sentir l'air et voir la lumière qui rentrent simultanément par le trou et par celui qui est bouché avec l'oreiller. D'une part, avec ce geste, Francis Alÿs a essayé de guérir les ruines des bâtiments. Selon Bruce W. Ferguson, Francis Alÿs cherchait à faire respirer de nouveau les bâtiments abandonnés53. À l'époque du désastre, des mouvements de solidarité se sont formés entre les citoyens pour venir en aide aux victimes, à l'encontre d'un gouvernement incompétent qui n'a pas pu faire face à la situation54. D'autre part, l'action de boucher un trou d'une fenêtre avec un oreiller crée une zone intermédiaire entre le dedans et le dehors. Le commissaire mexicain Cuauhtémoc Medina dit à propos de cette action : « De telles ''situations sculpturales'' fusionnent les espaces public et domestique et diffusent des
51 La traduction en français de cette citation est mienne. Le texte en espagnol dans le catalogue, dit : « Mientras caminaba por el centro de la Ciudad de México, coloqué almohadas en los marcos de ventanas rotas. México, D.F., 1990 ». Francis Alÿs : Walks = Paseos, op. cit., p. 14.
52 La seule photo en noir et blanc, connue de cette action, montre un seul oreiller dans le trou d'une seule fenêtre mais le lecteur des catalogues de Francis Alÿs peut, à partir des descriptions écrites de cette intervention, imaginer que plusieurs fenêtres avec leurs vitres brisées et bouchées par des oreillers ont existé.
53 Bruce W. Ferguson, « Creaciones inquietas », op. cit., p. 54.
54 Selon Mark Godfrey, l'action de Francis Alÿs voulait signaler la négligence des autorités à réhabiliter les bâtiments ravagés par le tremblement de terre. Mark Godfrey, « Politique/Poétique : le travail de Francis Alÿs », op. cit., p 17.
21
passages oniriques dans le quotidien55 »
L'interception des éléments qui composent l'action de Francis Alÿs, c'est-à-dire le parcours de l'artiste à travers les rues du centre-ville et la permanence des oreillers sur le châssis des fenêtres sont tous des éléments instables, hasardeux et éphémères. Ces éléments se conjuguent dans un espace et dans un temps précis et produisent une fusion entre l'espace public et l'espace domestique – fusion qui est proposée par Cuauhtémoc Medina dans sa citation. Il s'agit d'une zone intermédiaire que nous pouvons nommer entre-deux spatial et qui survient, dans ce cas, fragile et instable56. Cet entre-deux spatial est entre le dedans et le dehors. L'espace est fermé, bouché par un oreiller mais en même temps il est ouvert Ce qui en résulte c'est un entre-deux de refuge, de guérison provisoire pour les passants du centre-ville de Mexico.
Pour continuer de comprendre ce qu'est l'espace dans la pratique artistique de Francis de Alÿs et construire ainsi une notion d'entre-deux spatial, il faudra considérer que dans ses projets, il y a toujours une action principale qui se réalise. Cette action principale est exécutée par l'artiste ou par d'autres personnes souvent dans l'espace de la ville et elle est fréquemment l'action de marcher. D'autres fois, cette action action principale peut être une autre action qui se fait pendant la marche.
Le conservateur Thierry Davila, dans son livre Marcher, créer : Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle, analyse la pratique de la marche dans la ville à partir des œuvres de trois artistes : Gabriel Orozco, Francis Alÿs et le laboratoire Stalker. Il affirme à propos des enjeux des actions dans la ville : « L'action est donc avant tout une insertion dans un tissu urbain, dans une circulation, elle est une façon de participer à une vitesse et ne représente pas une totalité, un système, qui entre en rapport ou qui fait face à une autre entité organisée (la mégapole)57 »
55 Placing Pillows est le premier essai de l'artiste à faire de l'action de marcher un acte sculptural. Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 49.
56
À propos de la première époque de l'artiste à Mexico, ses constructions sont définies par Cuauhtémoc Medina comme : « […] des assemblages fragiles caractérisés par une articulation précaire. » Ibid., p. 47.
57 Thierry Davila, Marcher, créer. Déplacements, flâneries, dérives dans l'art de la fin du XXe siècle, Paris : Éditions du Regard, 2002, p. 80.
22

23
Image 8 : Francis Alÿs, Placing Pillows, Mexico, 1990, Documentation photographique d'une action
1.2.2 Le déplacement dans l'espace : marcher chez Francis Alÿs
As Long as I'm Walking de 1992 est un panneau de polystyrène installé dans le studio de Francis Alÿs à Mexico, où il a écrit tout ce qu'il ne doit pas faire pendant qu'il marche. Par exemple : ne pas choisir, ne pas fumer, ne pas faire, ne pas pleurer, ne pas demander, ne pas changer, ne pas répéter, ne pas se souvenir, etc. L'artiste a réalisé ce panneau peu de temps après son arrivée au Mexique. Selon le commissaire Russell Ferguson, c'était une époque dans laquelle Francis Alÿs était encore plus un observateur qu'un artiste en action dans son nouveau contexte58 . Marcher pour Francis Alÿs est en même temps une forme de réflexion, un acte de résistance sociale, dans une époque où la vitesse conditionne notre vie et aussi une façon de rassembler des images et des perceptions de son environnement pour construire ses récits et développer ses histoires59. À propos de cette idée et de son travail en relation avec la ville l'artiste affirme :
… je passe beaucoup de temps à marcher par la ville. […] Fréquemment le concept initial d'un projet se concrétise pendant que je marche. Comme artiste ma position est la même que celle d'un passant – j'essaie constamment de me situer dans un environnement qui bouge. Mon travail est une série de notes et d'orientations. L'invention du langage va de pair avec l'invention de la ville. Chacune de mes interventions est un autre fragment de l'histoire que je suis en train d'inventer et de la ville que je suis en train de créer. Dans ma ville tout est provisoire. Mexico, 199360 .
Francis Alÿs marche et fait des actions dans la ville, parfois seul, comme dans les projets : The Collector (Colector), Magnetic Shoes (Zapatos Magnéticos), The Leak de 1995 et The Leak (version colonial blue) du 2003, Fairy Tales, Paradox of Praxis 1 (Sometimes Doing Something Leads to Nothing), The Loop, Gringo, The Green Line, Raillings, Retoque/Painting, entre autres. Parfois, il marche accompagné, comme dans les
58 Russell Ferguson, Francis Alÿs : Política del Ensayo (commissaire : Russell Ferguson), Bogota : Biblioteca Luis Angel Arango del Banco de la República, avec le soutien du Hammer Museum à Los Angeles, 2009, p. 10.
59 Ibid., p. 9-10 et Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 52.
60
La traduction en français de cette citation est mienne. La citation complète en espagnol dit : « … paso mucho tiempo caminando por la ciudad. Desde que colaboro con talleres, mi estudio parece una bodega u oficina. Con frecuencia el concepto inicial de un proyecto se concretiza mientras camino. Como artista mi posición es igual a la de un transeúnte – intento constantemente situarme en un entorno que se mueve. Mi trabajo es una serie de apuntes y guías. La invención del lenguaje va de la mano con la invención de la ciudad.
Cada una de mis intervenciones es otro fragmento de la historia que estoy inventando y de la ciudad que estoy creando. En mi ciudad todo es provisional. México, D.F., 1993. » Francis Alÿs : Walks = Paseos, p. 15.
24
projets : Duett, Doppelgänger : Untitled (Bandera). D'autres fois, ce sont les autres qui marchent dans la ville, comme dans les projets : Ambulantes, Barrenderos, The Last Clown, When Faith Moves Mountains (Cuando la fé mueve montañas), The Modern Procession, The Nightwatch, Guards, Bridge/Puente.
Il y a des projets où l'action de marcher est le principe essentiel, comme par exemple dans l'action The Leak (La Fuite)
The Leak a plusieurs versions. La première, réalisée à Sao Paulo en 1995 dans le cadre de l'exposition El soplón à la Galería Camargo Vilaça, et la deuxième version, The Leak (version colonial blue), réalisée à Paris en 2003 et présentée dans l'exposition The Leak au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris la même année.
Dans la première version de The Leak de 1995, Francis Alÿs part de la galerie, se perd dans le quartier en portant à la main un pot de peinture percé et revient à la même galerie aidé par la ligne de peinture qu'il a laissée par terre. Il part d'un point, la galerie, et il revient au même point61. Le déplacement de l'artiste et la ligne qu'il a laissée sur le sol marquent un espace qui se ferme sur lui-même, à la manière d'un circuit.
Dans la deuxième version de The Leak (version colonial blue) de 2003, l'artiste fait un déplacement dans la ville, de nouveau, en portant à la main un pot de peinture bleue percé. L'action de Francis Alÿs est réalisée et enregistrée en vidéo le 17 octobre 2003. Il commence sa marche au Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris au 11, Avenue du Président Wilson, au 16e arrondissement, et va jusqu'au Réfectoire des Cordeliers au 15, Rue de l'École de Médecine, au 6e arrondissement. À la fin, l'artiste rentre au Réfectoire et accroche le pot de peinture vide au mur blanc de l'espace d'exposition62 .
Contrairement à la première version, dans The Leak (version colonial blue), le déplacement de l'artiste et la ligne laissée sur le sol vont d'un point à un autre point : du Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris au Réfectoire des Cordeliers. C'est-à-dire que l'espace marqué par la ligne de peinture ne se ferme pas sur lui-même.
L'action The Leak est un déplacement, dans lequel l'artiste laisse une trace, une ligne irrégulière de peinture sur le sol pendant qu'il marche. Le déplacement de l'artiste et la ligne laissée sur le sol marquent l'espace de la ville.
L'intention de Francis Alÿs pour les versions de ce projet est de faire l'essai « […] de produire un récit au moyen d'une dépense ou d'un gaspillage matériel63 . » Un récit produit
61 Avec ce retours à la galerie, l'artiste montre la relation et la dépendance paradoxal de l'art contemporain et les institutions de l'art. Mark Godfrey, « Politique/Poétique : le travail de Francis Alÿs », op. cit., p. 22.
62 Francis Alÿs, The Leak (version colonial blue), vidéo couleur, son, 14:41 min., Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, Paris, 2003. Disponible sur le web <http://www.francisalys.com/public/leak.html>.
63 Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 66. Selon Thierry Davila, dans The Leak, Francis Alÿs
25
dans le sens d'une trace dans la ville et dans la mémoire des habitants des quartiers où l'action se déroule.
Nous reviendrons sur l'idée de récit dans le chapitre 2, « L'entre-deux comme frontière ».
reprend le dripping de Jackson Pollock avec ces caractéristiques principales : « abandon de la peinture à sa propre matérialité, à sa propre pesanteur et liquidité », « déplacement du corps entier, et pas simplement de la main ou du bras » et « traitement horizontal de la toile ». Ce dernier élément est amplifié par Francis Alÿs à travers son déplacement dans la ville. Thierry Davila, Marcher, créer, op. cit., p. 103.

26
Image 9 : Francis Alÿs, The Leak, São Paulo, 1995, Documentation photographique d'une action
1.2.3
La ligne dans l'espace
Dans les deux versions de The Leak, décrites antérieurement, Francis Alÿs trace une ligne irrégulière de peinture sur le sol de la ville pendant qu'il marche, aussi bien que dans l'action The Green Line, réalisée à Jérusalem en 2004. Le sociologue brésilien Laymert Garcia dos Santos réfléchit à l'action de tracer une ligne dans la pratique artistique de Francis Alÿs, dans son essai « Devenir autre afin d'être soi : Francis Alÿs et la frontière » du catalogue de l'exposition Francis Alÿs : A Story of Deception de 2010 réalisée à Londres, Bruxelles et New York. Laymert Garcia dos Santos liste les projets dans lesquels Francis Alÿs trace une ligne et signale ce qui caractérise chaque ligne. Par exemple : dans l'action The Loop, la ligne connecte les villes de Tijuana et San Diego en marquant toutes les villes traversées par l'artiste pour éviter le passage de la frontière entre le Mexique et les États-Unis ; dans l'action Fairy Tales, la ligne bleue est produite par le pull porté par l'artiste, lequel se défait peu à peu durant le déplacement de Francis Alÿs par les rues de Mexico et de Stockholm ; dans To RL de 1999, la ligne sur le sol est produite par des déchets balayés par un balayeur de rue ; dans When Faith Moves Mountains, la ligne est
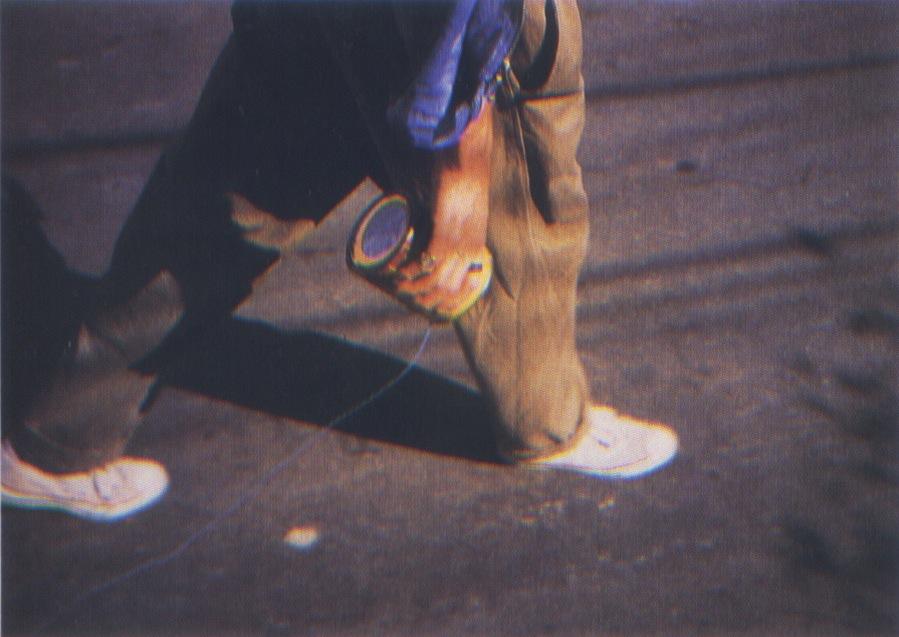
27
Image 10 : Francis Alÿs, The Leak, Paris, 2003, Documentation photographique d'une action
conformée par des étudiants qui font bouger une dune de sable dans les alentours de Lima ; dans The Nightwatch, la ligne est tracée par le déplacement d'un renard dans la National Portrait Gallery de Londres ; dans Bridge/Puente, la ligne est formée par des bateaux cubains et américains qui forment un pont entre les deux pays.
Le marcheur Francis Alÿs laisse une ligne dans la ville, parfois elle est une trace de peinture, d'autres fois elle est invisible aux yeux ou elle se laisse voir dans le déplacement même de l'artiste. Pour Laymert Garcia dos Santos, l'œuvre de Francis Alÿs peut se condenser dans le fait de tracer une ligne64. Il qualifie les lignes des actions de Francis Alÿs de multiples en raison des divers connexions et significations qu'elles procurent. L'auteur déclare que : « […] tracer une ligne constitue l'équivalent de trouver une faille, une fissure, [...], de reconfigurer l'espace-temps avec une nouvelle perspective, en l'ouvrant à celleci65 . » Selon Laymert Garcia dos Santos, quand Francis Alÿs trace une ligne sur le sol en marchant, il s'agit de dessiner une ligne sur une surface et aussi d'une possibilité pour le passant et pour l'artiste de parcourir la ville d'une manière différente. Faire la ligne et suivre la ligne peuvent être des expériences où notre relation à l'espace et au temps se modifient et c'est dans ce sens qu'une nouvelle perspective s'ouvre.
Francis Alÿs se déplace, trace la ligne et tisse une autre couche sur le tissu de l'espace de la ville dans un moment précis, dans un instant du quotidien de la ville. Il faut entendre l'idée de tisser dans le sens de tissage, de fabriquer, de construire peu à peu, pas à pas une trame complexe sur et dans la réalité de la ville que l'artiste parcourt. Nous entendons ici par le terme de couche l'étendue de quelque chose66. L'artiste tisse une trame complexe, une autre couche avec des éléments très divers qui composent la réalité de la ville dans un moment donné. Des éléments visibles et invisibles, tangibles et intangibles comme la lumière, les bruits, les sons, le mouvement du corps du marcheur et des passants, la ligne de peinture sur le sol, la poussière, le temps, l'espace, etc.
Sur ce point, nous pouvons revenir à notre sujet de recherche et nous demander comment le déplacement de l'artiste et la ligne laissée sur le sol qui marquent l'espace de la ville peuvent être articulés à la notion d'entre-deux spatial?
Pour essayer de comprendre cette articulation, considérons maintenant l'action Duett, laquelle propose un autre type de déplacement dans la ville
64 Laymert Garcia dos Santos, « Devenir autre afin d'être soi : Francis Alÿs et la frontière » in Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 188.
65 Ibid., p. 189.
66 La définition étymologique de couche est attachée à celle du verbe coucher, elle dit : « ''étendue horizontale de quelque chose'' ». Oscar Bloch, Walther von Wartburg, Dictionnaire Étymologique de la langue française, op. cit., p. 162
28

29
Image 11 : Francis Alÿs, Fairy Tales, Mexico, 1995, Documentation photographique d'une action
Duett
Duett (Duo) est un autre projet dont la marche est essentielle. Duett est réalisé en collaboration avec l'artiste belge Honoré d'O à Venise en 1999, dans le cadre de la première participation de Francis Alÿs à la Biennale de Venise, en dehors du programme officiel.
Les artistes sont arrivés dans la ville séparément, Francis Alÿs en train et Honoré d'O en avion. Les deux artistes se sont promenés dans la ville jusqu'à ce qu'ils se retrouvent. Chacun portait une moitié d'un instrument musical, un tuba hélicon. Ils étaient habillés avec un pantalon obscur et une chemise blanche à manches longues ; sur le dos, chaque chemise portait une lettre en rouge. Francis Alÿs portait la lettre A sur sa chemise et la partie supérieure du tuba hélicon. Honoré d'O portait la lettre B sur la sienne et la partie inférieure de l'instrument.
Ils se sont retrouvés sur une place de Venise après trois jours de déambulation. À ce moment-là, ils ont assemblé l'instrument. Honoré d'O a joué une note aussi longtemps que son souffle le lui permettait, Francis Alÿs applaudissait tant que Honoré d'O tenait la note. Puis, A et B repartaient chacun de leur côté. L'action a été documentée en vidéo67 et en photos. Dans Duett, les déplacements des personnages A et B et leur rencontre dans la ville de Venise forment des lignes invisibles dans l'espace. A et B ont des points de départ différents, il y a un point de rencontre, de croisement, qui n'est pas prévu. Ce point de rencontre est quelque part dans la ville.
Après, cette rencontre, A et B repartent chacun de leur côté. Francis Alÿs et Cuauhtémoc Medina énoncent de quoi il s'agit : « L'action implique un récit de fracture classique qui construit une situation, introduit des personnages, développe un drame de division ou de conflit et comporte une morale en termes de réunification des objets, des corps sociaux et des territoires68 » Ce qui veut dire que Duett est construit à partir de trois moments : une introduction, un climax et une conclusion ou un dénouement. La réunification est celle des personnages A et B, des deux parties de l'instrument, de la musique jouée et les applaudissements, des déambulations. Tout ceci est rassemblé dans un même espace et à un même moment.
67
68
Francis Alÿs, Duett, en collaboration avec Honoré d'O, vidéo couleur, son, 6:48 min., Venice, 1999. Disponible sur le web <http://www.francisalys.com/public/duett.html>.
Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 99.
1.2.4
30

31
Image 12: Francis Alÿs, Duett, Vénise, 1999
Nous pouvons donc nous demander où se situe et en quoi consiste l'entre-deux dans cette œuvre ?
Thierry Davila conclut dans la dernière partie du chapitre de son livre consacré à Francis Alÿs :
[…] les actions d'Alÿs, perturbations légères et poétiques de l'espace urbain, négocient en permanence avec l'imperceptible. […] inventent une réalité fugace dont les séquences relevées par l'artiste maintiendront l'impact vivace. L'art est une façon de proposer à l'organisme – la mégapole – quelque chose qui parcourt son tissu à un moment donné 69 […].
69 Thierry Davila, Marcher, créer, op. cit., p. 114.

32
Image 13: Francis Alÿs, Duett, Vénise, 1999, en collaboration avec Honoré d'O, Documentation vidéo et photographique d'une action
L'action Duett est composée de plusieurs rencontres, lesquelles sont aussi des passages d'une situation à une autre. Par exemple, le passage du moment où A et B se réunissent au moment où ils se séparent. L'entre-deux se situe possiblement comme un instant dans ces moments de passage. L'idée de « perturbations » dans la citation de Thierry Davila nous fait penser à la notion d' « espace d'un instant » mentionnée par Francis Alÿs dans la définition de Poétique et Politique70 du catalogue de l'exposition Francis Alÿs : A Story of Deception. Francis Alÿs affirme vouloir produire un bouleversement, lequel permet une révision de la réalité d'une situation donnée. Ce bouleversement produit une instabilité et « l'espace d'un instant », qui est « une vision différente de la situation, comme vécue de l'intérieur71 ».
Ainsi, nous pouvons nous demander : l'entre-deux est-il proche de cette perturbation, de ce déséquilibre généré par les actions de Francis Alÿs ?
Est-ce que l'entre-deux spatial serait ce moment où le spectateur se situe entre sa réalité quotidienne et la situation générée par l'œuvre de Francis Alÿs ?
1.2.5 D'autres déplacements dans l'espace chez Francis Alÿs : sans marcher
Auparavant, nous avons affirmé que Francis Alÿs travaille principalement l'espace de la ville. Ses actions décrites et analysées se développent dans la rue, dans l'espace public 72 . Dans sa pratique artistique il y a aussi des projets dans lesquels les actions se font dans l'espace domestique, dans des espaces intérieurs ou dans des espaces qui ne sont pas clairement identifiables. Par exemple, dans des peintures comme : La leçon de musique, 2000, La Théorie des ensembles, 1996, The Liar, The Copy of the Liar, 1994 et la vidéo Children's Game #14 : Piedra, Papel y Tijeras, 2013.
La leçon de musique est une peinture sur toile à l'huile et à l'encaustique. Elle montre deux hommes habillés en costume, assis face à face à table, avec leurs deux bras sur la table.
Entre les deux hommes, il y a une feuille de papier, en position verticale. La feuille est suspendue dans l'air par le souffle des deux hommes. Ce souffle se rend visible par une
70
« Francis Alÿs : A à Z », Sélection de Klaus Biesenbach et Cara Starke, trad. Zoé Derleyn in Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 39.
71 Francis Alÿs dit à propos de l'espace d'un instant : « Je pense que l'artiste peut intervenir en provoquant une situation dans laquelle vous vous éloignez subitement de votre quotidien et regardez les choses sous un angle différent, ne serait-ce que l'espace d'un instant. » Ibid., p. 39.
72 Je reprend le terme d'espace public dans le sens de la distinction que Cuauhtémoc Medina et Francis Alÿs font entre l'espace public et l'espace domestique. Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 49.
33
forme triangulaire de couleur rose clair qui sort de la bouche de chacun. La feuille est translucide, comme un papier calque, elle a un aspect fragile. Le spectateur peut presque sentir la subtile vibration de la feuille suspendue dans l'air.
Pour Russel Ferguson, commissaire de l'exposition Francis Alÿs : Política del Ensayo, l'idée implicite dans cette œuvre consiste à montrer que soutenir en l'air la feuille « exige une coopération constamment rééquilibrée73 ».
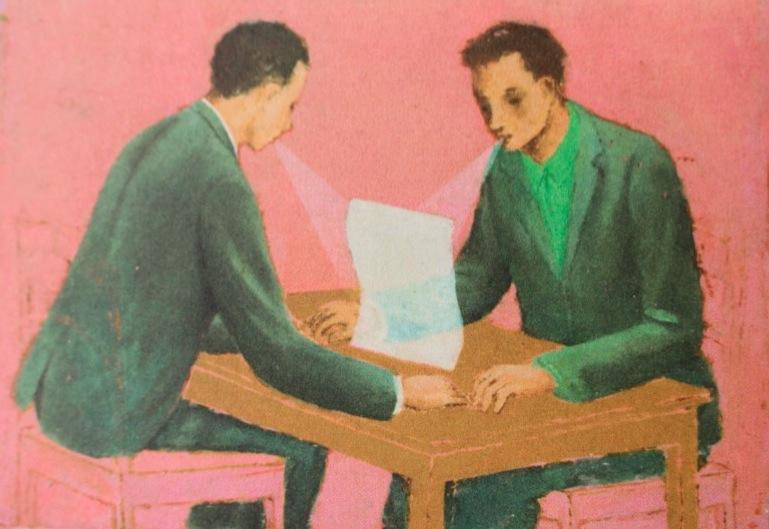
L'espace ainsi construit, à travers cette action coordonnée des deux hommes, existe dans un moment déterminé, c'est un instant pendant lequel les deux hommes vont continuer à souffler pour maintenir la feuille verticalement suspendue dans l'air. Instant fragile qui se révèle par la peinture sur toile presque immuable. Peindre cette action c'est rendre un instant intemporelle, une fiction d'éternité74
Image 14 : Francis Alÿs, La leçon de musique, 2000, Huile et encaustique sur toile, 21,6 × 27,9 cm
73 Je cite ici la phrase complète du texte en espagnol : « La hoja es frágil y sostenerla exige una cooperación constantemente reequilibrada.» Je traduis au français à partir du texte en espagnol. Russell Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », in Francis Alÿs : Política del Ensayo (commissaire : Russell Ferguson), Bogota : Biblioteca Luis Angel Arango del Banco de la República, avec le soutien du Hammer Museum à Los Angeles, 2009, p.16.
74 Idée de ma directrice de recherche Claire Fagnart dans la séance de travail du 7 février 2014 à Paris.
34
Cette même idée est ostensible dans les peintures diptyques de la série La Théorie des ensembles75 réalisées en peinture et cire sur toile en 1996. Les peintures montrent, dans chacune des toiles, un homme habillé en costume assis sur une chaise de bois. La couleur du fond des peintures est rouge.
Chaque homme regarde une corde ou un filet qu'il tient entre les doigts d'une de ses mains. La corde passe également par l'arrière de sa tête. En effet, la corde à deux points d'appui : la nuque de l'homme et les doigts de sa main.

Le visage des hommes dans cette version de Francis Alÿs76 n'est pas travaillé en détail, mais par la position de la tête, le spectateur peut reconnaître un homme concentré dans l'action de soutenir la corde77 .
75 Une autre œuvre de Francis Alÿs, à l'huile et graphite collé sur papier Vellum, apparaîtra en 1999 sous le titre Untitled (La Théorie des ensembles)
76 Francis Alÿs a fait une première version de cette série et autant d'autres et il les a données à plusieurs peintres d'enseignes du centre-ville de Mexico pour qu'ils fissent une nouvelle version. Le processus de cette commande et la réadaptation de la première version de l'artiste peut se voir dans la vidéo Francis Alÿs, Set Theory, vidéo couleur, son, 13:04 min., Mexico, 1997. Disponible sur le web <http://www.francisalys.com/public/theory.html>.
Thierry Davila parle en détail de la peinture de Francis Alÿs en relation à ce qu'il nomme comme peinture rotulista dans : Thierry Davila, Marcher, créer, op. cit., p. 87 et 90. Voir aussi Sign-Painters Projet (Rotulistas) in Russell Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », op. cit., p. 59.
77 Cet objet que dans certains peintures se présente comme une espèce de corde est un collier de perles dans la série de peintures Set Theory réalisée en 2005. Le titre Set Theory apparaît déjà en 1996. Une petite figure assise dans un verre d'eau mis à l'envers fait partie de cette série. Laymert Garcia dos Santos signale ce collier de perles comme une autre ligne tracée par l'artiste, il l'a définit comme « la ligne du collier absent/présent ». Laymert Garcia dos Santos, « Devenir autre afin d'être soi : Francis Alÿs et la frontière », op. cit., p. 188.
35
Image 15 : Francis Alÿs, La Théorie des ensembles, 1996, Diptyque, peinture et cire sur toile, 26,5 × 21 cm chaque
L'espace ici construit est comme dans la peinture antérieurement décrite, La leçon de musique, un espace créé par l'action soutenue des personnages dans un temps déterminé, un moment que la peinture rend presque permanent.
La documentation photographique de l'exposition de 1999 à la Galerie Lisson à Londres, montre que les tableaux ont été accrochés sur un mur blanc, l'un à côté de l'autre, en laissant un petit espace de mur blanc entre eux.

Image 16 : Francis Alÿs, Untitled, 1997, au premier plan et La Théorie des ensembles, 1996
Ce type d'espace ne se limite pas aux peintures. Dans la vidéo intitulée Children's Game #14 : Piedra, Papel y Tijeras78 (Jeu d'enfants #14 : Pierre, Feuille et Ciseaux) de 2013, l'espace est construit aussi à partir d'une action soutenue qui réclame la participation fréquente et balancée de deux parties.
Pendant deux minutes et cinquante et un secondes, la vidéo montre les ombres des mains 78 Cette vidéo fait partie de la série de l'artiste intitulé Children's Games (Jeux d'enfants), composée de 14 vidéos. La série rassemble des jeux d'enfants qui transmettent des histoires culturelles de génération en génération. Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 164. Pour consulter toute la série cf. Francis Alÿs, Children's Games, vidéos (durées différentes), lieux variés, 2008- aujourd'hui. Disponible sur le web <http://www.francisalys.com/children-games.html>.
36
de deux enfants en train de jouer « Piedra, Papel y Tijeras » sur un mur qui n'est pas lisse. Ce jeu enfantin, réalisé avec les mains, présente trois symboles : la main fermée comme un poing c'est la pierre; la main fermée avec la paume vers le bas et tous les doigts étendus c'est la feuille ; le doigt du milieu et l'index formant un V ce sont les ciseaux. L'objectif du jeu est de vaincre son adversaire à partir des trois coups possibles : la pierre casse les ciseaux, les ciseaux coupent la feuille et la feuille enveloppe la pierre. Ainsi les deux joueurs choisissent chaque fois une des trois options possibles. Celui qui gagne trois, quatre ou cinq fois est le vainqueur. Les participants peuvent utiliser des mots ou des jeux psychologiques pour tenter d'influencer son rival.

Dans la vidéo, les mains des enfants s'ouvrent et se ferment en même temps que leurs voix révèlent l'enthousiasme et la joie du jeu.
Dans toutes les actions des peintures et de la vidéo, décrites antérieurement, il y a aussi un déplacement dans l'espace, déplacement dans le sens de développement. C'est-à-dire que l'espace n'est pas un espace statique, c'est un espace qui se développe dans le temps de l'action et par l'action des personnages. Ce développement de l'espace est un mouvement qui s'oriente plutôt vers le fond, vers une profondeur. Ici, ce n'est plus l'espace public de la ville, c'est l'espace domestique où les actions des personnages sont au premier plan L'espace construit est proche de la définition antérieurement cité de Michel de Certeau79 . 79 Cf. p. 15.
37
Image 17 : Francis Alÿs, Children's Game #14: Piedra, Papel y Tijeras, Mexico 2003, Vidéo, 2' 51''
Et similaire aussi à la figure de la ligne travaillée par le sociologue brésilien Laymert Garcia dos Santos à propos des œuvres de Francis Alÿs, laquelle peut servir d'appui pour éclaircir notre idée : l'espace se développe par les lignes qui le traverse, et lesquelles se chevauchent. Ce sont des « lignes de pensées » et des « lignes d'action collective80 ». L'auteur caractérise les diverses lignes et affirme:
[…] la ligne peut aussi bien être créée que trouvée, dessinée, sculptée ou simplement conçue, faite ou défaite, visible ou invisible, continue ou interrompue, affirmative ou négative, intuitive ou l'objet d'une réflexion, individuelle ou collective, […]. Elles constituent toujours des actualisations entre l'homme et son environnement81 [...].
1.2.6 L'entre-deux de l'espace comme une ouverture
Il faut considérer les conclusions précédentes pour essayer de construire un entre-deux spatial dans la pratique artistique de Francis Alÿs. Comment nous l'avons dit plus haut, dans l'action Placing Pillows, l'espace des fenêtres est fermé, bouché par un oreiller mais en même temps il est ouvert ; Francis Alÿs essaie de produire avec ses interventions un moment de bouleversement où le spectateur reconsidère sa réalité ; que dans les actions de Francis Alÿs et de ses personnages il y a un déplacement dans l'espace, qu'est un espace qui se développe dans le temps de l'action et par l'action des personnages82 dans un moment donné et que ce déplacement de l'espace est un mouvement qui s'oriente plutôt vers le fond, vers une profondeur.
Ces dernières réflexions nous emmènent à la question suivante :
L'entre-deux spatial chez Francis Alÿs est-il une ouverture dans l'espace et le temps du quotidien de la ville expérimentée par le spectateur?
L’entre-deux spatial comme une ouverture dans l'espace de la ville peut se repenser, dans ce cas, à la lumière des réflexions sur la notion d'espace faites par Martin Heidegger. Nous reprendrons ces idées qui nous inspirent à notre compte et lesquelles nous proposent d'autres questionnements à propos de la notion d'entre-deux spatial.
80 Laymert Garcia dos Santos, « Devenir autre afin d'être soi : Francis Alÿs et la frontière », op. cit., p.188.
81 Ibid., p.188.
82 Pour les actions des personnages de Francis Alÿs, j'ai pris précisément les exemples des deux peintures et une vidéo de la série Children's Game, dans lesquels j'ai trouvé plus clairement un approche à la notion d'entre-deux spatial chez Francis Alÿs, pourtant il y a d'autres peintures et d'autres vidéos où nous pouvons analyser et trouver aussi un approche à cette notion.
38
Le philosophe allemand s'interroge sur la notion d'espace en lui-même et dans sa réponse nous trouvons l'idée d'ouverture :
Qu'est-ce donc que l'espace en tant qu'espace ? Réponse : l'espace espace. Espacer signifie : essarter, dégager, donner du champ-libre, de l'ouverture. Dans la mesure où l'espace espace, il libère le champ-libre et avec celui-ci offre la possibilité des alentours, du proche et du lointain, des directions et des frontières, la possibilité des distances et des grandeurs83
Cette question sur l'espace et l'idée d'ouverture, reprise à Martin Heidegger, se développe dans un contexte très précis : ce texte sur ''art, sculpture et espace'' est une allocution faite par le philosophe pour l'inauguration de l'exposition du sculpteur allemand Bernhard Heiliger à la Galerie Erker, dans la ville de Saint Gall, en Suisse en 1964. Dans ce texte, Martin Heidegger réfléchit, entre autres, à propos de l'espace mis à part du corps84 car il affirme que depuis la pensée classique et jusqu'à l'époque moderne, l'espace est représenté à partir du corps85
Dans sa réflexion, il fait la distinction entre les deux mots qu'en allemand désigne le mot français Corps : der Körper et der Leib Le premier mot, der Körper, se comprend comme une chose qui occupe un espace : une pierre, une lampe, un corps humain. Le deuxième mot, der Leib, est compris comme le corps des espèces vivantes dans sa dimension existentielle et ne s'utilise pas pour les choses comme une pierre ou une lampe. Martin Heidegger utilise ces deux mots, pour signaler que l'homme n'est pas circonscrit par la superficie de son corps (der Körper), mais que l'homme vit son corps dans l'espace « (''corporer, leiben86'') ». Il exprime aussi cette idée en utilisant l'expression Leibphänomen, traduit au français comme « phénomène corporant87 ».
Selon Martin Heidegger, l'homme est dans l'espace et il agence l'espace88, en se disposant lui-même et les choses dans « l'ouverture », dans le « champ-libre » de l'espace : « L'homme vit (lebt89) tandis qu'il corpore (leibt) et est ainsi admis dans l'ouvert de l'espace et, par cette admission, séjourne déjà par avance en rapport avec ses prochains et avec les
83 Martin Heidegger, Remarques sur art – sculpture – espace, trad. de l'allemand Didier Franck, Paris : Éditions Payot & Rivages, 2009, p. 24.
84 Ibid., p. 23.
85 Ibid., p. 21.
86 L'auteur utilise cette parenthèse. Dans celle-ci le mot corporer apparaît en italique. Ibid., p. 26.
87 Ibid., p. 27.
88 Dans la traduction du texte de Martin Heidegger, au lieu du verbe agencer, les verbes utilisés sont aménager, concéder et accorder ; en allemand le verbe est einräumen. Ibid., p. 25
89 Lebt est le verbe en allemand leben, vivre en français. Leibt (à la troisième personne du singulier) vient du substantif der Leib que Martin Heidegger conjugue comme s'il était le verbe leiben, lequel n'existe pas en allemand.
39
choses90 »
Ici, l'ouvert de l'espace, aussi nommé comme ouverture est conçue par Martin Heidegger comme appartenant à l'espace en lui-même, même si l'espace a besoin de l'homme pour faire du champ-libre, pour espacer91
Le philosophe français, Didier Franck commente dans le texte « Le séjour du corps92 », la réponse de Martin Heidegger à sa question sur le propre de l'espace : l'espace espace, en allemand der Raum räumt. Le verbe allemand räumen signifie espacer, dégager quelque chose. Didier Franck reprend la définition du dictionnaire Grimm pour réfléchir à cette proposition de Martin Heidegger : espacer « signifie originairement faire un espace, c'està-dire une clairière dans les bois (einen Raum, d.h. eine Lichtung im Walde schaffen93) ».
En effet, la phrase : Eine Lichtung im Walde schaffen (en français : Créer une clairière dans le bois) nous permet de mieux saisir l'idée d'ouverture de l'espace dans l'œuvre de Francis Alÿs, par exemple la zone intermédiaire nommée dans la réflexion sur l'action Placing Pillows. Et aussi de considérer que c'est l'action de l'artiste qui permet cette ouverture dans l'espace. Thierry Davila confirme cette idée quand il caractérise l'action de marcher comme « cette façon particulière d'ouvrir un espace et un sujet94 » dans l'œuvre de Francis Alÿs aussi bien que dans celle du groupe Stalker, de Robert Smithson et tous ceux qu'il appelle ''nomades actuels95''. Semblable à cette idée est celle de Laymbert Garcia dos Santos qui propose l'action de tracer une ligne comme équivalent à « trouver […] une fissure dans l'espace96 ». Également, comme nous l'avons déjà dit auparavant, Francis Alÿs essaie de créer des situations qui permettent d'introduire une distanciation imprévue par rapport à une situation donnée, pour produire ce qu'il nomme l'espace d'un instant. C'est ce que Thierry Davila désigne comme « des écarts dans le réel97 », la fracture du réel qu'est la mise à distance produite par les interventions de l'artiste sur la réalité d'un contexte précis, le pas en arrière ou de côté mentionné par Francis Alÿs qui fait possible que le passant reconsidère les idées présupposées d'une réalité particulière.
90
Enfin, nous nous demandons si est-ce, au fond, l'entre-deux de l'espace chez Francis
Martin Heidegger, Remarques sur art – sculpture – espace, op. cit., p. 25
91 Ibid., p. 24 et 29 Dans les Annexes de cette allocution publiée, Martin Heidegger revient à cette idée de l'espace qui espace en employant l'expression : « […] le spatialisant de l'espace ». Ibid., Annexes, p. 34
92 Didier Franck, « Le séjour du corps », in Martin Heidegger, Remarques sur art – sculpture – espace, op. cit., p. 39-89
93 Ibid., p. 51.
94
Thierry Davila, Marcher, créer, op. cit., p. 42.
95 Ibid., p. 41
96 Laymert Garcia dos Santos, « Devenir autre afin d'être soi : Francis Alÿs et la frontière », op. cit., p.189.
97 Thierry Davila, Marcher, créer, op. cit., p. 82.
40
Alÿs, cet « espace d'un instant » entre la réalité d'un contexte précis et celle créée par l'action de l'artiste dans un moment donné ?
ou
Est-ce, au fond, l'œuvre d'art qui ouvre un entre-deux spatial, qui est l'espace-même dans lequel l'œuvre existe ?
41
L'ENTRE-DEUX COMME FRONTIÈRE
Là où la carte découpe, le récit traverse. Il est « diégèse », dit le grec pour désigner la narration : il instaure une marche (il « guide ») et il passe à travers (il « traverse »). […] La limite n'y circonscrit que sur un mode ambivalent. Elle mène un double jeu. Elle fait le contraire de ce qu'elle dit. Elle livre la place à l'étranger qu'elle a l'air de mettre dehors. (Michel de Certeau, L’invention du quotidien98)
2.1 La notion de frontière
Actuellement, toutes les disciplines utilisent le terme de frontière et proposent des définitions adaptées et appropriées à leurs propres questionnements99. Il y a donc des frontières entre les États, entre les quartiers, entre les individus, entre les choses, entre les états des choses, c'est-à-dire des frontières géographiques, géopolitiques, culturelles, religieuses, linguistiques, personnelles, etc.
Pour expliquer la notion de frontière, le géographe et géopoliticien Yves Lacoste part de la notion d'« ensemble spatial100 » dans la géographie. Les ensembles spatiaux, aussi désignés sous le terme d'espaces, sont des ensembles linguistiques, démographiques, climatiques, religieux, botaniques, topographiques, entre autres101. Ces ensembles se chevauchent et s'enchevêtrent entre eux et, dans la plupart des cas, ils ne coïncident pas avec les frontières des États politiques, que l'on nomme aussi des frontières officielles. La frontière est une limite établie à un moment spécifique de l'histoire entre des ensembles spatiaux. Elle exprime des rapports de force qui se produisent en vue d'un partage et d'une dispute pour des territoires Ainsi pour l'auteur, la frontière comme phénomène de la
98 Michel de Certeau, L'invention du quotidien, op. cit., p. 189.
99 Karoline Postel-Vinay, « La frontière ou l'invention des relations internationales », Ceriscope: Frontières [en ligne], 2011 [consulté le 26 mars 2013]. Disponible sur le web <http://ceriscope.sciencespo.fr/node/138>.
100 Yves Lacoste, « Le dépérissement de l'idée de frontière ? Entretien avec Yves Lacoste : propos recueillis par Jean-Pierre Cléro », Cités, Murs et frontières : De la chute du mur de Berlin aux murs du XXIe siècle, PUF, 2007, (n° 31), p. 128.
101 Ibid., p. 128.
CHAPITRE 2
42
géographie est caractérisée par sa spatialité et par sa relation au pouvoir et au territoire102 Yves Lacoste la définit de la manière suivante :
La frontière, c'est d'abord la ligne de front. Les frontières entre les États, telles que les traités de paix ont entériné leur tracé sur les cartes, correspondant pour une grande part aux lignes sur lesquelles se battaient les armées avant la cessation des combats. La frontière, c'est d'abord le tracé du front des troupes103
Le mot Front est l'origine étymologique du mot Frontière : une zone où deux armées ennemies entrent en contact104. Selon, Michel Foucher, le mot frontière est le substantif en français du mot front : « Aller en frontière ; c'était se porter là où l'ennemi devait survenir105 . »
Dans la même optique qu'Yves Lacoste, Michel Foucher pense que les frontières sont liées aux territoires. Pour lui, les frontières sont le résultat d'un accord, fait par deux « instances » ou deux États dans un moment précis106 qui ne doivent pas s'analyser en tant qu'éléments indépendants mais par rapport au contexte où elles sont inscrites107. Il propose sa définition dans l'extrait suivant :
[…] constructions géopolitiques datées, multi-scalaires et multi-fonctions – limites politiques, fiscales, souvent linguistiques, militaires... Elles seront abordées aussi en distinguant les questions du dehors – relations internationales de proximité entre des États, rapports entre ethnies... [...] et les questions du dedans – effets internes des tracés, processus de construction nationale ou régionale108 .
Les effets des tracés concernent notamment les individus mêmes qui habitent et parcourent ces territoires définis par des divisions frontalières. Ainsi, le philosophe Philippe Fontaine fait un parallèle entre le « processus d'individuation » de tout organisme
102 Yves Lacoste définit la notion de géopolitique comme: « rivalité de pouvoirs sur des territoires ». Il place l'origine de la géopolitique dans le contexte militaire d'une Allemagne encore fragmentée. En 1820, les professeurs et instituteurs enseignaient la géographie et l'histoire, et promouvaient déjà l'idée d'une unité. Les élèves des instituteurs prussiens ont appris, dans leurs excursions sur le terrain, à utiliser les cartes, qu'ils ont utilisées plus tard en tant qu'officiers dans les combats de guerre. Yves Lacoste, « Le dépérissement de l'idée de frontière ? », op. cit., p. 131-132.
103 Ibid., p. 131.
104 Bernard Reitel, « Frontière ». Hypergeo [en ligne], [consulté le 26/03/2013]. Disponible sur le web <http://www.hypergeo.eu/spip.php?article16>. Sur l'histoire des frontières, cf. Gilles Rouet, « Identités & frontières : passages & interdits » in François Soulages (dir.), Géoartistique & Géopolitique : Frontières, Paris : L'Harmattan, 2013, p.15-21.
105 Michel Foucher, L'obsession des frontières, Paris : Perrin, 2007, éd. rev. et argum, 2012, p. 19.
106 L'auteur dit : « […] des constructions géopolitiques datées. Les frontières sont du temps inscrit dans l'espace ou, mieux, des temps inscrits dans des espaces. » Ibid., p. 25. Et aussi dans : Michel Foucher, Fronts et frontières : Un tour du monde géopolitique, Paris : Fayard, 1988, p. 11.
107 Ibid., p. 25.
108 Ibid., p. 16.
43
vivant et les frontières politiques internationales. Il définit la frontière comme une « démarcation » qui distingue entre le dehors et le dedans, entre le familier et l'étranger, le connu et l'inconnu, le proche et le lointain109. Cette dualité est attachée au territoire où un organisme vivant, un homme ou une société se place pour y habiter, pour construire un monde qui lui est familier et pour se protéger de ce qui est différent110. À ce propos Philippe Fontaine affirme: « Il est remarquable que la genèse du vivant procède par différenciation et donc par discrimination spatiale ; tout organisme se doit de se protéger de l'extérieur au moyen d'une ''frontière'', qui à la fois sépare et met en relation, comme le font la peau ou la membrane111 . »
Le professeur Didier Bigo met en question ces approches classiques de la notion de frontière qui, selon lui, ont dominé la discussion des sciences politiques entre les années 1930 et 1980. Ces approches en sciences politiques reflètent les processus historiques et politiques ayant conduit les États-nations modernes à se définir essentiellement comme des territoires limités et fermés112 ; Ce sont donc des frontières d'États qui ont pour but de maintenir le territoire fermé : il faut maîtriser l'intérieur et les flux qui viennent de l'extérieur et protéger l'intérieur de l'hostilité de l'extérieur113. Cette délimitation contrôle et sépare, non pas seulement l'intérieur de l'extérieur, mais les individus entre eux, ceux qui appartiennent à un territoire déterminé et ceux qui ne lui appartiennent pas. Didier Bigo utilise les adjectifs « homogène », « continu », « «fixe » pour caractériser cette conception classique de frontière-ligne114
En outre, il identifie deux approches alternatives différentes de la conception de frontière. L'une, qui promulgue la disparition des frontières par la progression et les processus de la mondialisation115. Et l'autre, à propos de laquelle réfléchissent et s'accordent les professionnels de plusieurs disciplines comme la biologie, l'économie, la sociologie, la philosophie, ainsi que des spécialistes de la géopolitique. Cette deuxième
109 Philippe Fontaine, « Des frontières comme ligne de front : une question d'intérieur et d'extérieur. Éléments de sociotopologie », Cités, Murs et frontières : De la chute du mur de Berlin aux murs du XXIe siècle, PUF, 2007, (n° 31), p. 119 et 122.
110 Ibid., p. 120.
111 Ibid., p. 120-121.
112 Cf. Benedict Anderson, Imagined communities : Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, Londres, Verso, 1991.
113 Didier Bigo, « Frontières, territoire, sécurité, souveraineté », Ceriscope: Frontières [en ligne], 2011 [consulté le 27 mars 2013]. Disponible sur le web <http://ceriscope.sciencespo.fr/content/part1/frontieres-territoire-securite-souverainete>.
114 Ibid., p. 6.
115 Ibid., p. 8. À propos des processus de Mondialisation en relation aux frontières, cf. Frédérick Douzet, Béatrice Giblin, « Des frontières indépassables ? », in Frédérick Douzet, Béatrice Giblin (dir.), Des Frontières indépassables? Des frontières d'états aux frontières urbaines, Paris : Armand Colin, 2013, p. 14-15.
44
approche n'associe pas la notion actuelle de frontière à « la gestion de la mobilité » et au contrôle du territoire. Ils la considère comme mouvante et hétérogène par rapport aux individus qui la traversent. C'est l'idée de la frontière entre ligne et réseau, « pixellisée », avec une fonction préventive116 où les points de contrôle et de passage117 se multiplient, se « délocalisent » et se « dématérialisent ». Dans le domaine du contrôle de la mobilité des personnes, les points de contrôle se multiplient, par exemple, en centres de détention, bases de données et zones d'attente aéroportuaires118 . Cette approche met en avant une conception de la frontière en termes de communication, de circulation, d'échange et de discontinuité, plutôt qu'une idée de distance et de fermeture totale119 . Ainsi, Didier Bigo réfléchit au problème de la notion de frontière comme ligne, en essayant d'élargir sa définition et de la détacher des approches les plus classiques, où elle est attachée au territoire. Il affirme en s'interrogeant :
La frontière est-elle une ligne continue séparant et démarquant des entités, des objets solides ou un point de passage, de transformation, de changement imperceptible d'états au sens physique du terme dont le caractère solide, liquide ou gazeux modifie la capacité à séparer ou même trier, canaliser ? […] Est-elle, selon un langage marin et de philosophe, une série de lignes brisées ou poreuses120 […].
La chercheuse Karoline Postel-Vinay dira que la frontière, dans le contexte des relations internationales, disjoint, met en commun et rapproche121. En revanche, pour Michel Foucher, cette idée de « bonne » frontière « […] ouverte mais protectrice, lieu d'échanges et de contacts122 [...] » est inexistante. Avec cette affirmation, Michel Foucher introduit un doute qui montre la complexité de la question des frontières aujourd'hui: À quelles réalités correspondent actuellement la vision alternative de Didier Bigo d'une frontière comme contact et circulation? Dans quelle mesure cette idée alternative s'est libérée de la fonction classique de séparation?
Par la suite, Michel de Certeau, dans le chapitre Récits d'espace, étudie la frontière telle qu'elle apparaît comme étant l'une des figures narratives du récit : « Dans le récit, la frontière fonctionne comme tiers. Elle est un ''entre-deux'', - un ''espace entre deux'' [...]
116 Ibid., p. 12.
117 Ibid., p. 9.
118 Ibid., p. 10-11.
119 Ibid., p. 7-8.
120 Ibid., p. 3.
121 Karoline Postel-Vinay, « La frontière ou l'invention des relations internationales », op. cit., [en ligne].
122 Michel Foucher, Fronts et frontières, op. cit., p. 9 et 11.
45
Lieu tiers, jeu d'interactions et d'entre-vues, la frontière est comme un vide, sym-bole narratif d'échanges et de rencontres123 . » Sa conception est fondée sur l'idée du récit comme une pratique qui procure un espace pour entamer des actions124 En bref, l'idée centrale de Michel de Certeau en ce qui concerne la frontière, conçue comme des interactions entre les éléments du récit, se résume dans le passage suivant : « Paradoxe de la frontière : créés par des contacts, les points de différenciation entre deux corps sont aussi des points communs. La jonction et la disjonction y sont indissociables125. [...] »
Tant Didier Bigo que Michel de Certeau montrent, d'une certaine façon, les limites de la notion classique de la frontière géopolitique: celle-ci n'est plus la distinction protectrice d'un dehors et d'un dedans du territoire, d'origine guerrière, ni liée nécessairement au contrôle et aux États. La frontière n'est pas seulement la limite, la démarcation des bords entre deux choses ou entre deux états de choses, elle participe aussi au passage d'un état à un autre.
Pour essayer de mieux comprendre les idées de Didier Bigo et de Michel de Certeau, et les articuler à la notion d'entre-deux comme frontière que nous élaborons, considérons maintenant deux exemples, la vidéo Klodi d'Adrian Paci et l'action The Loop de Francis Alÿs, dans lesquelles la problématique de la circulation entre les frontières internationales est évidente. L'étude de ces deux projets nous permet de relever que, face à cette problématique, chaque artiste a une façon particulière de montrer le passage des frontières.
2.1.1 Klodi et The Loop
La vidéo en couleur d'Adrian Paci intitulée Klodi, réalisée en 2005 pour l'exposition au P.S.1 Contemporary Art Center à New York126, présente la narration du voyage d'un homme albanais appelé Klodi127. Pendant 40 minutes, le protagoniste raconte les particularités de son périple entre l'Italie, le Mexique et les États-Unis, en passant par l'Allemagne et la Bulgarie. Son voyage est déterminé par des circonstances économiques et
123 Michel de Certeau, L'invention du quotidien, op. cit., p. 187.
124 Ibid., p. 171 et 183.
125 Ibid., p. 186.
126
La vidéo Klodi a été réalisée pour la première exposition individuelle d'Adrian Paci dans un musée à New York. Elle a eu lieu du 23 octobre 2005 au 23 janvier 2006, sous le commissariat d'Amy Smith-Stewart. Adrian Paci, MOMA PS1: Exhibitions [en ligne], [consulté le 8 janvier 2014]. Disponible sur le web <http://momaps1.org/exhibitions/view/91>.
127 Cette vidéo établit un parallèle entre l'expérience migratoire d'Adrian Paci et celle du protagoniste de la vidéo. Ibid., [en ligne] et Adrian Paci, Vies en transit, Dépliant de l'exposition No. 101, Paris : Jeu de Paume, 2013, non paginé.
46
politiques128. Un plan rapproché montre Klodi qui raconte son histoire face à la caméra. Sur cette image se superpose une sorte de cartes ou diagrammes, fait à la main, avec les noms des villes et des lignes. Ces lignes signalent des trajets parcourus entre les villes. Elles composent des figures géométriques irrégulières fermées indiquant des trajets doubles ou triples. Cela veut dire qu'un même trajet, comme par exemple entre Francfort et Sofia, a été parcouru plusieurs fois. Une première carte présente une ligne simple qui montre la route allant depuis la ville de Shkodër en Albanie jusqu'à la ville de Milan en Italie en passant par la ville albanaise de Vlora et les villes italiennes de Bari et de Rome.
Autres deux cartes, avec plus de villes et de lignes, vont apparaître, sur le visage de Klodi pendant qu'il parle. La vidéo présente aussi quelques plans de Klodi sans aucune superposition de cartes sur son visage.
128 Ibid., non paginé.

47
Image 18 : Adrian Paci, Klodi, 2005, Vidéo, couleur, son, 40'


48
Image 20 : Adrian Paci, Klodi, 2005
Image 19 : Adrian Paci, Klodi, 2005
C'est à travers sa manière particulière de construire la vidéo que l'artiste raconte le périple de Klodi : l'histoire racontée, dans une tonalité tantôt dramatique tantôt absurde129 , est accompagnée par les mouvements naturels du corps que Klodi fait en parlant, et par les noms des villes et les lignes qui se superposent sur son visage. Cette superposition est faite de telle façon que l'image est composée de trois couches. La première est la carte des parcours entre les villes. La deuxième couche est l'image du mouvement de Klodi racontant son histoire. Entre ces deux couches antérieures, il y a une autre, qui est comme un espace vide. Le vide de la non coïncidence entre les déplacements réels de Klodi en passant les frontières des différents pays et les déplacements représentés par les lignes sur la surface plate et presque transparente des cartes. C'est comme si les déplacements à l'échelle humaine, avec leur temps, leur rythme et leurs caractéristiques sociales, économiques et politiques particulières, ne correspondaient pas avec la réalité simplifiée des marquages et des délimitations dessinés sur une carte.
Concernant le même sujet, Francis Alÿs se pose la question suivante, à partir de l'action Don't cross the bridge before you get to the river, réalisée au détroit de Gibraltar en 2008 : « Comment peut-on simultanément promouvoir une économie globale et limiter les déplacements des personnes au niveau mondial130 ? »
Francis Alÿs a développé plusieurs projets autour de la problématique des frontières et des lignes de marquage131 . L'action The Loop (La Boucle) est un de ces projets, réalisé en 1997, pour le Festival binational d'art contemporain InSite132 , événement préparé par les villes de San Diego aux États-Unis et de Tijuana au Mexique. Francis Alÿs a observé que les spectateurs du milieu de l'art133, aussi bien que les citoyens américains, pouvaient
129 Ibid., non paginé.
130 Cette question apparaîtra dans une vitrine avec plusieurs documents et dessins, lors de l'exposition de l'action Don't cross the bridge before you get to the river de Francis Alÿs, à Marrakech, en novembre 2009.
Mark Godfrey, « Politique/Poétique : le travail de Francis Alÿs », op. cit., p. 27.
131 Par rapport aux frontières, les actions : Bridge/Puente réalisée entre Kay West aux États-Unis et La Havane, en 2006, Retoque/Painting dans l'ancienne zone du canal de Panama en 2008 ; les vidéos Children's Game # 2 : Ricochets faite à Tanger au Maroc en 2007 ; Watercolor, en Turquie et en Jordanie en 2010 ; Children's Game # 13 : Piñata, à Oxaca au Mexique en 2012 Cette problématique est, aussi, le fil conducteur de l'exposition collective Expats/Clandestines au Centre d'art contemporain Wiels à Bruxelles, dans laquelle Francis Alÿs a participé en 2007 avec l'œuvre Ambulantes faite à Mexico depuis 1992 jusqu' à aujourd'hui, même si nous pouvons dire que cette série de photos montrent plutôt des marquages dans la ville ou des frontières urbaines.
132 Russell Ferguson dit que le nom de l'exposition est inSITE. Russell Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », op. cit., p. 11. Le nom de l'exposition est border selon le catalogue de l'exposition Francis Alÿs : El profeta y la mosca, Museo nacional Centro de arte Reina Sofía. Madrid : MNCARS, 2003, p. 100.
133 Cela fait référence seulement aux gens du milieu de l'art que par leurs nationalités peuvent rentrer aux États-Unis sans un visa.
49
passer d'une ville à l'autre sans problème, tandis que les mexicains n'y étaient pas autorisés. The Loop est une action qui consistait à contourner le passage d'une ville, Tijuana, à l'autre, San Diego, sans traverser la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Pour ce faire, Francis Alÿs est passé de l'Amérique du Nord à l'Amérique centrale : de San Diego à Mexico et après au Panama. Ensuite, il a traversé l'Amérique du Sud jusqu'à Santiago au Chili et il est reparti, en traversant l'Océan Pacifique, pour Auckland en Nouvelle-Zélande, puis pour Sydney en Australie. Et de là en l'Asie. Il a parcouru l'Asie de l'est, du sud au nord, en passant par les villes de Singapour, Bangkok, Rangoon, Hong Kong, Shanghai et Seoul. Depuis cette dernière ville, l'artiste a voyagé vers l'Amérique du nord, à Anchorage en Alaska et le même jour il est parti pour Vancouver au Canada. Quelques jours après, il est passé à Los Angeles et finalement il est arrivé à San Diego. Le voyage a duré trentecinq jours. Avec cette action, l'artiste a mis l'accent sur la problématique de la circulation entre les deux pays, en proposant une solution absurde et en réfléchissant à l'absence de regard critique de la part des artistes contemporains quand ils voyagent134. L'artiste a financé son périple avec l'argent que le festival InSite lui avait attribué pour son projet.
Selon le commissaire Russell Ferguson, ce voyage est une version à plus grande échelle des promenades de l'artiste dans son quartier à Mexico avec laquelle il essaie de donner forme au principe d'« effort maximum, résultat minimum »135 qui sera travaillé plus tard dans l'action When Faith Moves Montains (Cuando la fe mueve montañas136) fait à Lima en 2002.
The Loop a été documenté par des objets et des documents produits pendant le voyage, par exemple des mails entre l'artiste et un des organisateurs de l'événement, une carte postale qui reproduit le voyage avec un plan du parcours et une photo, éditée pour l'action. Dans cette carte, l'artiste a écrit que cette action n'avait pas de significations critiques autres que les significations de son déplacement physique137 . De plus, il s'est déclaré en tant que « touriste professionnel » dans un contrat qu'il a établi lui-même pour cette action avec l'institution organisatrice de l'événement138 .
134
135
136
137
138
Mark Godfrey, « Politique/Poétique : le travail de Francis Alÿs », op. cit., p. 22 et 87.
Russell Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », op. cit., p. 11.
Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 87
Francis Alÿs : El profeta y la mosca, op. cit., p. 100.
Thierry Davila, Marcher, créer, op. cit., p. 19 et 24.
50


51
Image 22 : Francis Alÿs, The Loop, Tijuana-San Diego, 1997, Documents éphémères d'une action
Image 21 : Francis Alÿs, Document éphémère pour Don't Cross the Bridge Before You Get to the other River (titre de travail), 2008
Dans ces deux projets que nous venons de décrire, les déplacements dans l'espace d'Adrian Paci et de Francis Alÿs construisent d'autres manières de réfléchir à la notion de frontière et à la question de son franchissement. Ces déplacements dans l'espace proposent des frontières qui sont en même temps des frontières entre les États perméables et fermées, c'est-à-dire, dans le cas de la vidéo Klodi et de l'action The Loop, le passage est déterminé par la nationalité ou par le statut de la personne qui passe ou qui veut passer les frontières. Mais ces frontières sont aussi poreuses, elles sont donc des points de contact, de circulation et de blocage.
À ce point de notre réflexion, nous pouvons nous demander : Quel est donc le rapport entre ces déplacements dans l'espace et la notion de frontière ?
Pour aborder cette question, nous reprendrons la réponse d'Adrian Paci à l'interrogation de Chantal Akerman dans le projet Tarzan & Jane139 .
« Akerman : Les frontières sont-elles une limite ou une ressource?
Paci : Les deux. Les frontières sont évidemment une limite. Mais elles cessent d'être une limite et deviennent une ressource précisément lorsque vous décidez de les traverser140 »
2.2 Le déplacement dans l'espace en tant que geste politique
Comme nous l'avons précisé auparavant, Adrian Paci et Francis Alÿs font des actions dans l'espace. Des individus, des corps humains se déplacent dans l'espace. Ce sont des corps d'hommes, de femmes ou d'enfants. Dans le cas de Francis Alÿs, il y a parfois un chien qui accompagne l'homme qui marche, un chien tout seul ou plusieurs chiens141. Ces déplacements dans l'espace, nous allons les caractériser comme des gestes politiques. Ce composant politique est présent dans les thématiques de leurs projets artistiques car ils
139 Tarzan & Jane est une rencontre entre deux artistes et un projet fait spécialement par la revue Domus et Wrong Gallery, dirigé par Maurizio Cattelan, Massimiliano Giany et Ali Subotnick.
140
« Akerman : Are borders a limit or a ressource ? Paci : Both. Borders are obviously a limit. But they stop being a limit and become a ressource precisely when you decide to cross them. »
« Tarzan & Jane : Frontiere : Chantal Akerman e Adrian Paci/ Tarzan & Jane : Borders : Chantal Akerman and Adrian Paci », Domus, Janvier 2007, n° 899, p. 129.
141 Il y a des chiens, par exemple, dans la série photographique Sleepers réalisé depuis 1999 à Mexico, dans l'animation The Last Clown de 2000, dans l'action Untitled (Bandera), 2006. Il y a aussi, selon l'expression de Mark Godfrey, le « chien magnétique » avec des roues de l'action The Collector (Colector), 1990-1992. Pour savoir plus à propos des chiens dans l'œuvre de Francis Alÿs, cf. Miwon Kwon, « Les chiens et la ville », in Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 181-182 et Le Centre Historique de la ville de Mexico (texte de Carlos Monsiváis, images de Francis Alÿs), trad. espagnolfrançais Gilles Bert, publié à l'occasion de l'exposition Francis Alÿs. La Cour des Miracles, Wolfsburg, Kunstmuseum ; Nantes, Musée des Beaux-Arts, Madrid : Turner, 2005, p. 86-89.
52
manifestent des malaises et des problèmes sociaux, économiques et politiques actuels142 liés aux migrations, aux déplacements, aux frontières, à l'identité recomposée, aux propos tronqués de la modernité au Mexique et en Amérique latine chez Francis Alÿs143, à la réalité albanaise chez Adrian Paci, à l'exil, entre autres. Ces problématiques sont traitées, par exemple, dans la série photographique Ambulantes de Francis Alÿs, laquelle montre des vendeurs pauvres qui poussent leurs charrettes chargées d'objets ou qui les portent en marchant dans les rues de Mexico. Ce type d'archive photographique montre des « pratiques économiques informelles et des usages alternatifs de l'espace public144 » à Mexico145. Dans le cas d'Adrian Paci, l'escalier d'embarquement, aussi bien que le titre de l'œuvre en italien Centro di permanenza temporanea, nous renvoient aux centres de détention des étrangers en situation irrégulière et aux zones de contrôle des aéroports.
L'idée qui consiste à concevoir le déplacement dans l'espace comme geste politique est présente depuis le début de la pratique artistique des deux artistes, étant donné qu'Adrian Paci et Francis Alÿs ont émigré de leurs pays d'origine aux pays dans lesquels, aujourd'hui, ils habitent et travaillent. Cette espèce d'exil est présente dans leurs travaux artistiques, même si aucun des deux ne prétend faire des œuvres autobiographiques. Nous pouvons le voir, notamment dans l'action Turista de Francis Alÿs faite à Mexico en 1994 et dans la première vidéo d'Adrian Paci, intitulée Albanian Stories, réalisée en 1997146 Pourtant, cette dimension politique n'est pas présente uniquement dans les thématiques et les problématiques que leurs projets soulèvent. Elle est aussi présente dans la manière dont ces déplacements dans l'espace sont construits par les artistes dans leurs œuvres. C'est pourquoi, nous pouvons ajouter que même si les deux artistes, Francis Alÿs et Adrian Paci, ont travaillé dans des zones frontières ou autour de la notion de frontière en tant que thématique dans plusieurs projets, ils choisissent de partir, dans ce domaine, du point où la notion de frontière s'approche de la notion d'entre-deux, pour franchir les frontières : ils traversent les frontières par la construction d'un récit, tissé entre réalité et fiction. Pour préciser cette idée et montrer comment les artistes construisent ce récit, nous allons
142 Mark Godfrey, « Politique/Poétique : le travail de Francis Alÿs », op. cit., p. 9 et Adrian Paci : Transit, op. cit p. 28 et 32.
143 Ibid, p. 19.
144 Expats/ Clandestines : Saâdane Afif, Francis Alÿs, Nairy Baghramian, André Cadere, Gabriel Kuri, Moshekwa Langa, Chen Zhen (commissaire : Anne Pontégnie), Bruxelles : Wiels Centre d'art contemporain, 2007, p. 11.
145 Francis Alÿs et Carlos Monsiváis ont fait un livre à ce sujet. Les textes sont de Carlos Monsiváis, écrivain et chercheur mexicain, et les images sont de l'artiste. Le titre du livre est Le Centre Historique de la ville de Mexico, cf. Bibliographie.
146 La description et l'analyse de ces deux projets se trouvent dans le chapitre 3 « L'entre-deux du voyage et de l'exil » de ce mémoire.
53
examiner
2.2.1 The Green Line et A Real Game
The Green Line (La ligne verte) est un projet et une action fait par Francis Alÿs à Jérusalem en 2004. Cette action est une version de l'action The Leak fait à Sao Paulo en 1995, cette dernière étant comprise comme un geste poétique, comme une façon de laisser une trace physique de l'action de marcher147, ainsi que comme une continuation de l'action collective When Faith Moves Mountains faite à Lima en 2002148

Dans l'action The Green Line, Francis Alÿs parcourt l'ancien marquage entre Jérusalem est et ouest en portant à la main un pot de peinture verte percé et retrace la ligne en laissant couler la peinture. La ligne verte est le nom qui a été donné au marquage résultant de l'armistice signé en 1949 entre Israël et ses voisins arabes à la fin de la première guerre israélo-arabe (1948-1949).
147 Russell Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », op. cit., p. 143.
148 Mark Godfrey, « Politique/Poétique : le travail de Francis Alÿs », op. cit., p. 24.
l'action The Green Line de Francis Alÿs et la vidéo A Real Game d'Adrian Paci
54
Image 23 : Francis Alÿs, The Green Line

55
Image 24 : Francis Alÿs, The Green Line, Jérusalem, 2004, Documentation vidéo d'une action
La couleur verte est déterminée par la couleur du crayon qui avait été utilisé pour dessiner la ligne sur la carte au moment des concertations de paix. Pour comprendre la dimension de l'action de Francis Alÿs à Jérusalem, il faut rappeler quelques événements présents dans ce contexte politique. En 1947, par conseil de l'Assemblée générale des Nations Unies, un État juif et un État arabe devaient se constituer ; et la ville de Jérusalem et les lieux saints devaient acquérir un statut international particulier. Après cette recommandation, le 4 mai 1948, seulement un État s'est constitué, celui d'Israël; cet acte a eu pour conséquence, entre autres, l'expulsion massive des Palestiniens hors du territoire israélien. Les États arabes se sont opposés à cette expulsion et à la création de l'État d'Israël149. La guerre israélo-arabe de 48 s'est soldée par la faillite des pays arabes et par le traçage de la ligne verte sur une carte par le générale israélien Moshe Dayan, laquelle sera la frontière extérieure israélienne jusqu'en 1967. L'architecte et professeur israélien Eyal Weizman dit dans son essai « La carte 1 : 1 » à propos de cette ligne : « Cette ligne, indiquée sur la plupart des cartes palestiniennes et internationales (mais sur très peu de cartes israéliennes officielles) a été dévorée, brouillée et effacée par la réalité de la construction de Jérusalem en expansion constante150 .»
Francis Alÿs a utilisé 58 litres de peinture verte pour marquer 24 km de ligne. Cette action est documentée dans une vidéo qui a été montrée après à onze personnes, historiens, journalistes, anthropologues, architectes, cinéastes, militants ; ceux-ci ayant différents positions politiques. Ces personnes ont été invitées à faire une analyse spontanée de l'action de Francis Alÿs. Ces commentaires sont inclus dans la vidéo en voix off et dans les sous-titres en anglais. Le résultat est une installation-vidéo dans laquelle le spectateur peut choisir l'analyse à écouter. Les images de la vidéo sont toujours les mêmes. Il y a aussi l'option qui consiste à visionner la vidéo sans aucun commentaire151 .
Selon le commissaire Mark Godfrey, The Green Line a plusieurs interprétations. D'une part, cette action évoque un parallèle entre l'ancienne ligne verte et l'établissement de nouvelles frontières dans ce territoire, tel que la construction du mur de séparation fait par Israël. Une deuxième interprétation de l'action est celle de signaler le caractère « obsolète » de la frontière comme ligne dans l'actualité ; selon Eyal Weizman, les frontières disputées en Israël sont tridimensionnelles152. Cela veut dire qu'il y a des désaccords entre israéliens
149 Serge Cordellier (dir.), Le dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècle, 2e éd. augm., Paris : La Découverte, 2000, 2002, p. 373 et 564.
150 Eyal Weizman, « La carte 1:1 », in Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p 175.
151 Pour expérimenter le dispositif cf. Francis Alÿs, The Green Line, vidéo couleur, son, 17:34 min, Jerusalem, 2004. Disponible sur le web <http://www.francisalys.com/greenline/>.
152 À propos de cette caractéristique, Eyal Weizman affirme : « […] le rez-de-chaussée étant accessible
56
et palestiniens par rapport aux corridors des immeubles ou aussi des étages. Comme troisième interprétation, l'action de l'artiste peut être interprétée comme une contrefaçon de la nature arbitraire, douteuse et brutale des frontières et de « tous les actes de cartographie153 ». D'autre part, l'action et la ligne dans sa fugacité et fragilité peuvent désigner la possibilité de l'effacement de toutes les frontières à Jérusalem et la réorganisation et la répartition du territoire par la population. Une dernière interprétation, plus proche de l'idée de l'artiste, est celle d'établir un lien entre le titre, The Green Line et le sous-titre du projet Sometimes doing something poetic can become political and sometimes political can become poetic (Parfois, faire quelque chose de poétique peut devenir politique et parfois, faire quelque chose de politique peut devenir poétique). D'après Mark Godfrey, le dispositif de l'installation-vidéo amplifie le projet de Francis Alÿs en le transformant en « une sorte d'arène ouverte au débat et aux dissensions154 [...] ». Cela veut dire qu'avec ce dispositif, l'artiste voulait susciter des réactions de la part des principaux auteurs du conflit en leur donnant la parole.
L'entre-deux en relation avec la frontière est précisément ce que l'action de Francis Alÿs, offre au regard ou élabore, dans toute la complexité que nous venons d'énoncer. Cette ligne verte, sinueuse et sensible à l’action du temps, aux pas des passants et à l'intempérie, montre une couche d'histoire ; elle fait remonter l'ancienne carte à la surface de la ville155 L'action nous rappelle comment la ligne a été effacée, est redessinée par l'artiste et sera de nouveau effacée. La vidéo avec les analyses en voix-off, montre une ligne qui se construit peu à peu, elle prend corps entre l'image et la narration des voix, nous révèle un entredeux. Selon Didier Bigo, la frontière ne permettrait pas ces superpositions : « […] la frontière permettrait de ne pas se tromper. Elle aurait valeur de certitude par sa valeur logique de « ou exclusif », […]. On est à l'intérieur ou à l'extérieur , il est impossible d'être dans les deux lieux à la fois156 » Contrairement à l'entre-deux, qui est cet instant où c'est possible que le passé et le présent, le fixe et l'éphémère, la réalité et la fiction cohabitent.
À propos de A Real Game d'Adrian Paci il y a peu d'information et d'analyses. Même si depuis le quartier musulman et appartenant à l'État palestinien et les étages supérieurs étant accessibles par le quartier juif et appartenant à l'État juif. » Eyal Weizman, « La carte 1:1 », op. cit., p 177.
153 Mark Godfrey, « Politique/Poétique : le travail de Francis Alÿs », op. cit., p. 25.
154 Ibid., p. 25.
155 Dans un sens similaire à notre idée, Eyal Weizman dira : « Laisser couler de la peinture le long de cette ligne sur la surface de la ville, c'est transformer, pour le temps de la marche, le territoire en une carte, une carte à un pour un, aussi grande et aussi détaillée que le territoire. » Eyal Weizman, « La carte 1:1 », op. cit., p. 176.
156 Didier Bigo, « Frontières, territoire, sécurité, souveraineté », op. cit., p. 6.
57
notre description se limite ici à la vidéo connue par internet, nous considérons que cette vidéo est un travail artistique significatif sur la question de la construction de la relation entre la notion d'entre-deux et la notion de frontière dans la pratique artistique d'Adrian Paci
Image 25 : Adrian Paci, A Real Game, 1999, Vidéo, couleur, son, 6' 54''

A Real Game157 (Un jeu réel) est une vidéo en couleur réalisé en 1999 par Adrian Paci C'est une sorte de continuation de Albanian Stories, la première vidéo de l'artiste.
Pendant le temps de la vidéo, 6 minutes et 54 secondes, le spectateur voit un plan rapproché d'une des filles de l'artiste, Jolanda, qui répond aux questions posées par son père, Adrian Paci, qui tient la caméra vidéo en face d'elle. Adrian Paci est toujours hors champ.
Père et fille jouent au professeur et à l'élève. Jolanda, la petite fille, est l'élève et Adrian Paci est le professeur. La scène semble se dérouler dans la chambre de la fille. Pendant ce dialogue, Jolanda raconte la vie de la famille Paci dans son mouvement de l'Albanie vers l'Italie. La thématique de la vidéo en est l'immigration et le déplacement158
157
Cf. Adrian Paci, A Real Game, vidéo couleur, son, 6:56 min., 1999. Disponible sur le web <www.youtube.com/watch?v=-5M7PawApK4 >.
158 Shoot the family (commissaire : Ralph Rugoff), Bloomfield Hills, Cranbrook art museum ; Knoxville, Knoxville museum of art, Bellingham, Western gallery, New York : Independent Curators International, 2006, p. 38.
58
La vidéo démarre de la manière suivante : la caméra est en train d'enregistrer quand le dialogue commence. Jolanda pose une question à son père ; elle lui demande s'ils peuvent jouer au professeur et à l'élève. Ils se parlent en albanais. Et ils se mettent d'accord pour jouer le jeu en italien. Cette première partie de la vidéo met en évidence que la vidéo contient un double caractère, qu'elle se situe entre fiction et documentaire.
Le jeu commence. Ils se disent « Bonjour ». Ensuite, le professeur demande à Jolanda son prénom, son nom de famille, son âge. Après cette courte présentation, le professeur demande à Jolanda où elle est née. Jolanda répond qu'elle est née à Sienne. Le professeur affirme alors qu'elle est toscane (la région à laquelle la ville de Sienne appartient). Jolanda répond que non, qu'elle est albanaise (Jolanda est née réellement en Italie). Par la suite, la petite fille raconte qu'elle est retournée en Italie parce qu'elle avait peur des bandes qui tirent sur la population et la volent sans aucun contrôle en Albanie. Elle affirme les avoir vues et elle les décrit. Son récit inclut l'interaction, dans ces moments de danger, avec d'autres membres de sa famille tels que ses parents et sa tante. Après, le dialogue soulèvera les difficultés de l'immigration vécues par toute la famille, comme par exemple les emplois que ses parents ont pu avoir en tant qu'étrangers en Italie et comment leurs conditions de vie ont dramatiquement changé. Adrian Paci et sa femme étaient professeurs à l'université en Albanie. En arrivant en Italie, Adrian Paci travaillait comme restaurateur entre Torino et Milan ; parfois, il ne rentrait pas à la maison la nuit. Sa femme était baby-sitter et femme de ménage et s'occupait de leur maison et de leurs filles quand elle rentrait à la maison. Ensuite, Jolanda raconte que la famille ira en Albanie en vacances pour faire des démarches administratives. Elle dit : « […] nous irons là-bas pour Pâques parce que ma sœur n'a pas tout en ordre, elle n'a pas le certificat de naissance, elle doit envoyer ça de l'Albanie à Rome par la poste italienne, l'envoyer à l'ambassade italienne. » Finalement, Jolanda raconte qu'elle aime bien aller en Albanie, car là-bas il n'y a pas autant de voitures qu'à Milan, qu'elle peut rendre visite à ses amis toute seule, qu'ils peuvent emmener leurs jouets chez elle, qu'elle les invitent dans la maison qu'elle a, avec un grand jardin (cette dernière partie est, peut-être, à l'imagination de la petite fille.)
A Real Game montre, à travers l'histoire de cette fille de cinq ans, l'histoire réelle et complexe de beaucoup de migrants. Jolanda va et vient entre les deux pays, traverse les frontières, vit la violence, la peur, l'exil, l'identité partagée159, la bureaucratie en tant
159 Ce sont les thèmes qu'Adrian Paci travaille, d'après Edna Moshenson dans son essai « Sujets en transit » : « […] l'expression des grands thèmes discursifs de son époque : mouvement, mobilité, transition, déplacement, identité, déracinement, immigration et hybridité culturelle. » Edna Moshenson, « Sujets en transit », in Adrian Paci : Transit, op. cit., p. 44.
59
qu'étrangère, soit une vie quotidienne menaçante, risquée, instable et une maison de rêve160. Jolanda a survécu aux insurrections de 1997 qui avaient eu lieu en Albanie à cause de l'effondrement du système financier pyramidal, soutenu par le gouvernement de l'époque. Une grande partie de la population albanaise avait investi dans ce système frauduleux qui générait de l'argent rapidement par le moyen d'intérêts monétaires très élevés. Selon l'inattendu écroulement de ce système, les albanais sont restés, du jour au lendemain, dans la misère. C'est pourquoi, ils ont pris les armes par la force et la situation a tourné au cauchemar dans un chaos et une violence régnant dans tout le pays. Ces événements ont provoqué une grande vague migratoire vers l'Italie, similaire à celle qui s’était produite à l'époque de la transition vers la démocratie161 .
Si la ligne verte de Francis Alÿs soulève un entre-deux, le jeu-dialogue d'Adrian Paci va tisser l'entre-deux en faisant appel à la possibilité qu'à Jolanda d'habiter deux lieux en même temps. Dans son imaginaire, elle est en l'Albanie et en l'Italie et dans le présent, dans le passé et dans le futur. Cet entre-deux se construit aussi, pendant la durée de la vidéo, avec les mots de Jolanda et les images que le spectateur construit dans sa tête. Cette dernière idée a été élaborée par le critique d'art et commissaire albanais Edi Muka. D'après lui, dans les travaux d'Adrian Paci, la vidéo présente au spectateur une seule séquence et une seule action dans une seule image. En revanche, Edi Muka propose qu'il y ait comme une deuxième image, une autre couche qui s'ajoute, « l'image d'un monde qui se transforme lentement dans notre esprit » à partir de l'histoire de la petite fille. Il la nomme aussi « l'image comme double », comme « ce processus permanent de suture et de rupture entre visible et dicible162 » qu'est la manière d'Adrian Paci de tisser le récit.
Dans ce cas, l'idée d'un récit construit entre fiction et réalité est reliée à celle des déplacements dans l'espace conçus comme des gestes politiques : les artistes traversent la frontière grâce à la construction d'un récit. Ce récit est le type de construction narrative qui permet à Adrian Paci de traverser la frontière-limite pour que celle-ci devienne une frontière-ressource – ces termes ayant été utilisés par Adrian Paci et Chantal Akerman dans l'entretien cité précédemment Adrian Paci s'exprime de la manière suivante à propos du
160
Edi Muka, « Engendrer la réalité », in Adrian Paci : Transit, op. cit., p. 76.
161 Il faut rappeler que l'Italie fasciste avait dominé l'Albanie dès 1939, jusqu'à la libération par le communiste d'Enver Hoxha. Serge Cordellier (dir.), Le dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècleLe dictionnaire historique et géopolitique du 20e siècle, op. cit., p. 23.
162 Edi Muka inclut la vidéo Vajtojca (La Pleureuse), 2002, comme un autre exemple d'Adrian Paci, dans lequel cette « image à l'intérieur de l'image » se développe. Je ne suis pas d'accord avec l'auteur dans ce point, car justement dans la vidéo Vajtojca (La Pleureuse), il y a une coupure, par l'irruption d'une deuxième action et d'une musique, qu'empêche que ce processus se produise. Edi Muka, « Engendrer la réalité », op. cit., p. 76.
60
récit, en nous aidant en même temps à éclaircir la relation entre fiction et réalité dans le récit : « […] coexistence entre le conflictuel et le fabuleux, entre le réel et le fictionnel. […] il y a une structure de récit, et la chronique de faits réels se mêle à la légende et au conte163 » Dans cette citation, il faut souligner le verbe « se mêler », étant donné qu'il clarifie la relation entre la réalité et la fiction dans le type de récit dont nous parlons.
Pour traverser, Adrian Paci, Francis Alÿs ou les personnages de leurs œuvres se déplacent. Se déplacer c'est « bouger, circuler, se déranger […] changer de place, de lieu164 ». Ces déplacements dans l'espace en tant que gestes politiques sont d'autres formes de passage, de circulation construites à travers l'art, aussi bien d'un endroit physique à un autre que d'une pensée à une autre. Ces déplacements sont politiques dans le sens de permettre une possible reconsidération de la réalité165 et dans la mesure où ils rendent possible une distanciation de la part du spectateur, un arrêt dans son mouvement quotidien ; ceci contribuant à ce qu'il regarde, questionne, pense de nouveau cette réalité que les interventions des artistes mettent en évidence.
Cette possibilité de reconsidérer la réalité que les œuvres d'art donnent aux spectateurs peut s'étendre à tout le domaine de l'art contemporain et aux intentions qu'ont la plupart des artistes actuels avec leurs œuvres. Selon Jacques Rancière, ceci n'est pas exclusif de l'art : « La politique et l'art, comme les savoirs, construisent des ''fictions'', c'est-à-dire des réagencements matériels des signes et des images, des rapports entre ce qu'on voit et ce qu'on dit, entre ce qu'on fait et ce qu'on peut faire 166 » L'historien et critique d'art Mark Godfrey s'appuie aussi sur les pensées de Jacques Rancière pour définir le terme de politique dans son essai « Politique/Poétique : le travail de Francis Alÿs ». Or, il utilise le terme d'« actes politiques167 » plutôt que de geste. Effectivement «acte» et «geste» semblent suggérer des choses différentes, « geste » semble signifier une dimension plus transitoire, dynamique et fragmentaire de l'action, tandis que le mot « acte » fait souvent référence à une action complexe, considérée comme une totalité, définitive, marquant un avant et un après, souvent en rapport à un cadre institutionnel ou politique168. Dans ce mémoire, nous avons choisi le mot « geste » car il correspond à l'action subtile du
163 Marie Fraser et Marta Gili, « Entretien avec Adrian Paci », in Adrian Paci : Transit, op. cit., p. 33.
164
Josette Rey-Debove, Alain Rey, Le Petit Robert : Dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, Paris : Dictionnaires Le Robert, 2014, p. 685.
165 C'est ce que Francis Alÿs définit comme Poétique/Politique. « Francis Alÿs : A à Z, sélection de Klaus Biesenbach et Cara Starke », trad. de l'anglais Zoé Derleyn, in Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 39.
166
Jacques Rancière, Le partage du sensible : esthétique et politique, Paris : La Fabrique, 2000, p. 62.
167 Mark Godfrey, « Politique/Poétique : le travail de Francis Alÿs », op. cit., p. 25.
168 Les définitions des termes « geste » et « acte » sont de Gabriela Patiño-Lakatos, psychologue et docteur en Sciences de l'éducation de l'Université Paris 8 avec qui j'ai discuté ce texte.
61
franchissement des frontières par un individu dans un espace et dans un moment précis.
Pour préciser le sujet de ce chapitre, il faut insister sur le fait que le chemin que Francis Alÿs et Adrian Paci prennent, et la façon dont ils le prennent pour franchir les frontières, permettent de rapprocher la notion de frontière de la notion d'entre-deux. Comme nous l'avons observé dans les passages précédents, la notion de récit est fondamentale pour réaliser ce rapprochement conceptuel. Paul Ricœur définit la fonction du récit de la manière suivante : « […] le récit donne forme à ce qui est informe169». En somme, c'est le récit, tel qu'il est défini par Paul Ricœur, qui permet ce passage particulier des frontières dans un entre-deux170. Les deux artistes proposent un franchissement des frontières politiques dans les termes de Didier Bigo et de Michel de Certeau : communication, circulation, discontinuité, interactions, échanges, rencontres.
Dans un autre passage du chapitre intitulé « S'il faut en conclure que l'histoire est fiction. Des modes de la fiction », Jacques Rancière dit à propos de la poésie : « [...] elle est faite non pas d'images ou d'énoncés, mais de fictions, c'est-à-dire d'agencements entre des actes171 . » Nous pouvons dire que ces actes nommés par Paul Ricœur sont les récits d'Adrian Paci et de Francis Alÿs où le réel et le fictionnel se mêlent.
L'art réalise certains types de déplacements, concrets et abstraits, qui ouvrent des espaces d'entre-deux interrogeant le tracé des frontières aussi bien matérielles qu'immatérielles qui opèrent dans différents domaines à la fois ; cette ouverture pratiquée dans l'espace-temps d'un projet artistique particulier redéfinit, modifie, met en suspension ces frontières ; des artistes comme Adrian Paci et Francis Alÿs ont d'autres manières de se déplacer, ce qui est en soi un geste poétique ayant en même temps une dimension ou une portée politique.
Par conséquent, ces dernières réflexions nous conduisent à examiner de quelle manière d'autres types de frontières, désignées comme des frontières urbaines, s'approchent particulièrement et spécifiquement de la notion d'entre-deux.
169 Paul Ricœur, Temps et récit, tome I, Paris : Édition du Seuil, 1983, p. 111. De cet auteur, je reprend seulement la définition très précise de Récit. Je ne traiterai pas sa notion de temps raconté. Pour savoir plus sur cette dernière notion chez Paul Ricœur, cf. Temps et récit II : La configuration du temps dans le récit de fiction, Paris : Éditions du Seuil, 1984 et Temps et récit III : Le temps raconté, Paris : Éditions du Seuil, 1985.
170 Michel de Certeau dit dans le chapitre intitulé « Récit d'espace » : « Tout récit est un récit de voyage,une pratique de l'espace. » Michel de Certeau, L'invention du quotidien, op. cit., p. 171.
171 Jacques Rancière, Le partage du sensible, op. cit., p. 56.
62
2.3 Les frontières urbaines
Les frontières urbaines sont aussi nommées frontières de la ville ou frontières internes à la ville. Pour les chercheurs Frédérick Douzet et Béatrice Giblin, ces frontières naissent de la fragmentation et des tensions internes dans la ville, dues principalement à l'immigration, aux projets d'aménagement et de développement urbain, aux différences économiques et raciales des habitants, entre autres. Les frontières urbaines marquent des zones dans les villes, elles sont plurielles, politiques, attachées au territoire et sont le résultat, dans certain cas, des rivalités et des conflits de territoires. Les auteurs les caractérisent d'« indépassables », « floues » et « mouvantes172 ». Ces frontières traversent, divisent, caractérisent des villes, des quartiers, des zones, des communautés et déterminent les possibilités et les niveaux d'interactions entre les habitants173
Les frontières urbaines ou internes de la ville sont aussi des démarcations et des limites, perméables à certains groupes de personnes dans certains moments. Un exemple concret, qui peut nous éclaircir cette affirmation se trouve dans le quartier El Calvario (Le Calvaire) nommé aussi La Olla (La Marmite174) dans le centre-ville de Cali en Colombie. Ce quartier est habité par des gens très pauvres, principalement des toxicomanes, des prostituées, des commerçants. Il y a certaines rues dans lesquelles les citoyens, qui n'appartiennent pas au quartier, peuvent circuler, mais en général, La Olla est un lieu connu par sa haute criminalité et sa dangerosité. Les commerces de divers produits et matériaux, d'appareils électriques et électroniques, de meubles, de tissus, des garages pour des voitures, etc., se sont installés dans les rues périphériques du quartier. Pendant la journée, il est possible de les visiter et de trouver des produits bon marché. Par contre, il y a des rues qui marquent des frontières indépassables qui, du simple regard, sont impossibles à distinguer. C'est pourquoi, il faut demander aux commerçants jusqu'où il est possible d'avancer dans le quartier. À l'intérieur, les enfants, y compris ceux des prostitués, sont gardés et nourris par une communauté de religieuses. Pendant la journée, ce centre communautaire reçoit des enseignants de l'extérieur de la zone qui réalisent des activités
172 Frédérick Douzet, Béatrice Giblin, « Des Frontières indépassables? », op. cit , p. 16.
173 Ibid., p. 16 -18 et Frédérick Douzet, Béatrice Giblin, « Frontières urbaines : frontières choisies, frontières subies », in Frédérick Douzet, Béatrice Giblin (dir.), Des Frontières indépassables? Des frontières d'états aux frontières urbaines, Paris : Armand Colin, 2013, p. 211.
174 Ce mot a un double sens en Colombie, il désigne traditionnellement la « marmite » et il signifie dans le langage familier le « trou » ou le « fond du trou » ; il est utilisé, par exemple, pour indiquer un endroit dangereux ou une piètre situation.
63
avec les petits. Les enseignants doivent rentrer et sortir en taxi escortés par une personne du quartier175 .
Pour revenir à notre sujet de recherche, nous allons examiner deux séries, Ambulantes176 (Mexico 1992 - aujourd'hui) et Sleepers (Mexico 1999 - aujourd'hui), de Francis Alÿs. Ces séries nous interrogent sur l'entre-deux par rapport aux frontières urbaines. Dans ces deux projets, l'artiste collecte des images des habitants et de leurs façons d'habiter le centre-ville de Mexico.
Ambulantes est une archive photographique qui montre des vendeurs qui marchent en poussant ou en portant avec eux des marchandises. Ils sont couramment nommés ''vendeurs ou marchands ambulants''.

Avec ces photos, Francis Alÿs met l'accent sur l'idée du corps humain comme « un terrain de lutte177», sur les pratiques alternatives de l'espace publique et sur les économies informelles, symboles de résistance à la modernité178. Selon Cuauhtémoc Medina, ces gens ont l'air de se promener avec leurs articles qu'ils vendent ; l'on peut faire un parallèle avec leurs marches et celles réalisées par l'artiste179. Loin d'être des balades, ces activités, qu'ils exercent en marchant, leurs assurent la survie.
aujourd'hui
175 La réflexion autour des frontières urbaines à Cali en Colombie que je développe dans cette partie de ce texte a comme origine l'expérience comme enseignante que j'ai eu dans ce quartier.
176 Cf. « Centre cérémonial (III) L'économie ''souterraine'' » et « C'est votre toute dernière chance, avant la suivante ». Le Centre Historique de la ville de Mexico, op. cit., p. 73-85.
177 Sally O´Reilly, Le Corps dans l'art contemporain, trad. de l'anglais Lydie Échasseriaud, Paris : Thames & Hudson, 2010, p. 107.
178 Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 56.
179 Expats/Clandestines, op. cit., p. 12.
64
Image 26 : Francis Alÿs, Ambulantes, Mexico, 1992-

65
Image 27 : Francis Alÿs, Ambulantes, Mexico, 1992- aujourd'hui, Projection de diapositives
Ambulantes est présenté en tant que projection de diapositives dans des carrousels situés au niveau du regard du spectateur180 .
Aussi bien qu'Ambulantes, Sleepers (Dormeurs) documente la misère de la capitale mexicaine. Ce projet est une autre archive photographique, mise à jour chaque année par l'artiste et présentée en tant que projection de diapositives et aussi dans d'autres formes, comme par exemple, dans la revue anglaise The Big Issue, vendue par les sans-abri à Londres181 . Sleepers montre l'utilisation privée de l'espace publique : des sans-abri et des chiens en train de dormir par terre, sur des bancs, dans des parcs. Les photos sont prises horizontalement avec un cadrage au niveau du sol « pour éviter toute hiérarchie implicite avec le spectateur et pour mettre en avant le calme abandon de ces corps182 . » Les chiens et les humains sont mis sur le même plan, ils sont, tous les deux, les sans-abri du centre ville de Mexico.

180 Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 56
181 Dans le catalogue de l'exposition Francis Alÿs : El profeta y la mosca, l'on parle de 80 personnes et chiens photographiés. Francis Alÿs : El profeta y la mosca, op. cit., p. 34.
182 Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 96
66
Image 28 : Francis Alÿs, Sleepers, Eje central, 2000, Projection de diapositives
Ambulantes et Sleepers montrent des frontières urbaines qui s'établissent dans la ville à un moment donné. Les protagonistes de ces deux projets construisent un espace dans lequel ils habitent pendant un certain temps. Ce sont des espaces temporels car la condition de vendeur ambulant et de sans-abri n'est pas permanente pour ces personnes. Cet espace construit est une sorte de superposition aussi temporaire, étant donné que ces personnes sont littéralement superposées au sol ou à la rue sur laquelle ils se déplacent. Dans les photos d'Ambulantes et de Sleepers, les protagonistes sont montrés dans une situation de vie qui manifeste toute leurs vulnérabilité et fragilité, ils sont comme des points de passage qui permettent aux spectateurs d'aller vers une réalité inabordable et insaisissable par sa cruauté. Le dispositif de Francis Alÿs, nous propose une distance vis-àvis de cette réalité cruelle. En termes de l'artiste, ceci nous fait « repenser notre convivialité183» car c'est cette distance du dispositif qui nous permet de nous interroger et de nous approcher de cette réalité et de la reconsidérer184
183 Ibid., p. 96
184
À propos de Sleepers, Carlos Monsiváis écrit : « Le Centre de la ville de Mexico, endroit d'une singularité extrême, mélancolique et dramatique. Francis Alÿs vit l'expérience de l'art et de la société qui s'annonce comme un ensemble de projets et de réalisations. Il n'y a ni prêche ni conclusions, il s'agit seulement d'une élaboration insistante qui nous conduit à examiner et à reconsidérer notre point de vue. » Le Centre Historique de la ville de Mexico, op. cit., p. 95.

67
Image 29 : Francis Alÿs, Sleepers, República de Brasil, 2003, Projection de diapositives
L'ENTRE-DEUX DU VOYAGE ET DE L'EXIL
3.1 Albanian Stories
Albanian Stories (Contes albanais) est la première vidéo185 d'Adrian Paci. Elle a été réalisée quand l'artiste est arrivé en Italie en 1997 pour s'installer avec sa famille 186. Cette vidéo en couleur de sept minutes et huit secondes montre la petite fille de trois ans de l'artiste, Jolanda, en train de raconter une histoire à ses poupées187 en face de la caméra vidéo. Jolanda raconte les bouleversements socio-politiques de l'Albanie à la fin des années quatre-vingt-dix188, qu'elle a vécus avant de partir pour l'Italie avec sa famille. Dans son conte, les personnages sont un coq, un chat, un cochon et une vache, lesquels interagissent avec des forces internationales et des forces obscures qui arrivent en Albanie. Le coq, le chat, et la vache représentent les citoyens, l'entourage de Jolanda ou sa propre famille. Les personnages sont effrayés par la guerre et par la mort, souffrent et pleurent du fait d'être séparés de leurs pays d'origine et de devoir s'adapter à la nouvelle situation dans le pays d'accueil189. La famille représentée par ces animaux part vers l'Italie en laissant une grandmère vache triste en Albanie190 .
185 Adrian Paci affirme que cette vidéo est une introduction à la vidéo A Real Game (que nous avons déjà examinée dans le chapitre antérieur). Adrian Paci, A Real Game, 1999, Galerie Peter Kilchmann [en ligne], [consulté le 29 janvier 2014]. Disponible sur le web <http://www.peterkilchmann.com/artists/available-works/++/name/adrianpaci/id/21/media/paci10194.jpg/> L'artiste dit aussi qu'avec cette première vidéo, il a arrêté d'inventer des formes pour commencer à travailler avec ce qu'il rencontrait dans la réalité. Marie Fraser et Marta Gili, « Entretien avec Adrian Paci », op. cit., p. 33.
186 Adrian Paci, A Real Game, 1999, op. cit.,[en ligne].
187 Edi Muka, « Engendrer la réalité », op. cit., p. 76.
188 Pour une description des événements en Albanie cf. Chapitre 2 « L'entre-deux comme frontière », p. 60.
189 Marie Fraser et Marta Gili, « Entretien avec Adrian Paci », op. cit., p. 33 et Edna Moshenson, « Sujets en transit », op. cit., p. 45.
190 Adrian Paci, A Real Game, 1999, op. cit., [en ligne].
CHAPITRE 3
68


69
Image 31: Adrian Paci, Albanian Stories, 1997, Vidéo, couleur, son, 7' 08''
Image 30: Adrian Paci, Albanian Stories, 1997, Vidéo, couleur, son, 7' 08''
Nous transcrirons ensuite un extrait des paroles de Jolanda prises de cette vidéo pour mieux comprendre la construction de l'histoire :
« Il était une fois un coq191 et un chat et puis un jour, les forces sont arrivées. Le coq et le chat jouaient comme ça, quand les forces obscures sont arrivées et ont mis le feu près du mur. Le coq a eu peur et le chat lui a dit, n'aie pas peur car les forces internationales arriveront, Quand les forces internationales sont arrivées, le coq et le chat ont dit ''Salut'' forces internationales et elles ont dit ''Salut'' coq et chat. Un jour les forces internationales sont revenues et le coq et le chat ont dit ''Salut'' et elles ont dit ''Salut'' coq et chat. Et elles ne les ont pas tués parce que le coq et le chat et la vache avec les filles et le mari sont allés en Italie. Ils ne sont pas restés en Albanie. Ils avaient une mère vache qui était triste parce qu'ils sont partis parce qu'il y avait des forces obscures et ils voulaient venir en Italie192 »
191 « Once upon a time there was a cock and a cat and then one day came the forces. The cock and the cat were playing like this, when came the dark forces who made a flame near the wall. The cock was frightened and the cat said to him, don't be afraid because the international forces will come, When the international forces came, the cock and the cat said ''Hi'' international forces and they said ''Hi'' cock and cat. One day the international forces came again and the cock and the cat said ''Hi'' and they said ''Hi'' cock and cat. And they did not kill them because the cock and the cat and the cow with the daughters and the husband went to Italy. They didn't stay in Albania. They had a cow mother that was sad because they went away because there were the dark forces and they wanted to come in Italy. »
192 J'ai respecté les sauts des lignes et la ponctuation de la transcription des paroles du catalogue de l'exposition Adrian Paci (commissaire : Angela Vettese), Galeria Civica di Modena, Milan : Edizioni Charta, 2006, p. 39.
70
Dans cette vidéo, ainsi que dans la vidéo A Real Game, la relation entre fiction et réalité193 est de nouveau présente dans la construction de l'histoire. De même, est présente l'idée, avancée par Edi Muka et déjà évoquée dans le chapitre 2 « L'entre-deux comme frontière », de notre travail, d'une image complexe qui se construit à partir de deux images, à savoir, une première image d'une petite fille qui raconte une histoire, dans laquelle elle mêle fiction et réalité, et une deuxième image que nous, les spectateurs, construisons simultanément à partir de ce que nous écoutons. C'est ce que le critique et commissaire albanais Edi Muka a nommé « l'image à l'intérieur de l'image194 ».
La vidéo Albanian Stories nous intéresse parce que celle-ci nous approche de la notion d'exil195 à travers des éléments essentiels pour notre réflexion en ce qu'elle nous permet de construire la notion de l'entre-deux de l'exil. Ces éléments sont les suivants : le voyage, l'entre-deux cultures et l'exil.
3.1.1 Le voyage
Le voyage est inscrit de manière déterminante dans les vies d'Adrian Paci et de Francis Alÿs, dans la mesure où il a marqué une profonde transformation dans leurs pratiques professionnelles. Adrian Paci quittera l'Albanie pour aller vivre en Italie et Francis Alÿs quittera la Belgique pour aller vivre au Mexique.
Adrian Paci est né dans la ville de Shkodër, en Albanie, en 1969. Il a étudié l'art dans sa ville natale et à l'Académie des Arts à Tirana en 1987. Pendant sa dernière année d'études, le régime communiste est tombé. En 1992, il est arrivé en Italie pour la première fois, avec une bourse en poche pour étudier l'option ''Art et Liturgie'' dans l'Institut Beato Angelico à Milan. En 1995, il est retourné en Albanie pour travailler à l'Université de Shkodër en donnant des cours d'Histoire de l'art et d'Esthétique. En 1997, à cause de la difficile situation sociale et politique en Albanie, il a décidé d'aller vivre à Milan avec sa famille196 . Adrian Paci avait été formé dans la tradition classique de l'art et, selon lui, il s'est senti très gêné par l'art contemporain en arrivant en Italie car, en Albanie, l'art n'allait que jusqu'à
193
Cf. Chapitre 2 « L'entre-deux comme frontière », p. 46-62.
194 Edi Muka, « Engendrer la réalité », op. cit., p. 76.
195 La notion d'exil est présente aussi, de manière très claire, dans plusieurs œuvres d'Adrian Paci, comme par exemple dans Back home (Retour à la maison) de 2001, que nous n'examinerons pas dans ce mémoire. Pour en savoir plus sur cette œuvre cf. Éric de Chassey, « Back Home. La peinture d'Adrian Paci », in Adrian Paci : Transit, op. cit., p. 68-71.
196 Adrian Paci, (commissaire : Angela Vettese), op. cit., p. 15, 17 et 33.
71
l'Impressionnisme
197
Son histoire personnelle est marquée par les vingt-deux ans qu'il a vécus sous le régime communiste et par l'écroulement postérieur de celui-ci, par son départ de l'Albanie et l'arrivée en Italie avec sa famille. Ces événements sont présentés de manière très claire dans les œuvres de l'artiste datant de ce premier moment de survie en Italie 198, comme par exemple dans les vidéos Albanian Stories de 1997, A Real Game de 1999 et Believe Me I Am an Artist de 2000. L'artiste va donner à ce contexte socio-politique et personnel qui détermine son travail l'ampleur d'« une réflexion sur la condition humaine aux quatre coins du monde199», comme l'affirme Edi Muka dans son analyse de la vidéo Albanian Stories. Dans un entretien récent de Marie Fraser et de Marta Gili, commissaires de l'exposition Adrian Paci, Vies en transit, l'artiste déclare au sujet de ses transformations et des décisions prises dès la fin des années quatre-vingt-dix en relation à son travail artistique :
Le but n'est pas de décrire cette transformation mais de l'analyser dans ses multiples facettes. Mon ambition étant de créer un lien entre avant et après, entre ici et là-bas, mon travail se situe souvent dans un entre-deux, dans un moment de transition, à un seuil. […] J'essaie de décortiquer ces moments de tension, les décalages que j'observe dans des domaines qui me sont très proches, mais qui m'intéressent pour leur portée plus large, plus universelle200 .
D'autre part, Francis Alÿs est né à Anvers, en Belgique, en 1959. Il a étudié l'architecture à l'Institut d'Architecture de Tournai en Belgique, de 1978 à 1983, et à l'Instituto Universitario di Architectura à Venise entre 1983 et 1986. Après le tremblement de terre de 1985 au Mexique, l'artiste va collaborer aux projets de renouvellement de la ville dévastée de Mexico en tant qu'architecte. En 1989, l'artiste déménage définitivement au Mexique et s'installe dans son atelier au centre-ville de Mexico. Depuis cette époque, il a commencé à explorer son nouveau contexte urbain à partir des interventions architecturales et sculpturales201 dans le domaine de l'art contemporain, comme par exemple l'intervention Placing Pillows, de même que l'action The Collector, deux créations réalisées à Mexico en 1990. En rapport à ce premier moment de changement de contexte géographique et à sa pratique artistique Francis Alÿs dit ceci: « […] les premières œuvres – je ne les appellerai
197 Ibid., p. 15.
198 Ibid., p. 20.
199 Edi Muka, « Engendrer la réalité », op. cit., p. 76.
200 Marie Fraser et Marta Gili, « Entretien avec Adrian Paci », op. cit., p. 32.
201 Information reprise de la Biographie de l'artiste du catalogue d'exposition Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 196.
72
pas œuvres - mes premières images ou interventions étaient en grande mesure une réaction à la ville de Mexico, une façon de me situer dans cette entité urbaine colossale202».
Nous pouvons maintenant nous demander ceci : A quel point ou dans quelle mesure le déplacement participe-t-il à la notion de l'entre-deux de l'exil ? Est-ce que le voyage est un entre-deux ?
Commençons par reprendre la définition de voyage que donne le dictionnaire étymologique, en tant que « chemin à parcourir » et « allée et venue d'un endroit à un autre203 ». Par ailleurs, selon le philosophe et psychanalyste Daniel Sibony, le voyage est un entre-deux lieux ou un entre-deux mentalités204. Dans sa définition, le voyage n'est pas seulement le déplacement physique d'un endroit à un autre, il est aussi la distance qu'un individu peut prendre de lui-même pour se repenser, se comprendre, se reconstituer, se transformer. Dans ce cas, la mémoire est un élément très important de ce processus. Chez cet auteur, le voyage en tant qu'entre-deux est aussi le déplacement du corps entre deux lieux qui permet de mieux saisir le lieu d'origine : mettre de la distance entre soi et ses racines. Daniel Sibony affirme :
Aller loin, mettre de la distance pour mettre à nu ce qui est proche, et déjà pour le voir, le percevoir. Aller produire l'entre-deux où l'espace apparaisse et où le temps devienne sensible. Étrange et simple d'aller là-bas se relancer l'imaginaire sur le vide des choses élémentaires ; pour imaginer ce qui est ici. Aller ailleurs pour mieux revoir ici d'ailleurs, de l'ailleurs invisible qui est ici. Ce n'est pas un simple jet, une jonction entre deux lieux, mais un travail de corrosion et de subtiles métamorphoses de l'un par l'autre et de soi par les deux205
Ce déplacement dans l'espace nommé voyage est conçu en même temps comme voyage de transformation et de redécouverte de soi-même. Dans ce sens, cette notion est le fil conducteur du projet intitulé Déplacements, une exposition collective de 2003 au Musée d'art moderne de la ville de Paris, dans laquelle Francis Alÿs a participé. Le titre de l'exposition est inspiré du livre Déplacements de l'écrivain italien Claudio de Magris. Le
202 La traduction en français de cette citation est mienne. Le texte en espagnol dans le catalogue dit : « […] las primeras obras – no las llamaría obras-, mis primeras imágenes o intervenciones fueron en gran medida una reacción a la Ciudad de México, una manera de situarme a mí mismo en esta colosal entidad urbana ». Russell Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », op. cit., p. 3.
203 Dictionnaire Étymologique de la langue française, op. cit., p. 679.
204 Dans son livre, l'auteur utilise des guillemets pour écrire ''l'entre-deux- « mentalités »''. Daniel Sibony, Entre-deux :L'origine en partage, op. cit., p. 302.
205 Ibid., p. 305.
73
voyage est ici pensé en tant que quête identitaire qui montre la fragilité et la précarité du voyageur206 , car l'espace n'est plus compris, depuis longtemps, comme un concept neutre mais « comme un principe actif dans la formation des identités207 » De même que Daniel Sibony, dans le chapitre Récits d'espace, Michel de Certeau affirme que le voyage : « se construit sur l'établissement d'un ''ailleurs208'' ». Les idées de voyage, de déplacement dans l'espace et de récit s'articulent dans l'idée du récit vu comme « récit de voyage » et « pratique d'espace209 ». Nous pouvons rapprocher cette dernière idée de Michel de Certeau à la vidéo The Column (La Colonne) d'Adrian Paci Cette vidéo en couleur de 25 minutes et 40 secondes, réalisée en 2013, spécialement pour l'exposition Vies en Transit au Jeu de Paume de Paris, montre la transformation d'un morceau de marbre en colonne classique dans un bateau qui fait le voyage de l'Orient vers l'Occident. Ce sont des « naviresusines210 » dans lesquels, sont fabriqués des biens commercialisables, pendant le temps du voyage, à partir des matières premières présentes à bord. Adrian Paci a réalisé ce projet en partant de l'idée d'un voyage « conforme avec la logique de profit capitaliste : une mise en coïncidence entre le temps de la production et le temps du transport211 » La vidéo montre le processus du travail depuis l'extraction du marbre, en passant par le transport avec une grue dans le bateau, le travail d'un groupe de cinq travailleurs asiatiques sur le bloc de marbre pendant le temps du voyage jusqu'à sa transformation en forme de colonne.
A la fin du processus, la colonne sera transportée à Paris et installée dans le Jardin des Tuileries. Cette dernière partie n'est pas incluse dans la vidéo, mais le spectateur pouvait en sortant de l'exposition trouver la colonne juste à côté de l'entrée du Jeu de Paume212 .
206
Déplacements : Multiplicity, Deimantas Narkevicius, Nicolas Moulin, Dorit Margreiter, Bojan Sarcevic, Une agora réunionnaise, Francis Alÿs (commissaires : Laurence Bossé, Hans Ulrich Obrist), Paris : Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, 2003, p. 5.
207 Ibid., p. 7.
208 Michel de Certeau, L'invention du quotidien, op. cit., p. 181.
209 Dans cette phrase, j'utilise les mêmes mots que l'auteur. L'idée précise de Michel de Certeau dit : « Tout récit est un récit de voyage, - une pratique de l'espace. » Michel de Certeau, L'invention du quotidien, op. cit., p. 171.
210 Marie Fraser et Marta Gili, « Entretien avec Adrian Paci », op. cit., p. 33.
211 Ibid., p. 33.
212 À propos de cette œuvre et de son arrivée au Jeu de Paume, cf. Adrian Paci : The Column at the Jeu de Paume, vidéo couleur, son, 11:33 min., Jeu de Paume, le magazine: Coulisses, 19 mars, 2013. Disponible sur le web <http://lemagazine.jeudepaume.org/2013/03/adrian-paci-the-column-at-jeu-de-paume/>.
Adrian Paci : The story of a stone, vidéo couleur, son, 6:39 min. Disponible sur le web <http://channel.louisiana.dk/video/adrian-paci-story-stone>.
74


75
Image 33 : Adrian Paci, The Column, 2013, Vidéo, couleur, son, 25' 40''
Image 32 : Adrian Paci, The Column, 2013, Vidéo, couleur, son, 25' 40''
En ce qui concerne les projets de voyage de Francis Alÿs, en tant que récits et pratiques d'espace mentionnés auparavant, nous pouvons mentionner les actions The Loop213 de 1997 et Don't Cross the Bridge Before you Get to the River214 de 2008. Cette dernière a été réalisée au détroit de Gibraltar en 2008. Elle montre comment avec l'aide d'un groupe d'enfants européens et africains, l'artiste a essayé de construire, sans succès, un pont entre les deux continents. Les enfants étaient dans l'eau, avec à la main un bateau fait à partir d'une chaussure tout en formant une ligne vers le continent d'en face ; c'est-à-dire que les enfants d'Europe étaient en direction du Maroc et ceux de l'Afrique en direction de l'Espagne. Les lignes composées d'enfants finiront par s'unir visuellement sur l'horizon. L'artiste nous indique, à travers cette façon de travailler la question politique par l'intermédiaire du mode poétique que « c'est l'absence de pont qui produit un récit dans lequel les chaussures deviennent des vaisseaux et les enfants des géants mythiques215 . » Cette manière de voyager de Francis Alÿs, nous rappelle sa façon de traverser les

213 Œuvre décrite dans le chapitre 2 de ce mémoire « L'entre-deux comme frontière »
214 Pour voir quelques images de l'installation de cette œuvre, cf. Francis Alÿs, Don't Cross the Bridge Before you Get to the River, Détroit de Gibraltar, 2009, Installation-vidéo, 11 Biennale du Charjah, 13 mars -13 mai, 2013. Disponible sur le web <http://vimeo.com/63551961>.
215 Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 166.
76
Image 34 : Adrian Paci, The Column au Jeu de Paume, Paris, 2013
frontières.
Or, Francis Alÿs a réalisé un projet en 2002, intitulé When Faith Moves Mountains (Quand la Foi Déplace les Montagnes), lequel nous permet d'établir un parallèle avec la vidéo The Column (La Colonne) d'Adrian Paci. When Faith Moves Mountains est une action collective, conçue par Francis Alÿs pour la Biennale de Lima en 2002216. L'artiste a conçu ce projet après avoir visité la ville, accompagné de Cuauhtémoc Medina en 2000217 , époque de la première Biennale de Lima et la toute fin de la dictature d'Alberto Fujimori218. L'action consistait à faire bouger une dune de sable de 10 centimètres de son emplacement original avec l'aide de 500 volontaires, des étudiants, équipés de pelles. La dune avait une longueur de 500 mètres219 When Faith Moves Mountains a été conservée sur des vidéos, photos et d'autres documents éphémères220. La maxime de cette action était : « effort maximum, résultat minimum221 ». De plus, l'action était une critique, de la part de l'artiste, du romantisme du Land Art de Richard Long et Robert Smithson222. À ce propos, Francis Alÿs a affirmé : « Ici, nous avons essayé de créer une sorte de Land Art pour les paysans sans terre, et, avec l'aide de centaines de personnes et des pelles, nous avons créé une allégorie sociale223 . »
216 Ibid., p. 127.
217 Russell Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », op. cit., p. 16-17.
218 Francis Alÿs : El profeta y la mosca, op. cit., p. 100-101 et Ibid., p. 17.
219 Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 127.
220 Francis Alÿs, When Faith Moves Mountains (making of), vidéo couleur, son, 15:06 min, Lima, 2002. Disponible sur le web <http://www.francisalys.com/public/cuandolafe.html>.
221 Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 127.
222 Ibid., p. 129 et Russell Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », op. cit., p. 17.
223 La traduction en français de cette citation est mienne. Le texte en espagnol dans le catalogue, dit : « Aquí, hemos tratado de crear una especie de Land Art para los sin tierra, y, con la ayuda de cientos de personas y palas, creamos una alegoría social. » Ibid., p. 17.
77
Image 35 : Francis Alÿs, When Faith Moves Mountains (Cuando la fé mueve montañas), Lima, 2002, Documentation vidéo, 36' et photographique d'une action

Image 36 : Francis Alÿs, When Faith Moves Mountains (Cuando la fé mueve montañas), Lima, 2002

78
L'endroit de l'action se situait près des dunes du district de Ventanilla224, le plus grand district de la Provincia Constitucional del Callao au Pérou, dans la périphérie de Lima. Il faut dire que le contexte social général de l'action avait lieu dans les villages, où des paysans déplacés par la guerre civile de 1980 s'étaient installés, petit à petit, dans le désert péruvien225. Ventanilla est habité aujourd'hui par des gens pauvres, qui vivent dans des conditions très précaires, avec une infrastructure insuffisante et avec des niveaux très élevés de pollution de l'environnement. D'après Russell Ferguson, le climat socio-politique de la fin de la dictature au Pérou était très tendu et agité et il exigeait « une réponse épique226 ». L'artiste a donné une réponse à cette situation, à sa manière, à travers une action éphémère qui n'a pas laissé de trace dans le désert, car le jour suivant l'action, il n'était même pas possible de distinguer quelle dune avait été déplacée. Pourtant l'action a eu un écho, elle s'est répandue oralement comme une anecdote, par les rumeurs des habitants de la zone, des participants à l'action et de tous ceux qui ont entendu parler de celle-ci. Francis Alÿs a expliqué l'effet que cette action avait cherché à susciter : « Nous essayions juste de suggérer une possibilité de changement, et ceci a provoqué, même le temps d'un jour, cette illusion que peut-être les choses pourraient changer227. »

224 Francis Alÿs : El profeta y la mosca, op. cit., p. 102.
225
226
227
Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 129.
Russel Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », op. cit , p. 17.
La traduction en français de cette citation est mienne. Le texte en espagnol dans le catalogue, dit : « Estábamos tratando solamente de sugerir una posibilidad de cambio, y provocó, aunque fuera por un día esta ilusión de que las cosas podrían acaso cambiar. » Ibid., p. 17.
79
Image 37 : Ventanilla, Pérou
Dans cette action, nous parlons d'un entre-deux existentiel, étant donné qu'à travers la participation dans cette action, les jeunes générations, les cinq-cent étudiants, ont pris littéralement en main leur territoire228. Même si ces étudiants-volontaires n'habitent pas l'endroit où la dune a été déplacée, ils ont eu la possibilité de participer à un projet directement liée aux problématiques du pays telles que celles des populations qui envahissent légalement ou illégalement le désert, la pauvreté, l'absence de transparence dans des projets politiques et le manque d'alternatives pour une réelle participation citoyenne. Nous pouvons parler ici de voyage dans le sens d'un mouvement dans l'espace. Si la colonne d'Adrian Paci avance vers sa destination sur l'eau, les étudiants et la dune de sable avancent dans le désert. C'est un voyage existentiel, c'est-à-dire qu'il a permis à ce que, pendant un instant, l'existence des gens du désert changent : c'est la tentative collective consistant à déplacer la dune, à maîtriser l'impossible du désert, leur réalité quotidienne qui est de vivre dans un environnement sans eau ni végétation. Il est question dans cette proposition de l'espace d'un instant évoqué par Francis Alÿs, auquel correspond « une vision différente de la situation, comme vécue de l'intérieur229 » ou du mirage dont l'artiste parle par rapport à son film A Story of Deception ; ce film a été réalisé en Patagonie entre 2003 et 2006 et est l'une des œuvres qui analyse, comme le fait When Faith Moves Mountains, le projet de modernisation en Amérique Latine230 Le thème du mirage ou de l'illusion est précisé par Francis Alÿs dans le passage suivant : « Tout comme c'est le combat qui définit l'utopie, c'est la vanité de notre tentative ce qui donne vie au mirage, c'est par l'obstination de notre tentative que le mirage vient à la vie231 […]. »
Il est alors intéressant de penser la dune du désert péruvien qui a été déplacée de 10 centimètres par une collectivité comme une métaphore du possible changement social en 228 Selon l'historien péruvien Mauro Vega, l'action de déplacer une dune pourrait signifier la capacité de transformer la nature, seulement possible grâce à la participation collective, de rendre habitable l'inhabitable. La ''montagne'' ou sa forme est une représentation très fréquente dans les anciennes cultures péruviennes. Aplatir ou déplacer la montagne pourrait signifier une rupture avec le passé : la montagne, la dune, la nature ne représentent plus aucune divinité ou force métaphysique. Dans le monde d'aujourd'hui, ce sont plutôt des obstacles au développement de la vie urbaine. Déplacer la dune c'est ritualiser une nouvelle relation à la nature. Conversation avec l'historien péruvien Mauro Vega à partir de la documentation vidéo de When Faith Moves Mountain de Francis Alÿs, le 21 octobre 2013.
229 Mark Godfrey (éd.), op. cit., p. 39.
230 Ibid., p. 139.
231 La traduction en français de cette citation est mienne. Le texte en espagnol dans le catalogue dit : « […] Lo mismo que es la lucha la que define a la utopía, es la vanidad de nuestro intento lo que da vida al espejismo, es por la obstinación de nuestro intento que el espejismo cobra vida […]. » Russell Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », op. cit., p. 3.
80
Amérique Latine, de même que la colonne de la vidéo d'Adrian Paci est une métaphore des transformations produites par le voyage sur les hommes et sur les choses, la possibilité, comme l'artiste l'a affirmé, du voyage de retour chez soi232
Dans ce mouvement physique, intérieur, existentiel qu'est le voyage, tout l'individu, dans toute sa complexité, est bouleversé. Dans la distance d'espace et de temps accordée par le voyage, tout se transforme, les lieux nouveaux et les anciens que l'individu parcourt, avec son corps ; c'est un état et un processus d'instabilité et de fragilité.
Souvent, le voyage fait de l'individu qui voyage un étranger dans le nouveau contexte. Ceci peut se produire quand le voyageur arrive dans un pays où la culture est différente à la sienne. Pourtant, il y a aussi le cas de l'individu qui se sent lui-même, ou qui est considéré par les autres, comme un étranger dans son lieu d'origine, comme l'affirme le sociologue Laurent Muller dans son essai « Les ''Digressions sur l'étranger'' selon Georg Simmel233 ». En effet, d'après Laurent Muller, la condition d'étranger chez Georg Simmel n'est pas définie par la nationalité mais par le fait de ne pas être reconnue par un groupe d'individus qui se connaissent et qui entretiennent entre eux des relations stables234 . Selon l'auteur, la condition d'étranger est une question de distance par rapport aux autres individus qui habitent le pays d'installation. L'étranger essaye de trouver sa place dans ce nouveau modèle culturel qu'est le pays d'installation et « à cause de son état transitoire, ne considère pas du tout ce modèle comme un asile protecteur, mais plutôt comme un labyrinthe dans lequel il a perdu tout sens de l'orientation235 »
3.1.2 L'entre-deux cultures
L'étranger dont nous parlons est cet individu pour lequel sa condition est celle d'être déterminée par le fait d'être entre deux cultures, donc celui qui habite entre-deux lieux et entre-deux mentalités, suivant la définition de Daniel Sibony.
Le terme culture peut se comprendre dans le sens utilisé par le philosophe Tzvetan
232 Marie Fraser et Marta Gili, « Entretien avec Adrian Paci », op. cit., p. 34.
233 Dans cet essai, l'auteur considère les points de vue de plusieurs auteurs qui ont discuté à propos du sujet de l'étranger : le sociologue et philosophe allemand Georg Simmel et le sociologue et philosophe autrichien Alfred Schutz, l'anthropologue et sociologue français David Le Breton et le sociologue américain et l'un des fondateurs de l'école de Chicago, Robert Ezra Park.
Laurent Muller, « Les ''Digressions sur l'étranger'' selon Georg Simmel », in Laurent Muller, Stéphane De Tapia (dir.), Migrations et cultures de l'entre-deux, Paris : L'Harmattan, 2010, op. cit , p. 33.
234 Ibid., p. 36.
235
Cette réflexion est d'Alfred Schutz, citée par Laurent Muller. Ibid., p. 34.
81
Todorov dans sa conférence intitulée Vivre ensemble avec des cultures différentes :
[…] c'est le nom donné à l'ensemble des caractéristiques de la vie sociale, aux façons de vivre et de penser collectives, aux formes et styles d'organisation du temps et de l'espace, ce qui inclut langue, religion, structures familiales, modes de construction des maisons, outils, manières de manger ou de se vêtir. De plus, les membres du groupe, quelles que soient ses dimensions, intériorisent ces caractéristiques sous formes de représentations. La culture existe donc à deux niveaux étroitement reliés, celui des pratiques propres au groupe et celui de l'image que ces pratiques laissent dans l'esprit des membres de la communauté236
L'idée de l'entre-deux des cultures reprend le sujet de recherche de Edward T. Hall Depuis 1963, l'anthropologue américain s'interroge sur l'espace que l'homme édifie entre lui et les autres, dans son lieu de travail et chez soi237 et comment cet espace est différent selon la culture238. D'après l'auteur, « […] les individus appartenant à des cultures différentes, […] habitent des mondes sensoriels différents239 » Il a créé le terme ''proxémie'' pour rassembler son objet d'étude. Il donne la définition du terme dans son livre La dimension cachée : « Le terme de ''proxémie'' est un néologisme que j'ai créé pour designer l'ensemble des observations et théories concernant l'usage que l'homme fait de l'espace en tant que produit culturel spécifique240 . » Edward T. Hall a étudié la régulation de la distance et le comportement social aussi bien chez les animaux que chez les hommes dans une proxémie comparée des cultures française, allemande, américaine, japonaise et arabe. Il a identifié quatre distances chez l'homme : « intime, personnelle, sociale et publique (chacune comportant deux modes, proche et lointain241). », lesquelles varient par rapport à l'environnement de l'homme et par rapport à sa condition d'être ou de se sentir d'étranger dans l'espace où il habite.
236 Tzvetan Todorov, « Vivre ensemble avec des cultures différentes », conférence, Migrants, un avenir à construire ensemble : Semaine sociale de France, 85e session, Paris [en ligne], 2010 [consulté le 27 février 2014]. Disponible sur le web <http://www.ssf-fr.org/offres/file_inline_src/56/56_P_20289_2.pdf>.
237 Edward T. Hall, La dimension cachée, trad. de l'anglais (États-Unis) Amélie Petita, Paris : Éditions du Seuil, 1971, p. 9.
238 Cf. « L'utilisation de l'espace dans les différentes cultures » et « L'espace en tant que facteur de contact culturel » dans Edward T. Hall, Le langage silencieux, trad. de l'anglais (États-Unis) Jean Mesrie et Barbara Niceall, Paris : Éditions du Seuil, 1984, p. 192 - 215.
239 Edward T. Hall, La dimension cachée, op. cit , p. 15.
240 Ibid., p. 13.
241 Ibid., p. 144. Pour en savoir plus cf. Chapitre 10 « Les distances chez l'homme », Ibid., p. 147- 160.
82
3.1.3
L'entre-deux de l'exil
Turista (Touriste) est une action réalisée par Francis Alÿs le 10 mars 1994 à Mexico, laquelle a été documentée sur des photos242. Les documents montrent un groupe d'hommes, dont parmi eux Francis Alÿs, qui se tiennent debout en formant d'une rangée, le long de la grille de la cathédrale de Mexico, celle-ci étant située sur la place principale nommée ''Zócalo243''. Sur le sol, en face de chaque travailleur, il y a une pancarte de couleurs diverses sur laquelle est écrite le service qui est proposé par le travailleur. Ils proposent les services de plombiers, peintres, électriciens, charpentiers, etc. Francis Alÿs propose celui de touriste.

242 La description de cette œuvre dans le catalogue Francis Alÿs : el profeta y la mosca, parle d'une photographie faite avec un objectif grand angle, permettant ainsi un cadrage plus large. Francis Alÿs : El profeta y la mosca, op. cit , p. 32.
243 Zócalo, en français socle, est la place principale de Mexico. Le nom officiel de cet espace public monumental est celui de la Place de la Constitution mais son nom populaire est Zócalo. Cette place était à l'époque préhispanique un centre cérémoniel très important des Aztecas, Tenochtitlan. Zócalo (Plaza de la Constitución), Ciudad de México.com.mx [en ligne], [consulté le 20 janvier 2014]. Disponible sur le web <http://www.ciudadmexico.com.mx/atractivos/zocalo.htm>.
83
Image 38 : Francis Alÿs, Turista, Mexico 1994, Documentation photographique d'une action
Dans cette action, Francis Alÿs offre son travail d'artiste en tant que touriste, c'est-à-dire en tant qu'« observateur professionnel244 » au même niveau que ceux des autres travailleurs. L'artiste nous donne sa réflexion à ce propos :
À ce moment précis, je crois qu'il s'agissait de mettre en question ou d'accepter les limites de ma condition d'étranger, de ''gringo245''. Jusqu'à quel point puis-je appartenir à cet endroit? Dans quelle mesure je peux le juger? En proposant mes services comme touriste, je fluctuais entre l'oisiveté et le travail, la contemplation et l'interférence. J'étais en train de vérifier et de dénoncer ma propre condition. Dans quel lieu, je me trouve vraiment246 ?
D'après Russell Ferguson, dans ces premières œuvres, Francis Alÿs était encore en position de spectateur dans son nouveau contexte247, Mexico. L'artiste a utilisé plusieurs fois sa condition de voyageur et de touriste comme une identité, dans l'action Turista aussi bien que dans les actions Narcoturismo, réalisée à Copenhague en 1996, et The Loop en 1997248. Cette position de touriste et de voyageur, d'après Thierry Davila, lui a permis de faire « du déplacement une raison d'être, un acte social à part entière, un travail249 »
L'idée d'exil chez Francis Alÿs, particulièrement dans l'action Turista, peut se comprendre comme cette prise de distance, de conscience, du besoin et de la recherche d'une place pour lui-même dans le centre-ville de Mexico dans les années quatre-vingt-dix. Or, c'est aussi en tant que marcheur, comme « touriste éclairé » et avec « sa posture d'exilé250 » qu'il a continué à pénétrer les flux de la ville251 avec d'autres interventions dans les années suivantes. Cela veut dire que, en tant qu'observateur, il est comme un étranger qui regarde et analyse avec une certaine distance les contextes spécifiques dans lesquels il travaille. Également, pour Michel de Certeau, la marche est en relation avec la recherche d'un lieu, il affirme : « Marcher, c'est manquer de lieu. C'est le processus indéfini d'être
244 Francis Alÿs : A Story of Deception, op. cit., p. 61.
245 ''Gringo'' c'est le nom populaire, parfois péjoratif, donné par les gens d'Amérique centrale et du sud aux citoyens des États-Unis. Francis Alÿs a fait une action intitulée Gringo en 2003 à Mexico, enregistrée en vidéo. Cette œuvre montre comment des chiens protègent leur territoire, leur maison et leur maître d'un inconnu qui porte à la main une caméra vidéo, que l'homme utilise comme un bouclier protecteur.
246 La traduction en français de cette citation est mienne. Le texte en espagnol dans le catalogue, dit : « En ese momento pienso que se trataba de cuestionar o aceptar los límites de mi condición de extranjero, de ''gringo''. ¿Qué tanto puedo pertenecer a este lugar ? En qué medida puedo juzgarlo ? Al ofrecer mis servicios como turista oscilaba entre el ocio y el trabajo, la contemplación y la interferencia. Estaba comprobando y denunciando mi propia condición. ¿En qué lugar me encuentro realmente ? » Russell Ferguson, « Francis Alÿs : Política del Ensayo », op. cit., p. 4.
247 Ibid., p. 10.
248 Thierry Davila, Marcher, créer, op. cit., p. 18-19.
249 Ibid., p. 18.
250 Ces deux expressions ''touriste éclairé'' et ''posture d'exilé'', aussi bien que l'idée de ce paragraphe sont reprises du texte sur Francis Alÿs dans le catalogue d'exposition Expats/Clandestines, op. cit., p. 10.
251 Ibid., p. 10.
84
absent et en quête d'un propre252 »
Cette dernière citation de Michel de Certeau peut se comprendre et se mettre en relation avec l'art contemporain, comme dans l'œuvre Home to Go (Un toit à soi) d'Adrian Paci Home to Go est une série de neuf photographies de 103 x 103 cm de dimension pour chacune, réalisée en 2001. Adrian Paci apparaît torse nu, portant un sous-vêtement blanc et une sorte de toit en tuiles romaines attaché au dos avec une corde. Les photos présentent l'artiste dans des positions différentes, parfois couché sur le toit qu'il porte, d'autres fois appuyé sur ses genoux et sur un de ses bras ou debout, courbé par le fardeau pesant. Ces photos sont issues d'une performance253 et il existe aussi une sculpture réalisée en parallèle qui porte le même titre254. La série photographique Home to Go, nous montre un homme qui essaie de se redresser malgré un grand poids qui pèse sur ces épaules et sur son dos. Le spectateur peut imaginer que cet homme essaye d'avancer, de marcher.
Cette œuvre parle explicitement du chez-soi ou du retour chez soi, comme l'artiste l'a affirmé dans l'entretien qu'il a donné aux commissaires de l'exposition individuelle à Paris, Marie Fraser et Marta Gili ; il définit le chez-soi de la manière suivante :
[…] ce n'est pas seulement la maison, le toit, la famille ; c'est aussi un état de stabilité, de lien, d'affection et d'identification à quelque chose. Pour moi, le retour chez soi n'évoque pas la question de l'émigration, mais une question plus profonde sur la quête d'une stabilité perdue. Dans un contexte de transformation et de mutation de fond, nous nous devons d'élaborer des stratégies de survie et de continuité, et l'idée du retour chez soi en fait partie255
Selon Edna Moshenson, dans son essai « Sujets en transit », le fragment de toit que l'artiste porte sur le dos fait référence aux maisons en ruines résultant de la guerre dans la ville natale d'Adrian Paci, Shkodër, celle-ci ayant l'uniformité de l'architecture communiste de l'époque256. En outre, ce fragment de toit est « un abri, un morceau de mémoire, une cargaison d'histoire, de culture, de tradition, de famille, mais aussi un fardeau, une responsabilité et un engagement257 . » Home to Go est caractérisé comme un objet
252 Michel de Certeau, L'invention du quotidien, op. cit., p. 155.
253 Adrian Paci, Vies en transit, op. cit., non paginé.
254 La sculpture Home to go est un moulage en poudre de marbre et résine. Pour en savoir plus sur cette sculpture cf. Edna Moshenson, « Sujets en transit », op. cit., p. 44.
255 Ibid., p. 34.
256 Ibid.,p. 44.
257 Ibid., p. 44.
85
« hybride258 » par Edna Moshenson et comme une métaphore de l'exil par la critique d'art italienne Angela Vettese259 ; il représente notre figure de l'entre-deux de l'exil. Cet homme est tiraillé par ce morceau de toit, lequel représente son passé, son présent, son futur ; c'est à la fois un lest, une protection, un refuge, un fardeau. Pourtant, cet homme ne peut pas se débarrasser de son morceau de toit, ça lui appartient. Ce n'était pas le cas avant : quand il était chez lui, il ne portait pas ce morceau de toit, il était comme les autres hommes autour de lui ; il s'agit de sa nouvelle condition depuis qu'il est parti de chez lui. D'après les mots d’Edna Moshenson, c'est « un homme-maison260 fusionnant des paires conceptuelles telles que lieu et non-lieu, mobilité et immobilité, mouvement et arrêt, identité solide et identité fluide, sujet et objet [...]261 ».
Sur ce point, nous pouvons nous interroger de cette façon : Qu'est-ce-que l'entre-deux de l'exil ?
Contrairement à l'entre-deux spatial et à l'entre-deux comme frontière, l'entre-deux de l'exil aussi bien que l'entre-deux existentiel sont en relation directe avec l'homme, avec son vécu et avec son expérience. Edward W. Said définit l'exil de manière tragique262 : « C'est la fissure à jamais creusée entre l'être humain et sa terre natale, entre l'individu et son vrai foyer, et la tristesse qu'il implique n'est pas surmontable263 . » Il différencie les exilés des réfugies, des émigrés et des expatriés en réfléchissant à ce que cela implique pour ces personnes d'être dans l'impossibilité de retourner chez eux. Selon lui, les réfugiés, c'est un groupe qui est parti de son chez-soi, la plupart du temps pour des raisons politiques, et qui a besoin de l'aide internationale ; les émigrés et les expatriés sont proches en genre car ils sont partis de chez eux et, du fait d'un choix personnel, ils ont émigré vers un nouveau pays et, parfois, ils ont subi « l'aliénation et de la solitude de l'exil264 » ; finalement, Edward W. Said va distinguer les exilés des autres catégories par « une forme de solitude et de
258
Ibid., p. 45. Le terme ''hybride culturel'' est employé par Laurent Muller pour désigné « le Juif, l'étranger, le migrant etc., en fait l'Autre [...] ». Laurent Muller, « Les ''Digressions sur l'étranger'' selon Georg Simmel », op. cit., p. 40.
259 Angela Vettese, « Adrian Paci, Conversation », in Adrian Paci (commissaire : Angela Vettese), Galeria Civica di Modena, Milan : Edizioni Charta, 2006, p. 22.
260 Cet « homme-maison » fait référence aux images du Christ portant la croix et à l'ange tombé de la tradition chrétienne. Edna Moshenson, « Sujets en transit », op. cit., p. 44, Angela Vettese, « Adrian Paci, Conversation », op. cit., p. 44 et Giacinto Di Pietrantonio, « Answer to », in Adrian Paci (commissaire : Angela Vettese), Galeria Civica di Modena, Milan : Edizioni Charta, 2006, p. 103.
261 Edna Moshenson, « Sujets en transit », op. cit., p. 45.
262 Edward W. Said, Réflexion sur l'exil et autres essais, trad. de l'anglais (États-Unis) Charlotte Woillez, Arles : Actes Sud, 2008, p. 253.
263 Ibid., p. 241.
264 Ibid., p. 250.
86
spiritualité265 » L'exil d'Edward W. Said consiste en une perte d'orientation266 pour l'individu, cette caractéristique étant aussi présente dans la notion d'étranger énoncée par Laurent Muller
265 Ibid., p. 250.
266 Ibid., p. 257.

87
Image 39 : Adrian Paci, Home to Go, 2001, 9 photographies, 103 × 103 cm chaque

88
Image 40 : Adrian Paci. Vies en transit, Jeu de Paume, Paris, 2013. Photo: Romain Darnaud © Jeu de Paume
De surcroît, Michel Gironde définit l'exil autour de deux formes et à travers deux auteurs différents dans son livre Méditerranée et Exil aujourd'hui : Jean-Pierre Morel et Milan Kundera. De Jean-Pierre Morel, il va reprendre une définition qui va dans le même sens que celle d'Edward W. Said : « […] le bannissement et la souffrance de la patrie perdue267 ». En revanche, la définition de Milan Kundera est une vision plus proche de celle qui a été proposée en examinant Turista et Home to Go de Francis Alÿs et d'Adrian Paci. Michel Gironde reprend l'idée d'exil de Milan Kundera :
[…] l'épreuve de l'exil consistant à transformer la contrainte du bannissement en choix de vivre ailleurs […]. L'épreuve de l'exil se sublimerait alors en une densification de l'accomplissement de soi : une deuxième vie, une deuxième langue, une deuxième création, mais en accord avec les aspirations profondes de la première vie, la première langue, la première création.
Or, si l'exil est défini par l'auteur comme un déplacement d'une première position (une vie, une langue, une création) vers une deuxième, il nous semble important d'insister à cet endroit sur le fait que la deuxième ne se substitue pas à la première. La dimension d'entredeux de l'exil souligne le fait que ce déplacement d'une place à l'autre n'est pas un mouvement unidirectionnel ni définitif, qui se réaliserait une fois pour toutes, mais consiste plutôt dans une mise en suspension qui implique une situation indécidable de va-et-vient. C'est d'ailleurs dans ce sens que Cihan Gunes examine les notions de rencontre, de dimension interculturelle et d'exil en reprenant la notion d'entre-deux de Daniel Sibony, lorsqu'il dit :
Avec la notion d'entre-deux, il souligne l'idée d'un mouvement, d'un déplacement, d'un passage entre deux états qui ne se fait jamais soudainement (et j'ajouterais même complètement), mais qui est de l'ordre d'une traversée qui appelle à des mouvements incessants de va-et vient.[...]268
En effet, la relation entre les notions de voyage et d'entre-deux de l'exil s'établit étant donné que le voyage ne se limite pas au déplacement physique d'un endroit à un autre, il est constitué d'un va et vient, entre ici et là-bas, entre présent, passé et futur, entre cultures ; ce voyage tresse, peu à peu, la condition d'hybride mentionnée auparavant par Edna
267 Michel Gironde (dir.), « Introduction : Penser & écrire l'exil », in Méditerranée et Exil aujourd'hui, Paris : L'Harmattan, 2013, p. 9.
268 Cihan Gunes, Exil et précarité, l'entre deux de l'accueil, intervention Journées Paroles sans frontières, Association de psychanalyse interculturelle à l’épreuve du terrain [en ligne], 23 mars 2011 [consulté le 25 septembre 2013]. Disponible sur le web <http://www.p-s-f.com/psf/spip.php?article272>.
89
Moshenson et par Laurent Muller En revenant aux exemples décrits précédemment, Turista et Home to Go, nous pouvons ajouter que ces projets montrent Francis Alÿs et Adrian Paci au premier plan des situations présentées : il s'agit de deux hommes se présentant dans des conditions de survie par rapport à un nouveau contexte, chacun dans des endroits et dans des conditions différentes. Ce sont des situations existentielles, qui ont en commun des notions qu'Adrian Paci a plusieurs fois mentionnées comme essentielles dans sa démarche artistique : la vulnérabilité, la fragilité et l'instabilité269. Ces conditions existentielles associées à ce que nous avons appelé l'entre-deux de l'exil sont exprimées de manière éloquente par cette réflexion de Francis Alÿs :
Je pense que je suis plutôt d'ici mais je ne le suis pas. Ou bien que je ne le suis pas mais je le suis. C'est un piège. C'est drôle, il faut que l'on quitte l'endroit d'où l'on vient pour que l'on vous demande si vous en faites partie. Été 2006, déménagement temporaire de la famille en Europe, retour au vieux continent accompagné de la sensation d'être complètement déplacé après plus de vingt années d'absence. Entre deux eaux, local et immigré, tout trop familier et étranger à la fois270
269 Adam Budak, « Face au toucher ou ''Quand nos yeux se touchent...''», Adrian Paci : Transit, op. cit., p. 96 et « Adrian Paci in conversation with Mirjam Varadinis », in Adrian Paci : Electric blue (conversation avec Mirjam Varadinis), Zurich : Kunsthaus Zurich, 2010, p. 7 - 8.
270 Réflexion de Francis Alÿs à propos du mot Local dans : « Francis Alÿs : A à Z, sélection de Klaus Biesenbach et Cara Starke », op. cit., p. 37.
90
INDEX NOMINUM
AKERMAN Chantal .....................................................................................................52, 60
ALŸS Francis .4, 9, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 46, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 60, 61, 62, 64, 67, 71, 72, 73, 76, 77, 79, 80, 83, 84, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97
AUGÉ Marc 9, 15, 16, 17, 95 BIGO Didier ............................................................................................9, 44, 45, 46, 57, 62 BONNET Eric .....................................................................................................................96
CERTEAU DE Michel 9, 15, 16, 37, 42, 45, 46, 62, 74, 84, 85, 97
DAVILA Thierry ...............................................................................9, 22, 32, 33, 40, 84, 91
D'O Honoré 30, 109, 115
DOUZET Frédérick .............................................................................................................63
FERGUSON Bruce W. 9, 19, 21
FERGUSON Russell .....................................................................................9, 24, 50, 79, 84
FONTAINE Philippe .................................................................................................9, 43, 44
FOUCHER Michel 9, 43, 45
FRANCK Didier ..............................................................................................................9, 40
FRASER Marie 9, 72, 85
FUJIMORI Alberto ..............................................................................................................77
GARCIA DOS SANTOS Laymert ..........................................................9, 27, 28, 38, 40, 91
GIBLIN Béatrice 63
GILI Marta ................................................................................................................9, 72, 85
GIRONDE Michel 9, 89
GODFREY Mark .................................................................................................9, 56, 57, 61
GUNES Cihan 9, 89 HALL Edward T. 9, 82
HEIDEGGER Martin ..........................................................................................9, 38, 39, 40
HEILIGER Bernhard 39
KUNDERA Milan ...............................................................................................................89
LACOSTE Yves 9, 42, 43 110
LONG Richard 77
MAGRIS DE Claudio .........................................................................................................73
MEDINA Cuauhtémoc 9, 21, 22, 30, 64, 77
MOREL Jean-Pierre ............................................................................................................89
MOSHENSON Edna ...........................................................................................9, 85, 86, 89
MUKA Edi 9, 60, 71, 72 MULLER Laurent ...................................................................................4, 5, 6, 8, 81, 87, 90
OROZCO Gabriel 22
PACI Adrian ...4, 5, 6, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 46, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 68, 71, 72, 74, 77, 80, 81, 85, 89, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97
POSTEL-VINAY Karoline ..............................................................................................9, 45 RANCIÈRE Jacques ......................................................................................................61, 62 RICŒUR Paul 62
SAID Edward W. .................................................................................................9, 86, 87, 89 SCHNAPPER Dominique 7
SIBONY Daniel .....................................................................................4, 6, 9, 73, 74, 81, 89
SIMMEL Georg ...................................................................................................................81
SMITHSON Robert 40, 77 STALKER .....................................................................................................................22, 40
TAPIA DE Stéphane 4, 6 TODOROV Tzvetan ........................................................................................................5, 81
VETTESE Angela 9, 86
WEIZMAN Eyal 9, 56, 105 ZHEN Chen .........................................................................................................................96
111
INDEX RERUM
ailleurs 73, 74, 89, 91, 94, 95, 96 cartes.............................................................................................................18, 43, 47, 49, 56 centres de détention............................................................................................16, 45, 53, 96 chez soi 81, 82, 85, 95 circulation.............................................................................17, 22, 45, 46, 50, 52, 61, 62, 93 contact 8, 43, 45, 52 contrôle.......................................................................................16, 17, 19, 44, 45, 46, 53, 59 corps.........4, 8, 10, 11, 12, 28, 30, 39, 40, 46, 49, 52, 57, 64, 66, 73, 81, 91, 92, 93, 94, 102 couche 28, 49, 57, 60 culture.......................................................................................4, 5, 7, 81, 82, 85, 94, 96, 100 déplacement 4, 5, 7, 8, 24, 25, 27, 28, 37, 38, 50, 52, 53, 58, 73, 74, 84, 89, 92, 93, 94, 122 développement de l'espace.............................................................................................37, 92 dimension 5, 15, 39, 53, 56, 61, 62, 82, 85, 89, 101 distance...................................................................................4, 16, 40, 45, 67, 73, 81, 82, 84 échange.......................................................................................................................7, 45, 95 entre-deux 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 32, 33, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 53, 57, 58, 60, 62, 64, 68, 71, 72, 73, 80, 81, 82, 83, 86, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 102, 103, 105, 106, 122 entre-deux comme frontière.............................................3, 8, 26, 42, 46, 71, 86, 91, 93, 122 entre-deux de l'exil...................................................................71, 73, 83, 86, 89, 90, 95, 122 entre-deux des cultures 82 entre-deux du voyage...............................................................................3, 8, 68, 91, 94, 122 entre-deux existentiel 80, 86, 95 entre-deux langues..................................................................................................................6 entre-deux lieux 6, 73, 81 entre-deux mentalités 73, 81 entre-deux spatial...................3, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 28, 33, 38, 41, 86, 91, 93, 122 espace 4, 5, 6, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 45, 46, 49, 52, 53, 60, 61, 62, 64, 66, 67, 73, 74, 76, 80, 81, 82, 92, 93, 94, 95, 97, 100, 102, 103, 122
112
espace d'un instant 33, 40, 41, 80, 93, 100 espace de la ville...............................................................................19, 20, 22, 25, 28, 33, 38 espace domestique 22, 33, 37 espace intermédiaire...............................................................................................................8 espace public......................................................................................................22, 33, 37, 53 espace social 5, 103 espaces d'entre-deux...................................................................................................5, 15, 62 espaces de passage 17, 18 étranger...........................................................................5, 42, 44, 81, 82, 84, 87, 90, 95, 103 exil3, 4, 5, 8, 9, 53, 59, 68, 71, 73, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 102, 103, 107, 122 fiction....................................................................................34, 53, 57, 59, 60, 61, 62, 71, 94 fissure.................................................................................................................28, 40, 86, 93 flux 6, 44, 84 fragilité...................................................................................................57, 67, 74, 81, 90, 97 frontière 3, 4, 8, 9, 26, 27, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 62, 71, 86, 91, 93, 94, 98, 104, 106, 107, 122 frontières urbaines......................................................................62, 63, 64, 67, 102, 103, 122 géopolitique 42, 43, 44, 46, 101, 103 geste politique.........................................................................................................52, 53, 122 habiter 15, 18, 44, 60, 64, 94 hybride............................................................................................................................86, 89 identité 5, 6, 15, 17, 53, 59, 84, 86 instabilité 33, 81, 90 instant.................................................................5, 15, 28, 33, 34, 40, 41, 57, 80, 93, 97, 100 interactions 46, 62, 63, 95, 96 interculturelle................................................................................................................89, 107 l'autre 4, 6, 7, 15, 17, 36, 44, 50, 73, 89, 91, 92, 93, 96 lieu............5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 45, 46, 60, 61, 63, 73, 79, 81, 82, 84, 86, 92, 93, 122 ligne..9, 25, 27, 28, 38, 40, 43, 44, 45, 47, 54, 56, 57, 60, 76, 93, 94, 97, 104, 106, 107, 122 limite 8, 21, 36, 42, 46, 52, 58, 60, 89 marcher...................................................10, 12, 22, 24, 25, 33, 40, 54, 84, 85, 100, 101, 122 mémoire 4, 6, 26, 61, 73, 85
113
migrants 7, 12, 16, 17, 59, 92, 96, 107 mobilité.......................................................................................................................7, 45, 86 modernité 53, 64 mondialisation..................................................................................................................7, 44 mouvement.................................................5, 6, 16, 28, 37, 38, 49, 58, 61, 80, 81, 86, 89, 97 non-lieu 9, 15, 16, 86 ouverture...................................................................................9, 38, 39, 40, 62, 93, 103, 122 passage 5, 6, 8, 17, 18, 27, 33, 45, 46, 50, 52, 61, 62, 67, 80, 89, 93, 94, 95, 97, 103 perte d'orientation.................................................................................................................87 perturbation 33 poétique....................................................................................12, 33, 54, 57, 61, 62, 76, 100 politique..................................7, 33, 52, 53, 56, 57, 61, 62, 71, 72, 76, 79, 93, 100, 102, 122 pont 28, 76, 97, 98 profondeur......................................................................................................................37, 38 proxémie 82 récit.................................................25, 26, 30, 42, 45, 46, 53, 59, 60, 61, 62, 74, 76, 94, 102 rencontres...........................................................................................................33, 46, 62, 96 superposition 6, 18, 47, 49, 67, 93, 94, 95 surface..........................................................................................................28, 49, 57, 93, 94 suspension 62, 89, 92, 93, 95, 96, 97, 100 territoire..........................................................................7, 43, 44, 45, 46, 56, 57, 63, 80, 106 tissu 20, 22, 28, 32 touriste 9, 50, 83, 84 transformation..................................................................................45, 71, 72, 73, 74, 85, 95 transit 4, 15, 17, 72, 74, 85, 92, 104, 107, 108, 120 vide.............................................................................................12, 13, 18, 25, 46, 49, 73, 92 vivre ensemble 7, 82, 107 voyage..................................3, 4, 8, 9, 46, 50, 68, 71, 73, 74, 76, 80, 81, 89, 91, 94, 95, 122 vulnérabilité....................................................................................................................67, 90 zone 8, 21, 22, 40, 43, 63, 79, 92, 93, 94, 95, 96, 97 zone intermédiaire........................................................................................21, 22, 40, 93, 95 114