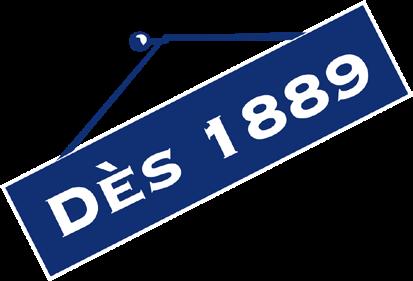Une journée particulière
Sophia Loren à l’honneur : photos inédites, musiques de ses films et projection d’Une journée particulière nous vous attendons le samedi 4 octobre dès 16h à La Cité Bleue
PROGRAMME, INFOS & BILLETTERIE SUR LACITEBLEUE.CH - LA CITÉ BLEUE GENÈVE, AVENUE DE MIREMONT 46, 1206 GENÈVE


Vos Droits

Septembre ’25
Me Douglas Hornung
Avec divorce.ch, il réinvente l’approche du divorce : informer, accompagner et protéger avant tout les enfants.
Me Xavier Diserens
L’intelligence artificielle bouscule le droit.
Sommes-nous prêts ?
Alors que l’intelligence artificielle (IA) s’invite dans nos vies quotidiennes, c’est tout l’écosystème juridique qui vacille. Avocat suisse depuis deux décennies, je suis témoin et acteur de cette métamorphose profonde, parfois enthousiasmante, souvent déconcertante. Ce bouleversement ne se limite pas à la technique : il touche aux fondements mêmes du droit.
Derrière les promesses d’efficacité accrue, de justice augmentée ou de gain de temps, se dessine un paysage à double tranchant. L’automatisation des tâches répétitives, l’analyse massive de jurisprudence, la rédaction assistée de contrats ou de recours ne sont plus de la science-fiction. Pour les professions juridiques, ces outils sont déjà des réalités. Mais l’adoption ne va pas sans prudence : l’IA ne raisonne pas, elle calcule. Elle ne comprend pas, elle corrèle. Le juriste ne peut se dessaisir de son rôle critique.
Les enjeux éthiques, juridiques et sociétaux sont multiples. Comment garantir la protection des données personnelles dans des systèmes apprenants qui consomment des masses d’informations sensibles ? Comment préserver les principes de transparence, de proportionnalité et de sécurité, consacrés par la nouvelle Loi sur la protection des données (LPD) ? Comment éviter les biais algorithmiques, qui peuvent être discriminants, et assurer la conformité avec la Convention européenne des droits de l’Homme (CEDH) ?
Sur le plan international, l’Union européenne a répondu par une réglementation ambitieuse : le Règlement sur l’intelligence artificielle (IA Act). Ce

texte institue une classification des systèmes d’IA selon leur niveau de risque et prévoit des obligations contraignantes pour les fournisseurs. La Suisse, elle, adopte une posture d’attente et d’observation. Mais cette neutralité stratégique n’est pas sans conséquences : nos standards juridiques devront être adaptés pour rester compatibles avec nos partenaires économiques.
Un autre défi majeur réside dans la responsabilité juridique en cas de dommages causés par ou via une intelligence artificielle. Qui répond lorsqu’un système de diagnostic médical assisté se trompe, ou lorsqu’un outil d’aide à la décision rend un jugement biaisé ? Le fabricant, le développeur, l’utilisateur, ou le client lui-même ? Ce flou normatif, appelé à s’éclaircir, soulève la question d’une responsabilité partagée et d’une gouvernance éthique à la hauteur des enjeux. Le droit des obligations, le droit de la responsabilité civile et même le droit pénal devront évoluer pour intégrer ces nouvelles configurations.
La régulation ne peut toutefois être la seule réponse. Il nous faut repenser la formation juridique : apprendre à travailler avec l’IA, comprendre ses logiques internes, en maîtriser les limites et les potentialités. L’avocat de demain sera tout autant juriste que stratège numérique. Il ne s’agit pas de prédire la disparition des métiers du droit, mais de préparer leur évolution.
En tant que professionnel du droit, j’ai choisi d’approfondir ces thématiques au sein d’une formation pionnière, universitaire et spécialisée en droit et intelligence artificielle, qui m’a permis d’acquérir des compétences concrètes et adaptées à la réalité technologique. Le savoir juridique ne peut plus faire l’économie d’une littératie technologique.
Car si l’intelligence artificielle peut renforcer l’état de droit, elle peut aussi le fragiliser. L’arbitrage automatisé, les agents conversationnels juridiques, la notation sociale implicite, la surveillance algorithmique : autant d’usages qui exigent un cadre clair, un contrôle rigoureux, une responsabilité bien définie.
Le débat est déjà lancé. Le droit ne doit pas le subir, mais y prendre part. Il lui revient de poser les balises, d’interroger les finalités, de rappeler les principes. Le rôle de l’avocat, plus que jamais, est de servir de médiateur entre la technologie et la justice.
Bienvenue dans une ère où le droit ne peut plus se penser sans l’IA. Encore faut-il qu’il reste humain…
Texte Me Xavier Diserens, Avocat FSA & OAV Burysek & Diserens CAS droit et intelligence artificielle CAS droit du sport
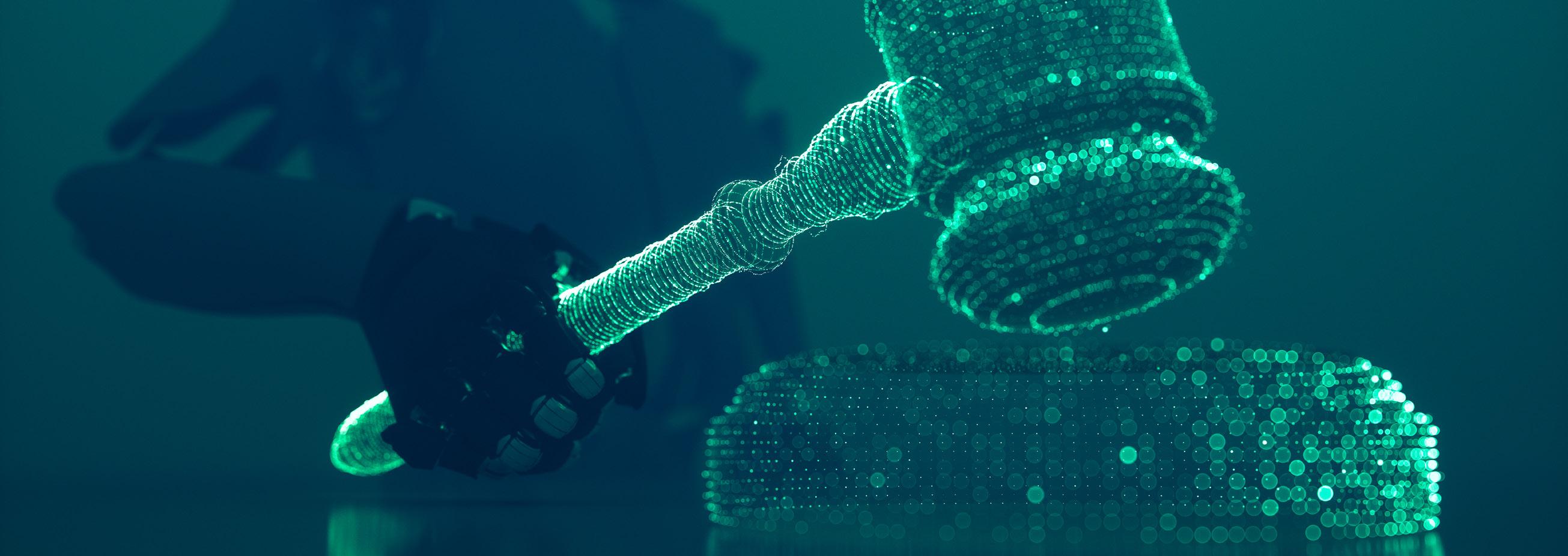
Contenu.
06 Investissement durable
08 Droit des affaires & fiscalité
10 Interview : Me Douglas Hornung
12 Droit des assurances
14 Violence conjugale
Focus Vos Droits. Chef de projet
Maxime Roux-Paris
Responsable national
Pascal Buck
Rédactrice en chef Romandie
Alix Senault
Responsable graphique
Mathias Manner
Graphiste
Marie Geyer
Journalistes
Alix Senault, SMA
Image de couverture màd
Canal de distribution
Le Matin Dimanche
Imprimerie DZB Druckzentrum Bern
Smart Media Agency
Gerbergasse 5, 8001 Zürich, Schweiz Tel +41 44 258 86 00
info@smartmediaagency.ch redactionFR@smartmediaagency.ch focus.swiss

Maxime Roux-Paris Chef de projet
Et si vous régliez vos Conflits autrement qu’au tribunal ?
Quand un conflit éclate, la première réaction est souvent : « allons en justice ». Mais il existe une autre voie, méconnue et pourtant redoutablement efficace : le processus collaboratif, aussi appelé droit collaboratif, une méthode de négociation encore peu connue en Suisse romande mais qui gagne du terrain.
Sortir du face-à-face
Ici, pas de bataille d’avocats ni de stratégies agressives. Le processus collaboratif repose sur une idée simple : on arrête de se battre sur des positions figées (« je veux / tu dois ») pour travailler sur les besoins réels de chacun. L’objectif ? Trouver une solution gagnant-gagnant, durable et respectueuse.
Chaque partie est assistée par un avocat spécialement formé. Les séances se déroulent autour d’une table, en toute confidentialité. Les avocats ne s’affrontent pas : ils coopèrent pour aider leurs clients à construire un accord. Tout ceci est soigneusement préparé, permettant un maximum de « rencontres » lors des séances communes. En quoi est-ce différent de la médiation ?
En médiation, un tiers neutre aide les parties à dialoguer, mais il ne peut pas donner de conseils juridiques ni soutenir activement une partie sans perdre sa neutralité. Les clients peuvent alors se sentir seuls et en position de faiblesse si le rapport de force est inégal.
En droit collaboratif, chaque client est accompagné en continu par son avocat. Ce dernier apporte son expertise juridique mais aussi un soutien humain, grâce à une formation spécialisée qui combine méthode de négociation raisonnée d’Harvard, approche structurée des conflits et techniques de communication efficaces. Résultat : les discussions se déroulent dans un cadre sécurisé, sans manipulation ni déséquilibre.
Quelle différence avec la négociation classique ?
Dans une négociation classique, chaque avocat défend avant tout « son camp » et garde la possibilité de saisir le tribunal si les discussions échouent. Le dialogue reste souvent marqué par la menace d’un procès et par des stratégies de contrôle.

































Dans le processus collaboratif, un contrat de participation est signé tant par les avocats que par les parties : personne ne peut brandir l’option du tribunal, la transparence sur toutes les informations (et documents) nécessaires à la résolution du conflit est obligatoire et si le processus échoue, les avocats se retirent. Ce cadre change tout, et les avocats doivent le respecter et le faire respecter à leurs clients. Autrement dit, le droit collaboratif, c’est la négociation… mais dans un cadre sécurisé, éthique et constructif.
Exemple : deux architectes, une amitié à sauver Prenons deux architectes romands qui ont fondé un bureau commun il y a vingt ans. A assure le côté créatif des dossiers, alors que B s’occupe principalement de l’administratif. Ils se disputent désormais sur la répartition des rôles. B se met à travailler sur le côté créatif d’un projet qu’il a apporté, pensant qu’il n’intéressait pas A, sans le tenir informé. En le découvrant, A se sent trahi. B délaisse l’administratif et affirme à A qu’il a toujours voulu faire plus de créatif et que c’est A qui l’en a empêché. Devant un juge, c’est la rupture assurée : dommage réputationnel, perte de mandats, relation d’amitié brisée. En droit collaboratif, chacun exprime ses besoins : prise en compte de ses capacités, clarification des rôles, besoin de stabilité pour l’un, besoin de changement, d’épanouissement et d’équilibre entre les associés, de


trouver un sens à son travail, pour l’autre. Guidés par leurs avocats, ils explorent des solutions : redistribuer les mandats (par zones géographiques, ou en fonction de la date d’entrée), engager un tiers pour l’administratif, instaurer des réunions hebdomadaires. Après un brainstorming créatif, les parties choisissent les options qui leur paraissent, aux deux, les plus à même de résoudre le litige. Résultat : la collaboration se poursuit, le bureau d’architectes prospère grâce aux ajustements effectués et la relation est préservée. Exemple : solution innovante lors d’un divorce Imaginons un couple qui divorce : Madame réclame la garde exclusive de leurs enfants, tandis que Monsieur souhaite une garde alternée. Derrière ce désaccord frontal, un processus collaboratif permet d’imaginer une solution progressive et créative qui sécurise l’une tout en rassurant l’autre, dans l’intérêt supérieur des enfants.
Après avoir identifié leurs besoins réels (stabilité pour Madame, engagement paternel pour Monsieur), ils conviennent d’une transition progressive : résidence majoritaire chez la mère les six premiers mois, trajets sportifs assumés par le père, puis extension du temps chez le père si tout se passe bien. Un calendrier partagé et une médiation parentale annuelle sécurisent la communication. Résultat : le conflit initial sur « qui aura la garde » devient un projet commun de coparentalité.
Pourquoi ça marche ?
Parce que le processus collaboratif, c’est :
– Des solutions sur mesure, créées par les parties elles-mêmes
– Un climat serein, sans rapport de force
– Un équilibre garanti par la présence de deux avocats formés
– Un gain de temps et d’argent par rapport à une longue procédure judiciaire
– Des accords durables, car répondant aux vrais besoins
Pour quel public ?
Divorces, litiges professionnels ou immobiliers, conflits entre associés… Partout où la loi ne vous impose pas une solution, le processus collaboratif peut être choisi. Contrairement à un procès, il ne cherche pas un coupable mais une issue constructive. Contrairement à la médiation, il garantit un soutien permanent, une transparence sur toutes les informations pertinentes et un conseil juridique clair.
Plutôt que de sortir brisés d’un affrontement judiciaire, pourquoi ne pas chercher une issue où chacun sort… gagnant ?
Pour plus d’informations : www.droitcollaboratif.ch

Guillaume Choffat Étude d’Avocat • Contenu sponsorisé
Mariage et parentalité en Suisse : un droit universel encore inachevé
Le mariage et la parentalité sont au cœur de débats sociétaux et juridiques en Suisse. Alors que l’ouverture du mariage pour toutes et tous, en 2022, a marqué une avancée historique, de nombreuses incohérences subsistent dans le droit de la famille. Rencontre et analyse de Maître Guillaume Choffat, avocat spécialiste en droit de la famille à Genève.

«Nos lois traduisent encore une vision hétéronormée de la famille. Malgré des progrès, les couples homosexuels, les célibataires ou les personnes non mariées souhaitant accéder à la parentalité par des voies médicalement assistées n’ont pas tous les mêmes droits. » Souligne Maître Choffat. Ce constat interroge : le droit suisse garantit-il réellement l’égalité face au mariage et à la parentalité ? Parlons du cadre légal actuel : une égalité proclamée mais des disparités qui se perpétuent
Un constat édifiant
Le mariage civil, régi par le Code civil suisse, est ouvert aux couples de même sexe depuis le 1er juillet 2022. Il entraîne des droits égaux en matière de filiation pour les couples de femmes : la conjointe de la mère est désormais reconnue comme parent légal dès la naissance de l’enfant issu d’une PMA réalisée en Suisse. Pour autant, plusieurs limites demeurent : l’accès à la procréation médicalement assistée (PMA) reste réservé aux couples de femmes mariées et la gestation pour autrui (GPA) reste strictement interdite en Suisse. Le don d’ovocytes est autorisé dans certains pays voisins, mais n’est pas encore ouvert en Suisse. Cela a pour conséquence d’empêcher l’accès des couples gays à la parentalité par la voie de la procréation médicalement assistée.
Ces restrictions créent une hiérarchie implicite entre les modèles familiaux. Selon Me Choffat : « Lorsqu’on compare d’abord les couples lesbiens et gays, force est de constater que les couples gays restent discriminés dans l’accès à la parentalité par voie de procréation médicalement assistée. Lorsque l’on compare ensuite les couples mariés ou non mariés (qu’ils soient hétéro ou homosexuels), là aussi on observe des droits inégaux dans l’accès à la parentalité. Lorsque l’on compare sous l’angle du statut social (marié, en concubinage ou célibataire), là encore on observe une discrimination des couples non mariés et des célibataires. Enfin, lorsque l’on compare sous l’angle du type d’infertilité dans le couple (féminine ou masculine), la loi aussi discrimine les couples ne pouvant pas avoir d’enfants en raison d’une infertilité féminine. Ainsi, l’égalité formelle proclamée par le système légal actuellement en vigueur masque encore des disparités réelles dans l’accès à la parentalité. »
Des discriminations sociales, économiques et juridiques
Au-delà du cadre légal, plusieurs formes de discrimination persistent. Elles concernent autant la dimension sociale que la dimension économique. Les familles homoparentales ou monoparentales restent perçues comme « hors norme », car dans les débats actuels visant à réformer la LPMA, l’accent reste mis sur la notion de « couple », ce qui exclut par exemple les célibataires du débat et l’argument de l’inégalité existante entre les couples lesbiens et gays n’est même pas abordé.
La dimension économique quant à elle se traduit par l’accès financier aux démarches à l’étranger pour accéder à la GPA ou au don d’ovocytes. Les coûts sont souvent élevés et restent accessibles à une minorité aisée. La discrimination est donc flagrante dans la loi elle-même : la restriction de la PMA aux couples
mariés exclut actuellement les couples en concubinage et les célibataires. Rester hors mariage entraîne également des désavantages juridiques, notamment en matière de succession ou de protection sociale.
Puis demeure l’absence d’un droit absolu à la parentalité : le droit suisse reconnaît le droit fondamental de fonder une famille (art. 8 CEDH), mais ne garantit pas un accès universel aux moyens médicaux pour y parvenir. C’est une vision somme toute encore trop patriarcale de la société : le modèle du couple reste la référence centrale du droit de la famille, au détriment des configurations plus diversifiées.
Les évolutions en cours : projets et débats Conscient de certaines de ces limites, le Conseil fédéral a lancé plusieurs projets de réforme : l’ouverture du don d’ovocytes non rémunéré, afin d’aligner la Suisse sur la pratique d’autres pays plus avancés. L’accès élargi à la parentalité pour les couples non mariés, afin de réduire les discriminations de statut civil, sans les éliminer toutefois puisque les célibataires n’auront toujours pas accès la PMA.
Ces propositions, encore à l’état de discussions, suscitent des débats éthiques et politiques. Les opposants invoquent souvent la protection de l’enfant et la crainte d’une « marchandisation » de la procréation, tandis que les partisans insistent sur l’égalité des droits et la nécessité de refléter l’évolution sociale.
Pour Me Choffat, la question est simple : « Voulons-nous garantir un droit universel à la parentalité au travers d’une interprétation large et idéalisée de l’art. 8 CEDH ? Aujourd’hui, ce n’est pas le cas. Certains ont accès aux moyens techniques, d’autres en sont exclus, non pas en raison de critères médicaux, mais de leur statut conjugal, civil, social ou économique ou de leur orientation sexuelle. »
Une vision pour l’avenir : vers une égalité réelle ?
L’évolution des droits LGBT a marqué un tournant bienvenu en Suisse, mais la perception des nouvelles générations montre que l’osmose des modèles familiaux n’est pas encore atteinte. Beaucoup ressentent encore une forme de discrimination liée au genre, à l’orientation sexuelle ou même au choix de vie hors mariage ou hors couple au sens « traditionnel ».
Selon Me Choffat : « Nous devons dépasser l’idée qu’il existerait une hiérarchie des modèles familiaux. L’enjeu n’est pas de défendre une orientation sexuelle, des différences de genre, le mariage, le concubinage ou le célibat, mais de garantir que chacun puisse accéder, dans la dignité, à la parentalité et à la protection juridique qui en découle. »
Le mariage pour toutes et tous a ouvert une brèche symbolique. Reste désormais à transformer cette égalité proclamée en égalité réelle.
La réflexion sur le mariage et la parentalité révèle aujourd’hui encore les tensions entre tradition et modernité, entre droit et société. Si la Suisse a franchi des étapes décisives, elle continue de maintenir des discriminations structurelles. L’avenir dépendra de la capacité du législateur à offrir une véritable égalité des droits, où chacun que l’on soit hétérosexuel, homosexuel, marié ou célibataire pourra envisager son projet familial sans obstacle juridique ou économique.
Plus d’informations sur choffat-avocat.ch
Le mariage a-t-il encore un intérêt en 2025 ?
Selon le site de l’Office fédéral de la statistique, près de 41 000 mariages ont été célébrés en 2022, alors que ce chiffre a baissé à 36 800 en 2024. On constate par ailleurs qu’en 2023, seuls 37 % des couples de personnes âgées de 24 à 34 ans étaient mariés, alors que 63 % vivaient en union libre.

Laurent Schuler
Avocat - Spécialiste FSA Droit de la construction et de l’immobilierSpécialiste FSA Droit de la famille

Dans ces circonstances, on peut s’interroger sur les risques que prennent les personnes non mariées lorsqu’elles s’engagent dans des actes importants de la vie tels qu’avoir des enfants, acheter un bien immobilier ou procéder ensemble à des investissements, alors qu’aucune règle de droit ne régit spécifiquement leur relation.
Dans un rapport du Conseil fédéral du 30 mars 2022, portant sur l’état des lieux du concubinage en droit actuel, le Conseil fédéral rappelait que la dissolution de l’union libre ne reposait sur aucune condition juridique et qu’elle n’était pas soumise à l’appréciation d’un juge ou d’une autorité, comme c’est le cas en matière de divorce. Cette dissolution peut intervenir en tout temps et sans motif, de manière individuelle ou par consentement mutuel. Certes, les concubins peuvent passer des conventions
qui permettent de régler en amont ces problèmes. Il était toutefois constaté que, dans la pratique, il est rare de rencontrer de tels aménagements, si bien que l’intervention des juges est souvent sollicitée. Ceux-ci vérifient d’abord si les partenaires ont conclu une convention et, si aucune convention n’est passée entre eux, les juges appliquent les règles ordinaires des droits réels et des droits des contrats ou de la société simple.
En cas de mariage, le principe de solidarité oblige les époux à s’entraider financièrement et même, si nécessaire, après une séparation ou un divorce. En revanche, ce principe n’existe pas pour les concubins, qui n’ont aucune obligation financière réciproque en dehors de l’entretien des enfants.
En effet, les règles régissant les pensions alimentaires illustrent bien la différence entre mariage et concubinage : seules les personnes mariées peuvent bénéficier, pour elles-mêmes, d’une aide financière de l’autre conjoint en cas de séparation ou de divorce, alors que les concubins n’y ont pas droit. Ainsi, lorsqu’un couple de concubins avec des enfants se sépare, le parent qui en a la garde pourra prétendre uniquement à une contribution d’entretien pour les enfants. Leur entretien se compose de deux éléments : le paiement des coûts directs, comme la nourriture, les vêtements, les assurances et le logement, et la contribution de prise en charge, soit la prise en charge du fait que le parent qui garde les enfants ne peut pas utiliser toute sa capacité de gain.
Ainsi, s’il est vrai que le nouveau droit qui règle les obligations alimentaires a quelque peu amélioré la situation pour le parent qui a la charge des enfants du couple, notamment par l’introduction de cette contribution de prise en charge, il convient de rappeler que celle-ci est limitée dans le temps et qu’elle ne règle que partiellement les problèmes, voire pas du tout, notamment en matière d’avoirs de vieillesse. Dans le cas d’un couple marié, la dissolution du mariage a des effets sur la prévoyance vieillesse, que ce soit au niveau
du partage des avoirs LPP ou du partage des avoirs du premier pilier, qui intervient par l’intermédiaire du splitting. Ainsi, l’époux qui a baissé son taux d’activité pour s’occuper des enfants est protégé par ces institutions légales, qui lui permettent de garantir une couverture par l’intermédiaire des cotisations de l’autre époux qui a maintenu un taux d’activité élevé. Dans le cadre du concubinage, ce partage n’existe pas. Dès lors, si le parent qui garde les enfants et qui a un taux d’activité plus faible peut bénéficier d’une contribution d’entretien importante grâce à la nouvelle législation, il devra rapidement reprendre une activité professionnelle, car la jurisprudence du Tribunal fédéral oblige le parent gardien à reprendre une activité professionnelle à tout le moins à 50 % dès l’entrée à l’école du dernier enfant du couple, et à 80 % dès lors que l’enfant a atteint l’âge d’entrer à l’école secondaire. Il ne peut en revanche prétendre à un comblement de ses cotisations AVS ou LPP, qui ont été moindres du fait qu’il a eu un salaire plus faible en raison de son activité à temps partiel.
Également, la protection du parent qui a baissé son taux d’activité pour s’occuper des enfants ou même arrêté de travailler n’existe pas en cas de séparation. Il n’aura pas droit au versement d’une pension alimentaire pour lui-même afin de pallier cette diminution de sa capacité financière. Sans contrat spécifique, il n’existe pas de règle lui permettant, par exemple, de se voir attribuer le logement conjugal. De surcroît, les règles de procédure qui s’appliquent devant les tribunaux dans les affaires de couples non mariés sont les mêmes que celles des affaires purement patrimoniales et exigent des avances de frais importantes. À l’inverse, les séparations judiciaires de couples mariés (mesures protectrices de l’union conjugale) sont souvent exemptes de frais judiciaires (selon les cantons) ou font l’objet de frais réduits.
En matière d’investissement immobilier, la situation est particulièrement délicate lorsque l’un des
concubins finance des travaux sur l’immeuble de l’autre. L’existence d’une société simple n’est pas forcément admise. Récemment, le Tribunal cantonal vaudois a rejeté l’action d’une concubine qui avait versé à son concubin un montant important pour faire des travaux dans son immeuble et qui souhaitait obtenir en retour, une fois la séparation intervenue. En l’absence de contrat spécifique, le Tribunal lui a donné tort. De même, les contributions financières pour aider le partenaire dans sa carrière, comme financer une formation ou soutenir un projet professionnel, ne donnent aucun droit en l’absence de contrat spécifique.
En matière successorale, le mariage offre une meilleure protection au conjoint survivant, qui hérite automatiquement d’une part légale de la succession, tandis que le concubin n’a aucun droit successoral, sauf si des dispositions testamentaires sont prises en sa faveur.
En définitive, le mariage offre une protection importante pour le membre du couple qui diminue son taux d’activité pour s’occuper des enfants. Ces avantages sont non seulement liés aux droits euxmêmes, mais aussi à la procédure. Le mariage garde donc tout son intérêt en 2025. On ne peut que recommander aux concubins qui ne souhaitent pas se marier, mais souhaitent construire une relation stable, de consulter un homme de loi pour régler le plus complètement possible les relations de concubinage par un contrat. Il est de toute manière plus facile de conclure ce genre de contrat lorsque les parties s’entendent plutôt qu’au moment de la séparation, lorsque le litige est important.
Pour plus d’informations : avopartner.ch
Cours préenregistrés
Visioconférences privées
Planning sur mesure
Planificateur ou ordonnanceur de production





Vacances : quels sont mes droits ?
Les vacances ne sont pas qu’un moment attendu de plaisir et de repos, elles sont aussi un droit garanti par la loi. Leur durée, leur rémunération et leur organisation obéissent à des règles précises, qui visent à assurer à chaque employé·e une période de récupération suffisante. Mais concrètement, que peut demander une personne salariée, que peut exiger un employeur, et que se passe-t-il dans des situations particulières (maladie, accident, licenciement) ?

Pour y répondre, nous avons interrogé Me Christian Giauque, avocat spécialiste FSA en droit du travail, qui nous éclaire sur les questions les plus fréquentes en matière de droit aux vacances.
De combien de jours de vacances dispose-t-on ?
La loi prévoit un minimum de quatre semaines de vacances par an dès l’âge de 20 ans révolus et de cinq semaines pour les plus jeunes. Chaque employé e doit pouvoir bénéficier d’au moins deux semaines consécutives par an.
Toutefois, il est fréquent que les employeurs accordent davantage de semaines de vacances. En pratique, les conventions collectives de travail (CCT) ou les contrats individuels peuvent prévoir des droits plus étendus, en raison du domaine d’activité (dans les bureaux, c’est en général cinq semaines), de l’ancienneté ou de la volonté des entreprises de fidéliser leur personnel. Et qu’en est-il lorsqu’on travaille à temps partiel ?
Le droit reste identique : ainsi, une employée travaillant par exemple trois jours par semaine dispose également de quatre semaines de vacances au minimum, soit
douze jours ouvrables, et non de vingt comme un plein temps. Lorsqu’elle prend une semaine de vacances, elle prend en réalité trois jours de vacances, ses deux jours de congé habituels n’étant pas décomptés.
Et si un jour férié tombe durant les vacances ? Si un employé à temps plein prend une semaine de congé la semaine du 1er août, ce jour ne doit pas être retranché du solde. Résultat : il ne « consomme » que quatre jours de vacances.
Qui fixe les dates des vacances ?
C’est l’employeur qui décide, mais il doit tenir compte des souhaits de ses employés dans la mesure du possible. Ainsi, un parent doit en principe pouvoir s’aligner sur les vacances scolaires de ses enfants. La jurisprudence estime qu’un préavis d’environ trois mois est suffisant pour que chacun puisse s’organiser, réserver un séjour ou anticiper un voyage.
Il existe toutefois des cas où un report des vacances peut être imposé. Imaginons un atelier de mécanique où un seul technicien est qualifié pour intervenir sur une panne imprévue. L’employeur peut alors exiger de lui de repousser ses vacances, mais il devra assumer les frais d’annulation du voyage envisagé, voire le surcoût si les congés reportés tombent en haute saison.
En cas de licenciement, la situation peut s’avérer complexe. Si une employée est licenciée et dispensée de travailler durant le préavis de résiliation, son employeur pourra lui imposer de prendre ses vacances durant le préavis, pour autant que le solde du nombre de jours de vacances ne représente pas plus d’un tiers de la durée de la libération de l’obligation de travailler, sinon ce solde devra être payé. Et si l’on tombe malade ou que l’on est victime d’un accident pendant les vacances ?
Dans ces cas-là, il faudra prendre en considération deux critères : la gravité et la durée de l’atteinte à
la santé. Si vous souffrez d’une indigestion durant quelques heures après un repas en vacances ou si vous vous foulez la cheville, vous pourrez normalement continuer de profiter de vos vacances. En revanche, si vous êtes hospitalisé le premier jour de votre semaine de ski, la fonction de repos des vacances n’atteint plus son but. Les jours concernés ne devront ainsi pas être décomptés et pourront être pris ultérieurement.
Dans ma pratique, je conseille toujours aux entreprises d’exiger de l’employé un certificat médical établi sur le lieu des vacances, afin de pouvoir déterminer la gravité et la durée de l’atteinte à la santé.
Comment est-on rémunéré pendant les vacances ?
L’employé e doit percevoir le même revenu qu’en travaillant. Le salaire de base, le 13e salaire, les commissions, les allocations familiales ou les diverses indemnités sont dus. En revanche, les remboursements de frais, comme les indemnités de repas ou de déplacement, ne seront en principe pas versés.
Dans les professions où les employés sont payés à l’heure, car l’activité varie fortement ou parce qu’ils travaillent pour plusieurs employeurs, comme dans l’économie domestique (femme de ménage), le salaire afférent aux vacances (8,33 % pour quatre semaines de vacances ou 10,64 % pour cinq semaines de vacances) peut être ajouté au salaire horaire de base. De ce fait, l’employé e ne percevra pas de salaire durant ses vacances effectives, mais percevra un salaire horaire supérieur tout au long de l’année. Attention toutefois : le salaire afférent aux vacances doit être clairement distingué du salaire de base dans le contrat de travail ainsi que sur les fiches de salaire.
Le droit aux vacances peut-il être réduit ? Oui, mais cela dépend des circonstances. Un employé absent fautivement, par exemple parce qu’il est en
incapacité de travail en raison d’un accident de la route qu’il a lui-même provoqué en étant alcoolisé, verra son droit réduit d’un douzième par mois complet dès le premier mois. Pour des absences non fautives, comme une maladie ou un accident, la réduction ne commence qu’au deuxième mois complet d’absence, et au troisième mois complet lors d’une incapacité de travail liée à une grossesse. À l’inverse, certaines absences ne peuvent jamais réduire le droit aux vacances. C’est le cas du congé maternité, du congé pour l’autre parent (anciennement congé paternité), du congé d’adoption ou encore du congé pour la prise en charge d’un enfant gravement malade.
À retenir
– Quatre semaines de vacances au minimum par an (5 avant 20 ans).
– Temps partiel : le nombre de semaines reste identique, mais le nombre de jours est inférieur.
– L’employeur fixe les vacances, mais doit tenir compte des intérêts de l’employé.
– Maladie ou accident durant les vacances : si incapacité à profiter des vacances, il faut l’annoncer à l’employeur pour pouvoir les reprendre ultérieurement.
– Durant les vacances, l’employé·e a droit à l’entier de son salaire (salaire de base, primes, commissions et 13e).
Plus d’informations sur hz-avocats.ch/christian-giauque
TVT Avocats • Contenu sponsorisé
L’avocat en évolution, ou comment la profession se plie aux exigences de son temps
L’avènement de l’ère de l’intelligence artificielle et l’évolution des procédures judiciaires ont donné naissance à un métier encore plus proche de l’humain. Point de vue.

Me Mihaela Verlooven, pouvez-vous présenter OMNIA Avocats ?
Notre étude est actuellement basée à Genève et à Zoug et le sera bientôt à l’étranger. OMNIA Avocats se distingue par son fort ancrage local et ses liens privilégiés avec l’Europe et les pays de l’Est, ce qui a d’ailleurs été l’un des piliers de notre rencontre et de notre projet. L’équipe est constituée d’avocats expérimentés aux profils variés qui ont travaillé dans des études genevoises, zougoises et étrangères. Nous assistons et conseillons une clientèle aussi bien nationale qu’internationale grâce aux profils des associés qui parlent couramment le russe, l’ukrainien, le serbo-croate ou encore l’anglais. Nos domaines d’activité sont variés, allant du conseil (civil, pénal et commercial), à l’administration de sociétés et de fondations, en passant par la représentation devant les tribunaux et administrations. La complémentarité des spécialisations de chacun permet une approche transversale, dynamique et complète des dossiers confiés. Il nous tient également à cœur de maintenir un contact humain et direct avec nos clients, assurant ainsi un suivi personnalisé. Ces valeurs humaines se traduisent également par un engagement des associés dans différentes causes caritatives, associations et fondations en parallèle d’OMNIA Avocats. Nos valeurs clés sont l’excellence, l’innovation et un engagement sans faille pour la défense des intérêts de nos clients.
On parle beaucoup de l’intelligence artificielle et de son impact sur le monde du travail en général. La profession d’avocat a-t-elle aussi été marquée par des changements ?
De façon générale, et contrairement à ce qui est souvent perçu par les personnes qui ne pratiquent pas ce métier, la profession d’avocat est en constante évolution. Elle suit les évolutions sociales, celles des modèles parentaux ou de la gestion des actifs, que ce soit en Europe ou au niveau mondial. Avant toute chose, il s’agit d’un métier profondément humain, ce qui explique que si la société évolue, nous évoluons obligatoirement avec elle et notre pratique se met à jour. En ce qui concerne l’intelligence artificielle, elle a en réalité permis de pérenniser les liens que nous entretenons avec nos clients puisque nous avons gagné un temps considérable dans la gestion des dossiers.
Pouvez-vous nous donner des exemples d’amélioration dans ce contexte ?
Comme exemple parlant, je peux vous donner celui du temps consacré aux recherches juridiques, au travail administratif ou encore à la préparation des documents et mémoires à déposer devant les tribunaux. Avant l’arrivée de ces nouveaux logiciels d’IA, ces tâches nous prenaient au moins le double de notre temps. Ne pouvant pas faire autrement, il arrivait souvent qu’elles soient répercutées sur le temps que nous accordions à nos clients, mais aussi sur la facture finale transmise. C’est une aide précieuse qui nous a permis d’être plus rapides, mais aussi bien moins chers qu’il y a dix ans, même si nous continuons d’appliquer le tarif horaire admis par la profession et le canton.
Au-delà de l’intelligence artificielle à proprement parler, y a-t-il d’autres avancées qui ont permis une évolution de votre pratique ?
Tout d’abord, dans un contexte plus général, nos dossiers présentent beaucoup plus de questions
extraterritoriales et exigent souvent des collaborations avec des confrères étrangers. Cela est dû en partie au fait que le client lambda peut aujourd’hui avoir des biens situés dans d’autres pays, une double nationalité ou encore être expatrié en Suisse. Les outils informatiques et d’intelligence artificielle nous aident à pouvoir communiquer plus efficacement en dépit de la barrière linguistique et à cerner les pratiques et les différences juridiques afin de maximiser notre intervention, ceci peu importe la langue parlée, même si l’anglais reste la norme. Ensuite, les données open source (c’est-à-dire accessibles à tout le monde) proposées par certains pays sont également une mine d’informations sans précédent qui nous permet de retrouver des informations utiles aux dossiers et à nos clients, sans devoir passer par des procédures administratives longues et parfois coûteuses ou devoir mandater un expert ou détective privé sur place pour effectuer ce travail. Finalement, ainsi que je le mentionnais précédemment, la Suisse s’adapte à l’air du temps – probablement vestige également de la crise du Covid-19 – et c’est l’apparition des projets cantonaux permettant aux autorités de mener des audiences à distance qui marquent les années 2024-2025. À Genève, par exemple, le Tribunal de première instance teste des dispositifs spéciaux avec l’objectif d’offrir aux parties la possibilité de mener des audiences, même en l’absence physique de l’une d’elles ou d’un témoin. Cela facilitera grandement l’apport de la preuve et potentiellement améliorera la résolution amiable des litiges, tout comme cela préservera la rapidité dans le traitement des dossiers. De plus, ces nouvelles technologies faciliteront l’accès à la justice pour les personnes vulnérables, à mobilité réduite ou les seniors.
Puisque vous mentionnez les processus menant à conclure des accords, il est vrai que c’est un sujet qui revient régulièrement
dans les journaux ou revues spécialisées. Avez-vous remarqué un changement de votre pratique dans ce contexte ?
La pratique actuelle est absolument centrée sur une résolution amiable des litiges. Entre les formations complémentaires et les outils mis à disposition par les tribunaux de certains cantons, il nous est difficile d’éluder cette vision. Nos clients sont par ailleurs bien conscients de cela et nous consultent régulièrement avec la demande claire d’obtenir un accord avec leur conjoint, employeur, etc. Les avocats sont sollicités pour participer à des séminaires de formation dispensés par les différents Ordres cantonaux autour de la médiation, du droit collaboratif ou de la négociation. À l’École d’avocature, à Genève, la négociation et la médiation sont des modules à part entière au travers desquels tout futur avocat doit passer pour obtenir son diplôme. C’est donc même avant de passer le brevet que nous sommes sensibilisés à cette approche. La Fédération Suisse des Avocats a également mis en place une formation approfondie en médiation et une association d’avocats romands a vu le jour dans le canton de Vaud pour promouvoir les formations en droit collaboratif. C’est donc tout un mode de pensée différent qui a émergé depuis quelques années. Quelle vision à long terme avez-vous pour la profession en Suisse romande ? La vision du futur offrira une synthèse des sujets qui ont été abordés aujourd’hui. En plus de l’évolution de la pratique vers une approche au plus près du client et de ses besoins, je pense aussi que l’IA et toutes les nouvelles technologies offriront à nos clients, mais aussi à nous-mêmes, une latitude dans la prise en charge des dossiers qui n’existait pas jusqu’à présent. C’est alors la personnalité et le style de chaque avocat qui pourront s’émanciper en lieu et place d’heures perdues à effectuer un travail administratif et juridique, souvent rébarbatif.

CQuand investir est porteur de sens
L’investissement durable, parfois appelé investissement responsable ou éthique, désigne une approche qui ne se limite pas aux critères financiers. Il vise à concilier performance économique et impact positif sur la société et l’environnement. Concrètement, il s’agit de choisir des placements qui respectent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) : réduction des émissions de CO2, inclusion sociale, transparence des pratiques, respect des droits humains…
L’objectif est double : générer un rendement financier, certes modéré, mais aussi contribuer à bâtir un monde plus juste et plus durable.
ette manière d’investir s’oppose à une logique purement spéculative : elle privilégie la pérennité et le sens, dans un contexte où les épargnants sont de plus en plus attentifs à l’usage de leur argent. En Suisse comme ailleurs, l’investissement durable attire un public varié : particuliers, institutions et organisations souhaitant que leur capital serve à financer des projets concrets plutôt qu’à alimenter des profits abstraits.
Une coopérative internationale
En Suisse romande, la coopérative internationale Oikocredit s’impose comme un acteur clé de cette finance à impact. Depuis plus de cinquante ans, elle permet aux particuliers et aux organisations d’orienter leur investissements vers des projets qui privilégient l’humain, la durabilité et la justice sociale. Créée dans les années 1970, Oikocredit a bâti sa réputation sur un modèle coopératif unique : les fonds collectés en Europe sont investis dans des projets situés principalement dans les pays du Sud. Les secteurs soutenus sont essentiels : la finance inclusive, qui favorise l’accès aux services financiers et le développement d’entreprises et de projets locaux, l’agriculture durable, qui renforce la sécurité alimentaire et soutient les petits producteurs ainsi que les énergies renouvelables pour répondre à des besoins concrets en énergie propre et abordable. Toutes ces actions visent à renforcer l’autonomie économique de communautés locales.
La sélection des projets repose sur des critères exigeants, intégrant la viabilité économique mais aussi la dimension sociale et environnementale.
« Nous avons des antennes sur place qui connaissent les besoins locaux et orientent les investissements en conséquence », explique Julien Pidoux, chargé marketing et communication d’Oikocredit Suisse. Inclusion des femmes, respect de l’environnement et gouvernance locale figurent parmi les critères incontournables.
Transparence et rendement éthique
L’un des points forts d’Oikocredit est sa transparence vis-à-vis des investisseurs. Chaque année, un rapport d’impact est publié, détaillant les résultats financiers et sociaux. Le rendement proposé est volontairement limité, oscillant entre 0 et 2 %. « Nous avons défini qu’au-delà de 2 %, on dépasserait le seuil d’un rendement éthique », souligne Julien Pidoux. Cette approche séduit une clientèle soucieuse de donner un sens à son argent, quitte à renoncer à des gains plus importants.
L’accessibilité est un autre facteur distinctif : une participation peut être souscrite dès 250
50 ans d’impact : pionnière d’hier et de demain
Depuis 1975, la coopérative Oikocredit incite à investir de manière responsable pour que chacun et chacune puissent faire les choix qui lui permettent de vivre dignement.
Continuons à faire la différence : investissez dès maintenant
francs, rendant l’investissement à impact ouvert au plus grand nombre. « Beaucoup imaginent que c’est compliqué ou réservé à une élite, alors que notre proposition est simple et sans frais », ajoute Julien Pidoux.
Des projets concrets et diversifiés
Les réalisations financées par Oikocredit illustrent la diversité de son action. Au Kenya, elle a permis la diffusion de systèmes solaires domestiques abordables et fiables, améliorant la qualité de vie, la sécurité et l’accès à l’électricité. Au Pérou, elle a financé une coopérative de petits producteurs de café, favorisant la production durable, la commercialisation équitable et le développement local.
En Inde, Oikocredit finance des institutions de microfinance, favorisant l’inclusion financière et permettant à des milliers de familles d’accéder à des services financiers de base. La coopérative s’engage aussi dans l’éducation et l’accès à l’eau potable, en partenariat avec des organisations locales, démontrant sa volonté de diversifier ses champs d’action tout en gardant une approche centrée sur les besoins des communautés.
Une vision d’avenir et des investissements porteur de sens Dans un contexte où l’investissement durable suscite parfois des doutes, notamment sur le risque de « greenwashing », Oikocredit défend une vision claire : l’argent investi doit générer un impact positif, mesurable et durable. « Chaque franc investi soutient directement des communautés qui bâtissent leur autonomie », insiste Julien Pidoux. Loin des logiques spéculatives, la coopérative défend une finance patiente, qui accepte des rendements modestes pour privilégier la stabilité et l’impact social. Pour ses promoteurs, la multiplication des crises économiques et climatiques démontre la pertinence d’une telle approche : investir devient un moyen concret de participer à la transition vers une économie plus juste et plus durable. En célébrant son cinquantième anniversaire, Oikocredit confirme que la finance peut être autre chose qu’une simple recherche de profit. Elle peut devenir un outil de transformation, reliant les épargnants du Nord aux besoins essentiels du Sud, et donnant à l’acte d’investir une dimension profondément humaine.
Texte Alix Senault




Une étude à dimension internationale à l’échelle suisse
Présente dans trois cantons suisses – à Sion en Valais, à Gstaad dans le canton de Berne et à Genève – l’étude MC Avocats offre un conseil juridique personnalisé, spécialisé dans le droit des affaires. Sa fondatrice, Me Béatrice Stahel, assure un rôle de conseil et un suivi sur mesure pour les particuliers comme pour les entrepreneurs, formant une équipe d’une petite dizaine de personnes.

Maître Stahel, vous avez repris l’étude MC Avocats SA à Sion en 2018. Quels sont aujourd’hui vos principaux domaines d’activité ?
J’ai une double nationalité suisse et britannique et j’ai étudié à Genève, dans un environnement international. Mon installation en Valais est liée à des raisons personnelles, et c’est à cette occasion que Me Gilles Crettol m’a offert l’opportunité de rejoindre son étude à Sion. J’ai d’abord développé les activités en direction des particuliers – notamment le conseil aux grandes fortunes, les litiges, la négociation d’actes de vente – puis la clientèle d’entrepreneurs valaisans.
Les chefs d’entreprise ont besoin d’accompagnement, par exemple pour assurer la transmission de leur société, organiser une vente à un actionnaire – suisse ou étranger – ou préparer une reprise.
Au départ, seule à Sion, j’ai fait croître et se développer l’étude : aujourd’hui nous sommes une équipe d’une petite dizaine de collaborateurs. En
2015, nous nous sommes restructurés en SARL ; en 2018, j’ai repris les parts de mon associé et suis devenue seule actionnaire de la SA.
J’ai ouvert une antenne à Gstaad en 2017, afin de répondre à la demande d’une clientèle fortunée, puis une antenne à Genève en 2020. Nous avons désormais une véritable approche internationale, soutenue par un réseau de confrères à l’étranger. Je suis très fière de nos collaborateurs et de nos valeurs fortes. Notre étude se distingue par ses services sur mesure, son indépendance, sa combativité et une discrétion absolue.
Quels sont les points forts et les atouts qui distinguent v otre étude ?
Nous offrons une très haute individualisation des services et une qualité de travail irréprochable, avec un contrôle systématique à « quatre yeux ».
Notre taille humaine favorise un suivi attentif et une communication optimale. Nous travaillons de manière proactive sur les dossiers et sélectionnons nos clients, souvent sur recommandation, afin de limiter le nombre de mandats et garantir un service de qualité. Notre plurilinguisme – cinq langues parlées au sein de l’étude – nous permet de toucher une clientèle internationale.
Nous développons également un pôle de criminalité économique sous la responsabilité de Me Arthur Seppey, collaborateur senior spécialisé dans des affaires telles que blanchiment d’argent, escroquerie, gestion déloyale ou autres arnaques financières.
Quelles sont les spécificités du pôle de criminalité économique au sein de l’étude ?
La criminalité économique connaît une forte progression ces dernières années. C’est pourquoi nous avons spécifiquement développé un pôle dédié aux affaires pénales, qu’elles soient liées à des activités professionnelles ou privées. Nous traitons notamment des dossiers d’escroquerie, d’abus de confiance ou de gestion déloyale d’entreprise. Dans ces situations souvent complexes, où des dirigeants ou responsables se retrouvent confrontés aux tribunaux, nous les accompagnons pas à pas dans leur défense. Ce pôle, qui s’est considérablement développé, propose un suivi personnalisé et une prise en charge attentive, afin de soutenir nos clients dans des affaires parfois délicates et émotionnellement éprouvantes.
Votre étude a la particularité d’être multilingue. En quoi cet atout vous aide-t-il au quotidien ?
Pour conseiller efficacement nos clients, la maîtrise des langues est essentielle. Par exemple, lorsqu’un entrepreneur suisse vend son groupe à une société allemande, l’entretien peut se dérouler en allemand et la procédure d’arbitrage se faire dans deux langues.
De même, un client étranger résidant en Suisse doit pouvoir lire et comprendre les documents dans sa langue. Cela favorise son implication dans le dossier et permet des échanges plus précis et constructifs. Nous offrons une capacité professionnelle complète en cinq langues (FR -EN-DE-IT-ES).
La prévoyance professionnelle, c’est notre métier Formez -vous dès aujourd’hui avec l’ESPP !
L’École Supérieure en Prévoyance Professionnelle (ESPP) est l’unique institut de formation romand entièrement dédié à la prévoyance

Des formations adaptées aux besoins de chacun



Des enseignants et conseillers issus du terrain
Un juste équilibre entre théorie et pratique
Des solutions sur mesure et un conseil personnalisé
Nous formons et conseillons divers publics



Collaborateurs RH, chefs d’entreprise, commissions de prévoyance
Intermédiaires d’assurance et financiers, assureurs, asset managers
Administrateurs, gérants de caisse, conseils de fondation, fiduciaires
Des formations sur mesure pour les PME et leurs collaborateurs

Plan de prévoyance : choisir la meilleure solution adaptée à l ’entreprise


Planification financière : anticiper et sécuriser l’avenir
Préparation à la retraite : accompagner la transition sereinement
Formation à la carte intra -entreprise
(prix : sur demande en fonction de la durée et du nombre de candidats)
• Formation de base ou continue
• Sujets spécifiques ou d’actualité
Formations certifiantes :
1. Diplôme fédéral de Gérant - e de Caisse de pension dès le 25.4.2026
2. Brevet fédéral de Spécialiste de la prévoyance professionnelle dès le 7.11.2025
3. Certificat ESPP de Gestionnaire en prévoyance professionnelle dès le 23.4.2026
Personnes de contact
Pour les particuliers, quels types de services juridiques proposez-vous ?
Nous intervenons en planification patrimoniale, droit social, installation en Suisse, family office, droit des affaires, procédures judiciaires et criminalité économique. Nous défendons également de nombreux prévenus dans le cadre d’affaires de criminalité financière.
En matière de droit des affaires, quelles sont les spécificités de votre approche ?
Les entrepreneurs n’ont pas de temps à perdre et vont droit au but. Nous adaptons donc notre approche pour qu’elle soit pragmatique et efficace, en limitant les procédures longues ou inutiles. Nous jouons également un rôle de conseil pour les orienter et les aider à prendre les bonnes décisions. Le diagnostic initial est primordial pour proposer la solution adéquate.
Selon vous, quelle est la plus grande force de MC Avocats ?
La combativité, la recherche de l’excellence et de la satisfaction totale de nos clients.
Plus d’informations sur www.mc-avocats.ch mail@mc-avocats.com


Droit des affaires et fiscalité en Suisse : mutations et pressions internationales
La Suisse, réputée pour sa stabilité juridique et son attractivité économique, est au cœur d’une profonde mutation fiscale. Depuis l’entrée en vigueur de la réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA) en 2020, les régimes fiscaux privilégiés pour les sociétés à statut cantonal (holding, domicile, auxiliaire) ont été supprimés. Ces statuts spéciaux, jugés incompatibles avec les règles de l’OCDE et de l’Union européenne, faisaient de la Suisse un havre pour de nombreuses multinationales. En contrepartie, les cantons ont abaissé de manière significative les taux d’imposition sur les bénéfices, instaurant une fiscalité plus uniforme et transparente.

Aujourd’hui, le taux effectif d’imposition des sociétés varie selon les cantons entre 12 et 21 %.
Genève s’est fixé à environ 14 %, Vaud à 13,8 %, Zurich à 19 %. Cette harmonisation vise à garantir la compétitivité internationale tout en assurant des recettes fiscales suffisantes pour les collectivités publiques. Les entreprises disposent d’outils supplémentaires d’optimisation, comme la « patent box » (imposition réduite des revenus de la propriété intellectuelle) ou la déduction supplémentaire pour la recherche et développement.
Les défis à venir : OCDE et fiscalité minimum
La Suisse doit cependant composer avec les pressions internationales. Le projet de l’OCDE sur l’imposition minimale des entreprises à 15 % (Pilier 2) entre progressivement en vigueur. Pour un pays qui mise sur une fiscalité compétitive pour attirer les investissements, cette norme mondiale change la donne. Le Conseil fédéral a prévu une imposition complémentaire afin que les grandes multinationales basées en Suisse ne paient pas moins que ce seuil de 15 %. La votation populaire de 2023 a validé l’introduction de cette taxe minimale, applicable dès 2024.
Les conséquences pratiques sont doubles : d’un côté, la Suisse perd une partie de son avantage comparatif ; de l’autre, elle conserve sa crédibilité internationale et évite d’être accusée de dumping fiscal. Pour rester attractive, elle mise sur d’autres facteurs : qualité des infrastructures, main-d’œuvre qualifiée, accords de libre-échange et stabilité politique.
Contenu sponsorisé • H&B Law
Droit des affaires une digitalisation accrue
Parallèlement, le droit des affaires évolue. La révision du Code des obligations en matière de droit de la société anonyme, entrée en vigueur en 2023, renforce les obligations de transparence et la protection des actionnaires minoritaires. Elle introduit davantage de souplesse dans la gestion du capital (par exemple, le capital autorisé et le capital conditionnel) tout en imposant de nouvelles règles sur la représentation équilibrée des sexes au sein des conseils d’administration des grandes sociétés cotées.
La digitalisation du droit des sociétés constitue également une avancée majeure : la possibilité de tenir des assemblées générales virtuelles, de gérer la documentation via des registres électroniques ou d’authentifier certains actes à distance facilite la vie des entreprises tout en posant de nouveaux enjeux de cybersécurité et de conformité.
L’impact des politiques protectionnistes américaines À ces défis internes s’ajoutent des pressions externes, notamment liées aux politiques commerciales américaines. La réintroduction par Donald Trump, lors de son second mandat, de taxes douanières ciblées bouleverse l’équilibre du commerce international. Ces mesures visent principalement les produits européens et chinois, mais la Suisse, intégrée aux chaînes de valeur mondiales, en ressent aussi les effets.
Les droits de douane frappant l’acier, l’aluminium, certains produits de luxe et pharmaceutiques, renchérissent le coût des exportations helvétiques vers les États-Unis. Or, ce marché est l’un des plus importants pour la Suisse, notamment pour les secteurs de la chimie, de la pharma et des machines de précision. Selon economiesuisse, près de 10 % des exportations suisses sont destinées aux États-Unis. Une taxe de 10 ou 20 % peut donc représenter une perte de compétitivité significative, difficile à compenser uniquement par la qualité.
Des conséquences pour les entreprises suisses Pour les grandes multinationales, l’effet direct est souvent amorti par leur présence locale : nombre d’entre elles possèdent déjà des filiales de production aux États-Unis, réduisant l’impact des droits de douane. Mais pour les PME exportatrices, les hausses de coûts sont immédiates. Certaines doivent répercuter ces surcoûts sur les prix, au risque de perdre des parts de marché ; d’autres absorbent une partie de la marge, au détriment de leur rentabilité.
Ces mesures protectionnistes fragilisent aussi les accords commerciaux bilatéraux. La Suisse, non membre de l’Union européenne mais étroitement liée à celle-ci, subit les effets collatéraux des tensions entre Washington et Bruxelles. Une accentuation de ces tensions pourrait obliger Berne à renforcer sa diplomatie économique, en cherchant de nouveaux
La responsabilité des dirigeants d’entreprise
partenaires ou en consolidant ses accords de libre-échange avec l’Asie et l’Amérique latine.
Entre stabilité interne et incertitudes mondiales
Ainsi, le droit des affaires et la fiscalité en Suisse évoluent dans un double mouvement. À l’interne, le pays renforce sa transparence, harmonise son système fiscal et investit dans des réformes structurelles pour conserver son attractivité. À l’externe, il doit composer avec une mondialisation marquée par le retour des barrières douanières, l’instabilité géopolitique et la concurrence fiscale accrue. La fiscalité des entreprises, loin d’être un simple outil de financement des dépenses publiques, devient un instrument stratégique de compétitivité. Quant aux droits de douane américains, ils rappellent que le commerce international peut basculer rapidement sous l’effet de décisions politiques unilatérales. Pour les entreprises suisses, le défi consiste à rester agiles : investir dans l’innovation, diversifier les marchés, optimiser la structure juridique et fiscale. Le droit des affaires et le droit fiscal ne sont plus de simples cadres, mais des leviers de résilience et de croissance.
Texte SMA
En ces temps de turbulences géopolitiques et économiques, les défis auxquels doivent faire face les dirigeants d’entreprises sont nombreux et variés. Ils peuvent notamment concerner l’imposition de droits de douane à l’export, les risques de défaillance de débiteurs importants, la restriction de l’accès au crédit, etc. En présence d’un marché de plus en plus tendu, les dirigeants de sociétés (gérants, administrateurs ou directeurs) de toute taille se trouvent en première ligne et sont de plus en plus amenés à répondre de leurs décisions vis-à-vis des actionnaires, des créanciers ou encore des pouvoirs publics. Cette exposition accrue se matérialise par des actions en responsabilité contre les dirigeants en nette augmentation, comme le démontrent certains cas très médiatisés. Il est par conséquent utile de connaître le cadre légal suisse qui réglemente ce sujet.
En droit suisse, un dirigeant peut voir sa responsabilité civile engagée s’il cause un dommage par un manquement à ses devoirs dans la gestion de la société. La loi prévoit en effet que les dirigeants répondent des dommages résultant d’une violation intentionnelle ou par négligence de leurs obligations. Autrement dit, un dirigeant qui ne respecte pas la diligence et la loyauté requises dans la conduite des affaires de la société peut être tenu de réparer le préjudice causé. En pratique, les situations les plus courantes de mise en cause de dirigeants incluent une gestion fautive (par exemple, poursuivre une activité déficitaire sans prendre de mesures correctives), le non-respect de la loi (tenue de comptabilité défaillante, absence de convocation des assemblées obligatoires, etc.) ou la distribution de dividendes illicites (p. ex. versement de dividendes alors que la société n’a pas assez de bénéfices réels).
Une responsabilité accrue
Selon les situations, la loi permet à plusieurs acteurs d’agir à l’encontre des dirigeants : la société elle-même, les actionnaires individuels s’ils subissent un tort ou encore les créanciers (notamment en cas de faillite de la société). On constate d’ailleurs que lors de faillites, les liquidateurs et créanciers hésitent de moins en moins à chercher la responsabilité des dirigeants dans la débâcle. Outre la responsabilité civile, la mauvaise gestion d’une société peut également avoir des conséquences pénales ainsi qu’administratives. Au niveau administratif, on mentionnera par exemple que la Loi fédérale sur l’AVS qui prévoit une responsabilité personnelle subsidiaire et solidaire des dirigeants ainsi que de toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation de la société pour les cotisations sociales non payées. Si l’entreprise devient insolvable, les administrateurs ou gérants devront personnellement rembourser le
dommage ainsi causé à la caisse AVS. Sur le plan pénal, diverses infractions peuvent entrer en considération, en particulier la gestion déloyale, l’abus de confiance, voire l’escroquerie et, dans certains cas, le faux dans les titres.
Le recours à la voie pénale est fréquemment utilisé pour mettre une pression sur la ou les personnes supposément responsables d’un dommage, voire éviter certains écueils liés à la procédure civile (coûts, fardeau de la preuve, etc.).
Pour se protéger, un dirigeant doit dès lors bien s’informer sur ses devoirs envers la société et adopter une gouvernance rigoureuse. Cela implique de se tenir informé de la santé financière de l’entreprise, de respecter les procédures juridiques, comptables et fiscales ainsi que d’agir sans délai en cas de difficultés financières (mesures d’assainissement, appel aux investisseurs, voire l’annonce de la faillite auprès du juge).
Texte Me Marc Häsler & Me Claude-Alain Boillat
H&B LAW Rue des Vignerons 1B, Case postale 359 CH - 1110 Morges contact@hnblaw.ch +41 21 804 71 00 www.hnblaw.ch


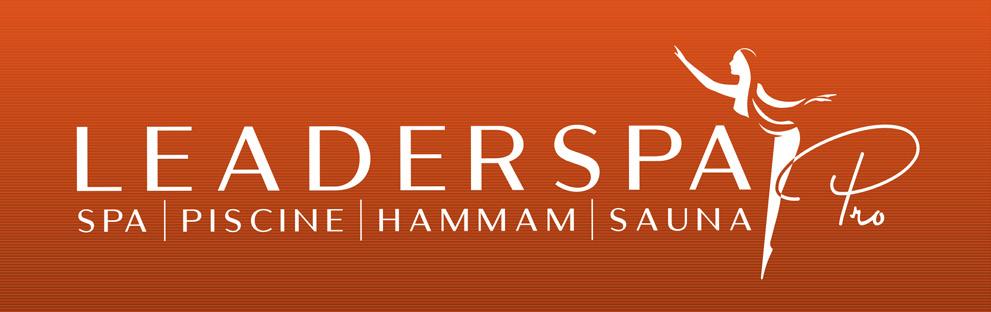
PASSEZ DU RÊVE À LA RÉALITÉ
Depuis 1997, Leaderspa Pro Sa, la référence en Suisse romande pour les Spas - Wellness - Piscines pour résidences privées et lieux publics.





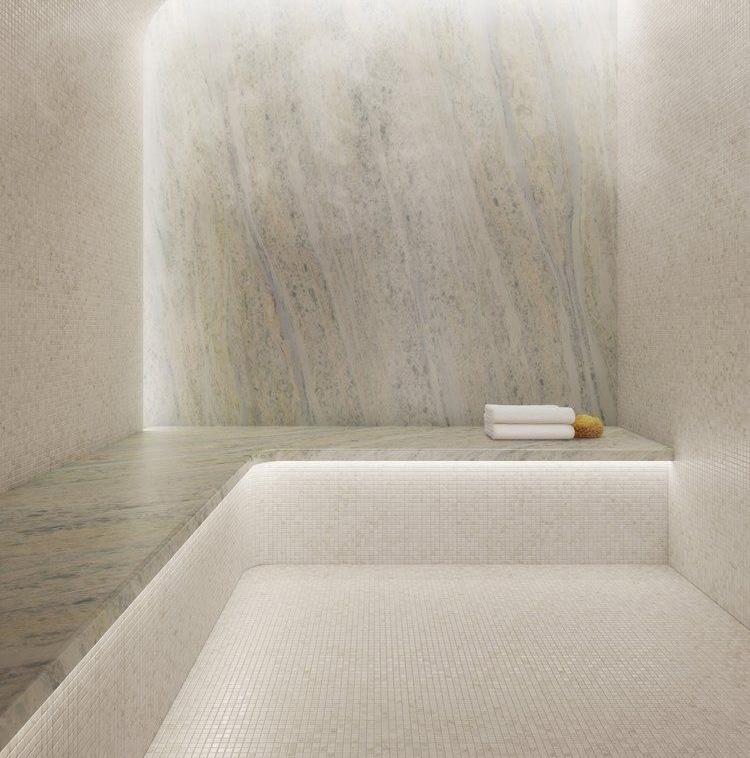


Me Douglas Hornung
Un parcours exemplaire
En 2007, Me Douglas Hornung, avocat au barreau de Genève et juge suppléant à la Cour de justice du même canton, lance le site divorce.ch : une plateforme d’information juridique consacrée à la séparation et au divorce. En 18 ans, divorce.ch –et sa version alémanique onlinescheidung.ch – sont devenus des références incontournables en matière de droit de la famille en Suisse. Rencontre avec un avocat visionnaire, qui a su anticiper la digitalisation du secteur juridique.
Interview SMA Image màd
Me Hornung, pouvez-vous revenir
Pourquoi avoir choisi

généraliser avec la modification prochaine de la loi. Quels sont les obstacles les plus fréquents rencontrés lors d’une séparation ?
Le site divorce.ch offre un accès libre à tous les aspects de la séparation ou du divorce. Tout est écrit à l’avance et on peut vous dire aujourd’hui quel sera le résultat dans 3, 5 ou 10 ans de procédure bagarre. Malheureusement l’affect ou l’émotion, souvent liés aux enfants, empêchent encore trop souvent les parents d’être raisonnables et de mieux tenir compte de l’intérêt supérieur des enfants. Les règles de procédure actuelles sont inadaptées. Elles poussent à la surenchère et à la bagarre stérile. Il est prévu qu’elles changent drastiquement d’ici une année ou deux (sous réserve de référendum).
Aviez-vous déjà une expérience entrepreneuriale avant cette plateforme ? Non, uniquement une expérience de terrain et une bonne dose d’intuition (et un peu de chance !). Après divorce.ch, j’ai lancé lawffice.ch, une solution d’espaces de travail partagés pour avocats. L’idée : offrir des bureaux haut de gamme flexibles, la possibilité de recevoir ses clients dans de bonnes conditions, tout en bénéficiant d’un réseau, de services de domiciliation, de formules adaptées à leurs besoins et de coûts dérisoires par rapport aux études traditionnelles. Cela répond à une vraie évolution de la profession. Cela m’a valu une très longue bataille juridique avec la Commission du Barreau. Il en reste quelques scories que le Tribunal fédéral devrait nettoyer prochainement.
Je voulais aider les gens et leur éviter de devoir dépenser des sommes excessives en honoraires d’avocat, surtout dans des situations émotionnellement lourdes.
– Me Douglas Hornung, avocat au barreau de Genève et juge suppléant à la Cour de justice du même canton, fondateur du site divorce.ch
lorsque l’IA propose diverses options, laquelle choisir et pourquoi (3) l’empathie. Un programme ou une machine n’est pas (encore) empathique. L’intelligence artificielle permet d’accélérer et d’optimiser les tâches, mais l’avocat doit rester à la pointe sur ses sujets, en apportant du sens, de la psychologie et de l’humain.
Votre profil est à la croisée du droit et de l’innovation. En quoi cela est-il un atout aujourd’hui ?
Il y a vingt ans, on me trouvait disruptif ! Aujourd’hui, ce sont les clients eux-mêmes qui attendent des outils innovants, efficaces et accessibles. Même si je n’accepte plus de nouveaux dossiers depuis quelques années, divorce.ch reste mon « bébé ». J’y crois profondément. Il mérite d’être développé, car il rend service à de nombreuses personnes.
Quelle est votre plus grande fierté professionnelle ?
Sans hésiter, la création de divorce.ch. C’est l’aboutissement de mon parcours et une source de fierté immense. Le site s’enrichit constamment, il est devenu un outil complet et utile pour accompagner les couples dans leurs désunions. Être une référence nationale et savoir que le site aide des milliers de personnes (le site a plus de 35 000 visiteurs par mois), c’est ma plus belle réussite.
Une nouvelle offre de restauration à domicile pour les seniors de Genève
Longtemps associés à l’image de la fin de vie, les établissements médico-sociaux cherchent aujourd’hui à se réinventer. Sous l’impulsion de son directeur général Olivier Cochereau, le Groupe butini dévoile une nouvelle offre de livraison de repas à domicile pour seniors. Une initiative pensée comme un prolongement de cette transformation.

Vieillir n’a jamais été aussi paradoxal. Si l’espérance de vie continue d’augmenter, la manière dont la société envisage ses aîné·es reste encore trop souvent enfermée dans des représentations figées. Dans l’imaginaire collectif, les établissements médico-sociaux (EMS) évoquent davantage la dépendance, la solitude et la fin de vie que la vitalité et la continuité d’une intégration sociale. Une vision qu’un grand nombre d’acteurs et d’actrices souhaitent bousculer, à commencer par Olivier Cochereau, directeur général du Groupe butini, institution genevoise au service des seniors : « Les EMS sont des lieux dans lesquels on poursuit sa vie et au sein desquels on doit maintenir son lien et sa place dans la communauté ». Pour lui, l’avenir passe par un changement de regard. L’enjeu est clair : transformer ces structures en acteurs sociaux à part entière, capables d’animer la vie locale et de créer du lien entre générations. Certaines de ses résidences ouvrent déjà leurs portes à des écoles, accueillent des repas partagés avec les élèves ou organisent des projets culturels et associatifs. L’idée de butini est de recréer une dynamique de village, où chacun·e, quel que soit son âge, trouve sa place. Ce changement de paradigme est d’autant plus nécessaire que le secteur traverse une crise profonde. La pénurie de personnel qualifié fragilise le fonctionnement des EMS et complique leur mission d’accompagnement. Dans ce contexte, l’attractivité devient un défi majeur. « Nous devons être perçus comme des lieux dynamiques et innovants pour attirer de nouveaux talents », souligne Olivier Cochereau. L’innovation, ici, ne se limite pas à la technologie. Elle touche à l’organisation, aux services proposés et à la manière même d’accompagner le vieillissement.
Les EMS sont des lieux dans lesquels on poursuit sa vie et au sein desquels on doit maintenir son lien et sa place dans la communauté.
Des repas livrés à domicile pour prolonger le lien social C’est dans cet esprit que le Groupe butini a décidé d’élargir son champ d’action. Forte de ses résidences spécialisées et de ses foyers d’accueil, elle imagine aujourd’hui des solutions au-delà de ses murs. L’objectif ? Prolonger la qualité de ses services jusque chez les personnes qui, pour diverses raisons, souhaitent rester à domicile. Ainsi est née « butini chez vous », une offre inédite de restauration livrée directement à la maison. Conçue sans but lucratif, cette prestation répond à un constat préoccupant : beaucoup de seniors vivant seul es s’alimentent mal, avec des repas déséquilibrés, trop légers et souvent insuffisamment riches en protéines. Or, une nutrition adaptée est essentielle pour préserver l’autonomie et la santé. « Il fallait trouver une solution concrète pour répondre à ce besoin », explique le directeur. Le service repose sur quelques principes simples : proposer chaque jour un repas savoureux et complet, composé d’une entrée, d’un plat et d’un dessert, avec plusieurs choix disponibles et des produits frais. Les menus sont élaborés par une équipe de cuisinier es professionnel les, en lien étroit avec des diététicien nes et nutritionnistes. Un menu végétarien est systématiquement proposé et une attention particulière est portée aux
Nous devons être perçus comme des lieux dynamiques et innovants pour attirer de nouveaux talents.
– Olivier Cochereau, directeur général du Groupe butini
possible de créer un compte pour offrir un repas à un e proche. Petits-enfants, voisin es ou ami es peuvent ainsi commander pour leurs aîné es et participer à leur bien-être quotidien. Certaines communes, de leur côté, prévoient des soutiens financiers afin de rendre ce service encore plus accessible. « Chaque partenaire impliqué dans ce projet a été choisi pour son sérieux, ses certifications et ses valeurs humaines », précise Olivier Cochereau. L’ambition est claire : offrir aux seniors une alternative qui valorise leur autonomie tout en sécurisant leur quotidien. À travers ce service de repas à domicile, le Groupe butini confirme sa volonté d’inscrire l’innovation dans le quotidien des aîné es, en prolongeant hors de ses murs la mission qui l’anime depuis toujours : accompagner chaque personne âgée dans sa singularité, avec dignité et humanité.
allergies et intolérances. L’idée est de combiner plaisir et équilibre nutritionnel. Vins, bières et boissons non alcoolisées sont également disponibles. Au-delà de la qualité de l’assiette, butini a misé sur l’accessibilité et la praticité. La commande s’effectue en effet en ligne, via une plateforme intuitive, rapide, sans engagement de durée et avec plusieurs options de paiement. « Contrairement à certains clichés, les seniors savent utiliser ces outils numériques. Il ne faut pas les sous-estimer », rappelle Olivier Cochereau. Le résultat ? Des repas livrés à vélo par un partenaire local du lundi au vendredi dans des contenants recyclables et prêts à réchauffer.
Du personnel de livraison formé
Le service pousse l’innovation encore plus loin en intégrant une dimension sociale essentielle : la livraison n’est pas qu’un simple transport. Formée et régulière, la personne qui apporte le repas devient l’interlocutrice privilégiée, capable de détecter chez les seniors une fatigue inhabituelle ou un signe de fragilité, et de transmettre l’information aux proches ou aux équipes concernées. Cette présence stable contribue à rompre l’isolement et à maintenir un lien humain, bien plus précieux qu’une simple livraison déposée sur le pas de la porte. Afin de renforcer cette logique communautaire, il est également

Plus d’informations sur le Groupe butini butini.ch


Chaque partenaire impliqué dans ce projet a été choisi pour son sérieux, ses certifications et ses valeurs humaines.


Livraison
de repas à domicile pour seniors
Adaptés aux besoins nutritionnels
9 Des menus savoureux au quotidien, confectionnés par une équipe professionnelle
9 Un repas composé selon les envies de chacun·e, avec des boissons en option
9 Des contenants pratiques et facile à réchauffer
9 Un lien social et relationnel maintenu à la maison
9 Un paiement en ligne simple, rapide et sécurisé
CHF 19.- par repas, livraison comprise
Commande en ligne sur : butinichezvous.ch







Soins à l’étranger : ce que la LAMal couvre vraiment
À l’étranger, un problème de santé peut vite se transformer en cauchemar financier. Maître David Métille, avocat spécialiste FSA en responsabilité civile et droit des assurances, et Maître Chahed Zedan, avocate-stagiaire, mettent en garde contre les limites de la LAMal et livrent leurs conseils pour voyager en toute sécurité.

Maître David Métille
Avocat spécialiste FSA en responsabilité civile et droit des assurances, Metropole Avocats

Maître Chahed Zedan Avocate-stagiaire, Metropole Avocats
Maître David Métille, Maître Chahed Zedan, dans quel cadre précis une caisse-maladie suisse peut-elle être amenée à prendre en charge des frais de traitement à l’étranger ?
Selon le principe de territorialité, la LAMal ne couvre en principe que les soins dispensés en Suisse. En d’autres termes, ne doivent être prises en charge par l’assurance de base obligatoire que les prestations fournies en Suisse. Les caisses-maladie suisses peuvent toutefois être amenées à prendre en charge des traitements effectués à l’étranger dans le cas d’urgence médicale imprévue lors d’un séjour temporaire à l’étranger (art. 36 al. 2 OAMal).
Concrètement, si un assuré tombe malade pendant un voyage à l’étranger et qu’un traitement ne peut pas attendre son retour en Suisse, l’assurance de base couvrira les frais nécessaires liés à cette urgence, dans les limites prévues par la loi. En revanche, les traitements volontaires ou planifiés à l’étranger ne sont, en principe, pas remboursés par l’assurance de base, sauf cas exceptionnel.
Concrètement, que recouvre la notion « d’urgence » aux yeux des assureurs et des tribunaux ? Existe-t-il une définition claire ou reste-t-elle sujette à interprétation ?
La notion d’urgence médicale en matière d’assurance-maladie est définie par l’OAMal. Selon l’art. 36 OAMal : « Il y a urgence lorsque l’assuré, qui séjourne temporairement à l’étranger, a besoin d’un traitement médical et qu’un retour en Suisse n’est pas approprié. Il n’y a pas d’urgence lorsque l’assuré se rend à l’étranger dans le but de suivre ce traitement ». L’urgence implique donc un besoin de soins immédiats et imprévus, apparu pendant un séjour à l’étranger, tel que le fait de rentrer en Suisse pour se faire traiter entraînerait un risque inacceptable pour la santé du patient. À contrario, il n’y a pas d’urgence si l’assuré s’est rendu à l’étranger dans le but de se faire soigner. Les assureurs appliquent strictement ce critère d’intention et de temporalité : il doit s’agir d’un problème de santé survenu de manière fortuite lors du séjour.
Lorsque les frais médicaux à l’étranger sont plus élevés que ceux pratiqués en Suisse, comment se calcule le remboursement ?
L’assuré doit-il systématiquement s’attendre à un reste à charge important ?
Dans l’UE/AELE, l’assureur suisse couvre les frais selon la législation du pays où les soins sont prodigués. Cela signifie que l’on applique les tarifs et règles de remboursement de ce pays, comme pour un assuré local. Mais si le système local prévoit une participation plus élevée du patient qu’en Suisse, l’assuré devra supporter cette différence. Hors UE/AELE (reste du monde), pour les urgences survenant dans des pays sans accord de réciprocité, la LAMal applique un plafond de remboursement basé sur le tarif suisse. En vertu de l’art. 36 al. 4
OAMal, l’assurance obligatoire ne remboursera les frais qu’à concurrence du double du montant qui
La loi fait-elle la distinction entre une urgence médicale survenue à l’étranger et un traitement programmé hors de Suisse ? Quelles sont les différences de prise en charge ? Oui, effectivement le droit suisse opère une distinction nette entre une urgence médicale survenant à l’étranger et un traitement programmé à l’étranger, et les modalités de prise en charge diffèrent radicalement dans ce cas de figure. En cas d’urgence médicale imprévue à l’étranger, l’assurance obligatoire des soins intervient. En revanche, les soins planifiés ou volontaires effectués hors de la Suisse ne donnent pas droit à une prise en charge par l’assurance de base, sauf accord exprès et préalable de l’assureur. Cette distinction légale vise à éviter le tourisme médical non contrôlé, tout en assurant la protection des assurés en cas d’imprévu grave à l’étranger.
aurait été payé par l’assureur si le traitement avait eu lieu en Suisse. Si les coûts à l’étranger dépassent ce plafond, la différence reste à la charge de l’assuré. Or, dans certains pays, tels que les États-Unis, les frais médicaux peuvent être très élevés, et le patient peut se retrouver avec un reste à sa charge d’un montant considérable. Concrètement, et en cas d’hospitalisation à l’étranger, la participation de la caisse-maladie va s’élever au maximum à 90 % des frais qui auraient eu cours en Suisse, soit le double de la part de 45 % prévue par l’art. 49a LAMal, puisque le solde de 55 % est à charge du canton. Quels sont les recours possibles pour un assuré qui estime que sa caisse-maladie n’a pas correctement pris en charge ses frais de traitement à l’étranger ?
Si l’assuré estime que sa caisse-maladie n’a pas correctement appliqué la loi ou a indûment refusé le remboursement de frais de traitement à l’étranger, plusieurs solutions s’offrent à lui. Il peut, premièrement, requérir une décision formelle de la part de son assureur, mentionnant les voies de droit, si ce n’est pas déjà fait. Il pourra ensuite former une opposition auprès de l’assureur lui-même, pour qu’il revoie sa position. Si l’assureur la maintient, l’assuré pourra soumettre sa cause au Tribunal compétent en matière d’assurances sociales de son canton de domicile. Le délai de recours dans ce cas est généralement de 30 jours dès la notification de la décision de l’assurance-maladie. L’assuré pourra, par exemple, démontrer que la position tarifaire appliquée par la caisse-maladie n’est pas correcte. En parallèle à la voie judiciaire, ou en amont, l’assuré peut également s’adresser à l’Ombudsman de l’assurance-maladie en vue d’une tentative de médiation. Avez-vous constaté, dans votre pratique, une augmentation des litiges liés à ces situations, notamment avec la multiplication des voyages internationaux ?
Avec la mondialisation et la multiplication des déplacements internationaux, on a effectivement constaté une augmentation des situations impliquant des soins à l’étranger, et par conséquent une hausse des litiges ou du moins des interrogations liées à leur remboursement. Dans notre pratique, nous voyons de plus en plus de cas de patients qui rentrent de voyage avec des factures médicales élevées et qui découvrent les limites de la couverture LAMal à ce moment-là. Cela mène à des contestations
potentielles, notamment lorsque l’assuré n’avait pas pleinement conscience du niveau de prise en charge auquel il pouvait prétendre, ou non.
Existe-t-il des conseils pratiques que vous donneriez aux assurés pour éviter les mauvaises surprises : assurances complémentaires, démarches à anticiper, documents à emporter en voyage ? Il est essentiel de rappeler aux voyageurs qu’ils doivent toujours se prémunir de leur carte d’assurance-maladie. En effet, elle atteste de leur droit aux soins urgents et permet leur prise en charge selon le système local. Il est important également de mentionner que certaines assurances complémentaires voyage permettent de pallier l’absence de prise en charge de l’assurance-maladie de base de la totalité des montants dus en cas de traitement à l’étranger, notamment en cas de voyages hors UE.
Enfin, au regard de l’évolution de la jurisprudence et du contexte international, pensez-vous que le droit suisse en la matière est suffisamment protecteur des patients, ou y a-t-il des réformes nécessaires ?
Le dispositif actuel permet de protéger les assurés en garantissant une prise en charge des urgences partout dans le monde, tout en évitant d’ouvrir la porte aux dérives et aux abus, notamment dans le cadre du tourisme médical, ce qui relève d’une politique de maîtrise des coûts. D’un autre côté, certaines limites du système actuel peuvent sembler insuffisamment protectrices, par exemple dans le cas des traitements urgents hors UE. En effet, cela signifie qu’un assuré qui s’est acquitté de sa prime LAMal doit encore assumer des sommes importantes s’il a le malheur de subir un problème de santé à l’étranger. Concernant la question des traitements programmés hors de la Suisse, le système actuel est très restrictif. En effet, le TF a jugé que des exceptions au principe de territorialité ne doivent en principe être admises qu’avec une grande retenue, même en cas de thérapies très rares. Il y aurait également peut-être quelque chose à entreprendre de ce point de vue-là, avec toutefois la question de savoir si l’ensemble des assurés est prêt à financer une éventuelle extension de prestations à l’étranger impliquant une augmentation potentielle de prime de l’assurance de base.
Texte SMA

Pleins feux sur les PME : Pour une solution de prévoyance optimale avec Tellco
Des stratégies personnalisées pour les besoins individuels
Lorsque le personnel qualifié manque, les conditions d’embauche attrayantes prennent de plus en plus d’importance. Dans ce cadre, la prévoyance professionnelle joue un rôle essentiel. Les entreprises qui offrent à leur personnel des solutions de prévoyance flexibles et de qualité renforcent leur position sur le marché. Tellco pk comprend les besoins spécifiques des entreprises et propose des solutions sur mesure qui peuvent être adaptées aux exigences individuelles.
Des stratégies personnalisées pour lesbesoins individuels
Le paysage des PME suisses présente une impressionnante variété d’entreprises de tailles et de secteurs différents. Elles ont toutes des objectifs et des défis différents et, en tant qu’employeurs responsables, elles recherchent une solution de prévoyance qui réponde à leurs exigences. Les PME sont au centre des préoccupations de Tellco. Des solutions sur mesure sont possibles, indépendamment de la taille et du secteur.
« Notre longue expérience auprès des PME nous montre que chaque entreprise a des priorités différentes. C’est précisément pour cette raison que nous attachons de l’importance à des solutions flexibles, adaptées aux besoins de chacune », déclare Loïc Sautebin, Responsable commercial régional Suisse romande chez Tellco Banque SA.
La fondation collective Tellco pk ne mise pas seulement sur des solutions de prévoyance individuelles, mais offre également à sa clientèle la plus grande flexibilité possible. Tellco pk propose aux entreprises de choisir entre trois solutions de prévoyance sur mesure: PRO, PULSE et INDIVIDUA. Elles se distinguent par leurs stratégies de placement, orientées vers la sécurité ou vers le rendement, et offrent la possibilité de définir soi-même certaines composantes de la solution de caisse de pension.
PRO met l’accent sur la stabilité. Grâce à son approche dynamique de la gestion des risques et à sa part d’actions de 28%, PRO est la solution idéale pour une clientèle orientée sur la sécurité.
PULSE s’adresse à une clientèle axée sur le rendement. Avec une part d’actions de 45%, les personnes assurées profitent de la croissance à long terme des marchés des actions. Pour INDIVIDUA une approche sur mesure est au premier plan. Du choix de la stratégie de placement à la banque de dépôt, c’est vous qui décidez. Cette solution est surtout destinée aux PME de grande taille à partir d’un capital de placement d’environ CHF 20 millions.
Flexibilité et adaptabilité
Tellco pk sait que les besoins des entreprises peuvent évoluer au fil du temps. Elle offre donc une flexibilité maximale : les entreprises peuvent modifier gratuitement leurs solutions de prévoyance
chaque année. De plus, les primes d’épargne ne sont dues qu’en fin d’année, ce qui permet une planification plus sûre. Des intérêts de 1.25% sont accordés sur les paiements anticipés.
Une gestion eff icace grâce à la numérisation
Grâce aux outils numériques comme l’application en ligne iTellco, les entreprises et les courtiers peuvent réduire leur charge administrative au minimum. iTellco permet de modifier à tout moment toutes les solutions standards et individuelles, de télécharger des documents et de consulter les mouvements des comptes. L’application en ligne ePlix offre également aux personnes assurées à tout moment un accès sécurisé à leurs données de prévoyance, comme le certificat de prévoyance personnel, le compte de libre passage et le compte 3a.
Un conseil personnalisé pour des solutions sur mesure
Chez Tellco, on met l’accent sur le contact personnel. Grâce à des consultations personnalisées, il est possible de discuter d’exigences spécifiques et de trouver rapidement des solutions appropriées. « L’essentiel est de bien comprendre la situation de l’entreprise. C’est pourquoi nous prenons le temps de trouver ensemble la solution la mieux adaptée », déclare Loïc Sautebin. Les entreprises peuvent ainsi offrir à leur personnel une prévoyance attrayante et profiter de conditions et d’avantages intéressants.
Des stratégies de placement durables pour des rendements à long terme
Tellco pk accorde de l’importance à une stratégie de placement durable et axée sur la sécurité, qui permet en même temps des rendements intéressants. « La durabilité n’est pas seulement une promesse pour Tellco pk, elle constitue la base de chaque stratégie de placement. Nous adhérons pleinement à la Stratégie énergétique 2050 et mettons en œuvre nos objectifs de décarbonisation de manière conséquente : les investissements dans le charbon sont exclus. À la place, nous investissons de manière ciblée dans les énergies renouvelables et dans des projets d’infrastructure. Avec nos investissements immobiliers, nous misons sur une réduction continue des émissions de CO2. Parallèlement, nous réduisons de manière continue l’empreinte écologi-
que de nos placements collectifs. Depuis 2024, nous portons le label « Good Practice » de l’Alliance climatique suisse et avons publié en 2025 pour la première fois un rapport de durabilité conforme aux standards de l’ASIP – garantissant une transparence maximale », explique Loïc Sautebin.
Un conseil sans engagement
Profitez d’un conseil gratuit et découvrez la solution de prévoyance optimale pour votre entreprise. Tellco pk se tient à vos côtés en tant que partenaire fiable et vous aide à assurer la meilleure prévoyance possible pour votre personnel.

Tellco pk est l’une des caisses de pension principales du marché suisse. Elle connaît une croissance continue et compte 10’074 entreprises affiliées et 95’527 personnes assurées. Elle gère des actifs de clientèle d’environ CHF 4.81 milliards. La structure d’âge jeune de la caisse de pension est remarquable : l’âge moyen des femmes assurées s’élève à 41.0 ans et celui des hommes assurés, à 40.4 ans. Le rapport entre personnes actives et bénéficiaires de rente de Tellco pk est donc favorable avec un bénéficiaire de rente pour 18 personnes actives (Chiffres à fin 2024). Découvrez-en plus
Victime de violences conjugales : quelles démarches entreprendre ?
Si vous êtes victime de violences conjugales au sein de votre couple, qu’il y a de la violence, physique ou psychique dans votre famille, que vous avez fait l’objet de menaces, d’insultes ou encore que l’on vous prive de votre liberté, cet article retrace la démarche à suivre à travers sept questions posées à Magali Buser, avocate spécialisée en droit pénal. Que désigne le terme « violences conjugales » ? Le Code pénal suisse n’a pas un article spécifique qui réprime les « violences conjugales », c’est pourquoi il faudra qualifier les actes au cas par cas en fonction de ce que vous avez subi. Vous pouvez avoir été victime de lésions physiques qui peuvent aller des voies de fait (pas de trace sur le corps ou seulement durant une très courte période) aux lésions graves, voire conduire au décès de la personne. Vous avez aussi pu subir des violences verbales, souvent qualifiées d’injures ou de menaces. Ensuite, il y a les infractions où la victime est privée de sa liberté, comme la contrainte ou la séquestration. On retrouve également le harcèlement téléphonique. Enfin, il y a évidemment toutes les infractions contre l’intégrité sexuelle qui peuvent aller d’attouchements non consentis au viol. Pour chaque type de cas, il faudra agir en fonction de ce qui est dénoncé, mais il y a des points communs dans chaque procédure. Celle-ci sera en général assez lourde à porter et souvent de longue durée. Il faut donc commencer par un dépôt de plainte clair et précis. Le dépôt de plainte : quand le faire et auprès de qui ?
En règle générale, une plainte doit être déposée dans les trois mois depuis l’infraction. Toutes les infractions ne nécessitent pas un dépôt de plainte. Si l’infraction est grave (comme par exemple des lésions corporelles graves, les infractions sexuelles ou encore la contrainte), le Ministère public devra poursuivre les faits d’office. Mais encore faut-il qu’il sache que vous avez été victime de tels actes, c’est pourquoi déposer plainte permet de dénoncer la situation. Par ailleurs, et c’est important, notre législateur a également voulu protéger les victimes de violences conjugales qui font ménage commun avec leur agresseur. En effet, si l’agresseur est la personne avec qui vous vivez, votre partenaire enregistré ou votre mari/épouse, le simple fait de dénoncer les actes de violences dont vous faites l’objet suffira pour ouvrir une enquête pénale. Cela ne vaut par contre pas pour les insultes et le harcèlement téléphonique. Pour le dépôt de plainte en tant que tel, deux options s’offrent à vous : Vous pouvez aller directement au poste de police pour déposer plainte. Dans ce cas, il faudra faire attention à ce que la police note dans le procès-verbal et bien relire votre déposition à la fin, car vous ne recevrez pas de copie. Il faudra également être attentif aux dernières questions qui vous seront posées en fin d’audition ou au début selon le canton où vous êtes. Les questions abordées ici sont :
– Est-ce que vous souhaitez que l’auteur soit poursuivi ? Il faut répondre OUI, sinon il ne s’agit pas d’un dépôt de plainte mais d’une dénonciation, vous n’aurez par la suite pas la qualité de partie plaignante.
– Est-ce que vous souhaitez que l’auteur soit condamné à vous verser une indemnité ? Il faut répondre OUI, faute de quoi, vous ne pourrez pas réclamer d’indemnité, même pour d’éventuels frais que vous aurez subis – frais médicaux, avocat, frais de justice, dommage matériel, etc. – dans le cadre de la procédure pénale à venir.
– Est-ce que vous renoncez d’ores et déjà à être présent ou à être convoqué ? Ici, vous pouvez répondre ce que vous souhaitez, ceci n’a pas d’influence directe sur la suite.
L’avantage de se rendre au poste de police est l’immédiateté de la démarche. En général, si la police est intervenue sur les lieux où il y a eu des violences, il faut immédiatement se confier à la police et déposer plainte. Cela aura le mérite que la police pourra faire son travail et « freiner » votre agresseur (par le prononcé d’une mesure d’éloignement du logement commun pour quelques jours, maintien en détention pour quelques heures, etc.).
La deuxième option est de rédiger vous-même une plainte que vous adresserez au Ministère public compétent de votre région. Dans ce cas-là, je conseille de vous adresser à une personne professionnelle du domaine, comme un avocat. Il y a en effet des choses à mettre en avant et une manière de rédiger qui aide pour la suite de la procédure.
Cette solution devrait être choisie s’il n’y a pas eu d’intervention de police, que pour une raison ou une autre, vous décidez de parler mais que les actes remontent à un certain temps, ou tout simplement parce que vous avez des difficultés à parler de ce qui vous arrive et que vous avez besoin d’aide pour synthétiser les faits dont vous avez été victime. L’avantage est que vous gardez une copie de votre plainte que vous pourrez relire avant l’audience de confrontation.
Comment fonctionnent les preuves et pourquoi sont-elles importantes ?
Souvent, c’est là qu’une procédure devient compliquée, car dans beaucoup de cas, votre agresseur niera ce que vous avez raconté. D’où l’importance des preuves que vous pourrez, vous, en tant que victime, apporter pour démontrer que vous dites la vérité.
Cela peut vous apparaître choquant, mais il n’appartient pas à celui que vous dénoncez de démontrer son innocence, mais bien à la partie plaignante de démontrer que la personne que vous dénoncez est coupable des actes que vous lui prêtez.
Les preuves à apporter sont multiples. Il s’agit tout d’abord de vos déclarations (votre plainte dans un premier temps et vos déclarations futures). Mais en cas de « parole contre parole », il serait utile d’avoir d’autres éléments de preuves. C’est pourquoi il faut toujours garder une trace de ce que vous avez subi, même si vous n’êtes pas encore prêts à entreprendre les démarches pour dénoncer. Il serait donc important
Contenu sponsorisé • Coop Rechtsschutz AG
de vous rendre chez un médecin pour faire constater les lésions, chez un psychologue/psychiatre pour parler de votre situation, prendre des photographies des lésions subies ou des lieux saccagés (objets cassés car lancés sur vous, etc.). Il peut également s’agir du témoignage de personnes de votre entourage à qui vous vous êtes confiés ou qui ont pu voir les séquelles que vous avez eues. Pour des infractions relevant de l’intégrité sexuelle, si l’infraction vient d’avoir lieu, il faut immédiatement vous rendre à l’hôpital le plus proche pour faire établir un certificat médical. Qui peut vous accompagner lors d’un dépôt de plainte et à quoi cela sert-il ? Il faut savoir qu’en tant que victime / lésé, vous pouvez vous faire accompagner par une personne de confiance pour déposer plainte. Il est préférable que la personne de confiance ne soit pas un éventuel témoin futur dans la procédure, car cela pourrait diminuer sa crédibilité par la suite.
Vous pouvez également vous faire accompagner de votre avocat, avec qui vous aurez préparé votre audition. Il pourra vous aiguiller sur la manière de répondre aux questions qui vous seront posées, et vérifier que la police note bien tout ce que vous avez dit ou en tout cas l’essentiel, que le procès-verbal soit ensuite relu et éventuellement corrigé, mais surtout, comme vous ne recevrez pas de copie de votre plainte, que des notes soient prises sur ce que vous avez expliqué.
Le dépôt de plainte auprès de la police est essentiel pour la suite de la procédure judiciaire car c’est la première fois que vous serez entendu. Plus vos dires seront précis et étayés, plus les chances que la procédure judiciaire aboutisse seront grandes.
Comment se protéger légalement d’un partenaire violent ?
Si vous faites ménage commun, il y aura évidemment un volet civil à entreprendre. Il s’agira d’entamer, devant le Tribunal, une procédure en mesures protectrices de l’union conjugale qui traite de la séparation, de l’attribution du logement, de la garde des enfants et des pensions alimentaires, si vous êtes liés par un mariage ou un partenariat enregistré. Si vous faites juste ménage commun, la procédure de séparation pourra également être entreprise, mais s’intitulera autrement.
Il existe également des mesures administratives qui peuvent être prises immédiatement par la police, telles qu’une « mesure d’éloignement » interdisant à votre agresseur de rentrer au domicile commun. Il est possible de la demander au moment du dépôt de plainte.
Auprès de qui trouver de l’aide ?
Vous pouvez prendre conseil auprès d’un avocat qui pourra vous accompagner dans vos démarches. Il est possible de demander l’assistance judiciaire, si vos moyens financiers sont limités.
Vous pouvez également vous rendre auprès du Centre LAVI de votre canton, qui pourra vous aider en cas de crise aiguë pour un logement d’urgence.
Quelle est la suite de la procédure ?
Après le dépôt de plainte, vient l’audience de confrontation. Il faudra répéter, devant le Ministère public, la même chose que ce que vous avez dit lors de votre plainte. Souvent, votre audition sera plus détaillée et, si votre agresseur a un avocat, ce dernier pourra également vous poser des questions. Il y aura ensuite des audiences pour entendre les témoins ou d’autres personnes dans la procédure. Enfin, la procédure se terminera par une ordonnance pénale ou un renvoi en jugement. Une procédure pénale ou civile peut prendre plusieurs années.
Comme vous le constaterez, souvent, les victimes / lésés seront démunis au départ, puis épuisés par la suite. C’est là que le rôle de l’avocat choisi pourra faire la différence et que votre entourage sera déterminant pour vous aider à surmonter les difficultés qui se présenteront à vous.
En cas de questions complémentaires ou d’aide pour votre problème particulier, l’Etude Etter & Buser (Bd Saint-Georges, 1205 Genève ; tél. 022 329 87 77) a l’expérience pour vous soutenir dans vos différentes démarches.
Les centres qui pourraient vous aider dans les différents cantons romands :
– Genève : Association Centre Genevois de Consultation pour Victimes d’Infractions (LAVI), 72, bd Saint-Georges, 1205 Genève Tél. 022 320 01 02
– Vaud : Centres LAVI du Canton de Vaud ; À Lausanne : Rue du Grand-Pont 2bis, 1003 Lausanne. Tél. 021 631 03 00
À Nyon : Route de l’Étraz 20A, 1260 Nyon Tél. 021 631 03 02
À Aigle : Rue du Molage 36, 1860 Aigle Tél. 021 631 03 04
À Yverdon-les-Bains : Rue de la Plaine 2, 1400 Yverdon-les-Bains Tél. 021 361 03 08 À Vevey : Av. du Général-Guisan 30, 1800 Vevey Tél. 021 631 03 06.
– Valais : Centre de consultation LAVI Valais Romand, rue des Vergers 1, 1950 Sion Tél. 027 607 31 00
– Neuchâtel : SAVI (Service d’aide aux victimes) Centre LAVI & Solidarité femmes, Rue des Poudrières 135, 2000 Neuchâtel Tél. 032 889 66 49 ou Rue Daniel-Jeanrichard 43, 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032 889 66 49
– Jura : LAVI centre de consultation, Quai de la Sorne 22, 2800 Delémont Tél. 032 420 81 00
– Berne : www.opferhilfe-bern.ch
Appel à la police en cas d’urgence : 117
Coop Protection juridique : la bonne adresse en cas de litige
Les litiges coûtent du temps, de l’argent et des nerfs. Avec Coop Protection juridique, les entreprises et les particuliers misent sur la sécurité et des prestations solides. Mais ce n’est pas seulement la promesse qui compte, c’est surtout sa mise en œuvre.
Le bouclier des consommateurs
Coop Protection juridique accorde une grande importance aux prestations favorables aux consommateurs et aux solutions simples. Les juristes et avocats s’engagent avec passion, flexibilité et savoir-faire pour leurs clients. Dans chaque affaire juridique, ils recherchent la meilleure solution possible en collaboration avec leurs partenaires. Compétents, professionnels, simples, individuels – dans l’intérêt des clients.
Plus d’informations sur www.cooprecht.ch

Avec Coop Protection juridique, les entreprises et les particuliers misent sur la sécurité et des prestations solide.
Texte SMA






LA RÉFÉRENCE ROMANDE DANS LE DOMAINE
Goodwill Formation est spécialisée depuis plus de 30 ans dans le domaine de la formation continue en finance et comptabilité.
Prochaine rentrée Février 2026

BREVET FÉDÉRAL DE SPÉCIALISTE EN FINANCE ET COMPTABILITÉ
700 périodes de cours, en 4 ou 5 semestres
• Fiscalité
• Techniques comptables
• Assurances sociales et salaire
• DAS in Accounting
• Un « Professional Bachelor »
5 lieux de formation
Lausanne, Vevey, Sion, Neuchâtel et Genève
Goodwill Formation SA Avenue de Gratta-Paille 2 1018 Lausanne
021 923 66 66
info@goodwill-formation.ch
Créé par des professionnels du milieu, Goodwill Formation a toujours placé la qualité de l’enseignement au centre de ses préoccupations.
Ainsi les cours sont assurés par des intervenants spécialisés dans les domaines abordés. Ces cours sont dispensés dans différents centres de formation, à Lausanne, Vevey, Sion, Neuchâtel et Genève
Prochaine rentrée Mars 2026
DIPLÔME FÉDÉRAL
D’EXPERT·E EN FINANCE ET CONTROLLING
Avec le Diplôme Fédéral d’Expert(e) en Finance et en Controlling, vous faites partie des experts de haut niveau grâce à vos connaissances approfondies.
• Un « Professional Master »
• Passerelle pour un MAS HES in Controlling
• Opportunités de carrière plus importantes
• Revenus supérieurs
30 ans d’expérience
Pour votre Formation professionnelle supérieure en Finance et Comptabilité, faites confiance à des professionnels expérimentés et passionnés
Remboursement de 50 % des frais de formation par la Confédération (SEFRI, voir conditions)
Courtage immobilier -
Tout ce que vous devez savoir avant de mettre votre bien en vente
Faire appel à un courtier soulève souvent de nombreuses questions : quand faire appel à lui ? Quand a-t-il droit à sa commission ?
Peut-on mandater plusieurs courtiers ? Entre obligations et moyens, frais annexes et choix d’un partenaire de confiance, il est essentiel de comprendre le cadre qui régit cette profession pour faire le meilleur choix possible en fonction de sa situation.

PBBG SA est une entreprise spécialisée en gérance et en gestion immobilières. Fondée en 1988 et basée à Lausanne, la société accompagne ses clients à chaque étape de leurs démarches, qu’il s’agisse de la vente d’un bien, d’un achat, d’une expertise ou encore de conseils fiscaux.. Ses équipes de professionnels proposent des solutions sur mesure et une approche personnalisée, et ce afin de répondre au mieux aux besoins de sa clientèle. Dans cette interview, PBBG SA répond aux questions les plus fréquentes sur la mission d’un courtier et les obligations des clients.
Quel est le rôle d’un courtier ?
Le courtier intervient comme un intermédiaire spécialisé entre un client, un marché ou un vendeur. Son rôle est de faciliter la transaction et d’optimiser le résultat pour son client. Parmi ses missions principales, on compte le conseil et l’expertise, qui vont lui permettre d’évaluer les biens et de proposer des stratégies adaptées, la mise en relation des acheteurs, vendeurs ou encore locataires. Lors de cette phase, il défend les intérêts de son client pour obtenir les meilleures conditions possibles.
Il peut également fournir un accompagnement administratif en s’occupant des documents et des contrats, et proposer des services après-vente pour s’assurer que toutes les obligations soient bien respectées.
Quand faire appel à lui ?
Il est conseillé de s’entourer d’un courtier lorsque l’on souhaite optimiser une transaction immobilière et sécuriser son investissement.
Grâce à son expérience professionnelle, il peut ainsi intervenir lors de la vente d’un bien pour estimer correctement le prix, rédiger les annonces et sélectionner les acheteurs sérieux, ou encore lors de l’achat d’un bien, auquel cas il cherche, évalue et négocie les conditions d’achat du bien.Il peut également guider ses clients qui souhaitent à investir, en analysant le marché, en identifiant les opportunités et en les conseillant sur le rendement.
Le courtier a-t-il droit à une commission si l’affaire se conclut… sans lui ?
Oui, si l’affaire a été conclue grâce à son intervention, même indirectement. C’est le principe de la causalité adéquate : si le client signe avec une personne mise en relation par le courtier, la commission reste due.
Peut-on donner plusieurs mandats de courtage en parallèle ?
Oui, tant qu’il ne s’agit pas d’un mandat exclusif. En cas d’exclusivité, seul le courtier désigné peut intervenir. Sans exclusivité, plusieurs courtiers peuvent être mandatés, mais un seul touchera la commission : celui qui amène le résultat (sauf s’il existe une convention de partage entre les agences).
Le courtier a-t-il une obligation de résultat ou seulement de moyens ?
Le courtier a une obligation de moyens : il doit

#focusvosdroits
agir avec soin, loyauté et professionnalisme. Sa rémunération n’est toutefois due que si son intervention permet effectivement de conclure l’affaire.
Un courtier peut-il cumuler ses honoraires avec des frais annexes (publicité, visites, etc.) ?
Oui, si cela est prévu dans le contrat. Les frais doivent être annoncés clairement dès le départ. Sinon, seul le montant de la commission convenue est dû.
Commission au forfait ou commission proportionnelle : de quoi parle-t-on vraiment ?
Une partie du forfait est dû même si le bien n’est pas vendu. Il couvre surtout des prestatsions marketing (annonces en ligne, photos, diffusion, etc.), mais pas nécessairement l’expertise du courtier ni l’accompagnement sur le terrain. À l’inverse, la commission proportionnelle rémunère le courtier uniquement si la vente aboutit. Elle inclut l’accès à son réseau, sa connaissance du marché local, la sélection des acheteurs et la négociation, ce qui en fait un véritable engagement de résultat.
Comment choisir un courtier de confiance ?
Un courtier professionnel ne se contente pas de mettre un bien en ligne : il apporte une réelle valeur ajoutée. Il analyse le marché, définit une stratégie, sélectionne soigneusement les acheteurs potentiels et échange avec eux en amont pour vérifier leur sérieux. Cela évite au client de multiplier les visites inutiles et de perdre du temps. Chez PBBG SA, cette approche personnalisée, basée sur la transparence et la connaissance du marché local, garantit un accompagnement efficace et de qualité.
Plus qu’un prestataire, PBBG SA accompagne ses clients dans toutes les étapes clés : recherche d’un logement, rénovation, gestion du bien et optimisation fiscale


Plus d’informations sur +41 21 345 36 36 pbbg.ch/services