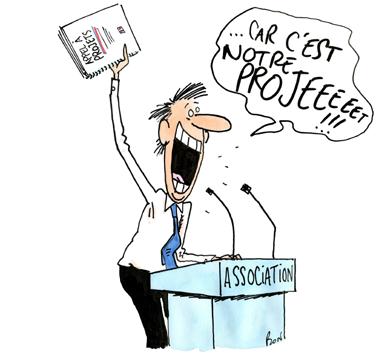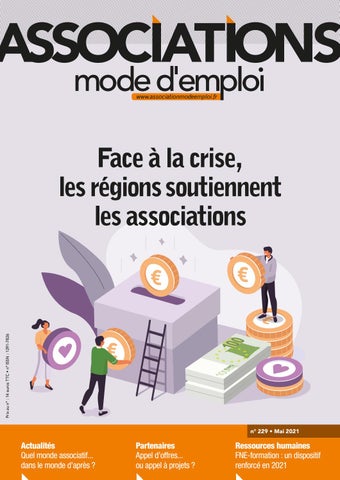4 minute read
en milieu confiné
INTERVIEW
DR
Advertisement
Bernard Petitgas, sociologue
Qu’appelez-vous un milieu confiné et pourquoi vous êtesvous intéressé à ce sujet ?
Je définis un milieu confiné comme un lieu qui enferme pour diverses raisons : judiciaires (une prison), psychiatriques (un hôpital ou un service de soin), liées à la vulnérabilité due à l’âge (un Ehpad), etc. Ayant moi-même vécu treize ans en détention, je me suis posé la question : « Quelles sont, dans ces lieux fermés, les possibilités pour les individus de s’engager, de donner et de créer malgré tout du lien social ? » Dans mes recherches, j’interroge la vulnérabilité des personnes elles-mêmes à l’aune de cette idée : tout citoyen, où qu’il soit, peut faire association et s’engager bénévolement. Cela peut se traduire par la création effective d’une association loi 1901, mais aussi par un simple regroupement informel autour d’un projet ou d’une initiative.
Par exemple ?
Des papis qui, dans une maison de retraite, se mettent à faire un potager. Au départ, ils doivent affronter une administration frileuse et les inquiétudes des infirmières qui craignent qu’ils se blessent. Or ils se débrouillent très bien et le confinement lié au Covid les a même aidés. Puis ils sont rentrés en contact avec une association qui leur a fourni des graines et des outils. Dans une autre maison de retraite, des femmes qui ont repris leurs « recettes de grandmère » et les ont transmises avec des cours de cuisine pour des jeunes couples. Ces femmes atteintes de la maladie d’Alzheimer retrouvaient leurs facultés cognitives lors de ces séances ! En prison, des détenus qui ont organisé un événement sportif et une collecte dans le cadre du Téléthon. Dans deux autres centres de détention, ils ont fait une collecte de nourriture au bénéfice d’une association de solidarité. Toutes ces initiatives génèrent de l’autonomie et amènent à la participation.
Quels enseignements tirez-vous de ces expériences ?
Je remarque que la vulnérabilité des personnes est souvent pensée comme les empêchant de pouvoir réaliser des projets ou s’engager. Or malgré ces vulnérabilités, liées à l’âge, à la santé, à la privation de liberté, il y a toujours des moments de citoyenneté qui sont possibles. L’éventail de la vulnérabilité est large mais celle-ci n’est pas la même pour tous. Dans une maison de retraite par exemple, elle peut être cognitive, physique, psychologique, etc., et à des degrés très divers. Or l’administration peine souvent à prendre en compte cette diversité et elle a tendance à assimiler tout le monde à la situation des plus fragiles. Par exemple, la notion de danger est appliquée administrativement à tous les résidents de la même manière. Du côté du personnel soignant, la position est plus ouverte car il voit bien l’apport positif des associations qui interviennent dans ces milieux, ou celui des rares projets d’initiative bénévole des résidents. Il comprend qu’ils sont un puissant agent de socialisation et qu’ils permettent une ouverture sur le monde extérieur. Les lieux qui enferment sont aussi des lieux de société. Celle-ci est partout et elle doit être présente dans ces lieux.
Comment les institutions réagissent-elles ?
Lorsque les personnes s’engagent, cela peut se traduire par l’émergence de projets, mais aussi par des revendications de droits, ce qui interroge directement l’institution. C’est très net en prison où l’administration a peur de l’organisation des prisonniers, avec une injonction paradoxale : on leur demande de devenir autonomes dans une optique de réinsertion et, quand ils le font, ils sont regardés avec soupçon et méfiance. Au niveau des politiques générales, tout le monde trouve très bien que les personnes s’engagent, mais au niveau des établissements c’est beaucoup plus varié. Il y a ceux qui ne favorisent pas beaucoup ce genre d’engagement et il y a ceux (qui sont quand même les moins nombreux), qui osent se lancer dans des initiatives. Cela tient souvent à la personnalité de chefs d’établissement qui sont à l’écoute des usagers mais aussi des salariés et qui savent le bénéfice social qu’apporte à tous ce genre d’initiatives bénévoles. La différence est dans la prise de risque – qu’on accepte de prendre ou non.
Que peuvent nous apprendre vos recherches à l’heure de la crise sanitaire ?
Que dans des situations de confinement structurel, l’engagement bénévole est toujours possible de façon formelle et informelle. On l’a bien vu durant la crise où des bénévoles se sont engagés pour répondre à cette situation d’urgence. La crise a confirmé aussi que les engagements ont pu être ponctuels, conjoncturels, qu’aider une association n’implique pas forcément d’y adhérer. J’ai entendu des associations dire que des bénévoles les « avaient lâchées » après le confinement. C’est plus complexe que cela : ils ne les ont pas lâchées, ce sont de nouvelles modalités de faire association qui ont émergé ou se sont confirmées. C’est un enjeu fort pour le monde associatif : il faut que les associations soient assez souples pour s’adapter à ce public qu’elles pensent à tort versatile et inconstant, et pouvoir peutêtre l’accueillir à nouveau plus tard.
Propos recueillis par Michel Lulek
En savoir plus
- Thèse de doctorat : « L’engagement relationnel et bénévolat en milieu carcéral » (2017), s.42l.fr/g0HC9WRs - Dans le cadre d’un prix de l’Institut du monde associatif, Bernard Petitgas poursuit actuellement une recherche sur l’engagement bénévole et associatif en milieu confiné en collaboration avec le laboratoire Cerrev de l’université de Caen.