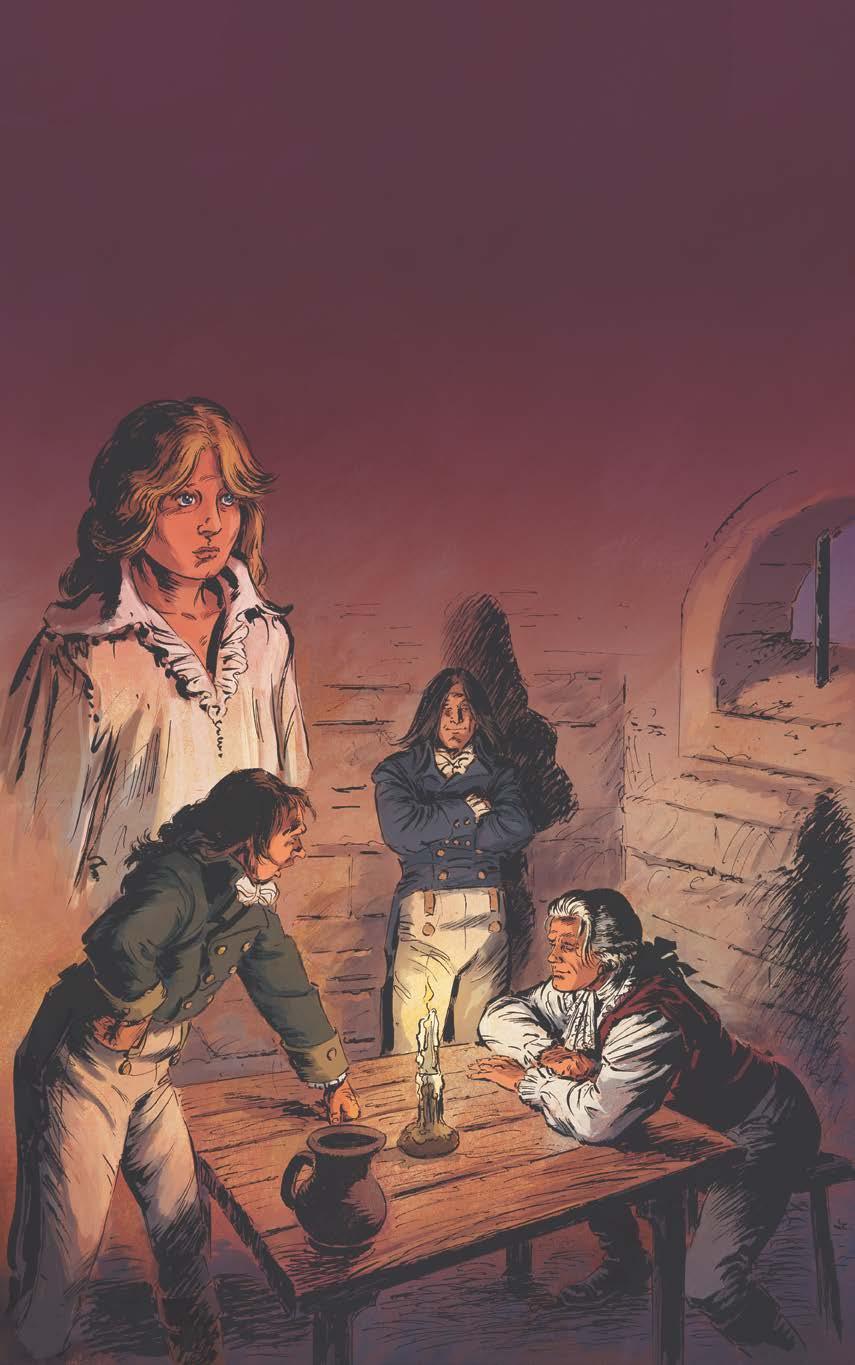
Baronne Emmuska Orczy

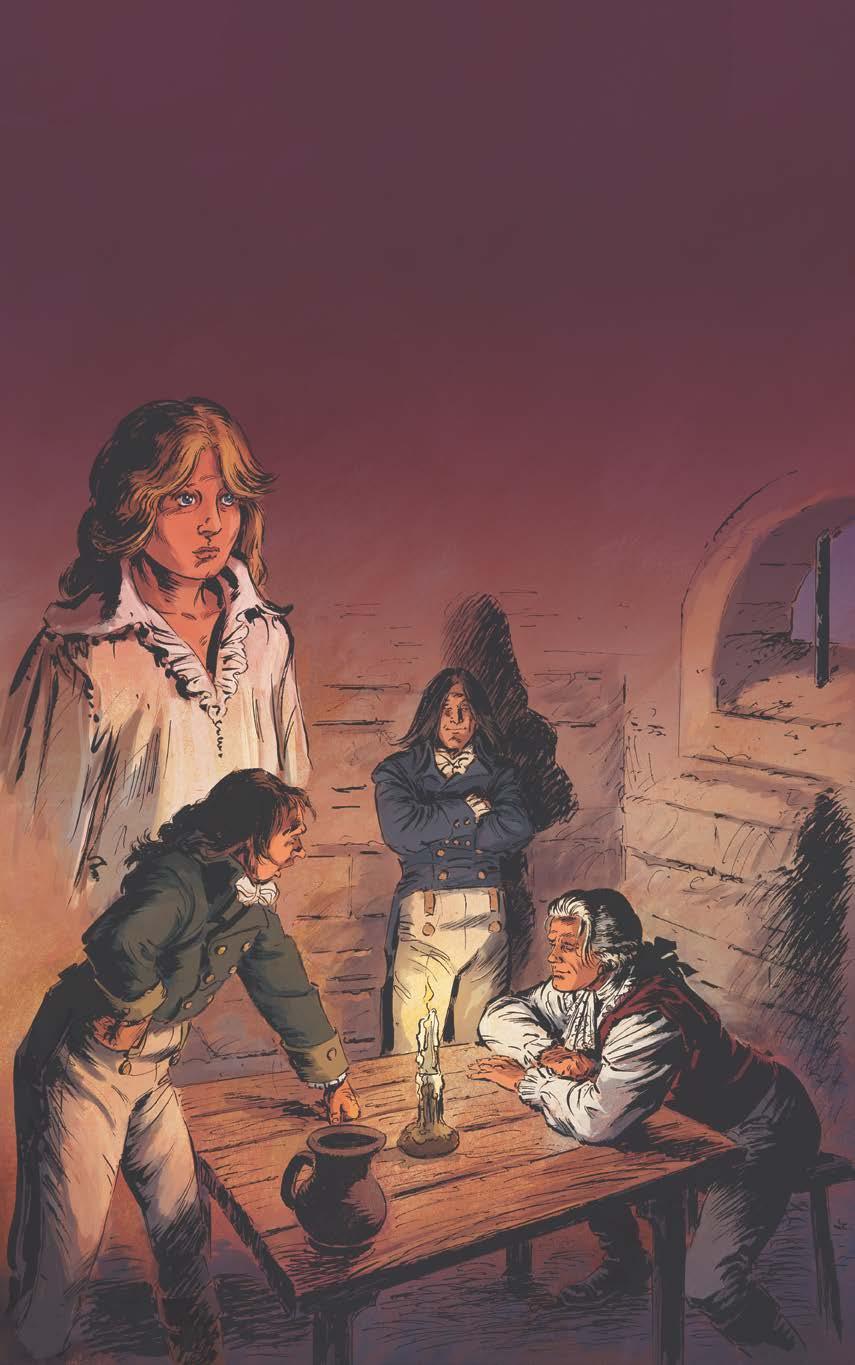
Baronne Emmuska Orczy
Tome IV
Roman
Traduction Anne de La Blache
Illustrations Fréderic Garcia
L’identité du Mouron Rouge a fait l’objet, ces dernières années, d’une théorie qui a créé une assez forte confusion dans l’esprit de l’étudiant comme dans celui du lecteur. Certains, en effet, ont cru reconnaître dans l’aventurier anglais le conspirateur royaliste gascon connu sous le nom de baron de Batz.
Il paraît donc nécessaire de mettre les choses au point : le Mouron Rouge et le baron de Batz sont deux personnes bien distinctes. Cette confusion identitaire ne résiste pas à une analyse même superficielle des deux personnalités qui montre bien les grandes différences existant entre les deux hommes, dans leur caractère mais surtout dans leurs objectifs.
Si l’on en croit quelques historiens enthousiastes, le baron de Batz était à la tête d’un vaste réseau de conspirateurs, soutenu financièrement depuis l’étranger – l’Angleterre et l’Autriche notamment –, dont l’objectif était le renversement du gouvernement républicain révolutionnaire et la restauration de la monarchie en France.
Pour atteindre cet objectif politique, sa stratégie consistait à semer la division parmi les membres du gouvernement révolutionnaire, à attiser les dissensions et la haine jusqu’à ce que chacun accusât l’autre de traîtrise durant l’Assemblée de la Convention qui devenait alors une arène où les révolutionnaires au pouvoir se jetaient à la gorge les uns des autres, assoiffés de sang comme des loups, hurlant comme des hyènes.
Ces mêmes historiens enthousiastes voient dans tous les évènements marquants de cette époque troublée le signe d’une soi-disant conspiration étrangère due aux intrigues du baron de Batz, qu’il s’agisse de la chute des Girondins, de l’évasion du jeune Dauphin de la prison du Temple, ou de la mort de Robespierre. Ce serait Batz qui aurait réussi à dresser les Jacobins contre les « Montagnards », Robespierre contre Danton, Hébert contre
Robespierre. Ils vont même jusqu’à imaginer qu’il aurait pu être l’instigateur des massacres de Septembre, des atrocités de Nantes, des crimes de Thermidor, des sacrilèges, des noyades..., tout cela pour créer des rivalités dans l’horreur et la cruauté, jusqu’à ce que les bouchers révolutionnaires disparaissent sous les décombres de leurs orgies et finissent par se massacrer entre eux dans une hécatombe anarchique.
L’objet de ce prologue n’est pas d’analyser les affirmations plus ou moins fantaisistes relatives au pouvoir qu’aurait eu le baron de Batz ou aux évènements révolutionnaires qu’il aurait fomentés. Il s’agit uniquement ici de bien marquer la différence entre la personnalité du conspirateur gascon et celle du Mouron Rouge.
Le baron de Batz était un aventurier sans grands moyens, hormis ceux qu’il pouvait obtenir de l’étranger. Il faisait partie de ces hommes qui n’avaient plus rien à perdre et tout à gagner en se plongeant dans le chaudron bouillonnant de la politique intérieure du pays.
Il tenta plusieurs fois cependant de sauver de la prison et de la mort, d’abord le Roi Louis XVI, puis la Reine et la famille royale. Il échoua. Il ne semble pas qu’il ait essayé d’arracher à la mort d’autres innocents, d’autres victimes moins célèbres, de cette Révolution sanguinaire qui secoua, par sa cruauté, les fondations du monde civilisé.
Lorsque le 29 prairial, tant de malheureux, femmes et hommes, furent condamnés et exécutés pour soi-disant « complicité avec une conspiration étrangère », le baron de Batz, suspecté d’avoir été à la tête de cette conspiration, si conspiration il y eût, ne semble pas avoir cherché à sauver ses alliés de la guillotine ni à périr avec eux s’il ne pouvait les sauver.
Et pourtant, comment oublier que parmi les martyrs du 29 prairial se trouvaient des femmes comme Mme de Grandmaison, amie dévouée du baron, la belle Émilie de Saint-Amaranthe, la petite Cécile Renault qui allait sur ses seize ans ? Parmi eux se trouvaient aussi des hommes comme Michoni et Roussel, fidèles serviteurs du baron de Batz, ou bien le baron de Lézardière et le comte de Saint-Maurice, des amis proches.
On voit bien qu’il ne peut y avoir le moindre doute : le conspirateur gascon et le gentilhomme anglais sont bien deux personnes très différentes.
Les objectifs du Mouron Rouge étaient non politiques. Il n’intrigua jamais pour la restauration de la monarchie ni même pour le renversement de cette République que, pourtant, il abhorrait.
Son seul souci était de sauver des innocents, de tendre une main secourable à ces infortunées créatures qui étaient tombées dans les filets tendus par des compatriotes, des misérables qui, ayant eux-mêmes tout perdu, avaient juré d’exterminer tous ceux qui s’accrochaient encore à leurs biens, à leur foi, à leur religion.
Le Mouron Rouge ne cherchait pas à punir lui-même les coupables, il ne s’occupait que des innocents menacés, de ceux qui n’avaient plus personne pour les aider.
Pour aider ces malheureux, il risquait sa vie chaque fois qu’il posait le pied sur le sol français ; pour eux, il sacrifiait sa fortune et même son bonheur personnel. Il leur avait consacré toute son existence.
Alors que le conspirateur français avait peut-être des alliés au sein même de la Convention, des alliés suffisamment importants et puissants pour assurer son immunité, lorsque le Mouron Rouge était en mission, il avait toute la Convention contre lui.
Autant il est impossible de chercher à justifier les objectifs personnels du baron de Batz et l’existence qui fut la sienne, autant apparaît légitime la grande fierté de toute une nation devant la personnalité de son héros, le Mouron Rouge.
Certains arrivaient à trouver malgré tout l’occasion de se distraire, de danser, d’aller au théâtre, au concert, de profiter des cafés et des promenades du Palais Royal.
De nouvelles modes féminines émergeaient, les modistes s’essayaient à de nouvelles créations et les bijoutiers trouvaient encore des clients. L’acuité angoissante du danger imminent, toujours présent, avait stimulé chez certains artisans un sens de l’humour macabre : on trouvait ainsi des tuniques dont la coupe s’appelait « tête tranchée » ou des plats comme le ragoût « à la guillotine ».
Pendant ces années dramatiques, les théâtres n’avaient fermé leurs portes que trois soirs, ceux qui avaient immédiatement suivi les atroces massacres du 2 septembre. Les scènes de boucherie humaine qui eurent lieu devant la prison de l’Abbaye avaient frappé d’horreur les Parisiens. Les cris déchirants des suppliciés auraient couvert les applaudissements d’une audience aux mains dégoulinantes de sang.
Mais tous les autres soirs, pendant ces quatre ans et demi, les théâtres de la rue de Richelieu, du Palais Royal, du Luxembourg et les autres avaient levé leurs rideaux et encaissé l’argent des spectateurs comme si de rien n’était. Une partie de ceux qui s’étaient agglutinés dans la journée place de la Révolution pour ne rien manquer des drames qui se jouaient sur l’échafaud se retrouvaient le soir sur les gradins et dans les loges pour rire aux satires de Voltaire ou pleurer sur les mésaventures tragiques et sentimentales de Roméos persécutés et d’innocentes Juliettes.
La mort frappait alors, à tant de portes ! La mort s’invitait sans prévenir, entrait dans les maisons des cousins ou des amis ; la grande Faucheuse était devenue un hôte si familier que lorsqu’elle arrivait, plus personne ne s’étonnait. Il suffisait de l’avoir frôlée, de l’avoir vue vous sourire ou, parfois, vous ignorer, pour qu’elle vienne le lendemain vous chercher,
accueillie avec la même indifférence. En dépit des horreurs et du sang qui éclaboussait ses murs, Paris était resté une ville de plaisirs, et le rideau des théâtres se levait et descendait à une cadence comparable à celle du couperet de la guillotine.
En ce soir glacé du 27 nivôse de l’an II de la République –soit, pour ceux qui comme nous, restent fidèles à l’ancien ordre calendaire, le 16 janvier 1794 –, une brillante compagnie se pressait dans l’auditorium du Théâtre National.
Une des actrices fétiches du public tenait le rôle d’une des insouciantes héroïnes de Molière dans l’une des nouvelles représentations du Misanthrope dont le Tout-Paris révolutionnaire avait beaucoup parlé, car la mise en scène, les décors, les costumes, jusqu’à cette charmante actrice, avaient été entièrement renouvelés pour ajouter du piquant à l’esprit, déjà mordant, du Maître.
D’après Le Moniteur universel dont la chronique des évènements d’alors est une source documentaire inépuisable, le même jour, la Convention votait une nouvelle loi donnant tous pouvoirs à ses espions, les autorisant à procéder de manière discrétionnaire à des perquisitions dans les domiciles privés, sans avoir même à en référer au Comité de salut public, à poursuivre et envoyer en prison tous ceux qu’ils estimaient être des obstacles au bonheur du peuple. Il était même décidé de leur octroyer une récompense de trente-cinq livres « pour chaque gibier ainsi rabattu vers la guillotine ». Et Le Moniteur universel relève l’autre fait notoire à cette date : la salle du Théâtre National où se jouait la comédie de Molière était comble.
La Convention avait donc voté cette nouvelle loi inique qui mettait des milliers de vies à la merci de quelques êtres assoiffés de sang. La session fut ensuite ajournée et les membres de cette Assemblée se hâtèrent vers le théâtre de la rue de Richelieu.
Lorsque les représentants du peuple arrivèrent dans la salle, celle-ci était déjà grouillante de monde. Ils se frayèrent un chemin, les uns derrière les autres, comme un serpent se glisse dans les hautes herbes, vers les sièges qui leur avaient été réservés dans les petites loges. En voyant passer le sinistre cortège, des « chut » se firent entendre dans la foule soudain apeurée à la vue de ces hommes qui inspiraient tant d’horreur et d’effroi.
La tête soigneusement emperruquée de Robespierre apparut dans une des loges ; son ami de cœur, Saint-Just, et la sœur de ce dernier, Charlotte, étaient avec lui. Danton, comme un énorme fauve dépenaillé, était encore en train de se frayer un passage dans la foule à grands coups de coude, tandis qu’apparaissait à
l’étage supérieur la haute carrure de Santerre, le beau boucher, idole de la populace parisienne, sanglé dans son uniforme de la garde nationale, et bruyamment acclamé.
Le public chuchotait avec excitation. Dans l’air surchauffé, on se répétait tout bas les noms terribles de ces hommes. Les femmes se tordaient le cou pour mieux voir autour d’elles, regardant avec avidité toutes ces têtes dont un bon nombre, dès le lendemain, rouleraient sous la lame de la guillotine.
Dans une des petites loges d’avant-scène, deux hommes avaient pris place, bien avant que le public n’ait commencé à envahir l’auditorium. L’intérieur de la loge était plongé dans une obscurité totale, son étroite ouverture ne permettait qu’à peine à ses deux occupants de distinguer une petite partie de la scène, et les cachait plus qu’elle ne les révélait.
Le plus jeune des deux hommes était visiblement étranger à Paris : au fur et à mesure que la salle se remplissait, il se tournait souvent vers son compagnon pour demander qui étaient les personnalités présentes.
— Dis-moi, Batz, dit-il en désignant un groupe d’hommes qui venaient d’entrer dans la salle, qui est cette créature, là-bas, celle qui a un manteau vert ? Il met la main sur son visage maintenant. Qui est-ce ?
— Où cela ? De quel homme voulez-vous parler ?
— Là-bas ! Il regarde de notre côté maintenant, il a un programme à la main. Ne le voyez-vous pas ? C’est cet homme au menton proéminent et au front convexe ; il a une tête de ouistiti et des yeux de chacal.
L’autre se pencha au-dessus du rebord de la loge et balaya du regard l’auditorium maintenant comble.
— Oh ! s’exclama-t-il en reconnaissant le visage que lui désignait son ami, mais c’est le citoyen Fouquier-Tinville !
— L’accusateur public ?
— En personne. Et à côté de lui, c’est Héron.
— Héron ?
— Oui, le chef du Comité de sûreté générale.
— Qu’est-ce que cela signifie ?
Les deux hommes reprirent appui sur le dossier de leur chaise, disparaissant ainsi de nouveau dans l’ombre protectrice
de l’étroite loge où se fondaient leurs silhouettes vêtues de noir. À la simple mention du nom de l’accusateur public, sans se concerter, ils s’étaient mis à chuchoter.
Le plus âgé des deux, un individu solidement bâti, au visage rougeaud où la petite vérole avait laissé ses empreintes, aux petits yeux étroits et vifs, haussa les épaules et répondit avec une indifférence dédaigneuse :
— Cela signifie, mon bon Saint-Just, que les deux hommes que vous voyez là-bas, tranquillement absorbés dans le programme de la soirée et visiblement disposés à goûter l’esprit de ce cher Molière, sont tous deux des chiens de l’enfer, aussi puissants que rusés.
— Oui, oui, dit Saint-Just, et un frisson involontaire parcourut son corps svelte, je sais qui est Fouquier-Tinville, c’est l’autre que je ne connais pas.
— L’autre ? reprit Batz d’un ton léger, mais je viens de vous le dire, l’autre, c’est Héron... et devant Héron, mon ami, même le pouvoir et l’animalité de ce damné accusateur public pâlissent.
— Comment cela ? Je ne comprends pas.
— Vous êtes resté trop longtemps en Angleterre, veinard, et les échos de l’horrible tragédie que nous vivons ici ne sont pas arrivés jusqu’à vous. Vous semblez ignorer tout des acteurs qui tiennent les rôles principaux dans cette arène baignée de sang et tapissée de haine. Ils changent ces acteurs, mon cher Saint-Just, ils changent. Marat... c’est du passé. Robespierre... c’est l’homme qui monte. Aujourd’hui, il faut encore compter avec Danton et Fouquier-Tinville. Le Père Duchesne est encore là ainsi que votre propre cousin, je crois, Antoine Saint-Just. Malheureusement, Héron et ses semblables, ceux-là sont tout le temps là, ils ne disparaissent pas de l’arène.
— Espions, bien sûr ?
— Espions, en effet, et quels espions ! Étiez-vous à la Convention aujourd’hui ? J’y étais. J’ai entendu proclamer ce nouveau décret qui a maintenant force de loi. On ne peut pas dire que l’herbe ait le temps de repousser sous nos pieds en ce moment. Robespierre se réveille un matin avec un nouveau caprice en tête, et dans l’après-midi, ce caprice devient une loi, une loi votée par une assemblée d’hommes serviles et terrifiés qui n’osent pas aller contre sa volonté de peur d’être accusés de modération ou même d’humanité, les pires crimes qui puissent être commis actuellement.
— Mais... et Danton ?
— Ah, Danton ! Il aimerait bien maintenant pouvoir contrôler les flots qu’il a laissé lui-même échapper, museler les crocs des bêtes féroces qu’il a lui-même excitées. Comme je vous le dis, Danton est encore dans l’actualité, mais demain, certainement, on l’accusera de modération ! Danton, un modéré ! Il y aurait de quoi rire si ce n’était pas aussi pathétique ! Danton qui trouvait que la guillotine était trop lente et qui fit distribuer des épées à trente soldats pour faire tomber trente têtes en même temps ! Ce même Danton, mon ami, périra demain, soyez-en sûr. Le lion qu’il est encore sera accusé de traîtrise contre la Révolution, de modération à l’égard de ses ennemis, et tous ces bâtards, ces chiens enragés, Héron en tête, se jetteront sur son cadavre.
Il s’interrompit un moment. Il n’osait pas parler plus fort et ses chuchotements devenaient inaudibles dans le brouhaha en provenance de l’auditorium. Le lever de rideau était prévu à huit heures. Il était presque huit heures et demie, et le rideau n’était toujours pas levé. Le public commençait à s’impatienter. Les gens martelaient bruyamment le sol avec leurs pieds et quelques sifflets se firent entendre de la galerie.
— Si Héron s’impatiente, murmura le baron de Batz d’un ton léger en profitant d’un moment d’accalmie, le directeur du théâtre et peut-être même l’actrice et l’acteur principaux risquent de passer un bien mauvais moment demain.
— Héron, toujours... murmura Saint-Just avec un sourire dédaigneux.
— Eh oui, mon ami, Héron toujours, rétorqua l’autre, imperturbable. Sa vie a d’ailleurs obtenu un renouvellement de bail, cet après-midi.
— Avec le nouveau décret ?
— Oui. Ce fameux nouveau décret. Les agents du Comité de sûreté générale dont Héron est le chef ont reçu aujourd’hui même des pouvoirs encore plus exorbitants, notamment celui de perquisitionner à volonté les domiciles des « ennemis du bien public », notion bien vague, vous en conviendrez... Il est tellement facile d’être un ennemi du bien public, il suffit de dépenser un peu trop ou, au contraire, pas assez ; de rire aujourd’hui ou de pleurer demain ; de pleurer la perte d’un parent ou de se réjouir de la mort d’un autre. On peut être un ennemi parce qu’on s’est lavé ou au contraire, en portant des vêtements sales, un mauvais exemple dans les deux cas. L’offense peut consister à marcher un jour et à rouler en carriole le suivant. Les agents du Comité de sûreté générale pourront décider suivant leur bon plaisir qui est un ennemi du bien public, les prisons sont ouvertes pour tous ceux
qu’ils dénonceront. Ils ont le droit d’interroger les prisonniers sans témoin et de les faire juger sans motif. Leur objectif est clair : « rabattre du gibier pour la guillotine » selon les termes du décret. Ils doivent donner du travail à l’accusateur public et, aux tribunaux, des victimes à condamner ; la place de la Révolution doit continuer à offrir aux badauds le spectacle quotidien de têtes qui tombent. Les agents du Comité seront dûment récompensés : trente-cinq livres par tête coupée sous la guillotine. Si Héron et ses comparses travaillent bien, ils vont pouvoir se faire un bon petit revenu, quatre à cinq mille livres par semaine. On progresse, Saint-Just, on progresse.
Pendant qu’il tenait ce petit discours, Batz n’avait pas une seconde élevé la voix. Son ton n’exprimait aucune horreur, plutôt même un léger amusement, tandis qu’il décrivait ces monstruosités, ces conspirations contre la liberté, la dignité, la vie même d’une nation en péril. Les horreurs qu’il décrivait ne semblaient curieusement pas susciter chez lui d’indignation, mais faisaient vibrer comme une corde triomphale. Il se mit à rire doucement, comme un parent indulgent observant les caprices cruels d’un enfant gâté.
— C’est pour cela, s’exclama Saint-Just avec chaleur, que nous devons sauver ceux qui refusent de se laisser emporter par le fleuve de l’enfer qui coule sur la terre !
Les yeux brillants d’enthousiasme, les joues enflammées, il avait l’air jeune et plein d’ardeur. Armand Saint-Just, le frère de Lady Blakeney, avait quelque chose de la beauté raffinée de sa sœur, mais ses traits, bien que virils, manquaient cependant de la fermeté qui caractérisaient ceux du délicieux visage de Marguerite. Il avait le front d’un rêveur plus que celui d’un intellectuel, et ses yeux bleu-gris étaient ceux d’un idéaliste plus que ceux d’un homme d’action.
Ces caractéristiques n’avaient pas échappé au regard perçant de Batz, bien que ce dernier ne se fût point départi, en regardant son jeune compagnon, de l’expression indulgente et aimable qui paraissait habituelle chez lui.
— Nous devons penser à l’avenir, mon bon Saint-Just, reprit Batz après une légère pause, parlant lentement, d’une voix décidée – comme un père reprenant son enfant indiscipliné –, ce n’est pas le présent qui compte. Que sont quelques vies à côté des grands principes qui sont en jeu ?
— Oui, je sais, la restauration de la monarchie, coupa SaintJust, toujours excité, mais en attendant...
— En attendant, reprit Batz sérieusement, chaque victime de la bestialité de ces hommes est un pas vers la restauration de la loi et de l’ordre, c’est-à-dire de la monarchie. Ce sont tous ces excès perpétrés au nom de la Nation qui amèneront celle-ci à se rendre compte qu’elle a été trompée par un groupe d’hommes intéressés seulement par eux-mêmes, par leur propre pouvoir et par leur avancement personnel, par des tyrans qui imaginent que le seul moyen d’arriver à ce pouvoir est de massacrer et de piétiner les corps de ceux qui se mettent en travers de leur chemin. Lorsque la Nation n’en pourra plus de ces orgies d’ambition et de haine, elle se tournera contre ces brutes infâmes et acclamera le retour de tout ce qu’elle s’acharne actuellement à détruire. C’est le seul espoir que nous pouvons avoir pour l’avenir. Croyez-moi, mon ami, chaque tête sauvée de la guillotine par votre héros romantique, le Mouron Rouge, vient consolider cette infâme République révolutionnaire.
— Je n’en crois rien, protesta Saint-Just avec énergie.
Batz haussa les épaules, en faisant un geste d’insouciance dédaigneuse qui reflétait son autosatisfaction et sa conviction qu’il avait raison. De ses doigts courts et épais, ornés de bagues, il se mit à tambouriner sur la rambarde de la loge. Il était sur le point de répartir à son jeune ami, dont l’attitude semblait l’irriter plus encore qu’elle ne l’amusait, mais se contint. Les trois coups traditionnels retentirent, annonçant enfin le lever de rideau. Comme par magie, le brouhaha de la salle, énervée d’attendre, cessa. Chacun s’assit confortablement dans son siège et l’attention se porta sur la scène.
Armand Saint-Just n’était pas revenu à Paris depuis ce jour mémorable où il avait décidé de rompre tout lien avec le Parti républicain dont sa sœur Marguerite et lui avaient été, au début, parmi les plus nobles et ardents militants. Cela faisait déjà plus d’un an et demi qu’il était parti, horrifié par les exactions dont les républicains se rendaient coupables. Ces exactions, loin de s’arrêter, avaient dégénéré en orgies écœurantes, culminant maintenant en massacres et en hécatombes sanglantes de victimes innocentes.
La mort de Mirabeau avait signifié la fin de l’influence des républicains modérés qui pensaient alors de bonne foi lutter contre la tyrannie et agir pour le bien commun en luttant contre les Bourbons. Ceux qui prétendaient défendre maintenant la cause républicaine n’étaient que des démagogues dépravés et aigris, mus par la haine qu’ils ressentaient contre tous ceux qui ne partageaient pas leur férocité et leur monstrueux égoïsme.
Comme était loin de leur pensée la lutte pour la liberté politique ou religieuse ! Il ne s’agissait que d’un combat impitoyable où le plus fort écraserait le plus faible. Étaient ainsi condamnés celui qui possédait quelque bien, le citoyen respectueux des lois, ou l’homme d’action qui s’était efforcé de lutter sincèrement pour une liberté qui, mal utilisée, se retournait contre lui.
Armand Saint-Just avait été un des apôtres de la Liberté, de l’Égalité et de la Fraternité, jusqu’au jour où il s’était rendu compte que les plus terribles excès de la tyrannie étaient perpétrés au nom de ces nobles idéaux.
Sa sœur Marguerite venait de se marier avec l’élu de son cœur et de s’installer en Angleterre, il n’avait plus de raisons de rester dans son propre pays dont les destinées lui échappaient complètement. Armand pensait avec tristesse aux efforts faits, auxquels il avait cru, dans le sillage de Mirabeau, pour allumer de nobles étincelles dans le cœur de ceux qu’il estimait privés de liberté. Ces étincelles étaient devenues des incendies de haine
que plus personne ne pouvait maîtriser. La prise de la Bastille avait été le prélude des atroces massacres de Septembre qui semblaient eux-mêmes, maintenant, peu de chose à côté des holocaustes actuels.
Grâce au Mouron Rouge, Armand avait pu échapper à la vengeance des révolutionnaires. Réfugié en Angleterre, il s’était aussitôt enrôlé sous la bannière du célèbre héros. Il n’avait cependant, jusqu’à présent, pas eu l’occasion de se distinguer au service de la ligue du Mouron Rouge. Son chef était réticent à lui faire courir de trop grands risques, car les Saint-Just, Marguerite comme Armand, étaient encore très connus à Paris. Marguerite n’était pas de celles qu’on oublie facilement, et son mariage avec un « aristo » anglais avait fortement mécontenté ces cercles républicains parisiens qui l’avaient considérée comme leur reine. La rupture d’Armand avec les républicains en avait, par ailleurs, fait une proie toute désignée pour des représailles spéciales dès qu’il serait possible de lui mettre la main dessus. Le frère et la sœur comptaient parmi leurs ennemis les plus acharnés leur cousin éloigné, Antoine Saint-Just. Ce dernier avait autrefois prétendu à la main de Marguerite, et il était maintenant un des admirateurs et des partisans les plus serviles de Robespierre dont il s’efforçait d’imiter la cruauté pour se faire bien voir de l’homme le plus puissant du moment.
Il n’était un secret pour personne dans les cercles du pouvoir que le rêve d’Antoine Saint-Just était de démontrer son zèle et son patriotisme en dénonçant ses propres cousins devant le Tribunal de la Terreur. Le Mouron Rouge, très au fait des intrigues du gouvernement révolutionnaire, n’avait pas l’intention de sacrifier la vie d’Armand ou même de le laisser s’exposer à des dangers inutiles.
Cela faisait donc plus d’une année qu’Armand Saint-Just, membre enthousiaste de la ligue du Mouron Rouge, piaffait d’impatience sous la main ferme d’un chef prudent, alors qu’il brûlait d’impatience d’aller, lui aussi, risquer sa vie aux côtés de ce chef qu’il vénérait et de ses chers camarades.
Enfin, au début de 1794, il réussit à convaincre Blakeney de le laisser prendre part à sa prochaine expédition en France. Si les membres de la ligue ignoraient l’objectif principal de cette expédition, ils n’ignoraient pas, en revanche, que les périls encourus seraient plus graves que tous ceux qu’ils avaient pu affronter jusqu’alors.
Les circonstances avaient changé. Le mystère qui entourait tout d’abord la personnalité du Mouron Rouge et, qui était une mesure essentielle de sécurité, commençait à se dissiper. Un
petit coin du voile avait été soulevé au moins à deux reprises : Chauvelin, ex-ambassadeur à la Cour d’Angleterre, n’avait plus aucun doute quant à l’identité du Mouron Rouge ; quant à Collot d’Herbois, il l’avait clairement vu à Boulogne lorsque le célèbre aventurier anglais l’avait mis en échec1 .
Quatre mois s’étaient écoulés depuis l’aventure de Boulogne. Les massacres à Paris et en province se poursuivaient et s’amplifiaient même, avec une rapidité effrayante. Le Mouron Rouge passait maintenant le plus clair de son temps en France, à la tête de la petite bande de jeunes gens courageux et altruistes dont l’aide devenait chaque jour plus nécessaire, plus pressante. Ils suivaient leur chef avec un enthousiasme et une ardeur toujours renouvelés. L’instinct sportif et le goût du défi, indissociables de la nature même du gentilhomme anglais, leur rendaient l’aventure encore plus passionnante maintenant que les risques encourus, toujours élevés, étaient décuplés.
Un mot de leur chef, et ces jeunes gens qui constituaient la fine fleur de la société anglaise quittaient les plaisirs, le luxe et la gaieté des salons à la mode de Londres ou de Bath, pour aller risquer leur vie et leur fortune, parfois l’honneur de leur nom, au service des innocents et des victimes impuissantes de l’impitoyable tyrannie révolutionnaire. À l’appel du Mouron Rouge, ceux qui étaient mariés – Ffoulkes, Lord Hastings, Sir Jeremiah Wallescourt – laissaient aussitôt femme et enfants pour se porter au secours de ces malheureux. Armand, célibataire et enthousiaste, estimait alors avoir le droit d’exiger de ne plus être laissé en dehors des expéditions.
Cela ne faisait donc pas un an et demi qu’il avait quitté Paris, mais comme la ville était différente de celle qu’il avait laissée derrière lui, aussitôt après les massacres de Septembre ! Une atmosphère de triste solitude pesait sur elle, en dépit de la foule. Les hommes dont il avait recherché la compagnie, quinze mois auparavant, amis ou politiciens, avaient disparu. Tous les visages qu’il croisait lui paraissaient étrangers, et les expressions, moroses ou triomphantes, portaient l’empreinte d’une sorte d’étonnement horrifié, comme si la vie était devenue un puzzle à résoudre rapidement, la faux de la mort pouvant tomber à tout instant.
Armand Saint-Just avait déposé ses quelques effets dans le logement, assez sordide, qui lui avait été assigné. À la nuit tombée, il sortit et se mit à déambuler sans but précis dans les rues sombres. Instinctivement, il guettait quelque visage familier, quelqu’un qui viendrait à lui, surgi de ce passé joyeux
1 Cf. tome 3, L’insaisissable Mouron Rouge.
et pas si lointain, lorsque Marguerite et lui partageaient un joli appartement rue Saint-Honoré. Parfois, il lui semblait reconnaître une personne de son ancien cercle dans un visage entrevu ou une silhouette furtivement croisée, mais avant qu’il pût réagir, le visage ou la silhouette avait déjà disparu dans une ruelle sombre, sans regarder ni se retourner, comme si craignant d’être vraiment reconnu. Armand se sentait de plus en plus étranger dans sa ville natale.
Heureusement, à cette heure tardive, les exécutions quotidiennes place de la Révolution étaient interrompues. On n’entendait ni le roulement des charrettes transportant les condamnés, cahotant sur les mauvais pavés, ni les cris des suppliciés résonnant à travers les rues désertes. Au moins, le jour de son arrivée, ce terrible spectacle épargnait Armand. Il était épargné par cette ultime dégradation de la ville qu’il aimait, mais pas par son aspect désolé, par l’atmosphère générale d’indigence honteuse et de dédain cruel qui glaçait le cœur du jeune homme.
Il n’est donc pas étonnant, alors qu’il reprenait lentement le chemin de son logis provisoire, que le son inattendu d’une voix aimable et chaleureuse lui fît répondre avec empressement. Cette voix au timbre fluide, bien huilée, comme si son propriétaire la tenait prête au service de tout aimable discours qu’il lui prendrait l’envie de tenir, était un écho du passé. Le baron de Batz était un ex-officier de la garde royale devenu conspirateur invétéré pour le rétablissement de la monarchie. Il avait souvent amusé Marguerite lorsqu’il lui développait ses plans, tous plus incohérents et impossibles les uns que les autres, pour renverser le cours des évènements.
Armand était tout content de le rencontrer, aussi lorsque Batz suggéra de saisir l’occasion pour parler du bon vieux temps, il accepta aussitôt avec joie. Les deux hommes, bien que ne manifestant pas de méfiance l’un pour l’autre, ne tenaient visiblement pas à révéler où ils logeaient. Batz proposa une des loges d’avant-scène dans un des théâtres, comme l’un des endroits les plus sûrs pour discuter sans craindre les oreilles ou les yeux ennemis.
— Il n’y a plus de lieu sûr ou privé, de nos jours, dit-il. J’ai essayé tous les coins et les recoins de cette maudite ville qui maintenant grouille d’espions, et j’en suis arrivé à la conclusion qu’une petite loge d’avant-scène est l’endroit le plus discret qui se puisse trouver. Les voix des acteurs sur la scène et le brouhaha de l’audience dans la salle noient avec efficacité toute conversation privée, sauf pour celui à qui elle est destinée.
Il ne fallut pas longtemps pour persuader Armand : quel jeune homme pourrait résister à la perspective soudaine de passer une bonne soirée avec un aimable compagnon comme Batz, au moment où il se sentait seul et misérable dans une grande ville ? Les divagations de Batz avaient toujours été amusantes, mais en l’occurrence, il sembla à Armand qu’il avait en tête des objectifs plus sérieux. Son chef l’avait bien mis en garde contre la tentation de renouer avec des connaissances parisiennes, mais le jeune homme se dit que ces restrictions ne s’appliquaient certainement pas au baron de Batz, un ardent royaliste dont les plans, farfelus certes, mais ayant tous pour objectif la restauration de la monarchie, le plaçaient dans la même catégorie que la ligue du Mouron Rouge.
Armand accepta donc l’invitation cordiale qui lui était adressée. Il se dit aussi qu’une loge dans un théâtre bondé serait un endroit plus discret que la rue pour discuter. Qui prêterait attention à la silhouette sombre d’un jeune homme ayant l’apparence d’un étudiant ou d’un journaliste, au milieu de toute une foule venue se distraire ?
Cependant, dix minutes ne s’étaient pas écoulées depuis que les deux hommes avaient pris place dans la loge, qu’Armand se sentit mal à l’aise et regretta le mouvement impulsif qui l’avait fait accepter de se rendre au théâtre et de renouer connaissance avec l’ex-officier de la garde royale. Bien qu’il connût les convictions royalistes de son compagnon, il ne pouvait s’empêcher de ressentir un sentiment grandissant de défiance à l’égard de cet individu prétentieux, imbu de lui-même, dont tous les propos exprimaient des objectifs parfaitement égoïstes plutôt qu’une dévotion à une cause désespérée.
Aussi, quand le rideau se leva enfin sur le premier acte de la spirituelle pièce de Molière, Saint-Just tourna son regard vers la scène et s’efforça de concentrer son attention sur la querelle de Philinte et Alceste.
Cette attitude ne convenait visiblement pas à son compagnon. Il était clair que les sujets de conversation n’étaient pas épuisés pour Batz, et que s’il avait attiré Saint-Just au théâtre ce soir, ce n’était pas pour lui permettre d’admirer Mlle Lange débutant dans le rôle de Célimène.
De fait, la découverte de la présence de Saint-Just à Paris intriguait énormément Batz et avait aussitôt fait naître de multiples conjectures dans son cerveau fébrile. C’était pour transformer ces conjectures en certitudes qu’il avait décidé d’amener le jeune homme à une conversation privée.
Il attendit sans rien dire pendant un petit moment, ses petits yeux vifs fixés sur le visage légèrement détourné d’Armand, tandis que ses doigts battaient impatiemment la mesure sur le velours de la balustrade. À un moment, Saint-Just tourna légèrement la tête dans sa direction. Aussitôt Batz sauta sur l’occasion pour reprendre la discussion. Il désigna d’un signe de tête un groupe d’hommes dans l’auditorium :
— Votre cher cousin Antoine Saint-Just est désormais un intime de Robespierre, dit-il. Quand vous avez quitté Paris, il y a un peu plus d’un an, vous pouviez vous permettre de l’ignorer comme quelqu’un sans importance, mais maintenant, si vous voulez rester en France, vous devez compter avec lui, il représente pouvoir et menace.
— Oui, j’ai appris qu’il avait choisi de hurler avec les loups, répondit Armand d’un ton indifférent. Quand je pense qu’à une certaine époque, il était amoureux de ma sœur, je remercie Dieu qu’elle n’ait jamais été attirée par lui.
— J’ai entendu dire que c’est cette déception qui l’avait conduit à rejoindre la meute de loups, reprit Batz. De fait, toute cette meute est composée de déçus ou de frustrés et d’hommes qui n’ont plus rien à perdre. Quand ils se seront tous entredévorés, c’est alors et seulement alors que l’on pourra espérer voir le retour de la monarchie en France. Ils ne se jetteront pas les uns sur les autres, cependant, tant qu’ils auront encore des proies pour assouvir leur férocité. Votre ami, le Mouron Rouge, devrait nourrir cette Révolution sanguinaire plutôt que de l’affamer, s’il a autant de haine pour cette Révolution qu’on le dit.
Ses yeux furtifs restaient fixés sur le visage du jeune homme. Il attendit, puis, comme aucune réponse ne venait, il répéta :
— S’il a autant de haine pour cette Révolution sanguinaire qu’on le dit.
Il insinuait un doute en répétant cette phrase. Aussitôt, piqué au vif dans sa loyauté à l’égard de son chef, Saint-Just reprit :
— Le Mouron Rouge ne poursuit aucun objectif politique. L’œuvre de miséricorde qu’il a entreprise, c’est pour des raisons de justice et d’humanité.
— Et pour le sport, à ce que j’entends, ricana le baron.
— C’est un Anglais ! riposta Saint-Just. Mais, quel que soit le motif de ses actions, regardez les résultats : des vies sauvées de la guillotine, des femmes, des enfants qui auraient péri sans son dévouement !
— Mais plus ces victimes sont innocentes, plus elles sont faibles, impuissantes et pitoyables, plus leur sang versé aurait crié vengeance contre ce gouvernement de sauvages, responsable de leur mort.
Saint-Just ne répondit rien. Il sentait bien qu’il était inutile de discuter plus avant avec cet homme dont les objectifs étaient purement politiques sinon personnels, et aussi éloignés de ceux du Mouron Rouge que le pôle Nord l’est du pôle Sud.
— Si vous avez quelque influence sur votre chef au sang chaud, reprit Batz sans se laisser émouvoir par le silence de son compagnon, je vous exhorte à l’exercer maintenant.
— Comment cela ? demanda Saint-Just, souriant malgré lui à la pensée qu’il pût, ou qui que ce soit d’autre d’ailleurs, influer d’une manière quelconque sur Blakeney et ses plans.
Batz, à son tour, resta silencieux. Il attendit un peu avant de reprendre :
— Votre Mouron Rouge est à Paris en ce moment, n’est-ce pas ?
— Je ne peux pas vous le dire, répondit Armand.
— Bah ! Ce n’est pas la peine de feindre avec moi, mon ami. Dès que je vous ai aperçu cet après-midi, j’ai su que vous n’étiez pas venu seul à Paris.
— Vous vous trompez, cher baron, répliqua le jeune homme sérieusement, je suis venu seul à Paris.
— Bien tenté, ma foi, mais peine perdue. Comme si je n’avais pas remarqué tout de suite que vous n’aviez pas l’air trop heureux de me voir lorsque je vous ai accosté !
— Eh bien, vous vous trompez encore. J’étais très content de vous voir, car la solitude m’avait pesé toute la journée et j’étais content de pouvoir serrer la main d’un ami. Ce que vous avez pris pour du mécontentement était simplement de la surprise.
— La surprise ? Ha, je veux bien croire que vous ayez été surpris de me voir marcher dans les rues de Paris au vu et au su de tous, sans être importuné, alors que vous avez dû entendre dire que j’étais un dangereux conspirateur, hein ? Un homme qui aurait toute la police du pays à ses trousses ? Un homme dont la tête était certainement mise à prix ? Hein ?
— Je savais que vous aviez noblement tenté de sauver le Roi puis la Reine des mains de ces brutes.
— Tous ces efforts étaient inutiles, acquiesça Batz. À chaque fois j’ai été soit trahi par un de ces damnés confédérés, soit découvert par un espion plus malin que les autres et motivé par une récompense. Oui, mon ami, j’ai plusieurs fois essayé de sauver le Roi Louis XVI et la Reine Marie-Antoinette de l’échafaud, et chaque fois, j’ai échoué. Et pourtant, me voici, libre et indemne. Je me promène au grand jour, je parle aux amis que je rencontre...
— Vous avez beaucoup de chance, dit Saint-Just, non sans une pointe de sarcasme.
— J’ai toujours été prudent, rétorqua le baron, j’ai pris la peine de me faire des amis là où je pensais que cela pouvait m’être le plus utile – avec « l’argent trompeur2 » –, vous comprenez ?
Et il éclata d’un rire suffisant.
— Oui, je comprends, répondit Saint-Just, la nuance de sarcasme s’accentuant dans sa voix, vous avez de l’argent autrichien à votre disposition.
— Tout ce que je veux, répliqua Batz avec complaisance, et une bonne partie de cet argent colle aux doigts sales et avides de ces patriotiques révolutionnaires. J’assure donc ma propre sécurité avec l’argent de l’empereur, ce qui me permet de travailler à la restauration de la monarchie en France.
Saint-Just, de nouveau, se tut. Que voulait-il dire ? Alors que le Gascon semblait remplir la loge de ses rodomontades et la faire déborder de plans aussi ambitieux qu’irréalistes, les pensées d’Armand volaient vers un autre conspirateur, un homme aux objectifs purs et simples, dont la main racée n’avait jamais touché l’or étranger, mais était toujours prête à aider le faible et le malheureux, pensant au secours qu’il allait apporter, mais jamais à sa propre sécurité.
Batz semblait parfaitement inconscient des pensées méprisantes qui traversaient l’esprit de son jeune ami à ce moment, car il continuait à discourir avec affabilité, bien que, peut-être, une note inquiète pût être distinguée dans sa voix suave :
— Nous avançons doucement, pas à pas, mon bon Saint-Just, dit-il. Certes, je n’ai réussi à sauver ni le Roi ni la Reine, mais il reste le Dauphin3 .
2 NDT : 2. Référence à l’Évangile de saint Luc (16, 9-15).
3 3. À la mort du Roi Louis XVI, le 21 janvier 1793, son fils Louis-Charles, Dauphin de France (depuis la mort de son frère aîné en 1789) devient Roi. Il n’a pas encore huit ans. Emprisonné avec sa famille dans la tour du Temple, il est arraché à sa mère en juillet 1793 et confié à la garde du cordonnier Simon. Enfermé dans des conditions atroces, seul dans une pièce sans
— Le Dauphin... murmura Saint-Just malgré lui.
Bien qu’à peine murmurée, cette parole sembla satisfaire Batz. Son regard sembla soudain moins tendu et ses doigts cessèrent de tambouriner le rebord de la balustrade.
— Oui, le Dauphin, reprit-il en hochant la tête comme suivant ses propres pensées, ou plutôt, le Roi Louis XVII par la grâce de Dieu, la vie la plus précieuse en ce moment sur terre.
— Vous avez raison en cela, mon ami, la vie la plus précieuse et qui doit être sauvée à tout prix, approuva Armand avec ferveur.
— Oui, dit Batz calmement, mais pas par votre ami le Mouron Rouge.
— Et pourquoi pas ?
À peine avait-il prononcé ces trois mots que Saint-Just se mordit la lèvre. Fronçant les sourcils, il regarda son compagnon d’un air de défi.
Batz sourit d’un air bonhomme.
— Ah ! ami Armand, vous n’êtes vraiment pas taillé pour la diplomatie ou pour l’intrigue ! Donc, ajouta-t-il avec sérieux, ce courageux héros, le Mouron Rouge, espère sauver notre jeune Roi des griffes du cordonnier Simon et de la horde de hyènes qui guettent le petit cadavre, c’est bien cela ?
— Je n’ai jamais dit cela, rétorqua Saint-Just d’un air maussade.
— Non, mais moi, je le dis ! Non, non, ne vous faites pas de reproche, mon jeune ami, vous êtes trop loyal. Comment auraisje pu douter, comment n’importe qui aurait pu douter un seul moment que, tôt ou tard, votre romantique héros s’intéresserait au drame le plus pathétique de toute l’Europe, à l’enfant martyr de la prison du Temple ? Je me demandais simplement si le Mouron Rouge ignorait notre petit Roi dans l’intérêt de ses sujets. Non, non, n’allez surtout pas penser que vous avez trahi pour moi le secret de votre ami. Lorsque j’ai eu la bonne surprise de tomber sur vous aujourd’hui, j’ai tout de suite deviné que vous étiez venu ici sous la bannière de cette énigmatique petite fleur rouge et, à partir de là, j’en ai déduit un peu plus. Donc le Mouron Rouge est en ce moment à Paris dans l’espoir de sauver Louis XVII de la prison du Temple.
fenêtre, sale et insalubre, l’enfant serait mort en prison en juin 1795. Cette mort n’a jamais pu être confirmée et le mystère Louis XVII n’est toujours pas résolu.
— Si c’est le cas, vous devez non seulement vous réjouir, mais aussi être en mesure de prêter assistance.
— Cependant, cher ami, je ne me réjouis pas plus que je n’ai l’intention d’aider, répondit le baron placidement. C’est que je suis un français, voyez-vous.
— Je ne vois pas le rapport.
— C’est pourtant évident, bien que vous-même, Armand, bien qu’étant français, ne voyez pas les choses de la même manière. Louis XVII est le Roi de France, mon bon Saint-Just, il faudra qu’il doive sa liberté et sa vie à des Français et à personne d’autre.
— C’est de la folie pure ! répliqua Armand, vous laisseriez périr cet enfant pour satisfaire vos propres idées égoïstes ?
— Qualifiez mes idées d’égoïstes tant que vous voudrez, tout patriotisme est, d’une certaine manière, égoïste. Qu’estce que cela peut faire au reste du monde si nous sommes une république ou une monarchie, une oligarchie ou une anarchie ? Nous travaillons pour nous, pour notre propre satisfaction, et je n’admettrai jamais, en ce qui me concerne, une quelconque interférence de l’étranger.
— Vous utilisez bien de l’argent étranger pour arriver à vos fins !
— C’est différent. Je ne peux pas trouver d’argent en France, donc je le prends là où je peux. En revanche, je veux organiser, moi, l’évasion de Louis XVII de la prison du Temple, et c’est à moi, à nous, royalistes de France, que reviendront l’honneur et la gloire d’avoir sauvé notre Roi.
Pour la troisième fois, Saint-Just laissa tomber la conversation. Il regardait droit devant lui, les yeux grands ouverts, mais sa pensée restait concentrée sur cet étalage insolent d’égoïsme et de vanité féroces. Batz, souriant et content de lui, s’était renversé en arrière sur sa chaise. Tout dans l’expression de ce visage marqué de petite vérole et dans l’attitude nonchalante de ce corps bien nourri exprimait la plus grande satisfaction. En le voyant, on pouvait facilement comprendre pourquoi cet homme jouissait d’une immunité étonnante, étant donné son passé de conspirateur raté. Hâbleur et vantard, il ne s’était jamais soucié que d’une seule chose : lui-même. Contrairement à de nombreux autres royalistes français qui avaient payé de leur vie leur engagement, il s’était toujours débrouillé pour éviter les combats à la campagne ou les dangers en ville. Il préférait jouer un jeu moins risqué. En
traversant la frontière, en se désignant agent autrichien, il avait réussi à obtenir de l’argent de l’empereur pour la cause royaliste et surtout, sans le dire, pour son bénéfice personnel.
Même un homme du monde moins avisé qu’Armand SaintJust aurait compris que la volonté manifestée par Batz d’être le seul artisan de la libération du pauvre petit Roi n’était pas dictée par le patriotisme, mais uniquement par l’avidité. Il avait certainement négocié une riche récompense pour le jour où il réussirait à amener le petit Roi sans trône, sain et sauf, à son oncle, l’empereur d’Autriche. La récompense lui échapperait si un trublion d’Anglais interférait dans cette affaire. Que, pour arriver à ses fins, il mît en péril la vie de l’enfant-Roi, peu lui importait. Ce n’était pas la vie la plus précieuse d’Europe – celle de l’enfant prisonnier du Temple – qui comptait pour le baron de Batz, mais bien sa propre prospérité et son propre bien-être.
La chance du diable
À ce moment, Saint-Just aurait donné beaucoup pour être de retour dans le logement misérable et solitaire où il s’était installé. Il se rendait compte, trop tard, de la sagesse de la mise en garde qu’il avait reçue avant de partir pour Paris, d’éviter de renouer d’anciennes amitiés.
Les gens avaient changé, ils avaient changé de manière effrayante. Assurer sa propre sécurité était devenu l’obsession de chacun, un objectif si difficile à atteindre qu’il fallait se battre pour réussir à sauver sa peau, quitte à perdre dans cette lutte son humanité et sa dignité.
L’égoïsme régnait en maître, un « chacun pour soi » impitoyable. Batz, les poches gonflées d’argent étranger, utilisait ces fonds essentiellement pour assurer sa propre immunité, les dispersant de droite et de gauche pour calmer les ambitions de l’accusateur public et satisfaire les espions avides qui grouillaient en ville.
Le reste de cet argent, il s’en servait pour attiser les tensions entre les démagogues sanguinaires qui siégeaient à l’Assemblée, contribuant à transformer cette enceinte en un gigantesque repaire de fauves, de bêtes sauvages occupées à se démembrer mutuellement.
Et si des centaines d’innocentes victimes périssaient misérablement pendant ce temps, Batz avouait lui-même que le sort de ces martyrs le laissait complètement indifférent. Il fallait bien rassasier la Révolution jusqu’à ce que les projets qu’il fomentait fussent arrivés à maturité. La vie même du précieux petit otage ne valait la peine d’être sauvée qu’au prix de l’argent qui viendrait grossir les poches du baron ou du succès de ses ambitions personnelles.
En peu de temps, une nation entière avait changé. Saint-Just se sentait aussi écœuré par ce soi-disant royaliste, en réalité un monstre d’égoïsme, que par les brutes qui massacraient par plaisir. Il se dit qu’il ferait mieux de regagner son logis sur-le-champ. Avec un peu de chance, un mot du chef l’y attendrait, un mot qui lui rappellerait qu’il existait aussi des hommes qui n’étaient pas mus par la recherche de la fortune ou de l’avancement personnel, mais par de nobles idéaux, par l’altruisme et la compassion.
Le rideau venait de redescendre, marquant la fin du premier acte et, comme toujours avec les représentations d’œuvres de Molière, les trois coups annonçant l’acte suivant furent aussitôt frappés. Saint-Just se leva, prêt à prendre congé de son compagnon avec un mot d’excuse. Le rideau se levait déjà lentement sur l’acte deux, découvrant Alceste argumentant avec Célimène.
La première intervention d’Alceste fut brève. Pendant que l’acteur parlait, Armand, tournant le dos à la scène, tendit la main vers Batz en murmurant ce qu’il espérait être une excuse polie et crédible pour justifier son départ alors que la soirée ne faisait que commencer.
Mais le baron, frustré et énervé, n’en avait pas encore fini avec son compagnon. Il se disait que les arguments spécieux qu’il venait d’asséner avec une forte conviction avaient certainement laissé leur empreinte sur l’esprit du jeune homme, mais il voulait encore renforcer l’impression qu’il pensait avoir produite. Aussi, tandis qu’Armand réfléchissait à une excuse plausible pour s’en aller, Batz se raclait les méninges à la recherche d’une raison pour l’obliger à rester.
C’est alors qu’intervint la capricieuse chance du diable. Si Saint-Just s’était levé deux minutes plus tôt, si son cerveau fébrile avait trouvé une bonne excuse plus rapidement, qui sait quelle affreuse douleur, quels malheurs accablants, quelle terrible honte auraient été épargnés au jeune homme et à ceux qui lui étaient chers ? Il ne savait pas que dans ces deux minutes d’hésitation venait de se décider tout le cours de sa vie future. L’excuse était sur ses lèvres, le baron de Batz, avec réticence, s’apprêtait à lui dire au revoir, lorsque la voix de Célimène, répondant à son prétendant en colère, fit retomber la main que tendait déjà Saint-Just et l’amena à se retourner vers la scène.
C’était, en vérité, une voix exquise, une voix douce et tendre aux accents profonds. Cette voix qui fit se retourner Adam et regarder la scène forma le premier maillon d’une chaîne qui l’attacherait pour toujours à celle qui venait de parler.
La voix mélodieuse de Mlle Lange l’avait certainement charmé au point de lui faire oublier sa méfiance à l’égard de Batz et son désir de s’éclipser. Presque sans s’en rendre compte, il se rassit et s’appuya des deux coudes au rebord de velours de la balustrade, le menton appuyé sur les mains, écoutant. Les mots que Molière met dans la bouche de Célimène n’ont rien de profond, ce sont des mots légers, un peu banals. Cependant, dès que les jolies lèvres de Mlle Lange les eut prononcés, Armand fut comme envoûté et ne la quitta plus des yeux.
Normalement, les choses n’auraient pas été plus loin. Ce n’est pas la première fois qu’un jeune homme est fasciné par une jolie actrice sur une scène de théâtre. C’est une trivialité dont ne
découle pas souvent une série d’évènements tragiques. Armand, qui avait une véritable passion pour la musique, serait resté en adoration devant la voix parfaite de Mlle Lange jusqu’au tomber du rideau final sur le dernier acte, si l’astucieux baron de Batz n’avait aussitôt perçu la fascination produite par l’actrice sur le jeune enthousiaste.
Batz n’était pas homme à laisser passer une opportunité, surtout si cette opportunité servait ses propres desseins. Il ne voulait pas tout de suite perdre de vue Armand, et voici que la chance du démon le servait.
Il attendit sans rien dire la fin de l’acte II, puis, alors qu’Armand se rejetait en arrière sur sa chaise, les yeux fermés, avec un soupir de satisfaction en revivant la dernière demi-heure, Batz remarqua avec une indifférence bien feinte :
— Mlle Lange est vraiment une actrice qui promet, ne trouvez-vous pas, mon ami ?
— Elle a une voix remarquable, c’est une mélodie exquise pour l’oreille, répondit Armand, je n’avais plus conscience d’autre chose en l’écoutant.
— C’est aussi une fort jolie femme, continua Batz en souriant, je vous suggère, mon ami, d’ouvrir vos yeux autant que vos oreilles durant le prochain acte.
C’est bien ce que fit Armand. Toute la physionomie de Mlle Lange semblait en harmonie avec sa voix. Elle n’était pas très grande, mais extrêmement gracieuse avec son petit visage d’un ovale parfait et sa silhouette menue, presque celle d’une adolescente, perdue dans les atours et les drapés de l’imposant costume féminin du temps de Molière.
Il n’aurait su dire si elle était belle ou non. Peut-être pas suivant les canons de la beauté classique, car elle n’avait ni la bouche petite ni le nez droit. Mais ses yeux bruns un peu voilés, bordés de longs cils, semblaient lancer des appels tendres, irrésistibles au cœur masculin. Ses lèvres, pleines et humides s’ouvraient sur de petites dents éclatantes de blancheur. On ne pouvait donc dire qu’elle était belle, mais le terme « exquis » lui convenait parfaitement.
Le peintre David a fait d’elle une esquisse que l’on peut admirer au musée Carnavalet. Les visiteurs se demandent souvent pourquoi ce petit visage charmant, aux traits un peu irréguliers, dégage une telle impression de tristesse.
Durant les cinq actes du Misanthrope, Célimène est à peu près tout le temps sur scène. À la fin du quatrième acte, Batz dit d’un ton dégagé :
— J’ai l’honneur de connaître personnellement Mlle Lange. Si vous souhaitez que je vous présente, nous pouvons aller faire un tour dans le salon vert après la pièce.
La prudence lui souffla-t-elle alors de refuser ? Se souvint-il qu’il devait loyauté à son chef, qu’il avait promis de respecter les consignes qu’il lui avait données ? Difficile à dire. Armand SaintJust n’avait pas encore vingt-cinq ans, et la voix mélodieuse éclipsait en cet instant, dans sa tête, les murmures de prudence et l’appel du devoir.
Il remercia Batz chaleureusement et, durant la dernière demi-heure, tandis que l’amoureux misanthrope repoussait une Célimène repentante, il se sentait étrangement impatient et nerveux, assailli par un désir irrépressible d’entendre ces jolies lèvres pleines prononcer son nom, et de voir le regard de ces grands yeux bruns à demi voilés plonger dans le sien.
Au milieu des bouleversements sanglants qui marquent la Révolution française apparaît un gentilhomme anglais qui, au péril de sa vie, va s’élever contre les excès de la Terreur. Il rend l’espoir à des victimes promises à la guillotine. Le nom de ce parfait pourfendeur de l’injustice et du crime ? C’est là le plus grand mystère. C’est en effet sous le surnom de “Mouron Rouge” que ce héros, insaisissable, enflammé, galant, amoureux et invincible, passera à la postérité. Aux heures les plus sombres de la Terreur, après l’exécution du roi et de la reine, le Mouron Rouge élabore un plan audacieux pour délivrer le petit dauphin de la prison du Temple. Ce projet insensé semble réussir, au-delà de toutes les espérances, lorsque le Mouron Rouge est intercepté par la police du Régime... Voici la réédition, dans une nouvelle traduction, de cette œuvre devenue un classique de la littérature de cape et d’épée.

Emma Orczy naît en Hongrie dans une famille de musiciens. Elle connait une jeunesse bringuebalée à travers l’Europe qui la conduit à Londres où elle se marie et travaille comme traductrice et illustratrice. En 1903, elle crée avec son mari la pièce
The Scarlet Pimpernel (Le Mouron Rouge) où un chevalier anglais recueille des aristocrates fuyant la Révolution française.
Illustrations de Frédéric Garcia