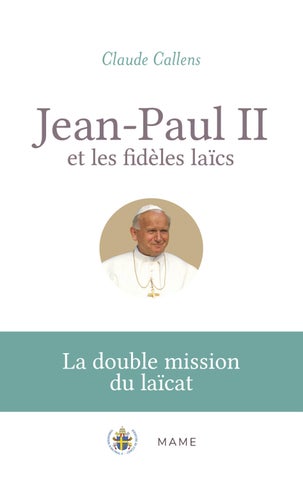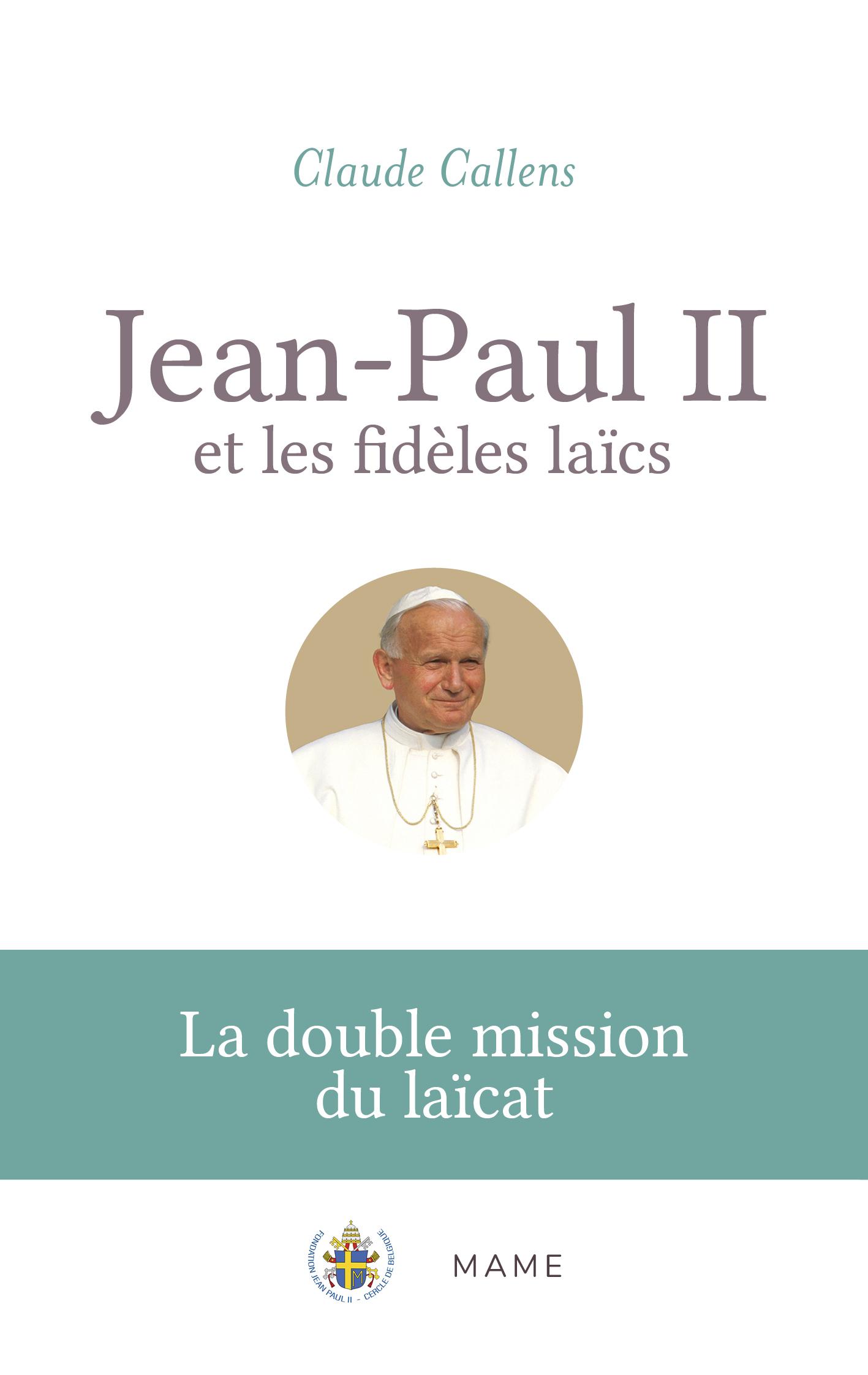 Cardinal Robert Sarah
Callens
Cardinal Robert Sarah
Callens
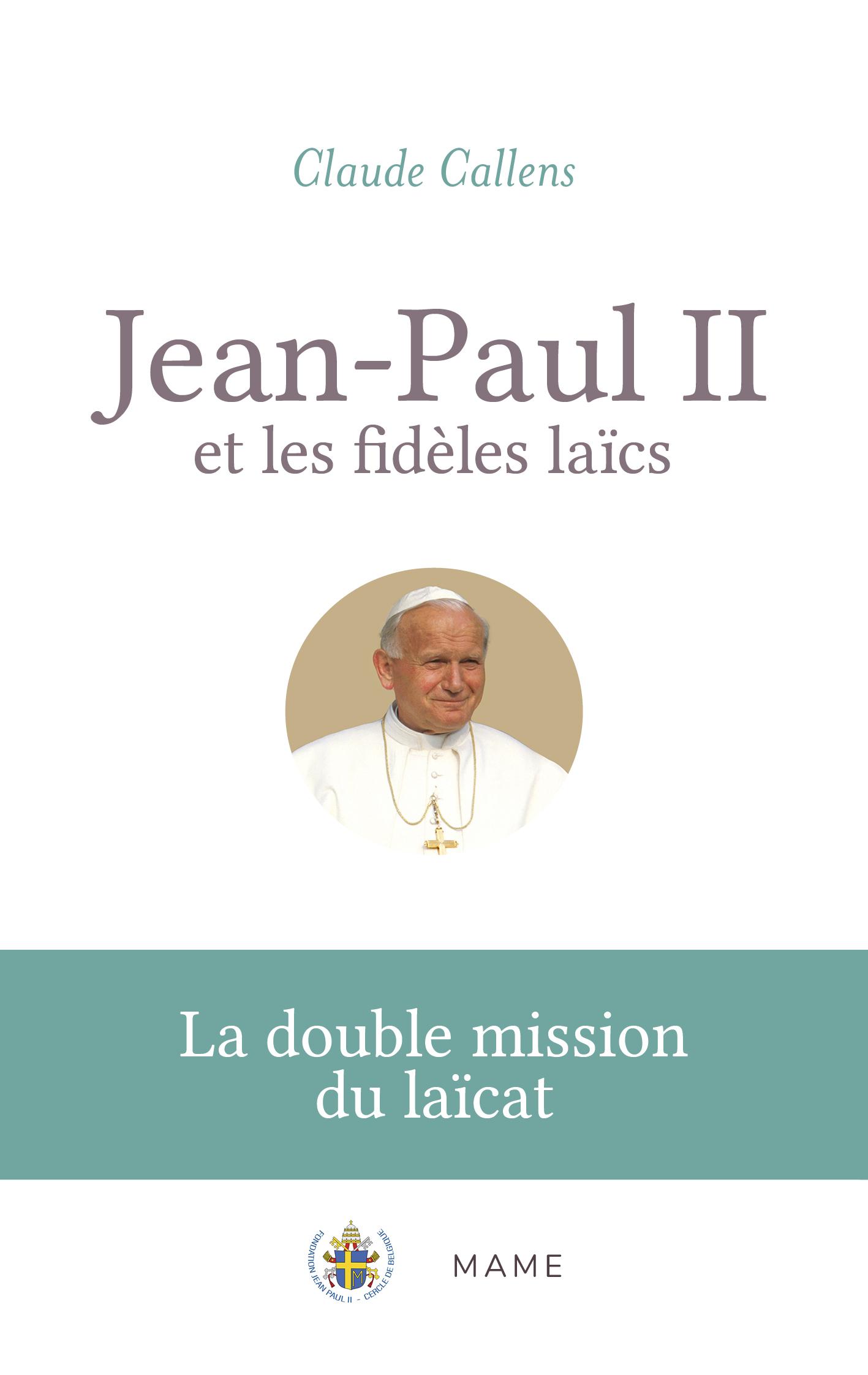 Cardinal Robert Sarah
Callens
Cardinal Robert Sarah
Callens
Jean-Paul II
Jean-Paul II
visionnaire et prophète des temps modernes
et les fidèles laïcs La double mission du laïcat
Avant-propos de George Weigel
Préface de George Weigel
Avec la Fondation Jean-Paul II Cercle de Belgique

MAME
Direction : Guillaume Arnaud
Direction éditoriale : Sophie Cluzel Édition : Vincent Morch
Direction artistique : Armelle Riva Direction de fabrication : Thierry Dubus Fabrication : Sonia Romeo Mise en pages : Pixellence © Mame, Paris, 2023 www.mameeditions.com ISBN : 978-2-7289-3390-7 MDS : MM33907
PRÉFACE
Les signes du temps Jean-Paul II et le sauvetage du projet « humanisme »
La canonisation du pape Jean-Paul II, le 27 avril 2014, fut celle d’un prêtre catholique qui a tenu captives les imaginations de générations entières pendant plus d’un quart de siècle. Par cette cérémonie, la volonté de l’Église rejoignait celle du peuple criant « Santo subito » et celle des nombreuses personnes, croyantes ou non, ayant manifesté leur attachement au pape défunt par leurs lettres adressées au « Pape Jean-Paul II/Ciel ». La personnalité du pape Jean-Paul II a en effet touché des hommes et des femmes de tous horizons et fait de sa canonisation un moment véritablement œcuménique et interreligieux. Cependant, depuis les années 1980, certains détracteurs de la pensée du pape diffusent l’idée que Jean-Paul II aurait été un pape refusant la modernité sur les plans aussi bien intellectuel que pastoral, le présentant volontiers comme celui qui aurait trahi les promesses du concile Vatican II. Parmi eux, les médias, qui parfois n’ont pas hésité à parler de saint Jean-Paul II comme d’un homme « prémoderne » rejetant le monde contemporain. Et pour-
tant, toute personne qui prendrait la peine d’étudier en profondeur la pensée de Jean-Paul II découvrirait sans aucun doute à quel point ces positions sont erronées, sur les plans tant intellectuel que culturel et historique. Ainsi, dès avant sa nomination comme pape, alors qu’il n’était encore que Karol Wojtyla, sa pensée intellectuelle était pleinement ancrée dans son temps. Comme étudiant, il avait choisi d’étudier la phénoménologie de Max Scheler pour sa deuxième thèse de doctorat, et avait participé par ses travaux au renouvellement de l’anthropologie philosophique tout au long des années 1950. Il fut ensuite l’un des évêques les plus engagés d’Europe au niveau de la réflexion philosophique et théologique qui précéda Vatican II, s’entourant de philosophes, de théologiens, d’historiens, mais aussi de scientifiques et d’artistes de tous horizons intellectuels et montrant ainsi son ouverture et son ancrage dans la pensée de son temps. Il fut aussi un grand lecteur de philosophie et de littérature contemporaine, ne se contentant pas d’étudier les « classiques » qui le précédaient. Tout cela témoigne de la modernité de Karol Wojtyla, un homme résolument de son temps dès avant le début de son pontificat, à l’opposé de l’homme de l’ancien temps décrit par certains. Mais l’examen du pontificat de Jean-Paul II confirme également qu’il était un homme étonnamment moderne. Moderne dans ses propos, en faisant de la rénovation de l’anthropologie chrétienne le programme de son ponti-
ficat, en défendant dès avant l’ONU l’universalité des droits de l’homme, en répétant inlassablement l’importance de la liberté spirituelle mais aussi en prônant un humanisme centré sur le « sujet », notamment dans sa célèbre encyclique Fides et ratio.
Moderne, aussi, dans ses nombreuses actions en faveur du dialogue interreligieux. On retiendra entre autres la visite de la Grande Synagogue de Rome et celle de la Grande Mosquée omeyyade de Damas, l’organisation à deux reprises de la prière commune à Assise, ou encore l’instauration de relations diplomatiques entre le Vatican et Israël. Sont-ce vraiment là les actions d’un pape de l’ancien temps ? On y voit plutôt les œuvres d’un homme résolument moderne.
De même, Jean-Paul II n’a pas eu peur de se confronter avec honnêteté à l’affaire Galilée et à ses effets secondaires sur le dialogue entre l’Église et la science, tout en favorisant le dialogue avec toute la communauté scientifique. Enfin, au niveau de la morale de l’Église, on peut relever sa description de l’amour sexuel au sein du lien matrimonial comme une icône de la vie intérieure de Dieu, la Sainte Trinité. Par-dessus tout ceci, Jean-Paul II était éminemment moderne dans la lecture alternative qu’il proposait de la modernité même. Ainsi, dans Fidei depositum, il affirme l’unité de la foi chrétienne en proposant l’image d’une « symphonie de la vérité », où les différents instruments jouent ensemble une musique harmonieuse. Il montre
ainsi que, pour étudier la foi chrétienne des origines à nos jours, l’Église doit utiliser la méthode historico-critique qui donne aux chrétiens l’accès aux origines de leur foi, et des clefs pour interpréter la Bible de manière juste. La façon dont Jean-Paul II a voulu mener l’Église sur ce chemin évoque l’action de l’Esprit Saint qui conduit son Église dans la vérité du Christ.
La vérité morale exprimée par la foi catholique met au défi le relativisme moral postmoderne, qui prétend à l’inexistence de « la vérité ». Se fondant sur l’expérience pastorale et sur l’intense réflexion qui sont à la base de sa pensée philosophique et morale, Jean-Paul II affirmait qu’une réflexion philosophique sur la morale humaine révèle des vérités qui font partie intégrante de l’humain et qui nourrissent l’esprit et l’âme. Ignorer ces vérités présente selon lui un risque important, pour nous-mêmes et pour le projet humain. Jean-Paul II voit dans le concile Vatican II une réponse à cette conception relativiste de la vérité, et ce parce qu’il met au centre de sa réflexion la personne humaine qui, en rencontrant le Christ, voit révélé le sens véritable de son humanité.
Le caractère sanglant du xxe siècle a démontré de façon évidente combien le grand projet humaniste des siècles précédents avait été torpillé. L’immense service que l’Église devait rendre au monde moderne était, pour l’évêque Karol Wojtyla, d’aider au sauvetage de ce projet par un humanisme centré sur le Christ. Une fois pape, il s’engagera pleinement dans cette direction.
Ainsi, Jean-Paul II rejoint l’idée exprimée par Alexandre Soljenitsyne dans son discours d’acceptation du prix Templeton en 1983 : pourquoi un siècle ayant débuté avec une solide confiance en l’avenir de l’homme est-il si rapidement devenu le siècle des plus grands massacres de l’histoire humaine ? De nombreux facteurs sont bien sûr en cause, mais, sous-jacente à ceuxci, Soljenitsyne avait discerné une vérité profonde : « Les hommes ont oublié Dieu. » Il est bon de se rappeler ici que, dans le monde slave dont sont issus Jean-Paul II et Soljenitsyne, c’est la culture et non la politique ou l’économie qui est le moteur dynamique de l’histoire. Le cœur de la « culture », c’est le « culte » : ce que nous chérissons, ce que nous estimons, ce que nous vénérons. Si l’objet de notre vénération est faux, la culture finira inévitablement par se corrompre. Lorsqu’une culture est corrompue et véhicule une fausse idée de ce qu’est l’homme, il en résulte une souffrance humaine sans précédent. Ainsi, le xxe siècle, en oubliant Dieu, a fait naître la barbarie. En oubliant Dieu, l’homme a oublié qui il était, ce qu’il était, et ce qu’il pouvait être.
Pour Jean-Paul II, la laïcisation n’est donc pas un phénomène neutre. Un monde entièrement laïcisé est un monde sans fenêtres, portes ni verrières : claustrophobe et, en définitive, suffocant. Si les références transcendantales de la culture humaine disparaissent, cela est mauvais pour la liberté humaine et la démocratie, car la démocratie se fonde finalement sur deux convictions : celle que
la personne humaine possède une dignité et une valeur inaliénables, et celle que la liberté n’est pas la simple expression de sa volonté.
L’humanisme chrétien de Jean-Paul II l’amène donc à considérer la place centrale de Dieu dans l’histoire de l’homme. Tenter de lire le cours de l’histoire sans Dieu, c’est tenter de lire l’histoire d’une façon superficielle. En effet, la recherche de Dieu pour l’homme et la réponse humaine à cette quête divine sont la réalité centrale de l’histoire. Une anthropologie véritable, un vrai humanisme parlera de « Dieu-etl’homme » et libérera donc les hommes et les femmes des confins étouffants du « silence ».
Je me suis immergé dans la vie et la pensée de Karol Wojtyla durant la préparation de mon livre Témoin de l’Espérance et de sa suite, La Fin et le Commencement. Mes longues conversations avec le pape Jean-Paul II m’ont amené à penser que c’est dans le chaudron de la Seconde Guerre mondiale que s’est forgée sa « passion pour l’homme ». C’est alors qu’il a décidé de consacrer sa vie à la défense de la dignité et de la valeur de toute vie humaine, et de le faire en devenant prêtre de l’Église catholique. Qu’il s’est engagé à bâtir ce qu’il appellera plus tard une « culture de vie » pour se dresser face à ces nombreuses manifestations du monde moderne qu’il percevait comme une « culture de mort ». Il ne pouvait imaginer, en 1945, que cet engagement serait celui de toute une vie.
Cet humanisme centré sur le Christ nous permet aussi de comprendre l’influence de Jean-Paul II sur la fin du xxe siècle et le début du xxie siècle. Durant les dernières années de son pontificat, certains commentateurs ont donné l’impression de vouloir « diviser » le pape, en opposant le « bon » pape-défenseur-des-droits-de-l’homme et le « dérangeant » pape-qui-défend-l’enseignement-del’Église-catholique. Il s’agissait là d’une grave erreur de lecture qui omettait de reconnaître la grande cohérence du pape Jean-Paul II. Omettre cette cohérence, c’est oublier que c’est elle qui a permis au pape de susciter l’éveil des consciences de l’Europe centrale et de l’Europe de l’Est qui mènera à la chute du Mur. C’est en appelant des hommes et des femmes à une conversion religieuse et morale que Jean-Paul II leur a donné des outils de résistance que le communisme n’a pu émousser. Même Mikhaïl Gorbatchev a admis le rôle de la nonviolence d’inspiration chrétienne dans le caractère pacifique de la chute de l’empire stalinien. On voit ainsi que la foi en Dieu, qui se fait visible à travers la personne de Jésus Christ, est libératrice et agit vraiment sur le monde. Les hommes et les femmes qui mettent leur confiance dans le Christ peuvent vraiment changer le cours de l’histoire.
Dans les défis qui nous sont donnés aujourd’hui, où beaucoup proclament que le bonheur humain passe par l’affirmation de soi, Karol Wojtyla nous propose encore une voie différente : celle du don de soi. Il rappelle
qu’aucun de nous n’est la cause de sa propre existence. Que c’est en nous donnant aux autres que nous découvrons qui nous sommes vraiment. Ainsi, Wojtyla va jusqu’à croire que la plus haute forme du témoignage chrétien est le martyre : un don de soi complet, radical, par lequel on donne sa vie.
Dans une Église du xxe siècle qui nous offre en héritage de nombreux martyrs, la conviction qu’avait JeanPaul II du caractère central du don de soi a eu un effet puissant.
Quelle que soit la fragmentation qui assaille toute vie humaine, chaque homme et chaque femme aspirent à vivre d’un cœur sans partage. Karol Wojtyla, le pape Jean-Paul II, était un homme résolument moderne, mais aussi un homme qui connaissait la malice humaine et la puissance tenace du mal dans l’histoire. Et pourtant, comme je le suggère dans La Fin et le Commencement, il a pu vaincre le mal grâce au pouvoir de la vérité et à un sens aigu de la façon dont les « enfants de la lumière » doivent œuvrer dans et à travers l’histoire pour orienter le cours des événements dans une direction plus humaine. Il n’était ni un naïf ni un romantique ; il savait que la souffrance et la mort sont le lot universel de l’homme ; mais il a montré par sa propre mort que la souffrance conformée au Christ devient source de noblesse et d’inspiration.
Par-dessus tout, Jean-Paul II était un disciple du Christ, qui vivait de la conviction que Jésus est la réponse
à cette question qu’est toute vie humaine. Cette conviction a formé un cœur sans partage et très grand, une vie de vertu héroïque accompagnée d’une analyse frappante de nos circonstances culturelles postmodernes. Et même si cette vie de vertu héroïque est ce que l’Église catholique a officiellement reconnu lorsqu’elle a canonisé Karol Wojtyla, la lecture distinctive que celui-ci a faite des signes de ces temps est un composant essentiel du défi que saint Jean-Paul II a posé et continue de poser à la culture et à la vie publique du xxie siècle.
GeorGe WeiGel.AVANT-PROPOS
Dans toute l’histoire de l’Église, jamais un pontificat n’a accordé une telle importance à l’action des fidèles laïcs. Toutefois, Jean-Paul II n’a pas personnellement révolutionné de fond en comble la pensée de l’Église en la matière, mais il a mis en œuvre, amplifié et approfondi l’enseignement du concile Vatican II qui lui-même avait développé considérablement et brillamment illustré quelques intuitions fondamentales du pape Pie XII. C’est donc dans la seconde moitié du xxe siècle, marquée par un concile dont rêvait déjà Pie XII et un pontife particulièrement fécond, que l’Église a officiellement reconnu avec force et sans ambiguïté non seulement le statut royal, prophétique et sacerdotal de tout baptisé, mais aussi la nécessité pressante d’une mobilisation générale de tous, sans exception, au service du Christ, de son Église et du monde. Les fidèles laïcs semblent enfin avoir retrouvé leur statut originel qui, à certaines époques et pour diverses raisons, a été occulté ou oublié.
Pour bien comprendre ce qui s’est passé à la fin du siècle dernier, il ne sera donc pas inutile d’esquisser une brève histoire de la manière dont les laïcs, au fil des siècles, ont été considérés au sein de l’Église (chapitre i). C’est en tant qu’héritier des perspectives ouvertes par ses prédécesseurs que Jean-Paul II va définir l’action des laïcs à
l’intérieur mais surtout à l’extérieur du sanctuaire et entreprendre parallèlement une réanimation spectaculaire de la doctrine sociale de l’Église (chapitres ii à iv). Les successeurs du saint pape, Benoît XVI et François, poursuivront dans la même voie, insistant davantage encore sur la coresponsabilité des laïcs dans la mission de l’Église et leur engagement nécessaire et urgent dans le monde qui est le premier lieu où ils sont appelés (chapitre v)1.
1. Cet ouvrage, pour rester dans les limites imposées à cette collection, est le condensé d’un syllabus destiné aux étudiants des Séminaire et Studium NotreDame à Namur (Belgique). Le lecteur gourmand pourra y trouver, s’il le désire, tous les textes de référence et des explications plus développées (voir sur le site www.moralesociale.net, Évangélisation et action politique, VI, 1).
UN PEU D’HISTOIRE
Si l’on tente de déterminer brièvement, au fil des siècles, l’importance et le rôle accordés aux laïcs dans l’Église, on peut grosso modo repérer trois grandes périodes.
DES ORIGINES AU XIX e SIÈCLE : OÙ SONT LES LAÏCS ?
Dans les évangiles, le Christ ne fait acception de personne, il bouscule même les hiérarchies de son temps en se préoccupant des petits et des exclus. Il n’y a pas, à l’origine, de distinction de dignité entre ce que nous appelons aujourd’hui le « clergé1 » et les « laïcs ». Il y a certes une diversité de charismes dans l’Église2, mais tous sont les « élus », les « frères », les « saints », les « croyants », les « disciples », ceux qui ont été « mis à part ». Il y a seulement un « peuple saint », un « peuple élu ». Quand Pierre s’adresse à la communauté chrétienne, il lui dit : « Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que
1. Le clergé inclut le pape, les évêques, les prêtres et les religieux. Le diacre a un statut un peu particulier : il fait partie du clergé mais conserve ses activités professionnelles, syndicales et associatives. Le diacre est donc engagé à la fois comme clerc et comme laïc.
2. 1 Co 12, 7-11.
vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Autrefois vous n’étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu ; vous n’aviez pas obtenu miséricorde, mais maintenant vous avez obtenu miséricorde1. »
Ce texte est très important, comme nous le verrons plus loin. Pierre attribue à tous les membres du peuple chrétien les mêmes qualités, la même dignité. De même, Paul ne reconnaît que les distinctions attachées aux différents charismes qui contribuent à l’élaboration de l’unique Corps du Christ2. Mais, au fil des siècles, une distinction qualitative va apparaître et se transformer en « clivages hiérarchiques3 ». On va considérer que la fonction du laïc est inférieure et doit être subordonnée au pouvoir ecclésiastique. Et donc, même si les laïcs ont été actifs dans diverses congrégations, même si certains princes ou certains de leurs conseillers ont cherché à être d’authentiques chrétiens dans le monde avec un grand souci de justice sociale, il ne faut pas s’étonner si, très souvent, du xie au xixe siècle, la définition du laïc est négative dans deux sens : non seulement le laïc est défini simplement comme celui qui n’est pas clerc mais, en plus, la fonction du laïc est d’obéir au clerc.
1. 1 P 2, 9-10.
2. Voir Ep 4, 3.7-10. Pour la définition de « Corps du Christ », voir p. 27, n. 1.
3. André Vauchez, « Les laïcs au Moyen Âge entre ecclésiologie et histoire », Études, t. 402, n° 1, 2005, p. 55-67.
DE LÉON XIII1 À PIE XI2 : LES LAÏCS SONT « DES COLLABORATEURS ACTIFS ET SOUMIS3 »
Les révolutions politiques, sociales, économiques du xviiie siècle vont inciter l’Église à réfléchir à la dimension politique de la justice. Ainsi va naître, sous Léon XIII, la doctrine sociale de l’Église4. Dans sa grande encyclique Rerum novarum5, Léon XIII invite patrons et ouvriers à travailler à résoudre la « question sociale » à la lumière des principes fondamentaux de la doctrine qu’il inaugure. Il invite donc les laïcs à agir « sans délai », mais précise que leurs efforts doivent être placés sous le « haut patronage » des évêques6. Pourquoi ? Parce que l’action des laïcs a comme but « l’accroissement le plus grand possible, pour chacun, des biens du corps, de l’esprit et de la fortune » et doit « viser, avant tout, à l’objet principal qui est le perfectionnement moral et religieux »7.
1. Pape de 1878-1903.
2. Pape de 1922-1939.
3. Pie XI, Lettre apostolique aux archevêques, évêques et autres ordinaires des îles Philippines en vue de développer et d’intensifier la vie catholique dans ces régions, 18 janvier 1939.
4. Voir ci-dessous, p. 29, n. 4.
5. 1891.
6. Léon XIII, encyclique Graves de communi re, 18 janvier 1901. Dans une lettre à Monseigneur Guillaume Meignan (1817-1896), archevêque de Tours, Léon XIII écrit : « Il est constant et manifeste qu’il y a dans l’Église deux ordres bien distincts par leur nature, les pasteurs et le troupeau, c’est-à-dire les chefs et le peuple. Le premier a pour fonction d’enseigner, de gouverner, de diriger les hommes dans la vie, d’imposer des règles, l’autre a pour devoir d’être soumis au premier, de lui obéir, d’exécuter ses ordres et de lui faire honneur » (cité par Amédée d’Andigné, « Spirituel et temporel », dans Laïcs dans la cité. Actes du Congrès de Lausanne, Garches-Sion [Suisse], L’Office, 1966, p. 5).
7. Léon XIII, encyclique Rerum novarum
Telle est l’origine de ce qu’on appelle encore aujourd’hui l’Action catholique. C’est à son développement à travers le monde que Pie XI consacrera ses efforts. Les laïcs sont pour lui les « premiers apôtres » du monde temporel1. Mais il leur attribue principalement un rôle spirituel : l’Action catholique « ne poursuit pas des buts politiques mais religieux2 ». Elle collabore à « l’apostolat hiérarchique », elle « est une aide à la hiérarchie sacrée »3.
Pie XI reconnaît toutefois l’existence d’autres associations de laïcs qui n’appartiennent pas à l’Action catholique et qui, elles, sont engagées sur le terrain temporel, économique, professionnel, politique. Il précise qu’elles « doivent conserver leur autonomie et leur responsabilité exclusive dans le domaine technique4 ». Mais, prioritairement, c’est au sein des mouvements d’Action catholique que le pape envisage surtout l’engagement des laïcs qui, par ailleurs, peuvent devenir les cadres des organisations dites autonomes.
Il y a clairement chez Pie XI une envie de centralisation et de contrôle des organisations de ces « apôtres laïques » qui, face au laïcisme et à l’athéisme notamment
1. Pie XI, encyclique Quadragesimo anno, 1931, pour le 40e anniversaire de la publication de Rerum novarum. Le domaine temporel est celui du temps, des choses qui passent (vie matérielle). Chez saint Thomas d’Aquin, « temporel » est synonyme de « séculier » et s’oppose à « éternel » ou à « spirituel » (vie morale et religieuse) (voir André Lalande, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, Presses universitaires de France, 1983).
2. Pie XI, Lettre apostolique aux archevêques, évêques et autres ordinaires des îles Philippines, 18 janvier 1939.
3. Pie XI, Lettre au cardinal Ildefonse Schuster, archevêque de Milan, sur la tenue du IXe concile provincial de Lombardie, 28 août 1934.
4. Pie XI, À l’épiscopat de Colombie, 14 février 1934.
de la classe ouvrière et des jeunes, sont comme les « vaillants soldats du Christ1 », « soldats d’avant-garde2 », nourris des Exercices spirituels3, et que les évêques et les prêtres doivent « rechercher avec soin » et « choisir avec prudence » avant « de les former et de les instruire »4.
PIE XII5 : VERS UNE JUSTE AUTONOMIE DES LAÏCS
Pie XII va élargir la perspective de ses prédécesseurs, soulignant sans aucune ambiguïté non seulement l’importance capitale des laïcs dans la mission globale de l’Église, et spécialement sur le terrain temporel, mais aussi leur relative autonomie par rapport à la hiérarchie. C’est l’esquisse de la doctrine qui sera proclamée lors du concile Vatican II6. Quatre points sont importants à retenir7.
1. Ibid. Pie XI emploie volontiers un langage militaire : « âpres combats », « phalanges serrées », etc.
2. Pie XI, Lettre au cardinal van Roey, archevêque de Malines, 19 août 1935.
3. Pie XI, encyclique Mens nostra, 20 décembre 1929. Dans son petit livre éponyme, saint Ignace de Loyola (1491-1556), fondateur de la Compagnie de Jésus, propose, à l’instar de ce que l’on fait pour le corps, d’entraîner l’âme en quatre semaines par des exercices qui rassemblent « toute manière de préparer et de disposer l’âme pour écarter de soi toutes les affections désordonnées et, après les avoir écartées, pour chercher et trouver la volonté divine dans la disposition de sa vie en vue du salut de son âme » (Exercices spirituels, Paris, Desclée de Brouwer, 1960, p. 13).
4. Pie XI, encyclique Quadragesimo anno.
5. Pape de 1939 à 1958. Sur la nouveauté de l’enseignement de Pie XII, on peut lire Georges Dejaifve, s.j., « Laïcat et mission de l’Église », Nouvelle revue théologique, LXXX, 1958, n° 1, p. 22-38.
6. De 1962 à 1965.
7. La pensée de Pie XII s’exprime principalement dans deux discours destinés aux participants du Congrès mondial de l’apostolat des laïcs, le premier le 14 octobre 1951 et le second du 5 au 13 octobre 1957. Pour la facilité nous les identifierons simplement par leur millésime : 1951 et 1957.
« Les laïcs sont l’Église1 » Conformément aux enseignements du Christ, Pie XII ne considère pas les laïcs comme des subalternes. Il s’insurge même à deux reprises contre l’expression « émancipation des laïcs2 ». Émanciper les laïcs insinuerait qu’ils ne sont ni adultes ni libres. Or, rappelle Pie XII, « tous les fidèles, sans exception, sont membres du Corps mystique du Christ3 ». Tous « sont appelés à collaborer à l’édification et au perfectionnement du Corps mystique du Christ ». Les laïcs ne sont pas « des enfants, des mineurs [...], dans le royaume de la grâce, tous sont regardés comme adultes ». Et donc ce serait une erreur de distinguer d’une part « un élément purement actif, les autorités ecclésiastiques, et d’autre part, un élément purement passif, les laïcs ». Tous les membres de l’Église « sont des personnes libres et doivent donc être actifs ». Pie XII
1. Voir l’Allocution aux nouveaux cardinaux, 20 février 1946 : « Les fidèles, et plus précisément les laïcs se trouvent aux premières lignes de la vie de l’Église ; par eux, l’Église est le principe vital de la société humaine. Eux, par conséquent, eux surtout, doivent avoir une conscience toujours plus nette, non seulement d’appartenir à l’Église, mais d’être l’Église, c’est-à-dire la communauté des fidèles sur la terre sous la conduite du chef commun, le pape, et des évêques en communion avec lui. »
2. « Elle rend un son un peu déplaisant », dit Pie XII (1951).
3. 1951. Pie XII renvoie également à son encyclique Mystici Corporis Christi, 29 juin 1943. L’expression « Corps mystique du Christ » désigne l’Église. Elle proclame que les chrétiens et le Christ ne font qu’un seul corps, comme Paul en a fait l’expérience sur le chemin de Damas quand le Christ lui a reproché de le persécuter alors qu’il pensait ne persécuter que les chrétiens (Ac 9, 1-5). Les chrétiens sont comme les membres du corps humain, tous différents, utiles et solidaires. Le Christ est bien sûr la tête. Quant à l’adjectif « mystique », il signifie ici : « qui est lié au mystère de Dieu ».
résume sa pensée dans cette formule : « La communauté est en définitive au service des individus et non inversement. » Formule où l’on retrouve le vrai sens de l’autorité, quelle qu’elle soit, y compris l’ecclésiastique : un service1.
L’action de tous, sans exception, est nécessaire et urgente2, comme le répètent ses prédécesseurs depuis Léon XIII, et elle n’est pas facultative : « Toute attitude d’acceptation passive des événements, de laisser-aller, toute forme de quiétisme3 inerte est à rejeter4. » Et donc, aucun alibi, même spirituel, comme dira Jean-Paul II, ne peut dispenser de l’action.
Pie XII rappelle ainsi l’égalité de dignité de tous les croyants et l’importance de leur engagement là où ils se trouvent et selon leur vocation.
Les laïcs ont devant eux un vaste champ d’action
L’Église a besoin des laïcs pour deux raisons : tout d’abord parce que la pénurie de prêtres est déjà, à l’époque, de plus en plus sensible5, mais surtout parce que l’apostolat doit atteindre tous les domaines tempo-
1. 1957.
2. Ibid
3. « Doctrine ou tendance selon laquelle, aux plus hauts états mystiques, l’âme n’aurait qu’à s’abandonner au repos (quies) en Dieu, tout passivement » (Louis Bouyer, Dictionnaire théologique, Paris, Desclée, 1990).
4. Pie XII, Discours aux organisations féminines catholiques, 29 septembre 1957.
5. Pie XII, Lettre au patriarche de Venise à propos des nouveaux statuts de l’Action catholique italienne, 11 octobre 1946.
rels, tous les milieux1, et que « le clergé a besoin de se réserver avant tout pour l’exercice de son ministère proprement sacerdotal, où personne ne peut le suppléer2 ».
Le champ d’action des laïcs est donc immense. L’accomplissement du devoir d’état est déjà une forme d’apostolat d’une « puissante et irremplaçable valeur3 ».
L’Action catholique n’a pas le monopole de l’action Alors que Pie XI, nous l’avons vu, tout au long de son pontificat a cherché à promouvoir prioritairement l’Action catholique, Pie XII a une position plus nuancée et plus ouverte. Certes, il confirme l’importance de l’Action catholique, mais il met en garde cette organisation contre deux tentations : celle de se confondre avec l’apostolat hiérarchique (celui du clergé : pape, évêques, prêtres) et celle de s’octroyer le monopole de l’apostolat des laïcs.
Le premier danger est donc la cléricalisation du laïc4 et le second, de considérer toute organisation qui ne fait pas partie de l’Action catholique comme de moindre impor-
1. Pie XII pense aux familles, aux écoles et à l’éducation en général, aux pauvres, aux missions, à l’émigration et à l’immigration, à la vie intellectuelle et culturelle, au jeu, au sport, à l’opinion publique, à la vie sociale et politique… Il insistera encore sur la collaboration des laïcs, « en particulier, quand il s’agit de faire pénétrer l’esprit chrétien dans toute la vie familiale, sociale, économique et politique. [...] La consecratio mundi est, pour l’essentiel, l’œuvre des laïcs euxmêmes, d’hommes qui sont mêlés intimement à la vie économique et sociale, participent au gouvernement et aux assemblées législatives » (1957).
2. 1951.
3. Ibid.
4. L’expression, nous le verrons, est de Jean-Paul II, mais le fait est déjà ici condamné.
tance1. Pie XII ajoutera encore que « l’Action catholique n’a pas davantage, par sa propre nature, la mission d’être à la tête des autres associations et d’exercer sur celles-ci un rôle de patronage en quelque sorte faisant autorité2 ».
Si l’Action catholique, du fait de son but spirituel, est bien « un instrument entre les mains de la hiérarchie », d’autres associations de laïcs « peuvent être laissées davantage à leur libre initiative, avec la latitude que demanderaient les buts à atteindre3 ».
Pie XII reconnaît même que « l’initiative individuelle [...] a sa fonction à côté d’une action d’ensemble organisée et menée par le moyen des diverses associations. Cette initiative de l’apostolat laïc se justifie parfaitement, même sans “mission” préalable explicite de la hiérarchie4 ».
Dans tous les cas, les laïcs exerceront leur apostolat sous leur propre responsabilité. Pie XII invite les clercs à « faire bon accueil » au travail apostolique des laïcs, « à l’encourager et, surtout, à le laisser se développer librement, soit que ces groupes demeurent dans les limites de la paroisse ou qu’ils s’étendent également à l’extérieur, soit qu’ils se rattachent à l’Action catholique organisée ou non5 ».
Au sein de chaque organisation, il demande « que l’autorité ecclésiastique applique ici aussi le principe
1. 1957.
2.
Pie XII, Discours à l’Action catholique italienne, 3 mai 1952.
3. 1951.
4.
Pie XII, Discours aux organisations féminines catholiques, 29 septembre 1957.
5. Pie XII, Discours aux curés de Rome et aux prédicateurs de carême, 6 février 1951.
général de l’aide subsidiaire1 et complémentaire ; que l’on confie au laïc les tâches qu’il peut accomplir, aussi bien ou même mieux que le prêtre et que, dans les limites de sa fonction ou celles que trace le bien commun de l’Église, il puisse agir librement et exercer sa responsabilité2 ».
Pie XII condamne donc le dirigisme : « Il n’est pas admissible de voir les chefs de l’Action catholique être comme les manipulateurs d’une centrale électrique devant le tableau de commande, attentifs seulement à lancer ou à interrompre, à régler ou à diriger le courant dans le vaste réseau3. »
Il condamne également ce qu’il appelle l’« exclusivisme mesquin », et invite l’Action catholique elle-même à laisser « à chacun grande latitude pour déployer ses qualités et dons personnels en tout ce qui peut servir au bien4 ».
Ainsi, après avoir rappelé l’égalité de dignité, Pie XII souligne l’importance de la liberté qui fait partie intégrante de la dignité de la personne.
1. Le principe dit « de subsidiarité » a été défini par Pie XI dans l’encyclique Quadragesimo anno : « Ce que les particuliers peuvent faire par eux-mêmes et par leurs propres moyens ne doit pas leur être enlevé et transféré à la communauté » (voir également Pie XII, Allocution aux nouveaux cardinaux, 20 février 1946).
2. 1957. Dans son Discours à l’Action catholique italienne du 3 mai 1952, à propos des groupements féminins, il souhaitait déjà que « les prêtres, avec une fine et délicate réserve, laissent complètement aux dirigeantes et en tout cas aux soins et entre les mains de femmes pieuses et sages, ce que celles-ci peuvent faire par elles-mêmes, parfois même mieux, limitant ainsi eux-mêmes leur activité au ministère sacerdotal ».
3. Pie XII, Discours à l’Action catholique italienne, 3 mai 1952.
4. 1951.
Les laïcs doivent se former
Si Pie XII, d’une part, insiste sur l’initiative, la liberté et la responsabilité des laïcs, il rappelle aussi, d’autre part, la nécessité d’être en accord avec la hiérarchie : « L’initiative des laïcs, dans l’exercice de l’apostolat, doit se tenir toujours dans les limites de l’orthodoxie et ne pas s’opposer aux légitimes prescriptions des autorités ecclésiastiques compétentes. » Il précise que l’apostolat des laïcs ne peut être indépendant vis-à-vis d’elle1. Toutefois, « l’union des membres avec la tête n’implique nullement qu’ils abdiquent leur autonomie ou qu’ils renoncent à exercer leurs fonctions ; bien au contraire, c’est de la tête qu’ils reçoivent l’impulsion2 ».
Comment concilier cette exigence de fidélité et la liberté responsable reconnue, sinon par une formation sérieuse3 qui est le véritable lien entre les laïcs et la hiérarchie, qu’elle soit ou non présente au sein de l’organisation ? Tous doivent s’engager4 mais non sans se former : « Même l’apôtre laïc, qui travaille parmi les ouvriers dans les usines et les entreprises, a besoin d’un savoir solide en matière économique, sociale et politique, et connaîtra donc aussi la doctrine sociale de l’Église. » Cette formation peut être assurée par les œuvres d’apos-
1. Ibid.
2. 1957.
3. Voir également l’Allocution aux nouveaux cardinaux.
4. « Au lieu de céder à une tendance un peu égoïste, en songeant seulement au salut de leur âme, qu’ils prennent aussi conscience de leur responsabilité envers les autres et des moyens de les aider » (1957).
tolat elles-mêmes aidées par le clergé, les ordres religieux, les instituts séculiers1 ou encore par les laïcs eux-mêmes au sein d’une « cellule2 » : « La “cellule” catholique doit intervenir dans les ateliers, mais aussi dans les trains, les autobus, les familles, les quartiers ; partout elle agira, donnera le ton, exercera une influence bienfaisante, répandra une vie nouvelle3. »
1. 1957. En 1955, il invitait les ouvriers à « connaître les principes fondamentaux » et les « dirigeants des peuples, les législateurs, les employeurs et les directeurs d’entreprises à les mettre en exécution » (Discours à l’Association chrétienne des travailleurs italiens, 1er mai 1955).
2. Pie XII a constaté que « que certains laïcs catholiques – sous l’impulsion et la direction du prêtre – ont formé de petites sociétés ou des cercles, où une ou deux fois par mois, selon les circonstances, des collègues de la même profession, des parents, des amis, se réunissent pour traiter et discuter, sous une direction compétente, parmi les autres sujets, des questions également religieuses » (Discours aux curés de Rome et aux prédicateurs de carême, 6 février 1951).
3. 1957. Il précise que « les cellules catholiques, qui doivent se créer parmi les travailleurs, dans chaque usine et dans chaque milieu de travail, pour ramener à l’Église ceux qui en sont séparés, ne peuvent être constituées que par les travailleurs eux-mêmes ».
TABLE DES MATIÈRES
Préface ............................................................ I
Avant-propos .................................................. 5
I. Un peu d’histoire ....................................... 7
Des origines au xix e siècle : où sont les laïcs ? .. 7
De Léon XIII à Pie XI : les laïcs sont « des collaborateurs actifs et soumis » ........... 9
Pie XII : vers une juste autonomie des laïcs ..... 11
« Les laïcs sont l’Église » .................................... 12
Les laïcs ont devant eux un vaste champ d’action ..................................................... 13
L’Action catholique n’a pas le monopole de l’action .................................................. 14
Les laïcs doivent se former ................................ 17
II. Karol Wojtyla et le concile Vatican II ....... 19
Une définition de l’Église bien conforme aux Écritures ..................................................... 22
Une définition plus complète du laïc ............... 23 La mission de l’Église ..................................... 23
Ne pas séparer le spirituel et le temporel ......... 24 Distinguer le spirituel et le temporel ............... 26
La mission spécifique du laïcat ........................ 27
La doctrine et les programmes ........................ 29
Une formation complète au service du seul Royaume .................................................... 31 L’action est partout nécessaire et urgente ......... 31 Les rapports entre laïcs et clercs ...................... 32
III. Jean-Paul II et les Christifideles laïci ....... 34 Qui sont ces fidèles laïcs ?................................ 35 La mobilisation générale est confirmée............ 36 L’état du monde .............................................. 38 Les lieux d’engagement ................................... 39 La mission des laïcs dans l’Église ...................... 39 La mission des laïcs dans le monde ...................40 La formation du laïcat .................................... 47
IV. Jean-Paul II et l’animation chrétienne de l’ordre temporel...................................... 51 Pourquoi l’Église tient-elle tant à ce que les laïcs travaillent à « changer le monde… ...... 51 … à la lumière de la doctrine sociale de l’Église » ? ............................................... 54 Les moyens offerts .......................................... 58
V. L’héritage de Jean-Paul II ......................... 63
Chez ses successeurs Benoît XVI et François... 64 Sur le terrain ................................................... 67 Où se trouvent les laïcs aujourd’hui ? ................68 Où en est-on sur le plan de la « coresponsabilité » ? ................................................... 71 Et demain ?...................................................... 75