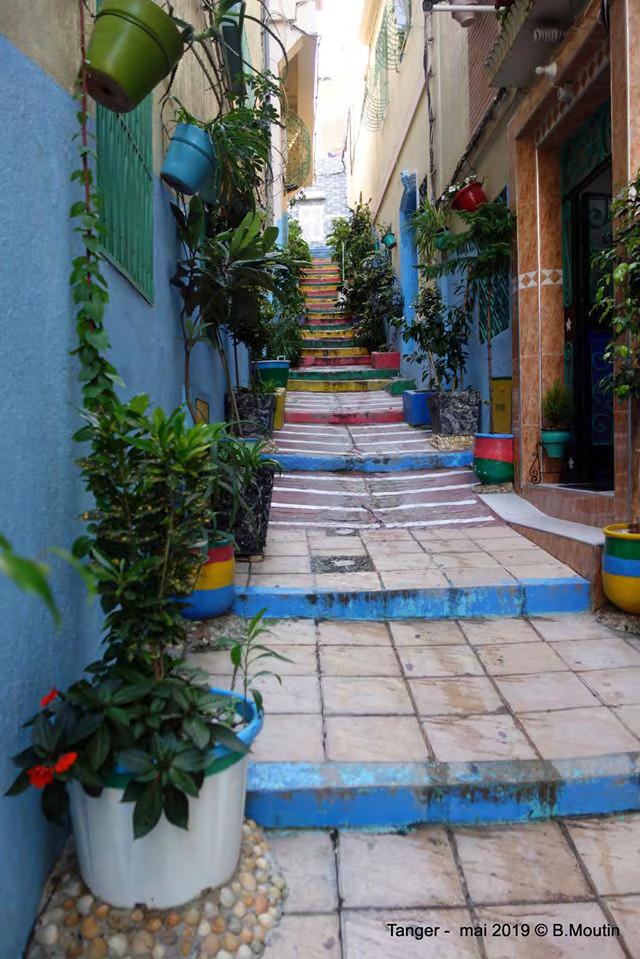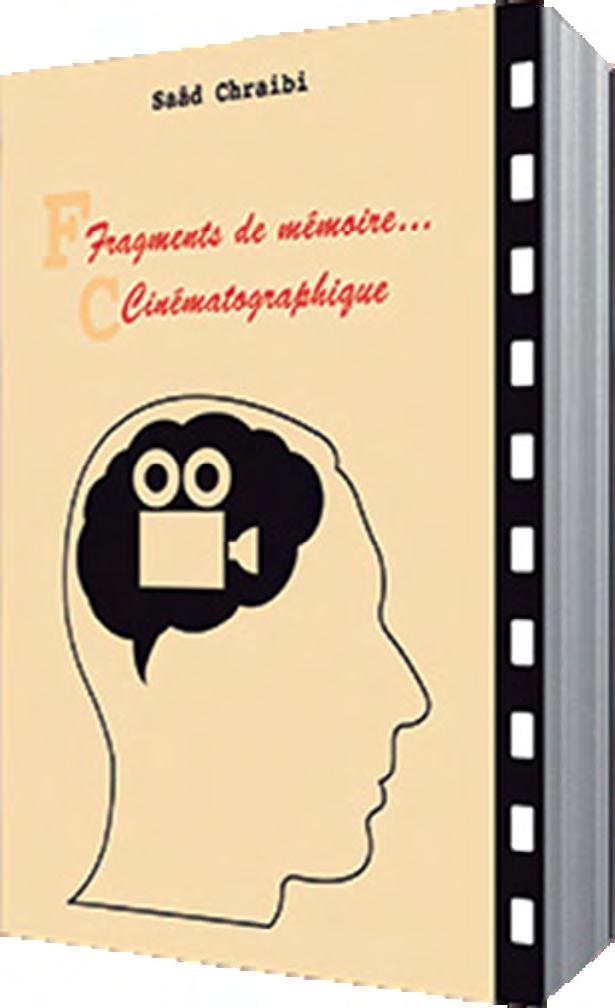3 minute read
Dossiers
L’État des droits humains en Belgique est un rapport publié annuellement par la Ligue des droits humains qui a pour vocation de faire le point sur l’actualité de l’année écoulée à l’aune des droits fondamentaux.
Pour cette nouvelle édition 2019, nous avons décidé de prendre au sérieux l’idée de lieu : identifier un certain nombre de lieux pour les enjeux qu’ils posent en termes de droits humains. Il peut s’agir de lieux qui protègent (le domicile) ou qui exercent une contrainte (les prisons, les centres fermés), de lieux symboliques où s’exercent la démocratie (le parlement) ou la justice (les cours et tribunaux). Mais également de lieux plus diffus selon les dispositifs mobilisés (la surveillance dans l’espace public), voire même de lieux où la notion même de territorialité n’a plus beaucoup de sens (la responsabilité sociale des entreprises). Un état des lieux qui nous amène à constater que les défis restent nombreux et qu’il n’y a qu’à travers un engagement collectif que nous pourrons les relever.
Advertisement
Téléchargez gratuitement l’État des droits humains 2019 en cliquant ici : http ://bit.ly/31eKDJj Ou commandez un exemplaire imprimé au prix de 10€ (+ frais d’envoi)
Réservations et commandes :
02/209 62 80 – ldh@liguedh.be
(mention États des droits humains 2019 en objet et vos coordonnées postales complètes)
31 janvier 2020
Lire l’article : http://bit.ly/37OuSeC
L’ANNUAIRE DE LA MÉDITERRANÉE 2005
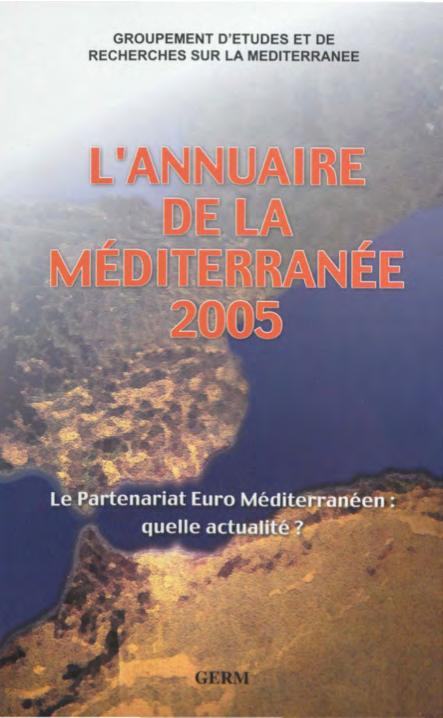
Le Partenariat Euro Médi- terranéen: quelle actualité? En novembre 2005, la Déclara- tion de Barcelone aura soufflé sa dixième bougie. Cette Déclaration et le processus qu’elle a enclenché ont nourri des espoirs et ont fixé des objectifs. Par sa vision globale et intégrée (les trois volets: politique, économique et social), sa prospective (l’établissement de la zone de libreéchange) et ses ambitions (une zone de paix et de prospérité partagée), cette Déclaration a visé haut. Cet évènement s’inscrit dans un contexte marqué par le rapprochement des points de vue entre palestiniens et israéliens, suite aux sommets de Madrid et d’Oslo, et aussi par une meilleure communauté de vue entre les pays de l’Union Européenne et les pays partenaires méditerranéens sur les grandes menaces quant à la stabilité du bassin euro-méditerranéen (migration clandéstine, lutte contre le trafic de drogue, déficit démocratique, fossé économique ... ). Le rôle grandissant et prometteur des acteurs sociaux dans cet espace du globe n’a pas échappé aux rédacteurs de la Déclaration de Barcelone. Il est explicitement dit dans cette Conférence euro- méditerranéenne que « la Société civile peut apporter sa contribution essentielle en tant que facteur essentiel d’tme meilleure compréhension et d’un rapprochement entre les peuples »… http://bit.ly/38Atj3Z
A la découverte d’Ibn Khaldoun Originaire du Yémen, la famille d’Ibn Khaldoun immigre d’abord à Séville où elle occupe d’importantes fonctions politiques. Après la chute de Séville (1248), obligée de s’exiler, elle s’établit à Tunis auprès des princes Hafsides qui lui confient de hautes responsabilités. C’est dans cette ville, le 27 mai 1332, qu’Ibn Khaldoun voit le jour. Il fut à la fois homme politique, sociologue et historien.[1] Après avoir mené une vie diplomatique mouvementée au service de différents souverains, il décide d’effectuer un retrait et commence à rédiger plusieurs ouvrages, fruits de ses recherches et lectures tout autant que de son expérience personnelle, dont l’oeuvre principale est la Muqaddima (Prolégomènes). C’est en 1406, le 17 mars, qu’il meurt au Caire. Une pensée qui nous parle… La pensée d’Ibn Khaldoun, après avoir été longtemps oubliée, réapparaît au 18ème siècle dans les milieux intellectuels turcs préoccupés par le déclin de l’Empire ottoman. Au début du 19ème siècle, à la suite de l’expédition en Egypte de Bonaparte, c’est autour de l’Europe, en pleine ascension, de découvrir ce penseur du 14ème siècle.[2] Six siècles après, sa pensée nous parle plus que jamais. Tout d’abord, par rapport à sa modernité scientifique. En effet, Ibn Khaldoun 1) conçoit l’histoire en tant que science ; 2) développe des concepts tels « l’umran » et « l’asabiya » qui semblent provenir non pas du 14ème siècle mais de la sociologie moderne, fondée au 19ème

siècle ; 3) pense l’histoire des civilisations et les causes de leurs grandeurs et décadences. « Ibn Khaldoun (…) a été l’un des premiers théoriciens de l’histoire des civilisations » [3], et il a également « conçu et formulé une philosophie de l’Histoire qui est sans doute le plus grand travail qui ait jamais été créé par aucun esprit dans aucun temps et dans aucun pays[4] . » http://bit.ly/38IIR6l