





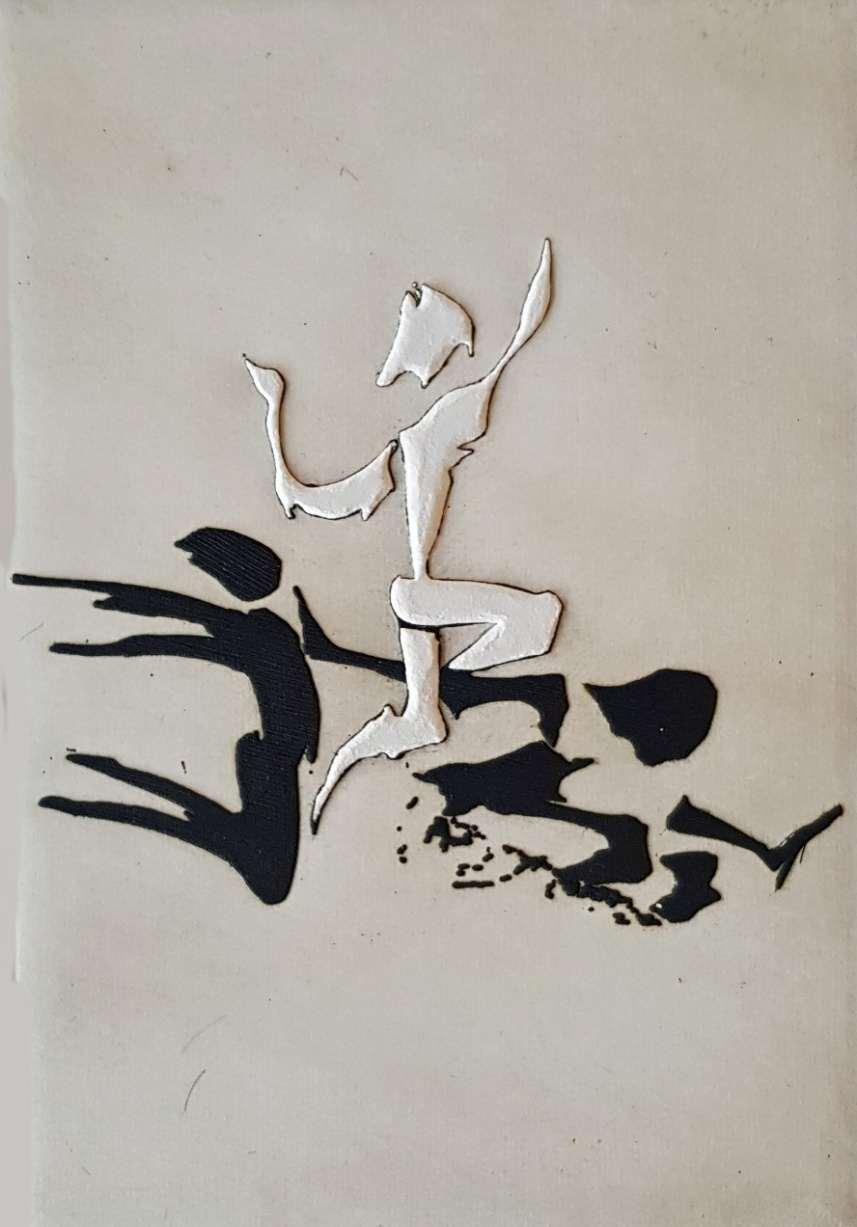
Essai sur la genèse de l’idée sportive.
Jean DURRY
AVANT-PROPOS.LESPORTCONFRONTEAL’HISTOIRE,SONHISTOIRE,TOUTE L'HISTOIRE.
INTRODUCTION.LACULTUREETLETEMPS.Lesraisonsd'undétourparl'histoireet laculture.
L'émotion précède et transcende la technique: le sport est d’abord affectivité. Le sport est une communication d'individu éprouvant à individu éprouvant. La puissance du fondement archétypal. La constitution de l'idée sportive s'effectue à travers des modèles culturels successifs. Il y a superposition et non substitution des modèles de conduite successifs: rien ne disparaît, tout est intégré.Dessystèmesdepenséeantagonistesfont éclaterlesport.
PREMIEREPARTIE.SURLATRIPLEORIGINECULTURELLEDELA COMPÉTITIONSPORTIVE.Uncontrôleculturelsurlanaissance,lemariageetlamort.
Chapitre1.LASTRUCTURESPORTIVEDUSACRIFICE.Danslecasdefiguredusport,la structuredusacrifices'affineetsedédouble.
Chapitre2.MORTETVIOLENCEINITIATIQUES.Unritueldesocialisation.
Chapitre3.UNRITUELFUNÉRAIRE(Se)jouer(de)lamort,l’imiter,laparodier,latromper.
Chapitre4.UNRITUELHIEROGAMIQUE.Mariageetmeurtre:lamortetlepouvoirsonten balance,enpartage.
Chapitre5.L'ORDALIE.Lecercledu(bon)droit.
SECONDEPARTIE.SURLESSPORTSPRESUMESLESPLUSANCIENS:LA TAUROMACHIE,LALUTTE,L'ARC,LACOURSE.Lescow-boysmythiquesetlesgarçons manquésduwesternarchaïque.
Chapitre6.ÉLEVAGEETTOTÉMISME.Desroisetdesdieux-taureaux,desluttesmagiqueset sacréeset...descow-boysmythiquesquiontlaflèchefacile,tantôtjusticiersettantôttueurs.
Chapitre7.FONCTIONSDELAFEMMEETÉVOLUTIONDESSTRUCTURESSPORTIVES. Coursescruellesetritesagraires,L'éterneln'estpasféminin.
TROISIEMEPARTIE.SURLESPORTAL’EPOQUEDEL'ARISTOCRATIECLANALE. Lasignificationdesenjeux,lanaturedusporthomériqueetlastructuredesmythesde fondation.
Chapitre8.NATURE,VALEURETSIGNIFICATIONDESENJEUXDANSLAPÉRIODE PREINSTITUTIONNELLEDUSPORT.L'ambivalenceduprofaneetdusacré,del'intérêt personneletdurespectdeschosessurnaturelles.
Chapitre9.LESPORTHOMERIQUE.Adéfaut d'immortalité,lagloire.
Chapitre10.LESMYTHESDEFONDATION.Leserpent,ledragon,laterre,oulereculdéfinitif desdivinitésféminines.
Chapitre11.DIVERSESHYPOTHÈSESSURL'ORIGINEDESJEUX.Dequelquestémoignages anciensetopinionsplusrécentes.
QUATRIEMEPARTIE.SURLEDECALAGEHISTORIQUEETLEPHENOMENEDE RUPTUREENTRELESSTRUCTURESTRANSMISESETLESCONDITIONSSOCIALES NOUVELLESOUELLESS'INTRODUISENT.Aucarrefourdelapenséemythiqueetdela penséeanalytique.
Chapitre12.PINDARE OUL’IDEOLOGIEDUBEAURISQUEACOURIR.Unequasiimmortalitéetunequasi-toute-puissance.
Chapitre13.LEQUATORZIEMEPRETENDANT.LacoursegagnantedePélopsou,comment, surlabasedutotémisme sanguinaire,s'établitl’héroïsmearistocratique.
Chapitre14.PINDARE,LESPORTETLAPENSEEMYTHIQUE.Lepatrimoinegénétiquede l'institutionsportive.
Chapitre15.EVOLUTIONDEL'INSTITUTIONSPORTIVECHEZLESGRECS.Unebrusque rupturedansl'idéologie.
CINQUIEMEPARTIE.NATUREETCULTURE.Lapassionsportiveetlaraisond'Etat.
Chapitre16.HIERON,SIMONIDEETXENOPHON.Despersonnageshistoriquestransformésen personnagesd'undialoguephilosophique.
Chapitre17.PLATONETL’EDUCATIONSPORTIVE.Unsportrécupéré,incorporédansl'Etat.
Chapitre18.LESPORTPARCONNATURALITEOUL’ANTISYSTEMEORIENTALDU SPORT.Orient/Occident.
Chapitre19.LAGLADIATUREETL'HIPPODROME.Jeuxétrusques,Jeuxromains,la dépolitisationdesmasses.
SIXIEMEPARTIE.DELAFINDEL’ANTIQUITEAL'APPARITIONDESGRANDES FEDERATIONS.Entredeuxinstitutionsqueletempssépare.
Chapitre20.SPORTETRELIGION.ApôtresetPèresdel'Eglise.
Chapitre21.L’IDEESPORTIVEAUMOYENAGE.Uneparenthèseinstitutionnelle
Chapitre22.SPORTETPHILOSOPHIE.Descartes,Fénelon,Voltaire,LaMettrie,Rousseau, Hume.
Chapitre23.SPORTETLITTERATURE.Shakespeare,Ronsard,VictorHugo,Mérimée, Hemingwayetbiend'autres.
SEPTIEMEPARTIE.LESPORTDANSLASOCIETEINDUSTRIELLE.Lesmalentendus dusportmoderne.
24,L’IDEESPORTIVEETL’IDEEOLYMPIQUECOINCIDENT-ELLES?LePartagedes pouvoirsdanslesport.
ANNEXEI:Quelquesremarquessurlachronologiedusportdansl'Antiquité
ANNEXEII:Dela findusportantiqueàl'apparitiondesgrandesfédérations;datesetbrefs commentaires.
ANNEXEIII: Informationsetobservationssurle sportsoviétique
Cedontnousnouspréoccupons,notresouci,notreproblème,encontributionauxeffortsentrepris actuellementunpeupartoutencesens,c'estdedonnerausportlesmoyensdesaisirsapropreimage, desavoircequ'ilest,dedécouvrirsonidentité,et,decepointdevue,leprésentouvrageconstituele complément,lacontrepartiedutravailprécédentparusousletitre Le sport, l'émotion, l'espace.
Eneffet,demêmequ'ilétaitnécessairededécrirelesportentermesd'espace,àtraverslalogique signifiantedesesformes,demanièreàaboutiràuneclassificationétaléedesdisciplinessportives,ce qui était du même coup une définition élargie, approfondie, du phénomène sportif, de même il est indispensable pourque le sportsoit mieux àmême encorede se comprendre, pour qu'il soit capable de se situer exactement dans son environnement social et culturel, pour qu'il puisse acquérir la maîtrise de ses méthodes et de ses objectifs, de faire intervenir maintenant dans son analyse la dynamiquedutemps.
Lesportestinévitablementuneréalitéqui naît,qui sedéveloppeetquimeurt.Il asescrises. Ila ses moments de grandeurs. Il a ses faiblesses. Il est rempli de contradictions. Disons qu'il doit être confronté avec l'histoire, avec son histoire, avec toute l'histoire. « Le temps découvre tout », disait Thalès.
C'estunedimensionquimérited'êtreexaminéetrèsattentivement,carlesports'ymanifestedans la plénitude de ses évolutions, avec des échecs, des réussites, des hésitations, des recherches. L'histoire, richesse inestimable, a d'abord valeur de témoignage. Elle ne fournit pas seulement des données.Elleestporteusedel'expériencecumulativedesgénérations.Elleoffreégalementl'avantage de ladistance. Transportant dans lepassé nos interrogations présentes, puis réinvestissant lesleçons souventcontradictoiresdecepassédansnotreprésent,elleintroduitlacomparaison,l'analogie,et,en cesens,ellen'estriend'autrequelaphilosophieelle-même.
Évidemment,iln'existe pas,commedans lepoèmedeLucrècedesbergesintemporellesd'oùles sages, d'ailleurs désignés on ne sait trop par qui, pourraient, en un lieu écarté du monde et du bruit, contemplerobjectivement,sereinement,lecourstumultueuxdescivilisations.Ilfautsavoird'avance que tout phénomène est un phénomène interprété par quelqu'un d'engagé dans la réalité des choses. Toute étude de l'histoire est elle-même historique. Toute réflexion sur les idéologies est forcément idéologique.
Decefait,lesappréciationsportéessurlanaturedusportetsaplacedansl'ensembleduprocessus historiquerisquentsouventd'êtredivergentesetiln'yapaslieudes'enétonnernides'enscandaliser. Huizinga y verra une survivance: « En dépit de son importance aux yeux des participants et des spectateurs, il demeure une fonction stérile, où le vieux facteur ludique s'est presque entièrement éteint. »1. Giraudoux, au contraire, pensera à une sauvegarde de l'espèce: « Le seul moyen de conserver dans l'homme les qualités de l'homme primitif »2
Maiscelanedoitpasnousinclinerpourautantaurelativisme.L'absenced'observatoireimmobile nesignifiepasqu'onpuissediren'importequoi.Ilfautenconclureplutôtqu'unerechercheesttoujours située.Noussommesimpliquésdansla situationdontnousentreprenonsl'étude.Nousfaisonspartie duphénomèneanalysé.Nousintervenons.Doncnousinterférons.
Toutcomptefait,ilvautmieuxnousféliciterqu'ilensoitainsi.Nousévitonsl'académismeélégant maisstérile.
Notre théorisation est subordonnée à une pratique. Nous posons des questions vivantes et actuelles, même si c'est le passé que nous interrogeons. Dans ces conditions, il serait bien inutile de regretterunescienceabstraiteprésuméeidéale.Onnepeutqu'approuverVanGenneprecommandant
1.Huizinga. Homo Ludens NRF/Galimard.1951.Originalnéerlandais:1938.p.316. 2.Giraudoux. Le sport.1928.p.7.
auchercheurde« ne pas faire deux parts de sa vie, l'une consacrée exclusivement à étudier, dans des cours, des laboratoires ou des livres, et l'autre à vivre dans le sens courant du mot. »3
Detoute façon,nous ne partonspasde rien. Ily a lesdonnéesdela mythologie,de l'histoiredes religions primitives, du folklore, de l'ethnologie. Il y a les témoignages nombreux des littératures. Deuxchosespourraientmêmedéjàêtreadmisescommeassurées.Lapremière,c'estquelesorigines du sport sont très anciennes, remontent bien au-delà du sport grec, bien au-delà par conséquent de l'institutiondesgrandsjeuxhelléniques.Laseconde,c'estquelesoriginesdusportsontàrechercher ducôtédelapenséemythique.Lesportestd'abordunrituel.C'estunacteauxsignificationssacrées. Il est, en ses formes primitives, participation au geste archétypal, participation à une réalité primordialeillustréeetfondéeparl'exploitduhérosmythique.Ilestlegestearchétypallui-même4 .
Unetelle structure decomportement est d'ailleursparfaitement conservée denos jours. L'éternel retour des saisons sportives ou des olympiades consiste à re-"produire" chaque année, tous les deux ans, tous les quatre ans, le délai est sans importance, le champion nouveau, selon ces mêmes procéduresquiontdésignélechampionprimitif.Etl'ontientreligieusementàjourlalistedesavatars, des métamorphoses, des réincarnations de ce héros aux noms multiples qu'est l'éternel champion vainqueurdutemps.
Ce que nous voudrions pouvoir montrer, c’est la confirmation de ces deux thèses, d’une part comment le sport émerge effectivement de la pensée mythique, sous l'influence de divers contextes historiques, comme rite d'initiation, de socialisation, rejoignant tous les aspects de la vie sociale primitive, et, d'autre part, comment il évolue. Il apparaît significatif de l'organisation sociale chez Homère,évocateurdepuissantsheurtsculturelsdanslesmythesdefondation,associantétrangement le maintien des traditions sacrées et la justification des privilèges aristocratiques chez Pindare, ensuite. Puis, de façon brutale et presque sans transition, il va cesser brusquement de bénéficier de son prestige théologique, ridiculisé par Aristophane, méprisé par Euripide, voué à la récupération politiqueavecPlatonetXénophon,constatéparAristoteavecunsourireindulgent.
Mais surtout, ce que l'on voudrait pouvoir montrer, c'est qu'à partir de ce moment historique, le sport a posé sa contradiction fondamentale qui constitue l'essentiel de sa problématique moderne. Nouslevoyonsinévitablementécarteléentresondoublehéritage,dansl'impossibilitédechoisirsans se détruire, partagé entre, d'un côté, sa tendance initiale, qui est protestation optimiste de la vie en face d'un monde violent et cruel, besoin héroïque, émotion tragique, bref persistance du rite, en un mot la compétition sportive, et, de l'autre, sa tendance dérivée, qui devient l'organisation du sport dans, paret pour la société, àdes fins qui sont propresà cette dernière,dans un but utilitaireet dans lecadred'uneréglementationofficielledelapratiquesportive.
Et ce que l'on voudrait montrer plus encore, - car tout ce détour abstrait n'a évidemment de significationqueparrapportàunepratiquedelavie oùiltrouvesonpointdedépartetparrapportà unepratiquedusportoù il espèretrouversonpointd'arrivée -,c'estlemécanisme,lejeudialectique par lequel la spontanéité du phénomène sportif entretient des relations ambiguës, complexes, contradictoires, avec le calcul politique d'une société utilitaire, chacun des deux aspects - pulsion compétitive et structure de récupération - appelant, exigeant l'autre, mais non sans méfiance, aucun finalement n’étant capable de prendre le pas sur l'autre, encore que tous les deux aient à cœur de rameneràsoilapresquetotalitédelaréalitésportive.
3.ArnoldVanGennep. L'étude des rites et des mythes.Dans"Religions,MœursetLégendes".Quatrièmesérie.1911.p.80.
4.Laparticipationaugestearchétypalestl'équivalent,dansl'ordredutempsmythique,essentiellementcirculaire,decequ'estle sacrifice,fondantuncentredumonde,danslecadredel'espacesacré.Ils'agitdelamêmevisiondumonde.
Situons clairement notre entreprise. Le phénomène sportif est pris ici comme centre de perspective.Ilnousintéresseenlui-mêmeparcequenousaimonslesport.Ilnousintéresseaussipour les questions qu'ilpose. Il nous intéresse encore parles réponses qu'il apporte ou qu'il suggère.Cela nousconduit,deproche enproche,versla philosophieetl'histoire.Aussi, cetteétude,loind'exclure le contexte social et culturel où le sport se manifeste, s'efforce-t-elle, au contraire de l'y replacer constamment.Ilyestramenécommeàlasourcedesessignificationsetdesesambiguïtés.
Une question préalable se pose. Qu'est-ce qui nous pousse à vouloir retourner en esprit aux origines et à essayer de revivre les péripéties du long développement par lequel le sport se met à apparaître?
Troisraisonspeuventvalablementêtreavancéespourjustifiercedétourparl'histoireetlaculture. La première, c'est que l'histoire du sport fait partie du patrimoine culturel de l'humanité. Cette histoire porte témoignage à sa manière sur la vie, les formes successives de société, leurs contradictions, la créativitédes peuplesen matière de symbolisme. L'histoiredu sportnous offreun condenséd'expériencehumaine.Ellenousapprendquelesstructureshéritéesd'unepenséemythique, quiavait elle-même àl'époqueune fonction régulatrice,semettentpeu àpeu,comme cela se réalise aussi ailleurs pour d'autres institutions ou formes de la vie sociale comme le droit, la comédie, la tragédie,laphilosophie,àvivredefaçonrelativementindépendante,envertudeleurlogiquepropre, toutenrestantinfluencéesparlarésonancedesémotionssocialesprimitivesetparlesouvenirobscur ducontextesocialquiétaitcontemporaindeleurnaissance.
La seconde, c'est que l'histoire du sport nous permet, grâce au décalage dans le temps, d'établir desanalogiesdesituation,analogiesd'autantplusinstructivesquelecontextesocio-politiqueestplus éloignéde nous.En effet,en comparant cequirapproche ces situations delanôtre etcequilesrend dissemblables, on peut tenter de dégager ce qu'il y a d'essentiel et d'inessentiel, d'accidentel et de nécessaire en chacune d'elles, bref ce qui relève du sport en tant que révélation progressive d'une logique générale de l'institution compétitive et ce qui appartient au sport en tant qu'émanation de réalitésculturellesparticulièresetcontingentescommel’idéologiepropreàunmilieusocio-historique déterminé.
La troisième, c'est que l'histoire du sport souligne, essentiellement dans la compétition, la force d'impactetl'actionpersistanted'émotionspremières,véhiculéesparlesrites,cesschémasdeconduite, ces comportements quasi-instinctifs aux significations oubliées, émotions ressenties dans la participationàunesorted'inconscientcollectifmatérialisédanslessymbolismesdelareprésentation sportive.
On peut discuter, certes, sur la nature de cet inconscient et surtout sur les procédures de transmission des archétypes de génération en génération. Comment cette réceptivité émotionnelle primitivesemaintient-elle?
On peut aussi discuter sur la moralité d'une adhésion consentie aux valeurs explosives de ces matériauxarchaïqueshéritésd'unecultureenprinciperévolue.
Mais on ne peut pas refuser de voir le soleil en plein jour. Des centaines de millions de téléspectateursregardent enmêmetempslesgrands événementsdusport.Ceseraitrenverser l'ordre causaldesinfluencesqued'attribueruntelengouementauseulmatraquagetélévisuel.Lestélévisions utilisentetexploitentunbesoin,uneexigence.Ellesamplifientlephénomène.Ellesnelecréentpas. Etcette amplificationn'estpossiblequeparcequ'ellerencontreunesensibilitéprompteàs'émouvoir
surlesimagesproposées,parcequ'elledécouvreuneréceptivitéparticulièrementattentiveàcegenre dedramatique.
Quandbienmêmeils'agiraitdedélire,ilresteraitàexpliquerclairement-etnonpasàdénoncer, ce qui est vraiment trop facile, sur un ton moralisateur- le besoin massivement ressenti de ce délire collectif intense. Pourquoi le sport n'est-il jamais neutre affectivement ni chez celui qui le pratique, nichezceluiquileregarde,nichezceluiquilecritique?
C'estque,sanslesavoir, danslesport,nousmanipulonsdesrites.Lacompétitionsportiveestun riteexplosif.Écoutezdeloinlarumeurdesstades.Moralisern'apporterarienàlaconnaissance.C'est seulement l'allergie au rite, donc l'adhésion négative à l'immédiateté du phénomène sportif, qui s'exprime alors. Il est plus utile de connaître les ingrédients, la posologie et le mode d'emploi de ce riteexplosif.C'estlaculturedel'histoirequinousenfournitlaformule.
L'émotionprécèdeettranscendelatechnique.Lesportestd'abord affectivité.
Cetteprésencedel'émotiondoitêtreconsidéréecommeunedonnéefondamentale.Contrairement à un préjugé solidement établi, l'essentiel des significations du sport ne réside pas dans l'effort physique. On prend la conséquence pour la cause. Cette illusion d'optique provient de ce que les valeursphysiquessontpréalablementl'objetd'unchoixsocialinaperçu etd'unchoix émotionnel.La plupart des erreurs commises dans l'organisation du sport tiennent à cette ignorance. Ce qu'il est important de bien comprendre et ne jamais perdre de vue, c'est la cause, la motivation, la raison, ce qui fait que l'effort physique, la difficulté, l'obstacle sont recherchés, ce qui fait que les valeurs physiquessontenréalitédesvaleurssociales.
L'oubli, la sous-estimation de cette donnée émotionnelle fondamentale équivaut à une vision tronquée du sport. C'est même une faute méthodologique caractérisée, le réductionnisme. On réduit latotalitéduphénomèneétudié,sonprincipevital,carlesportengagel'hommeglobalementavecson corps, son cœur, son intelligence, et tout l'environnement des valeurs sociales qui sont attachées à l'effortaccompli,àn'êtreplusquelabiomécanique,cequiconfortel'impérialismemédicalenmatière desport,ouàn'êtreplusqu'unmoyend'éducation,cequisatisfaitlabonneconsciencedeséducateurs, ouencoreàn'êtreplusqu'unloisirdemasse,cequiassurel'occasiondelargesprofitsaucommerce. Cet oubli, il est vrai, a un sens. L'accent s'est déplacé du pratiquant et du spectateur, qui représentaient la passion sportive, dans la droite ligne des jeux traditionnels, vers le chercheur, l'entraîneur, l'éducateur, qui sont plutôt la raison d'Etat, reprise en main paternelle, morale et bienveillante du sportif par des salariés au service de la société. Il est clair que le sportif tend à être dépossédé du contrôle du sport qu'il pratique. On aurait parfois l'impression que le sport appartient ouvaappartenir auxmédecins,auxéducateurs,auxmarchands,àl'Etat.Cequesignifiel'éclatement ouvertementsouhaitéde certainesdespyramidessportivesunisports,c'est,àla limite,quel'individu aencoreledroitd'apportersa contributionausportdeprestige,s'il estapte àla haute compétition,à sedéfoulerphysiquementdanslecadred'unloisirorganisé(parqui ?),s'il n'est qu'unadulte moyen, àsefaireéduquers'ilestécolierdebase.
Lesattaquesdetousbordsdontlesportcivilestl’objetetqu'ilignoreleplussouvent,nesontque l'expressiondecettetentationqu'ilinspireetdelavolontédesunsetdesautresdes'enemparer.Dans cette voie, les pulsions héroïques sont dominées, soumises. L'institution sportive est récupérée. On parledeservicepublicetl’Etats'assurelamaîtrised'uneréalitéquiluiéchappait.Onparledenormes techniques pour le matériel et c'est le commerce qui s'ouvre des marchés nouveaux qu'il n'a pas contribué à créer. On parle de santé et d'éducation, et médecins et pédagogues, en vertu de leur position officielle dans la société, réclament un droit presque d'exclusivité sur le sport qu'il n'ont pourtantpasinventé.Maislepeuplecréateurn'estjamaisévoqué.C'estcommes'iln'existaitpas.On pourrait d'ailleurs, à première vue, s'étonner, alors que l'animation socio-culturelle très en vogue invoqueleprincipedelapriseenchargeetdésespèreparfoisdefaireassumerleurpropredestinaux petits groupes de population locale, de voir dans le même temps des critiques directes ou indirectes
s'abattresurlesportcivilquiprécisémentréalisecettepriseencharge.Maisl'apparitionetlamontée d'unpouvoirsportifdontilfaudraittenircompteetavecquiilfaudraitnégociersuscitentévidemment desinquiétudeschezlesuns,desobstaclesetdeslimitesàl'actiondesautres.
Par un juste retour des choses, il est vrai, ceux qui ont cru pouvoir saisir à bras le corps le mouvement sportif, le techniciser àoutrance, l'orienter defaçon volontariste vers la performance de trèshautniveau 5n’ontsouventobtenuqueledémentidel'expérience,desrésultatsinférieursdansla pratiqueàcequelathéorieprévoyait.
C'est qu'il nesert àrien de sophistiquer l'apprentissage technique,de fabriquerdes musculatures d'exception etde dresser des virtuoses de l'effort physique, s'il n'existe pas, derrièreces formidables machines humaines, une volonté profonde de gagner. Une épreuve sportive signifie qu'on veut prouver quelque chose devant quelqu'un. Tout le problème du sport est celui d'une émotion subordonnéeà un écho. On est le champion d'un groupe, jamais un champion abstrait. Ce qui est en jeu, c'est toute la relation complexe de l'individu à son milieu, et cela va bien au-delà de l'étroite psychologiedegroupeappliquéeauxéquipessportives.Onestloindefairedusporttoutseul,entête àtêteavecsaconscience:ilyalesamis,lesdirigeants,l'entraîneur,lesspectateurs,tout lecontexte delaviesocialeettoutl'héritageculturel.Couperendeuxouendavantagedemorceauxlespyramides sportivesunisports,dansunesortededécoupagedelavolaillesportive,c'estpresqueàcoupsûr,qu'on nouspardonnecesexpressionsvulgaires,tuerlapouleauxœufsd'or,d'argentetdebronze.
Par un juste retour des choses également, la trop grande sollicitude éducative à l'égard des nonchampionsnerencontrepastoujoursladocilitéattendue.C'estlanotiond'éducationquidoitêtreune bonne fois remise en cause. D'abord, les populations sportives ne sont pas si stupides qu'elles aient besoinqu'onvienneleurdireprophétiquementcequ'ellessaventdéjàd'instinct.Detoutesfaçons,on nevientpasfairedusportpoursefaireéduquer,maisparcequ'onaime.Lepaternalismequesuppose (et qui impose) une relation pédagogique n'est pas aisément supporté, même s'il est habile, subtil et discret,endehorsdumilieuoùilestjustifié,l'école. Il faut avouer aussi que l'idée omnisport est souvent un obstacle. Elle apparaît en contradiction avec la passion sportive qui, comme toute passion, est exclusive et s'attache à une discipline. Enfin, l'éducation implique la transmission d'un message idéologique. Le sport est moyen. C'est la raison qui parle. Mais l'objectif de ceux qui se présentent demeure l'activité sportive. C'est le plaisir qui se prononce. Tout ne devant pas être obligatoirement dans tout, il est à prévoir un refus instinctif de mélangerlapoursuitedesfinssportivesetlapoursuitedevaleursnon-sportives,si justifiéessoientelles. C'est effectivement ce qui se passe. On a souvent constaté et déploré l'écart, le décalage entre les principes officiels prônés par le sport éducatif et la faible prise de conscience de ces principes chezlespratiquantssportifs.C'estinévitable.
Sous-estimerlepouvoirdel'émotion,c'estsous-estimerlepouvoirdesmasses,c'estsous-estimer lacréativitépopulaire,c'estignorercetteantimatièredel'histoirequ'estlacontre-sociétésportive.
5 L'analogie est frappante avec l'organisation de l'enseignement en vue des concours. Les conservatoires semblent s'obstiner à subordonner leurs actions à la formation des concertistes, race noble de la musique, et les U.E.R de nos universités à construire leur cursus avec amour autour d'un programme d'agrégation, tirant grande et belle gloire à passer de temps à autre un sujet d'élite dans le pusillus grex delapenséefrançaise.Demême,danslesport,onoublievolontiersl'existencedel'ensembledelapyramidesportiveau profit,lemottombejuste,desapointeextrême,brillanteetvulnérable.Unanciensecrétaired'Étatfrançais(interviewsurFranceInter le2août1976)laissaitentendrequenosmédiocresrésultatsolympiques,cedontilfaisaitundramepersonnel,tenaientàl'incuriedes fédérations et qu'il était, lui, désarmé par la loi de 1901; il a ajouté qu'il était prêt à intervenir et à presque étatiser le sport d'élite, ce dontnousapréservéunopportunremaniementministériel.Onyviendrapeut-être,mais,silesportdevientunservicepublic,avecdes dirigeantsnommésparl'Étatetnonplusélusparlessportifs,ilfaudra,enbonnelogique,quelesmilliersdebénévolesquiontinventé etquifontsubsisterlesportcivilreçoiventdésormaisunsalairedefonctionnaire.Ilesttropfaciled'ignorerlesolsurlequelons'appuie. Leconcertiste,l'agrégé,lechampionnepeuventpasvivreseuls,inaccessibles,danslesnuagesetlesillusionsdel'Olympe,tandisque lamajoritémuette,nepouvantprétendreàdetelleshauteurs,s'engagedansdesfilièresprofessionnellesousportivesenimpasse.
Lesportestunecommunicationd’individuéprouvantàindividu éprouvant. Undoubletransfertaffectifseréalise.Lachoraledes supporters,c’estlechœurdelatragédieantique.
L’utopie sportive consiste à imaginer un sport qui "devrait" être pur. Pur de quoi? Au nom de quoi?Surquelmodèle?Leproblèmeresteentier.Laseulechosecertaine,c’estquec’estl’émotion qu’oncondamne.Et,toutnaturellement,l’émotionsansactiondusupporterestunecibleprivilégiée. Lacritiquedusport-spectacleestdevenueunlieucommun.
Mais il serait vain d’espérer, pour des raisons supposées morales et pures, transformer les spectateurs, trop vite réputés violents et ignares, en acteurs soudains gentils, sages et disciplinés, chacun faisant du sport dans son coin pour lui-même, l’adversaire étant tout juste toléré. Ce qui caractérise le plus profondément le phénomènesportif, c’est son retentissement affectif, on n’ypeut rien,ilsuffitdeleconstater,etrienneprouveaudemeurantquecesoitlàunmalabsolu.
Il faut même aller plus loin, non seulement accepter le réel, mais le respecter. Ce fameux retentissement affectif, si on l’observe de près, est l’objet d’un double transfert, celui-là même qui s’exprime dans le tragique, et, par-delà le tragique dans toute forme de culture, aussi bien dans les penséesprimitivesavecmasquesquedanslesplusmondainsdenosspectaclesmodernes.D’unepart, la vedette sur le stade est le dieu souffrant, le bouc émissaire qui porte les espoirs et les craintes de son public et qui sera maudit ou adulé suivant l’issue du drame. D’autre part, le spectateur souffre devantl’agoniedesonhéros. Il yassisteimpuissant.Maisilmanifestesasympathiedela voixetdu geste.
L’émotionduchampionquivaseproduires’expliqueparlasignificationsocialedesonacte.On attenddeluibeaucoup.Tropsansdoute.Sera-t-ilàlahauteurdel’idéequ’onsefaitdelui?Saura-til franchir en vainqueur ces obstacles symboliques que sont les haies, les rivières, les filets, les systèmes défensifs?Restera-t-il, auterme de l’épreuve,le champion qui porte les souffrances et les espoirsdelafoule?
Ainsi la chorale des supporters souffre effectivement pour son héros tandis que le héros souffre moralement et physiquement pour elle. Il y a solidarité évidente, complémentarité, complicité, dans cejeuderôles.
Le mécanisme est bien celui de la tragédie et Freud semble décrire les ressorts profonds du spectaclesportiflorsqu’ilécrit:« Pourquoilehérosdoit-ilsouffriretquesignifie"faute"tragique ?... Il doit souffrir parce qu’il est le père primitif, le héros de la grande tragédie primitive… La faute tragique, c’est celle dont il doit se charger pour délivrer le chœur… Le héros tragique est promu rédempteur du chœur. »6
Onvoitbienl’organisationaffectivedecetransfertrituel.Lechampiondit:jesouffrepourvous, j’affronte pour vous l’épreuve mortelle, je suis dépositaire de votre angoisse, je vous sauve par ma victoire,jevousperdsparmadéfaite.Lachorale dessupportersrépond:jepartagecettesouffrance, c’estlamienne,jeregardeattentivementlespéripétiesdel’épreuve,spectatricedemonpropredestin, etjevismarédemptionoumacondamnation,monsalutoumaperte.
Le schéma pouvait convenir pour interpréter Les Perses d’Eschyle ou l’Electre de Sophocle. Il convient tout autant à l’interprétation des grandes compétitions sportives. Autrement dit, ces supporters dont nos moralistes se complaisent à dire tant de mal et dont ils se servent pour dénigrer le sport civil ont quandmême su, du fond deleurignorance etparfois deleur sauvagerie, réinventer àleurusagelesémotionslesplusprofondesdelaculture
6Freud, Totem et Tabou,Payot.P.179.
Visiblement, on rejoue en commun quelque chose d'important. Ce quelque chose est ressenti instinctivement.Ilmobilisel'émotioncollective.
Entoutcas,levocabulaireemployéestrévélateur.Onsecroiraitplongédansleconteoudansles religions primitives. On parle de la sorcière aux dents vertes et de l'homme au marteau. Les descriptionssonttoujoursgénéreusesetcolorées.Onévoqueaussitraditionnellementl'EnferduNord pour souligner ladimension inhumainede Paris-Roubaix cycliste.On dit encorela dureloi du sport pourlaisserentendrequelesportn'estpasuneaffairedebonnesintentions,demoraleetdesentiment, que son verdict tombe sans appel. Enfin, on sait que la connaissance intime profonde des subtilités del'épreuveestréservéeàceuxqu'onnommedesinitiés.
On pourrait aisément multiplier de tels exemples. De pareilles rencontres ne sont pas fortuites. Une idée, toujours la même, s'y exprime et s'y impose. Sans aucune ambiguïté possible, le sport, l'émotion sportive, c'est en même temps l’épreuve, l'exploit et, nous le verrons plus tard, la récompense. Par là on en devine déjà les origines. Si le sport rencontre un tel écho affectif, si sa moralesituelebienpar-delàle malqu'onsedonne,c'estqu'iltoucheauxélémentslesplussensibles duscénarioinitiatique.
On connaît ce scénario, décrit classiquement par les historiens des religions primitives. On éprouve l'adolescent qui devra affronter obstacles et périls. Larécompense, ceseral'admission dans lasociétédesadultes,lemariage,éventuellementlepouvoir.Mais,entre-temps,ilaurafallu-etc'est l'exploit-traverserlamort,mourirsymboliquement,renaître.
Onsaitaussiquecepassagedangereuxdel'étatd'adolescentàlasituationd'adultes'effectuedans un milieu extra-culturel qui n'est pas un lieu, dans une nature qui est estimée surnaturelle, dans une parenthèse sacrée de l'existence sociale. L'adolescent est expulsé. Il perd son nom. C'est au retour, l'épreuve accomplie, qu’on lui en donnera un autre, quand il aura pu faire la preuve physique des énergies surnaturelles accumulées au cours de son séjour dans la nature, au cours de son voyage au paysdesâmes,aupaysdesmorts,oùl'onerredépourvudenom,doncsansidentité.
Le sport n'est évidemment pas seul à véhiculer à travers l'histoire le souvenir confus de ces émotions. Les mêmes archétypes se retrouveraient sans peine dans le conte poétique, le roman policier, les récits de science-fiction. C'est toujours l'expression symbolique d'un certain nombre d'idéespremièresperçuesimmédiatementdefaçonaffective.C'esttoujourslevoyagepérilleux.C'est toujours l'épreuve, l'exploit, la récompense. C'est toujours la même réceptivité à l'égard de superstructuresenapparencepérimées7 .
Encore une fois, il faudrait expliquer comment des archétypes si persistants passent d'une générationàl'autrepourconstitueretstructurerl'inconscientcollectif.Lavoiebiologiqueestexclue. Mais il n'est vraiment pas besoin de faire intervenir le patrimoine génétique dans de telles explications. Ildoityavoirdesvoiesdetransmissionbeaucoupplussimples8 Il conviendrait aussi d'expliquer pourquoi ils sont ressentis plus intensément à certaines époques historiques.Probablementviennent-ilscompensercertainsmanques.Onaural'occasiondelevoir.
7 Pour le conte poétique, on peut renvoyer aux analyses du livre: Le sport, l'émotion, l'espace, ouvrage complémentaire de celui-ci. Pour le roman policier, plus éloigné de nos préoccupations, indiquons seulement qu'il comporte obligatoirement une descente aux enfersdestruands,unepoursuiteetfinalementlavictoireduhérosàl'issuedel'épreuvemortelle.Quantàlascience-fiction,ilapparaît clairementquelevoyagedansl'au-delàestsuividuretouretquelesdeuxgrandeschosesattenduesdufuturetdulointainnesontque deuxvisiblesobsessionsdel'humanité:latoute-puissanceetl'immortalité.
8 Par exemple, l'argument de l'Opéra de Rimski-Korsakov, Tsar Saltane, est emprunté à un conte en vers de Pouchkine qui s'inspire de récits populaires russes ; si on analyse ceux-ci, on retrouve des éléments du mythe grec de Persée, mythe qui d'ailleurs s'accorde parfaitementaveclamorphologieducontedécriteparPropp.Ondevinelesmécanismesdesélectionetdeconservation:transmission orale, récits déformés par les voyageurs, nombre limité des histoires possibles, jeu du rêve et de la peur, les meilleures structures se fixentetsetransmettent.
Mais, en tout cas, ils sont universels. Michel Clare en fait l'observation: « Il est assez remarquable que le phénomène sportif atteigne aussi bien les nations les plus évoluées que celles qui sortent à peine du totémisme »9."
Cequirenddifficilelaprésenteentreprise,c'estquel'histoiredusportn'apasseulementàrendre compte des évolutions de l'institution sportive, une fois celle-ci créée. Déjà pour cela, elle doit commencer par définir cette institution. C'est relativement facile pour les fédérations et les jeux olympiques modernes. C'est déjà plus délicat pour les grands jeux de la Grèce. Et de toutes façons cecinenousconduitpasbienloin,au-VIIIe siècle.Homèreestendehorsducadre.
L'histoiren'a rienrésolu quandelle amis unedate,-776,pourmarquer ledébut delasuccession régulière des jeux. Tout dépend de ce que l'on appelle institution. Désormais, on a effectivement un déroulement plus cohérent, les épreuves se reproduisent périodiquement. Mais la coupure est loin d'être aussi nette, qu'on veut bien le dire par souci de simplification. Avant -776, les formes des épreuvessontdéjàfixéesetl'onpourraitparlerd'institutionpuisqu'ilyadesoccasionsprécisespour organiser des jeux. Après -776, on n'est pas installé dans un ordre immuable et les choses changent encoreaucoursdessiècles.
Etpuis,antérieurementàsonétatd'institutionsportive,lesportapuêtre,adûêtreuneinstitution religieuseetsocialeenmêmetemps.
Celanousconduitàl'examendesformespré-sportives,préfigurationsdusport.Voilàtoutcedont l'histoiredusportaàrendrecompte.
On a donc pas tort d'attribuer aux Grecs, comme on le fait communément, l'invention de l'institutionsportive,danslamesureoù,parinstitution,onentendl'universalitédesrèglesetleretour périodique des compétitions. Mais il ne faut pas oublier que cette institution sportive, si elle est réellement un couronnement, l'aboutissement de toute une évolution, est elle-même un fait relativementtardifdansl'histoiredusport.Ilyabeaucoupd'autreschosesavant.
Pour bien comprendre ce qui se passe alors, il convient de rappeler qu'au début du premier millénaire nous assistons à une dissolution du régime clanique en Grèce et à l'instauration des relationsdemaîtreàesclave.Antérieurement,lesEtatsduPéloponnèseavaientconnuunepériodede haut développement économique et culturel, en particulier en Messénie, à Pylos, et en Argolide, à Mycènes et Tirynthe. Puis, vers la fin du -XIIIe siècle, époque présumée de la guerre de Troie, les tribusdoriennesavaientpénétréparvaguessuccessivesvenantdunord.C'estlàquesesituelasociété dite homérique. Il s'agit d'économie rurale. Le commerce se réduit au troc. IIy a des manifestations sportivesetlastructureenestdéjàtrèsélaborée, modernesurbiendespoints.Onnepeut cependant pasparlerd'institutionsportivedanslesensquenousavonsindiqué,carlesinitiativesd'organisations sontponctuelles.
C'estentrele-VIIIe siècleetle–VIe sièclequeseproduisentlesévénementsdécisifsquiaccélèrent lemouvementdel'histoiredusport.Àcetteépoque,lasoudures'installeàChio,lafonderieàSamos. Le tissage se perfectionne, ainsi que la poterie, la taille de la pierre. De nouvelles professions apparaissent. Des liaisons commerciales s'organisent. Les centres politiques et économiques se développent. Surtout c'est l'époque de la grande colonisation. On fonde des cités dans tout le bassin méditerranéen.
Toutes les conditions sont maintenant réunies pour que surgisse l'institution sportive au sens rigoureux du terme. C'est en effet sur le double principe de l'unité (de langue, de culture) et de l'opposition (rivalité, émulation des cités autonomes) que se construit l’institution sportive, la voie maritime faisant lien plutôt qu'obstacle. L'unité de culture appelle l'universalité de la règle. La
9 MichelClare. Introduction au sport.Leséditionsouvrières.1965.p.11
diversité politique maintient la possibilité d'une opposition permanente entre adversaires égaux en droit,etdoncpermetleretourpériodiquedesjeux.
Et de fait, c'est dans la période allant de la fin du -VIIIe siècle au début du -VIe siècle que se «rétablissent»surcesbasesnouvelleslesgrandsjeuxdelaGrèce.
On s'en doute, une très longue et riche préhistoire du sport précède cette organisation déjà parfaitement structurée. Ce qui apparaît comme le début de l'ère historique du sport constitue en réalité la fin d'une très longue période préparatoire où le sport n'était pas le sport mais tenait lieu d'institutionsocialerégulatrice.Ilnefautdoncpasselaisserabuserparleprestigedecescompétitions célèbresetparl'échoqu'ellesontrecueillienGrècetoutd'abord,puisàtraverslemonde,etilimporte desavoirrésisteraupartiprisd'idéalisationquis'estattachéàtoutcequitouchaitàlaculturegrecque, au sport grec, au mot même du jeu dont on voudrait parfois, sur la foi du français, retenir la composanteludiquepourcondamnerlesportmodernecompétitif10 .
Nousnousdevonsd'insistersurcepoint etde nousyattarderun instant,caronconstatesouvent chezceux qui parlent du sport de singulières erreurs de perspective, leur ignorance du passé servant paradoxalementd'argumentpourlacondamnationduprésent.
Or, c'est d'abord beaucoup simplifier que d'opposer le jeu des Grecs au sport industriel. Par exemple, Jules Gritti écrit: « Nous avons constamment trouvé des traces dans le sport moderne de l'idéal olympique, idéal de jeux plus que de rendement11 ».Cemoralismeennoiretblancn'estguère justifié historiquement. Le sport grec se veut lui aussi efficace et intéressé. Il a ses entraîneurs célèbres.EtGernetetBoulangernotentl'expressionquiàl'époquehistoriquedésigneral'organisation desjeux.Ondit:tithenai(athla),déposer(lesjeux)12
Ensuite,c'estvraimentse faireplaisir etillusionqued'imaginerle géniegrecinventantde toutes pièces,dansladouceurdevivre,desfestivitéssportivesrustiquesetbucoliques.Cen'estpasdansun cadre idyllique et reposant que s'organisent des jeux. Ce n'est pas non plus en Grèce qu'il convient obligatoirement de signaler les premières manifestations de la réalité sportive. Nous disposons, en tout cas, de témoignages plus anciens que ceux des grands jeux, plus anciens aussi que ceux d’Homère,etcenesontpasd'aimablesdivertissementsentregensdebonnecompagnie.
C'est un fait que lesport commencetrès tôt dans la civilisation. Il est déjà présent aux débuts de la littérature. On trouve dans l'Epopée de Gilgamesh des indications précieuses sur une réalité qui pourrait bien nous faire remonter jusqu'au quatrième millénaire. L'histoire est connue. Un homme sauvage, Enkidu, dévaste les plantations de la ville d'Uruk et déjoue les pièges des chasseurs. Gilgamesh, roi de la ville, parvient à le faire capturer par ruse. Mis en présence l'un de l'autre, Gilgamesh etEnkidu commencent par se battre et c'est Enkidu, -notons cetrait au passage, il a son importance-, qui l'emporte. Cela ne les empêche pas, bien au contraire, de devenir amis, Ensemble, ilsirontensuiteaffronteruntaureaucéleste.Puis,Enkiduétantmort,Gilgameshpartiraàlarecherche delaplanted'immortalité.
Toute unesymbolique compliquéese devine aisément àtravers la légende assyro-babylonienne. Maisdeuxpointssollicitentdefaçoninsistantenotreattentiondesportifs.C'estd'abordl'allusiontrès netteàuncombatrituel,uneluttequi,visiblement,marquel'entréedel'hommesauvage,noncivilisé ouprétendutel,dansunesociétérelativementstable,aveciciunedominanteagraire,commesemble l'indiquerladévastationdesplantations.C'estensuitel'épreuvetauromachique,probablementunrite d'initiation royale, ayant par conséquent valeur consécratoire, non dépourvu, en tout cas, d'une résonancetotémique,lamiseàmort,lemeurtredutaureausacré13 . UntextedelaGenèsemériteraitaussideretenirnotreattentionparlesrenseignementsqu'ilfournit surl'intimitédesstructuressocialesetdesstructureslesplusanciennesdusport.Onnousraconteque
10Legrecdésignelesjeuxpar agôn,jeu,concours,lutte,etsurtoutpar athlos,lutte,combat,concours.
11JulesGritti. Sport à la une.ArmandColin.Uprisme.1975.p.210.
12LouisGernetetAndréboulanger. Le génie grec dans la religion.AlbinMichel.1970.p.83.AntérieurementparuàlaRenaissance dulivre,1932.
13 Contenau. L'épopée de Gilgamesh. L'artisandulivre.1939.p.83-84,etp.110à113. Conrad. Le culte du Taureau.Payot.1961.p. 44à47. Histoire de l'art 1.EncyclopédiedelaPléiade.p.429. Histoire des religions 1. EncyclopédiedelaPléiade.p.57à162et172173. Histoire universelle 1. EncyclopédiedelaPléiade.p.321à323.
Jacob lutta toute la nuit contre un dieu, et que ce dernier, pour se tirer d'affaire, dut avoir recours à une prise qu'on jugera peu "fair-play". Cependant Jacob, l'articulation démise, tint bon néanmoins. Ledialoguequis'instaurealorsnemanquepasd'intérêt.LedieudemandeàJacobdelelaisserpartir. Maiscedernier,conscientdelavaleursurnaturelledesonadversaire,luidemandepréalablementde le bénir. Le dieu en question refuse de donner son nom, - une telle révélation donnerait pouvoir sur lui, on pourrait l'évoquer-, mais, bienveillant, il donne, en revanche un nouveau nom à Jacob qui s'appelleradésormais Israël,cequisignifie:celuiquialuttéavecundieu14 . Manifestement, on se trouve ici devant un mythe de fondation, - le peuple d'Israël est fort parce qu'ilpossèdeassezdevertusurnaturellepoursemesureravecundieu-,quis'appuiesurlevieuxrite initiatique des sociétés primitives. Ce rite initiatique est caractérisé non seulement par l'épreuve du combatrituel,maisaussiparlepassaged'unerivière,-symboledelalimite,del'au-delà-,quioblige précisément àlivrercombat,etenfinpar labénédictionduvaincuqui seretireauvainqueur qui s'en vaau-devantdesépreuvesdelavie.
Mais il y a aussi quelque chose d'anormal et de comique dans l'anecdote ainsi rapportée. Sans doute l'adolescent futé avait-il deviné, reconnu un membre de la tribu sous le masque du dieu venu luibarrerlaroute.Ilnelelâchepas.Iloseluidemandersonnom.Etl'autre,bienembarrassé,s'entire au prix d'une prise sportivement discutable, puis de l'attribution du nom d'adulte flatteur pour son adversaire Vraisemblablement on a dû réutiliser à des fins sérieuses et hagiographiques une bonne vieille histoire drôle de la tribu, histoire dont l'intérêt s'était émoussé avec l'abandon des rites initiatiquesdanslecadrepatriarcal.
Ilyasuperpositionetnonsubstitutiondesmodèlesdeconduite successifs.Magie,mythe,totémisme,riennedisparaîttotalement.
Lesport,danssondéveloppement,estétroitementassociéaumouvementdel'histoire.Ilhéritede matériauxempruntésàl'organisationsociale:sesstructuress'eninspirent 15.Ilévoquedesémotions quiontunebaseculturelleprimitive:initiations,ritesfunéraires,hiérogamies;ilexprimedesbesoins ressentis par la société, soit positivement sous la forme d'une élaboration de valeurs sportives, soit négativementcommeréponseàdesmanquessociauxouaffectifs. Ilrejaillitmêmesurla culture: la sophistiqueestunecompétitionintellectuelleoùl'argumentvictorieuxtientlieudevérité16 .
Enfin,àl'apogéedesonsuccès,ilsefaitrécupérerparunesociétéutilitaire:onlemetauservice duprestigepolitique,ducommerce,del'éducationmilitaireoucivique,etc...
Mais en même temps, l’institution sportive aurait tendance à figer l'histoire dans un instant universeld'éternité.L'espaceludiqueconsacrel'abolitionprovisoiredutempshistorique,irréversible et destructeur, interrompant magiquement pour ses adeptes le cours réel du devenir. Porteur de réponsesrituelles,-jeuxstructurésdela mortetdelaviolence-,àdesinterrogationssubconscientes -toute-puissanceetimmortalité-,quisontcellesdelaconditionhumaine,lesportsefaitanhistorique, volonté de mettre l'histoire entre parenthèses, c'est-à-dire de maîtriser dans l'éternel retour de son symbolisme ce que l'événement réel a d'agressif. On rejoue, pour les dédramatiser, les drames profondsdel'humanité,maisenleurdonnantuneformestylisée,laformulerituelledelacompétition. Celasefaithorsdutemps,donchorsdelasociété,enaffirmantdesvaleurshéroïquesqu’iln'estplus possibled'yréaliser,doncfinalementcontreunétatdelasociétéjugéprosaïque.
14 Genèse,XXII,25-32.
15 De ce point de vue, les analyses un peu provocatrices de Sport, Culture et Répression, seraient justifiées, n’était leur réduction de l’histoireàsonseulprésent,l’oublidespesanteursdupassé.
16 Cen’estévidemmentpasparhasardquelesdeuxsophistessontprésentés,dansl’Euthydème dePlaton,commedessportifs reconvertis.
Refletouparenthèse?Ilnepeutpasnepasêtreunrefletdessociétésqu'iltraverse.Ilnepeutpas non plus ne pas désirer êtreune parenthèse rassurante. Reflet négatif alors ? Il y a quelque chose de cela.Maisilnetardepas,larécupérationétantinévitable,àêtreunesociétécontredite17 . A la fois reflet et parenthèse, il se développe dialectiquement. Se constituant en permanence contreletemps,ilétablitcependantpeuàpeu,avecletemps,desstructurescumulativesd'expériences historiques stylisées. C'est dans les modèles interpénétrés de ce passé que le présent sportif d'une sociétévients'introduireets'intégrer.
Étantdonnécettesituationcomplexeetparadoxale,maisquifaittoutelarichessedusport,ilfaut doncs'attendreàdécouvrir,sil'ons'engagedanscettevoie: lafossilisationd'expérienceshistoriques,samatérialisationdanslesstructuresd'originerituelle: magie,totémisme,animisme,etc... lastratificationdecesritesenmodèlessuccessifsdecomportementintégréslesunsauxautreset dont la continuité des uns par rapport aux autres obéit à une certaine logique qui n'est autre que l'histoiredusport; lasurvivance émotionnelle decesarchétypes,les sentimentsétantassociés auxstructuresdu rite compétitif;
une rationalisation de ces structures dont la logique se met àévoluer de façon indépendante,dès quel'oublidesvaleursprimitivescommenceàs'installer,d'oùuneligned'évolutionallantdansle sensdufonctionneletdel'abstraction.
Cette subsistance d'une relative sacralisation du sport jusqu'à nos jours n'étonnera pas outre mesurelessportifsetcertainss'ensontdéjàavisés.« Le monde des sportifs reste sensible à un certain mystère »,écritMichelClare.18 Elle surprendra encore moins l'historien des religions. Mircéa Eliade témoigne en ce sens:« on pourrait montrer... que les festivités etles réjouissances d'une société religieuse, ou prétendues telles, les cérémonies publiques, les spectacles, les compétitions sportives... tout ceci garde encore la structure des symboles, des rites et des mythes, bien que dépourvus du contenu religieux ».19
Ceseraitmalgrétoutfairepreuved'unoptimismeexagéréquedes'imaginerquel'intégrationdes élémentsdiversprovenantdessourceshistoriques successivess'effectuetoujoursdefaçonheureuse, harmonieuse et facile. Ces éléments sont hétérogènes. Certains télescopages se produisent. De plus, desvisionsdumondecontradictoirespeuvent refléterleursoppositionsdans lesport.C'est pourquoi desmodèlesincompatiblesrésistentàlarationalisationunificatrice,perpétuentdansl'histoiredusport leurs conflits. Les anomalies qu'engendre leur coexistence sont révélatrices des divergences profondesdanslafaçondeconcevoirlesportet,parvoiedeconséquence,danslafaçondeconcevoir lavie.
Lecasleplusflagrantetceluidel'actuelledualitédesstructuresauniveauleplusélevé.Onpeut lamettreenévidenceparletableausuivant:
ChampionnatsduMonde
JeuxOlympiques épreuvesunisports épreuvesomnisports professionnalismeaccepté amateurismeexigé inspirationindustrielle,divisiondutravail, rendement… nostalgied’uneantiquitéidéalisée,bien qu’esclavagiste valeur:passionsportivepourunediscipline particulière valeur:éducationparle sport confréried’initiés championsjuxtaposés
17 C’estcequenousavonsessayédemontrerdansl’article La contre-société sportive et ses contradictions.Esprit.1973.n°10.
18 MichelClare. Introduction au sport.Leséditionsouvrières.p.1965
19 Eliade. Initiation, rites, sociétés secrètes. Idées/Gallimard.1959.p.269.
dirigeantsélus
dirigeantscooptés solidaritéverticaledela pyramidesportive solidaritéhorizontale
autoritémontante:pouvoirvenantenprincipe despopulationssportiveselles-mêmesparune suited’électionsencascade
disciplinesexemplaires:sportsdeballese jouantenéquipe
autoritédescendante,lesathlètesn’ayantaucun pouvoir
disciplinesdominantes:cellesoùprévalentla performanceetl’effortindividuels,athlétisme, natation
Mais la contradiction la plus fondamentale se situe sans doute dans l'opposition entre sportpassion et sport-éducation, opposition dont on verra plus loin les origines et qui se perpétue de nos jours dans l’incompréhension mutuelle du sport éducatif et du sport civil. Elle vient de loin. C'est PlatoncontrePindare.Elleatraversél'histoire.Cesontlesjeuxtraditionnelscontrelespouvoirs.Elle expliquebiendesmalentendusetdesconfusionsdusportmoderne.
Nous essayons de saisir le sport à la limite socio-culturelle de ses origines. Préalablement il convient d'indiquer les critères qui permettront de reconnaître comme préfigurations sportives les manifestationsrituellessurlesquellesnousseronsamenésàfaireporterl'analyse
Nousretiendrons,enpremièreapproximation,lessignessuivants:
1)engagementphysiqueavecopposition;
2)règlelibrementdéfinieetacceptéeàl'avanceparlesdeuxadversaires;
3)incertitudedurésultat;
4)absenced'obligationd'undéfilancéetrelevéparseulsoucideprestige.
Cessignes,certainement,n'épuisentpaslanaturedusport.Mais,armésdecescritères,nousallons pouvoirdécouvrirparmilesmythesetlesrituelsarchaïquesd'indispensablespréfigurationssportives, commenousavonsdéjàeul'occasiondelefaireàproposdetextesdel'EpopéedeGilgameshetdela Genèse.
Par-là,nousconstaterons sansdoutequelesoriginesdusportsonteffectivementàrechercherdu côtédelapenséemythique.Lesport,nousnecesseronsdeleredire,estunrituel.
Mais nous découvrirons en même temps que ces préfigurations sportives font référence à des valeurs,àuneorganisationsociale,àuntypedeculture.
Système régulateur, le rite sportif contrôle l'entrée de la société, en insérant dans le scénario initiatique, la sortie hors de cette société, en tant que cérémonie funéraire, et la reproduction de la lignéeroyale,parsavaleurhiérogamique.
Systèmedepensée,ilimpliquel'adhésionàuneconceptioncycliquedutemps.Ilinstalledansun espace ludique, lieu sacré où s'abolit magiquement le temps historique. Le sport ne cesse de re"produire"lemonde.
Système juridique, il suppose que la nature -dans une sorte de jugement de dieu- dit obligatoirementlavéritésurlesvertusoupouvoirssurnaturelsduchampion.Ilinviteàs'enremettre, comme à un arbitrage supérieur et sans appel, à l'épreuve qui révèle celui qui incarne la force cosmique: quelemeilleurgagne!
Systèmereligieuxenfin,loind'établirunecoupureradicaleentrecemondeet"l’autremonde",il laisse entendre que tout fonctionne par échange de substances dans un univers fermé et que, par conséquent, la faveur du ciel - régularité des saisons, pluie, récolte et vie de la société - ne s'obtient que contre un sacrifice, éventuellement humain. On est sous l'influence du totémisme et des rites agraires.
Cettepremièrepartiecomporteracinqchapitres:
Chapitre1. La structure sportive du sacrifice.
Chapitre2. Mort et violence initiatique.
Chapitre3. Un rituel funéraire
Chapitre4. Un rituel hiérogamique
Chapitre5. L'ordalie ou le cercle du (bon) droit
Lastructuresportivedusacrifice.
Danslecasdefiguredusport,lastructuredusacrifices'affineetse dédouble.
Aux origines du sport, on remarque indiscutablement non pas la préparation à la chasse ou à la guerre, hypothèse qui n'est que la projection de nos préjugés éducatifs selon lesquels tout savoir provientd'uneécole,maislesvestigesdusacrificehumain.
On peut y voir une allusion très nette dans un épisode fugitif des jeux célébrés en l'honneur de Patrocle, dans l'Iliade lorsque s'affrontent, armes en mains, dans un combat à outrance Ajax et Diomède. 20 La formule est archaïsante et contraste fortement avec le contexte sportif où les autres épreuves affectent une alluredéjà presque moderne. On demande des volontaires. Il ne s'agit pasde luttesimulée.Onirajusqu'aumomentoùlefertraverseralacuirasseetverseralesang.Deuxhommes selèventaussitôt.
Comme cela fait partie d'un ensemble de jeux funéraires, il est permis de penser qu'un rite aussi cruelreprésentel'élémentleplusancien,qu'ilvienticiàsaplace,carsonintroductionestinévitable, momentcrucialdelafête primitive.S'ilnes'imposaitpasparla forcedesonpassé,oncomprendrait malsaprésencequijuretout-à-faitaveclescompétitionsquil'accompagnent.
Mais le décalage historique entre cette épreuve anachronique et la suite des jeux où elle vient s'insérer est déjà sensible à l'époque homérique. On ne peut pas empêcher l'appel des concurrents pourcetteépreuve.Celafaitpartiedudéroulementmoraldelacérémoniepost-funéraire.Maisonne peut pas non plus supporter le spectacle. Effrayés, les spectateurs réclament qu'on interrompe le combat.Autrementdit,leriteesttransmismaisn'estpluscompris.
L'originesacrificielleestnetteégalementdansl'institutiondelagladiature.LesRomainsl'auraient empruntéeauxÉtrusquesdirectementouindirectement21.Ceux-cil'auraienthéritédesGrecs.Unpeu gênés, et on les comprend, les anciens voyaient dans l'invention de la gladiature un adoucissement desmœursprimitives.Autrefois,lesvictimesétaientsacrifiéessansappel.Maintenantonleurdonnait une chance sur deux de s'en sortir. L'argumentation est évidemment spécieuse. Sur la voie d'aussi bonssentiments,ilétaitencoreplussimpledeleurdonnerdeuxchancessurdeux.
Lavéritéestprobablementtoutlecontraire.Aupointdedépart,lecombatenarmesestunscénario mythique, une histoire qu'on joue, une obligation religieuse à laquelle on ne peut se soustraire, une réalitéprofondeàlaquelleonparticipevolontairement,etpeut-êtremêmedeboncœur.C'estunculte héroïque,lehérosétantjustementunmortimmortalisé,telHerculesursonbûcher.
Chacun des deux adversaires représente pour l'autre le génie de la mort. Celui qui gagne a remportéunevictoiresurlamort.Celuiquiperdesthéroïséparsonsacrifice.
Plus tard, l'inégale répartition des richesses résultant de l'éclatement du régime clanique, on assisteraàlasurenchèrelorsdesfunérailles.Lamultiplicationdesvictimessuruneamplificationdu rite,maislasignificationneserapluslamême:ons'acquitteaveclesangdesautres.Plustardencore, ladégradationdesfonctionsprimitivesduritesepoursuivant,onneretiendraplusquelegoûtmorbide du spectacle de la mort des autres. La Grèce saura se préserver d'une telle déchéance, le sport étant un substitut symbolique suffisant du rite funéraire sacrificiel pour satisfaire aux obsessions de l'inconscient collectif. Mais la civilisation romaine y succombera. Un tel spectacle deviendra même unmoyendegouvernement.Et,pourl'alimenter,oninstalleradesécolesdegladiateurs.
20.Homère. Iliade. ChantXXIII
21.JacquesHeurgon. La vie quotidienne chez les Étrusques.Hachette.1961Pointp262-264.
Cette origine sacrificielle du sport trouve encore des échos dans la littérature médiévale. Le combat du Morholt et de Tristan, dans la légende de Tristan et Iseult, rappelle étrangement les circonstancesducombatdeTaurusetdeThésée.IlsuffitdecompareraveclesrécitsdePlutarque.22 MaisilyaaussilesecondgéantterrassébeaucoupplustardparTristan,Beliagogàlamassueenbois d'ébène23 dont la soumission rapide et totale et la réconciliation étonnante avec notre héros qui l’a pourtant, sans raison sérieuse, agressé physiquement avecune brutalité sauvage etdépossédéde ses biens,faitsongeràlasituationdurexnemorensisdeFrazerqu'onpouvaitassaillirenpermanenceou aucurieuxépisodedel'épopéedeGilgameshoùl'onvoitHumbaba,préalablementtuéparGilgamesh etEnkidu,partagertranquillementsonrepasaveceux.24.Etilyaencore,chezChrétiendeTroyeset ses continuateurs, des chevaliers qui se cherchent pour s'immoler joyeusement, comme Guiromelan etGauvinparexemple.25
La donnée positive dans cette organisation pré-sportive du sacrifice humain positive du moins à une époque déterminée où elle peut être considérée comme un progrès de civilisation, mais certainement pas à une époque plus tardive où la dégradation du rite rend manifeste un état de décadence sociale et morale, c'est la part active prise par l'individu dans le sacrifice. Si la victime, dansunecertainemesure,tientsondestinen mains,sipar ailleursle mort, parla dignité desamort, peutêtrehéroïsé,c'est-à-direrenduimmortel,celasignifiequelasociéténevitplussimplementdans lecadrereligieuxdereprésentationsoùtoutreposesurunecirculationanonymedesénergies.Quelque choseéchappeaucycleetdemeure,lapersonnehéroïque.Lerêved'uneombre,diraPindare.26
Autrementdit,enprenantlaformed'unduel,lastructuredusacrifices'affineetsedédouble.Sous lethèmedel'éternelretourtransparaîtdéjàl'idéedesalut.
Pour mesurer la différence, on peut prendre comme point de comparaison le raffinement du sacrifice humain chez les Aztèques. Avec l'accord de peuples voisins, des guerres étaient périodiquement organisées afin de se procurer des prisonniers destinés aux sacrifices. Parmi ces prisonniers, on en choisissait un, disent les auteurs espagnols, sans défaut physique: Il incarnait le dieu, on le faisait vivre une année dans le luxe, puis, vingt jours avant la fête, on lui amenait quatre femmes parmi les plus belles, et enfin, le jour venu, avec un couteau de pierre, on lui a arrachait le cœurqu'onoffraitausoleil27 .
Dans cet exemple, la procédure est linéaire, fatale, sans surprise, inévitable. On ne peut rien changer,onnepeutrienespérer.Ils'ytrouvedesélémentsquenousverronsapparaîtreaussidansles préfigurations sportives. Le hiéros gamos, mariage symbolique du ciel, incarné par le héros ou la victime, et de la terre, ici signifié par quatre femmes, les 4 directions de l'espace. Mais l'attitude du protagonisteestpassive.
Ilestvraiquedanscetexemple,particulièrementinstructif,leraffinementvajusqu'àorganiserla guerrepoursefournirdesvictimesqu'onpourraitfortbiendésignersurplace.Ilyadoncunmoment de liberté où chacun tient son sort entre ses mains. Mais cela traduit surtout un insuffisant développementdelasociétédeclasses,carautrementlesprisonniersseraienttransformésenesclaves producteurs.
Iln'endemeurepasmoinsqu'onalàunestructuredesacrificequichezlesaztèquesestàlalimite entre le sacrifice à victime désignée sur place où tout est fatal 28, l'épreuve de la gladiature qu'ils
22. Tristan et Iseult,livredepoche,1972.p.11à17.Plutarque, Les vies des hommes illustres,ViedeThésée,Pléiade,p..166
23 Tristan et Iseult,op.cit.p.225-235
24.Contenau. Epopée de Gilgamesh.op.Cit.p.46,48,102,120.Humbabaestaussiunroidelaforêt:ilrègnesurlaforêtdecèdres.
25. Continuation de Perceval,manuscritdeMons
26.Pindare.
27.D'aprèsTokarev, La religion dans l'histoire des peuples du monde.Moscou,1965,page267,(enrusse).VoiraussiJ.Eric Thompson, La civilisation aztèque,Payot,1934,p.159-162.
28.Thompson,op.cit.p.145:"unefemmequipersonnifieladéesseestimmoléeàlafindescérémonies...onselivreà desjeuxspéciauxetàdesbouffonneriesenprésencedecettefemmequiignorequ'ellevaêtresacrifiée."
connaissentaussimaissouslaformed'uneparodiecruelle29 etlejeudeballe oùlecapitaineperdant peutêtresacrifié30
Onpeutdoncmaintenantproposerleschémasuivant:
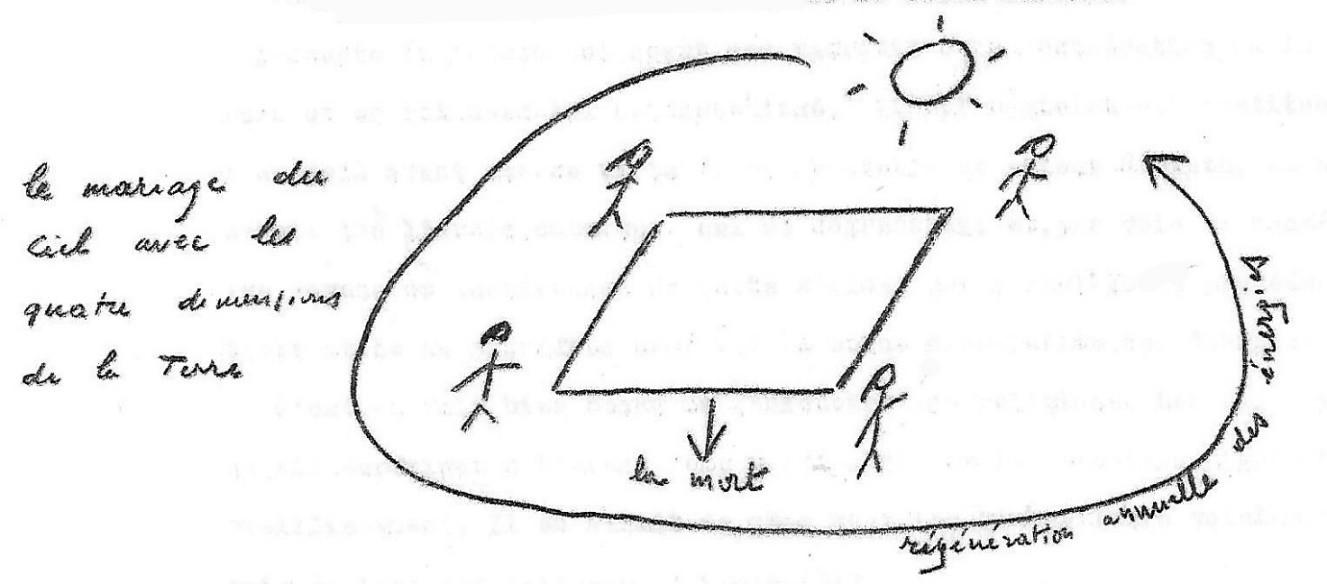
etlecompareraveclastructuresportivedusacrifice:
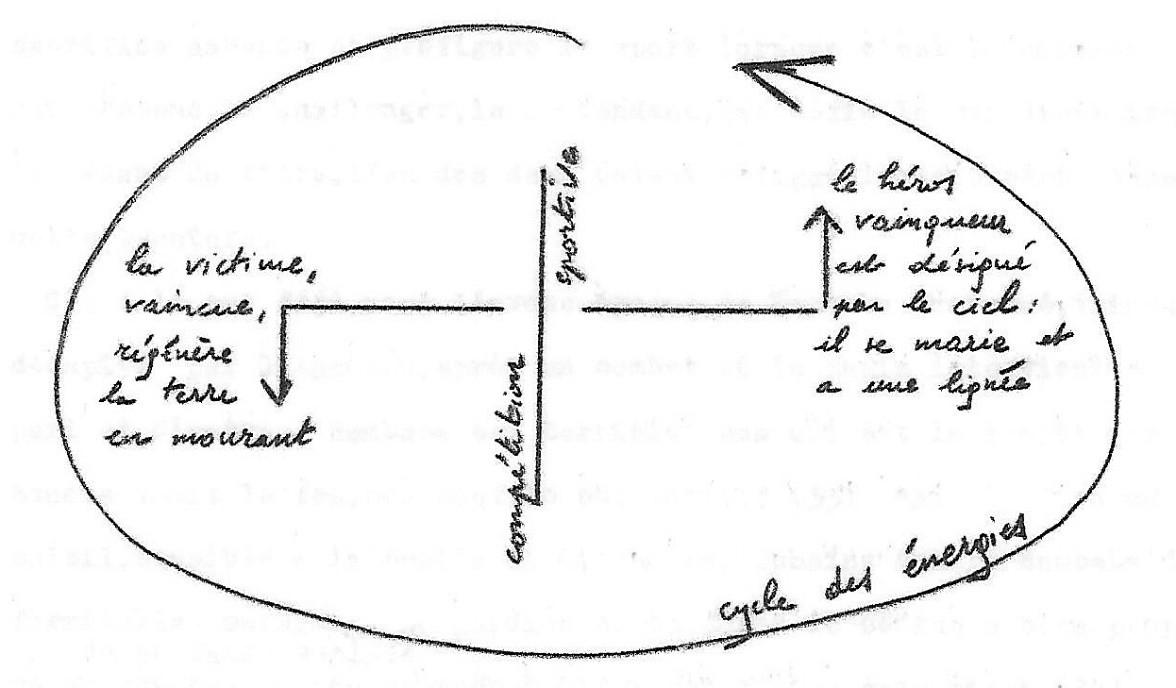
Dans les deux cas, le roi ancien dont les pouvoirs sont affaiblis et qui représente la saison qui meurt est sacrifié à la régénération de la nature et un roi neuf lui est substitué. Le roi magicien est restitué à l'au-delà avant que sa vertu et ses pouvoirs ne soient éteints, sinon ce serait tout l'ordre cosmique qui se dégraderait et, par voiede conséquence, lesmoyens de subsistancede cette société quianégligédeprocéderentempsutileausacrificepropreàlabonnecirculationdesénergies. C'estunfaitbienconnudel'histoiredesreligions.LesChilloukisduNilSupérieurmettaientleur roiàmortdèslespremierssignesdevieillissement.IlenallaitdemêmechezlesDinkas,leursvoisins, oùlesroisétaientdesfaiseursdepluie31
29. op. cit.p.137,138,139,147;lesconditionsducombat,armesfactices,enchaînementdesvictimes,sontfaussées,cequifait pensertoutàlafoisàcertainescérémoniesétrusquesetauxaberrationsromaines.
30. op. cit.p.163,178-180.VoiraussiMireilleSimoni-Abbat, Les Aztèques,Letempsquicourt,1976,p62-65
31.Fraser. The Golden Bough.CitéparTokarev, op.cit.p.175.
On conçoit que l'honneur d'être roi n'était guère enviable dans ces conditions. Et Freud semble approuver l'hypothèse de Frazer : les premiers rois des tribus latines auraient été des étrangers qui jouaientlerôled'unedivinitéetétaientsacrifiéscommetellesolennellement32.OnavulesAztèques prendredesprisonnierspourvictimes.
Maistoutdevientqualitativementdifférentetlastructuredusacrificeannonceetpréfigurelesport lorsquec'estlenouveauroiprésumé,lechallenger,leprétendant,quidéfieleroivieillissant,letenant dutitre,l'undesdeuxdevantobligatoirementpérirdanscetteaventure.
C'est le cas déjà, nous l'avons évoqué, de Humbaba provoqué, vaincu, décapité par Gilgamesh, aprèsuncombatoùlamagieintervientdepartetd'autre.Humbabaestterrible:soncriestlatempête, sa bouche vomit le feu, son souffle est mortel!33. Mais le dieu du soleil, sensible à la prière de Gilgamesh, déchaîne contre Humbaba de formidables ouragans. Le gardien de la forêt de cèdres a beauproposerdeserendreetdesefaireesclave.EnkidudemandeàGilgameshd'êtresanspitié 34
C'est le cas sans doute, nous l'avons évoqué également, de ce Rex Nemorensis dont l'exemple a servi à Frazer comme hypothèse de travail. Il s'agit d'une coutume étrange conservée jusqu'au II° siècle de notre ère. Ce curieux roi pouvait tuer (ou être tué par) celui qui voulait prendre sa place. Pouravoirledroitaucombat,leprétendantdevait,enentrantdanslebosquetsacré,arracherdel'arbre lerameaud'or,aprèsquoiilpouvaitassaillirleroidelaforêtetlefrapperdesonglaive.
Survivance rituelle, il n'y avait guère que des esclaves en fuite pour prétendre à cette périlleuse dignité.Leroientitredevait eneffetmonterlagardenuit etjourautourdesonarbrepourconserver savie.
Maislasignificationoriginelleestassezapparente.Labranched'arbresymbolisel'âme,laviedu roi gardien. Tout se joue entre deux vies. Le vainqueur est le double vivant, actuel, de la forêt et l'autre,levaincu,estlavictimeimmoléeàlarégénérationdelavégétation.35
C'estlecascertainementdePélopsaffrontantOïnomaos.Ils'agitdumytherapportéparPindare36 La lutte à mort entre le gendre et le beau-père n'aurait pas d'explication suffisante s'il était question seulement de la main d'Hippodamie. En fait, ce qui joue, c'est la royauté. On est en pleine ordalie. L'histoire du Cid n'est qu'un pâle souvenir du meurtre du beau-père, à des fins successorales, quand le pouvoir se transmettait par mariage avec la fille du roi et que le mariage avec la fille du roi ne s'obtenaitqu'enéliminantletenantdutitre.
Toutes ces situations, fictives mais révélatrices de certains états de fait, correspondent évidemment à une période déterminée dans le développement social. On vit dans un système qu'on pourrait qualifier de démocratie militaire et qui est antérieur au renforcement du pouvoir des chefs. À ce stade, les rois sont responsables sur leur tête de l'état de la société. Ils ne seront despotes qu’à l'étapesuivante.
Mais d'autres exemples pourraient encore venir souligner la relation du sport et du sacrifice. Le plus connu est sans doute celui d'Atalante. Elle ne devait se marier qu'avec le prétendant qui la vaincrait à la course. Mais le prétendant vaincu y laissaitla vie37. La difficulté, dans l'interprétation de cette dernière légende, c'est que le prétendant ne se heurte pas à un roi en place mais qu'il a une femme pour adversaire sportif. Des données ethnographiques pourraient nous donner à penser qu'il s'agitd'unétatencoreplusanciendelasociété.Nousenreparleronsàproposdeshiérogamies. Unechoseentoutcasnesemblepasdouteuse,c'estlastructuresportive,lacompétition,appliquée àunsacrificehumain.Gilgameshtranchelatêted'Humbaba.Oïnomaosvoulaitconstruireuntemple aveclescrânesdesprétendantsdesafilleetAtalantefaisaitexécutersesamoureuxvaincus.Lutteou course,leperdantétaitmisàmort.
32.Freud. Totem et Tabou.Payot.p.173
33.Contenau, op.cit.p.87,103-104.
34.Contenau, op.cit.p.87,103-104.
35.Frazer, The Golden Bough,citéparTokarev, op. cit.p.175.
36.Pindare. Première olympique
37.Ovide. Métamorphoses.LivreX,570-680.
Unritueldesocialisation.
L'idéedesacrificefaittoutletragiquedesritesd'initiation,mêmes'ilserévèlepourl’initié,après coup,quelaviolenceetlamortn'étaientqu'apparentes,symboliques.
Dans les civilisations primitives ou traditionnelles, l'entrée dans la société des adultes, au terme de l'adolescence, passe par l'épreuve. On sacrifie l'enfant pour que naisse l'adulte. Telle est l'idée centraleautourdelaquellechaquerituelbrodesessymbolismesparticulierssuivantlesethnies.
C'est une mort qui initie. C'est un commencement. Et le fait qu'on doive ainsi commencer par la mort,mêmesymbolique,nousdonnedéjààréfléchir.Onestinstalléàl'intérieurd'uncycle.Toutdoit secompenser.Unevieexigeunemort.Unemortapporteunevie.
Mais pour nous, initiation ne signifie plus seulement entrée. Elle a pris aussi, par un glissement de sens qui correspondait à la réalité deschoses, lasignification d'enseignement sacré. Lanaissance socialen'est pas simplement laconsécration d'une évolution biologiquedel'individu désormais apte auxactesdeproductionetdereproductionqu'onattenddelui.C'estsurtoutlaconnaissanceofficielle dustatutculturel,religieux,deschosesetdesêtres.
Dans tout cela, la structure sportive n'est pas obligatoire. Du moins la compétition, plus exactement,n'est-ellepasindispensable.Onsecontentedel'épreuve,dupassagedifficile.
Souvent d'ailleurs le scénario initiatique renverrait plutôt au scénario du film policier avec un héros insulté, séduit, qu'on tente d'acheter, attaqué dans un guet-apens, volé parfois, compatissant malgré tout, et enfin dominant sa peur dans une poursuite effroyable. C'est exactement ce qu'imposeTchangTao-LingàsondiscipleLiéou,selonKaltenmark:«1° Avant de l'admettre auprès de lui, il le laisse attendre quarante jours en le faisant accabler d'injures, 2° Il envoie une jolie fille pour le séduire, 3° Il le tente avec un trésor trouvé par hasard sur son chemin, 4° Il le fait attaquer par des tigres en pleine forêt, 5° Liéou doit subir sans sourciller les duperies d' un marchand malhonnête, 6° Liéou va jusqu'à se dévêtir pour habiller un mendiant, 7° Epreuve décisive, Tchang lui demande de cueillir des pêches sur un arbre surplombant un gouffre effroyable. Liéou surmonte le vertige ; puis comme Tchang se précipite dans l'abîme, il le suit et retrouve le maître qui lui révèle les secrets ultimes du Tao38.»
Ici en effet, le héros est à l'épreuve. Mais pas de compétition. Pas de sport. Mais tous les ingrédientsd'unebonnesériepolicière.
Lesportpeutquandmêmeluiaussiavoirsapartdansl'initiation.Ilpeutapparaîtrecommel'acte ultime du scénario initiatique. Il peut constituer la dernière épreuve, celle qui fait la preuve de toute l'énergieaccumuléependantletempsderéclusion.
L'épisode de la lutte dans l'Epopée de Gilgamesh mérite à cet égard de retenir l'attention. On y retiendrad'embléedeuxfaitsessentiels:
1)Enkidudévastelesplantationsetdéjouelespiègesdeschasseurs,
2) Enkidu, l'homme sauvage, après avoir été capturé, l'emporte sur Gilgamesh le roi en combat singulierdansuneépreuvedeluttesansdouterituelle39 .
S'agirait-il de la description d'un paléolithique attardé solidaire du groupe animal avec lequel il pratiquelachasseencommun?Ilyapeut-êtredanslagenèsecompositedecesrécitsl'écholointain d'unheurtdouloureuxdescivilisationsetdescoutumes.
38.MaxKaltenmark. Le Taoïsme religieux.Dans"HistoiredesReligions"tome1.EncyclopédiedelaPléiade.p.1234.
39.Contenau, op. cit. p.67et83-84.
S'agirait-il d'un Mowgli préhistorique recueilli par les habitants de la forêt? Ce serait renverser la perspective. Le cas des enfants sauvages n'est que l'occasion de redécouvrir un mythe ancien, primitif,essentiel, le retourà la nature, supposée bienveillante etvivifiante avant de réintégrer,neuf etfort,lasociétéquiimposecetempsd'épreuve.
Il s'agit très vraisemblablement de l'élaboration très littéraire d'un rite archaïque d'initiation: Enkidu,tout seuldansla forêt,vivraitsontempsderéclusiondeséparation. Il luiserait demandéde faire ses preuves, de vérifier ses aptitudes à la survie, à la vie adulte autonome. On lui donnerait l’occasionaussid'apprendreparexpériencecombienlaviesauvageestinhumaine,combienlaviede groupe lui est préférable. Mais surtout, la nature étant ici perçue comme l'au-delà de la culture, il serait invité, selon les usages du clan, à aller dans cet au-delà se ressourcer aux forces premières de lanature,c'est-à-direenpleinsurnaturelpouryacquérirunevertucosmique.
Une telle interprétation serait attestée par des conduites qui survivront ailleurs très tardivement. En Arcadie, par exemple, celui qui goûtait à la chair humaine, des chairs d'enfant mêlées à de la viande, passait pour devenir un homme-loup. Il traversait une rivière à la nage - l'eau est un des symboles de la puissance - et s'en allait vivre neuf ans dans la montagne; la dixième année, revenu homme,ilrevenaitpossesseurd'uneforceneuve. Dumoinslepensait-on,carla légenderapporte,et cela nous réintroduit en plein cœur de notre propos, que l'un d'entre eux avait, sitôt son retour, triomphéauxjeuxolympiques.40
S'ilenestainsi,l'épreuvesportivepourraitréapparaître,danslecasdelalutterituelle,maisaussi de façon beaucoup plus générale, comme l'émanation et même l'aboutissement logiquede la longue épreuve initiatique. Ce serait l'instant de vérité, l'ultime obstacle à surmonter. On se doit de faire la preuvedesavertucosmique.Onsedoitdedémontrersapuissancesurnaturelle.Etlarécompense,le prix,l'enjeu,c'estunesecondenaissance,nonplusnaissanceàlavie,maisnaissanceàlasociété.En somme, on pénètre alors en force dans le cercle des adultes. Il est tout-à-fait significatif que ce soit Enkidu, l'hommesauvage, le méchant, qui l'emporte sur Gilgamesh, le roi. Et il est peut-être encore plussignificatifquetoutlemondes’accommodedecerésultat,peuconformepourtantàlahiérarchie, àcommencerparlesdeuxantagonistesquideviennentaussitôtdesamis.
Ce qu'il y a de remarquable également dans ce rite qui contrôle l'entrée de la société, c'est sa fonctiondeparadoxalemaisefficaceinitiationaudroit.Cen'estpasseulementunnécessaireexamen depassage,jadisréeldansunesociétésoucieusepoursurvivrederesterenéquilibreécologiqueavec lemilieu,c'est-à-direderespecterunedémographieconstante.C'estaussiunesolideetdernièreleçon. C'estl'apprentissagedelaloiparl'usagedelaviolence.Procédureparadoxale,onseréunittoutexprès pour s'opposer! Mais combien efficace: l'adversairese révèle l'indispensable partenaire. Le contact estplutôtrude.Maislacommunicationestimmédiate.
Le combat d'Enkidu n'a donc rien d'une rixe vulgaire. Il est l'illustration parfaite de l'ultime moment d'un rite initiatique. C'est un passage, le passage physiquement joué dans la lutte, métaphysique jouée par le rite compétitif, du particulier à l'universel, du naturel au culturel, de la passion à la raison. L'adolescent est avant l'épreuve. L'adulte est né. On lui donne un nom nouveau. C'estuneprocéduredesocialisation.
Au fond, cette forme archaïque du sport qu'est la lutte rituelle relèverait d'une psychanalyse sociale assez raffinée. C'est d'abord un appel au jugement sans appel de la puissance impersonnelle des choses, une confrontation sans merci devant la loi absolue d'une nature remplie de pouvoirs surnaturels.Leplusfortsportivementestproclaméleplusdivin,leplusvertueux,danslecadred'une croyance générale à un cosmos bien organisé où tout setient. Et, enmême temps, deuxième donnée essentielledeceritepré-sportif,lefaitpourlesprotagonistesd'êtred'accordpoursebattre,implique unereconnaissancedel'adversairecommeégalendignité:onnesebatpascontreunmédiocre. On mesure maintenant toute la ruse de la raison qui préside au combat rituel initiatique. Cette préfigurationsportivepermetd'effectuerlepassagedel'affirmationdesoi,delavolontédepuissance individuelle,àl'actedereconnaissanced'unepluralitéd'individuslibresetégaux,libresparcequele
40. Francis Vian. La religion grecque à l'époque archaïque et classique. Dans"Histoiredesreligions1". Encyclopédie dela Pléiade. 1970.p.536–537
défiqu'ilsselancent etqu'ils relèventn'estpasobligatoire,égaux parcequechacund'euxattachedu prixàvaincrel'autre,doncattacheduprixàl'autre.
Nous venons de montrer que l'initiation est liée à l'idée d'épreuve, que le sport n'y est pas forcément attaché, mais qu'il peut y avoir sa place. Certains seraient tentés d'aller plus loin et d'affirmerquelesjeuxdelaGrècedériventdesprobationsjuvéniles.
C'estl'hypothèsedeH.Jeanmaire41.Elleestexposéeet,semble-t-il,approuvéeparFrancisVian.42 On a généralement accordé aux jeux une origine funéraire parce qu'ils étaient effectivement en relationaveclacommémorationdesdéfunts.Maisdanscecas,ons'expliquemalunepériodicitédans lacélébrationquin'aaucunrapportavecleretourdesanniversaires.Deplus,oncommémorenonpas un roi ou un guerrier, mais, dans les grands jeux de la Grèce, un adolescent dépecé par son père : Pélops pour les jeux olympiques ou de jeunes enfants, Mélicerte et Opheltès pour les jeux isthmiqueset néméens. Si l'on sait que la Grèce préhistorique a possédé des rites d'adolescence, on peutenreconnaîtreicidiverssignes.Héraclèsauraitinstituélesjeuxolympiquesenl'honneurdeces jeunesgensmythiquesquesontlesCourètes.Apollon,aprèsavoirtuéledragon,estcontraintàl'exil, une mort temporaire. Les adolescents, enfin, sont censés renaître sous un nom nouveau, après une mortsimulée:or,danslesmythesdefondation,ArchémorosdevientOphéltèsetPalémonMélicerte. La théorie est fort séduisante. Elle contribue à éclairer le pouvoir de socialisation du sport. On rejouerait encore de nos jours un rite permanent d'initiation à la vie sociale, rite d'autant plus nécessaire à l'individu adulte que les sociétés impersonnelles d'aujourd'hui ne sont plus investies d'émotionssacrées.Parailleurs,elletrouveraitdes appuis danslaGenèse,nousl'avonsvu,oùJacob devient Israël à l'occasion d'une lutte rituelle. Euripide s'en ferait indirectement l'écho lorsque lui aussi, dans son Alexandros, parle de jeux funèbres, de substitution de noms, avec cette circonstance particulièrequ'Alexandros,aliasPâris,vientgagnerlesjeuxcommémorant sapropremort.
Cependant, elle ne semble pas pouvoir s'imposer comme unique explication. Dans l'Epopée de Gilgamesh, elle convient pour le combat d'Enkidu et de Gilgamesh, pas pour celui de Gilgamesh contre Humbaba. Et en Grèce, les jeux de l'Iliade sont quand même bien funéraires et ceux de l’Odyssée depuredistractionouhiérogamiques.
41. H. Jeanmaire. Couroï et Courètes. Essai sur l'éducation spartiate et sur les rites d'adolescence dans l'antiquité hellénique. Lille. 1939.
42.FrancisVian,op.cit.p.541-542.
Unrituelfunéraire.
(Se)jouer(de)lamort.L’imiter,laparodier,latromper.
C'estunfaitquelapratiquesportivesetrouveliéeendenombreusesoccasionsàdescérémonies funéraires.Homèreévoquelesfunéraillesd'ŒdipeàThèbes,lesjeuxqu'onydonnaetTalaosquifut vainqueur,encettecirconstance,detouslesfilsdeCadmos.43 Ilévoqueégalementlesfunéraillesdu puissantAmarynkéeàBouprasion.Nestoryparticipait ets'ensouvientavecémotion.Lesfilsduroi défuntproposèrentdesprix.Iln'yavaitpaslàquelesÉpéens,maisencorelesPyliensetlesEtoliens. Nestor vainquit Clytomède à la boxe, Ankaï à la lutte, Iphiclos à la course, Phylée et Polydore au javelot. Il n'y a que la course des chevaux qui lui échappa, les jumeaux fils d'Actor s'étant divisé le travail, l'un tenant fermement les rênes, l'autre le fouet.44 Mais c'est pratiquement l'objet de tout le chant XXIII de l'Iliade que de décrire des jeux funèbres, ceux que donne Achille en l'honneur de Patrocle. Le repas mortuaire a déjà eu lieu. Partout, auprès du cadavre, coulait le sang des animaux tuésàceteffet.Mais,lanuit,lefantômedePatrocleapparaîtàAchille:ilréclamel'ultimecérémonie pournepluserrerenvainentrelemondedesvivantsauqueliln'appartientplusetlemondedesmorts qui le repousse. Alors, on brûle le cadavre et, en même temps que lui, des moutons, des bœufs, du miel et de l'huile, quatre chevaux, deux chiens parmi les neuf de Patrocle, égorgés, et douze nobles enfants troyens, puis, le feu ayant fait son œuvre toute la nuit, on éteint le bûcher avec le vin flamboyant,etenfincommencentlesjeux.
Mais la mythologie grecque a conservé le souvenir d'autres jeux funèbres. D’abord, ceux en l'honneur de Pélias, le tyran d'Iolcos auquel Jason, le chef des Argonautes, revint demander des comptes.Atalante,dit-on,yremportaleprixdelacourse,maisaussiceluidelalutteoùelleeutpour adversaire un homme, Pêlée, le futur père d'Achille. Selon d'autres informations, ce sont Calaïs et Zétès, les Boréades, qui gagnèrent la course. Ces jeunes gens seront d'ailleurs plus tard tués par Hercule,carc'estsurleurconseilquelesArgonautesavaientabandonnélehérosenMysie45.Ensuite, ceux en l'honneur du roi Cysicos tué par erreur par les Argonautes au cours d'un débarquement nocturneimprévu46 .
Beaucoupplusprèsdenous,SeanOSuilleabh’ain,unfolkloristeirlandais,rappellel'existencede jeuxfunèbresenIrlandeetilauraitassistélui-mêmeàcertainessurvivancesdanslepremierquartde notre XXe siècle. Il y voit même, comme enGrèce, l'origine profonde du sport47. On sait queJoyce déjàabordelaquestiondanssoncélèbre Ulysse48 .
Maislesjeuxsontaussidescommémorations.Plutarquenousdit« Minos, en mémoire de son fils Androgée, avait institué des fêtes et jeux de prix, là où il donnait à ceux qui y emportaient la victoire ces jeunes enfants athéniens.49 » Il est vrai que cet exemple pourrait être exploité pour illustrer les ritesd'adolescence.Desoncôté,Thucydidenousapprendquetouteslestroupesalliéesassistèrenten armes aux obsèques de Brasidas, que depuis on lui offre des sacrifices et que, chaque année, on organisedesjeuxpourhonorersamémoire50.Ilestvraiquecettefoisl'exempleappartientenpleinà l'époquehistoriqueetdonneraitpresquel'impressiond'unemystificationpolitiquedontpersonnen'est
43.Homère. Iliade.ChantXXIII.Vers680.
44. op.cit.ChantXXXIII.Vers630à640.
45.PierreGrimal. Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine 5eédition1976.PUF.p.354.
46.Grimal, op. cit.p.112.
47.SeanOSuilleabhain. Irish Wake Amusements.MercierPress.1967.2édi.1969.P.173-174.LelivreoriginalenIrlandais.
48.JamesJoyce. Ulysse.1922.
49.Plutarque. Vie de Thésée.XVIII.TraductionAmyot.Pléiade.
50.Thucydide. La guerre du Péloponnèse.V,11.
dupe: on voudrait bien ressusciter le passé ou, du moins, profiter du prestige des usages passé pour renforcer le courage militaire. L'ethnologie, en revanche, fournit des documents en ce sens. Uno Harvaaffirmeque« des courses et des concours figuraient aussi dans les fêtes commémoratives des Turcs du Tourfan » Il ajoute:« nous retrouvons cette coutume, qui était déjà connue des anciens Grecs (IliadeXXXIII) chezles tribus caucasiennesoù elle est courante. 51 ».Mais,est-ilbesoind'aller si loin quand sous nos yeux on voit tant d'épreuves sportives organisées sous le patronage d'une personnalitédéfuntedusport,mémorial,coupe,challenge,etc.…?
Ilexisteunrapportplussubtiletquin'aguèreétésoulignéjusqu'ici,entrelesportetlamort,c'est lesymbolismequis'attacheaudécèssurvenantlorsdesjeuxfunèbres,ou,toutsimplement,lorsd'une compétitionsportive.AinsiPerséetueson grand-père Acrisius(,)d'un coupdedisque,lorsdesjeux donnéspourlesfunéraillesdePolydecte.Par-làs'accomplissaitunevieilleprédictioncontrelaquelle tant d'efforts avaient été accomplis envain: Danaéenfermée dans une tour, puis jetéeà la meravec son fils, etc ... Acrisius meurt devant le spectacle sportif donné pour la mort de Polydecte et rejoint donccedernierdansunmêmedestin.Accidentquecedisquedéviéparle vent? Ilfautplutôtyvoir lamaindudestin.IlétaitnormalquelepremierpersécuteurdeDanaé,sonproprepère,soitainsipuni solennellement par le ciel devant le cadavre du second persécuteur de Danaé, celui qui avait voulu lui faire violence, Polydecte, et surtout en présence du fils de sa fille, bien vivant et de surcroît victorieux52.Peuimportequelaversion faisantétat dePolydectesoitaberrante etqu'Acrisiusait été tué parPerséelors des funérailles du pèrede Teutamidès, roi deLarissa53, ildemeureque l'accident estunemanifestationdelajusticedivine.
Le cas de Persée semble d'ailleurs bien proche de celui de Pâris, rapporté au chapitre précédent, etqui,dansla présentationd'Euripide,vient- hasard,symbole ouvengeancesubtile? -remporterla victoire dans des jeux commémorant sa propre mort et prendre le dessus sur ses frères Deïphobe et Hector54
C'estdoncunsignedudestinquandlamortphysiqued'unspectateurcoïncideavecleritesportif funéraire. Cela peut prendre l'allured'une condamnation solennelle desdieux àl'égardde cette folie quiacruensonpouvoirdedétournerlecoursdéterminédesévénements,commepourAcrisius.Mais celapeut,aucontraire,manifesteravecautantdesolennité(,)latrèsgrandesagessedeceluiquivient terminer sa vie en harmonie avec cette mort jouée qu'est le sport. Nous avons au moins deux exemples, donnés parDiogèneLaërce. Il y a le cas du sage Chilon qui mourut aux jeux olympiques après avoir embrassé son fils, vainqueur au pugilat et que les spectateurs conduisirent au tombeau avecdegrandshonneurs55.IlyalecasdeThalès,nonmoinsconnupoursasagesse,etquimouruten regardantdesjeuxgymniques56 . Finalement,siimportantquepuisseêtreleriteinitiatique,avecsamortsimulée,danslaformation dusport,onseraitassezfondédesupposerquelerôledecontrôle,derégulationdurites'exerceaussi bien à la fin qu'au début de la vie sociale et que les jeux à caractère funéraire au même titre que les jeuxàcaractèreinitiatiquenesontquedesapplicationsparticulièresdesgrandescatégoriessportives. Si on ouvre Pausanias et si l'on révèle une à une, à travers ses dix livres, les allusions aux jeux funéraires,onyvoit,certes,laréférenceàlacélébrationdemortsquiontbienpuêtredesrenaissances, commelorsqu'ilparlepardeuxfoisdeMélicerte-Palémonàproposdesjeuxdel'Isthme57.Maisilest questionégalementdesjeuxdonnésàl'occasiondesfunéraillesd'Œdipe 58,dePatrocle 59,dePélias60 , quenousconnaissonsdéjà,maisencoredanslescérémoniesfunèbresenl'honneurd'Azanoùfigurent
51.UnoHarva. Les représentations religieuses des peuples altaïques NRF/Gallimard.1959.p.232
52.Pausanias. Description de la Grèce.II,16,2.
53.Grimal, op. cit.p.10,362,384.
54.Euripide.Alexandros.
55.DiogèneLaërce. Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres.Chilon.
56.DiogèneLaërce. op. cit Thalès
57.Pausanias, Description de la Grèce.I,XLIV,8etII,I,3
58.Pausanias, op. cit.I,XXVIII,7.
59.Pausanias.V,VIII,3.
60.Pausanias.V,XVIII,9.
descompétitionsathlétiquesetpeut-être,ditPausanias,hippiques61 etoù,paraît-il,ditlemêmeauteur, Apis,filsdeJason,incident decourse,futtuépar lechar d'Aetolus62.Il estquestionencoredesjeux donnés par Acaste en l'honneur de son père 63, des compétitions annuelles réservées au Spartiates devant les tombes de Pausanias, le général vainqueur à Platées, et de Léonidas 64, et des courses en armesappeléesEleuthéris,organiséesdevantl'auteldeZeus,roidelaliberté,etlestombesdessoldats mortsàPlatéesensebattantcontrelesPerses,cequileurvalutdesversélégiaquesdeSimonide65 .
Tout un symbolisme de la mort vient, sinon adoucir, du moins habiller sa cruauté et donner l'illusion qu'on maîtrise ses mécanismes, pour la rendre supportable. La mort est jouée, c'est-à-dire imitée,parodiée,trompée.
La mortimitée, c'est le sacrifice parsubstitution du jeu auréel. Une étrangehabitude pousseles hommesàmettreenscèneleursinfortunesetàtirerquelqueplaisirsubtil,-c'estlesentimenttragique - dans la sympathie qu'inspire le héros souffrant. Ce procédé a d'ailleurs un nom dans l'histoire de l'esthétique. Il s'appelle la catharsis. C'est la purification. Chacun se purifie de ce que la passion a nécessairement de personnel, d'individuel, en projetant cette passion sur une situation générale, commune à tous, donc universelle. Une telle passion n'est plus passion puisqu'elle se confond avec l'adhésionàlaconditionhumainevécuesurlemodedel'image.Parlamortimitée,l'hommeestguéri desafollepassiond'immortalité.Onjouetousensembleàmourir.
Lamortparodiée,c'estlamortpourrire.Onfaitsemblantdemourir.Onn'estpasmortvraiment. À l'issue de lacompétition, lavie est rendueau vaincu envue d'une compétition ultérieure. Il existe uncycledessaisonssportives,commeilexisteuncycledela vieetdelamort,unretouréterneldes situations. Autrement dit, le vaincu fait l'expérience de son immortalité pendant que le vainqueur expérimentesoninvulnérabilité.Partoutcetappareilsymbolique,onsemoquedelamortréelle.Ce n'est peut-être pas sans arrière-pensée qu'Euripide, l'ennemi du sport, présente un Hercule ivre, Herculelefondateurdesjeuxolympiques,allantprovoquerstupidementlegéniedelamort.
Lamortjouée,trompée,c'estlefaitdeluilaissercroirequ'elleauraunevictime,levaincu,offerte ensacrifice.Enfait,lesconcurrentsnesebattentpasl'uncontrel'autre,simplementhommeàhomme. Chacunreprésentepourl'autrelegéniedelamort.Ainsilevainqueurn'apaséchappéàlamort,mais avainculamort,cequilerendplusfortqu'elle,etlevaincu,outrequ'ilaservidevictimesubstituée, sedécouvreimmortel,puisquelamortnepeutpasmourir.
61.Pausanias.VIII,IV,5.
62.Pausanias,V,I,8.
63.Pausanias,III,XIV,1.
64.Pausanias,III,XIV,1.
65.Pausanias,XX,II,5.
Mariageetmeurtre:lamortetlepouvoirsontenbalance,unpartage.
A mi-distance entre la mort initiatique, la naissance sociale (,) et la mort physique, la sortie de l'individu hors de la société, il y a le mariage sacré. C'est un symbolisme compensatoire destiné à assurer sur le plan du sacré l'équilibre du nombre des vivants, un rapport constant entre les morts et les naissances, et la chose est évidemment d'importance dans les sociétés obligées de vivre à démographiestablepourrespecterl'écologiedumilieuquiassureleursubsistance.
Mais c'est aussi une procédure exceptionnelle. Ce n'est pas le mariage de tout le monde. L'hiérogamierelèvedu divin.Sonprincipe,c'est l'unionducieldelaterre. Lasociétéseconformeà l'ordrecosmiqueetassuresaprospéritématérielleenorganisantlesunionssurlemodèledelanature. Mais le couple princier jouant, imitant, symbolisant le mariage fondamental, essentiel, vital, du ciel et de la terre a pour fonction précisément de mettre en relation les unions terrestres, la reproduction de la population, avec l'union primordiale qui garantit le bon déroulement du cycle des événements etdeschoses.
C'est donc finalement toute une vision où se projette la société du monde qui s'exprime par là. Lorsque le mariage se décide en vertu d'un protocole sportif, la compétition, on devine l'hésitation entre le régime naissant du clan aristocratique - la compétition, c'est la victoire d'un homme - et le régimedéclinantduclanmatriarcal-épouserunefemme,c'estépouseruneterre,unpouvoir.
Ainsi, on n'est plus dans un matriarcat mais dans le patriarcat qui s'installe en matrilinéaire. On épousepouravoirledroitaupouvoiretpourobtenirunelignée.Lapossessiondelafemmesymbolise lapossessiondupouvoir.
Leprotocole sportif enmatièredemariage princiersignifieaussiquelesvaleurssocialement les plusappréciéesdanslemilieuconsidéré,cellesquipermettentdefaireunmariageremarquableetqui vont, par ce biais, faire office de sélection naturelle de l’aristocratie, sont des valeurs du courage physique.
Ce sont d'ailleurs des valeurs tout à fait nécessaires dans l'état des forces de production de ces sociétés.Oncomprendquel'ons'yreportespontanémentetqu'onacceptelaprocédurequilesmetle mieux en valeur pour la désignation du meilleur. Cela concerne au plus haut point l'aristocratie naissantequi ytrouvesonimagedemarque.Qu'onsesouviennedelaformuleméprisanted'Euryale àUlysserefusantdeparticiperàdesjeux:« Tu n'es pas un noble, mais un marchand66 !»Maiscela ne laisse pas indifférent les autres. Un gars musclé fait un compagnon solide et bien utile économiquementpouréleverunefamille.
Le rapprochement du sport et du mariage qui nous étonne à première vue a donc un fondement dans les choses et nous ne devons pas être trop surpris de trouver nombre de témoignages ethnologiques, mythologiqueset littéraires confirmant son existence, celle d’épreuvesimposées aux prétendants.
Robert Lowie nous dit que « les épreuves imposées aux prétendants jouent un rôle de premier plan dans le folklore indigène qui se plaît à dépeindre le héros surmontant les obstacles les plus extraordinaires »67.Ilrévèleque « parmi les Athapaskan méridionaux de la région du Mackenzie, il y avait des assauts de lutte entre rivaux, le plus fort étant autorisé à emmener la femme... » Et il
66.Homère. Odyssée.ChantVIII.Vers144-184.
67. Lowie. Traité de sociologie primitive.Payot. p.31.
ajoute: « On nous a signalé des pratiques analogues chez les Esquimaux de la côte occidentale de la baie d'Hudson.68 »
Mieux, Oreckine rapporte que chez les peuples esquimaux du Tchoukotka, « avant de conclure un mariage, les fiancés concouraient avec leur fiancée pour la force physique et la course. Une fille ne devenait la femme que d'un homme qui avait su la vaincre69. »
Un exemple à contrario nous est fourni parDumézil qui présentela légende Oubykh où le jeune mariépassesanuitdenoceàtireràl'arcsurleplafond;àsonépousevexée,legarçonexpliquequ'elle a beau être séduisante, il a dû l'épouser sans affronter pour elle des épreuves et aller voir de par le mondes'ilyavaitunhérosmeilleurquelui70
Il y aurait, semble-t-il, un premier niveau de l'hiérogamie sportive où l'homme a la femme pour adversaire.Lamythologieconfirmel'ethnologie. PindarerapportequePelée,lepèred'Achille, avait lutté avecThétys et l'avait prestement vaincue.71 Nous avons vu précédemment que cemême Pélée, lorsdesjeuxfunérairesdePélias,avaitétévaincuàlalutteparunejeunefille,Atalante!
Bien entendu, le prototype littéraire de ce genre d'hiérogamie est constitué par l'histoire célèbre de cette Atalante et de la course où le jeune Hippomène la vainquit par la ruse et non par la vitesse. Mais très curieusement on trouve encoreun écho dece comportement rituel chez Chaucer. Il y aun passage des Contes de Canterbury qui autrement serait inexplicable. C'est quand la jeune Mai, surprise par son mari en train de le tromper avec un jeune page sur un poirier, invente une invraisemblablehistoireselonlaquelleil faut,pourguérir lacécitéde son mari,qu'ellelutte avecun homme sur unarbre. Sans doute sommes-nous ici en pleine féerie puisque les dieux interviennent. Sansdouteaussil'atmosphèreest-elleauburlesqueetàlamisogynie.Maislecaractèreinsolited'une telle situation ne s'invente pas et ne peut que s'inspirer d'éléments de provenance plus lointaine qui ont été détournés de leur signification première. On notera, en tout cas, deux points où l'on rejoint l'histoired'Atalante,d'abordlajoutesportivedel'hommeetdelafemme,ensuitelaprésencedel'arbre magiqueetdesesfruits,iciunpoirier,làlespommesd'ord'Hipomène72 73
Un second niveau de l'hiérogamie sportive serait atteint avec une structure nouvelle opposant uniquementdeshommesetramenantlafemmeàlasituationd'enjeu.Sileprécédentniveauétaitbien illustré par la légende d'Atalante et pouvait correspondre en gros à une période de déclin du clan matriarcal, ce second niveau trouverait parfaitement son expression dans le mythe de Pélops et refléteraitunearistocratieclaniqueentraindesedévelopper74
Lamajeurepartiedeces hiérogamiessontdescourses.C'estlecaspourAtalante etpourPélops. C'estencorelecasdanslaterriblehistoiredesDanaïdesquiontimmolélesfilsd'Egypteslorsdeleur nuitdenoceetquinesetrouventguèreensuitedeprétendantsroyaux,voientleurpèreorganiserdes jeux où elles seront les prix décernés aux vainqueurs et où les concurrents seront lesjeunes gens du pays75.C'esttoujourslecasavecPénélopeque,dit-on,Ulysseauraitméritéedanscegenred'exercice sportif 76 .
De tels exemples ont trouvé des imitations encore à l'époque historique. Pindare77 et Pausanias 78 racontent qu'Antée, le roi d'Irasa? s'inspira du mariage imaginé jadis par Danaos, à Argos, pour ses quarante- huit filles. Le Libyen posta sa fille près de la ligne extrême du champ et déclara que le vainqueur serait le premier qui toucherait ses vêtements. Ce fut Alexidème qui l'emporta. Mais l'épreuve matrimoniale peut faire appel à d'autres disciplines sportives. Pénélope organise son
68. Lowie, op. cit.p.31.
69.E.I.Orechikine. La suppression des survivances religieuses chez les peuples de Tchoukotka."Questionsdesuppressiondes survivancesreligieusesenURSS."Moscou-Léningrad.1966.p.101.
70.GeorgesDumézil. Contes et légendes des Oubykhs.1937.p.21-22.
71.Pindare. Troisième Néméenne.Vers32-36.
72.Chaucer. Contes de Canterbury.Lecontedemarchand.C'estl'histoireduvieuxJanvierbernéparlejeuneMai.VoirLegouis, Geoffrey Chaucer,1910,p.203-204.
73.Ovide. Métamorphoses.LivreX.Vers560-680.
74.Pindare. Première Olympique
75.Eschyle. Les suppliantes. Pindare. Neuviéme Pythique
76.Grimal. Dictionnaire de la mythologie.p.225,Icarios.
77.Pindare. Neuviéme Pythique.Vers110-125.
78.Pausanias. Description de la Grèce.III,122.
remariage obligé sur la base du tir à l'arc.79 Dans la tradition indienne, on voit les prétendants à la maindeDroupadi 80 etàcelledeSitâ 81 tenusàdesépreuvesdeforce.
Parfois l'arrangement mythologique ne permet pas de faire la part de l'affabulation et celle des données sociales et culturelles sous-jacentes et il faut se contenter d'admirer une fresque grandiose. Pour Déjanire si belle et convoitée par de nombreux prétendants Hercule doit vaincre le fleuve Achélaos malgré les ruses de ce dernier, d'abord à la lutte, puis avec un adversaire transformé en serpent, et enfin dans une sorte de joute tauromachique où le fleuve métamorphosé en taureau perd unedesescornesquiseralacorned'abondance82 .
Parfois de surprenants événements se produisent comme lorsque les Argonautes abordèrent, dit Pindare,chezlesLemnienneshomicides.« Là ils firent juger la force de leurs membres dans des jeux dont un vêtement était le prix, et ils s'unirent à ces femmes. 83». Mais les Lemniennes avaient-elles réellementtuéleurspiratesdemaris?
Dumézil insiste sur le rapprochement entre l'affaire des Danaïdes et celle des Lemniennes«L'arrivée des héros prétendants, les nouveaux mariages, le concours de course terminent l'histoire desDanaïdescommel'arrivéedesArgonautes,lesnouveauxmariagesetlesjeuxterminentl'histoire desLemniennes»-etdevinesousceslégendeslasecondepartied'unrituel,«lesritesderenaissance etdejoies'opposantauxritesdedeuiletdemortsimulée84.»
Iln'estpasdouteux,selonDumézil, quelesGrecs ont dûmalinterpréterouinterpréteràlalettre une légende initiatique barbare. Huizinga a tendance à rapprocher ces hiérogamies des origines du droit. « Ce n'est certainement pas l'effet du hasard, si la compétition tient en particulier une place importante dans le choix de l'épouse ou de l'époux. Derrière le mot anglais wedding, qui désigne la conclusion du mariage, il y a le même arrière-plan lointain d'histoire du droit et de la civilisation que derrière le mot néerlandais bruiloft... Bruiloft évoque la course pour l'épouse, c'est-à-dire l'épreuve ou l'une des épreuves dont dépendait la conclusion de la convention 85 »
Eliade voit dans l'hiérogamie une sorte de création continuée qui a la mort pour compensation : «La création s'achève et se parfait soit par une hiérogamie, soit par une mort violente, c'est-à-dire quelacréationdépendaussibiendelasexualitéquedusacrifice.86»
Cesaspectssontliés.Droitcruel,sansdoute,maisdroit.Undroitquisepaiechercependant.Un droitfondésurl'ordrecosmique.Laformuledédoubléedusacrificedanslastructuresportivepermet de satisfaire en même temps aux deux conditions de la création lorsque celle-ci est continuée et achevée sur le plan humain. L'un épouse, l'autre meurt, encore que la formule initiale soit plus compliquée.Aveclecas defigured'Atalante,l'uneépouseoun'épouse passuivantquel'autremeurt ou ne meurt pas. Avec le cas de figure de Pélops, la négociation sportive s'effectue non pas directementaveclaprincipaleintéressée,maisavecunintermédiaire,lepère,etleprétendantépouse oumeurt.Iln'yajamaissymétrievéritable.
Lesdeuxniveauxqu'ilsemblepossibledediscernerdansleshiérogamiesdoiventcorrespondreà dessignificationssuccessivesplusoumoinsbienintégrées.L’hiérogamiead'abordunesignification agraire. Il s'agit de promouvoir la fécondité et la mentalité voit un rapport direct de magie sympathique entre fécondité et fertilité. On compare volontiers l'accouplement au labour et ce n'est passimplementuneimage.GernetetBoulangerdisent :« L'hypothèse paraît fondée que les jeux, et notamment les courses, ont pu être conçus d'abord - et ont pu continuer à l'être obscurément dans la conscience populaire - comme contribuant à entretenir les énergies de la nature, suivant un cycle
79.Homère. Odysée. Vers60-80.
80. Mâhâbhârata
81. Râmâyana
82.Ovide. Métamorphoses. Vers30-90.
83.Pindare. Quatrième pythique.Vers252-254.
84. Dumézil. Le crime des Lemniennes.1924.P50.Dumézilinversel'ordredumariageetdesjeuxcommesicesderniersétaientune célébrationplutôtqu'uneépreuve,cequiestcontraireautextedePindare.
85. Huizinga. Homo ludens.NRF/Gallimard.1951.p.141.
86. Eliade. Mythes, rêves et mystères.Idées/NRF.p.225.
régulier87.» Dumézil, parlant des Lemniennes, évoque Thoas et la décapitation du génie végétal88 88, une décapitation toujours présente dans le cas des prétendants d'Hippodamie. Mais l'hiérogamie acquiertensuitelasignificationd'uneinitiationroyale,d'uneprobationjuvénile.Danslepremiercas, on rejoint ces fêtes végétales où l'on retrouve « jusqu'en pleine Europe moderne, les mariés de l'année. 89»Danslesecond,onpenseauprivilègedumariagedivincommeprixquelehérosretirede l'épreuve« Éternellement en paix, il obtiendrait, pour compenser ses durs labeurs, le privilège d'une félicité inaltérable,dans la demeure des bienheureux ; il recevrait enmariage la florissante Hébé 90 »
87.GernetetBoulanger. Le génie grec dans la religion. p.50.
88.Dumézil. Le crime des Lemniennes.p.42-55.
89..Dumézil. op.cit.p.50.
90.Pindare. Premiére Néméenne.Vers70-71.
L'ordalie.
Lecercledu(bon)droit.
Structuresacrificielledédoubléepermettantàlafoisderendresondûausacréetdesacraliserune situationdefait,contrelerituels'exerçantauxtroismomentsessentielsdel'existence,surlanaissance sociale, le mariage et la mort physique, le sport participe à une mise en ordre cosmique, à un droit universel.Ilinstitueuncerclemagique.
C'est un cercle temporel. Il s'inspire d'une conception cyclique du temps, d'une universelle circulation des énergies. Il la reproduit. L'éternel retour des saisons sportives, l'organisation périodiquedesjeuxsontuneimitation,uneimageducosmos.C'estpourquoiletempsdusportestun temps particulièrement sacré. Parenthèse sacrée dans le temps profane, il est un cercle raccourci de touteslespuissancesdumonde.
C'est un cercle spatial. C'est un champ clos. On y débat sans intervention extérieure. Rien de profane ne peut y pénétrer. Mais comme ce cercle spatial est une sorte de temple qui concentre les énergies universelles, on y débat dans une atmosphère éminemment religieuse. Le sport est un tribunalcosmique.Lavertus'yrévèleparsaseuleforce,laforce.
Dequeldroitledroit?Lesportestunedécisionsansappel.
Danscettenouvellefonctionquisupplante,résumeetsacralisetouteslesautres-ledroitdenaître socialement, de se marier et d'avoir lignée, de mourir bien - deux idées conditionnent le pouvoir juridique.C'estledéfietlechampclos.C'estl'agonetlelieusacré.C'estlalutteavecdesrèglesfixes, le débat, et le cercle inviolable,la cour de justice. Dans la mythologie, Loki, dieu germain, s'assure, avant de participer à une compétition rituelle d'injures, qu'il se trouve bien dans un grand emplacementoùrègnelapaix91.EtHomère,décrivantlebouclierd'Achille,indiquelaprésenced'un cerclesacréoùsiègentlesjuges.92 L'analogiedestructuredusportetdudroitestmanifeste,uncombat loyal, dans les règles, le fair-play. On ne sortira pas du cercle sans avoir fait apparaître la vertu cosmique du champion, son droit à être le premier, s'il s'agit de sport, sans avoir fait apparaître la vérité, s'il s'agit d'un jugement. Maisau fond, c'est la même chose, vérité de la force ou force de la vérité.
Tout cela manifeste l'adhésion implicite à un système de valeurs ou la force physique, l'adresse, laruse,enunmotl'aptitudeàgagner,àêtrelepremier,lemeilleur,occupentuneplacecentrale.Telle estl'idéologiehéroïquequivaconstituerpeuàpeul'institutionsportive,l'idéedubeaurisqueàcourir. Mais qu'on ne se reprenne pas sur la spontanéité ni sur sa pureté d'intention. Cela se construit, s'appuie ets’organise sur la base une pensée magique et totémique, sophistiquant progressivement les symbolismesutilisés. Et cette progression correspond à une stratification nouvelle, patriarcale et pré-esclavagiste,delasociété.
Lacroyancepremièresubsisted'unmondedontilconvientdecontribuerà fairebiencirculerles énergies,notammentpardessacrifices.Maisonconçoitdéjàlesavantagesqu'ilyaàêtredésignépar le ciel. Aide-toi et le ciel t'aidera, on se donne toutes les chances de se faire indiquer comme le meilleur. On se prépare. On s'entraîne. Bientôt toute une éducation renforce ce climat d'une désignationsportiveduplusfortetdel'appartenanceà unefamille quipossèdelavertucéleste.Plus tard l'initiation royale apparaît comme la manifestation à l'individu de cette idéologiedominante, de sonsystèmederégulation,larègledejeudupouvoir,etsurtoutdudroitprivilégiéqu'iladeparticiper
91.Huizinga. Homo ludens.NRF/Gallimard.1951.p.133. 92.Homére. Iliade.ChantXVIII.
à cette compétition et de s'y préparer. On est alors passé insensiblement des royautés primitives à l'aristocratieclanique.
Ainsi la structure sportive est une forme archaïque du droit politique. Mais ce droit, pris au sérieux, n'est conservé que parce qu'il est adopté comme un droit de classe. De cette manière, on s'expliquequ'ailleursl'ordaliedisparaisseaulieudesefixerdanslaprocéduresportive.Anacharsisa ledroit,luilebarbare,d'ironisersurcesviolencesinutilesetcontrairesauprincipemêmedudroit.93
Finalementonfaitsemblantd'ycroiretoutenn'ycroyantqu'àmoitié.Onjouelejeu.Maisonne joue pas franc jeu. On augmente ses chances héroïques en se préparant techniquement et athlétiquement. On les augmente encore en faussant discrètement les conditions normales de la rencontre.Onaideledroitàêtrebon.
De fait la ruse est partout, et ce n'est pas ruse innocente. Pélops obtient de Myrtile, l'écuyer d'Oïnomaos,qu'ilremplaceleschevillesdeboisdesrouesduchardesonadversairepardeschevilles de cire, ce qui, l'échauffement aidant, provoquera un accident mortel. Hippomène profite de la cupidité d'Atalante. Jason, Thésée sont quelque peu aidés par l'intervention extérieure, l'un de la magicienneMédéequiestamoureusedelui,l'autredelajeuneArianepourlesmêmesraisons,deux fillesquitravaillentcontreleurpère.Jusqu'ausagePythagorequitrichesursacatégoried'âge94 .
C'estpourquoionpeutdirequelesjeuxviennentdetrèsloinavecleuridéederèglequiestplutôt régulationnaturelledelasociété,dejusticenaturellequiestplutôtjustesse,ajustementdel'harmonie cosmique. Gernet et Boulanger évoquent des fêtes de paysans tenues en des lieux champêtres, avec leurs réjouissances, leurs occasions de dépense, les ripailles, les manifestations d'hospitalité réciproque,l'admissiondesnouveauxmembres,lesritesdepassage,lesmariagessimultanéscélébrés auprès des rivières. Ces concours, « préludes des agones classiques, suggèrent dans des images de légendes, l'idée première de ces épreuves matrimoniales qui seront imposées aux héros. »95 « De toute antiquité, les jeux paraissent un élément essentiel du culte : et le moins qu'on puisse dire du vainqueur, c'est qu'il a une éminente vertu religieuse. »96
C'est pourquoi on doit dire aussi que les jeux se maintiennent en tant que structure juridique nécessairepourrégler,formulecontradictoireetquitémoigned'unsymbolismesubtil,laviolence,et mêmecommestructureconstitutionnelle,politiqueentoutcas,desuccession.
Droit sacré ? Le dieu germain Tîvas, le Mars Thinsus, est à la fois un dieu belliqueux et undieu juridique,notionsquines'opposentpas. C'estquelaguerrenevapassansrègle:lelieudelabataille est souvent fixé d'avance. C'est aussi qu'on procède par victime substituée : un duel judiciaire peut remplacerlabatailleelle-même97.MaisdéjàPausaniasraconte:"EndymionorganisaàOlympieune épreuve de course à pied entre ses fils pour la royauté. C’est Epéios qui l'emporta et qui obtint le pouvoir98 .
C'est une façon de voir que partage le monde indien à une époque correspondante de son évolution. Huizinga rappelle que tout un chapitre du Mahâbhârats traite de l'installation de l'espace ludique - sabha - pour le jeu des fils de Pandû et de leurs adversaires99. Il faut dire, il est vrai, que l'ordalienesejouepaspartoutsurlamanifestationphysiquedelaforcepuisquelarévélationduchoix divinpeutsefairesuruncoupdedés.Maislecerclecomporteunesignificationmagique;ilesttracé avecsoin,ditHuizinga;desgarantiessontprisescontrelafraudeetlesjoueursnepeuventquitterle cercleavantqueladécisionintervienne.
C'est d'ailleurs une donnée constante du sport de mêler le hasard et l'anti-hasard. Et c'est très explicable. D'une part, on a besoin de savoir et de trancher dans une situation obscure et problématique. La glorieuse incertitude du sport a valeur aléatoire et, cette procédure étant éminemment dramatique et émouvante, on y prend goût et plaisir et on cherche à la reproduire, à
93.DiogéneLaërce. Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres.Anacharsis.
94.DiogéneLaërce. Vie, doctrines et sentences des philosophes illustres.Pythagore.
95.GernetetBoulanger. Le génie grec dans la religion.p.42.
96.GernetetBoulanger, op.cit.p50.
97.JandeVries. La religion des Germains."Histoiredesreligions1",EncyclopédiedelaPléiade,1970,p751.
98.Pausanias. Description de la Grèce.I,i,4.
99.Huizinga. Homo ludens.p.102.
recréer l'émotion tragique du sacré. D'autre part, tout en voulant s'appuyer sur quelque chose d'objectif, qui s'impose de lui-même, on n'aime pas que ce quelque chose soit extérieur à soi, on entend avoir au moins l'impression qu'on fait soi-même son destin, bon ou mauvais, et, par conséquent,ons'efforcedesedonnerlesmeilleureschances,onseprépare,ons'organise,àlalimite en triche. Aussi lorsque Thompson signale que le jeu de paume aztèque servait à régler des contestations personnelles ou des querelles tribales - fonction ordalique du sport - mais que néanmoins les jeux étaient avant tout des occasions de paris 100, il ne décrit pas deux fonctions distinctesdusportmaisdesoccasionsdevaleurhistoriqueinégaledesoumettreaujugementdedieu des questions incertaines. De ce point de vue, les jeux de hasard sont des questions vides, sans contenu, poséespour le plaisirde mettreen route ledispositif sacré de laréponseordalique. Mais le sport de compétition moderne n'est pas autre chose. La différence n'est que de degré entre le hasard (jeuxdecartes,dedés,etc...)etlanécessité(jeuxdedames,d'échecs)etlesdisciplinessportivesont engénéralleméritedesesituerentrel'unetl'autre,cequileurvautl'intensitédramatiquemaximale. Lesensprofonddel'épreuvemortellecontinueprobablementdehanterl'ordaliesportive:« Rien ne peut se créer que par immolation, par sacrifice »101. Mais si l'épreuve de la lutte donne au vainqueur un droit total sur le vaincu 102 et si « des sacrifices humains sont attestés un peu partout dans les religions agraires, bien que la plupart du temps ce sacrifice soit devenu symbolique »103,il faut sans doute y voir une fonction de socialisation. Pollux, vainqueur du géant Amycos qui avait inventélaboxeetleceste,luifaitjurerderespecterlesétrangers etlelesvivants.104
100.Thompson. La civilisation aztéque.Payot.1934.p.180.
101.Eliade. Mythes, rêves et mystères.p.226.
102.GernetetBoulanger. Le génie grec dans la religion.p.77.
103.Eliade, op. cit. p.230.
104.OrtegayGassetvajusqu’àparlerd’uneoriginesportivedel’Etat.Cf."ElEspectador",T.VII,Madrid,1930,pp.103-141.Voir aussiG.Davy, La foi jurée,thèse,Paris,1923.EtHume, Enquête sur les principes de la morale
Lescow-boysmythiquesetlesgarçonsvachersduwesternarchaïque.
Nousvenonsdevoircommentlesacrificefondaitundroitnaturel,cosmique,etcommentcedroit englobaitlesmomentsessentielsdelaviesociale,cequenousappelonsmaintenantl'étatcivil,c'està-dire l'enrôlement dans la liste officielle des adultes, le mariage et la mort. D'un bout à l'autre, le sport est présent, du moins sous la forme de structures compétitives rituelles sur lesquelles le sport naissantvas'appuyer.
Il convient àprésent d'essayer dedéterminerquels sports ont été les plus anciens et pour quelles raisons. Cela suppose que, sur la foi de documents mythologiques, littéraires, ethnologiques, nous nous attachions à comprendrele contextesocio-économique etles symbolismes religieux qui, d'une part, permettent à ces sports d'apparaître et qui, d'autre part, leur confèrent la signification d'un comportementcultureletunevaleurémotionnelle.
Cettesecondepartiecomporteradeuxchapitres:
Chapitre6. Élevage et Totémisme.
Chapitre7. Fonction de la femme et structure sportive.
Desroisetdesdieux-taureaux,desluttesmagiquesetsacrées,et...des cow-boysmythiquesquiontlaflèchefacile,tantôtjusticiersettantôt tueurs.
Leplusvieuxrécittauromachiquesesituedansl'Epopéede Gilgamesh.Leroid'Uruk,Gilgamesh, aoffenséladéesseIshtarenrepoussantsesavancesetenluiénumérantlesnomsdesesamants.Celleci,poursevenger,demandeàsonpèredecréeruntaureaucélestequirempliraGilgameshdeterreur. Ishtarobtientsatisfactionàconditiondes'engageràfairecroîtrel'herbeàprofusionpendantseptans. Onvoitclairementlelienentrelacorneetl'abondance,entrelasexualité,lafertilitéetlatauromachie. L'animalestimpressionnant.Àsonpremieréternuement,iltuetroiscentsguerriers.Àsonsecond éternuement,troiscents autresguerriers tombèrent.Enkidu,lecompagnondeGilgamesh,nullement intimidé,estalléunepremièrefoistoucherlescornesdutaureau.Puisils'estapprochédoucement,a sauté sur le dos de l'animal, l'a tiré par la queue. C'est l'épreuve, la réussite, l'exploit. Enkidu dit à Gilgamesh:nousavonsgagné!C'estalorslamiseàmort.105
Comblededérision,dansungestededéfi,réminiscencepeut-êtred'unriteancien,nosdeuxhéros jettentlespartiesdutaureau-Conradditavecpudeurlacuisse-auvisagedeladéesse.106
Dansce récit,latauromachie révèle clairementsesoriginestotémiques.C'estunelutte d'homme à dieu, un affrontement où le héros tente de se mesurer à la bête sacrée. Il ne faudrait pas, dans une interprétation trop facile, s'imaginer que le rite tauromachique symbolise le triomphe nécessaire du supérieur, l'homme, sur l'inférieur, l'animal, de l'intelligence sur la stupidité. C'est exactement le contraire qui se passe. Le taureau, c'est le totem, la divinité, la puissance, et l'homme essaie de se hisser à la hauteur de son totem. La tauromachie, c'est la mort respectueuse du père primitif. C'est l'alternativedelamortetdelapuissance.Letaureau,c'estlepère,c'estledieu,c'estlaforce.
On peut imaginer, à la manière de Freud, dans Totem et Tabou, une fête tragique qui s'achève, aprèsl'estocadedutaureau,surunrepastotémique.Entuantletotem,l'ancêtresacré,enlemangeant, on réalise l'identification avec lui. C'est un crime utile, indispensable. Mais tout est ambivalent. Le père est terriblement puissant, il peut donner la mort, ses cornes sont le signe de cette puissance absolue.Enmêmetempsilprocure,lui,legéniteurdutroupeau,lanourriture,lavie,laforce.Onvit dansunesociétéd'élevage.
L'affaireesttragique,on est obligédetuerla divinitépourabsorbersatoute-puissance.Et on est obligé de le tuer dans les règles si on ne veut pas que l'animal mort s'offusque du sacrifice dont il a été l'objet. Car on ne conçoit pas la mort comme l’anéantissement définitif, mais plutôt comme un vagueno man's land naturel au-delà du domaine dela cultureet le sacrifice, s'il posedes problèmes de technique rituelle, ne pose pas, en revanche de problèmes de conscience insurmontables apparemmentnipourlesacrificateurnipourlesacrifié.Dansl’Epopée de Gilgamesh,noshérostuent Humbaba, puis, un peu plus tard, partagent pacifiquement un repas avec son fantôme. Donc on ne meurt pas vraiment et tout le tragique consiste dans la réussite plus ou moins correcte de la mise à mort.
105.Contenau. L'Epopée de Gilgamesh.L'Artisandulivre.1939.p.110-111.Conrad. Le culte du taureau.Payot.p.44. 106.Lacuissedroiteestd'ordinairel'offrandeparexcellence,maisletexteporte imitu,préciseContenau,etilconvientdes'en rapporteràlasignificationdelaracinedumot, emëdu,setenirdroit,conformémentàl'opiniondeG.SmithetR.Campbell Thompson.Conteneau,p.112ennote;SmithetThompson, Gilgamesh,p.81,note161.
Peut-êtreaussiautrefoisétait-cel'hommequimouraitsacrifiéautotemetàsacorned'abondance. L'abattagedutaureausacré-afind'avoirenpermanenceundieujeuneetviril-dérivaitpeut-êtred'un régiciderituelplusancien.
En tout cas, c'est un symbolisme de la puissance qu'on retrouve partout. Chez les sémites occidentaux (Ougarit), Ei, le dieu créateur, vieux et sage, est le taureau, tandis que Baal, le gardien del'équilibrecosmique,jeune,violent,estleTaurillon. 107.ChezlesHébreux,Aaron,édifiantleveau d'or, se conforme à la tradition taureaulâtrique, et Moïse en bénissant les enfants d'Israël avant de mourir,ditpourJoseph: « A son taureau premier né, à lui est la gloire, ses cornes sont les cornes du buffle, il en frappera tous les peuples ensemble jusqu'aux extrémités de la terre ». 108 ChezlesGrecs, le légendaire Thésée aurait défié l'homme fort de Minos, qui s'appelle justement Taurus109, tué le Minotaure qui n'est autre que le taureau de Minos 110 et fait passer de vie à trépas le taureau de Marathon.111 Il n'y a pas d'ailleurs que le témoignage des légendes. Le rite s'est fait sport avec les célèbrescorridascrétoises,lesacrobatiessansdouteexécutéespardesprofessionnels112 au-dessusde labête113 ;onsedoitd'évoqueraussiles taurokathapsiaï théssaliennesetlescourseségyptiennesdu bœufApis.114
Le symbolisme taurin est d'ailleurs souvent associé à celui de l'eau dans la signification de la puissance. La mythologie indienne nous parle d'Indra le Taureau qui fait pleuvoir. Le cylindre de Sharkalissharri nous présente un Gilgamesh agenouillé offrant au taureau céleste le vase de rafraîchissement. La Genèse décrit Joseph comme « un jeune taureau près d'une source. »115 Poséidonlui-même,dieu dela meretdieu-chevaldanslamythologiegrecque,serad'abordundieutaureau et Platon s'en souvient lorsqu'il décrit le sacrifice totémique chez les Atlantes. Poséidon le père sous la forme d'un taureau à la loi duquel on appartient dès lors qu'un caillot de son sang, préalablementmêlédansuncratère,aétéjetésurchacundesmembres.116 .
Tragédie, c'est certain, et Hemingway a fort bien vu ce qu'il en était; il a raison d'insister sur l'inégalité des protagonistes dans la tauromachie : « Ce n'est pas un combat égal ou un essai de combat égal entre un taureau et un homme. C'est plutôt une tragédie ; la tragédie de la mort du taureau, qui est jouée plus ou moins bien, par le taureau et l'homme qui y participent.»117 C'est un dramecosmique.Ilimportedelebienjouer.Laforcerenouveléedel'universendépend.
On a donné, il est vrai, d'autres interprétations du phénomène, de son origine, de sa persistance, de sa signification fondamentale. Papini, dans son Coloquio con Garcia Lorca, retient que « la corrida es la representacion publica y solenne de esa victoria de la virtud humana sobre el instinto bestial. »118
Mais une telle prise de position s'inscrit dans la ligne d'une réinterprétation chrétienne du totémisme tauromachique. Le christianisme triomphant en a rétrogradé les cultes païens au rang de services religieux diaboliques. C'était une manière de discréditer les survivances et leurs adeptes. Ainsi fut-il fait des cultes rendus au taureau. Le cornu, c'est le diable. Il reste des réminiscences de cesluttesidéologiquesdanslefolklore.OnditqueSaintTaurin-nomdecirconstanceaussibienque celui de Taurus, le capitaine de Minos le roi taureau - qui fut le premier évêque d'Évreux au IX° siècle, fut mis en présence du diable, que celui-ci se transforma en buffle, que Taurin lui arracha sa corne et que le diable supplia en vain l'évêque de lui rendre ce symbole de sa puissance et de l'abondance. L'histoire est même encore plus intéressante en ceci que le diable fait périr la fille de
107.AndréCaquot. Les Sémites Occidentaux."HistoiredesReligions"Encycl.Pléiade.p.324.
108. Deutéronome,XXXIII,17.
109.Plutarque, Vie de Thésée,XXII.C'estl'unedesversions.
110.C'estl'autreversiondel'exploit,laplusrépandue,rapportéeaussiparPlutarque.Mêmeréférence.
111.Plutarque, Vie de Thésée,XVI.
112.Conrad. Le culte du taureau.p.139(dessin);YvesBéquignon. La Grèce."HistoireUniverselle1",Encycl.Pléiade.p.530.
113.PierreDewauber. Antiquité classique."Histoiredel'art1",Encycl.Pléiade,p.579.
114.FrancisVian. La religion grecque."HistoiredesReligions1",Encycl.Pléiade,p.475.
115. Genèse.XLXIX,22-24.
116.Platon. Critias.119d-120b.
117.Hemingway, Mort dans l'après-midi. Pléiade,tome1,p.1000.
118.SuzanneVarga. La tauromaquia.MassonetCie.p.86.
l'hôtedeSainttaurinmaisquecedernierla ressuscite,reprenant ainsi aucompte duchristianismele symbolisme agraire de la mort et de la renaissance. Effectivement, la foule aussitôt, dit-on, se convertit.
On trouverait aisément de nombreux témoignages de ce genre. Par exemple, à Mèze, dans l'Hérault, le 19 mai, jour de laSaint-Hilaire, on promène à travers la ville un bœuf fait de bois etde toile,toutenimitantsesmugissements.EtàBarjols,dansleVar,onmèneunbœufenprocession,on l'immoleetonprocèdeàungigantesquefestin.C'estévidemmentlevestiged'unefêtetrèsancienne, maisonluitrouveunpatronchrétienet,avecunhumourdontonnesaitpasbiens'ilestdirigécontre lespratiquesanciennesoucontrelecultenouveau triomphant,onparledestripettesdeSaintMarcel comme de reliques. Jean de Meung y aurait fait allusion dans le Roman de la Rose. Mais, chose certaine,nilesautoritésreligieusesdeFréjus,nilesautoritéspolitiquesdelaRévolutionnevinrentà bout de cette coutume. On ne s'en explique que mieux que la persistance du rite ait trouvé dans la passiontauromachiquesonterraind'élection.
On adonc tout lieude penserque la tauromachie est le plus ancien des sports. Sacrificedivin, il est un acte de communion totémique. Il devient ensuite un rite d'initiation royale - les rois de Crête sont des rois-taureaux - avant de devenir un exercice physique spectaculaire accompli par des spécialistes.
Sans doute pourrait-on contester la dénomination de sport en faisant remarquer, comme le souligne justement Hemingway, que la situation n'est pas égale entre les parties en présence. Le taureau est à la fois l'adversaire et l'enjeu, sauf accident, c'est l'homme qui doit gagner. On est beaucoupplusprèsdusacrificequedelacompétition.
Maisilestintéressantdevoircommentonpassedelatauromachieauxsportsdecombat,laboxe, mais surtout la lutte, par simple glissement des structures, en dissociant les notions d'enjeu et d’adversaire.
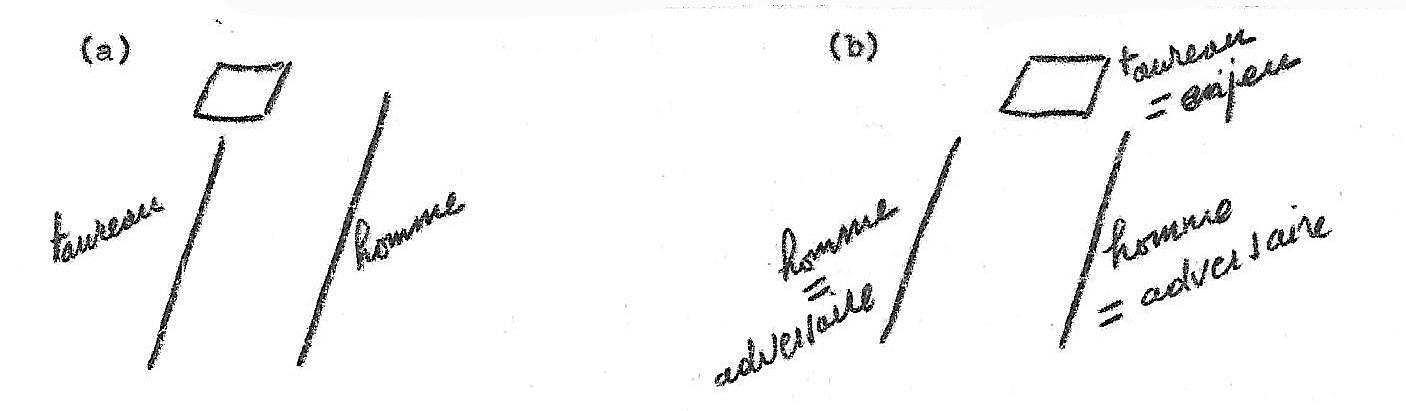
Du sacrifice au sport, de la tauromachie à la lutte, du risque héroïque à la compétition, du rite royald'initiationàl'épreuvesymétriquementorganisée,beaucoupdenuancessontpossibles,maisle glissement définitif est opéré lorsqu'on passe de la structure (a) à la structure (b), c'est-à-dire le taureau, objet du sacrifice au souvenir de cet objet, cessant d'être affronté pour être réduit à l'état d'enjeu et laissant sa place d'adversaire à un homme semblable et égal au premier. Biensûr,cetransfertd'éléments,mêmesfondamentaux-il s'agit desnotionsd'adversaireetd'enjeu! -, apparaîtrait comme un jeu d'écriture conventionnel s'il n'était confirmé dans les faits par la nature conservéedecesadversairesetdecesenjeux.Or,c'estbiencequisepasse,etparlànouscomprenons quelalutteetlesautressportsdecombatdériventdelatauromachieencequiconcerneleurrituel. Dans l'Énéide, lors du combat de ceste, Darès, sans adversaire, va s'emparer du taureau mis comme enjeu. Il est le plus fort, même et surtout si personne ne s'oppose à lui. Mais, au dernier moment, Entelle relève ledéfi et finalement vainqueur après plusieursretournements de situation,il abatletaureaud'uncoupdepoing.Ons'estbattupoursavoirquelseraitleplusdigne,envertudesa force,d'êtrelesacrificateur.119
119.Virgile. Enéide Vers425-480.
Ovidedécritl'épreuvedelutteàlaquelleselivrent,pourlamaindeDéjamire,Herculeetlefleuve Achélous. Ce dernier, qui est censé raconter le combat parle avec admiration de son adversaire, dit en matière de comparaison qu’il a vu de même façon de courageux taureaux se jeter l'un sur l'autre. Sur le point d'être battu, il se métamorphosera en serpent, puis... en taureau.120 Cette fois, c'est la continuitédelanaturedel'adversairequisemanifeste.L'hommequiaffrontaitletaureaudanslerite tauromachiquen'étaitplusunhomme,maisl’égaldutaureauendivinitéetenpuissance.Leslutteurs nesontpasnonplusdeshommessimplesmortelsmaisdesdieux-taureaux.
Cesrencontreslittéraires sontd'autantplusintéressantesqueni Virgileni Oviden'ontl'intention dedémontrerquoiquecesoitetque,faisantœuvrepoétique,ilssecontententdereprendreuncertain nombredematériauxmythiquesoufolkloriquesquipassentàleurportée.Lefaitqu'onpuissetrouver ailleursd'autresenjeuxn'estpasplusgênantquelaconstatationdeladésacralisationapparentedurite avec les adversaires qui se battent pour eux-mêmes. Il y a évidemment une évolution historique qui faitperdredevuelessignificationspremières.Maislacontinuitépersistantedecertainessurvivances n'en est que plus significative justement. Ce qui est clair, c'est que les hommes- taureaux veulent sacrifierledieu-taureaupourpossédersaforceetqueladifférenciationdesfonctions,lejeuderôles, dirait-onaujourd'hui,s'établitprogressivement.
Lapuissancedessignificationsattachéesàcesstructuresseraitencoreattestéeparlapermanence decesdernièreslorsquedesraisonséconomiquesbiencompréhensiblesobligentàintroduireunenjeu desubstitution.Lebélierdeviendralepremierprixtraditionneldelaluttebretonneetlechoixesttout indiqué: on conserve le symbolisme de la corne d'abondance, mais c'est moins cher. Mieux, la réduction de la valeur financière de l'enjeu va entraîner la possibilité de multiplier les tournois de village, donc de démocratiser un sport qui, dans sa formule antérieure, dépendait du caractère somptuairedesfunérailles.
Chaucer, faisant le portrait du meunier, dit bien qu'il était « gros de muscles, et aussi de charpente » et que « partout où il allait, à la lutte il emportait toujours le bélier (At wrastling he wolde have alwey the ram) »121
Tout prèsde nous, ce qui prouvel'extraordinaire continuitédes influences structurelles à travers le temps, un spécialiste du folklore breton, Creston, apporte encore témoignage des mêmes réminiscences totémiques, de la miniaturisation, si l'on peut dire, d'un enjeu traditionnel qui reste significatif, dans sa transformation; il nous montre, en même temps, le naturel entrelacement des intentions etdesmotivations,l'ambivalenceentrel'intérêtetlagloire,etlecomposanthiérogamique qui suppose un consensus social sur les valeurs de la victoire sportive: « un bon lutteur, autrefois, outre qu'il pouvait augmenter son troupeau à bon compte en faisant le tour des localités où il y avait un tournoi, par le fait qu'il remportait le prix principal, le Maout, le mouton, plus exactement le bélier, était assuré aussi de trouver un bon parti pour se marier .»122
Onvoitcommentleprosaïquesemélangeausacré,etil enfutcertainementainsi detoustemps. Mais Creston nous livre une remarque encore plus instructive en ce qui concerne le passage de la tauromachie à la lutte, la proximité de ces deux sports, l'identique nature totémique de leur enjeu principal... Il seréfèreà ceque disait Cambry dans son Voyage dans le Finistère sur le protocole de défi préalable à la lutte pour le premier prix: « Un lutteur saisissait le taureau par les cornes et lui faisait faire le tour" de la lice.123 Ainsi le mouton était un substitut du bélier lui-même substitut du Taureau.
C'est également sous le signe du totémisme et de l'élevage que va naître et se développer une troisièmeorientationsportive.L'arc,commelatauromachieetlalutte,estcertainementunediscipline dontlesoriginessontlesplusanciennes.
Sursonimportancerituelle,onnemanquepasnonplusd'informations.LesAînosduJapon,iln'y apassilongtemps,pratiquaientuncultedel'oursdontlesrésonancestotémiquesnefontpasdedoute.
120.Ovide. Métamorphoses.LivreIX.
121.Chaucer. The Canterbury Tales. Prologue,vers546-548.
122.Creston. La lutte bretonne à Scaer.ÉditionsB.A.S.1957.p.13.
123.Creston. op. cit.p.24
On transporte l'ours capturé de maison en maison, puis il sert de cible pour un tir à l'arc rituel et on mange ensuite sa chair avec solennité. 124 De nos jours, ce n'est plus qu'un divertissement pour touristes.UnoHarvanousditdesoncôtéquelesKalarstirentsuruncrâned'ourssuspenduàunarbre, les Toungouses sur le ventre de l'ours abattu, tandis que les Caréliens ouvrent la poitrine de la bête, dessinent avec son sang une croix sur un pin et y tirent quelques flèches, et il y a bien d'autres procédures suivant les peuples.125 On se contentera d'observer en cette occasion que le sport ne naît pas directement de l'utilité de la chasse, mais qu'il s'inspire de nécessités religieuses, de réponses rituelles, qui, au second degré seulement, lui font retrouver les réalités économiques de la chasse. Il suffiradefaireremarquerquecestirsontparfoispourobjetderenforcerlepouvoirmagiquedel'arc en vue d'expéditions ultérieures mais que le plus souvent on veut tout simplement tuer l'âme de la bête-d'oùletiràblancsuruneciblesubstituée:unepartiedel'animal-aprèsavoirtuésoncorps,afin quel'animalmortnereviennepas-craintesuperstitieusedesrevenants-sevenger.
En Chine également, l'arc et la flèche ont des vertus éminemment religieuses. Sous les Tchéous en Chine, le culte du Ciel avait lieu, première cérémonie religieuse de l'année, sur un tertre rond au momentdel'équinoxeetlavictimeétaituntaureauqueleroiabattaitàcoupsdeflèches.126
Lamythologiechinoisedéjàparlaitdel'archerdontonsaitqu'ildébarrassalecieldeneufdesesdix soleils.127
Mais,s'agissanticid'un contexted'élevage,lamythologiegrecquenouslivre,enmatière detir à l'arc,lesportraitshautsencouleursdequelquesvachershéroïques,traversantavecassurancelegrand western des migrations helléniques, tantôt shérifs, tantôt hors-la-loi. Ce sont parfois de mauvais garçons,mêmes'ilssontdivinisésparlasuite,etlespopulationsnelesacceptentpasd'embléecomme tels,onleverraàproposdesmythesdefondation.Cesontentoutcaslespersonnagesquisortentde lagrisaille.IlsontnomApollon,Hercule,Thésée,lesDioscures,j'enpasse.
« Apollon ne tend pas toujours son arc pour punir »,ditHorace, « quelquefois, il réveille sa lyre endormie ».128 Ce sont des symboles solaires, l'un signifie la toute-puissance, le pouvoir imparable defairemourir,l'autrel'harmonieconstructrice.CesontdesprivilègesdivinsetApollon,susceptible et nerveux, n'aime pas qu'on vienne le défier dans ces deux spécialités qui sont siennes. On sait par Homère 129 qu'ilavaitfaitdondesonarcàEurytosetapprisàcelui-ciàs'enservir.Pourquoifallut-il qu'Eurytos,tropsûrdelui,osâtporterundéfiàsonmaître?Chacunsortitsonarme,commedansles westernsd’Hollywood,etApollonfutleplusrapide.IlfutaussidéfiéàlalyreparlesatyreMarsyas, dont il eut la peauau sens propre etfiguré, ce qui, dans la croyancede l'époque, constituait à la fois uncharmefavorisantlavenuedelapluieetuninstrumentdepurification.
C'estàcoupsdeflèchesqu'ApollontualeserpentPythondontlapeauserviraàcouvrirletrépied où sera assise la Pythonisse. C'est à coups de flèches qu'il percera les Cyclopes, ces forgerons qui avaientforgélafoudretuantsonfilsEsculape.C'estàcoupsdeflèches,avecl'aidedesasœurArtémis, qu'ilmassacrales filsde Niobésurpris entrainde s'exercer dansles plaines thébaines, sousprétexte quesamèreLatoneavaitétéoffenséeparl'orgueildeNiobéquisevantaitdesesnombreuxenfants.
Apollonestd'ailleursàl'origined'undesplusvieuxaccidentssportifs.Hyacinthe,l'amid'Apollon, futatteintenpleinetêteparunpaletquecelui-ciavaitlancéetquiavaitétédétournéparlevent(sous l'injonction d'une divinité malveillante). Mais on parle d'un accident analogue à propos de Persée tuantinvolontairementsongrand-pèreAcrysioslorsdesfunéraillesdePolydecte.
Lorsdel'épreuvedutiràl'arcdel’Iliade,c'estApollonquidonnelavictoireàMérion,parceque cedernierluiapromisunehécatombe.130 Ils'agitbiendudonetdel'anti-don.Ildoityavoiréquilibre, échange. Il faut offrir un sacrifice au ciel pour que le ciel favorise les entreprises terrestres. On est bien dans un contexte totémique et une croyance à la circulation fermée des énergies. Teucer qui a
124.Batchelor. The Ainu and their folklore. London.1901.
125.UnoHarva.Lesreprésentationsreligieusesdespeuplesaltaïques.p.298.
126.MaxKaltenmark. La religion de la Chine antique.«HistoiredesReligions1».EncyclopédiedelaPléiade.p.947.
127.YuanK'ê. Les mythes de la Chine ancienne.Moscou.1965.(enrusse)p.175etsuiv.Premièreéditionchinoise:1950.
128.Horace. Odes.II.ALicinus.
129.Homère. Odysée.ChantVIII.vers226etsuiv.
130.Homère. Iliade. ChantXXIII.
négligédefairelamêmepromesseàApollonsevoitrefuserlaréussitemalgrétoutsonadresse:ilne faitquecouperlefilquimaintientl'oiseauattachéaumât.
Remarquablearcherluiaussi,Herculeestunhommecontroversé.Ilestcontroverséd'aborddans la littérature. Chez Homère, il n'est pas encore dieu. Il est pareil à la nuit sombre, regard menaçant, uneflèchedéjàsurlacorde.C'estUlyssequilerencontreauxenfers.131 Eschyleenfaitunsauveurde Prométhée132 ; Sophocle, un bandit de grand chemin,133 ; Euripide tantôt le présente dans une atmosphère de légende, humain et grand,134 tantôt au contraire a tendance à en faire un personnage assezgrotesqueetlourd.135 Quantauxsophistes,ilsverrontenluiunexempledevertu.136
Rienneluifaitpeurvisiblement.IlobligeCharonàletransportervivantauxenfers.Etileffectue sesfameuxTravauxavec unevitalitédésarmante.Maiscehérosafâcheusementtendanceàtirersur toutcequibouge.IltiresurJunonuneflècheàtroispointesquilablessegrièvement.IlatteintPluton àl'épauleetcelui-cidoitremonteraucielsefairesoigner.Iltiresurlesoleildontl'ardeurl'incommode etiltueleCentaureNessusd'uneflèchetrempéedanslesangdel'HydredeLernes.
Il a des démêlés plus ou moins hiérogamiques avec Eurytos, roi d'Œchalie, en Etolie septentrionale. Ce personnage, célèbre pour son adresse à l'arc, avait promis Iole, sa fille, à qui le surpasserait dans cette spécialité. Il fut vaincu par Hercule, refusa de tenir sapromesse. Notre héros sublimefitunmortdecemauvaisperdant.
Le différend avec Lépréos eut une certaine allure. C'était une vieille histoire, car Lépréos avait conseilléjadisàAugiasdenepaspayerlesalairedûàHerculepourlenettoyagedesfameusesécuries. Venu s'expliquer, Hercule, à la prière d'Astydamie, se contenta d'un concours - nourriture, boisson, lancer du disque- avec Lépréos. Ce fut un véritable duel de tueurs de bœufs, raconte Pausanias: « Chacun exécuta un bœuf en même temps et le prépara pour être mangé ».137 Vaincu partout, Lépréos saisit ses armes et fut assez hardi pour provoquer Hercule en combat singulier. Ce futsaperte.
Les Dioscures, Castor et Pollux, étaient un peu du même style. « L'un fut bon chevalier, l'autre bon escrimeur », écrit Ronsard.138 C'est une façon de voir les choses. Nonobstant leur ascendance divine, ils participaient aussi aux règlements de compte pour les troupeaux de bœufs. Pindare nous conte comment les fils de Tyndare et les fils d'Apharée (les avis divergent) sont rentrés en conflit pourenlèvementd'épousesoupourunraptdebêtes.LyncéeàlavueperçanterepèreCastorembusqué qu'Idaspercedesalance.Polluxlespoursuit.Ellesfontfaceetmeurent.139 Thésée fait partie de cette galerie de tableaux. Ce n'est qu'une pâle imitation d'Hercule, dit Méautis.140 Maispeuimportel'existenceréelleoumythiquedesévénementsattribuésauxunsouaux autres. Le besoin de créer des héros et l'hagiographie qui en résulte suffisent à renseigner sur les structures de pensée. Pour Thésée, il n'est que de suivre Plutarque. On apprend toute une série de choses qui, vraies ou fausses, fournissent au moins une atmosphère: admiration pour Hercule141 , combats contre les brigands142, voyage en Crète et affrontement du Minotaure143, établissement des jeux isthmiques144, combats contre les Amazones145, enlèvement d'Hélène146, conflit avec Castor et
131.Homère. Odysée.ChantXI.vers610-615.
132.Eschyle. Prométhée délivré
133.Sophocle. Les Trachiniennes
134.Euripide. Héraclès furieux
135.Euripide. Alceste
136.Platon. Banquet, 117b:lesmeilleurssophistes,commeProdicos,fontl'éloged'Hercule.
137.Pausanias. Description de la Grèce
138.Ronsard. Hymne à Henri deuxième de ce nom.
139.Pindare. Dixième Néméenne
140.Méautis. Pindare le Dorien.Albin Michel.1962.
141.Plutarque. Vie de Thésée.VII.
142.Plutarque,X.
143.Plutarque,XIX.
144.Plutarque,XXX.
145.Plutarque,XXXIII.
146.Plutarque,XXXIX.
Pollux147,etc...Telsdevaientêtrecespersonnagesextraordinaires,imagés,quipratiquèrentcessports lesplusanciensàuneépoquesauvagehéroïque.
Fonctionsdelafemmeetévolutiondesstructuressportives. Coursescruellesetritesagraires.L'éterneln'estpasféminin.
L'ancienneté de lacourse est à mettre enparallèle avec celle delatauromachie.Ony retrouvele totémisme. Croyance en un cycle naturel et régulier des énergies, il s'agit de simuler et de stimuler lesforcesducosmos.Sacrificehumain,lecoureurrattrapéestimmoléauxdieuxdelavégétation.148 Le gagnant est désigné par sa victoire pour absorber une boisson ou une nourriture sacrée, mixture d’immortalité accordée au vainqueur. 149 Mais, sémiologiquement, l'orientation de l'espace est différente. Dans le cas précédent, la verticale était privilégiée: l'adversaire devait tomber. Ici, l'horizontalitédevientlaligneimportante.C'estunautrescénario:lapoursuiteetlesacrifice. En fait, et comme toujours, plusieursidées, plusieurs images interfèrent, chacune attirant l'autre à soi dans une sorte de glissement progressif et continu. La première est celle du cercle magique et protecteur.Talos,dontonnesaitpass’ilfutunêtrehumainouunrobotdebronze,effectuaittousles jours trois fois le tour de l'île de Crète, empêchant d'y entrer ou d'en sortir.150 De même, Achille au piedléger,commelerappelleDumézil,tournaitencourantautourdel'îledeLeuké.151 Déjàs'annonce la structure circulaire du stade. C'est la projection sur la terre d'un lieu sacré, d'un centre du monde. Ce lieu sacré affecte de reproduire la course du soleil dans le ciel. Du coup, on comprend le double usage possible d'une telle course du héros autour de l'île: d'une part, le rite circumambulatoire de significationsolaireservantàrégénérerparmagieimitativelespuissancescélestesquiprésidentaux saisons en vertu du principe similia similibus curantur ; d'autre part, la défense à la fois magique et militaire assurée par le coureur confèrant un fondement religieux à une organisation politique autoritairedelasociété,lecerclespatialdelacourseétantgarantiparlecycledivindutempsdontil estl'imagematérielle.
Maislescénario estcelui,nousl'avonsdit,de lapoursuite etdusacrifice. Nousyvoyonsdéfiler comme dans une suite d'instantanés toutes ou du moins une bonne partie des disciplines qui seront cellesdel'athlétisme:oncourt,onsaut,onlance,ontire.Donconrejoint,puisonfrappe.Répétition de la chasse ? C'est peu probable. Sans doute une interprétation positive, utilitaire et, somme toute primitive, pourrait-elle nous y amener. Mais la chasse des primitifs n'adoptait pas la trajectoire linéairedelapoursuite.
Elle était plutôt encerclement. C'était du moins la méthode inévitable des grandes chasses collectives, celles qui ont dû laisser les émotions les plus profondes dans la conscience de ceux qui onteuàlesvivre.
Surtout, on doit tenir compte de ce que la course prend toujours la forme de la poursuite en ses originesetplusencorepeut-êtredecequel'attention,lasympathieseportentautantsinonplussurle poursuiviquelepoursuivant,unpeucommedanslejeudesgendarmesetdesvoleursauquelselivrent lesenfants,etoù,chosecurieuse,onpréfèrefigurerparmilesvoleurs.C'estlepoursuivi,eneffet,qui alebeaurôledanslesmythesdufeunord-américainsdontnousparleFrazer.C'estlapoursuiteavec relais.Une légendeNavajoes152 rapporte quele coyote,la chauve-souris etl'écureuil dérobentle feu
148. Thoas, roi de Lemnos, en qui Dumézil voit un dieu végétal, donc mourant et renaissant, a un nom de même racine que le verbe théô (=courir).
149. Gernet et Boulanger. Le génie grec dans la religion. p. 50. On ne saurait s'empêcher de rapprocher ce rite de la boisson immortalisantedu«pot»systématiquementoffertauxéquipesvisiteusesdenosjours.
150.PierreGrimal. Dictionnaire de la mythologie grecque et romaine.PUF.p.434-435
151.GeorgesDumézil. Le crime des Lemniennes.1924.p.42.
152.TribuanciennedunouveauMexique.
aux autres animaux qui sont en train de jouer, se transmettent le feu-témoin et l'apportent intact aux hommes,leursamis.153 C'estleparcoursavecobstacles.Dansl'unedesversions d'unmytheNaotka, c'est le daim qui s'introduit chez les loups, leur dérobe le feu en dépit de leur méfiance et de leurs précautionsetqui,chaquefoisqu'ilsesentrattrapé,jettederrièreluiunobjetquisetransformeenun gigantesqueobstaclenaturel,unlac,unemontagne,cequidanslacoursestyliséedusteeplemoderne est devenu la rivière et la barrière.154 Dans la course d'Atalante, c'est toujours le poursuivi qui est sympathique,demêmequedanslacoursedePélops.
Au fond, il y aurait deux questions à se poser : 1) pourquoi la poursuite ? et 2) pourquoi, dans cettestructuredissymétrique,est-celejustementlepoursuiviquisembleavoirlebeaurôle?
Pour essayer de répondre à la première question, il est utile de se référer à la course perdue d'Atalante. Son cas est intéressant non seulement parce qu'il a toujours intrigué et séduit les auteurs etdesauteursaussidiversquePindare,Platon,Ovide,Rousseau,cequiestdéjàunsignedelavaleur attractive du mythe, mais encore par le fait qu'il semble se situer en un temps où les femmes affrontaient régulièrement les hommes - Pélée, le père d'Achille, se serait fait battre à la lutte par AtalanteauxfunéraillesdePéliasetauraitvaincuenrevancheThétys-,circonstancequipeutétonner quandonpenseaucaractèreexclusivementmasculindel'institutionsportivechezlesGrecsàl'époque historique, mais surtout le cas est intéressant parce qu'il s'agit précisément d'une course perdue. Disons tout de suite qu'il faut regarder la fonction féminine dans la société et que, selon la magie sympathiquequifaitsymbolisertoutechose,lafemme,c'estlaprotectiondufeu,dufoyer,etc'estla fertilitédela terre,la miseaumondedelavie.Noussavonsd'ailleursquelefeuranimelesénergies telluriques155 etquedessacrificesyétaientliés156 dontcertainspouvaientêtredessacrificeshumains. Il semblerait bien que nous sommes dans une structure sportive du sacrifice où Atalante joue le rôledel'officianteetson«prétendant»celuidelavictimeàimmoler.
C'est ici qu'il convient de se souvenir de ce que Propp et beaucoup de folkloristes disent de la morphologieducontepoétiqueetdesmétamorphosesdeladragonne.Onnousditquelejeunehéros est poursuivi par la sorcière, que celle- ci se change en objet attrayant et se met sur le passage du hérossansqu'onsachecommentellefaitd'ailleurspourledépasser.
Propp écrit: « La dragonne se transforme en jeune fille, séduit le héros, puis se transforme en lionne et veut le dévorer.»157 On le constate, l'analogie est déjà assez étonnante avec l'exemple mythologiquequetoutelatraditionlieàlacourse àpiedetquinouspréoccupeactuellement.
Maiscelavaplusloin.Ilyaaussilaclassique « transformation de la dragonne en pommier placé sur la route du héros »158 qu'on retrouve ici par l'intermédiaire des pommes d'or, présent magique reçu par Hippomène, qui vont permettre de renverser les rôles. Le charme est retourné. C'est la poursuivante et non le poursuivi qui va rencontrer l'objet attrayant sur sa route. Et les pommes, effectivement,agissentdefaçonirrésistible.
Etfinalement,ilfautbiencomprendrequelajeunefille,lasorcièreetlamarâtresontuneseuleet même personne que l'âge ou la situation transforme. Propp le signale: « Si l'on compare, d'une manière générale, les façons d'agir de la dragonne pendant la poursuite et les actions de la marâtre au début des contes, on obtient des parallèles qui éclairent les ouvertures où la marâtre tourmente sa belle-fille... La marâtre est une dragonne transportée au début de l'histoire... La transformation de la dragonne en pommier placé sur la route du héros... peut en tout point se comparer à l'offre des pommes empoisonnées que la marâtre envoie à sa belle-fille après l'avoir chassée ».159
Ainsi Atalante, sous cette optique, serait la dragonne ou la sorcière, plus du tout l'héroïne romantique d'Ovide. La victime doit être sacrifiée. Il faut la poursuivre. La sorcière est là pour procéderausacrifice.
153.Frazer. Mythes sur l'origine du feu.Payot.p.153.
154.Frazer, op. cit.p.177.
155.GernetetBoulanger. Le génie grec de la religion.p.56.
156.Pausanias. Description de la Grèce.VII,xviii,11-13;X,i,6;IX,iii,8.
157.Propp. Morphologie du conte.p.69-70.
158.Propp,p.84
159.Propp,p.84
Elle doit sacrifier, même si elle est jeune et belle. Le sentiment serait trahison et signe d'un affaiblissement de ses pouvoirs. Cela ne veut pas dire que parfois des situations embarrassantes ne puissent se produire et introduire des manquements à la règle. Dans Euripide, Iphigénie miraculeusement transportée en Tauride y est devenue - curieuse analogie de situation - prêtresse d'Artémisetelledoitimmolerlesvoyageursquidébarquent,maisvoiciqu’ils'agitd'Oreste,sonfrère, etdesonamiPylade.
Maisl'affabulationd'Euripideestévidemmenttardiveetintroduitunélémentsentimentalnouveau très probablement inconnu dans une société primitive aux règles strictes, non ambiguës et excluant l'interventionextérieure.
En fait, la course perdue d'Atalante doit être mise en relation étroite avec la condition féminine et, puisqu'elle est perdue et qu'on s'en souvient, avec l'évolution de cette condition et des fonctions qui la caractérisent. Dans l'histoire d'une Atalante qui n'est peut-être pas la même, les mythologues divergent,maisquiestmalgrétoutunesportiveaccomplieetque,detoutesfaçons,onaeutendance à confondre avec la première dans la sélection instinctive des souvenirs populaires à conserver, on remarque que Méléagre est tué sur l'initiative de sa propre mère dans des conditions qui nous ramènentaucultedufeu.LamèredeMéléagreavaitcachédansuncoffretuntisonéteintauquelétait liéelavie desonfils,etc’est decolère,envoyant lescrimesqu'ilavaitcommiscontresesonclesau coursde la chasse qu'elle avait jeté le tison dans le feu. On le voit, l'extraordinaire pouvoirmagique delafemmeencetteoccasion-AtalantedragonneséduisanteetlamèredeMéléagresorcièrepunitive - ainsi quel'importancedu crime commis contreles oncles etnon contrele père semblent bien nous indiquerunesociétématrilinéairesinonmatriarcale.
Et, les choses se clarifiant peu à peu, le feu signifie l'âme, la vie du monde. Veillant sur le feu, gardiennedufoyer,ladragonnedétientlaviedumondeetdetoutlemonde.Dèslors,toutlesensde lapoursuites'éclaire.Lefeuaétévolé.Etoncomprendaussiquedanslerelais,seulceluiquidétient le feu-témoin continue d'être poursuivi, les autres étant hors course. Atalante serait une Vestale des origines.
Seulementlacoursed'Atalanteestunecourseperdueetl'incertitudedetouteunesériedelégendes vientnousindiquerqu'unetellecourseadûs'inscriredanslecontextesocio-culturelderelationsplus oumoinstenduesentrehommesetfemmes,marquantmêmeunpointdenon-retourdontelleservirait d'illustration.
Auxtempsanciens,ilarrivaitauxhommesdesemesurerauxfemmesavecdesfortunesdiverses danslesépreuvessportiveseton adéjà eul'occasiondesignaler quePelée avaitsuccombé àla lutte contreAtalantelorsdesfunéraillesdePélias,encorequ'ilaitfaitmeilleurefigure,nousl'avonssignalé aussi,end'autresoccasions,commelerappellePindare: « Parmi les héros des temps antiques a brillé Pélée... Il avait lutté avec Thétys, la déesse marine etl'avait prestement vaincue. »160 Biensûr,ils'agit de mythologie. Mais déjà, nous avons pu en faire la remarque à propos des hiérogamies, de telles légendes peuvent avoir quelque fondement dans les choses et, si on se réfère aux documents de l'ethnographie contemporaine, on découvre aisément des raisons sociales qui ont dû jouer autrefois comme elles jouent peut-être encore en certains endroits pour motiver de tels comportements. Chez les peuples où la vigueur physique est une nécessité pour la survie, les valeurs sportives sont des valeurssociales. Ilestexplicablequelesfemmes,avant des'engager,nedédaignentpasdetesterles hommeset,aubesoin,l'amour-propreaidant,derivaliseraveceux.Lowie161 etOrechikine162 sefont l'échodetellespratiquespré-matrimonialeschezlesEsquimaux.
Maissansdoutel'affrontementfut-iljadisplussérieuxetpluscruel.Onépousaitoùonmourrait. Lafemmesedonnaitpourenjeu.Elleexigeaitencontrepartiequelepartenairemetteenjeusapropre vie.Sibienqu'onenarriveàsedemandersilesexemplesdonnésparLowieetOrechkinenesontpas
160.Pindare. Troisiéme Néméenne
161.Lowie. Traité de sociologie primitive. Payot.p.31.
162.Orechkine. Suppression des survivances religieuses chez les peuples du Tchoukotka.«Questionsdesurvivancesreligieusesen URSS».Moscou-Léningrad.1966.p.101.
des survivances très adoucies d'une hiérogamie sacrificielle auxquelles on aurait donné une significationutilitaireaprèsenavoirperdulasignificationpremière.
Coursescruellesetrites agraires,lesrapports entrelessexesn'étaientpasceuxdela tendressela plus évidente. N'oublions pasThésées'en allant combattreavecHercule contreles Amazones.163 Ni toutes les filles qui furent irréductibles au mariage et à la famille, à commencer par Artémis, « la maîtresse des flèches les plus rapides »164. Il y a Cyrène: « Cyrène aux bras admirables désigna le va-et-vient de la navette ; elle dédaigna la joie des festins, partagée avec des compagnes, auprès du foyer. Javelots d'airain ou glaive en mains, elle combattait contre les bêtes fauves. »165 Et puis les noms reviennent des Amazones intransigeantes et indomptées: Hippolyte qui fut reine au temps d'Hercule,PenthésiléequivolaitausecoursdeTroie,Harpalycesurtoutfameuseparlalégèretédesa courseetquisoumitàsonpouvoirtoutelaThrace.
Eschyle qui est de la génération de Pindare évoque «les vierges de Colchide intrépides au combat » 166 etfaitdireàl'undesespersonnages : « si vous étiez armées d'arcs, j'aurais certainement supposé que vous étiez ces Amazones sans maris, qui mangent de la chair crue. »167 C'est Eschyle encorequisoulignecesrapportsautrefoissicruelsavecleshommesetquiparlecommed'unmonstre de « la sanguinaire Skylla » qui, séduite par les présents de Minos, eut si peu le sens de la famille qu'elleacceptadetrancherlecheveuimmorteldesonpère. 168 Etc'estEschyletoujoursquiditdeces « Lemniennes homicides » dont Pindare 169 parle sur le même ton que « de tous les crimes, le plus mémorable est celui des Lemniennes, que la voix des peuples réprouve avec horreur ».170 On sait qu’elles avaient tué leurs maris, puis s'étaient unies aux Argonautes après que des jeux eurent été organisés.
Alors, matriarcat ? Freud, on s'en souvient, avoue qu'il ne sait comment situer dans l'évolution historique la place des divinités maternelles qui ont peut-être partout précédé les dieux pères.171 Lowie, pour sa part, conteste l'existence de tout matriarcat.172 Et Dumézil, étudiant le dossier des Lemniennesqu'il rapprochedecelui desDanaïdes, afaitjustice173 del'idéede gynécocratieavancée parBachofen.174 Ensensinverse,onpeutsesouvenirque,chezlesAïnos,ilexisteunetraditionselon laquellelesritesreligieuxétaientautrefois accomplisparlesfemmesqui, depuis,ontétéécartéesdu culte.175 Mieux, une légende desIndiens de laTerrede Feurapporte quele système d'initiation était jadis entre les mains des femmes, que les hommes un jour en découvrirent le secret et qu'ils l’utilisèrent contre les femmes.176 Enfin, on ne peut pas ne pas constater que l'institution sportive fonctionneàl'époquehistoriquesurlesbasesd'unesociétésecrèteréservéeauxhommes,quelesport faitl'objetd'untabouquis'appliqueauxfemmesetqueseulelaprêtressedeDéméter,Chamyne,ale droit d'assister aux jeux177 comme si la fondation des jeux avait accompagné une régression du pouvoirféminin.
De ce fait, nous serions amenés à voir dans l'histoire du sport une évolution des structures liées auxfonctionsdelafemmedanslesportet,parconséquent,àopposerlecasdefigured'Atalanteàun autrecasdefigure,celuidePélops.Etparlà,aprèsavoirévoquédefaçonencoreconfuse,discutable, ce que pourrait être une réponse au pourquoi de la poursuite, nous tenterions d'aller plus loin et
163.Plutarque. Vie de Thésée.XXIetsuiv.
164.Pindare. Quatrième Pythique
165.Pindare. Neuvième Pythique
166.Eschyle. Prométhée enchaîné
167 .Escchyle. Les Suppliantes
168.Eschyle. Les Choéphores
169.Pindare. Quatrième pythique
170.Eschyle. Les Choéphores.
171.Freud. Totem et Tabou
172.Lowie. Traité de sociologie primitive.p.184.
173.Dumézil. Le crime des Lemniennes.p.16.
174.Bachofen. Das Mutterrecht.Stuggart.1861.p.84-92.
175.Butchelor. The Ainu and their folklore.Londres.1901.
176.Gusinde. Die Selknam.(«DieFeuerland-Indianern»).Bd1.1931-Koppers. Unter Feuerland-Indianern.Sttugart.1924.-Tokarev. Les religions dans l'histoire des peuples du monde.Moscou.1965.
177.Pausanias. Description de la Grèce.VI.xx.9.
d'aborderlaréponseàlasecondequestion,lepourquoidelasympathiequivaaupoursuivi.Engros, sur le premier point, nous avons laissé supposer que c'était la femme, la terre, la gardienne du foyer quipoursuivaitlavictimesacrificielledansunecoursedestinéeàstimulerlesénergies.Surlesecond, on aurait tendance à déclarer que c'est maintenant la version du poursuivi qui prévaut, un poursuivi quiarenversélesdonnéesdupouvoiretlesconditionsdelacourse,unpoursuiviquisedonnelebeau rôle, un poursuivi qui s'est révolté contre l'ordre ancien des choses, une victime qui a refusé d'être sacrifiée.Àlacourseperdanted'Atalantes'opposelacoursegagnantedePélops.
Sil'oncomparelesdeuxmythes,onconstate,certes,despointscommuns:1)Unmariagesejoue àlacourse;2)C'estunmariagequiaunecontrepartiesacrificielle;3)Lepoursuivin'estpasrattrapé. Maislesdifférencessontnotables.D'abord,lacourseàpiedfaitplaceàlacoursedechars,cequi suppose tout un symbolisme nouveau lié à la présence du char et du cheval, mais ce qui date historiquement le mythe en le limitant par l'arrivée du cheval en Grèce. Ensuite le mythe d'Atalante symbolise l'échec du pouvoir féminin face à l'autorité masculine qui s'impose, alors que Pélops affirmelesvaleursdel'héroïsmearistocratiquecontreledespoteduclan.Autrechangement:Atalante cherchait unevictime etse fait épouser (engrec dompter)tandis quePélops chercheune épousequi luidonneunpouvoir:l'orientationdiffèreautantquelerésultat.Onnoteraencorequed'uncôtéona un homme en compétition avec une femme, ce qui donne à cette dernière un rôle actif, alors que de l'autre les compétiteurs sont tous les deux des hommes et que la femme est seulement enjeu. Enfin, onobservequesi,danslepremier cas,les enjeux n'étaientpaséquivalents-lemariagedelafilleou lamortdugarçon-,enrevanche,danslesecond,c'estbienlemêmeenjeupourlesdeuxconcurrents : lepouvoirsurlafemmeencasdevictoireetlamortencasdedéfaite.
De cette analyse comparative, on peut tirer, semble-t-il, plusieurs conséquences importantes concernantl'évolutiondesstructuresetdesfonctionsdusport.
La première concerne le statut du roi. On sait que Freud approuve Frazer d'avoir « émis l'hypothèse que les premiers rois des tribus latines étaient des étrangers qui jouaient le rôle d'une divinitéetétaientsacrifiéscommetellesolennellement, unjourdefêtedéterminé »178 OresteetPylade étaient bien des étrangers lorsqu'ils abordèrent en Tauride et faillirent être sacrifiés par la prêtresse d'Artémis. Cette conception magique de la royauté a d'ailleurs laissé des traces nombreuses dans le folklore. Dumézil en évoque quelques-unes et en particulier il indique que, parmi des variantes qui sontnombreuses, « parfois les jeunes gens commencent par faire une course, et c'est le vainqueur de la course qui figure le roi ; parfois enfin le roi n’est pas seulement immergé mais décapité ».179 Bien entendu,ils'agitdesacrificesdesubstitution,souventd'uncoq,maisilsneselaissentpasd'êtrecruels. Un peupartout, dans le folklore enAllemagne 180, en Belgique181, en France, on tranche latêted'un coq enfoui comme autrefois sans doute celle d'un roi de la végétation. Et à Saint Pée-sur-Nivelles, dans les Basses-Pyrénées, au cours d'un arrêt de la danse circulaire, une Atalante se détache de son cavalier et, telle une prêtresse d'Artémis, coupe d'un coup de sabre une tête qui jadis aurait été celle deson"prétendant".
Or,avecla légendedePélopsquisertparla suitedemythedefondationauxjeuxolympiques,il yaquelquechose dechangé.Leroitendàdevenir moinsmagiqueetpluspolitique.Ons'éloignedu sacrifice totémique. On serait plus près du rite de probation royale. D'ailleurs Pausanias nous conte qu'unegénérationenvironavant Pélops,Endymion,filsd'Æthlios,déposaClymèneetorganisa pour sesfilsunecoursedontlepouvoirétaitleprix.182 Sil'onfaitlapartdeschosesdanscetteinformation etquel'ontientcompteduvolontarismedorienquiaimposéHerculecommefondateurdesjeux,non sansavoir àvaincre,semble-t-il, desfortesréticenceslocales,onserait plutôttentédepenserqu'une tellecourseconsacreaucontrairetouteuneévolution.
178.Freud. Totem et Tabou.Payot.p.173.
179.Dumézil. Le crime des Lemniennes.p.45.
180.Mannhardt. Die Korndamonnen.Berlin.1868.S.15-15.
181 .Ravez. Le folklore de Tournai et du Tournaisis.p.140-141.« Ce jeu cruel était fort répandu en Wallonie... Ce qu'il y avait de sauvagement symbolique dans la décapitation a… disparu, pour ne laisser subsister que l'aspect sportif de cette tradition. »
182.Pausanias. Description de la Grèce.V.viii.1-2.
Il ne s'agit plus de poursuite comme pour Pélops qui doit être antérieur s'il a existé personnellement. Il s'agit forcément d'une course en ligne. Il ne s'agit plus non plus d'une fuite sacrificielle. Il s'agit d'une course du pouvoir. Désormais, le roi est tout-à-fait politique sans se démarquertotalementdelajustificationmagiqueapportéeparlacoursequiledésigne.
Une seconde conséquence se dégage de la confrontation de la course d'Atalante et de celle de Pélops.C'estl'élaborationprogressivedelalogiquecompétitiveàpartirdelaprocéduresacrificielle. L'enjeusedistinguedel'adversaire;unecertainesymétries'installe:

Aussitôtonconstateunesimilitudeaveccequiaétéditsurlepassagedelatauromachieàlalutte auchapitreprécédent:
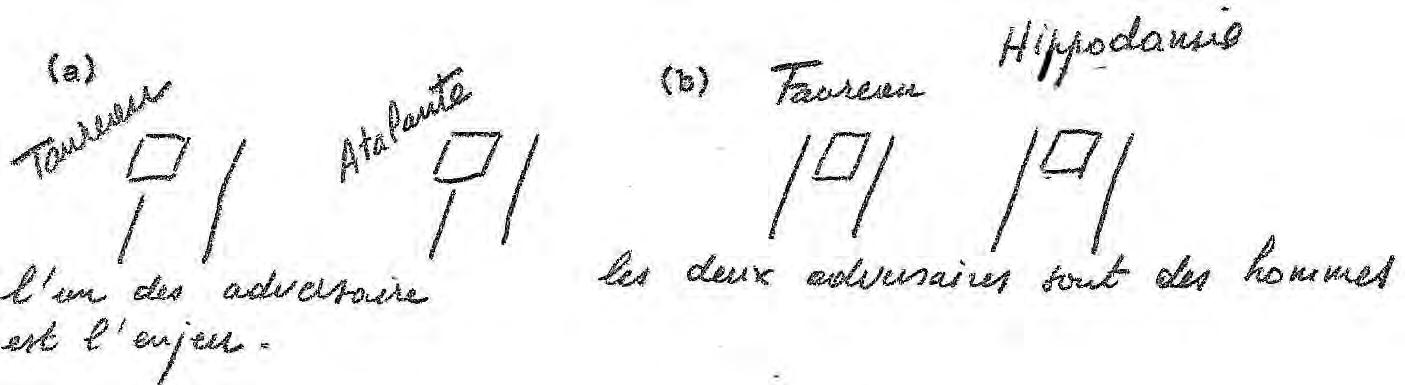
Cette analogie de développement aurait valeur de confirmation pour les analyses produites. Elle invite en tout cas à examiner la nature de la signification des enjeux dans la période préinstitutionnelledusport.
Dans les deux parties précédentes, nous avons essayé de montrer le rôle régulateur du rite présportif, son fondement social primitif, son insertion dans le système général de la croyance, puis l'évolution du modèle compétitif vers des structures symétriques. C'est cette évolution qu'il importe maintenantdemieuxapprécier.
Deux faits marquants semblent devoir retenir notre attention dans cette perspective évolutive. D'une part, le sacrifice totémique d'ordre tribal aurait tendance à se transformer en rituel d'initiation royale destiné à prouver la vertu du chef, puis en compétition aristocratique, image de marque en mêmetemps queprobationd'uneclassesocialenaissante.D'autrepart,la transformationqu'onvient d'évoquer paraît se doubler d'une régression de la présence féminine dans le sport. D'abord compétitrice,ensuiteenjeu,lafemme finiraparneplusavoirmêmeledroitd'êtrespectatrice.
Cettetroisièmepartiecomportera4chapitres:
Chapitre 8. Nature, valeur et signification des enjeux dans la période pré-institutionnelle du sport.
Chapitre9. Le sport homérique
Chapitre10. Les mythes de fondation.
Chapitre11. Diverses hypothèses sur l'origine des jeux
Nature,valeuretsignificationdesenjeuxdanslapériodepréinstitutionnelledusport.
L'ambivalenceduprofaneetdusacré,del'intérêtpersonneletdurespect deschosessurnaturelles.
Iln'yapasdejeuxsansenjeux.Cen'estpaspossibled'abordpourdesraisonsdestructure:l'enjeu estcequimobilise,metenroute,motiveetjustifieledéfi,lacompétition.
Cen'estpaspossiblenonpluspourdesraisonsdepsychologie:pourqu'onattacheduprixàune épreuve, il faut que l'enjeu en vaille la peine, que l'importance de l'effort consenti, investi, soit vraisemblable, donc matérialisé, attesté par des objets qui méritent qu'on se passionne pour leur possession.
Cen'estpaspossibleenfinpourdesraisonshistoriques:lapossessiondel'enjeusemblebienêtre unsubstitutdumeurtresacrificielparglissementdesstructures,pardissociationdel'adversaireetde l'enjeu.
Ce dernier point exige réflexion. Ceux qui aujourd'hui voudraient, pour des motifs moraux et politiques, que le sport devienne pur ou revienne à sa pureté présumée, non seulement se trompent surlanatureprofondedusport,maisencoreoublientquel'enjeudesubstitutionprotègeprobablement contreleretouràlasauvagerie,lamortréelledel'autre.
Onvoitdumêmecoupl'intérêtd'uneanalysedesenjeux.Lanaturedel'objetdesubstitutionn'est pasindifférente.Ellerenseignesurlavaleurmatérielleetsocialedesprixofferts.Ellerenseigneaussi surlessignificationsreligieusesqu'onyattache.
Cette importance de l'enjeu est très classiquement attestée. Pindare nous dit: « Ils ornèrent leur maison de trépieds, de bassins, de phiales d'or ; ils connurent la victoire et les couronnes qu'elle rapporte ».183 Homère accorde beaucoup de temps à la description détaillée des prix offerts aux vainqueurslorsdesjeuxfunèbresdePatrocle.184 GernetetBoulangerprécisentque« dansla tradition les jeux sont l'occasion des générosités princières.». Les jeux sont donnés: l'expression qui continuera à les désigner, c'est celle de titénaï (athla), « déposer les récompenses » - où l’enjeu est ungestequiestprimitivementungestededéfi.185.
Maiscequi estmoinsremarquéjusqu'ici,c'est ce dontilaété questiondanslesdeuxprécédents chapitres, la progressive différenciation des concurrents et des enjeux. Dans l'exemple d'Atalante, chacun des concurrents est un enjeu pour l'autre. Gagnante, Atalante reste libre et sauvage et elle obtient, que ce soit dans le rôle de la prêtresse d'Artémis ou dans celui de la méchante sorcière du conte, la mort d'Hippomène. Vainqueur, Hippomène reste vivant et gagne non seulement la course maisaussil'adversaire,Atalantequ'ilépouse.Dansl'exempledePélops,uneévolutiondéjàsedessine. Hippodamie cesse d'être concurrente et n'est plus un enjeu passif. En revanche, les concurrents, qui sont maintenant tous les deux des hommes, continuent à jouer chacun leur vie. L'épreuve devient symétrique. Elle est une affaire d'hommes. Dans le sport moderne, à partir du sport homérique, la mort n'est plus jouée (= risquée) mais jouée (= simulée) et les enjeux symboliques sont matérialisés pardesobjetsdeprix.
Si l'onprendappuisurletexted'Homère,lesenjeuxsont: chaudrons, trépieds,chevaux,mulets, juments, bœufs, femmes, fers de hache, cratères, vases, armes, argent. Et cette énumération dans le
183.Pindare. Première Isthmique
184.Homère. Iliade. ChantXXIII.
185.GernetetBoulanger. Le génie grec dans la religion.p.83.
désordre est pour nous fort utile dans la mesure où nous pouvons penser que le texte homérique exprimehistoriquementlepassagedurégimetribalprimitifaurégimedel'aristocratieclanique.186
Onnevoit plusdéjàchez Homèreapparaîtrecommeenjeulesprémicesde larécolte.Pourtantil estnormal,danslamesureoùlesportrelèvedesritesagraires,quelesproduitsdelanatureaillenten premier… au premier, puisque celui-ci symbolise l'esprit de l'an nouveau. Effectivement, Gernet et Boulangerontremarquéque,parmilesenjeux,ilyavaitleblé:« Dans les Eleusinia, qui sont la fête la plus ancienne du culte d'Eleusis, nous voyons, à l'époque historique, que les fermages de la plaine Rharia, versés en nature, c'est-à-dire en blé, servaient en particulier aux prix que remportaient les vainqueurs. »187 Il y avait également l'huile :« De même l'huile des oliviers d'Athéna, pour le concours des Panathénées. »188.Ilyavaitencoreunbreuvagefaitd'huiledevin,demiel,defromage etdefarine:«Aux Oschophories... celui des dix garçons concourants qui arrivait le premier recevait un breuvage composé d'huile, de vin, de mil, de fromage, et de farine. »189. Une potion magique finalement : « Ainsi le vainqueur est désigné par sa victoire pour consommer une nourriture sacrée. »190 C'estl'élixirtotémique.
On ne voit plus non plus apparaître chez Homère la manifestation du sacrifice humain effectué, l'enjeu de la vie, le crâne du perdant. Pourtant, et c'est encore Gernet et Boulanger qui en font l'observation,« les crânes... sont des trophées : on les suspend volontiers à l'arbre sacré, et le thème de la tête coupée deviendra celui d'un pouvoir magique »191. Or, nous savons qu'Oïnomaos voulait bâtir un temple avec les crânes des prétendants de sa fille Hippodamie, et que Pélops devait fournir le quatorzième. Uno Harva rapporte que « les Kalars tireraient sur un crâne d'ours suspendu à un arbre »192, ce qui nous ramènerait à l'étape antérieure de l'adversaire-enjeu. Mais on sait aussi que Gilgamesh et Enkidu coupèrent la tête du géant Humbaba après l'avoir défait en combat singulier, non sans complicités surnaturelles.193 Et on sait encore, d'après les constatations faites à lagrotte de Montespan, que, dans leurs combats sacrés avec l'ours, les antiques habitants des Pyrénées, comme lesSibériensdécritsparUnoHarva,empalaientlecrânedel'animalsacrifié.
Néanmoinsl'éventaildesenjeuxestremarquablementlargechezHomère.Déjàl'argentfigure.Le sacrificehumainyestencoreprésent.Decedernier,nousavonsparléprécédemmentdanslechapitre premier, c'est le combat d'Ajax et de Diomède. Visiblement, c'est une survivance. Inversement, l'argent ne joue qu'un rôle tout-à-fait accessoire. On le voit intervenir comme troisième prix de la vitesse.C'estentrecesextrêmesquesesituentlesenjeux,sinondetoutelapériodepré-institutionnelle du sport, c'est-à-dire avant la fondation des grands jeux, du moins dans la période homérique, qu'il n'estd'ailleurspastellementfacilededaterdefaçonprécise,enraisondestélescopagesdespériodes décrites.
Première catégorie d'enjeux: les objets dotés de propriétés magiques. Il faut commencer par évoquerquelquessombreshistoiresdetrépieds.Letrépiedestsacré;quiledétientunpouvoir.
GernetetBoulangerlerappellent:« Des trépieds, signes de vertu divinatoire – mais gages, aussi bien, de sécurité pour une terre de chef – sont disputés, enlevés, cédés.»194. On en aurait le témoignaged'Euripide:« La pythie... J'ai quitté le trépied fatidique et je franchis cette enceinte, moi, la prophétesse de Phoibos, choisie entre toutes les Delphiennes pour veiller sur l'antique coutume du Trépied. »195
186.P.F.Préobrajenski. Dans le monde des idées et images antiques.Moscou.1965.Reprised'articlesécritsdansles années20, 30.
187.GernetetBoulanger. Le génie grec dans la religion.p.50.
188.GernetetBoulanger. Le génie grec dans la religion.p.50.
189.GernetetBoulanger. Le génie grec dans la religion.p.50.
190.GernetetBoulanger. Le génie grec dans la religion.p.50.
191.GernetetBoulanger. op. cit.p.77.
192.UnoHarva. Les représentations religieuses des peuples altaïques.Gallimard.1959.p.298.
193.Contenau. L'épopée de Gilgamesh.1939.3eédition.p.104.
194.GernetetBoulanger, op. cit.p.85.
195.Euripide. Ion
Mais un trépied a également une valeur marchande et Homère va jusqu'à la préciser. Le trépied qu'il attribue, qu'Achille attribue, au vainqueur de la lutte est un trépied qui vaut douze bœufs. Pour situerleschoses,lesecondprix,unefemme,estévaluéàquatrebœufsseulement.
Le trépied est chose qui peut faire rêver. Chez les dieux, Homère les imagine mécaniques et marchanttoutseuls,cequilaisseraitsupposerqued'habilesartisansdel'époquedevaientparfoisêtre capablesderéaliserdesprodigesd'ingéniosité.196
Mais le trépied est signe encore de profonde sagesse. Diogène Laërce se fait l'écho, après tant d'autres, d'une histoire compliquée où il est question d'un trépied que des pêcheurs tirent de l'eau, à propos duquel ils se disputent et finalement s'en remettent à l'oracle de Delphes pour trancher leur débat. On leur répond qu’il faut donner le trépied au plus sage. Alors on le donne à Thalès qui le donneàunautreetcetautreàSolonqui,estimantqueleDieuestleplussagedetous,remetletrépied àDelphes.197
Sedisputeruntrépiedsignifiedoncprétendrerévélerqu'onpossèdeunsavoiretunpouvoir.C'est un signe extérieur magique de puissance et de vertu. C’est pour un tel enjeu que s'affrontent à l'épreuve de la lutte Ulysse et Ajax, le fils de Télamon. Et le combat s'achève par un match nul, la victoire ou désignation du meilleur n'allant à personne, tout comme dans l'anecdote du trépied des pêcheurs qui passe de mains en mains entre les sept sages de la Grèce. C'est aussi pour faire démonstrationdeleurpouvoirsurl'oracledeDelphesqu'HerculeetApollon,refletvraisemblabledes conflitsentrelesvaguesdemigration,sedisputentletrépiedpythique.Pausaniasnousdécritlascène: « HéraclèsetApollonsontagrippésautrépiedetsepréparentàcombattreà sonsujet.LétoetArtémis calment Apollon tandis qu'Athéna retient Héraclès. »198
Mais on n'est pas loin d'hésiter entre le profane et le sacré et l'ambivalence prédomine. Le champion fait toujours partie d'un système théologique qui fonde le rituel sportif. Mais il aura fortement tendance à se conduire déjà en individualiste. On le voit dans l'histoire que rapporte Hérodoted'uneprofanationpureetsimpledel'enjeuparunindividuquifaitbandeàpart,suivied'une répression collective, nous dirions aujourd'hui d'une suspension à l'égard de la cité à laquelle appartenaitcetindividu.
La compétition est une cérémonie. Voici l'histoire: « Dans les jeux célébrés en l'honneur du Triopion, les prix offerts aux vainqueurs étaient autrefois des trépieds de bronze qui ne devaient pas quitter le temple et qu'il fallait consacrer sur place au Dieu. »199 Mais il y aen aun qui ne joue pas lejeu:« Un habitant d'Halicarnasse, Agasiclès, vainqueur aux jeux, emporta son trépied au mépris de la loi pour le suspendre au mur de sa maison.»200 Évidemment, on ne doit pas suspendre un trépiedsacrésurlemurd'unehabitationetlaréponseàcetteprofanationserajustement collectiveet ignoral'individufautif.C'estpourquoi« lesDoriensdescinqvilles-lePentapole d'aujourd'hui,qu'on appelait autrefois l'Hexapole, les six villes - ont grand soin d'exclure de leur sanctuaire du Triopion tous les Doriens de leur voisinage, et ils l'interdisent aussi à ceux d'entre eux qui ont transgressé les lois... Les cinq autres villes Doriennes, Lindos, Lalyssos,Camiros, Cnos et Cnide ont interdit l'entrée du sanctuaire à la sixième, Halicarnasse. »201
Autre objet magique, le chaudron. Chez Homère, c'est le troisième prix de la course de chars, maisil estpréciséquecechaudronnevapasaufeu.Lechaudronest parédesvertus magiquesdela purification.PindarenousrappelleraqueClôtôretiraPélopsduChaudronpurificateur,l'épauleparée del'éclatdel'ivoire202 etilfaitallusionàMédée,lameurtrièredePélias,quiavaitfaitcroireauxfilles decedernierqu'elleétaitcapable,parlapuissancedesamagie,derajeunirleurpère Elleavaitdonné pour preuve de ce pouvoir le rajeunissement d'un vieux bélier coupé en morceaux et jeté dans un
196.Homère. Iliade.ChantXVIII.Vers376-377.
197.DiogèneLaërce. Vies, doctrines et sentences des philosophes illustres.Thalès.
198.Pausanias. Description de la Grèce.LivreX.XIII,7.
199.Hérodote. L'enquête.I,144.
200.Hérodote. L'enquête.I,144.
201.Hérodote, ibid
202.Pindare. Première Olympique
chaudron.203 Or,MédéevenaitdeColchide,c'est-à-direduCaucase,del'undeslieuxdefondationde la métallurgie et il n'est pas besoin de s'attarder sur toute la magie qui entoure le feu, le travail des métaux.
Le chaudron doté de propriétés merveilleuses se maintiendra dans l’imaginaire poétique des peuples. Dans le Mabinogi de Branwen qui appartient à la littérature galloise du XIIème - XIIIème siècle, un guerrier géant, sorti tout armé, avec sa femme deux fois plus grande que lui, d’un lac d’IrlandefaitdonàBendigeitVrand’unchaudronmagiqueoùlesmortsressuscitent.C’estcemême chaudrondontontrouveraencorelaprésencedansShakespeareaveclessorcièresde Macbeth. 204
Mais Aristophane saura déjà se servir du mythe en présentant ironiquement un Démos rajeuni après être passé « à travers une préparation culinaire. »205 . Et Max Kaltenmark montre que l'idée religieused'éminentevertuquis'attacheàceschaudronsestuniverselle: « La fonte de ces objets était une préparation religieuse qui exigeait un sacrifice humain ; elle était conçue comme unehiérogamie métallique, conception que l'on retrouve plus tard dans les théories alchimiques. »206 L'auteur poursuit: « Les plus célèbres de ces palladia étaient les chaudrons magiques qui avaient été fondus par Yu et que les rois Tchéou conservaient dans leur trésor. Seule une vertu royale pouvait les posséder ; un prince qui essaya de les enlever n'y parvint pas car ils étaient trop lourds pour lui. Mais quand la vertu dynastique des Tchéou fut épuisée, les chaudrons s'envolèrent et disparurent dans l'eau d'une rivière. »207
Autresobjetscomplétantcettepremièrecatégoried'enjeux:lecratèred'argentquisertdepremier prixàlavitesse,le vase àdeux ansesqui constituele cinquièmeprixde la coursedechars, lacoupe à deux anses qui revient au second de la boxe et le vase n'allant pas au feu pour le deuxième du javelot.
Une deuxième catégorie d'enjeux pourrait être constituée par ce qu'on pourrait appeler, par survivance,letributhumain.OnsaitqueMinosgardaitlesjeunesAthéniensetlesjeunesAthéniennes pour les décerner en récompense aux vainqueurs de ses jeux, et l'on sait aussi qu'Ilios, fils de Tros, victorieux en Phrygie dans les épreuves organisées par le roi, reçut en prix cinquante garçons et cinquante filles.208 Traces de l'esclavagisme à sonétat naissant ?ou plutôt souvenir confus des dichotomies tribales destinées à éviter la consanguinité et donnant droit aux cousins d'exiger les cousines pour épouses comme ces fils d'Aegyptes poursuivant les filles de Danaos rebelles à l'ordre établi?209
AvecHomère,dansl'Iliade,noustrouvonspourlepremierprixdelacoursedecharsunefemme à emmener plus un trépied à anses, la femme étant présentée comme une ouvrière irréprochable, et pour deuxième prix de la lutte, donc pour le vaincu, une femme dont on dit qu’elle savait faire beaucoupd'ouvragesetquel'onestimaitàquatrebœufs.C'esticiquel'onvoitàquelpointlafonction de la femme dans le sport a évolué depuis Atalante et Hippodamie. Elle n'est plus avec l'homme comme Atalante. Elle n'est plus non plus l'enjeu royal qui symbolise la terre et le pouvoir comme Hippodamie.Ellereprésenteunevaleuréconomiquequantifiableetsoumiseàl'autoritémâle. Il est vrai que chez Homère, il y a aussi, dans l'Odyssée cette fois, l'image de Pénélope. On y discerne encore le télescopage des fonctions sportives de la femme dans l'institution sportive. D'un côté, il est clair que lorsque Pénélope doit décider de son remariage, elle se réfère instinctivement à une vieille couture hiérogamique pour que le choix du prétendant s'effectue sans contestation possible.Celaveutdirequel'ons'enremetauciel.CelapeutvouloirdirequePénélopeelle-mêmese désintéresse du résultat et refuse de faire état de ses sentiments particuliers. Mais c'est encore une manière de dire qu'elle n'admet pas de prétendant inférieur au mari précédent. En tout cas, dans le
203.Pindare. Quatrième Pythique
204.Shakespeare. Macbeth.ActeIV.Lessorcièrestournentenrondautourduchaudronoùbouillonnedelasouped'enfer.
205. Aristophane, vers la fin des Cavaliers : « Le charcutier. Je viens d’accommoder Démos... Démos. Quel bien tu m'as fait en me faisant passer à travers cette préparation culinaire.»
206.MaxKaltenmark. Religion de la Chine antique.«HistoiredesReligions1».EncyclopédiedelaPléiade.p.935.
207.MaxKaltenmark. Religion de la Chine antique.«HistoiredesReligions1».EncyclopédiedelaPléiade. p.935.
208.GernetetBoulanger. Le génie grec dans la religion.p. 83.
209.Eschyle. Les Suppliantes
poème,cetteprocéduren'apparaîtpascommeunacteoriginald'imagination.Certainsserendentbien comptequ'elleleurfaitperdretoutechance,maisilssegardentbiendemurmurer,cequ'ilsn'auraient pas manqué de faire s’ils avaient pu invoquer le caractère insolite de la méthode de désignation proposée. En fait, Pénélope nefait quereprendre pourson remariage éventuel l’usage qui avait déjà été accompli pour son premier mariage. On dit qu’Ulysse l’avait gagnée à la course. Seule la disciplinesportiveachangé.
D'unautrecôté,ilestassezétonnantdevoirTélémaquefairel'articleàproposdesamèreauprès desprétendantsetexigerledroitdemanierl'arclepremieretderacheterainsisamère. « Prétendants, vous voyez ici le prix du combat : une femme qui n'a pas sa pareille sur la terre achéenne, ni à Pylos ville sacrée, ni à Argos, ni à Mycénes, ni même à Ithaque, ni sur le sombre continent. Cela, vous le savez. Ai-je besoin de venir vous vanter ma mère ? Ne perdez pas de temps. N'attendez plus. Tendez cet arc. Que l'on vous voit à l'action. »210 Hiérogamie, oui, bien sûr; il s'agit d'une arme sacrée: Eurytos,roid'Œchalie,enThessalie,l'avaitléguéeàsonfilsIphitosenmourantetIphitosl'échangea par amitié avec Ulysse contre d'autres armes alors qu'ils étaient tous deux à la recherche de bêtes perdues ou dérobées. Mais c’est en contrepartie de la valeur financière d'un fief qui se transmet par voieféminine,enépousant,quel’épreuvesportivemetenévidencelesqualitésdeforceetdecourage propresàlabonnegestiondudomainedansdesconditionsextérieuresd'insécurité.
Unetroisièmecatégoried'enjeuxconsisteenanimaux,etc'estnormalpuisquenoussommesdans une civilisation où l’élevage joue un rôle prépondérant. C'est, dans le cadre des jeux de L'Iliade qui continuentdenousservirdesystèmederéférenceetdecomparaison,lajumentindomptéeetlemulet quisontledeuxièmeprixdelacoursedechars,lamuledesixanségalementindomptéequivienten premierprixdelaboxe,lebœufquireprésentelesecondprixdelavitesse.
Ilyaencoreunequatrièmecatégoried'objets.Cesontlesarmes,lesoutilsetlemétallui-même. Cesontleglaiveàclousd'argentetlesautresarmesàpartagerquifigurentcommeenjeuxducombat àoutrancequeselivrentAjaxetDiomède.C'estleblocdeferquisertàlafoisd'instrumentetd'enjeu dupoids.Ce sontlesdixdoubleshachesetlesdixhachespourl’arcetenfin lapiquelonguecomme premierprixdujavelot.
Uno Harva, traitant des fêtes funèbres Kirghizes et Kazakhes, parle, dans un contexte analogue auxjeuxfunérairesdePatrocle,deprixapportésdanslamaisonmortuaire etdecoursesdechevaux. Il fait étatde travaux de Radolffqui mentionne dix prix. Le premierserait une petiteyourte endrap rougeavectoutsonmobilier,unejeunefilleencostumedefiancéeassisesurunchevaletcinquante animaux de chaque espèce: chameaux, chevaux, vaches, moutons. Le dernier prix était de cinq chevaux.211
210.Homère. Odyssée.ChantXXI.
211.UnoHarva. Représentations religieuses des peuples Altaïques.p.232.
Lesporthomérique. Àdéfautd’immortalité,lagloire.
Lechapitreprécédentconsacréàl'examendesenjeuxdanslapériodepré-institutionnelledusport prenait pour centre de perspective les jeux funèbres en l'honneur de Patrocle dans l'Iliade. Il apparaissait que le sport était lié aux représentations religieuses, les trépieds par exemple, et aux moyenstechnologiquesdel’époque,commeparexempleleblocdeferetlesarmes,del'époque.On discernait à la fois un télescopage provenant d’enjeux visiblement hérités de moments historiques différents,allantducombatàoutrance,doncdesacrificehumain,jusqu'àlasommeverséeenespèces, et, en même temps que ce télescopage, peut-être une hésitation entre une vision théologique et une visionintéresséedelaréalitésportive.
Chez Homère, le sport semble en effet se situer à la limite indécise du sacré et profane, dans un mélangecurieuxdesignificationsreligieusesetd'intérêtsprimaires.Lesdieuxsontomniprésents,peu scrupuleux et fort pénétrés de leur statut divin. On est frappé de voir des procédures sportives déjà trèsmodernes,commeletirageausortetlechoixdescouloirs.Onestfrappéducaractèretrèsactuel decessupportersquisechamaillentetparient,decesconcurrentsquirusentouquicontestent.Mais l'actionsportivecontinueàparticiperdusurnaturel.C'estunactereligieux.Àlacourse,lorsqu'Ajax etUlyssesontaucoude-à-coude,c'estl'interventiond'Athénaquidécidedelavictoiresurunincident de course burlesque :c’est qu’Ulysse a prié et sollicité le secours de la déesse. De même, dans l'épreuvedel'arc,entrel'adressedeTeuceretlavirtuositédeMérion,ilyalesoutiendivind'Apollon quiétablitladifférence.Teuceranégligédepromettel'hécatombe,Mérionyasongé.
Il faut bien comprendre que le champion homérique se situe à égale distance entre le monde extraordinaire des dieux et le monde ordinaire des hommes. C'est la double conscience de cette limitation-leshérosnesontpasdesdieux-etdecetteinsatisfaction-ilsneveulentpassecontenter de la banalité d'un destin médiocre - qui justement les pousse à la gloire, à l'exploit. À défaut d'immortalité, la gloire. « Si nous devions toujours être exempts de vieillesse et de mort, moi-même je ne combattrais pas dans la bataille glorieuse ; mais, puisque, de toute façon, les divinités de la mort se dressent près de nous par milliers - et il est impossible à un être humain de les fuir, ou de les éviter -, allons, donnons de la gloire à autrui, ou bien qu'il nous en donne. »212
Nesoyons pasdupes decette idéalisation. Lespoètes embellissent lessujets qu'ils touchent. Les individus excellent à couvrir leurs actions des motifs les plus nobles. L'idéologie moralise ce qui n'était pasobligatoirement recommandable. Walter Leaf,213 et àpartir de lui,Arnold Van Gennep214 ont disserté sur l'Iliade poème économique et, sans attenter à la poésie, restitué les proportions. «Troie… était une de ces villes d'Orient où un commerce et une industrie très actifs ont accumulé, des siècles durant, des produits venus de loin ; le fait est que les débris découverts ne sont pas tous indigènesettémoignentd'uneaisancequidevaitdésignerTroieàl'avidité despiratesetdesrazzieurs. Et les Grecs n'étaient guère autre chose. Voyez le soin d'Achille à accumuler sous ses tentes les produits de ses rapines, l'avidité, dans le chant XXIII, des rois pour les présents - tous produits du vol armé - qu’Achille offre en prix aux coureurs, aux boxeurs, aux lanceurs de disque et de javelot. Donc, Orientaux industrieux et amants de belles choses, Occidentaux courageux et pillards. »215 Pas
212.Homère. Iliade.ChantXII.vers322-328.
213.Leaf. Troy.a Study in homeric Geography.London.1912.
214.Arnold VanGennep. L’Illiade, poème économique.Dans"Religions,MœursetLégendes" 5èmesérie.MercuredeFrance. 1914.
215.VanGennep, op. cit.p.80
de doute possible. « La guerre de Troie fut une entreprise considérable, et non pas un fait divers héroïco-sentimental. Homère, en bon poète, a utilisé des situations et conduit logiquement plusieurs intrigues. »216
Homère nous apporte un triple témoignage sur le sport. Il y a en effet au moins trois textes significatifs pour l'enquête que nous menons. D'abord dans l'Iliade, les jeux donnés par Achille en l'honneurdePatrocle.Onyvoitclairementexpriméslesliensdusportaveclamort.Cesontdesrites funéraires. Ensuite, dans l'Odyssée, les jeux organisés par les Phéaciens dans l’île d'Ithaque. Ici, il s'agit visiblement d'un rite aristocratique de reconnaissance. Des maîtres rejouent entre eux une situationacquisedesupériorité.Ulyssehésite-t-ilunseulinstantàs'aligner,onl'accuseaussitôtavec force sarcasmes, de ne pas être un noble, mais un marchand vulgaire. Il en résulte d'ailleurs une dispute sérieuse. Enfin, dans l'Odyssée toujours, la façon dont Pénélope organise son remariage, par l'épreuvedutiràl'arc,nousoffreencoreuneautrefacedusport,sonaspecthiérogamique.
Le premier de ces textes donne l'occasion de faire une foule d'observations intéressantes. Il est inutilederevenirsurl'importancedesenjeuxetlanaturedesrécompensesaccordéesauxvainqueurs. Les chaudrons font référence à la métallurgie naissante, son prestige et ses secrets. Les trépieds ont valeur divinatoire et symbolisent la puissance exercée sur un lieu. Les femmes esclaves annoncent quelaGrèceclassiquesecaractérisera,commeonl'asignalé,parundoublerefus,refusdelafemme (la cité est un club d'hommes), refus de l'esclave (c'est un club de citoyens).217 Le fer utilisé pour le lancementdupoidsetquisertenmêmetempsd'enjeurappellequ'onentredansunâgedufer.Onne serapasétonnédevoirapparaîtreenpremièreplacela coursedechars,compétitioncriantedevérité et qui pourrait être actuelle. Les Indo-Européens, au début du deuxième millénaire, en arrivant en Grèce, ont amenéaveceux le cheval auquelils attribuent un pouvoir magique surles sources, sur la fécondité et sur les forces souterraines. C'est eux qui créeront Poséidon, le dieu-cheval, ce « Maître de la terre ».218 Lefaitestd'importance.Unemajeurepartiedudéveloppementdusportvadésormais s'effectuer sous le signe du cheval qui prend ainsi en quelque sorte la relève du taureau. L'image du char vient amplifier cette signification de puissance. Gernet et Boulanger le rappellent: « Char nuptial, les rites du mariage ne cesseront pas de la comporter : en Pélops comme en Pélée, il atteste aussi le roi. Il va de soi que les dieux ne peuvent s'avancer que sur des chars... Mais, autre image mythique, c'est un char qui emporte au ciel le roi mort... Le schéma restera exactement le même : au cœur de la procession sinon au milieu, le char des époux, le char du triomphateur, le char du mort, le char du prêtre ou du dieu. »219
On s'expliquel’ampleur dela place accordée à la description de la course decharsdans le chant XXIII de l'Iliade. L'adhésion au sacré n'y exclut pas le détail vrai qu'on pourrait encore voir de nos jours. C'est le vieux Nestor donnant des conseils techniques et tactiques à son fils avant le début de lacompétition.C'estletirageausortdesplacesavantledépart.C'estlebluffd'Antilochosquioblige Ménélasàs'écarteretàlelaisserpasser.C'estlaprotestationdecedernieretlesexcusesdupremier. C'est Achille qui essaie de trafiquer les enjeux en faveur d'Eumélos et la contestation qui en résulte. C'est l’évocation du passé sportif de l'ancien, le vieux Nestor. Ce sont les disputes et les paris des spectateurs,AjaxetIdoménée.Mais,danscetteaffaire,lesdieuxsontassezpeusportifsetfontpreuve d'une absence totale de dignité, se conduisant comme on ne permettrait plus de le faire aujourd'hui auxpiresdenossupportersdontonditpourtantvolontierstantdemal.Apollonfaitéchapperlefouet des mains de Diomède qui se trouve ainsi désarmé. Et Athéna, en représailles, brise le joug de l'attelaged'Eumélos,cequi,enpleinecourse,estextrêmementdangereuxetsouventmortel.
L'analysedesdifférentes épreuvessportivesprésentéesparHomèredansl'Iliade montrequel'on se trouve généralement devant le schéma suivant: description des prix, appel et présentation des
216.VanGennep, op. cit.p.90.
217. Vidal-Naquet. Esclavage et gynécocratie dans la tradition, le mythe et l'utopie. "Recherches sur les structures sociales dans l'antiquité classique" (Colloque du CNRS, Caen 25-26 avril 1969). René Van Compernolle. Le mythe de la gynécocratiedoulocratie argienne."Lemondegrec.HommagesàClairePréaux".Bruxelles.1975.
218.Vian. Grèce archaïque et classique."Hist.DesRelig.1".p.500.
219.GernetetBoulanger. Le génie grec dans la religion. p.79.
concurrents,récitdespéripétiesdel'épreuveetdesréactionsdupublic,palabresaprèslacompétition.
Nous avons déjà eu l'occasion de dire ce qu'il en était pour la course de chars où, image encore employéedenosjours,lesjumentsreculèrent.Ilenvademêmepourlaboxeoùl’onfrappeàpoings levés,oùlebraveEuryaled'abordtouchéàlajouesubitunK.O.sévère,commeunpoissonsubmergé par la puissance de la mer, lorsque le vent, dit Homère, le jette sur le rivage, le fait rebondir sur les algues et lorsque la vague noire le recouvre aussitôt. Le vainqueur magnanime, Epéos, relève son adversaire, le prend dans ses bras, le redresse, et le remet aux compagnons de celui-ci qui « l’emmenèrent à travers l'assemblée, les pieds traînants, crachant un sang épais, la tête rejetée de côté », sans oublier, en partant avec leur champion privé de connaissance, d'emporter le prix du vaincu, la coupe à deux anses. Même schéma pour la lutte où aucun des adversaires ne parvenant à prendrel'avantage,lepublicselasse.AjaxetUlysses’enrendentd'ailleurscompteetfontdelouables effortspouranimerleurcombat.MaisAchille,danslasituationdoubled’arbitreetd'organisateurde spectacle,déclarelerésultatnulpournepasennuyerdavantagelepublic.Mêmeschémad’exposition toujours pour la course à pied où Ajax et Ulysse sont foulée dans foulée, tandis que le jeune Antilochos,l'espoirdesjuniors,suitdeloin.C'estlàqu’Athénaintervientenfaveurd’Ulyssequisent sesmuscless’alourdiretl’onassiste,lesdieuxantiquesétantaussifarceurs,àunefindecourseplutôt burlesque. Ajax glisse sur les bouses de bœuf qui lui emplissent la bouche et les narines et tout le mondederiregentimentdelaconclusioninattenduedususpense.Ilyenaund'ailleursquinemanque pas d'astuce, c'est le jeune Antilochos arrivé bon troisième. Il fait remarquer qu'une génération le sépared'Ajax,deuxd'Ulysse,quelesvieuxsontencoresolidesauposteetqueseulAchilleauraitpu battreUlysse.DucoupAchilledoubleleprixd'Antilochos. C'estàcemomentquesesitue,dansletextehomérique,cetépisode,étrangepournous,dontnous avonsdéjàparlédanslepremierchapitre,quicontrastesifortementaveclestylepresquemodernede toutcequiaprécédé.Ils'agitducombatàoutrance,dudueljusqu'ausang,queselivrentDiomèdeet Ajax, le fils de Télamon. Peut-être nous trouvons-nous là devant l'élément sacrificiel le plus ancien du cérémonial funéraire. Ainsi s'expliquerait sa survivance au milieu de compétitions de caractère nettement aristocratique et historiquement plus évoluées. Son importance serait attestée par sa persistance ausein d'un contexte étranger.Son archaïsme serévélerait par lefait que les spectateurs qui n'ont pu se dérober au rite inévitable n'en perçoivent plus la signification, s'effraient du risque insensé couru par lesdeux protagonistes etréclament l'arrêt du combat, ce à quoi Achille ne semble vouloirsouscrirequed'assezmauvaisegrâce.
Onenrevientaussitôtàdesconcourshumainementsupportables.C'estlelancementdupoids.On observera le détail qui fait vrai. C'est Epéos, concurrent un peu ridicule dont la faible performance attire le rire des spectateurs. C'est Ajax qui semble devoir l'emporter. C'est enfin, coup de théâtre, Polypoètesquivientsurclassertoutlemonde.Maisonretiendraaussicefait déjàsoulignéplushaut que leblocde ferremplit un doubleemploi, àla fois instrument dela compétition etenjeu. C'est en mêmetempsuneinformationsurlecaractèreprécieuxduferetsurlespossibilitéséconomiquesqu'il offre, un témoignage sur la genèse progressive des structures sportives où l'enjeu, l’adversaire et l'instrumentdecompétitionnesontpastoujoursdifférenciésdèsl’origine.
On en arrive à l'épreuve de l'arc. Teucer et Mérion s'avancent comme concurrents. Dix doubles haches constituent le premier prix et dix haches simples le second. La cible est verticale. On dresse le mât d'un navire sur le sable. Une colombe y est attachée par la patte avec une corde fine. On tire au sort, dans un casque garni de bronze, l'ordre dans lequel les adversaires vont tirer. Teucer tire le premierettranchelacorde.Mérionluiprendl'arcdesmains,atteintl'oiseauenpleinvolquiretombe sur le mât. Deux observations seraient à faire. D'abord, le mode de tir à l'arc est différent de celui qu'on retrouveradans l'Odyssée lorsqu'il s'agira du remariagede Pénélope. Ici, le tir est vertical. Là, il sera horizontal. Ensuite, l'intervention divine qui tranche, qui fait la différence entre deux champions dont l'un a pensé à s'adresser aux dieux. Apparemment, cela donne brusquement une couleurarchaïqueàunesituationquiparailleursnedésorientepastroplesportifmoderne.Maisquel est le sportif qui ignore cette importance du détail impondérable, du souffle, du cheveu, du presque
rien sur lequel se joue une victoire ou une défaite, ce qui fait retomber la barre ou la fait seulement frémir? Quelestlechampionquiunjournes'estrassuré,concentré,tranquillisé,motivéenadoptant instinctivementuncomportementdetypeplusoumoinsmagique?
C'estlejavelotquiintervientautitredeladernièreépreuve.Curieusementlarencontren'aurapas lieu. Certes, on propose des prix: une pique longue et un vase n'allant pas au feu. Certes, des concurrents se présentent: Agamemnon en personne et Mérion. Mais Achille avec une sorte de précipitationprendlesdevants.Ildonneleprixd'avanceàAgamemnonqu'ildéclarelemeilleur.Que se passe-t-il ? On peut supposer que le roi Agamemnon qui est le généralissime ne s'est pas avancé jusque-làparcequesonranglecondamneàresterspectateuretneutre,demêmequ'Achilledeparsa situation d'arbitre; probablement, n'y tenant plus, il ne résiste pas à la tentation de s'avancer pour l'ultimeépreuve.Maisquelembarrass'ilestvaincuetquelleinjustices'ilestvainqueur?Dansuncas, ondiraqu’ils'estridiculisé,dansl'autre,quel'adversaireamontrédelacomplaisance.Etpuis,lechef peut-ilimpunémentsemesureràseslieutenantssansfroisserleuramour-propreoulesien?Ilesttrop visiblequelesportquifonctionneencontre-société-absencedehiérarchiepréalable-n'apasintérêt à interférer avec la hiérarchie sociale. Aussi Achille, plutôt que de déclencher des règlements de comptes en série entre ces chefs de bande que sont les rois grecs, préfère laisser intacte l'autorité suprêmedéclaréehorsconcours.
Le second passage d'Homère consacré au sport figure dans l'Odyssée. Ulysse vient de faire naufrage.Ilestaccueilli,recueillidansl'îledesPhéaciens.Desspectaclesetdesjeuxysontorganisés. Onl'inviteàparticiperauxépreuvessportives,etmêmeàproposerdesépreuvesnouvellesquiseraient en usage dans son propre pays. Ulysse, peu motivé étant donné les circonstances par la compétition sportive,refuse.Etaussitôtl'incidentéclate.Onaccusenotrehérosdenepasêtrenoble.Iln'estqu'un vulgairemarchand.
Onvoitapparaîtreiciparlebiaisd'unetoutepetitephrasedutexte,unenouvellesignificationdu sport.Lesportestunritedereconnaissancearistocratique.Lecouragephysiqueestunevaleurnoble. Il définit la race de ceux qui préfèrent mourir physiquement que de s'avouer vaincus. Ce qu'on demanderait à Ulysse, ce serait de révéler son rite d’initiation royale. Il prouverait ainsi son rang social.
Mais le rite aristocratique peut aussi s'expliquer d'une autre manière. Le maître s'affirme par opposition à l'esclave. Le premier préfère sa liberté à sa vie, la situe plus haut dans l'échelle des valeursetdesbiens.Lesecondfaitlechoixinverse:lavieluiestpluschèrequesaliberté.Lepremier est politiquement survivant (vivant au-dessus des autres) parce qu'il a osé prendre le risque d'être physiquement mort. Le second est métaphysiquement mort (les esclaves égyptiens sont les mortsvivants,lesmortsqu'onalaissésvivants)pourpouvoirconserveruneviephysiquequitombedansla possessiondumaître.DanslejeudesPhéaciens,lesportestvisiblementunsignedereconnaissance: les maîtres rejoueraient en commun au niveau du rite, c'est-à-dire encore une fois des significations oubliées,lamarqued'origined'unesupérioritédeclasse.
Le vif échange de propos mérite d'être retenu. Euryale et Laodamas invitent Ulysse à s'essayer aux jeux. Pas de plus grande gloire qu'une victoire sportive, affirment-t-ils. On ne peut dire plus clairement que les valeurs sportives sont des valeurs sociales. Ulysse répond en substance qu'il n'a pas le moral. Euryale aussitôt bondit: tu n'es pas un athlète mais un marchand. La distinction de classe est nettement exprimée : l'un recherche la gloire, l'autre le profit, ils n'appartiennent pas au même monde, n’ont pas les mêmes raisons de vivre. Effectivement l'argument porte. Ulysse est indiscutablement mortifié. Il réplique:« Tu es beau, mais tu as la tête vide. Je réponds à ta provocation.» Alors Ulysse, sans quitter son manteau, saisit un disque plus grand que les autres, lourd et massif, le fait tourner, le lâche. La pierre siffle et, toujours le petit détail qui fait vrai chez Homère, les Phéaciens baissent instinctivement la tête. Et, brusquement déchaîné, le héros lance un défià tous, sauf àLaodamas qui estle filsde sonhôte, dans n'importe quelexercicesportif, pugilat, lutte ou course à pied. Il rappelle son habilité à l'arc; mis à part Philoctète, Hercule et Eurytos d'Œschalie, il ne craint personne à titre de comparaison. Il est prêt aussi à se battre à la lance. Manifestement, les esprits s'échauffent et, avec beaucoup de sagesse et de prudence, Alcinoos
intervient.C'estunparfaitcompromisdiplomatique:« Nous ne sommes pas irréprochables à la lutte ni au pugilat. Mais nous sommes de rapides coureurs et d'excellents marins ». Et, sans tarder, on passeàautrechose.
Onnepeutpasnepasêtrefrappédevantcettefinrapideetdiscrètedesépreuvesetsurtoutdevant sasimilitudedesituationaveclafindesjeuxdansl'Iliade.Danslesdeuxcas,onsemblecraindreque laviolences'introduisedanslesport.Larencontrerisquededégénérer.Dansl'Iliade,onn'apasvoulu laisser concourir Agamemnon. Dans l'Odyssée, on se garde de relever les défis d'Ulysse. Il est clair que le jeu excite les passions. On a vite fait d'oublier, dans un cas, le caractère funéraire et sacré de la cérémonie au profit de l'attrait des enjeux et du prestige personnel, dans l'autre, le sens de l'hospitalité,lasolidaritéaristocratiqueetlegoûtduspectacle.
Celadit,ilexistequelquesdifférencesentrelesjeuxdel'Iliade donnésenmémoiredePatrocleet les jeux de l'Odyssée organisés en l'honneur d'Ulysse. Différence d'occasion d'abord :la mort d'un côté, l'accueil d'un étranger de l'autre. Différence de lieu ensuite : sur le rivage de Troie dans le premiercas,surl'agoradesPhéaciensdanslesecond.Différencesencoredanslalistedesépreuves: silaboxeoupugilat,lalutte,lacourseàpiedseretrouventdepartetd'autre,l'Iliade yajoutelacourse de chars, le lancement du poids, l'arc, le javelot et même le fameux duel à outrance, tandis que l'Odyssée mentionneenpluslesautetledisqueetévoquel'arcetleduelàoutrance. Ilyauntroisièmepassaged’Homèrequirequiertl'attentiondel'historiendusport.Ilsesituedans l'Odyssée. Il s'agit du fameux remariage de Pénélope et de l'épreuve du tir à l'arc. Poussée par les prétendants qui la pressent de se déclarer, Pénélope s’en remet à l'arbitrage du sport. Étrange et déroutantedécisionpourunlecteurmodernequiauraittendanceànepascomprendreunépisodequ'il attribuerait volontiers à l'imagination débordante de l'auteur. Mais il n'y a rien là cependant de fantaisiste et d'ailleurs la proposition n'étonne personne, paraît raisonnable et naturelle à tout le monde. Il ne se trouve personne pour la contester. C'est que nous sommes là en présence d'une hiérogamie sportive, procédure sacrée du mariage que nous avons déjà abordée dans le troisième chapitre.Noussavonsquelesexemplesensontnombreux.
Maisici,c'estsurtoutl'occasiondesesouvenirdecettelégendeselonlaquelleUlysseauraitgagné Pénélope à la course. Autrement dit, Pénélope, sans faire preuve d'imagination le moins du monde, organisesonsecondmariageselonlesprocéduresdupremier.
Une telle procédure hiérogamique n'est pas absurde dans le contexte socio-culturel de l'époque. Lajustificationestdouble,socialeetcosmologique.Socialement,ilestasseznormalquenesoitadmis à réaliser un mariage princier que celui qui réunit au plus haut degré les qualités les plus appréciées danslasociétéoùilsetrouve.C’estuneépreuvematrimoniale.Or,commelesvaleursnécessaires(,) et par conséquent les plus recherchées sont, dans la société donnée, la force physique, la ruse et l’aptitudeàvaincre,ildevientexplicablequ’onrèglelaquestionauvuetausudetoutlemonde,sans tricherie, sans arrangements possibles, en vue d’une désignation automatique du meilleur, par voie deconcourssportif.D’autantquecemeilleurestgarantireligieusement,puisquelaloisportivequile désigne s’appuie sur un ordre cosmique. C’est donc aussi une épreuve métaphysique. Dans le rite hiérogamique,levainqueurestenquelquesorterévélé,manifesté parlavertucosmiqueàlaquelle il participe.
Onnedoitpasoublier,eninterprétantcestexteshomériquesnousdécrivantunétatpré-olympique du sport, que nous assistons à un processus de dissolution du clan ancien et que ce processus dans l’Odyssée est encore plus apparent que dans l’Iliade. Il semble bien, dit Préobrajenski, que le vieux principeclaniqueselonlequellaterreappartientàtoutelatribucommesonbiencollectifsoitébranlé. La question agraire se pose et le processus de formation des classes est la cause essentielle du phénomène de colonisation, ce trait caractéristique de l’histoire grecque des -IXe-au -VIIe siècles. L’Odyssée est le reflet de cette situation. Quand elle décrit les cyclopes, peuple sauvage et agité, comme la négation de la culture, elle annonce la polis en formation. Quand Thersite l'agitateur intervient,ilestrépriméetlamasserestepassive.L’agorahomériquesemeurt.Elleressusciteraplus tard sous la forme ecclésiale de ladémocratie esclavagiste. En même temps, nous y découvrons des
survivances matriarcales. C’est Pénélope qui transmet le pouvoir. Et Alcinoos l’a reçu de cette manièrechezlesPhéaciens.220
220.P.F.Préobrajenski. Dans le monde des idées et des images antiques. Moscou,1965.Celivrereprenddesarticlespubliésdansles annéestrente.
Leserpent,ledragon,laterre,oulereculdéfinitifdesdivinitésféminines.
L’institution des jeux est une affaire relativement tardive et l’on assiste plutôt à un degré de développement nouveau des formules anciennes qu’à une véritable création. L’apparition de la cité constitueunfaitsocialquiétendlaconsécrationdel’individuvainqueursurlegroupetoutentier.La colonisationintroduitunedimensionpluslarge.Dèslors,onpeut,ondoitcodifierdefaçonplusstricte etleretourpériodiquedelacompétitioncessed’êtrealéatoire.
Donc l’histoire prend en compte la légende. Il faudra toujours retenir la présence simultanée de ces deux registres. Les données interfèrent et leur fusion établit justement l’idéologie sportive. Paradoxalement, c’est le changement politique et historique qui explique la permanence mythologiquedanslesport.Eneffet,l’aristocratienetardepasàjouerlespremiersrôles.Latradition à laquelle on tente de se rattacher est la justification implicite d’un pouvoir actuel. On gagne, donc on est divin, donc on mérite la richesse et le pouvoir. La persistance des éléments mythiques vient ainsiconsolideruneorganisationsocialeavantageuse.
C’estparcetteruseidéologiquequ’onrécupèreetqu’onretientunelégendequin’enapasmoins sa vie propre, sa logique, qui recèle des sources émotionnelles et des charges affectives, qui reste lourde des tensions du passé, qui est pénétrée d’histoire, qui véhicule des adhésions et des refus instinctifs.
Tels sont les mythes de fondation qui ne sauraient être politiquement ni métaphysiquement neutres. Politiquement, une aristocratie esclavagiste se reconnaît la meilleure dans l’image sacralisante des jeux. Métaphysiquement, l’image du serpent, du dragon, le rôle malheureux des femmesetlesymbolismequilesrelientàlaterremarquentlasubordinationdesculteschtoniensaux divinitésolympiennes,l’abaissementdel’imageféminineetlasuprématiesocialedeshommes.
LesJeuxolympiques.
Onsaitqu’ilsontduréde-776à393,qu’ilsavaientunepériodicitédequatreans,queladirection des jeux fut disputée entre les Pisates et les Eléens et que des cultes divers s’y rejoignent, ceux de Pélops,HéraclèsetZeus.
Les jeux olympiques passaient pour avoir été institués par Héraclès plusieurs siècles avant le commencement de la liste officielle des olympiades. Pausanias raconte : « Ils vinrent de Crète… Héraclès était le plus vieux. Il opposa ses frères par jeu dans une course à pied et couronna le vainqueur avec une branche d’olivier sauvage. »221 Il ajoute: « C’est pourquoi Héraclès d’Ida a la réputation d’avoir été le premier à organiser… les jeux et à les avoir appelés olympiques. Il établit ainsi la coutumede les organiser tous les cinq ans, car lui etses frères étaient au nombrede cinq. »222
Maisdanslasuitedurécitdumêmeauteur,onal’impressionquelesjeuxolympiquesnecessent d’êtreretrouvésetréinventés.Eneffet,unenouvellefondationinterviendraitcinquanteansplustard et serait le fait des descendants d’Hercule. Clymène « vint de Crète cinquante ans après… Il descendait d’Hercule d’Ida. Il organisa des jeux à Olympie et éleva un autel en l’honneur d’Hercule, son ancêtre, et des autres Courètes. »223 Puis, « Eudymion, fils d’Aethlios, déposa Clymène et organisa pour ses fils une course dont le pouvoir était le prix. »224 Ensuite, « une génération plus tard environ, Pélops organisa des jeux en l’honneur de Zeus Olympien d’une manière plus fastueuse
221.Pausanias, Description de la Grèce.ElisI,chap.VII,v7.
222.Pausanias,op.cit.,Ilfautentendrequ’onrecommencelacinquièmeannée,doncenfaittouslesquatreans.
223.Pausanias,ElisI,ch.VIII,1-3.
224.Pausanias,ElisI,ch.VIII,1-3.
que ses prédécesseurs. »225 On assiste encore à toute une succession d’initiatives: « Amythaon, un cousin d’Endymion, organisa des jeux olympiques, et, après lui, Pélias et Nélée en commun. Augéas aussi… »226
Ensuite,ilyaurauneinterruption,lesjeuxtombentendésuétude:« Après le règne d’Oxylos qui célébra aussi des jeux, les fêtes olympiques furent interrompues jusqu’au règne d’Iphitos. »227 Dans l’intervalle, on avait perdu la signification exacte des choses, rites et mythes : « Lorsqu’Iphitos restaura les jeux, on avait entre-temps oublié les anciennes traditions. »228
Herculed’Idaàquionattribuelapaternitédel’institutionfaisaitpartie desDactylesd’Ida,aussi appelésCourètes,qui avaienteula garde,àlademandedesamèrePhéa,deZeusenfant queCronos son père voulait faire périr. Ses frères avaient nom Païonaos, Epimédès, Iasios et Idas.229 Ainsi l’origine présumée se rattache-elle à la fois à la succession mouvementée des divinités olympiques, etenmêmetempsàunevaguemigratoirevenuedeCrète.
Le temps et la tradition ont produit un amalgame étrange entre la mythologie et des événements politiques réels. On retiendra que le vainqueur est couronné par Hercule d'une branche d’olivier sauvagequ’ilaramenéedupaysdesHyperboréens.Onretiendraplusencorelesréticencesmisespar la population à restaurer les jeux olympiques, car c’est bien cette restauration qui semble faire problèmehistoriquementetquimotivetoutlerappelantérieurdesévénements.
Tout ne semble pas aller pour le mieux à l’époque. Pausanias écrit : « A cette époque, la Grèce était cruellement atteinte par un malaise interne… Iphitos pensa à demander à la divinité de Delphes la délivrance de ces maux. On raconte que la Pythie ordonna à Iphitos et aux Eléens de restaurer les jeux olympiques.»230 Quelle était cette crise ? D’où venait ce malaise ? Ce qu’ajoute Pausanias est intéressant: « Iphitos persuada les Eléens de sacrifier à Hercule comme à un dieu, lui qu’ils tenaient jusqu’alors pour leur ennemi.»231
C’est le moment de se souvenir de ce qu’Hercule chez Homère n’est pas encore un dieu, de se souvenir ainsi de ce que chez les auteurs classiques, il sera diversement apprécié, tantôt présenté comme un personnage stupide,tantôt au contraire comme un exemple de vertu. C’est le moment de se souvenir surtout de ce qu’Hercule est le héros par excellence des Doriens et que l’arrivée des Doriensn’apasdûsefairesansmalnidouleur.
On comprend mieux dès lors, puisqu’il s’agit de réhabiliter, d’héroïser et même de diviniser, quelle est l’importance du mythe de fondation qui attribue à Hercule l’établissement des jeux. La divinisation d’Hercule entraîne la révision de l’histoire. La priorité dans l’organisation a valeur consécratoire.
D’ailleurs, les historiens grecs interprètent diversement le rôle d’Hercule et l’on sent bien quela définition psychologique et morale du personnage ne sert que de prétexte à des prises de position politiques plus actuelles. Timéo éprouve le besoin de présenter un Hercule devenu doux comme un agneau. Polybe le lui reproche véhémentement: « Il parle plus loin d’Hercule et nous dit qu’en instituant les jeux olympiques et la trêve sacrée, il a révélé le sens de sa conduite, à savoir que le mal qu’il avait pu faire à tous les adversaires qu’il avait combattus, il ne l’avait fait que par nécessité ou par ordre, mais qu’il ne lui était jamais arrivé de faire du mal à un être humain. »232
Ce qu’il y a d’un peu troublant pour l’exactitude historique, c’est que le personnage d’Hercule réintervientcommeparticipantdanslesjeuxqu’ilalui-mêmecréés.C’esttoujoursPausaniasquidit « D’Hercule lui-même, on dit qu’il remporta des victoires à la lutte et au pancrace. » 233 Ilyamême l’épisodeclassiqueduhérosquirésisteaudieu.Personnen’osant concouriravecHercule,Jupiteren personnevientlutter contresonpropre fils enprenant lafigured’un athlète. Lecombat futégal,dit-
225.Pausanias,Elis,ch.VIII,1-3.
226.Pausanias,ElisI,ch.VIII,1-3.
227.Pausanias,ElisI,ch.VIII,5..
228.Pausanias,ElisI,ch.VIII,5
229.Pausanias,ElisI,ch.VII,6.
230.Pausanias,ElisI,ch.IV,5.
231.Pausanias,ElisI,ch.IV,6.
232.Polybe. Histoire.LivreXII,ch.XIII,26.
233.Pausanias. Description de la Grèce.ElisI.Ch.VIII.4.
on,etJupiters’étantfaitreconnaîtrefélicitasonfils.CelarappellebeaucouplepassagedelaGenèse oùJacobluttetoutelanuitcontreundieuetsefaitbénirparlui.
Il est vrai que Pausanias se fait l’écho d’une autre tradition, la lutte de Zeus et de Cronos. « Les uns disent que Zeus lutta ici avec Cronos pour le pouvoir, d’autres qu’il fonda les jeux en l’honneur de sa victoire sur Cronos.»234 Dèslors,iln’estplusétonnantdevoirapparaîtredesdieuxolympiques parmi lesvainqueurs: « La liste des vainqueurs comprend Apollon qui dépassa Hermès à la course et le battit après à la boxe. C’est pour cette raison, dit-on, qu’une flûte est sacrée pour Apollon et qu’Apollon remporte des succès olympiques. »235
Pindare qui est un Dorien fait état de deux mythes de fondation. Le premier se rapporte évidemment à Hercule. Il figure dans la Xe Olympique : « Le temps, en s’écoulant, a appris à la postérité de façon certaine comment Hercule partagea le butin de guerre et en consacra les prémices, comment aussi il institua la fête quinquennale, par la célébration de la première olympiade, et les prix donnés pour la première fois aux vainqueurs. »236 Pindare va jusqu’à donner les noms des gagnants : « Celui qui, menant droit jusqu’au bout sa course, triompha au stade fut le fils de Lycimnios, Oïonos … A la lutte, Echémos illustra Tégée. Doryclos obtint le prix du pugilat… Le prix du quadrige fut pour Samos, fils d’Halirhothios… Phrastor envoya son javelot au but. Niceus, faisant tourner dans sa main le disque de pierre, le lança plus loin qu’aucun autre. »237
Mais cemême Pindare a quand même proposé, dans sa PremièreOlympique,un autre mythe de fondation où figurent Pélops et Poséidon qui ont toutes les chances de précéder chronologiquement Herculelehérosdorien.
Or, Pélops a des lettres d’ancienneté qui sont loin d’être négligeables à Olympie, même s’il se subordonne à Poséidon et, par voie de conséquence, au panthéon olympique. Son image continue à s’imposer quand une autre vague de peuplement vient installer son héros à la première place. Le caractèrecomplexeetarchaïqueduthèmeplaideenfaveurdePélops.GernetetBoulangerécrivent: « Cette histoire condense une masse considérable de thèmes légendaires. Ce qui en fait l’intérêt propre, c’est justement cette association et cette imbrication des thèmes… une idée d’ordalie, une image de triomphe, tels sont les éléments les plus saillants à première vue. La pensée des jeux qui sont l’occasion de la légende les a suscités et en a provoqué la synthèse dans une histoire continue. »238
Enrevanche,Hercule,poursefaireadmettre,tentedes’introduirechezlesdieuxdel’olympe.A l’époque d’Homère, on le sait, il n’en fait pas partie. Ce n’est que plus tard que l’on racontera la présenced’HerculeauxjeuxolympiqueavecJupiterquivintsemesureràlui..239 Cegenred’histoire estclassiqueetressembleétrangementàl’épisodedeJacobluttantcontreundieu240.Maisiciilnous révèle surtout comment l’assimilation idéologique du champion dorien s’effectue par le biais de sa filiationàZeusOlympien.
Comme Zeus lui-même a été précédé historiquement comme divinité masculine dominante par PoséidonetquePélopsserecommandedePoséidon,ondevineaisémentquelescontradictionsentre lesmythesdefondationnesontpasinnocentesetquelesheurtsdecivilisationtrouventunéchoetun enjeutoutàlafoisdanslastructureduPanthéonetl'originedesjeux.
C'estàpartirde-582quecommencelasuccessionrégulièredespythiades.Lesjeuxsedéroulèrent alors tous les quatre ans. Le mythe de fondation relate le meurtre du serpent Python par Apollon. Aucunesignificationhistoriqueprécisenes’yattache.Lamêmelégendeseretrouve,eneffet,enAsie Mineure à Sycyone. Il est probable qu’Apollon a dû prendre la place, vers le -VIIIe siècle, d'une
234.Pausanias, Description de la Grèce
235.Pausanias. Description de la Grèce.
236.Pindare. Dixième Olympique.vers55à59.
237.Pindare. Dixième Olympique. vers64à74
238.GernetetBoulanger. Le génie grec dans la religion.p.76.
239.Commelin. Mythologie grecque et romaine.Garnier.p262.
240. Genèse.
déesse de la terre. En clair, cela veut dire qu’une Terre-Mère, divinité féminine, a été dépouillée de son antique primauté et que l'instauration d'un Panthéon nouveau allant de pair avec l'évolution des sociétés, on assiste à la dissolution du clan matriarcal et à l'avènement d'une aristocratie tribale. Le sacrificedu serpent PythonparApollon signifie unevictoiresur les forces de la terre et, parvoie de conséquence, sur le pouvoir féminin. Tel est le premier conflit culturel qui s’exprime à travers l'institution des jeux pythiques. La fête commémore, en principe tous les huit ans à l'origine, la troisièmeannéedel'olympiadeimpaire,lamortàcoupdeflèchesdudragonPython-Delphynéchargé deprotégerlevieiloracledeThémisetlapurificationd'Apollonquifaitsuiteàcemeurtre.
On retiendra cependant quele concours est d'abord musicalet on donne pourpremier vainqueur le Crétois Chysotémis. Mais Delphes, village de montagne incapable de se défendre par lui-même, avaitd’incessants différendsaveclesgensdeCrisaqui rançonnaient lespèlerins. Ils enappelèrentà leurs alliés. Une première guerre sacrée commença en -594 et en -591, Euryloque, un Thessalien, s’empara de Crisa, rétablit le concours et ajouta à l’épreuve musicale des compétitions dites gymniques,c'est-à-diresportives.
Hercule qu'on retrouve partout joue aussi un rôle curieux dans la lutte pour le pouvoir (ou les pouvoirs)surl'oracleetlesjeux.Unvased’AndocidelemontretirantuntrépiedqueretientApollon devant une Athéna indifférente.241 Et le fronton du Trésor de Siphnos le présente aussi, arrivant à Delphes,cherchantàravirletrépiedprophétique,maisavecuneAthénacettefoisconciliatrice.242 On raconte qu’à la suite du meurtre d’Iphitos243, fils d’Eurytos, Hercule de nouveau atteint de folie se rendit àDelpheset vint demanderà la Pythiede quelle manièreil pourrait êtrepurifié de son crime. L’oracle refusant de répondre, le héros mécontent prétendit piller le sanctuaire, s'empara du trépied prophétiquepourinstallerailleursunoracleplusàsaconvenance.C'estalorsqu’Apollonaccourutau secoursdelaprêtresseetilfallut,dit-on,l’interventiondeJupiterpourlesséparer.244
L'historique des compétitions pythiques est relaté par Pausanias qui mentionne l'introduction successivedesdifférentesépreuvesmusicales,gymniquesethippiques.245
Mais il est bon de se souvenir également que la renommée des jeux pythiques se maintient dans les œuvres littéraires classiques. Ovide dit: « Pour que le temps ne pût effacer la renommée de son exploit, le dieu institua des jeux sacrés, aux compétitions acclamées par la foule, appelés pythiens, du nom du serpent mis à mort par lui. Là, quiconque des jeunes gens avait, à la lutte, à la course, en char, remporté la victoire, recevait pour récompense une couronne en feuillage de chêne. »246 Et Sophocleparlesansémotiond'unOrestevainqueuretmourantauxjeuxpythiques:« Ton fils s’était rendu à Delphes pour prendre part à ces jeux célèbres… Il parut tout brillant de force devant l’assistance éblouie… De toutes les épreuves que proclamèrent les juges - course simple, double course et les cinq joutes - il remporta les premiers prix… On l'acclamait ... Mais lorsqu'un dieu vous cherche … »247 Mais le sport est quand même saisi par eux comme le grand fait de civilisation archaïque.
Lapériodicitédesjeuxisthmiquesétaitdedeuxans.Ladatationhistoriques’effectuaitàpartirde -582. Ilsdurèrent jusqu'à lafindel'époquepaïenne.Les récompensesn'étaient pasfinancières,ainsi quel’attestePlutarque. « Les Corinthiens couronnent ceux qui emportent le prix aux jeux Isthmiques, qui se célèbrent en leur terre, avec des chapeaux d’ache, et le prix de la victoire aux jeux solennels isthmiques était encore la couronne d’ache, comme jusqu'ici l’est-elle aux jeux de Némée, et il n’y a pas longtemps que, dans les jeux Isthmiques, on a commencé à user de branches de pin. »248
241.E.Pfuhl. Malerei und Zeichnung der Griechen
242.Méautis. Pindare le Dorien.p.
243.Anepasconfondreavecl’Iphitosquirétablitlesjeuxolympiques
244.Grimal. Dictionnaire de la mythologie.p.201.
245.Pausanias.DescriptiondelaGrèce.LivreX.ChapitreVII,2-8
246.Ovide. Métamorphoses.LivreI.
247.Sophocle. Electre
248.Plutarque. Vie de Timoléon,XXXV.
Ilexisteiciaussiplusieursmythesdefondationoùsereflètentdesconflitsculturelsaigus.
Le premier se rapporte au conflit qui aurait surgi entre Poséidon et Hélios et à l’arbitrage qui aurait étéapportéparBriarée.Poséidonaurait obtenul’Isthme etses alentours,Hélios(leSoleil)les hauteurssurplombantlaville.249
Le second est visiblement inventé pour donner au héros athénien Thésée une stature mythique comparableauhérosdorienHercule.Plutarques’enfaitl’écho : « Ce fut lui aussi qui institua les jeux que l’on appelle Isthmiques, à l’imitation d’Hercule, à cette fin que, comme les Grecs célébraient la fête des jeux appelés olympiques en l’honneur de Jupiter, par l’ordonnance d’Hercule, ils célébrassent aussi ceux que l'on appelle Isthmiques, par son ordonnance, et de son institution, en l’honneur de Neptune ; car ceux qui se faisaient au même détroit en l’honneur de Mélicerte se faisaient de nuit, et avaient plutôt forme de sacrifice et mystère, que de jeux et de fête publique »250
Letroisièmeestleplusunanimementreconnuetvoitdanslesjeuxisthmiquesunhommagerendu à la mémoire de Mélicerte/Palémon, fils d’Ino/Leucothée. Eschyle 251, Sophocle 252, Euripide253 en parlent. Mais aussi Ovide 254 et Pausanias255. La légende raconte qu’Ino, fille de Cadmos et épouse d’Athamas,craignantlacolèredesonmari,fuyantsapoursuite,s’étaitjetéedanslameravecsonfils Mélicerte.LamèreetlefilsdevinrentdesdivinitésmarinessouslesnomsrespectifsdeLeucothéeet dePalémon.Sisypheretrouval’enfantetlefitenterrer,dit-onaussi.Plustard,Corintheétantsoumise àuneépidémiedepeste,l’oracledéclaraqu’il fallaitorganiserdesjeuxenl’honneurdeMélicerte et onlesappelaisthmiquesàcausedel’isthmeduPéloponnèse.
Ovide, toujours àla recherche du sensationnel et de l’effetfacile, écrit: « Il se lance comme sur la piste d’une bête féroce, à la poursuite de son épouse… Il arrache Léarque qui lui rit et lui tend les bras, deux ou trois fois le fait tournoyer en l’air, comme une fronde et fracasse férocement contre un rude rocher la face de l’enfant…La mère égarée … pousse des hurlements et fuit, cheveux épars, raison perdue… le portant dans ses bras, Ô Mélicerte ! » C’est déjà le style de notre presse à sensation.Maislesensprofonddumytherapportééchappeàl'auteurquienfaitl’utilisationlittéraire, etnousverronspourquoidanslechapitreconsacréauxhypothèsessurl’originedesjeux.
Évidemment, il faut toujours s’attendre à ce qu'Hercule intervienne quelque part. « Une fois de plus, c’est pour une méchante affaire de règlement de comptes qui remonte au nettoyage des écuries d’Augias. Notre héros, n’ayant pas été payé, était allé réclamer son dû, mais sa troupe s’était fait battre par celle de son débiteur. Plus tard, profitant de la célébration des troisièmes jeux isthmiques, il tua dans une embuscade à Cléones les Molionides qui représentaient la ville d’Elis au concours puis s’en alla prendre Elis et tuer le roi Augias. » 256
Ce crime impuni d’Hercule pendant la trêve corinthienne eut des conséquences qui se firent longtemps sentir. Pausanias parle de la demande de réparation des Eléens et du refus d’extradition des Argiens (Hercule ayant à cette époque élu domicile à Tirynthe). Depuis lors, « Aucun athlète d’Elis ne va concourir aux jeux isthmiques.»257
L’institution sportive des jeux isthmiques sera un thème de référence. Socrate évoque un personnage casanier qui n’est sorti de chez lui une seule fois, à l’Isthme, ni pour aller nulle part ailleurs.»258
Ce sera aussi une tribune politique à l’époque romaine. Flaminius, puis Héron y viennent successivement proclamer la liberté de la Grèce: « Ainsi la ville de Corinthe a eu ce heurt, que les Grecs y ont été par deux fois déclarés affranchis et remis en liberté ; la première fois par Titus
249.Pausanias. Description de la Grèce.LivreII.Chapitre1,7.
250.Plutarque. Vie de Thésée.XXX.
251.Eschyle.Athamas.
252.Sophocle. Athamas
253.Euripide. Ino.
254.Ovide Métamorphoses.LivreIV515–541.
255.Pausanias. Description de la Grèce.LivreI.Chap44,7-9.
256.Grimal, Dictionnaire de la mythologie.p.197.
257.Pausanias. Description de la Grèce
258.Platon. Criton.52b.
Quintius, et la seconde par Néron en notre temps, et en même saison, c'est à savoir, lorsque l’on célébrait la fête qui s’appelle Isthmia. »259
Lesjeuxnéméensfurent restaurésen-573etsedéroulèrentdèslorsdefaçonbiennale.
Le principal mythe de fondation fait état du passage des sept chefs marchant contre Thèbes qui, prèsdeNémée,demandentàlalemnéenneHypsipyledelesmeneràunefontaineoùilspuissentboire et se ravitailler en eau. Hypsipyle est la nourrice d’Opheltes, fils de Lycurgue, le roi du pays. Or, pendantqu’ellelesconduitàlafontaine,l’enfantesttuéparunserpent.
Adraste,l’un des sept, organisealors desjeux, cérémonie propitiatoire,et l’enfant mort reçoit le nomritueld’Archémore,c’estàdire"ledébutdudestin".
Euripideamisenscènecettelégende.260
On dit aussi que c’est Amphiaros, l’un des chefs qui menait la troupe, qui, lors de ces jeux, remportelesaut etledisque.
Maisilnefautpasoublierquelenomd’Hypsipyleétaitliéégalementàd’autresjeuxend’autres circonstances non moins tragiques. On sait que lorsque les Argonautes abordèrent chez les Lemniennes,celles-civenaientdemassacrertousleshommesdel’île.Lareineétaitprécisémentcette Hypsipyle. Elle organisa des jeux en l’honneur de son père Thoas qu'elle était censée avoir tué. Les Argonautes « firent juger la force de leurs membres dans des jeux dont un vêtement était le prix, et ils s’unirent à ces femmes »,ditPindare.261 Hypsipyleelle-mêmeépousaJasonquil’abandonna.
LesmalheursdelapauvreHypsipylel’atteignentàtouslesniveauxderelationhumaine.Comme fille,elledoitsimulerle meurtredesonpère.Commeépouse,elleestabandonnée.Commenourrice, ellevoitmourirlegarçonconfiéàsacharge. Mais il y a d’autres symbolismes étranges qui viennent marquer les jeux funèbres en l’honneur d’Archémore. C’est à l’occasion de ces jeux que se manifeste la rapidité du cheval d’Adraste, un certainAérion.Or,Aréionavaitdesparentsdivins.L’histoireestscabreuse.Déméter,pouréchapper à Poséidon, s’était métamorphosée en jument. Mais Poséidon prit à son tour l’aspect d’un cheval et s’unit à elle. Aréion en naquit, mais aussi une petite sœur dont il était interdit de prononcer le nom. Onestenpleindanslechampdutotémisme(cheval)etdutabou(lamaîtressedesanimaux).
Il existe un second mythe de fondation. On l’a déjà dit, Hercule est décidément partout. Cette fois-ci, il revient de son expédition contre le lion de Némée et le pauvre Molorchos qui ne l’attend plusestentrain,letrentièmejouraprèssondépart,desacrifierunbélieràlamémoired’Hercule.Ils offrent donc ensemble le bélier à Zeus sauveur et, sur l’emplacement du sacrifice, ils organisent les jeuxnéméensquiseront parlasuiterénovésparlesseptmarchantcontreThèbes.
LesjeuxpythiensdeSicyone.
Pindarenousparledes « jeuxqu’Adraste institue à Sicyone. »262 CetAdraste,nousvenonsd’avoir l’occasiond’enparler.Lalégendeditqu’expulséd’Argos,oùilétaitroi,parAmphiaraos,ilséjourne à Sicyoneet y organise desjeux en l’honneur d’Apollon. C’est plus tard qu’il conduira l’expédition des sept chefs contre Thèbes et qu’il contribuera, à l’occasion de l’événement que nous avons mentionné,àl’établissementdespremiersjeuxnéméens.
L’histoire nous renseigne autrement. Ces jeux furent fondés par Clisthène lors de la première guerre sacrée. Les prix en étaient des couronnes et des phiales d’argent. On y tenait des concours musicaux,hippiquesetgymniques.
259.Plutarque. Vie de Flaminius. XXVI.
260.Euripide. Hypsipyle
261.Pindare. Quatrième Pythique
262.Pindare. Quatrième Isthmique.
LesJeuxhéréens.
Pausanias porte témoignage en faveur de l’ancienneté du sport féminin : « Les jeux des jeunes filles remontent aussi aux temps anciens. »263 Mais, s’agissant des jeux héréens, il en subordonne l’origine à celle des jeux olympiques et il en fait matière d’action de grâce: « On dit qu’éperdue de gratitude pour Héra à la suite de son mariage avec Pélops, Hippodamie rassembla seize femmes et inaugura avec elles les jeux héréens.»264
Onyobservaitdescatégoriesd’âge:« Toutes n’ont pas le même âge. Les premières à courir sont les plus jeunes ; après elles, celles qui les suivent dans l’ordre de l’âge, et les dernières à courir sont les plus âgées des jeunes filles. »265
Lesprixetrécompensesméritentd’êtrenotés: « Aux gagnantes on remet des couronnes d’olivier et une portion de la vache sacrifiée à Héra. »266 Très nettement, on voit apparaître la trace du totémisme. Et curieusement, alors que Pélops se plaçait, avec l’aide de Poséidon, sous le signe du cheval,c’estàunautreanimalquelaféminisationdusportfaitappeltoutenserapportantàl’histoire dePélops.Enfait,c’estlemomentdesesouvenirquelecultedeZeusàOlympieasupplantéleculte d’Héra. On observerait comment le modèle religieux ancien subsiste avec ses caractéristiques propres,bienquerétrogradéetinterprétédanslecadremythologiquenouveau. Par ailleurs, dans le jeu derôles de l’institution, il faut tenir compte del’intendance dela fête, de sa préparation:quidonnelesjeux,lesorganise,lesdirige?Obligatoirement, « les organisatrices, sont ...des femmes mariées. »267 Onvoittransparaîtreunriteinitiatique,doncfortancien.
Plusieursremarquespeuventêtrefaites.
D’abord,lesmythesdefondationconsacrentpartoutunreculdesdivinitésféminines.AOlympie, Zeus écarte Héra. A Delphes, Apollon supplante la Terre. Et l’image que donnent de la femme les mythes de fondation est pessimiste et tragique. Hypsipyle est malheureuse sur toute la ligne et rien ne lui réussit malgré ses bonnes intentions. Ino, poursuivie, se jette dans la mer. C'est un destin catastrophique.
On remarquera aussi que le pouvoir féminin est lié à la terre et symbolisé par la présence du serpent.Auxjeuxpythiques,ApolloncélèbreladéfaiteduserpentPythontuéàcoupdeflèches.Aux jeuxnéméens,Mélicerteaététuéparunserpentoudévoréparundragon.
Cette représentation religieuse du reptile est constante dans l’imaginaire collectif. Faut-il y rattacherl’histoiredudieuserpentbattuaujeudeballechezlesAztèques?Biensûr,ilyalerécitde la Genèse, la tentation originelle et la perte du paradis terrestre. Mais les traditions traversent les siècles. A Flamanville, dans la Manche, on montre une pierre énorme masquant un trou qui abritait jadisungigantesqueserpenttransforméenrocherparSaintGermainvenud’Irlande.Ici,c’estlalutte idéologiqueduchristianismecontrelesidolesceltiquesquis’exprime.Lapoésieromantiquenesera pasnonplusinsensibleàlapermanencedecethème.KeatsnouscontedansLamial’histoiredecette femmeserpentquienvoûteunathlète:
“She saw the young Corinthian Lycius
Charioting foremost in the envious race
Like a young Jove with calm uneager face, And fell into a swooning love of him.” 268
263.Pausanias. Description de la Grèce.
264.Pausanias. op. cit
265.Pausanias. op. cit.
266.Pausanias. op. cit
267.Pausanias. op. cit
268.Keats. Lamia.Premièrepartie.
Mais le pouvoir féminin peut être aussi lié à l’élément marin. C’est le cas dans la légende d’Ino se précipitant dans les flots. Cette fois, les significations sont enchevêtrées. On retrouve l’élément initiatiquedel’engloutissementjouéauféminin.Onretrouveégalementladragonnevouéeàlaperte du petit garçon innocent. Mais les rôles de lapoursuiteont été inversés. Athamas, un homme, est le poursuivant.
Une seconde remarque, ensuite, peut être faite au sujet des mythes de fondation. On est frappé par la vie mouvementée d’Hercule, son omniprésence et surtout par certains anachronismes qui ne relèventpasdel’innocencehistorique.Sesinterventionsnesontpastoujours,tants’enfaut,cellesde lajusticeetdubondroit.Iln’enfigurepasmoinsunpeupartoutàl’originedesjeux.Ilestclairqu’on vise,par cebiais, àobtenir pourunepolitiqueou uneethnie l’investiturethéologiqueque garantit la paternitédesjeux.
On observera que tous les symbolismes reflétant la première crise culturelle au niveau de l’expression mythologique, passage d’un possible matriarcat au clan aristocratique, sont repris au compte du héros pour le justifier dans un contexte tout autre qui est celui du heurt entre les vagues migratoires.Pindare,faisantlerécitdupremierexploitd’Hercule,parledesaluttecontrelesserpents, - force chtonienne -, envoyés par Héra, - divinité féminine -, pour l’étouffer. C’est à Hercule que revient, comme précédemment à Apollon, de procéder à l’annulation du meurtre accompli par le serpent en tuant le serpent lui-même : « De ses deux mains invincibles, il saisit le cou des deux serpents ; la durée de l’étreinte fit exhaler le dernier souffle de leurs corps gigantesques.»269 Et Pindared’ajouter: « Alors une épouvante horrible frappa de stupeur toutes les femmes qui veillaient autour du lit d’Alcmène. »270
Diverseshypothèsessurl’originedesjeux.
Quelquestémoignagesanciensetopinionsplusrécentes.
Parfois on nese pose pas du tout de questions etla présencedes jeux est admise commeun fait. Virgile se contente d’une description purement conventionnelle et, nous dirions aujourd’hui, très positiviste : « On place bien en vue au milieu de l’enceinte les trépieds sacrés, les vertes couronnes et les palmes, les armes, les vêtements de pourpre, un talent d’argent et un talent d’or, tous les prix des vainqueurs. Puis, du haut du tertre, la trompette annonce l’ouverture des jeux. »271
En revanche, on trouverait des éléments de réponse chez Hérodote. Les jeux peuvent être un dérivatif. C’est au cours d’une grande famine en Lydie, dit-il, qu’on invente les dés, les osselets, la balleettous lesjeux,sauf,précise-t-il maissansendonnerlaraison,letrictrac.272 Oulapurification des crimes. Depuis que Carthaginois et Tyrrhéniens avaient lapidé leurs prisonniers, tout vivant, hommeoubête,passant encetendroitdevenaitcontrefaitouparalyséetlapythieconsultéeordonna des sacrifices aux victimes ainsi que l’organisation de jeux hippiques et gymniques.273 Ou encorela célébrationdefunérailles. Ils’agit de cellesdepersonnagesrichesetdesprixvariésysont proposés dont les plus beaux sont attribués au combat singulier.274 Ou même l'héroïsation d’un fondateur de cité. C’est ce que font les habitants deChersonèse en l’honneur de Miltiadelorsqu’ils préparent des jeux auxquels les habitants de Lampsaque n’ont pas le droit de participer.275 Ou enfin le culte d’un hérosimaginaired’uneville.EnEgypte,lesChemnitesdonnentdesjeuxenl’honneurdePerséequi, seloneux,estnélà-bas.276
On en trouverait aussi chez Plutarque. Les jeux sont une cérémonie funéraire : « Minos, en mémoirede son fils Androgée, avait institué des fêteset jeux deprix. »277 Oulacommémorationd’une victoire,cequefitThéséeàDélos: « On dit aussi qu’il fit en cette même île de Délos un jeu de prix auquel fut premièrement donné au vainqueur la branche de palme pour loyer de la victoire. »278 Ou unecérémoniesymbolique : « Aristide mit en avant … que de cinq en cinq ans on y célébrât des jeux publics qui seraient appelés jeux de la liberté. »279
OnentrouveraittoujourschezThucydide.LesAmphipolitainsontentouréletombeaudeBrasidas d’uneclôture.Ilsyoffrentdessacrificescommeàunhéroset « chaque année ils organisent des jeux pour honorer sa mémoire ».280 Également chez Macrobe qui s’interroge sur l’origine des jeux apollinaires et qui hésite entre deux versions « à raison d’une victoire …, pour des causes sanitaires » ! choisissant la premièresolution, mais de toutes façons dans le cadre d’une conception astrologiquedesjeux.281
Chez les contemporains, l’idée la plus intéressante a été présentée par l’historien des religions Henri Jeanmaire282 Ce sont des rites de passage. Les jeux sont d’abord des initiations juvéniles. FrancisViansemblelareprendreàsoncompte.
271.Virgile. Enéide.ChantV.110-115
272.Hérodote. L’enquête.I.94
273.Hérodote.L’enquête.I.167
274 .Hérodote. op. cit.V8.EtI,144.
275.Hérodote. op. cit. VI.38
276.Hérodote. op. cit. II,91.
277.Plutarque. Vie de Thésée.XVIII.
278.Plutarque. Vie de Thésée.XXV.
279.Plutarque. Vie d’Aristide.LI.
280.Thucydide. La Guerre du Péloponnèse.V.11.
281.Macrobe. Les Saturnales.LivreI,ch.XVIII
282.Jeanmaire. Couroi et Courètes.Lille.1939.
Apriori,l’hypothèsefunérairedesjeuxsembleavoirquelquevraisemblance: « On leur a souvent prêté une origine funéraire. Les plus anciens concours sont, en effet, destinés à honorer les défunts, Patrocle, Achille, Pélias, Amaryncée. Or, les Jeux Olympiques sont en relation avec Pélops et avec son tumulus funéraire… ; les jeux Isthmiques commémorent la mort de Mélicerte; les Jeux Néméens sont donnés en souvenir d’Opheltès et leurs organisateurs portent des vêtements de deuil ; quant aux Jeux Pythiques, ils avaient été fondés pour expier le meurtre par Apollon du serpent Python. »283 Mais cette hypothèse est insuffisamment approfondie : « Cependant ces analogies demeurent superficielles. Les jeux funéraires n’ont lieu qu’au moment des funérailles ; on concevrait qu’ils fussent renouvelés aux anniversaires, mais non tous les deux, quatre ou huit ans, comme c’est le cas pour les grands jeux. En outre, dans ces derniers, le défunt n’est pas un roi ou un guerrier illustre. Pélopsest un adolescent dépecéparson pèreTantaleàl’occasiond’un banquetsacré,puis ressuscité par les dieux. Mélicerte et Opheltès sont de jeunes enfants : l’un a été dévoré par un dragon, l’autre fut précipité dans les flots par sa mère devenue furieuse ; tous deux ont bénéficié de l’apothéose ou de l’héroïsation, ce qui leur a valu de recevoir un nouveau nom, Archémoros pour Opheltès, Palémon pour Mélicerte. » 284
Aussi Françis Vian approuve-t-il Henri Jeanmaire : « Comme l’a montré Henri Jeanmaire, on retrouve là le scénario des initiations juvéniles : des rites marquant la sortie des jeunes gens, puis leur retour ; et, dans l’intervalle, un temps de réclusion où les adolescents sont bannis du groupe social et vivent à l’aventure aux prises avec les monstres. »285
Illeredit: « La Grècepréhistorique a possédé des rites d’adolescence ; les novices étaient censés renaître avec une personnalité nouvelle après une mise à mort simulée : le déchirement rituel, l’engloutissement par un monstre factice, la plongée dans la mer font partie de ces rites de passage à valeur immortalisante. Henri Jeanmaire semble avoir eu raison de penser que les jeux étaient issus de ces probations juvéniles : on comptait d’ailleurs que les Jeux Olympiques avaient été institués par Héraclès en l'honneur de ces adolescents mythiques que sont les Concrètes. »286
En tout cas, poursuit Vian, « l’hypothèse explique que les jeux aient un aspect funéraire, bien qu’ils relèvent desOlympiens : la mort héroïsée n’est autreque le prototypemythiquedes adolescents qui viennent chercher dans les jeux rénovation et transfiguration. Le mythe de fondation des Jeux Pythiques admet une interprétation analogue : le jeune Apollon, après avoir tué le dragon, est contraint de s’exiler, c’est-à-dire de subir une mort temporaire ; après quoi, il revient célébrer les funérailles de sa victime et recevoir l’investiture prophétique que lui a valu son exploit. »287
Lefameux combatdeJacobcontreun dieu,dans la Genèse,viendraitsansdouteconfirmercette thèse. « Jacob resta seul ; et un homme lutta avec lui jusqu’au lever de l’aurore. Voyant qu’il ne pouvait le vaincre, il le toucha à l’articulation de la hanche… Ton nom ne sera plus Jacob, mais Israël, car tu as combattu avec Dieu et avec des hommes et tu l’as emporté. »288 Onvoitl’épreuveet le changement de nom caractéristiques des initiations. Un rituel probatoire est porteur du mythe de fondationdupeupled'Israël.
Avec le temps, bien entendu, les significations premières disparaissent et font place à d’autres : « Le souvenir de ces origines rituelles s’est effacé à l’époque historique, quand les jeux ont été réorganisés. Néanmoins, ce que les concurrents attendent de la victoire, ce n’est ni la fortune, ni l’éphémère réputation que nos athlètes tirent de leur performance, mais bien une gloire qui équivaut à l’immortalisation. »289
Ilestvraiqu’uneclassesocialeétaitréceptive: « Les mystères d’Eleusis proposeront aux hommes d’autres voies de salut. Celle que traçaient les jeux convenait parfaitement aux traditions et aux
283.FrancisVian. La Grèce archaïque et classique.Dans“HistoiredesReligions1”,p.541-542.
284. Ibid.
285. op. cit.p.538.
286. op.cit p.542.
287. Ibid.
288. Genèse.ch.XXII.25-32.
289.FrancisVian.p.542.
ambitions de l’aristocratie qui fournissait la majeure partie des concurrents aux épreuves sportives. »290
Deleurcôté,GernetetBoulangerinsistentsurlasignificationagrairedelacourse: « Les jeux, et notamment les courses, ont pu être conçus d’abord – et ont pu continuer à l’être obscurément dans la conscience populaire – comme contribuant à entretenir les énergies de la nature suivant un cycle régulier. Hypothèse qui paraît bien corroborer l’exemple des jeux les plus illustres, ceux d’Olympie : car non seulement la personne du vainqueur y présente les caractéristiques que nous venons de voir, mais la course la plus ancienne dont la légende rapporte l’institution à un Héraclès crétois et à ses frères dactyles dans un décor de fête champêtre, était en rapport avec des rites de fertilité. »291
Plusloin,GernetetBoulangerparlentdesrésonancesquipersistentlongtempsdanslaconscience religieuse à propos des jeux et qui perpétuent une idée d’ordalie: « Par les jeux la vertu religieuse qui se réalise dans les fêtes au bénéfice de tous se fixe tour à tour sur un des éléments de la cité. Mais aussi bien cette pensée s’exprime à sa manière, et, plus formellement encore, dans la procédure religieuse que nous venons de voir à Cos et qui ne laisse pas de participer du concours parce que c’est une idée d’Ordalie qui, dans celui-ci comme dans celle-là, se prolonge obscurément. » 292
GernetetBoulangervoientd’ailleursdanslescombatsrituelsunedesformeslesplustenacesde la religion populaire: « Il n’y a guère de cérémonies publiques où n’entre en jeu une rivalité de tribus… La course des Oschophories athéniennes avait lieu entre les représentants de chaque tribu, et les Karnéates, parmi lesquels étaient pris les Staphylodromes, étaient tirés au sort à raison de cinq par tribu… Ces oppositions de groupes, qui appartenaient déjà à la structure de la fête primitive, donnent lieu à des usages dont çà et là la rudesse première s’est conservée comme telle… Il est certain qu’une idée générale d’efficace y était attachée, qui a pu se définir et se spécialiser en celles de vertus fertilisantes, frustratoires, divinatoires. »293 De tels usages effectivement se maintiennent longtemps et très loin parfois de ces significations premières. Hérodote nous en donne un bon exempleaveclabagarrerituelledePaprémisenEgypte,oùonsefracassejoyeusementlescrânesen jouant le retour d’Arès que les serviteurs de la déesse, mal informés, empêchent d’aller rejoindre sa mère. 294 AGignac,dansl’Hérault,onobserveaussiunsimulacredecegenreentreungroupearmé de grosses racines et un autre groupe disposant de sabres de bois flexible et habillé de pantalons bigarrésquisignifieraientlesoleiletlalune.
C’est plutôt sur la constitution de sociétés secrètes masculines qu’un historien soviétique des religions. S.A. Tokarev attirerait l’attention: « Vraisemblablement, c’est aux anciennes sociétés masculines que remontent par leurs origines les célèbres jeux nationaux des Grecs, - olympiques, néméens, isthmiques, pythiques, - qui étaient indiscutablement liés au rituel religieux. » 295 On se rappellera l’interdit qui empêchait les femmes d’assister aux jeux. Pausanias écrit: « Une loi d’Elis condamne les femmes surprises aux jeux olympiques… Aucune femme n’y fut prise, en dehors de Callipatéira… Veuve, elle vint déguisée en athlète conduire son fils... » 296
En d’autres lieux, en d’autres temps, on a pu assister à l’apparition de jeux populaires et d’institutions sportives plus ou moins stables. Le folkloriste irlandais Sean O Suilleabhain voit une origine analogue aux fêtes et jeux irlandais et aux grands jeux de la Grèce, s’appuyant, il est vrai, surtout sur l’analyse des veillées funèbres.297 Sujet passionnant pour le petit monde irlandais si l’on en croit Joyce: « So off they startedabout Irish sport and shoneen games the like of the lawn tennis and about hurley and putting the stone and racy of the soil and building up a nation once again and all of that. »298
290.FrancisVian.p.543.
291.GernetetBoulanger. Le génie grec dans la religion.p.50.
292.GernetetBoulanger. op. cit.p.256.
293.GernetetBoulanger, op. cit. p.50-51;
294.Hérodote, L’Enquête.II,63.
295.S.A.Tokarev. Les religions dans l’histoire des peuples du monde.Moscou.1965.p.434.
296.Pausanias. Description de la Grèce
297.SeanOSuilleabhain.IrishWakeAmusement.1967
298.JamesJoyce. Ulysses.PenguinBooks.p.314-315
EnFrance,àGourin,dansleMorbihan,onassiste,lorsdeladernièresemainedeseptembre,lors du Pardon local, à descoursesde chevaux, desconcoursde leverà la perche etdes tournois de lutte bretonne.299 L’épreuvesportiveestliéeàunefêtereligieuse.
Dans les Pyrénées, c’est le 15 août que, dans la vallée de la Soule où tant de traditions ont été conservées, « les bergers luttent au saut, à la course, au lancer de la pierre ou de la barre de mine, et on accourt de tout le pays basque quand on annonce un tournoi d’aizkolarris. »300 Et c’est le 18 aoûtquedanslepâturaged’Ahusquydesbergersseréunissentpourletriplesaut,lelancerdelabarre, lejeudepierre,lacourse.Ilyavaitjadisenpluslejetdelahacheetceluidelapique.301
Circonstance propre à établir certaines analogies avec l’Antiquité, on observe des tentatives de restauration des traditions sportives. Comme Iphitos autrefois on prétend reconstruire le passé avec des intentions évidemment modernes. « Depuis une vingtaine d’années, la ville de Saint-Palais organise un Festival de la Force Basque. »302 Il y a six épreuves: (1) le soka tira (lutte à la corde), (2)les salsularis, coureurs avecun sac de 100 kilos sur les épaules, (3)les Ségaris, scieursde long, (4)les lasto altsari quisoulèventdesballotsdelaine,(5)les aizkolarris,hommesdelahache,(6)le jeudelacharretteoùl’onfaitpivoterunvéhiculesursontimon.Toutleproblèmeresteévidemment de savoir, aujourd’hui comme autrefois, si des valeurs nouvelles vont pouvoir s’investir sur des modèlesanciens.
End’autrestermes,celasupposetoujourstroisconditions,unemobilisationaffectivepossibledu présent, la présence d’un modèle ancien dont les structures soient susceptiblesde retenir l’attention, l’adaptation de la situation actuelle aux sollicitations émotives du passé. Ainsi s’explique qu’une restauration purement folklorique n’accroche pas en profondeur et ne se maintient pas. Pour les mêmes raisons, n’importe quelle innovation n’est pas plus recevable que n’importe quelle restauration.OnsaitquelacoursedemulesauxJeuxOlympiquesn’aduréquecinquante ans.
Toujours sur le compte de la spontanéité inventive des jeux populaires, on peut apporter le témoignagedePouchkinequi,dansle Conte du Pope et de son serviteur Balda,nousrévèlelaplace réservée à l’épreuve sportive dans la structure du conte et par conséquent les significations les plus lointaines du sport. Quand le désaccord juridique se fait évident entre le petit diable négociant pour le compte du pope, l’affaire se règle en manière d’ordalie parodique sous la forme d’épreuves sportives successives jusqu’à ce que l’une des parties en présence s’incline devant la volonté supérieuredel’autre.C’estlacourseautourdulac.C’estlechevalsoulevé,etc…
Dans ces conditions, il n’est pasétonnant que l’institution des jeux etleur restauration et encore leurpaternitésoientliées àdesheurtsdecultureet desconflitsdeprésenceidéologique.Ce sontdes valeursphysiquesetdesvaleurssocialesquis’exprimentenmêmetemps.Toutconflitdominésefête joyeusement dans la reprise primitive du droit qu’est l’épreuve, l’ordalie, le jugement sans appel de lavertuphysique,l’interventionclairedelavéritédanslecercleinviolableoùsemanifesteauxyeux detousl’établissementdel’ordre.
Parlàoncomprendmieuxlavaleurdusacrifice.ApollonsacrifieleserpentPython.Levainqueur instaure son ordre des choses. Le vaincu est l’holocauste nécessaire à l’établissement de cet ordre, l’échange nécessaire entre le ciel et la terre. Tout mythe de fondation consacre et sanctionne une victoireet,encontrepartie,unsacrifice.303
Il est vrai que ces explications ne suffisent pas encore. Pourquoi cette réussite grandiose qui par deux fois dans l’histoire donne brusquement à certains jeux locaux une dimension universelle, avec lesgrandsjeuxdelaGrèced’abord,aveclesgrandssportsmodernesensuite?
Chez les Grecs, on a pu constater que le développement des grands jeux était lié au phénomène dit de la seconde colonisation qui agite le monde grec du VIIIe au VIe siècle. « Certaines de ces colonies deviennent des métropoles et elles établissent avec les cités grecques des rapports suivis.
299. Guide de la France Mystérieuse.Tchou.p.402.
300. Guide des Pyrénées Mystérieuses.Tchou.p.115
301. Id.p.214.
302. Id.p.116
303.C’estpeut-êtrelaraisondel’absencedelanatationdansleprogrammedesjeuxgrecs.Lastructurecompétitivedusacrifice substituéestimpensable.Iln’yapasd’analoguemarinpermettantunetauromachieaquatique.
On verra des athlètes de Crotone prendre part aux Jeux Olympiques, des tyrans de Sicile dédier leurs offrandes au sanctuaire de Delphes. »304 Autrementdit,ilyaenmêmetempsunitédeculture,cequi permetl’établissementdelarèglesportiveetsacompréhension,indépendancedescitésdisséminées autourdubassinméditerranéen,cequiimpliqueladiversitéetlacompétition,facilitédetransportet decommunicationparvoiemaritime,cequiautoriseleretourpériodiquedescompétitions. Dans la modernité, le sport, à l’époque industrielle, bénéficie de conditions analogues. Cela fait ladifférenceentrelasouleetlefootball,lapaumeetletennis.
304.YvesBéquignon. La Grèce.Dans«HistoireUniverselle1»,Pléiade,p.592
Lesportestfixéentantqu'institutionsocialeaveclesgrandsjeuxdelaGrèce.Sonimpactculturel est assez puissant pour fournir une unité de temps, le calendrier se calcule par Olympiades, et une unitédemesuredelongueur,lestade.
Mais les structures de la société changent. La richesse ne s'exprime plus comme à l'époque homérique par l'importance du troupeau de bœufs mais par la possession héréditaire de la terre. Et toutaévoluéenconséquence.
Aussi est-on fondé de penserque l'institution qui fixe et transmet les émotions du sacrificeobéit aussiàd'autressollicitationsquisont cellesdel'actualité.Lescontradictionsquienrésultentnesont pasobligatoirementperçuesdescontemporains.Maisellessefontcependantévidentes.
Cettequatrièmepartiecomporteraquatrechapitres:
Chapitre12. Pindare ou l’idéologie du beau risque à courir.
Chapitre13. Le quatorzième prétendant.
Chapitre14. Pindare, le sport et la pensée mythique.
Chapitre15. Évolution de l'institution sportive chez les Grecs.
Pindareoul’idéologiedubeaurisqueàcourir.
Unequasi-immortalitéetunequasi-toute-puissance.
NousenarrivonsenfinàPindare.Cettefois,noussommestroissièclesaprèslafondationdesjeux olympiques. L'institution fonctionne. Mais, par un étrange paradoxe, le sport qui, dès l’époque homérique, adopte déjà des allures profanes et presque modernes, continue néanmoins à valoriser, avecPindare, à près d'un demi-millénairede distance, ses structures ancienneset les plus sacrées. Il s’agit,enfait,d'unlongetlentprocessusd’évolutionquivoitlaréalitésportiveémergerpeuàpeude lapenséemythiquesansjamaisd’ailleurss'endégagertout-à-fait.
L’ambiguïtélongtempspersistantedecephénomènedonneraitmatièreàréflexionpourlathéorie de la connaissance, pour la philosophie de l'histoire et, bien entendu, pour la compréhension en profondeurdusport,ycomprisdanssamodernité.
Pour l’instant, il est important de constater, sur la foi du témoignage pindarique, que le sport, aprèstroissièclesdecompétitionsininterrompuesetd’institutionnalisationdesjeux305 ,reste très lié, du moins dans son interprétation poétique, aux paramètres essentiels de la pensée mythique: (1) participationaugestearchétypal,(2)magiesympathique,(3)résonancetotémique.Maisondoitnoter toutaussitôt(1)quel'appelàlatraditionmythiquen’estpasinnocentpolitiquement,(2)quelerespect des dieux est un élément de rationalisme qui mine de l'intérieur la pensée mythique, (3) que cette vision du sport ne va pas tarder à être contredite par une idéologie sportive nouvelle dont Platon et Xénophonserontlesporte-parole.
Pindare indiscutablement nous offre un centre de perspective exceptionnel pour saisir la genèse de l'idéesportive dans l’ampleurde son mouvement etde son évolution.Son œuvreest une sorte de carrefouroùdifférentesinfluencessecroisent,secontredisentetfinalementinterfèrent.
Ontend,eneffet,versunesuprématiedelapenséeanalytique.Lesport,àsamanière,ycontribue. Il fournit le modèle pour philosopher, l’opposition dans les règles, la dialectique, Il fournit le lieu pour philosopher, le gymnase, où l’on se rassemble et où l’on discute. Il fournit le milieu pour philosopher. Des personnes libres de leur temps ont reçu une éducation basée sur la musique et la gymnastique. En outre, la pratique sportive conduit elle-même à l'analyse, le calcul technique et le stratagèmetactique.
Et pourtant, la pensée mythique demeure. Elle se manifeste dans l’intérêt pour les mythes de fondation des jeux. Elle se manifeste dans la poésie lyrique, chez Simonide, chez Bacchylide, chez Pindare.
On sait que la poésie sportive occupe une part importante du lyrisme grec. L’apparition de ce lyrismeestliéeauperfectionnementdesinstrumentsdemusique,lyre,cithare,flûte.Ellecorrespond historiquementaupassagedela royautéprimitiveàl’aristocratieetàladémocratie.Ondistingueun lyrisme ionien, celui de Minnerme, Tyrtée, Solon, Théognis, poésie élégiaque et gnomique, un lyrisme d’Archiloque, satirique, poésie iambique, un lyrisme lesbien, celui de Sappho, d'Alcée, d’Anacron,etenfinunlyrismedorien,celui quinousintéresse,celuid’Alcman,d’Arionquiinvente la tragédie, celui de Stésichore, de Simonide de Céos, de son neveu Bacchylide et de Pindare. Ce lyrisme dorien laisse sa marque dans l'histoire. La République de Platon commence par évoquer les proposdePindare 306 etdeSimonide 307.Xénophon,dansl’Hérion,feradialoguerHiéronle tyranet
305.FondationdesJeuxOlympiques-776,PremièreOlympiquedePindare-476.
306.Platon. République. I,33la, 307.Platon. République.I,33id-332d,
Simonidelepoète.LaFontaineparledeSimonidedansunedesesfables308 etRonsardditdePindare qu’iladmire:
« Aussi nul chant ne s’accompare
Au chant courageux de Pindare
Que la honte ne colorait
D’entremêler ses propres gloires
Avec les fameuses victoires
Des batailles qu’il honorait » 309
Pindare eut effectivement une carrière brillante. Né près de Thèbes en 522, il fait exécuter, à vingt ans, une ode triomphale, la dixième pythique. Son audience est grande: il est reçu aussi bien danslesvilleslibrescommeAthènesquechezlestyranscommeHiérondeSyracuseouArcésilasde Cyrène. Cent ans plus tard, son prestige reste intact et Alexandre, faisant raser la ville de Thèbes, épargnera la maison du poète. L’œuvre est importante. Bien qu'une bonne partie en soit perdue, on disposeencoredequaranteépiniciesouodestriomphalesqui,d’ailleurs,sontdelongueurtrèsinégale puisquela douzième pythique n’aque56versalorsquela quatrième pythique encompte533.Quant à la structure de l’ode, elle est assez constante: on commence par l’éloge du vainqueur, ensuite un récitmythiquereliecevainqueurauxtraditionsdelacité,enfininterviennentdesconseilsmoraux. La première chose à souligner, semble-t-il, en abordant la pensée de Pindare et le système de valeurs auquel elle se réfère, c’est l’influence des thèmes homériques, leur résonance profonde. La proximité des formules est souvent étonnante. A défaut d’immortalité, la gloire. Le sport est une quasi-immortalitéetunequasi-toute-puissance.Lesujetrevientsanscesse.PindarefaitdireàPélops dansla Première Olympique : « Puisqu’il faut mourir, pourquoi s’asseoirdans l’ombre etconsommer en vain une vieillesse ignorée ? »310 Dansla Quatrième Isthmique : « A ceux qui ne veulent pas tenter leur chance, revient le silence et l’oubli. »311 Dansla Quatrième Pythique : « Aucun d’eux ne voulait laisser sa jeunesse flétrir sans péril, en restant auprès de sa mère ; tous ces jeunes gens, au prix même de la mort, rêvaient de conquérir ensemble le remède de leur vertu. »312 Dans la Cinquième Isthmique : « Il n’y a que deux biens qui… fassent s’épanouir la joie la plus précieuse de la vie, c’est le succès et la gloire qui le proclame. »313
Lesportestdoncunevaleuretlavictoireuneconsécrationdecettevaleur.L’idéerestelamême. Homèredit:« Il n’est pas de plus grande gloire pour un homme au cours de sa vie que de remporter quelque victoire avec ses pieds et avec ses mains.»314 Pindare en écho: « Là se juge la vitesse des jambes et la hardiesse endurante de la force. Puis le vainqueur savoure toute sa vie le miel de la félicité… Une joie que les jours transmettent aux jours, sans répit, c’est le bien suprême pour un homme. »315
Cette valeur est d’ordre aristocratique et se juge par l’épreuve: « A l’épreuve se manifeste la supériorité dont chacun est capable »316.L’homme,danslesport,faitlapreuvedesavertucosmique. Il appartient alors au poète, à Pindare, de célébrer la victoire de l’homme le meilleur. Dans ce contexte, comme le remarque Huizingua, « chaque chose possède une vertu propre à sa nature. Un cheval, un chien, l’œil, l’arc, la hache, tout à sa vertu spécifique… Le mot arétè est en connexion avec aristos, le meilleur, le plus éminent. »317
Dans cette affaire, le poète joue un rôle qui est loin d’être secondaire. Il apporte le logos, la consécration de la renommée; grâce à lui, l’action se perpétue dans le discours. L’éminence de l’exploit physique appelle un prolongement culturel. Aussi le meilleur des athlètes a-t-il besoin du
308.LeFontaine, Simonide préservé par les dieux.LivreI,FableXIV.
309.Ronsard. A Madame Marguerite.1578.
310.Pindare, Première Olympique,vers82-83.
311.Pindare, Quatrième Isthmique,vers30.
312.Pindare, Quatrième Pythique,vers82-83.
313.Pindare,CinquièmeIsthmique,vers12-13.
314.Homère, Odyssée,chantVIII.
315.Pindare, Première Olympique,vers95-100.
316.Pindare, Troisième Néméenne,vers70.
317.Huizinga. Homo Ludens.p.111.
meilleur des poètes. On ne doit pas s’étonner dès lors de voir un Pindare parler d’égal à égal avec celuiquilecommanditeetluidonnerdesconseilsmoraux.Lagloiredupoèteetlagloireduvainqueur sontdescomplémentaires.Ilssontassociés.
Quasi-immortalité et quasi-toute-puissance, disons-nous. Les héros ne sont pas des dieux. Mais nousavonsquelquerapportaveclesimmortels.Leshérosnesontpasdesdieux: àla suiteducrime commisparsonpèreTantale,Pélopsaété « retrouver la race misérable des mortels. »318 Nousavons quelquerapport avecles immortels; il y a la race des hommes etla racedes dieux. C'est àla même mèrequenousdevonsderespirer.319
Tout est dans la mesure. Il faut aller jusqu'aux limites du possible. Mais il ne faut pas tenter l'impossible. Cette philosophie morale s’exprime constamment chez Pindare. Dans la Troisième Pythique : « N'aspire pas à la vie immortelle, épuise le champ du possible. »320 Dans la Troisième Néméenne : « Il avait dompté dans la plaine marine des bêtes monstrueuses, cherchant spontanément l'aventure … jusqu'à ce qu'il eût rencontré le point qui l'obligeait au retour, et marqué les limites de la terre. »321 Dansla Cinquième Isthmique : « N'aspire pas à devenir l’égal de Zeus … Aux mortels convient la condition mortelle »322 Dans la Septième Isthmique : « Le plus ambitieux reste trop petit pour atteindre la résidence où les dieux siègent sur un sol d’airain. Le cheval ailé, Pégase, renversa, quand il voulut aller jusqu’aux demeures du ciel et pénétrer dans le conseil de Zeus, son maître Bellérophon. »323
Cettemoraledubeaurisqueàcourirn'adoncrienàvoiravecunesortedefolletémérité,unefuite enavantfaceaudestin.Elleesttempéréeparlesensdelamesure.
Elle porte indiscutablement la marque de l'expérience sportive. Le sportif, dans la compétition, doitsavoirprendresesrisquesaubonmoment,placerundémarragedansunecoursepourépuiserses adversaires, renverser le jeu dans une phase de football, prendre son adversaire à contre-pied. Sans prendreaucunrisque,onnegagnejamais.Enprenantdemauvaisrisques,onperdtoujours.
Elle est retenue par la philosophie morale classique. Socrate parle de l'immortalité comme d'un beaurisqueàcourir. 324
Et elle est exprimée avec les accents de la vérité par une poésie vigoureuse dont la sincérité ne laissepasinsensibleettraverseletemps.Horace enafaitla remarque: « Qu'il célèbre les héros qui rentrent dans leur patrie avec la palme d'Élide, ou les combats de ceste, ou le coursier vainqueur, et qu'il donne des éloges plus précieux que mille statues… un souffle vigoureux soutient toujours le cygne de Thèbes… » 325
318.Pindare. Première Olympique,vers65.
319.Pindare, Sixième Néméenne,vers1-2.
320.Pindare, Troisième Pythique,vers61-62.
321.Pindare, Troisième Néméenne,vers24-26.
322.Pindare, Cinquième Isthmique,vers14-16.
323.Pindare, Septième Isthmique,vers44-46.
324.Platon, Phédon
325.Horace, Odes.IV,2.
LacoursegagnantedePélopsoucomment,surlabasedutotémisme sanguinaire,s'établitl'héroïsmearistocratique.
Il s'agit d'un drame à quatre personnages :Poséidon, Pélops, Oïnomaos, Hippodamie. L'histoire estconnue.Oïnomaosn’accorderalamaindesafillequ'àceluiquiaurapulevaincredanslacourse de chars. Le prétendant perdant doit y laisser sa tête. Pélops est le quatorzième à se présenter. Ce mythe figure dans la Première Olympique de Pindare. Nous allons essayer d'analyser les structures de la légende et de montrer à partir de là le système de fonctionnement de l'idéologie sportive telle qu'elles'exprimechezPindare.
Lepremierpersonnages'appelleOïnomaos.C'estunpèreabusif.IlfaitpenseràcequeditFreud de la horde primitive et de l'exogamie. Freud rappelle, en effet, que, selon Darwin, l'homme aurait sansdoutevécuprimitivementenpetiteshordesàl'intérieurdesquelleslajalousiedumâleleplusâgé etleplusfortempêcheraitlapromiscuitésexuelleetqu’Atkisonaétélepremieràremarquerqueles conditions assignées par Darwin à la horde primitive ne pouvaient, dans le partage, que favoriser l'exogamie,expulsiondesadolescentsetinterdictiondetoucherauxfemellesdutroupeau.
Mais cette hypothèse ne fait pas disparaître la nécessité du combat. Disons qu'à la lutte du fils contre le père se substitue celle du gendre contre le beau-père. Même expulsé, l'adolescent doit se faire une place quelque part. Il échappe à la consanguinité. Cela ne le dispense pas du meurtre. Oïnomaos partout reste un père jaloux. Il faut lui prendre sa fille de force. Ainsi ce serait déjà le combatdeRodrigue.UneChimèneprimitiveenseraitl'enjeu.
Maisicinoussommesdanslecadredutotémisme.L’aïeultiresapuissancedeseschevauxailés, quiluipermettentd'atteindreleciel,etsafilleHippodamie,deparsonnom,estelle-mêmeconsacrée aucheval.
Ilestvraiquelenomdel’aïeuljalouxévoquelevinet,parconséquent,unriteagraire.Onpense à l'importance du vignoble lemnien. Thoas est un fils de Dionysos et le frère d’Oïnopiôn et de Staphylos.LafêtevégétaledeLemnosestselonDumézilunefêtedelavigne.Cesanalogiespeuvent êtreinstructives.Maistoutcelalaissesupposerdesstratificationssuccessivesdelalégende.
Lesecond personnages'appellePélops. Ila laissé unnomdanslagéographieetsansdoutefut-il un héros préhellénique. Thucydide écrit : « Ceux qui ont recueilli sur l'histoire du Péloponnèse les traditions les plus sûres nous apprennent que l'homme qui, le premier, acquit de la puissance dans le pays, fut Pélops. Possesseur de grandes richesses, il était arrivé d'Asie parmi des populations dépourvues de ressources, et, tout étranger qu'il était, il donna son nom à la contrée. »326
La mythologie grecque en a fait un héros. Il n'y a que Platon pour en avoir parlé irrespectueusement, disant, sur la foi d'une fausse étymologie ou par mauvais jeu de mots, que cet homme avait la vue courte et méritait bien son nom. On lit, en effet, dans le Cratyle, des propos dépourvus de toute ambiguïté :« Pour Pélops également, son nom lui est, à mon avis, exactement adapté : il signifie celui qui a la vue courte … En ce sens que, si j'en crois la légende qui concerne ce héros, il fut tout-à-fait incapable, quand il tua Myrtile, de pourvoir aux événements qui, par la suite, fondraient sur toute sa race, ni de prévoir cette immense infortune dont elle fut alors comblée : le tout proche, le contigu, c'est-à-dire le pelas voilà de quoi il avait alors la vision, opsis, quand il brûlait d'obtenir n'importe comment son union avec Hippodamie ».327
326.Thucydide. La guerre du Péloponnèse.I,9.
327.Platon. Cratyle 395cd.
IlfautdirequePélopsappartientquandmêmeàuneétrangefamille.D'abordsonpèreTantalel'a servi comme nourriture dans un banquet offert aux dieux. Ces derniers s’en aperçurent à temps et ressuscitèrent l'adolescent. Mais Héra avait déjà mangé l'épaule et on dut faire une épaule d'ivoire à Pélops. Pindare ne veut pas croire à une histoire aussi horrible. Il la relate comme un bruit malveillant: « Un voisin jaloux conta que dans l'eau qui bouillonnait sur une vive flamme, tes membres dépecés au couteau avaient été jetés et que sur leurs tables, au dernier service, les convives s'étaient partagé ta chair et l’avaient mangée ». 328 Mais la descendance de Pélops poursuit dans la mêmevoie.ThysteetAtrée,filsdePélopsetd’Hippodamie,serontaussileshérosd'unfestincruel. L'Histoire des Atrides, on le sait, est un tissu d'horreurs. Les deux frères sont en conflit pour la royautédeMycènesetlafemmed’AtréeaThyestepouramant.Ilsontdéjàtuéleurdemi-frère.Puis, poursevengerdesoninfortune,Atréetue,dépèceetfaitbouillirlesenfantsdeThyesteetlessertau coursd'unbanquet,puisilmontreàleurpèrelatêtedesesenfants.Etcen'estqueledébutd'unesuite demonstruositésoùl'imaginationdemeureconfondueparlesressourcesinventivesdel'immortalité. Thyeste a un fils de sa propre fille: c’est Egisthe. Cet Egisthe sera envoyé par son oncle tuer son père.Etc…
Bienentendu,ilfautdevinerdesallusionsvoiléesautotémisme,àl'exogamieetàl'initiationdes adolescentsmythiquementdévorésparl’épreuveavantd'êtrerendus,adultes,àlaviesociale.Maisà l'époque, ces mythes pèsent encore sur les consciences sans pour autant être compris. Les significations primitives ont disparu, sont oubliées. Mais l'histoire fait peur. Une sourde culpabilité est mystérieusement ressentie. Ainsi s’explique le refus horrifié de Pindare qui nie purement et simplementlemytheetparledela« fête irréprochable ». 329
Le troisième personnage s'appelle Hippodamie. C'est la filled’Oïnomaos. Elle est recherchée en mariage par de nombreux prétendants. Pélops est le quatorzième. Elle est l'enjeu de la compétition. Ellereprésenteuneterre,unpouvoir.
Son nom donneà réfléchir. Hippodamie, c'est la dompteuse dechevaux, ou, si on lit dans l'autre sens,cellequiestsoumise,oumariée,aucheval.Encoreunefoisletotémismes'affirme.Encoreune fois on pourrait faire des rapprochements avec des usages attestés ailleurs. Mircéa Eliade rapporte: « Les Mordvins ont une confrérie secrète de femmes qui a comme enseigne un cheval-bâton, et les affiliées y sont nommées chevaux : elles portent, suspendue au cou, une bourse pleine de millet, représentant le ventre du cheval. »330
En tout cas, treize déjà sont morts. Ils sont treizeà avoir osé prétendre à la main d’Hippodamie. Ils ont été treize à affronter Oïnomaos dans la course de chars. Ils sont treize à avoir péri, treize à avoir été sacrifiés. Pausanias donne les noms de ces téméraires: Marmax, Alcathe, Euryale, Eurymaque, Crotalos, Acrias, Capétos, Lycurge, Lasios, Chalcôdon, Tricolônos, Aristomaque, Prias.331 Chaquefois Oïnomaosalaissépartir enavant sonadversaireemmenantsonHippodamieet on pense instinctivementà ce que dit Propp: « On pourrait se convaincre que, du point de vue morphologique, tous les éléments du conte peuvent être tirés de l'histoire qui raconte l'enlèvement d'une princesse par un dragon. »332 Puis, chaque fois, après avoir sacrifié aux dieux, Oïnomaos s’élanceàsapoursuiteet,l'ayantrejoint,illetuedesalance.
On dit que Pélops, à la suite de sa victoire, sacrifia chaque année auprès de la sépulture des prétendants, comme à des héros. Mais la tradition n'ignorait pas qu'il avait dû sa victoire à la ruse, ayantsoudoyélecocherd’Oïnomaos,lefameuxMyrtile,poursaboterlechar.Ellen'ignoraitpasnon plusqu'ilavaitensuiteassassinéMyrtile,sansluiversersonsalaire.Ilestvraiquecedernierréclamait pourprixdesacomplicitédepasserlapremièrenuitavecHippodamie.
Lequatrièmepersonnageestundieu.Ils'appellePoséidon.Ilnes'agitpasden'importequeldieu. Ce fut sans doute d'abord un dieu-taureau. Platon se fait l’écho d'une tradition chez les Atlantesqui
328.Pindare. Première Olympique.
329.Pindare. Première Olympique.
330.MircéaEliade. Initiations.
331.Pausanias. Elis II,XXI,7-11.
332.Propp. Morphologie du conte.p.142.
va dans ce sens.333 Par la suite, Poséidon, dans le Péloponnèse, sera représenté sous les traits d'un cheval.LesIndo-Européensauraientimaginé,enoppositionàuneTerre-Mèredéjàinstallée,undieucheval auxfonctions agrairesqu’ils nommèrent Maîtrede laterre(Poséi-das)334 Onpeut serappeler aussi à cette occasion la tradition primitive racontant que Troie avait été prise par Hippos, donc le cheval, donc Poséidon, ce qui donna lieu par méprise, quand la formule cessa d'être comprise, à la fableduchevaldeTroie. 335 Pindareramasseenunephraselesouvenirdesdiversesmétamorphoses; l'image du Taureau persiste, il s'agit alors de Bellérophon: « Il voulait dompter Pégase, le cheval ailé. Athéna l’engage à sacrifier un taureau à Poséidon dompteur de chevaux. »336 L'idée d'un pouvoirsurnaturelestliéeàlareprésentationducheval.Pégaseestunchevalailé.Oïnomaosdispose dechevauxailésquiluipermettentderattrapersesconcurrentsàcoupsûr.Etc’estleprêtdechevaux ailés que vient solliciter auprès de Poséidon Pélops soucieux de lutter à égalité avec son adversaire Oïnomaos. Le cheval est signe et moyen de la puissance. D'ailleurs on trouvera des prolongements decescroyancesmythiquesdanscertainsusagesdel'époquehistorique.HérodotenousditqueDarius devaitsontrôneàunsubterfugedontusasonécuyerŒbarèspourfairehennirsonchevalavantceux desautrescompétiteurs.337
Maisilnes'agitpasseulementdechevaux,maisaussidechars.Quand,au-XVIe siècle,lesIndoEuropéens apprirent des Hittites l'usage du char de guerre, Poséidon devint le dieu des chars est le patrondela classe militaire.Or,ilestquestionicid'uneluttepourlepouvoir.Poséidonest bienàsa placecommel'undesprincipauxacteursdecette Première Olympique
Voilàpourlesacteurs.Letout constitueundrame.C'estleprétendant quinesera gendreques'il tue celui qui ne veut pas être beau-père. Le marché est aussi clair que cruel. On devine le sacrifice humain lié à la transmission du pouvoir. L'ordalie désigne celui qui a le plus de vertu. Mais on discerne en même temps la parenté avec la structure du conte. Le mythe de la Première Olympique enrespectelesrègles.La fuite,lapoursuiteetle sacrifices'effectuent selon le modèleintemporeldu merveilleux. Propp dit: « Au cours de l'action, le héros est le personnage pourvu d'un objet magique…et qui s'en sert. »338 C'est le cas avec Pélops dans son char attelé des chevaux ailés. De même Eliade: « La divinité n’intervient pas dans …cette fuite devant la mort ; ce sont des animaux favorables… qui aident le héros. »339 Pélops est aidé par les chevaux de Poséidon, sans compter l’interventionhumaine,trophumainedeMyrtile.
C'estledrame.Lesvivantsseconsolentaisément.Hippodamienetientpasrigueuràsonmaridu meurtre de son père. Mais les morts reviennent, car ils ne sont pas satisfaits par la tournure des événements.Pausaniasévoquedeshistoiresassezeffrayantesderevenants. « Il y a aussi une histoire selon laquelle Pélops laissa ici un espace vide en l’honneur de Myrtile et lui fit un sacrifice pour essayer de calmer la colère de l’homme assassiné, nommant cet espace Taraxippe - Frayeur des Chevaux - puisque les cavales d’Oïnomaos avaient été effrayées par la ruse de Myrtile. Certains disent que c’est Oïnomaos lui-même qui nuit aux coureurs lors de la compétition. J’en ai entendu qui rapportaient l’accusation sur Alcathe, le fils de Porthaon. Tué par Oïnomaos parce qu’il courtisait Hippodamie, Alcathe, dit-on, a ici son terrain ; battu à la course, il est une divinité maléfique et hostile aux conducteurs de chars … »340
Le mythe de la Première Olympique contient des archétypes assez puissants pour continuer à s'exprimer à travers l'histoire, la culture et la littérature. Les harmoniques de la mythologie se développentàtraverslesgénérationsetdonnentlieuàdesreprisesfolkloriquesetlittérairesdel'infini. Dans le Mabinogion, on raconte unehistoireanalogueà cellede Pélops. Olwen (=Hippodamie), filledumonstreYspadadden(=Oïnomaos),estlafemmeprédestinéedeKulhwch(=Pélops).Onvoit
333.Platon. Les Lois.
334.
335.
336.Pindare. Treizième Olympique
337.Hérodote. L’Enquête
338.Propp. Morphologie du conte.p.63.
339.Eliade. Mythes, rites et mystères.p.132.
340.Pausanias. Elis II,XX,17.
Kulhwchserendreàlacourd’Arthur(=Poséidon)etobtenirdeluiledonquiluiestnécessairepour meneràbiensonentreprise.EtfinalementlemonstreYspadaddenposesesconditions.Celles-cisont remplies.EulhwchtueYspadaddenetépouseOlwen.
DanslesArdennes,lerécitadopteunevarianteliéeàlachristianisation.Lalégenderapportequ’à Escombres-le-Chesnois, un châtelain tenait enfermée sa fille qui était très belle. C’est la relation Oïnomaos-Hippodamie. Un berger vendit son âme au diable, parle truchement d’un sorcier,afin de voirlajeunefille.C’estlarelationPélops-Poséidon.Lafilleapparaîtetdisparaîtaussitôt.Lavictoire païenne de Pélops est devenue impossible puisque Poséidon, rétrogradé du rang de dieu au rang de diable, est maintenu dans l’impuissance. Alors, s’estimant lésé, le berger assassine le sorcier. C’est la relation Pélops-Myrtile. Ainsi le sorcier joue le rôle de deux personnages du mythe païen. On l’a consultécommedivinitépuissante.Iln’étaitqu’unhabilecharlatan.
En Bretagne, on raconte égalementquelque chose d’approchant. Près de Saint-Goazec, dans le Finistère, habitait un géant (= Oïnomaos) et sa fille (= Hippodamie). Un des serviteurs du père (= Pélops) enleva la fille, le père se lança à leur poursuite, jetant dans leur direction les pierres de son château,cequiexpliquedenosjoursunalignementdemenhirs.
La légende du roi Marc surtout offre de curieuses réminiscences, malgré des distorsions structurelles.L’idéedel’ancêtretotémiqueestencoresous-jacente.Penmarc’hsignifieenbreton"tête decheval"etleroiMarc’h(christianiséenMarc)possédait,dit-on,unchevalquifilaitcommelevent (=chevalailé) et qui pouvait traverserla mer(Poséidon est à la fois dieu-cheval et dieu dela mer); sonchevals’appelaitMorvac’h(=chevaldemer).Lethèmedelapoursuiteestl’objetd’unevariante. Marcpoursuit unebiche qui setransforme enfemme etsa flèchelui revient et tue son cheval. C’est l’immolation involontaire du totem. Or, la femme était Ahès ou Dahud, fille de Gradlon. Elle transforme les oreilles de Marc en oreilles de cheval et retourne dans la mer. Bref, Marc, initié, est devenuunhomme-cheval.
L’histoire ne s’arrête pas là. Marc tue ses coiffeurs jusqu’au jour où les ciseaux magiques de Yeunig rendent la repoussedes cheveux impossible.Puis, il marie sa filleet justement cejour-là un coupdeventledécoiffe.Ilsesauvepourcachersahonte,sonpiedglisse,ilsefracasselatêtesurles rochers. C’est alors qu’apparaît une femme montée sur un cheval à tête d’homme, l’exacte contrepartieduroiMarc,etdit:« Voici Morvac’h, cheval de Marc’h. Les oreilles de Morvac’h sont celles de Marc’h celles de Marc’h sont celles de Morvac’h.»
Donc, rien ne se perd, rien ne se créé dans cette circulation universelle des pouvoirs et des énergies. Tout se transforme et se métamorphose. Aussi la mort est-elle une fête le jour même du mariage. Certes, le roi Marc fut pleuréparson gendre, sa fille etson coiffeur.Mais la fête continua. C’estlefestintotémique.Etlesoironallavoirlerocheràtêted’homme.
Dans la distribution des rôles, l'association Marc-Oïnomaos est évidente. Poséidon est joué par un personnage féminin naturellement hostile au roi Marc et c’est peut-être la relation d'hostilité qui exige la métamorphose féminine du dieu de la mer et des chevaux. En revanche, la fille de Marc (= Hippodamie)etsonépoux(=Pélops)nesontmentionnésqu’aumomentdelacélébrationdumariage et on passe complètement sous silence tout ce qui a amené cette célébration et, par voie de conséquence et de compensation, la mort de Marc. En un mot, cette présentation est symétrique de celledePindare.Ici,c’estleversantOïnomaos-Poséidon(Marc-Dahud).Là,c’étaitleversantPélopsPoséidon.Leprojecteurn’estpasbraquésurlemêmepersonnageetcen’estpaslemêmepersonnage quiestlaissédansl’ombre.
Ce mythe est donc une sorte de modèle de pensée, d’inspiration totémique, autour duquel s’articulent diverses variantes justifiant tels usages ou telles traditions. Donnons-en encore un exemple.OnditqueCathétos(=Pélops),amoureuxdelafilleduroiétrusqueAnnios(=Oïnomaos), une certaine Salia (= Hippodamie), l’enlève, l’emmène à Rome. Le père, désespéré de n’avoir pu atteindre les fugitifs, se précipite dans une rivière, l’Anio, donc toujours dans le domaine aquatique (=Poséidon).Delàvient,dit-on,quelesprêtressaliens,consacrésàMars,selivraientchaqueannée, àRome,àdesdansessacréesaucoursd’uneprocessionrituelle.
Pindare,lesportetlapenséemythique. Lepatrimoinegénétiquedel’institutionsportive.
On voudrait maintenant invoquer le témoignage de la Première Olympiques de Pindare et montrer, sur la foi de cet exemple, que le sport reste très lié, après trois siècles de compétition régulière et d’institutionnalisation des jeux, aux paramètres essentiels de la pensée mythique: l'épreuve, la participation au geste archétypal, la magie sympathique, la réminiscence totémique.
La valeur sacralisante de l’épreuve n’a plus à être soulignée. L'épreuve sportive n’est qu’une varianteamélioréedel'épreuveinitiatique. Cetteépreuveestdangereuseetmortelle.Lesrisquessont sérieux,ditPindare341.Parlamortdetreizehéros,de treizeprétendants,elleestréservéeàceshéros qui,telPélops,sontallésretrouver « la race misérable des mortels. »342
Mais le prix de l'épreuve est loin d'être négligeable. Les conséquences de l'épreuve mortelle affrontée sont impressionnantes. C'est d'abord la victoire : « Il triompha d’Oïnomaos ».343 C’est ensuitelemariage:« Et la vierge vint en son lit.»344 C’estencoreladescendance:« Six princes aux vertus généreuses.»345 C’estlagloire: « Partout va resplendir, grâce à l'arène d'Olympie, la gloire de Pélops.»346 C'estlafélicité:« Une joie que les jours transmettent aux jours.» 347
L'idéederécompenseetfinalementdebonheurestattachéeàl'épreuveetluidonneunsens.Cela seretrouveend'autrespoèmesdePindare.Dansla Première Néméenne : « Éternellement en paix, il obtiendrait, pour compenser ses durs labeurs, le privilège d'une félicité inaltérable, dans la demeure des bienheureux ; il recevait en mariage la florissante Hébé. »348 Dans la Première Isthmique : « Celui qui, grâce aux jeux ou à la guerre, a conquis la gloire charmante, trouve son profit le plus haut dans la louange que distille la bouche de ses concitoyens et des étrangers. »349 Etdansla Cinquième Isthmique Pindareparlede « la joie que donne le chant de triomphe doux comme le miel. »350
Maispourquoil’épreuveest-ellenécessaireàl'obtentiondelafélicité?C'estcequelamodernité arriveleplusdifficilementàcomprendreparcequ'elleestinstalléedansuntempshistoriquelinéaire alorsqu'ils'agiticid'uneconceptioncycliquedutemps.
La réponse, c’est la participation au geste archétypal, à l’exploit primordial du héros mythique. Cet exploit a été constitutif du réel. Rééditer cet exploit, c’est, d'une part, renouveler la réalité des choses constituées jadis, et c’est, d'autre part, se donner une réalité héroïque. Intellectuellement, on comprendmal,denosjours,cettedémarche.Maispourtant,instinctivement,c'estquandmêmecelle quisevitdanslesportdecompétitionoùchaqueannée,defaçoncyclique,letitreestremisenjeuet où on tient régulièrement à jour la liste des réincarnations, sous les noms des champions successifs, duhérosprimitiffondateurdurite.
Sur le modèle ancien de la participation viennent cependant se greffer les préoccupations, les intérêts des époques ultérieures. La Première Olympique célèbre la victoire d’Hiéron, tyran de
341.Pindare. Première Olympique. vers79
342. Ibid.vers65-66
343. Ibid.vers88
344. Ibid.vers88
345. Ibid.vers89
346.Pindare. Première Olympique.vers94-95
347. Ibid.vers97-98
348.Pindare. Première Néméenne.vers
349.Pindare. Première Isthmique.vers
350.Pindare. Cinquième Isthmique.vers
Syracuse, et le mythe central du poème rapporte la course victorieuse de Pélops. Ce n'est pas un simple parallèle littéraire, une habile flatterie. On souligne une identité de comportement, donc une consécration,unesacralisation.L'exploit,l’épreuven'ontpasréellementdesignificationoriginaleet personnelle. Au contraire, c'est le geste archétypal, le modèle primordial, qui conserve valeur consécratoire,parparticipationaurite,àceluiquiimite,quireproduitlesactionsduhérosprimitif.
Une situation tragique initiale est évoquée, invoquée. On la revit par le rite et par le mythe. La course de Pélops en tous cas n'est pas banale.Vainqueur, il épouse Hippodamie, une femme, une terre, unpouvoir.Letemps,également, luidevientsoumis: ilauraune lignée.Vaincu, enrevanche, il sera mis à mort. Oïnomaos, confiant, voulait construire un temple avec les crânes des prétendants desafille.Lesdonnéesdelatraditionrelatentlesacrificecosmogonique.
Maisl'appelaumytheopèresubtilementunglissementversuneapologiedel'aristocratie.Hiéron joueunjeucrueletbiendangereux,celuidelapolitiquetumultueuse,lepouvoirpersonnel,lerisque de l'aventure tyrannique. Rattaché à Pélops, il se trouve, grâce aussi au génie poétique de Pindare, justifiédanssonpouvoirpolitiqueetdanssarichesse.
Ainsi le geste archétypal propose les contours d'un comportement que découvre d'instinct celui qui possède la vertu héréditaire. Pindare le dit ailleurs : « Par l'héroïsme héréditaire, un homme est grandement puissant. Celui qui ne sait que ce qu'il a appris demeure obscur, ballotté par un souffle inconstant ; jamais il ne s'avance d'un pied sûr et son âme inégale tente la gloire par tous les moyens ».351 Lavictoiresportiveestcenséefairelapreuvethéologiqued'unpouvoirroyal.
Tout cela se passe dans le contexte de la magie sympathique. Tout symbolise et tout conspire. D'abordlesstructuresdel'odepindariquese construisentsur le modèled'unmonde fermé sur lui-même où tout renvoie à tout, parfaitement cyclique. Ensuite, les significations sont interagissantes.
Lamagie,ditFreud,c'est latoute-puissancedesidées.Ons'imaginequelesrelationsquel'esprit établit entre les choses sont efficaces du seul fait que l'esprit les pense.352 La magie sympathique y ajoute que la toute-puissance des idées est supposée s'exercer dans le cadre d'une universelle interactiondeschosesetdeleurreprésentation.Toutsetient.Touslesaspectsdelaréalités'appellent, serépondentlesunsauxautres.
Or, dans la Première Olympique, le premier mot déjà -« le meilleur » - donne non seulement la tonalitédutexte,maisaussisasignificationlaplusprofonde.Lesportveuteffectivementl'émergence dumeilleur.
Qu'on y prenne garde, cependant, le mot grec est au neutre. Il a valeur impersonnelle. Gagner révèle qu'on possède une vertu, un pouvoir, une force qui viennent s'appuyer sur l’ordre cosmique, sourcepremièredetoutevertu,detouteforce,detoutpouvoir.Gagner,c'ests'intégrerheureusement danslamarchegénéraledeschoses.
C'est pourquoi l’épreuve, l'exploit renvoient à tout un système d'images, de valeurs, de représentations, de réalité que la magie sympathique tient reliées. Comme l’eau, dans l'ordre cosmique,représente l'élémentprimordial,ilestnormalquel'eauapparaisseaussitôtpourcompléter le premier vers du poème :ce qu'il y a de meilleur, c'est l’eau. En même temps, comme tout est vraimentliédansl'économiedupoème,l'eau,dont ilfaut redirequ’elle estpuissancedesorigineset origine de la puissance, annonce aussi l'intervention de Poséidon, le dieu de la mer qui prêtera ses chevaux.
Toutunjeud'analogiessedéroulelogiquement.Cequ'ilyademeilleur,c’estl’eau,lapuissance. C'estencorelarichesse.Dansledomainedesconventionsetdeséchanges,l’orestbrillantcommele feu,le feudontonsaitqu’il avaleurimmortalisante.353 Etfinalement,commelemot« meilleur »se dit en grec « ariston », toutes ces assimilations, de proche en proche, finissent par être une approbation du pouvoir politique aux meilleurs, ce qui se dit en grec aristocratie. A nouveau, nous glissonsinsensiblementdelapenséemythiquetraditionnelleversuneapologiedupouvoirautoritaire.
351.Pindare. Troisième Néméenne
352.Freud. Totem et tabou.
353.ParexempleJ-PVernant. Mythe et pensée chez les Grecs.PetitecollectionMaspero.Tome1.p159etsuiv.
Ces annotations multiples de la puissance, l'eau, l’or, le cheval, le sport, sont naturellement reprises dans d'autrespoèmes de Pindare.La Troisième olympique fait état descorrespondances. Le meilleurdeséléments,c'estl'eau;lemeilleurdesmétaux,c’estl’or;lemeilleurdeshommes,c'estle vainqueur. « Si, entre tous les éléments, l'eau tient la première place, l’or est le plus estimable de tous les biens ; en ce temps-là aussi c’est Théron qui, entre tous, est allé le plus loin dans la voie des vertus. »354
Demême,onpeutliredansla Cinquième isthmique :« Mère du soleil, Thia, que nous invoquons sous des noms multiples, c’est aussi grâce à toi que les hommes estiment plus que toute chose la grande puissance de l'or. N'est-ce pas sous ton patronage que les vaisseaux qui rivalisent sur mer et que les chevaux attelés aux chars dans le tourbillon de l’arène, se font admirer de nous, et que, dans les luttes où se dispute le prix, celui-là obtient la gloire désirée, qui voit son front vainqueur paré de toutes sortes de couronnes, pour l'avoir emporté par la vigueur de ses bras ou l'agilité de ses jambes. » 355
Et Puech, à qui nous empruntons ces traductions du texte de Pindare, dit en commentant la PremièreNéméenne:« La vie héroïque d’Héraclès… symbolise admirablement toute la vie héroïque de Chromios… Héraclès goûte cette félicité dans les bras d’Hébé, son épouse divine, à la table de Zeus, son père, comme Chromios jouit de sa gloire auprès de sa femme, sœur de Gélon, auprès de son beau-frère Hiéron, dans son palais d’Ortygie.»356
Néanmoins, si la pensée mythique inhérente au sport s’adapte aux évolutions historiques et intègre,grâceàlamagiesympathique,lesélémentspolitiquesdel’actualité,ellecontinue,maintenant uniesensesstructuressesdiversesstratificationsculturelles,àvéhiculerdeschosestrèsanciennes.Il existed'incontestablesrésonancestotémiques.
Dans la Première Olympique, tout se passe sous le signe du cheval. Hippodamie, enjeu de la course, est, si on décomposeson nom, ladompteuse dechevaux, et, si on retourne l’ordre des mots, celle qui totémiquement est soumise au cheval, soumise à son père Oïnamaos qui possède… [page manquante]
354.Pindare. Troisième Olympique
355.Pindare. Cinquième Isthmique
356.Puech,sonintroductionàlatraductiondela Première Néméenne.CollectionBelles-Lettres
Unebrusquerupturedansl’idéologie.
Lechangementquiintervientestbrutal.C’est le mépris d’Euripide,l‘ironied'Aristophane.Mais surtout c’est la récupération étatique du sport àla manièrede Xénophon etde Platon. PourAristote, leproblèmen’existeplus.Commentenest-onarrivélà?
D'abord, on commencepar tout remettre en cause et on assiste à une désacralisation progressive des valeurs. Socrate est un bon exemple de ce à quoi aboutit cette tendance qui s'amplifie irrésistiblement. L’individu s’interroge sur lui-même et la morale prend le pas sur les questions cosmologiques. On met en doute, c’est l’Hiéron de Xénophon, le bonheur qu’on peut retirer du pouvoir. On conteste la passion sportive, comme le Philippide des Nuées. On analyse, c’est Hippocrate,lescausesdelamaladie.Oncherche,PolyclètedeSicyone,lesconditionsdelabeauté.
Ensuite,lecommerce,l’artpublicitaireetl’iconographie« éducative »s’emparentdusport.
Lacommercialisationdesarticlessportifs,c’estparexemplel’huilepourlaquellelesCorinthiens possédaient des forêts d’olivier. Les Corinthiens seront les principaux fournisseurs de l’huile parfuméeutiliséeparlessportifsavantdes’adonneràlalutte.
Mais le conditionnement n’est pas sans importance. Les marchands demandent aux potiers des flacons susceptibles d’inciter la clientèle à acheter. Ainsi s'explique la forme des vases, une embouchure étroite pour ne laisser sortir l’huile que goutte à goutte. Pour plaire à l’œil et vendre mieux,desthèmes,desscènes,dessujetssontreprésentéssurcesvases.
Plusd’argentcompenseunesacralisationmoindre.Lamythologiebienécritefaitvivre.Simonide s’est fait dans ce domaine une forte réputation d’avarice. C’est Aristote qui rapporte qu’un homme avait remporté la victoire avec un attelage de mules, course relativement peu prisée et qui ne se maintintauxjeuxolympiquesqu’unecinquantained’années.Unetropfaiblesommed’argentluiétant offerte, Simonide refusa la commande, sous prétexte qu’il était indigne de lui de composer des vers à la louange de demi-baudets. Mais l’autre insista, proposa un salaire plus important et le poète, changeant d’avis, aurait commencé son texte en saluant « les filles des coursiers aux pieds rapides comme la tempête.»Etpourtant,ironiseAristote,cesmulesn’enétaientpasmoinsdesbaudets.357
PindarequisefaitpayerluiaussifaitsansdouteuneallusionperfideàsonaînéSimonidelorsqu'il parledecestemps « où la muse n’était pas mercenaire. »358
La sculpture elle aussi s’inscrit dans l’évolution technologique et commerciale. Egine avait son école. On y avait découvert des procédés de fonte de bronze. On connaît le nom de Glaukias à qui GélondeSyracuseavait commandéunchardebronzepourcommémorersavictoireolympiquede485-484.En-466environ,HiérondemanderaàOnatasunquadrigedebronze.Lasciencetechnique d’Onatas lui permettait, en effet, d’entreprendre des statues de grande dimension ; il avait construit unApolloncolossalàPergameetsonHéraclèsàOlympiemesurait4.60mdehaut.
Lesport,quiapartieliéeaveclarichesse,etlepouvoirsontmaintenantd’ordrearistocratique.La poésietentederelierl’exploitsportifaugestearchétypal,larichesseprésenteauxlégendesdupassé, lesréalitésactuellesaux mythesanciens.Maisl’exploitsportifestréservéàlarichesse.Desécuries, desécuyers,letransportdeschevauxetdumatériel,lesalairedupoète,celuidusculpteur,toutnous montrequelesportexigeuncertainstandingsocial.
357 Aristote. Rhétorique.LivreIII,chapitreII,14.
358 Pindare. Deuxième Isthmique
Pindaresoulignecettesituation:« Ils n’avaient pas négligé non plus d'envoyer leur quadrige au siège courbe dans les grandes panégyries et ils se complaisaient aux dépenses qu’exigeaient d’eux leurs chevaux pour lutter contre les peuples de toute l’Hellade.»359 Ilsuffit d’ailleursderegarderla listedescommanditairesdePindare:HiérondeSyracuse,Thérond’Agrigente,PsaumisdeCamarine, DiagorasdeRhodes,Chromiosd’Etna,etc…Deplus,pratiquementunpoèmesurdeuxvientcélébrer unecoursedechars.
Le sport est donc un signe de la réussite sociale et un moyen de promotion politique. Plutarque dit d’Alcibiade « qu’il n’y eut onques homme privé, ni roi même, qui envoya aux jeux olympiques sept chariots équipés pour courir, comme il fit, ni qui en une même course ait remporté le premier prix, le second et le quatrième comme dit Thucydide, ou, comme le met Euripide, le troisième.»360 Thucydide rapporte le discours que fit Alcibiade pour réclamer le commandement d’une expéditioncontrelaSicileetCarthage:« Je ne me crois pas indigne d’un tel poste … N’ai-je pas fait courir sept chars à la fois ? … Avoir pu réaliser un tel exploit constitue aux yeux de l’opinion un indice de puissance. »361 Maispersonnen’estdupe:« Un tel succès lui rapporterait de l'argent et de la gloire… Ils le soupçonnèrent d'aspirer à la tyrannie et se dressèrent contre lui ».362
Maislesacrén'estplusjamaisplus.C'estl'ironied'Aristophane.Tantôtelleestinsultante:« Si tu t’abstiens du vin, du gymnase et autres insanités …»363 Tantôt elle reste souriante « Que signifie donc cette crête des oiseaux ? Sont-ils venus courir le double stade ?»364 Tantôtelles’exprimesous laformedela fantaisie:deschevauxdisent deleursmaîtresqui ontprislesramespourlesconduire versCorinthe« Hippapaï ! qui va ramer ? souquez ferme ! » Il yabienun jeudemotsévident avec « Ruppapaï » qui est l’exhortation des matelots à ramer. Mais l’association du cheval et de l’eau ne susciteaucuneallusionausacré.Iln’yaquelamoqueriedeschevauxenversleshommes.365
Enfait,chezAristophane,ondoitretenirsurtoutladénonciationvigoureusedelapassionsportive pourlescoursesdechars.Onlatrouvedansles Nuées etdansles Cavaliers
Dans les Nuées, Philippide « portant longue chevelure, fait du cheval, conduit attelage à deux chevaux et rêve chevaux. »366 C’est pour raisonner une telle passion, exclusive et coûteuse, que son pèrele conduit àSocrate. Lepèrey renonce. Il aessayé deprendreson fils par les sentiments enlui demandant s’il l’aimait et ce dernier a répondu « Oui, par Poséidon. » Or, Poséidon est le dieu des chevaux.L’enfantestintoxiquédemythologieetdepassionsportive.
L’interventiondeSocrateopèreefficacement,maisàlamanièred’unecurepsychanalytique.Tout estdémystifié.Maisplusrienn’estsacrédèslorsqu’onasupprimélapassion,lapenséemythiqueet toute l’organisation émotionnelle. La froide analyse ne distingue pas entre les valeurs. Rien ne tient devant elle, ni la société, ni la famille, ni le sport. C'est le grand déblayage. Le verdict du fils démystifiéestterrible: « Quand je nem'intéressais qu’àl'équitation, je n'étais pas seulement capable de dire trois mots correctement. Mais à présent que cet homme m'a détourné de cette pratique et que je suis rompu aux fines maximes, aux raisonnements et aux méditations, je vais pouvoir prouver qu’il est juste de châtier son père. »367
Troptardpourrevenirenarrière.Strépsiadeesttoutprêtàconcéderàsonfilscedontilvoulaitle dissuader.L'élève neveut pas renoncer à ses maîtres. En vain Philippide est-il supplié devénérerle Zeuspaternel. « Comme tu retardes ! Y a-t-il un Zeus ? »368 Laraisonanalytiqueaprisdéfinitivement lepassurlamythologiesportive.Ilneresteplusaupèredésespéréetfurieuxqu’àadopterlaréaction laplusstupide,celledelaviolence,àallermettrelefeuàlamaisondeSocrate.
359.Pindare. Quatrième Isthmique
360.Plutarque. Vie d’Alcibiade.XVII.
361.Thucydide. La guerre du Péloponnèse.VI,16.
362.Thucydide. La guerre du Péloponnèse.VI,15.
363.Aristophane. Les Nuées.
364.Aristophane. Les Oiseaux
365.Aristophane. Les Cavaliers.
366.Aristophane. Les Nuées
367.Aristophane. Les Nuées.
368.Aristophane. Les Nuées.
Dans les Cavaliers, l'ironie à l'égard des chevaux, des valeurs qui s'y attachent et du prestige sportif et militaire des cavaliers se fait nette et directe : « Nous voulons célébrer comme nous les connaissons les mérites de nos chevaux. »369 Ceux-ci entendent participer à la geste héroïque des hommes et « comme des hommes s’embarquer sur des navires, ...s'emparer des rames. »370 Et l'un despersonnages,Théôros,faitdireàuncrabecorinthien: « C'est terrible, avoue-le, Poséidon que je ne puisse échapper aux cavaliers ni sur Terre, ni sur mer, ni dans les profondeurs sous-marines. »371
Désacralisationencore,Euripideparledesathlètescommed’unfléauquiaffligelaGrèce.Ilssont esclavesdeleursmâchoires,dominésparleurventre:« Brillants dansleur jeunesse, ils sont laparure de la ville, mais quand s’abat sur eux la vieillesse amère, usés jusqu’à la corde, ils disparaissent.»372 Or, c’est à Autolycos qu’il fait dire ces paroles, Autolycos qui enseigna à Héraclès l’art de la lutte. Certes Xénophane jadis avait tenu des propos analogues : « Il n’est pas juste de préférer la force physique aux avantages de l’esprit. »373 EtAnacharsis. 374 EtSolon. 375 Maiscettefoislespropossont lancésdansunthéâtre.
Désacralisation toujours, la trêve militaire n’est plus toujours respectée. Thucydide nous conte comment les Lacédémoniens se voient interdire l’accès des jeux par les Eléens. Un spartiate disqualifiéparcequ’iln’avaitpasledroitdeconcourirestfrappésurlapiste.Toutlemondes’attend àuncoupdeforce.376 LatrêveolympiqueserarompueensuiteparuneinterventiondesBéotiensdans lePéloponnèseen-364.
Désacralisation enfin, ou du moins laïcisation des jeux, des athlètes consacrent leur effigie à Olympie.C’estPraxidamasd’Eginegagnantlepugilatàla59èmeOlympiadeetRhéxibiosd’Oponte remportantlepancraceàla61èmeOlympiade.
Le sport va devenir profane. Il ne sera plus qu’un moyen. Mais cette profanation du sport s'accompagne d’une sacralisation de l’Etat qui devient la fin poursuivie. D’où le changement de fonctiondusport.Iln‘estplusgestemythiqueintégrateur,maisactepolitiqueprémilitaire,hygiéniste. Sous des dehors éducatifs, il exprime une lutte des classes autant qu’une formation militaire : « Les athlètes devaient défendre leur Etat des ennemis extérieurs, mais ils écrasaient les révoltes d'esclaves commençant dès le Vème siècle avant notre ère. »377
L’ambiance des jeux, de toutes façons, était devenue très différente dès le -VIe siècle. Les concours de rhapsodes, les représentations théâtrales, les jeux gymniques, les processions somptueuses font perdre un peu partout la signification primitive des fêtes. Les sacrifices aux Olympiens avaient de tout temps donné lieu à des banquets où l’on communiait en consommant les chairsdelavictime.Ceneserabientôtplusqu’unprétexteàdistribuerdesvivresaupeuple.Lesfêtes nesontplusdestinéesauxdieux.
369.Aristophane. Les Cavaliers.
370.Aristophane. Les Cavaliers.
371.Aristophane. Les Cavaliers.
372.Euripide. Autolycos
373.Athénée. Le Banquet des Sophistes.X,413.
374.DiogèneLaërce.Anacharsis.
375.DiogèneLaërce. Solon
376.Thucydide. La guerre du Péloponnèse.V,49-50
377. Guide de l’Ermitage. La culture et l’art du monde antique. Leningrad.1963.p.20.
IlyaunelignedePindareetunelignedePlaton.Désormaislaproblématiquedusportestposée historiquement dans toute l’ampleur de sa contradiction, divisée entre tendance initiale, le besoin héroïque du beau risque à courir, et une tendance secondaire et dérivée, mais très possessive, la récupération étatique à des fins éducatives. Le sport hésite, partagé entre les pulsions de la vie et le servicedelasociété.
Cettequatrièmepartiecomporteraquatrechapitres:
Chapitre16. Hiéron, Simonide et Xénophon
Chapitre17. Platon et l’éducation sportive.
Chapitre18. Le sport par connaturalité ou l’antisystème oriental du sport.
Chapitre19. La gladiature et l’hippodrome.
Despersonnageshistoriquestransformésenpersonnagesd’undialogue philosophique.
Nousavons déjàrencontréHiéronàproposdela Première Olympique dePindare.Ronsardnous rappelleraitaubesoinquePindare « Avec Hiéron, roi de Sicile, Trafiqua maint vers difficile. »378
NousavonsdéjàrencontréaussiSimonide,l’aîné,lerivaldePindare. Cesontcesdeuxpersonnages,leprinceetlepoète,tousdeuxétroitementliésàl’histoiredusport et à la littérature sportive, que Xénophon, penseur, politique et stratège, va mettre en scène comme protagonistesd’untraitédialoguésurlatyrannie.
Onpeuts’attendreàcequeladescriptiondutyransoitmoinsidéaliséechezXénophonqu’ellene l’était chez Pindare, encore que celui-ci multipliait les encouragements à la prudence et à la modération. On peut s’attendre également à ce que Xénophon tire les personnages à soi et n’agisse pasenhistorienmodernescrupuleux.
Mais Syracuse jouissait d’une telle renommée et Simonide d’un tel prestige que Xénophon trouvait là des interlocuteurs tout désignés et un décor idéal pour situer concrètement sa démonstration. Lesujet devait d’ailleurs faire communément l’objetde discussions. Théophraste en aurait parlé dans un Traité sur la royauté dont Plutarque évoque le passage se rapportant à Hiéron: « Théophraste écrit au traité qu’il a composé de la royauté que Hiéron ayant envoyé à la fête des jeux olympiques des chevaux pour courir, et y ayant fait une fort magnifique, somptueuse et riche tente, Thémistocle fit une harangue aux Grecs, en laquelle il leur remontra que l’on devait déchirer et saccager cette tente de tyran, et ne recevoir point ses chevaux pour courir avec les autres, à qui emporterait le prix de vitesse en ces jeux sacrés. »379
Enfait,Xénophons’enprendausportdeprestigeparlequelunhomme–iciunprince–cherche à obtenir une gloire personnelle. Hiéron – son nom signifie l’homme du sacré – entend d’étranges leçonsdanslabouchedeSimonide.D’abord,lacompétitionestabsurde: « Les athlètes n’ont pas de plaisir à vaincre, quand ils se battent contre des gens qui n’entendent rien à la lutte ; mais, s’ils sont vaincus par leurs rivaux, ils en ont du dépit. »380 Ensuite, il est plus absurde encore que ce soit le princelui-mêmequientreencompétitionàtitreindividuel.Ilaautrechoseàfaire: « Quelle est à ton avis la plus belle victoire, celle que tu gagnes par l’excellence de ton attelage, ou par le bonheur de la cité que tu commandes ? »381 Il renverse les rôles: « Crois-tu qu’il serait plus glorieux pour toi d’être celui de tous les Grecs qui nourrirait et enverrait aux concours le plus grand nombre d’attelages que si le plus grand nombre des éleveurs venaient de ton état ? »382 Ilsemet entant que prince,ensituationimpossible: « Vainqueur, tu ne seras pas admiré, mais envié, parce que tu auras dépouillé un grand nombre de maisons pour fournir à tes dépenses ; vaincu, tu seras le plus ridicule des hommes. »383
378.Ronsard. A Madame Marguerite.1578.
379.Plutarque. Vie de Thémistocle.XLVII.
380.Xénophon. Hiéron.ChapitreIV.
381.Xénophon Hiéron.ChapitreXI
382 . Ibid.
383.Xénophon. Hiéron.ChapitreXI
AubrillantdeSyracuse,Xénophonpréfèrelasoliditéspartiate.Onnedoitpasseprépareraujeu maisauxbatailles. « Il est bien plus glorieux d’être vainqueur à la guerre qu’au pugilat. »384 Notons queXénophonneditpas« plus utile »mais« plus glorieux ».
Qu’on ne dise d’ailleurs pas que la guerre est un état exceptionnel et qu’on se passerait bien de pareille gloire. Il suffit de se préparer à l’éventualité de la guerre et la force qu’on en retire donne l’occasiondetriomphersanscombattre: « Dans les jeux, on ne couronne pas moins le champion qui n’a pas trouvé d’adversaire que celui qui a gagné la palme en combattant. »385
Néanmoins, Xénophon a remarqué combien les récompenses sportives étaient stimulantes. Son Simonide le dit à Hiéron: « Vois dans les concours hippiques, gymniques et chorégiques combien sont chétifs les prix qui provoquent des dépenses immenses, des travaux sans nombre et des soins innombrables. »386 Illereditlui-mêmedansl’Hipparque :« Pour des prix de médiocre valeur, on se donne des peines infinies, on fait de grosses dépenses.»387
Maisils’agitd’êtreprudent,carl’armeestàdoubletranchant.Cyrusestàlafoislouéetcontesté. « Les jeux qu’il proposait et les prix qu’il offrait, dans le but d’inspirer de l’émulation pour les nobles travaux, s’ils méritaient des éloges à Cyrus pour le soin qu’il prenait de faire pratiquer la vertu, ils excitaient par contre des contestations et des rivalités parmi les grands »388 Nousavonsunpeuplus loin dans la Cyropédie un exemple de ces organisations: Cela commence par un sacrifice: « Ils sacrifièrent à Zeus et firent un holocauste de taureaux ; ils brûlèrent de même des chevaux en l’honneur du soleil ; puis ils immolèrent des victimes à la terre dans les formes que lui indiquèrent les mages, puis aux héros protecteurs de la Syrie ; ensuite, comme la place se prêtait à son dessein, Cyrus indiqua un but éloigné d’environ cinquante stades… Lui-même fit la course avec les ¨Perses et l’emporta de beaucoup sur les autres… Cyrus fit aussi courir chacun des corps de chars, et, à tous les vainqueurs il donna des bœufs pour faire un sacrifice et un festin et des coupes... »389
En tous cas, selon Xénophon, pas de sport de prestige, c’est une des leçons à tirer de l’Hiéron, mais un sport utilitaire et guerrier, c’est l’enseignement de l’Agésilas. Agésilas, le roi de Sparte, est enquelquesortel’anti-Hiéron,letyrandeSyracuse.
XénophonloueAgésilasd’avoirdissuadésasœurdetirergloiredelaréussitesportive.Lavictoire sportive est une affaire d’argent. Agésilas, dit Xénophon, avait « persuadé à Kynisca, sa sœur, d’élever des chevaux et montré, quand elle eut remporté la victoire, que l’entretien d’une écurie annonçait non le courage, mais l’opulence… Une victoire remportée sur des particuliers dans une course de chars n’ajouterait rien à sa renommée. »390
Plutarque, il est vrai, nous montre un Agésilas peu scrupuleux dans l’appui qu’il apporte pour faire inscrire un concurrent dans une catégorie d’âge qui n’est peut-être pas la sienne. « Il se vint présenter pour être enrôlé au nombre de ceux qui devaient combattre aux Jeux Olympiques, il fut en danger d’être de tout point rejeté ; par quoi le Persien qui l’aimait eut recours à Agésilas, le requérant de vouloir aider ce jeune champion, de sorte qu’il ne souffrit point ce déshonneur d’être refusé. Agésilas, lui désirant gratifier jusqu’à là, s’y employa et obtint ce qu’il demandait, non sans grande peine et difficulté. »391
MaisXénophon,logiqueaveclui-même,nousdépeintAgésilasentretenantuneagitationsportive à Ephèse à des fins militaires. « On put voir alors les gymnases pleins d’hommes qui s’exerçaient, l’hippodrome rempli de cavaliers qui s’entraînaient, tandis que les lanceurs de javelots et les archers tiraient à la cible, en sorte que la ville entière où il était, offrait un intéressant spectacle.»392 Ilajoute unpeuplusloin:« On aurait pu vraiment prendre la ville pour un atelier de guerre.»393
384.Xénophon. Hipparque. ChapitreVIII.
385 .Xénophon. Agésilas.ChapitreVI.
386.Xénophon. Hiéron.ChapitreIX.
387.Xénophon. Hipparque.ChapitreI.
388.Xénophon. Cyropédie.LivreVIII.ChapitreII.
389.Xénophon. Cyropédie. LivreVIII.ChapitreIII.
390.Xénophon. Agésilas.ChapitreXI.
391 .Plutarque. Vie d’Agésilas.ChapitreXX.
392.Xénophon.Agésilas.ChapitreI 393. Ibid
Seulement, on voit apparaître, dans la pensée de Xénophon, la distinction entre deux sortes de pratique sportive. L’une d’elle concerne le tout-venant, le militaire de base et Xénophon prévoit le détail de l’intendance sportive: « Ceux que la loi soumet à un entraînement physique seront plus assidus aux exercices du gymnase si on leur donne une nourriture plus abondante qu’ils n’en reçoivent du gymnasiarque dans les courses aux flambeaux. »394 L’autre souligne la noblesse de l’équitation, le sport par plaisir: « La plupart des exercices gymniques ne se pratiquent pas sans sueur, tandis que la plupart des exercices équestres se font avec plaisir. Si l’on envie le vol de l’oiseau, il n’y a rien dans les actions des hommes qui y ressemble davantage. »395
Finalement, on n’est peut-être pas aussi loin d’Hiéron ni de Simonide que l’on ne l’imaginait. Sans doute le vrai Simonide se serait-il gardé de tenir au vrai Hiéron le discours que Xénophon lui prête et vraisemblablement n’aurait-il jamais eu l’idée de tenir de pareils propos, car il vivait de ce sportdeprestigeetdesesretombées.Etlacontrepartiedel’Agésilas estlàsansdoutepourrévélerun contextesocialetculturelbiendifférentdeceluidescitésaristocratiquesdeGrandeGrèce.Maisily a au moins ceci en commun dans les deux attitudes à l’égard du sport que le plaisir du sport est un privilège.Lefantassinn’adroitqu’àdel’éducationphysiquemilitaire.
En effet, la passion sportive est quand même présente chez Xénophon. L’accent mis sur les préoccupationsmilitairespeutlemasquer,demêmequelacondamnationdelapublicitésportiveàla manière d’Hiéron. Mais il y a un domaine où le sport représente valeur, joie et passion, sans que l’analysedeXénophonnepuisseriendissimulerdesesconvictionsintimes.C’estlachasse.
D’abord, la chasse est divine. « C’est une tradition antique que les dieux aiment à chasser et à voir chasser »396 dit Xénophon. La chasse et les chiens, ajoute-t-il, sont une invention d’Apollon et d’Artémis. 397 EtcetteinventionfuttransmiseàChiron,unfilsdeCronos,Chironquifutunéducateur remarquable. La chasse est une vertueuse passion finalement: « Parmi les anciens, les élèves de Chiron… avaient acquis, étant jeunes, de nombreuses et belles connaissances, à commencer par la chasse. De là leur était venue cette haute vertu pour laquelle on les admire encore aujourd’hui. »398 Philosophe,historien,stratège,mémorialiste,Xénophonthéoriselesportàlalimitedusportd’Etatet lapassionaristocratiqueencorelestéedemythologie.
394 .Xénophon. Les Revenus.ChapitreIV.
395.Xénophon. L’Hipparque.ChapitreVIII.
396.Xénophon. De la chasse.ChapitreXIII. 397.Xénophon. De la chasse.ChapitreI.
398.Xénophon. De la chasse.ChapitreXII.
Platonetl’éducationsportive
Unsportrécupéréincorporédansl’Etat.
PourPlaton,onadéjà eu l’occasiondeledire,le sportn’aplusrienàvoir aveclamythologieet lapoésie. Il raille Pindaredansl’Euthydème, enparodiantle débutdela Première Olympique : « Ce qui est rare se paie cher, tandis que l’eau est ce qu’il y a de meilleur marché tout en étant, à ce que dit Pindare, ce qu’il y a de meilleur. »399 Et, dans le Lysis, il traite de vieillerie la poésie sportive à base mythologique: « Ce que la cité chante… sur ses aïeux, sur leur richesse, sur le soin qu’ils prirent à l’élevage des chevaux de course, sur leurs victoires… Voilà ce qu’il met en vers ou en prose, et des vieilleries encore plus antiques que cela. »400
QuelssontdonclesobjectifsdusportpourPlaton?
C’estd’abordl’entretienducorpsetl’excellencedel’âme.Lapréparationsportiveencesensest louable.Elleimpliquel’effort,letravail,lemérite: « La vie d’un homme qui aspire à être vainqueur aux jeux pythiques ou olympiques, cette vie, dont à très bon droit j’ai affirmé qu’elle a rapport, d’une façon générale, à l’entretien du corps et qu’elle a pour but l’excellence de l’âme, cette vie-là est dépourvue de loisir, lourde d’occupations, au double de l’autre et même bien davantage encore. »401
C’est ensuite l’apprentissage de la guerre et la célébration des fêtes. Sport, entraînement, compétition doivent déboucher sur la préparation militaire et le culte de l’Etat. « Les compétitions gymniques, avec les exercices qui les préparent, si elles ont un but, ne doivent en avoir un autre que celui-ci : l’apprentissage de la guerre et la célébration des fêtes. »402
C’est enfin (à) un rôle médical à jouer: purger le corps.403 A condition, bien entendu, de ne pas selivreràunepratiquesportiveexcessivecomme cefameuxHérodicos, entraîneurimpitoyable,qui s’exténua lui-même et en exténua bien d’autres404, faisant courir jusqu’à Mégare, revenir, repartir, etc.405
Mais on ne peut pas tenir rigueur au sport de l’usage qu’on en fait. L’abus n’implique pas la condamnationdel’usage.« Ce n’est pas parce qu’on sait pratiquer le pugilat, le pancrace, l’escrime en armes, de façon à y être le plus fort qu’amis ou ennemis, que la raison d’être de ce savoir soit de cogner sur ses amis ni non plus de leur piquer dedans ni de les tuer ; c’est pourquoi, s’il arrive qu’un homme, après avoir fréquenté la palestre, bien en forme physiquement, cogne ensuite sur son père, sur sa mère ou sur quelque autre de ses proches ou de ses amis, cela ne doit pas être un motif, vis-àvis d’eux et de ceux qui enseignent l’escrime en armes, pour haïr ces gens-là ni pour les chasser des cités. »406
Toutsimplement,il s’agit, avecmesure,detenirsesobjectifs.Lechoix desméthodesenrésulte. Par exemple on retiendra l’utilité pour la guerre des pratiques sportives requérant l’ambidextrie: « Qui s’est parfaitement exercé, soit au pancrace, soit au pugilat seul ou seulement à la lutte, n’est pas impuissant à recourir dans le combat à sa main gauche, au lieu d’agir en estropié et de se contorsionner maladroitement quand l’adversaire, en y portant son attaque, le force à faire travailler
399.Platon. Euthydème.304b.
400.Platon. Lysis. 205cd.
401.Platon. Lois.VII.807c.
402.Platon. Lois.VII.796d.
403.Platon. Timée.89a.
404.Platon. République.406a-b.
405.Platon Phèdre 227b.
406.Platon. Gorgias.456c-457a.
l’autre côté »407 Et c’est dans ce sens qu’on peut dire du philosophe qu’il est à l’image de l’athlète complet 408,c’est-à-direéquilibré,sûrdelui,opérationnel,dominantlessituations.
D’ailleurs, Platon prévoit toute une réglementation de la pratique sportive. Dans les projets platoniciens, l’Etat s’intéresse de très près à l’organisation du sport et à ses modalités concrètes de réalisation. C’est un sport obligatoire pour tous, femmes comprises, sauf certaines compétitions spéciales.Platonledit: « Rien de plus déraisonnable que ce qui a lieu à cette heure dans notre pays, où l’on ne voit pas hommes et femmes pratiquer de toutes leurs forces, d’un même cœur, les mêmes exercices. »409 Illeredit: « C’est une obligation aussi que ces exercices soient pratiqués par tous les citoyens et toutes les citoyennes. »410 Tout au plus, en matière de dispense, envisage-t-il une participation facultative et conditionnelle des femmes aux compétitions hippiques: « Quant aux femmes, il ne vaut pas la peine de les contraindre par des lois et des règlements à prendre part aux jeux qui concernent ces exercices ; mais si, en conséquence précisément de tout cet apprentissage antérieur elles sont venues à un état d’habitude, si leur constitution naturelle ne s’y oppose point et que, dans leur enfance et leur jeunesse, elles y aient participé sans déplaisir, alors on leur permettra de concourir pour ce dernier jeu. »411
Réglementation de la pratique sportive, Platon a même prévu l’accident mortel. « Si c’est dans une compétition ou dans les jeux publics que l’on fait, sans le vouloir, périr un compatriote sous les coups, que ce soit sur le champ, que ce soit dans le temps qui suit… une fois que le meurtrier aura été purifié conformément à la loi qui a été apportée de Delphes, qu’il soit lavé de toute souillure.»412 Il est vrai que ce genre d’incident survenant lors des jeux devait engendrer une sorte de frayeur superstitieuse.Rienn’arriveparhasard.Unemaindivinedirigeoudétournelestrajectoires.Lesmorts accidentelleslorsdesjeuxontpumarquerlamythologie.C’estparexempleledisquelancéparPersée qui,malencontreusementdévié,frappeAcrisiosàlatêteetletue.
Réglementation toujours de la pratique sportive, Platon envisage déjà l’hypothèse des détournementset,lachosedevaitarriversansdoute,parledelaconduiteàtenirencasd’enlèvement d’un adversaire pour l’empêcher de concourir. « Si maintenant c’est un compétiteur qu’on empêche par la violence de se présenter à un concours d’athlétisme, de musique ou de quoi que ce soit d’autre, le dénonce qui voudra aux présidents des jeux ; et ceux-ci donneront à celui qui se proposait de participer au concours la possibilité de le faire. S’ils n’en ont pas eu la possibilité et que le vainqueur soit celui qui a empêché son compétiteur de concourir, c’est au concurrent déloyalement écarté que sera attribué le prix de la victoire, avec le droit d’inscrire dans les temples qu’il voudra son nom comme étant celui du vainqueur, tandis qu’à l’auteur de l’empêchement, il ne devra pas être permis de jamais faire aucune offrande dédicatoire, non plus qu’aucune inscription relative à une pareille compétition. »413
Maislaréglementationdelapratiquesportive,c’estévidemmentlaconstructiondeséquipements. Platon en parle dans le Critias : « Beaucoup de gymnases pour les hommes, de manèges pour les chevaux, à part dans chacun des îlots des deux premières enceintes circulaires ; et, en outre, dans le milieu du plus grand des îlots, avait été réservé un hippodrome, large d’un stade et dont la longueur permettait aux chevaux engagés dans la course de faire le tour entier de l’îlot »414 Ilenparle encore dans les Lois « Construction de gymnases en même temps que d’écoles publiques, au nombre de trois, au milieu de la ville ; et, d’autre part, hors de la ville et dans ses environs, encore au nombre de trois, des manèges pour l’équitation, avec de larges espaces libres aménagés en vue du tir à l’arc et des divers lancers de projectiles, destinés à la fois à l’instruction et aux exercices de la jeunesse. »415
407.Platon. Lois.VII.7695a.
408.Platon. Les Rivaux.136a.
409 .Platon. Lois.VII.805a.
410 .Platon. Lois.VII.814.
411 .Platon. Lois.VIII.834d.
412 .Platon. Lois.IX.865a
413 .Platon. Lois.XII995ab
414 .Platon. Critias. 117c
415.Platon. Lois.VII.804c.
L’arbitrageetl’intendancedesjeuxsont aussiunequestiondélicateetd’autantplusquelesjeux ontenmêmetempsuncaractèresacréetsocial.Toutelacitéestengagéeparleurbonneorganisation. Il faut que le jury soit exemplaire. Platon imagine une procédure très compliquée de désignation du corps arbitral, soucieux d’éviter l’incompétence que pourrait amener un tirage au sort pur et simple et d’échapper au soupçon d’arbitraire qui résulterait d’une nomination d’office par le pouvoir en place. Platon réaffirme d’abord l’autorité de l’Etat sur le sport, sa volonté de tutelle, nous dirions aujourd’huisondroitd’habilitation:
« La loi entend parler de fonctionnaires chargés de veiller au bel aménagement des gymnases et des écoles, à l’instruction qui s’y donne en même temps qu’ils surveilleront ce qui a rapport à la fréquentation scolaire et aux locaux pour les garçons et pour les jeunes filles. Mais, d’un côté, la loi entend parler aussi des concours, et aussi bien dans les exercices gymniques que pour tout ce qui a trait à la musique, de magistrats qui président les jeux dans lesquels des concurrents aspirent des récompenses. »416
Voicicommentonprocède:
« Il convient après cela d’élire des présidents de jeux… pour les concours gymniques et les concours hippiques… Sur les vingt qu’aura préalablement désignés un vote à main levée, par tirage au sort on en retiendra trois ; et, une fois ces trois désignés par le sort, c’est par le suffrage de ceux qui sont qualifiés pour faire subir l’examen probatoire, que seront définitivement choisis ceux qui auront satisfait à l’examen. Dans le cas où l’un des élus, dans la désignation au sort ou par choix à une quelconque de ces charges, serait refusé à l’examen, il faudra à sa place en choisir d’autres, selon la même procédure, et leur faire subir l’examen dans les mêmes conditions.»417
Chose certaine, la dominante est étatiste, utilitaire et surtout militariste. L’exposé des Lois ne laisseplaneraucundouteàcesujet:
« Donc, voici que dans les jeux, notre héraut, pour commencer, annoncera, comme cela se fait aujourd’hui, la course du stade ; et le concurrent s’avancera avec son armement tandis que pour celui qui n’en sera pas muni nous n’instituerons aucune récompense. Or, ce sera le premier à s’avancer qui, avec ses armes, concourra pour la course du stade ; le deuxième pour le double stade ; le troisième pour le parcours hippique ; le quatrième, cela va de soi, pour la longuecourse ; le cinquième, avecses armes, mais plus pesamment chargé quen’était le premier coureur, celui-là, que nous appelons "hoplite", nous le laisserons partir lepremier, et il aura à franchir une distance de soixante stades jusqu’à un temple d’Arès, aller et retour, concourant pour le prix sur une route assez unie ; tandis que l’autre cinquième, un archer, portant son équipement d’archer au complet, devra parcourir cent stades, jusqu’à un temple d’Apollon aussi bien que d’Artémis, concourant pour le prix sur un trajet montueux avec une grande diversité dans la nature du terrain. Puis, une fois les concours engagés par nos soins, nous attendrons le retour des coureurs, et aux vainqueurs nous donnerons les prix de la victoire fixés pour chaque course.»418
L’essentiel du sport consiste en parcours prémilitaires, masculins et féminins, des courses en armes:
« Ces concours sont de trois sortes, l’un pour les enfants, l’autre pour les garçons encore imberbes, l’autre encore pour les adultes. Aux jeunes garçons nous assignerons les deux tiers de la longueur de la course, aux enfants la moitié des courses en question, aussi bien s’ils concourent comme archers que si c’est comme hoplites. Quant aux filles, tant qu’elles sont impubères, elles concourent sans armes, dans le stade même, pour le parcours simple, pour le parcours double, pour la longue course. A partir de leur treizième année, pour celles qui attendent encore d’être mariées et de s’unir ni au-delà de vingt ans non plus qu’à moins de dix-huit ans, il n’y a lieu de descendre dans l’arène où se disputent ces courses, mais équipées
416.Platon. Lois.VI.764cetsuiv.
417.Platon. Lois.VI.765d.
418.Platon. Lois.VIII.833a-833c.
avec l’équipement approprié. Voilà qui est réglé en ce qui concerne la course à pied, tant pour un sexe que pour l’autre. »419 Ilyauradesexpertspourjugerdel’escrimeenarmes: « Passons aux concours dans lesquels la vigueur est en cause. A la lutte et aux autres compétitions du même genre, à toutes celles qui, de notre temps, sont « de poids lourds », nous substituons l’escrime en armes, soit en combat d’un contre un, soit de deux contre deux, ou encore de dix concurrents au plus contre dix autres. Quant à ce qui est de dire quels coups sont valablement parés ou valablement portés et combien il en faut pour être vainqueur, des lois sont proposées à cet égard : de même qu’il y en a aujourd’hui pour la lutte, dues aux hommes qui en cette matière ont compétence pour dire ce qui est le fait d’un bon lutteur ou d’un autre qui n’est pas bon ; identiquement aussi, il faut que les hommes qui sont éminents pour l’escrime en armes soient appelés par nous en consultation, pour nous conseiller d’un commun accord, sur les conditions auxquelles, dans les combats dont il s’agit cette fois, on sera en définitive justement vainqueur, sur les coups valablement parés ou valablement portés et, de la même manière, sur le règlement en vertu duquel on reconnaît qui est vaincu. Il en sera aussi de même pour les lois concernant les combats de ce genre entre les filles en âge de porter les armes, jusqu’au temps de leur mariage.»420
Desdisciplinessportivesserontreconvertiesàdesfinsmilitaires.Lepancracesimulerauncombat guerrier:
« Quant au pancrace, il nous faut le remplacer par un combat qui ne comporte que des armes légères, dans lequel les concurrents usent de l’arc, du bouclier léger, du javelot, des pierres qu’on lance à la main ou avec la fronde, instituant à l’égard de cette nouvelle forme de compétition des lois pour l’attribution des honneurs et du prix de la victoire à qui se sera le plus parfaitement conformé aux règles de ce jeu.»421
Et, si des compétitions hippiques non réclamées par la géopolitique sont malgré tout tolérées, c’estseulementsousréserved’unesimulationd’éducationmilitaire:
« Dans un pays comme la Crète, nous n’avons pas besoin d’un très grand nombre de chevaux, et nous n’avons pas beaucoup à nous en servir ; par suite, on aura forcément moins de zèle pour l’élevage du cheval et pour les compétitions hippiques. Aussi bien, de façon générale, n’aurons-nous pas de gens pour l’entretien du char, et, par rapport à ces choses, aucune ambition justifiée ne saurait exister chez personne. En conséquence, tout en reconnaissant qu’il ne serait pas justifié de notre part, ni ne passerait non plus pour tel, de vouloir donner à nos citoyens un entraînement spécial en vue de ces compétitions qui ne s’accordent pas avec les conditions locales, nous ne ferions rien cependant qui fût en contradiction avec la nature du pays si nous donnions une place au divertissement hippique, en instituant des prix pour les courses montées… en excluant aussi bien des présentes compétitions que de celles qui sont proprement gymniques, ceux qui se présenteraient sans avoir sur eux leur armement.»422 Les autres aspects du sport ne sont pas ignorés par Platon. La beauté du geste est évoquée par lui:« Pour courir, sauter, pour tout ce qui est exercice physique, ne sont-ce pas les mouvements vifs et rapides qui sont ceux de la belle façon ?»423 De même il perçoit l’intérêt des retournements de situation,commedanscettedescriptiond’unjeuanalogueaujeudebarres:« Il se trouve maintenant dans le camp des fuyards…, il se lance dans la fuite. Mais l’autre se trouve obligé de poursuivre.»424 Il sait qu’il faut techniqueet condition physique. Onne conduit par un char de compétition sans une préparation sérieuse: « Si quand ton père participe à un concours, tu avais envie, monté sur un de ses chars, de prendre en mains les rênes, il ne te laisserait pas faire, mais bien plutôt, il t’en
419.Platon. Lois.VIII.833c-834d.
420.Platon. Lois.VIII.833d-834a.
421.Platon. Lois.VIII.834a.
422.Platon. Lois.VIII.834bcd.
423.Platon. Charmide.159d.
424.Platon. Phèdre.241b.
empêcherait.»425 Tout est affaire de style, en sport comme en littérature: « Un propos qui compte, court et bien ramassé, à la façon d’un habile lanceur de javelot.»426 Et puis il y al’élimination des toxines et des kilos superflus: « Un seul boxeur remarquablement entraîné ne te semble-t-il pas capable de combattre deux non-boxeurs qui de surcroît sont riches et gras.»427
Platonnouslivred’ailleursdefaçoninattendue,dansuntexteconsacréàl’immortalité del’âme, desprécisionssurlatechnologieduballon: « L’aspectqu’offrirait cette terre,si on la regardait d’enhaut, ce serait à peu près celui des balles à douze pièces. »428 C’est une allusion sans doute au fait que le démiurge a donné au monde la forme d’un dodécaèdre et que, convenablement courbées, les surfaces des douze pentagones présentent l’aspect d’une sphère. Mais c’est la preuve aussi que la technologiesportivetrouvesoninspirationdansdesconsidérationsd’arithmologiecosmogonique.
Bien sûr, le sport est aussi passion populaire. Platon connaît le sport qui déplace les foules: il compare le rassemblementdesâmes àunegrande manifestationsportive oùlessupportersaffluent: « Les âmes qui sans cesse arrivaient en ce lieu y venaient manifestement à la suite d’une sorte de long voyage ; et c’était une joie pour elles de s’en aller dans la prairie, d’y poser, si l’on peut dire, leurs tentes comme aux assemblées des jeux, de s’y mutuellement congratuler chaque fois qu’elles se reconnaissaient. »429
Le sport apparaît dans la conversation comme le référentiel de toute compétition: « Ce serait comme de me demander de suivre Crison d’Himère en pleine course, ou de rivaliser avec un des concurrents soit de la longue course soit de la course d’un jour.»430
On fait d’ailleurs référence, pour dénoncer l’illogisme d’une attitude ou d’une proposition, au caractèreabsoludelalogiquesportive: « C’est comme si nous comprenions les choses de cette même façon dans le cas, aux jeux olympiques, d’une course de chevaux ou bien d’une compétition entre des hommesengagésdans la longue course ; quenous proclamions le plus lent celui qui est le plus rapide et le plus rapide celui qui est le plus lent et que, composant des poèmes d’hommages, nous chantions la victoire de celui qui a eu le dessous, alors que nos hommages ne seraient ni correctement ajustés à leur objet, ni de façon à plaire aux coureurs, à eux qui sont des hommes. »431 Autrement dit, la victoireetladéfaitesontdescatégoriesabsolues,évidentes,nonpasrelativesetcontestables. Mieux, la victoire symbolise la vie heureuse en ce monde et en l’autre. C’est en termes de rencontre sportive que Platon décrit la joie des âmes arrivées à la fin de leur voyage: « Pour que, pareils aux vainqueurs qui font autour du stade leur tour d’honneur pour recevoir gloire et récompense,nous ayons aussi bon succès ici-bas quedans ce voyage de mille annéesdont nous avons dit l’histoire. »432 Signalons au passage l’association des idées: il s’agit du voyage des âmes et on évoquelesport.
Maisonnevitquandmêmeplusdanslecontextecultureldelavietribale.Ilexistetoutunmonde dusportquiasaviepropreetsonjeuderôles.Lesportasesarbitresquidoiventresterhumainsdans leurs décisions: « C’est la juste mesure et la convenance qu’il te faut, je pense, surveiller, en ta qualité de sage arbitre … Ne sois pas rigoureux à l’excès. »433 Le sport a déjà ses associations qui fonctionnentenmicrosociétés : « Salue pour moi tes compagnons du jeu de balle. »434 Lesportases pédagogues expérimentés: « Les maîtres du gymnase connaissent, en observant la complexion naturelle des corps humains, de quelle sorte est la complexion qui, par rapport à chaque genre d’exercice, est celle qui vaut, et de quelle sorte, celle qui ne vaut pas. »435 Le sportasesentraîneurs etseschampions: MélésiasetStéphanos,lesfilsdeThucydide « étaient à Athènes, comme lutteurs,
425.Platon. Lysis.208a.
426.Platon. Protagoras.342e.
427.Platon. République.IV.422b.
428.Platon. Phédon. 110b.
429.Platon. République.X.614e.
430.Platon. Protagoras. 335e.
431.Platon. Lois.VII.822b.
432.Platon. République.X.621d.
433.Platon. Cratyle.414e.
434.Platon. Lettre.XIII.363d.
435.Platon. De la vertu.378e.
ce qu’il y avait de mieux ; il avait en effet donné l’un à Xanthias, l’autre à Eudêre, lesquels passaient, en ces temps-là, parmi ceux qui à la lutte étaient les plus habiles. »436Le sport a son public dont les cris ne constituent pas une mince stimulation: « Au spectacle des jeux, les lutteurs sont stimulés, même par les cris des enfants, à plus forte raison certainement par ceux de leurs amis dont les encouragements, on s’en doute, ont une ardeur proportionnée à leur sympathie. »437
Mais le sport sert aussi de véhicule et de prétexte à diverses choses. Certains de ses théoriciens étaient des sages déguisés: « L’art du sophiste est un art ancien, mais ceux des anciens qui l’ont exercé, par crainte de ce qu’il a d’importun, ont pris à cet effet un déguisement…, ceux-ci la poésie, comme Homère, Hésiode, Simonide ; ceux-là, de leur côté, tels Orphée et Musée, les initiations et les vaticinations ; quelques-uns, je m’en rends compte, ont choisi la gymnastique, comme Iccos de Tarente. »438 D’autres furent des doctrinaires dangereux: « Cet autre qui vit encore, non moins sophiste qu’aucun, Hérodicos de Silymbrie, anciennement de Mégare. »439 Onenadéjàparléunpeu plushaut.
Parfois, c’est le sport qui, franchissant ses limites, pénètre dans le domaine de la philosophie et, lasophistiqueenportetémoignage,substituel’art devaincreetde convaincreàlavolontédedirele vrai. Platon nous présente dans l’Euthydème des sportifs reconvertis en professeurs d’éloquence judiciaire:
« Cesont,pourbiendire,despuits descience,tous lesdeux,etje nesavaispasjusqu’àprésent ce que c’est que le vrai pancratiste… Ne sont-ils pas l’un et l’autre savants achevés dans l’escrime en armes et à même d’y rendre un autre savant, pourvu que celui-ci lui donne en salaire ? et c’est ensuite à combattre dans les luttes judiciaires qu’ils sont très forts, aussi bien qu’à instruire un autre dans l’art de parler, comme dans celui de composer des discours destinés aux tribunaux… Nul ne serait capable de même se lever pour leur résister, tant ils sont devenus habiles à faire de l’escrime avec pour armes des paroles, à réfuter chaque fois ce que l’on dit, pareillement quand cela est faux comme quand cela est vrai.»440 Ilfautdirequecetteliaisondusportetdelapolitiqueestmoinsinattenduequ’onpourraitlecroire pourlescontemporains.NousavonsvuplushautquelestyransdeGrandeGrècenesefontpasfaute d’utiliser le prestige théologique pour renforcer leur pouvoir personnel. Les grandes manifestations sportives sont aussi l’occasion de la surveillance et de l’espionnage: les propos sont entendus et répétés, on profite de ce moment d’euphorie où les langues se délient. Platon, suite à de telles délations, éprouve le besoin de se disculper auprès de Denys, tyran de Syracuse: « L’un de ces hommes prétendait avoir entendu mal parler de toi, aux Jeux Olympiques, par plusieurs personnes de ma compagnie. »441 Éventuellement, c’est de la diplomatie qui s’amorce: « Une fois arrivé dans le Péloponnèse, à Olympie, et y ayant rencontré Dion qui y était venu pour le spectacle des Jeux, je lui apprenais tout ce qui s’était passé. »442
L’association d’idées entre le sport et le droit, qui s’exprime dans l’Euthydème, n’est donc pas fortuite et, outre qu’elle rejoint cette vieille notion d’ordalie physique (devenue ici verbale), notion abordée dans notre cinquième chapitre, elle ne manque pas d’apparaître et de trouver ainsi confirmationend’autres endroits, et,commeparhasard,justement quandil s’agit demontrerquela justice ne se réduit pas à la force ou aux rapports de force: « Tu déclares que ce qui profite au plus fort est juste. Or, par-là, Thrasymaque, que peux-tu bien vouloir dire ? … quelque chose du genre : Poulydamas le pancratiste, la viande de bœuf lui profite par rapport à son corps. »443
Lavisionplatonicienne dusport,sielle est richeenélémentsquiviennent del’observationdela viequotidienneetdeshabitudesdepenséequienrésultent,marquecependantunepenséeenrupture
436.Platon.Delavertu.378a.
437.Platon. Lettre.IV.321a. 438.Platon. Protagoras.316d. 439.Platon. Protagoras.316e. 440.Platon. Euthydème.271c-172b.
441.Platon. Lettre. II.310d. 442.Platon. Lettre. VII.350b. 443.Platon. République.I.338d.
radicale avec les valeurs sportives traditionnelles. Tout est subordonné. Et tout est subordonné à l’Etat. Et cette subordination va jusqu’au totalitarisme le plus invraisemblable, tellement invraisemblableque Platon lui-même ditdans sonprojet qu’on vaen sourire,hausserles épaules ou s’indigner.
Quineriraiteneffetàl’époqueàl’idéedevoirlesfillesfairedusportaveclesgarçonsalorsque les filles sont quasiment cloîtrées et que les garçons font du sport dans leur plus simple appareil? Questiond’habitudeditPlaton.Lesport,acquisculturel,désexualiselanudité. « Il ne s’est pas passé beaucoup de temps depuis l’époque où les Grecs, exactement comme le plus grand nombre de barbares, jugeaient honteux et risible que des hommes se fissent voir tout nus, et que, le jour où la pratique de la nudité au gymnase fut inaugurée, d’abord en Crète, puis à Lacédémone, il y avait matière pour les gens spirituels d’alors à tourner tout cela en farce. »444
Alors, Platon promoteur du sport féminin dans une civilisation où la femme est une éternelle mineure?Ceseraitconclureunpeuvite.
Lamisogynieestévidentelorsquelemythenousmontrelesâmesentraindechoisir,dansl’ordre dutirageausort,parmilesnouvellesviespossibles.Atalanteveutdevenir unhommepouravoirune carrièred’athlète: « Le tirage au sort donna une place moyenne à l’âme d’Atalante : apercevant de grands honneurs attachés à une vie d’athlète mâle, elle fut incapable de passer outre et la prit. »445 Cettemisogynie n’est pasmoinsévidentequand Platondit dePélopsqu’ilavaitla vuecourte,parce qu’il « brûlait d’obtenir n’importe comment son union avec Hippodamie ». 446
C’est que la promotion du sport féminin est en fait motivée et conditionnée par la militarisation etladéfensedel’Etat.Oui,Platonsuggèredefairefairedusportauxfemmes.Mais,enmêmetemps, il présente comme un modèle de vertu la soif de victoire qui, chez certains champions, a conduit la tempérance jusqu’à l’abstention sexuelle: « En raison de l’ambition qu’il avait d’y être vainqueur, et l’âme emplie du souci de son art et de ce courage qui accompagne la tempérance, pendant tout le temps où son entraînement était à son apogée, il n’approche jamais, à ce qu’on raconte, aucune femme, non plus d’ailleurs qu’aucun garçon. »447 Il s’agit d’Icos de Tarente. Mais Platon poursuit: « Il va de soi que la même tradition a cours en ce qui concerne Crison, Astylos, Diopompe. »448 SansdoutePlatonest-ill’idéologuedusportéducatif,dusportd’Etatetdusportféminin.Ilenest lepremierthéoricien.Maisc’estunsportmilitaristeettotalitaire.Asadécharge,ladéfensedelacité etdeslibertésducitoyenavaitpourluiunesignificationimmédiate.Ilavaitétévenducommeesclave par Denys! Les élèves avaient dû racheter le professeur. Impossible d’envisager un sport tranquille etdésintéresséavecdetelssouvenirs.
444.Platon. République.V.452c. 445.Platon. République.X.620b. 446.Platon. Cratyle.395cd. 447.Platon. Lois.VIII.840a. 448.Platon. Ibid
Lesportparconnaturalitéoul’antisystèmeorientaldusport. Orient/Occident.
Lagrandequestionrestedesavoirpourquoilesports’estinstitutionnaliséenGrèceetnonailleurs pendant l’Antiquité, en Occident et non ailleurs dans la modernité. Nous avons vu que les préfigurations sportives précèdent de loin la civilisation grecque et si le sport reprend au niveau du rituel,c’est-à-direducomportement,lesaventuresdel’âme,sesépreuves,aucoursdulongetdifficile voyage initiatique, on peut penser que Platon et Empédocle lorsqu’ils parlent des pérégrinations de l’âme en peine, ne font pas tellement preuve d’imagination. La transmigration, c’est le samsara indien.Maislesfaitssontlà:ilyaunsportgrecetiln’yapasdesportindien.
Par bonheur, le Taoïsme se sert de l’exemple sportif pour illustrer en Chine l’enseignement philosophique, tout comme Platon en Occident. Cela nous montre d’abord qu’il y avait possibilité d’une institution sportive, la base d’une pratique du sport existait et elle retenait suffisamment l’attentionpourfournirdesexemples,descomparaisons.Celanousrévèleaussiunemanièreinversée de voir les choses. Platon acceptait le fait de la contradiction, ce qui implicitement entraîne trois choses: la compétition (le sport), la dialectique (l’analyse philosophique) et l’événement violent (l’histoire).Chosesurprenante,cesévidencesdelatraditionoccidentalenesontpastenuespourtelles parl’enseignementtaoïste.
Dans cette perspective, les valeurs sportives se révèlent inconsistantes. Le sport ne peut exister dans l’absolu et la perfection technique ne peut déboucher que sur la nullité du résultat. Or, nous savons que tous les efforts des règlements sportifs visent précisément à éliminer le cas de nullité (prolongations, nombre de corners, épreuve supplémentaire des penaltys). L’escalade technique compétitive,sembledireLieTseu,aboutirait,avecdescompétiteursimpeccables,àuneimpossibilité dedésignerunvainqueur.Autantquechacunreste assis. « Les pointes de leurs flèches se heurtèrent à mi-distance et tombèrent sur le sol sans soulever de poussière. » 449 La logique sportiveimplique, àlalimite,sapropredestruction.
Mais va-t-on jamais jusque-là? Cette maîtrise est illusoire et ne résiste pas à l’épreuve du réel. En tous cas, elle demeure précaire devant l’imagination du péril. Le tireur perd toute sa superbe en surplombantleprécipice.Levertigefaitévanouirsadominationdessituationssportives.« Meou-jen monta avec lui sur une haute montagne, se plaça sur un rocher en surplomb au bord d’un gouffre de cent jen. Tournant le dos à l’abîme, la plante des pieds aux deux tiers suspendus au-dessus du vide, il prit Yu-k’éou par la main et le fit avancer. Mais ce dernier semit à plat ventre,inondé de sueur.»450
Ou alors il faudrait que la technique s’épanouisse et s’efface en même temps dans la fusion du sportif avec la nature, avec le réel. C’est le sport par connaturalité. On communique avec la nature. Onestpartiedelanature.Onestlanature.
Sport par connaturalité, le nageur se joue de l’élément liquide, vertu absolue qui transcende la technique: « Je m’offre au tourbillon qui m’aspire tout entier et je ressors du gouffre écumant. Je suis le Tao de l’eau et je ne fais rien par moi-même. C’est pourquoi je puis ainsi évoluer dans les flots. »451
449.Lietseu.Livrecinquième:T’ang.Chapitre15.
450.Lietseu.Livresecond:Houang-ti.Chapitre5.
451.Lie-tseu.Livresecond:Houang-ti.Chapitre9.
Sportparconnaturalité,lecoqdecombatparsasuperbeindifférenceécartetoutel’agressivitéde l’adversaire et l’éloigne. « Les autres coqs n’osaient pas s’approcher de lui ; ils se détournaient et s’en allaient. »452
Sportparconnaturalité,l’archer,l’argumentadéjàétérapportéplushaut,doitêtreindifférentau contextequil’environneetnepasselaisserimpressionnerparlescirconstances. « C’est bien là tirer comme un archer, mais ce n’est pas tirer comme quelqu’un qui n’a plus conscience de tirer à l’arc. Si nous gravissions une haute montagne, si nous nous tenions sur un rocher surplombant un gouffre de cent jen, serais-tu encore capable de tirer ? »453
La conséquence n’est pas bien difficile à développer, bien que paradoxale. L’athlète parfait, le seul véritable, authentique,absolu, c’est l’athlète ignoré,non seulement celui dont sagénération n’a pas eu connaissance, mais celui qui n’a jamais eu à faire usage de sa vertu. La théorie est celle du non-événement sportif. Il n’y a pas d’événement absolu. La vertu cosmique est hors du temps. « Personne sur terre ne pouvait égaler sa force et pourtant même ses proches parents l’ignoraient parce qu’il ne fit jamais usage de sa force. »454
Il serait trop simple évidemment de réduire la vision orientale du sport à cette spectaculaire positiondutaoïsmequijustementseprésentesousunjourdeprovocationpourmieuxaccrocherson public dans ses intérêts immédiats et lui révéler la théorie qui, pour étonnante qu’elle soit, "colle" avec la réalité quotidienne. On peut penser que le confucianisme, avec sa doctrine des désignations correctes, son respect positiviste des structures établies, son conformisme au sens strict du terme et sahiérarchiemandarinaleacquiseunefoispourtoutesàbased’examen,acontribuéaumoinsautant que le taoïsme à rendre idéologiquement impossible une institution du sport comparable à celle de l’occident.
En Inde, le bouddhisme ne semble pas avoir eu besoin de ce radicalisme provocateur. Tout ce qu’il pouvait y avoir de formes pré-sportives dans l’univers brahmanique a dû être balayé par le bouddhisme.Parailleurslesystèmedescastes,avecsonfixismeabsolu,étaitunmodèleincompatible avecunmondedusportoùplacesd’honneurettitressejouentetserejouent.
Mais,demêmequelaChineconnaîtunecertainepratiquesportivepuisquecelle-cisertd’exemple à l’établissement d’un antisystème,le taôisme,de même l’Inde aau moins connu des préfigurations sportives. On peut citer les épreuves de force accomplies, dans le Mahâbhârata, par les prétendants de Draupadi, et, dans le Râmâyana, par ceux de Sîta. L’hiérogamie sportive n’est donc pas absente. Huizinga rappelle aussi que tout un chapitre du Mahâbhârata traite de l’installation de cet espace ludique– sabhâ –pourlesjeuxdufilsdePandûetdesesadversaires. 455
En Iran, une préfiguration sportive se dessinait également dans la mythologie. Sur un vase d’os retrouvé à Hasanbu, près du lac Urmiya, on observe un combat à coups de gants de boxe entre un hommeetunehydre.456
Onnepeutpasnonplusnepasêtrefrappéparcertainesanalogiesdesituationentrelasophistique chinoise et la sophistique grecque qui utilisent, l’une et l’autre, dans le domaine de la philosophie, desexemplesempruntésaudomainedusport.
Parexemple,Kong-souenLongdit:quellequesoitlavitessed’uneflèche,ilesttempspourelle de ne point bouger et de ne point rester en place et on pourrait imaginer un maître qui décrocherait des flèches à la queue-leu-leu au point de mettre en contact l’arc et le but. C’est-à-dire que l’espace est à la fois continu et discontinu, que toutes les flèches sont en même temps mobiles au plus haut pointetrigoureusementimmobiles,commeZénondesoncôtéledirachezlesGrecs.
Circonstance intéressante pour la théorie de la connaissance, ce thème de la flèche n’est pas simplement et banalement emprunté aux exemples de la vie quotidienne. Il a derrière lui un écho affectif,toutuncontenumythique.Laflèchen’estpasunvulgaireinstrumentdechasseetdeguerre. C’estunmoyensurnatureldecommunication:onpeuttirerversleciel.Méthodequinevapassans
452.Lie-tseu.Livresecond:Houang-ti.Chapitre20. 453.Lie-tseu.Livresecond:Houang-ti.Chapitre5 454 .Lie-tseu.Livrequatrième:Confucius.Chapitre12, 455.Huizinga. Homo ludens.Gallimard.p.94. 456.
risque d’ailleurs. On raconte que le roi Wou-Yi vit sa flèche lui revenir etqu’il mourut foudroyé. A titred’exemplecontraire,onditqueYaofutélevéparlepeupleaurangdefilsduCiel,àlasuited’un tir heureux. Autrement dit, la logique n’opère pas à partir d’un matériau neutre. Ici, l’archer détient oupasl’efficaceduTaoetsontirestàmêmeounonderestaurerl’ordredumonde457
L’analyse logique tire ainsi son pouvoir des matériaux qu’elle utilise et on comprend mieux, s’agissant d’instruments cosmogoniques touchant à la toute-puissance et à l’immortalité, le choix d’exemples sportifs par une sophistique, grecque ou chinoise, qui veut vaincre comme le sport et convaincrecommelamythologie.
Peut-être faut-il chercher là les raisons profondes de procédures philosophiques similaires employées dans des contextes culturels indépendants, similitudes soulignées en son temps par Masson-Oursel458 etsurlesquellesleRoumainBanuintervientànouveau.459
Entouscas,lesquatreparadoxesrestantsdelasériedequaranteproposésparZénond’Eléepour démontrer l’impossibilité du mouvement font tous les quatre appel à l’exemple sportif. C’est (1) le coureur sur le stade qui ne touchera jamais le but car il doit préalablement effectuer la moitié du parcours et préalablement encore la moitié de la moitié et ainsi de suite à l’infini. C’est (2) Achille courant après la tortue mais qui ne parviendra pas à la rattraper car chaque fois qu’il parviendra à l’endroit où elle était, celle-ci seraun peu plus loin. C’est (3) la flèche qui vole etqui pourtant reste immobileàchaqueinstantdesonparcours.Cesont(4)lesdeuxfilesdecharsquise croisentdevant desspectateursimmobilesetpourquiletempsdecroisementestégalàlamoitiédelui-même.
L’importancedecesparadoxesestconsidérableetl’histoiredelaphilosophielesaeffectivement retenus. Mais si, chez les Grecs, ce goût de l’analyse, de la dispute, du raisonnement subtil était en rapport avecune institution sportive, la même harmonie ne seretrouve pas enChine.Biensûr, dans lesdeuxcas,l’exemplesurlequelons’appuieprouveuneréalitéimmédiatementaccessibleàl’esprit desauditeursquientendentl’argument.Maisiln’enestqueplusintéressantdeconstaterladivergence dustyle decivilisationtantdansledomainedusportquedansceluidela philosophie.D’uncôté,on voitsedévelopperdegrandesinstitutionssportivesetdegrandssystèmesphilosophiques;del’autre, ilyasoitdestaoïstesniantl’événement,l’histoire,soitlesconfucianistes,desmaîtresd’armesetdes mandarins.
Antisystèmeorientaldusport,iln’yaplusdecontradiction,fautededictions,donclacompétition estimpossibleparmanqued’adversaires.
Évidemment,ilnefautpasnonplustropaccorderauschématisme.
D’abord, le concept d’Orient est susceptible de plus larges acceptions. Ainsi ce qu’on appelle le Proche-Orient apportera plus tard une note voluptueuse dans l’histoire du sport. La douzième des MilleetUneNuitsnousrapporteunearistocratiquepartiedepolooùleroiguéritdelalèpreenjouant sur prescription, il est vrai, d’un médecin grec.460 Cette note nouvelle semble se transmettre à l’occident,RaoulGlaberl’attesteraitauXIe siècle461,parl’intermédiairedumessagedestroubadours. Et c’est probablement dans cet esprit qu’il conviendrait d’interpréter, en partie du moins, la conceptiondusportquisefaitjourdansl’œuvred’unChrétiendeTroyes.WalterScottnousinciterait àchercherdanscette voieavecsa descriptiondunoble combatentrele sultanSaladin etle chevalier Kenneth,idéalisationromantiqued’uneguerresommetoutetrèssportive. 462 Ensuite,danslatraditionchinoiseelle-même,le sportsubsiste assez pour queMaoTsé-toungse serve de la boxe pour illustrer ses propos. « Il est connu pourtant que dans son combat de boxe le plus avisé recule souvent d’un pas alors que son stupide adversaire fonce en avant et dès le début prodigue ses forces, si bien que, finalement, c’est souvent celui qui a reculé qui l’emporte. »463 On
457.NicoleVaudier– Nicolas, la philosophie chinoise des origines au XVIIe siècle.Dans«Histoiredelaphilosophie1», EncyclopédiedelaPléiade,1969,p340.
458.Masson-Oursel. La philosophie comparée.P.1923.Partie1,ch.3.
459. Banu. Humanisme et universalisme de la raison philosophique. Dans «Colloque de Sinologie», sept.1970, Institut des Hautes EtudesdeBelgique.
460. Les Mille et Une Nuits.Histoiredumédecingrec.
461.MoinehistorienduXIe Siècle.
462.WalterScott. Richard et Saladin
463.MaoTsé-toung. Les problèmes stratégiques de la guerre révolutionnaire en Chine
notera cependant, en même temps que l’appel au sport comme référence comparative, la résonance taoïste de l’agir sans agir, le Wéi Wou Wéi, dans une discipline où un Occidental aurait plutôt eu tendanceàsoulignerlepunchoul’agressivité.L’utilisationdel’exempleestrévélatrice.
Jeuxétrusques,jeuxromains,lapolitisationducirqueetladépolitisation desmasses.
A Rome, sous Néron, le spectacle est fait pour oublier. A Byzance, quelques siècles plus tard, il ravive les antagonistes sociaux. C’est la même institution. Elle exerce des fonctions politiques différentes.Celanousaideàpercevoirlacomplexitédurapportdialectiquedupeupleetdel'Étatdans lesport.Celanousmontreaussicommentlesportpeutsefaire,sousdiversesformesculturelles,surrépressif comme on dit aujourd'hui. Cela nous rappellerait enfin qu'on ne doit pas envisager mécaniquementetunilatéralementl'influencedusystèmesocialsurlapratiquesportiveetlespectacle qui en résulte: le sport est susceptible de prendre une part active dans la conduite de la politique là oùlevidedesvaleursse faitparticulièrementsentir.
Le sport est évidemment présent aux débuts de l'histoire romaine. Tite-Live nous raconte que Tarquin,pourcélébrersesvictoires,n’eutriendepluspresséqued'organiserdesjeux: « Sa première guerre fut contre les Latins. Il leur enleva la ville d’Apiodes, Et en ayant rapporté un butin plus considérable que ne le pouvait faire espérer cette guerre, il donna des jeux où il surpassa en magnificence tous ses prédécesseurs. C'est alors que fut désigné l'emplacement du premier cirque qui reçut plus tard le nom de Grand. Des places particulières y furent réservées aux Pères et aux chevaliers. Ils se firent fabriquer des sièges spéciaux appeler fori, qui formèrent une galerie supportée par des échafaudages de douze pieds de haut. Le spectacle comprenait des courses de chevaux et des luttes pugilistiques. Les athlètes étaient presque tous des Etrusques. Ces jeux furent maintenus et eurent lieu désormais chaque année, tantôt sous le nom de jeux romains, tantôt sous celui des grands jeux. »464
Nous savons aussi que l'enlèvement des Sabines fut organisé à l'occasion de jeux tout spécialementpréparésàceteffet.Plutarqueleraconte:
« Il entreprit d’exécuter le rapt en cette manière : ils firent premièrement courir le bruit partout qu’il avait trouvé l'autel d'un dieu caché dans la terre ; et appelant ce dieu Consus, soit que ce fut un dieu de conseil, ou que ce fût Neptune que l'on surnomme le chevalier, ou bien le patron des chevaux ; parceque cetautel est aujourd'hui dans les grandeslices, couvert et caché tout le reste du temps, excepté quand on fait des jeux de courses de chevaux. Les autres disent que parce qu'il faut qu’un conseil soit ordinairement tenu secret et couvert, ils tinrent à bonne cause cet autel du dieu Consus caché dans la terre ; mais quand il fut découvert, Romulus en fit un sacrifice de joie magnifique, et envoya publier partout qu’à certain jour préfixé on jouerait à Rome des jeux publics et ferait-on une fête solennelle où tousceuxquivoudraientvenir seraientreçus.Grandemultitudedepeuple yaccourutdetoutes parts ; et lui fut assis au plus honorable lieu des lices, vêtu d'une belle robe de pourpre, accompagné des principaux hommes de sa ville à l’entour de lui ; et avait baillé le signe pour le ravissement, quand il se lèverait debout, et qu'il plierait un pan de sa robe et puis le déplierait. À cette cause étaient ses gens au guet avec leurs épées ; lesquels aussitôt qu’ils aperçurent le signe, s’en coururent çà et là, les épées au poing, avec grand cris, ravir et enlever les filles des Sabins, laissant fuir les hommes sans leur faire autrement déplaisir. Si disent aucuns qu’il n’y eut que trente ravies seulement. »465
Tite-Livedit:
« Il dissimula donc son dépit et se mit à préparer, en l'honneur de Neptune Equestre, des jeux solennels qu'il appela Consuales. Il fit annoncer cette fête dans toute la région environnante et, pour éveiller la curiosité des peuples voisins, il apporta le plus d'éclat possible aux préparatifs.
On y vint de partout. Les habitants des cités les plus proches accoururent en masse, curieux de voir également ce qu'était cette ville nouvelle… Quant au Sabins, ils arrivèrent au grand complet, en amenant avec eux leurs femmes et leurs enfants. Ils reçurent à Rome la plus grande hospitalité et furent logés chez les habitants. La solidité des remparts de la ville, les avantages de sa position provoquèrent chez eux la plus vive admiration et ils furent étonnés de voir que de si grands progrès avaient été réalisés en si peu de temps.
Les jeux commencent. Ils retiennent toute l'attention, tous les regards des spectateurs. C'est alors que les jeunes Romains passent à l'action. Ils se répandent partout, en s'emparant des jeunes filles rencontrées au passage. Quelques-unes, choisies parmi les plus belles, furent réservées aux principaux Pères et conduites dans leurs demeures par les plébéiens chargés de ce soin. L'une d'elles, particulièrement remarquable par sa beauté et par sa taille élancée, fut enlevée par les gens d'un certain Thalassius. Comme l'on ne cessait de leur demander à qui elle était destinée, ils criaient tout au long du trajet : « A Talassius ! ». C’est là l'origine du cri que l'on entend dans les cérémonies nuptiales. »466
On sait par ailleurs que Virgile évoque des jeux troyens, jeux funébres donnés pas Rhée en l'honneurd’AnchiseetquiserontcélébrésàRomejusquesousl'Empire.EnéeauraitabordéenSicile àladateanniversairedelamortd’Anchise.Aussitôtilorganiseunsacrificedecommémoration,puis, neuf jours plus tard, il donne des jeux. Ces jeux comportent (1) des régates, (2) de la course à pied, (3)un combat de ceste, (4)du tir àl'arc, (5) un carrousel. Bien sûr, dans ses descriptions, Virgile ne se fait pas faute d'imiter Homère. Mais il s'inspire aussi des coutumes de son temps : Auguste patronnait les fêtes sportives. Dans son témoignage, il y a un mélange de données de provenance diverses.L'anachronisme,entoutcas,estévident:VirgilefaitremonteràEnéedesjeuxtroyens,qui, enréalité,furentinstituésparSyllaetremisenhonneurplustardparJulesCésar.467
Onnoteracependant,danscesrécitsconsacrésàlafondationdeRome,larécupérationàdesfins pseudo-historiques, au titrede mythes de fondation, des bons vieux thèmes d'originetribale. Lerapt des Sabines correspond sans doute à des difficultés historiques réelles éprouvées par un clan nouvellement constitué pour s'insérer dans le régime matrimonial d'un système intertribal rigoureusement codifié.Maisil s'inscritsanspeinedans ladroiteligne des hiérogamiessportivesoù il fallait conquérir une femme, une terre, un pouvoir, et le prétexte de jeux en l'honneur d'un autel retrouvé n’est peut-être que de souvenir lointain du défi au beau-père. De même la réminiscence initiatique est toujours attestée par la présence d'un adolescent: Virgile y dépeint Ascagne, le fils d’EnéeetdeCreuse.PlussignificatifencoresurcepointestletextedeTite-Liverapportantlacourse desLupercales,classiquehistoiredel'enfant-loup: « Une fête importée par Évandre, originaire de Pallatium, - ville d'Arcadie qui avait donné son nom au Palatin, - était célébrée tous les ans sur ce mont à l'endroit où se trouve le Lupercal. Pendant cette fête, les jeunes gens couraient tout nus en l'honneur de Pan Lycoeus appelé par la suite Innus par les Romains.»468
Legrandfaithistoriqueromain,cependant,enmatièred'institutionsportive,c'estlagladiatureet l'hippodrome.Troisfaitssontàprendreenconsidération.D'abord,lesportestunepolitique.Suétone quiauraitétél'auteurdeslivressurlesjeuxgrecsetromainsnemanquepas,dansles Vies des douze Césars, de faire apparaître les illustrations de cette politique sportive, ses constantes et ses options diverses. Auguste fait donner les jeux quartier par quartier. Tibère restreint les dépenses. Avec Caligula, Claude et Néron, l'ostentation reprend, plébiscite et publicité. Ensuite, c'est la rencontre,
466.Tite-Live. Histoire romaine.I.IX.
467.Virgile. Enéide.ChantV.
468.Tite-Live. Histoire romaine.I.V.
ambiguë etcomplice, du princeet du peuple. Enfin, le rite se fait spectacle. Lagladiature apparaît à Rome vers - 264. En -221, Flaminius fait construire un cirque édifié en pierre, avec gradins, sur le modèledesstadesgrecs. Auparavant,cen'étaitqu'unsimpleterrainoùons’assemblaittantbienque mal.
Selon Nicolas de Damas, qui écrit à l'époque d'Auguste, Rome aurait emprunté aux Etrusques l'usage des gladiateurs dans la première moitié du - IIIe siècle. A l’origine, au lieu de tuer les prisonnierssurlestombes,onlesfaisaitcombattrepardeux.C'estcedédoublementdusacrificedont nous avons parlé dans le premier chapitre. Chacun des deux adversaires représentait pour l'autre le génie de la mort. C'était un mimodrame sanglant. Mais il a un caractère somptuaire. Il convient aux funérailles de riches, car le gladiateur, la victime, même esclave, doit être acheté. La signification initialeduriteseperdant,le côté somptuairedevientprépondérantet,vers lafindelaRépublique,il s'agit vraiment de sport-spectacle. La masse des oisifs s'est accrue. Les jeux, s’inspirant du principe du potlatch, sontun moyen deredistribution desbiens, une obligation desriches envers les pauvres. Les princes sont entraînés sur la voie de la surenchère :Auguste présentera jusqu'à 625 paires de gladiateurs par spectacle. Le sport est pratiquement un moyen de gouvernement : sous Galien qui exclut les sénateurs des commandements militaires, les sénateurs et les questeurs n’ont plus d'autre rôle que de préparer les jeux. L'accent n'est plus mis sur la réalité sociale mais sur une immense contre-société où règne l'imaginaire. Les barbares auraient tôt fait de le comprendre : Totila, vainqueuravecsesOstrogothsen549,n’ariendepluspresséqued’organiserdesjeuxpourentretenir lesRomainsdansleursoumission.
Sur tout cela règne une atmosphère de sang. Tout est misérable et grandiose à la fois. On y expérimenteun substitut d’immortalité. Lesacrificehumain reproduit levieux rite funéraire devenu avecletempsusagearistocratique,ceneuvièmejourdudeuilréservéauxjeux.Levainqueuravaincu le génie de la mort et le vaincu est héroïsé grâce à sa traversée des enfers. On y expérimente un substitutdetoute-puissance.Legladiateuràterreattendquelafouleseprononce.C’est Mitte (laisselepartir)ou Jugula (égorge!).Pendantuninstant,lepeupleassemblédisposed’unpouvoirabsolu.
A partir de cette émotion puissante, cruelle, horrible, on raffine. On joue sur la mobilité et l’armement. Rétiaire, oplomaque, mirmillon, secutor, etc… on invente toutes sortes de manières de combattreetlecombatlui-même,opposantl’uneetl’autredecesméthodes,ressembleàunesuitede figures,commeenfaitlaremarqueRolandAuguet. 469
NotonsbienaupassagequelesRomainsnesontpasleseulpeupleàavoirintroduitlagladiature dans ses institutions. Les Aztèques eurent des pratiques analogues. Thompson en décrit plusieurs variantes:toutessontaffreuses,maisellesontaussiencommund’êtreinégales,lesvictimesétaient désignéesd’avanceetnepouvaient,aumieux,quereculerl’échéance.
Combatsimulé:
« Chaque captif est lié à un autel de pierre par une corde passée autour de sa cheville, reçoit une épée de bois à bords émoussés et doit se battre contre des guerriers armés comme à l’ordinaire. Après ce combat simulé, il est étendu sur un autel de pierre… Le prêtre lui découpe le cœur qu’il élève ensuite pour l’offrir au soleil et aux quatre points cardinaux.»470
Oucombatdésespéré:
« Les prisonniers, traînés par les cheveux le long de l’escalier, sont attachés séparément aux pierres avec une épée et obligés de combattre successivement quatre guerriers vêtus de peau de jaguar ou de plumes d’aigles. Certains captifs sont si épuisés par la montée douloureuse de l’escalier qu’ils sont incapables de résister, mais d’autres fatiguent leurs adversaires. En ce cas, un cinquième guerrier qui doit être gaucher, s’avance et, élevant le prisonnier dans ses bras, il le jette avec forcesur lesol. Le captif est alors traînésur la pierre du sacrifice.»471
Oucombatdérisoire:
469.RolandAuguet. Les jeux romains 470.Thomson. La civilisation aztèque.Payet.p.138. 471.Thomson.p.139.
« L’un de ces groupes, formé de guerriers captifs, reçoit de fausses armes ; l’autre, se composant d’esclaves destinés à être immolés, combat avec de véritables épées en bois à lame d’obsidienne. La lutte est si sérieuse qu’elle entraîne parfois la mort de quelques combattants ; mais qu’ils succombent ou non, leur sort est le même, les survivants n’échappent pas au sacrifice. »472
Il est clair que le contexte et l’ambiance ne sont pas les mêmes chez les Romains et chez les Aztèques.Mais, àtraversla rechercheraffinéedes procédures,descérémoniesetdescasdefigures, c’esttoujourslamortobsédantequirôdeetlavolontédepuissancequiparle.
Certes, des voix s’élèvent à Rome et protestent. Mais comment faut-il l’entendre? Le texte de Sénèqueestconnu:
« Je me suis rencontré à un spectacle qui se donnait à midi, où je pouvais entendre quelques bons mots, et voir des jeux et quelque divertissement pour récréer les yeux, rebutés de sang humain que l’on ne cessait de répandre ; mais, au contraire, les combats qui avaient précédé n’étaient que des actions de miséricorde. Il n’y a plus de jeux ; ce n’est que massacre… C’est un divertissement que bien des gens préfèrent à celui des gladiateurs qui sont appariés et choisis ; et pourquoi ne les préféreraient-ils pas ? … A quoi bon toute cette escrime ? Cela ne fait que retarder la mort. Au matin, on expose les hommes aux lions, aux ours ; à midi, on ramène devant les spectateurs ceux qui ont tué de ces bêtes, et on les fait combattre entre eux. »473
Auprèsd’unhistoriencommeTacite,lesgladiateursontmauvaisepresse.Inutiledelesemmener àlaguerre:« Les gladiateurs n’apportaient pas au combat la même solidité queles soldats.»474 Leur vertu a dégénéré dans le spectacle selon Tacite et on leur en fait grief: « Les uns accusaient leurs ennemis de lâcheté et de fainéantise, ne voyant en eux que des soldats gâtés par le cirque et le théâtre.»475 Aussi, faisant allusion aux troupes d’Othon, Tacite parle-t-il du « secours déshonorant de deux mille gladiateurs »476 Et, lorsqu’il veut dépeindre Julianus et Appollinaris qu’il estime des capitaines peu attentifs à leurs devoirs, écrit-il: « Tous deux, par leur frivolité et leur apathie, ressemblaient plutôt à des gladiateurs qu’à des chefs.»477
Maisilyaplusinquiétantencore.Nonseulementlesgladiateursnepeuvent-ilsfairedessoldats, mais ceux qui ont une vocation naturelle de soldats tendent à se faire gladiateurs. Sous Vitellius on dutprendredesmesureset,c’esttoujoursTacitequilerapporte, « on défendit sous des peines sévères aux chevaliers romains de se dégrader dans les jeux de l’arène, ou dans les écoles de gladiateurs. Les princes, ses prédécesseurs, les y avaient poussés par l’appât du gain ou contraints par la violence, tandis qu’un grand nombre de colonies et de municipes jaloux de cet exemple s’efforçaient d’y attirer les jeunes gens les plus corrompus en les payant. »478
Ilestvraique,ducôtédesgladiateurseux-mêmes,tousnesontpasforcémentd’accordavecleur condition sociale. Certes, ils ont droit à des écoles, comme celle que créa Jules César à Ravenne. Mais, s’ils apprennent à bien se battre et à bien mourir, c’est l’école qui s’en charge, ils seraient éventuellementdisposésàbienvivre,etc’estsureux-mêmescettefoisqu’ilsdoiventcompter.
En tous cas, c’est d’une école de gladiateurs que provient ce gigantesque mouvement social qui ébranlapourlapremièrefoisdefaçonspectaculairelemondeantique.Larévolteéclataen-73etdura jusqu’en -71. C’est l’histoire de Spartacus. Les insurgés comptèrent un moment plusieurs milliers d’hommes.Toutel’Italieméridionalefutconcernée.Depuisl’invasiond’Hannibal,Romen’avaitpas connupareillepanique.
Plutarqueraconte:
472.Thomsonp.147.
473.Sénèque. Epitre.VII.ALucilius.
474.Tacite. Histoires.LivreII.Ch.XXXV.
475.Tacite. Histoires.LivreII.Ch.XXI
476.Tacite. Histoires.LivreII.Ch.XI
477.Tacite. Histoires.LivreIII.Ch.LXXVI. 478.Tacite. Histoires.LivreII.Ch.LXII.
« Il y avait en la ville de Capoue un nommé Lentullus Batiatus qui faisait métier de nourrir et entretenir grand nombre de ces escrimeurs à outrance, que les Romains appellent gladiateurs… Lesquels étaient détenus et enfermés, non pour aucune forfaiture qu’ils eussent commise, mais seulement pour l’iniquité de leur maître qui les avait achetés, et les contraignait par force de combattre les uns contre les autres à outrance ; il y en eut deux cents qui délibérèrent entre eux de s’enfuir ; mais, leur conspiration ayant été découverte, avant que leur maître y donnât ordre, il y en eut soixante-dix-huit qui allèrent en une rôtisserie, où ils saisirent des broches, des couperets, et des couteaux de cuisine, et se jetèrent hors de la ville à tout; par le chemin ils rencontrèrent d’aventure des chariots chargés d’armes dont ont accoutumé de combattre les gladiateurs.»479
Plutarquepoursuit:
Spartacus: « avait non seulement le cœur grand, et la force du corps aussi, mais était en prudence et en douceur et bonté de nature meilleure que ne portait la fortune où il était tombé… Si repoussèrent premièrement quelques gens qui sortirent de Capoue sur eux pour les cuiderreprendre,et leur ayant ôté leurs armesde soudards, furent bienaise deles changer à celles de gladiateurs, qu’ils jetèrent comme étant barbares et déshonnêtes. »480
L’épisodeestimportanthistoriquement.Ilintéresselavisiondynamiquedusportetdelaculture. Son écho actuel a des significations philosophiques et politiques. Observons, par exemple, qu’en Russie soviétique, sur décision du Conseil des Commissaires du Peuple en date du 30 juillet 1918, alors qu’on établit une liste des personnes pour lesquelles on se propose d’ériger un monument à Moscouetdansd’autresvillesrusses,unnomvientàlapremièreplace:Spartacus!
Un fait social aussi important que la gladiature, les proportions qu’il avait prises, son enchevêtrementavecl’économieetlapolitique,toutcelaposaitévidemmentdesproblèmesdanstous lessens.
Il y avait déjà en ce temps des promoteurs de spectacle peu scrupuleux. Tacite raconte un fait significatif:
« Voulant donner à Fidèneun spectaclede gladiateurs, un certain Atilius, affranchi d’origine, avait construit son amphithéâtre sans en assurer les fondations sur un sol ferme, ni en consolider par des liens assez forts la charpente de bois ; aussi bien n’était-ce pas la surabondance des richesses ni l’ambition de se populariser dans sa ville, mais un sordide intérêt qui lui avait suggéré cette entreprise. Là coururent, avides de tels spectacles et sevrés de plaisirs sous un prince comme Tibère, une multitude de tout sexe, de tout âge, dont la proximité de Rome augmentait l’affluence. La catastrophe en fut plus terrible. L’édifice entièrement rempli, ses flancs se déchirèrent ; il s’écroule en dedans, se renverse au dehors, entraînant dans sa chute et couvrant de ses ruines la foule innombrable qui regardait les jeux ou se pressait à l’entour. Et ceux du moins qui avaient été frappés à mort dès le début de l’écroulement partagèrent lesort commun, mais échappèrent auxsouffrances. Plus à plaindre furent ceux qui, tout mutilés, conservaient un souffle de vie.»481
Investissement non productif, à fonds perdus, ce genre de sport est une ruine publique. On doit prendredesmesures.Tacitedit:
« Un édit de César défendit aux magistrats ou aux procurateurs de donner dans les provinces un spectacle de gladiateurs ou d’animaux féroces ou tout autre divertissement… De telles libéralités n’étaient pas moins que leurs rapines un fléau pour leurs sujets, en mettant sous la protection de la popularité les fautes inspirées par leurs caprices.»482
Maisquelquefois c’esttout simplementlaméfiancepolitiquequi conduit àmoinsdefolie,sinon àplusdesagesse.Suétonerapporte:
479.Plutarque. Vie de Crassus.XIV.
480. Ibid
481.Tacite. Annales. LivreIV.Ch.LXII.
482.Tacite. Annales.LivreXIII.Ch.XXXI
« César donna encore un combat de gladiateurs, mais avec des couples bien moins nombreux qu’il ne l’avait projeté ; en effet, l’importance de la troupe qu’il avait rassemblée de toutes parts ayant effrayé ses ennemis, on fixa par précaution le nombre maximum de gladiateurs qu’un citoyen était autorisé à posséder dans Rome. »483
Le danger,il est vrai, n’est pas seulement économique, laruine des finances publiques dans une surenchère improductive permanente, ni politique, la menace sur les libertés qui résulte de cette publicité tapageuse ostentatoire, mais moral. On institutionnalise le plaisir morbide de voir mourir. Onsecomplaîtdanslacruautésordide.
Suétonemontra–unpeutropbienquandmêmeetsontémoignageestsuspectdepartialité,mais il n’invente pas tout – combien l’imagination est inventive dans son escalade sadique. Il parle de l’empereurClaude:
« Dans tous les combats degladiateurs, donnéspar lui ouquelqu’un d’autre, ilfaisaitégorger même ceux qui tombaient par hasard, surtout les rétiaires, pour observer leur visage quand ils expiraient. Deux gladiateurs s’étant mutuellement frappés à mort, il ordonna de fabriquer sans retard avec leurs deux fers de petits couteaux pour son usage. Les luttes des bestiaires et les combats de midi lui plaisaient si fort, que non seulement il descendait au spectacle dès l’aube, mais restait à sa place à midi, quand le peuple sortait pour déjeuner, et, non content des gladiateurs prévus, faisait combattre tout-à-coup, même pour un léger motif, jusqu’à des machinistes, des employés ou des gens de cet ordre, lorsqu’un dispositif automatique, une trappe ou tel mécanisme de ce genre n’avait pas joué comme il faut. »484
La seconde grande passion sportive romaine, c’est l’hippodrome. Les princes et le peuple la partagent.
OnsesouvientdesversdeRacinefaisantleportraitdeNéron.
« Pour toute ambition, pour vertu singulière, Il excelle à conduire un char dans la carrière.
A disputer des prix indignes de sa main,
A se donner lui-même en spectacle aux Romains.»485
Suétonedisait:
« Pour les chevaux, il eut, dès son plus jeune âge, une passion particulièrement vive, et la plupart de ses conversations roulaient, quoiqu’on le lui défendît, sur les jeux du cirque ; un jour il s’apitoyait, au milieu de ses condisciples, sur un cocher du parti vert traîné par ses chevaux et, comme son maître le grondait, il déclara qu’il parlait d’Hector. Au début de son principat, il s’amusait chaque jour à faire évoluer sur une table de jeu des quadriges d’ivoire et quittait sa retraite pour assister aux moindres jeux du cirque, d’abord en secret, puis sans se cacher, de sorte queces jours-là tout le monde était absolument certain qu’il serait présent. D’ailleurs il ne cachait pas qu’il voulait voir augmenter le nombre des prix ; aussi, comme on multipliait les départs, le spectacle se prolongeait-il jusqu’à une heure tardive et les chefs de partis eux-mêmes ne daignaient plus amener leur troupe que pour une course d’une journée entière. Bientôt il voulut conduire lui-même et, qui plus est, se donner souvent en spectacle : il fit donc son apprentissage dans ses jardins, au milieu des esclaves et de la populace, puis s’offrit aux yeux de tous dans le grand cirque, et ce fut un de ses affranchis qui jeta la serviette de la place où le font habituellement les magistrats.»486
Dansunecertainemesure,onpeutêtreamenéàpenserquelagladiatureetl’hippodromesontdes institutions complémentaires. La première est une amère méditation sur la mort. Le rite originel sur lequelons’appuieadégénéréensoncontraire.Onnedémontreplusl’immortalitéetl’héroïsme.On démontre,c’est duSénèque,lesarmesàlamain,labrièvetédela vie.Laseconde,c’est larecherche désespéréede la toute-puissance.Mais là aussi tout est inversé.Ce n’est plus le sportqui conduit au
483.Suétone. Vie des douze Césars.César.X.
484.Suétone. Vie des douze Césars.Claude.XXXIV.
485.Racine. Britannicus.
486.Suétone. Vie des douze Césars. Néron.XXII.
pouvoir, en vertu d’une ordalie, mais c’est au contraire le pouvoir qui se sert du sport et qui en définitive vient se réfugier moralement en lui. A la limite, c’est la société, en la personne de son prince, qui vient s’engloutir, comme une autruche apeurée, dans la contre-société sportive. Il y a vraiment très loin de Pélops à Néron, même si c’est de course de chevaux qu’il s’agit dans les deux cas.
Complémentarité, cependant, car faute de valeurs véritables, il faut bien que l’imaginaire se constituedesprincipesrégulateurs,desmodèlesdecomportement,desstylesdeconduite.Etlesdeux grands paramètres dont on voudrait dire qu’ils sont métaphysiques mais qui ne sont que la négation illimitée d’une limite, l’immortalité, la toute-puissance, ne peuvent que hanter l’imagination et lui faireinventerdesformesaberrantes,provocantes,scandaleuses,danslesdeuxdimensionspossibles: resteréternellementvivant,devenirinfinimentpuissant.
Mais si la gladiature évoluée en spectacle représente le doute issu d’une très grave crise de civilisation,aupointquecelle-cirefusedes’assumer,pessimismeprofondquantausensdelavie,en revanche, l’hippodrome, malgré l’importance exagérée qu’il acquiert, maintient une certaine permanencedansl’affirmationsymboliquedelavie.
Entouscas,l’hippodromedontlesformessportivessontdéjàfixéesdepuislongtempsauraaussi une fortune plus longue. Et c’est à Byzance, dans l’Empire Romain d’Orient, qu’il saura donner sa pleinemesurepolitique,sesubstituantpratiquementàl’Etat.
Comme à Rome, l’hippodrome de Constantinople servait aux courses de chars et, comme dans tous les hippodromes de l’Empire, les quatre factions du Circus Maximus romain s’y étaient organisées, associées deuxàdeux,lesBleusetles Blancsd’unepart,lesVertsetlesRougesd’autre part. Le peuple se partageait entre les deux factions principales, les Bleus et les Verts. Associations sportivesàl’origine,ellesavaientprisunaspectpolitique.
En effet, le souverain, à son avènement, prenait parti pour l’une de ces factions. Par ailleurs, les jeux ne pouvaient avoir lieu que sur décision de l’empereur. De plus, le nouveau souverain était acclamé à l’hippodrome et c’est là que le plus souvent se tenaient les grandes assemblées. C’est là encorequ’onprocédaitauxexécutionscapitales.Lesportétaitunlieupolitique.
Lieu politique effectivement. L’hippodrome se fait tribunal, les sujets se font juges. En 512, Anastaseacceptedecomparaîtreaucirquedevantlepeuple.LaséditiondeNikaen532etlesrévoltes de602etde612ontunprétextesportif.LesempereursorthodoxessemblentavoirsoutenulesBleus et les empereurs hérétiques les Verts. Les factions, appelées dèmes, qui correspondaient à des circonscriptions, à des divisions territoriales, sont maintenant des groupes de pression influents. Politisationducirque,lesportravivelesantagonismessociaux.
Huizinga a bien situé la signification du sport byzantin: un épilogue. Le sport antique y achève soncyclehistorique.
« Les passions populaires, auparavant assouvies par des combats sanglants d’hommes et d’animaux, devaient dès lors trouver leur exutoire dans les courses. Désormais, celles-ci ne constituaient plus qu’un divertissement profane, mais néanmoins, elles étaient en mesure de concentrer sur elles toute l’attention du public… Cette dernière fusion du divertissement solennel et de la vie publique n’avait plus grand-chose à faire avec l’unité archaïque du jeu et de l’action sacrée. C’était un épilogue.»487
Jacques Heers observe finement de son côté le transfert qui s’effectue à l’époque médiévale du domaine politique au domaine sportif, par quoi on serait déjà dans un nouveau cycle historique du sportquiannoncelamodernité:
« A l’origine et pendant plusieurs siècles, les partis "populaires" au nombre de quatre, correspondaient, chacun à peu près, à une circonscription particulière de la ville et présentaient donc une teinte sociale assez marquée ; ils jouaient un certain rôle administratif sinon politique ; ils armaient des milices pour la défense de la cité. Par la suite, à la fin du Moyen-Âge, mais par une évolution qui se manifeste déjà vers l’an mille, ces partis ne sont 487.
plus que des équipes qui organisent les grands jeux de l’hippodrome et s’affrontent lors des courses de chars ; dès lors deux couleurs suffisent : les Verts et les Bleus. »488
Avant d’en arriver là cependant, l’hippodrome byzantin aura sérieusement hypothéqué la vie politique. On se souvient de la sédition de Nika le 11 janvier 532. Justinien avait pris le parti des Bleus, lui réservant ses faveurs. Les Verts en étaient irrités. De plus ils étaient monophysites. Exactions et corruption des fonctionnaires créaient en outre un état de tension. Justinien fut insulté par les Verts à l’hippodrome, puis assiégé dans son palais. Il fallut que Bélisaire cerne avec des mercenaireslesrévoltés del’hippodrome.Celaseterminaparlemassacredetrentemilleinsurgéset l’exécutiond’Hypaties,l’empereurdesrévoltés.
Maiscefutlarévoltede602etcelle de610quimarquèrentlafindusport politique.Lemariage du fils aîné de Théodose avec la fille de Germain, chef des Bleus, provoqua un vif mécontentement desVertsetcesderniersserévoltèrentetacclamèrentPhocas.Maiscelui-ci,àsontour,futmaladroit et vit se dresser contre lui les Bleus et les Verts réunis. C’est alors qu’Héraclius fit venir la flotte à Constantinople et régla définitivement le problème. Leurs excès avaient discrédité les factions. A partir de l’avènement d’Héraclius, les jeux ne furent plus troublés par des manifestations intempestives. Les dèmes, tout en continuant à organiser des jeux, ne pratiquèrent plus d’ingérence danslesaffairesdel’Etat.
Il faut revenir cependant sur la situation du sport dans la Rome impériale car c’est là qu’on voit apparaître le mieux le dialogue complice du prince et du peuple, avec toutes ses conséquences, ses ambiguïtés,sescontradictions.
Onobserverad’abordtouteladifférenced’aveclesportgrec.Cen’estpasquecertainsn’essaient pas d’introduirecelui-ci. Mais l’innovation est pour le moins contestée.On la taxe de snobisme. On lajugesévèrement.C’estl’abandondesbonnesmœurs.Taciteexplique: « On institua à Rome des jeux quinquennaux à l’imitation de la Grèce ; ils donnèrent lieu à des réflexions diverses, comme à peu près tout ce qui est nouveau. Les uns rappelaient que Pompée avait déjà encouru le blâme des vieillards pour avoir établi un théâtre permanent ; car, avant lui, des gradins improvisés et une scène élevée pour la circonstance suffisaient pour les jeux... Au moins fallait-il s’en tenir au caractère ancien des spectacles… où nul citoyen n’était obligé de concourir… Ainsi dégénérait, sous l’influence d’habitudes étrangères, une jeunesse dont les gymnases, le désœuvrement et d’infâmes amours se partageraient la vie… Que leur restait-il à faire, sinon à dépouiller aussi leurs vêtements, à prendre le ceste et à se préparer à ces combats plutôt qu’à la guerre et aux armées ? » … Un plus grand nombre aimaient cette licence pour elle-même, et cependant ils se couvraient de prétextes honnêtes.»489
Enfait,l’intérêtvasurtoutaugrandspectacle,gladiatureethippodrome,maisaussiauxcombats d’hommescontredesanimaux,auxcombatsd’animauxd’espècesdifférentes,auxnaumachies. Cela tourne parfois à la catastrophe, d’ailleurs, tant la précipitation rend insuffisants les préparatifs.Tacitenousdécrituncombatnavaldontlaprésentations’achèveencatastrophepourles spectateurs:
« Afin que la magnificence de l’ouvrage eût plus de spectateurs, on donne sur le lac même un combat naval… Le spectacle achevé, on ouvrit passage aux eaux, et alors parut à découvert l’imperfection du travail, qui ne descendait pas assez profond dans le lac. En conséquence, on prit du temps pour creuser davantage le tunnel... On donne un combat de gladiateurs sur des ponts construits pour le combat. Un repas fut même servi près de la décharge, et devint l’occasion d’une terrible épouvante générale. Cette masse d’eau, se précipitant avec violence, entraînait ce qui se trouvait près d’elle… Agrippine alors, profitant de la terreur du prince, accuse de cupidité et de vol Narcisse, qui avait dirigé les travaux. Et Narcisse ne garde pas le silence, dénonçant le caractère impérieux de cette femme et son ambition démesurée.»490
488.JacquesHeers. Fêtes, jeux et joutes.p109
489.Tacite. Annales.LivreXIV.ChapitreXX.
490.Tacite. Annales.LivreXII.ChapitresLVI,LVII.
Maiscombiensurtoutilestintéressantdesuivrelecomportementdesempereursenfacedesjeux. Suétonenousendonnelapossibilitéetmêmesisontémoignageest partial virguleil yabeaucoupà apprendre.
C’estCésaraprèsavoirprononcéson Veni, vidi, vici :
« Il offrit des spectacles de différents genres : un combat de gladiateurs, des représentations théâtrales… ainsi que des jeux du cirque, des luttes d’athlètes, une bataille navale. Au combat des gladiateurs donné dans le forum prirent part Furius Leptimus, issu d’une famille prétorienne, et Q. Calpenus autrefois sénateur et avocat… Pour les jeux du cirque, on agrandit l’arène dans les deux sens, on l’entoura d’un fossé, et des jeunes gens de la plus haute noblesse y firent évoluer des quadriges, des biges et des chevaux d’écuyers. Des jeux troyens y furent donnés par deux escadrons d’enfants d’âge différent… Des athlètes luttèrent pendant trois jours sur un stade construit pour la circonstance.»491
C’estAugusteetlesoucideconserverlesusagesanciens:
« Il rétablit même quelques institutions religieuses d’autrefois, peu à peu tombées en désuétude, comme… la cérémonie des lupercales, les jeux séculaires et ceux des Compitales. Il interdit la course des Lupercales aux jeunes gens encore imberbes.» 492
Augusteetlerespectdetouteslesmanifestationssportives:
« Il n’assista jamais à un concours grec sans honorer chacun de ses adversaires selon son mérite. Il eut un goût très particulier pour les lutteurs, surtout de race latine, et non seulement pour les professionnels des jeux, qu’il se plaisait même à mettre aux prises avec les Grecs, mais encore pour les gens du peuple qui se battaient en troupes au coin des rues. »493
Augustequicependantdélaissapeuàpeu,encequileconcerne,lapratiquesportive:
« Il renonça aux exercices militaires de l’équitation et de l’escrime aussitôt après les guerres civiles, et les remplaça d’abord par le jeu de paume et de ballon ; ensuite il se contentait de promenades en litière ou à pied, qu’il terminait en courant et en sautant, le corps enveloppé d’une petite couverture.» 494
MaisunAugustequilégifèrepartout,quiexigel’ordre,lahiérarchieetl’organisationrigoureuse, sanscompterunecertaineségrégation:
« Il régnait partout dans les spectacles la confusion et le sans-gêne le plus complet : Auguste y introduisit l’ordre et la discipline… Il sépara les soldats du peuple. Il assigna aux plébéiens mariés des gradins spéciaux… Quant aux femmes, il ne leur permit pas de se placer, même pour les combats de gladiateurs qu’un usage établi les autorisait à suivre pêle-mêle avec les hommes, que sur les gradins supérieurs et toutes seules. Mais pour les luttes d’athlètes, il exclut si rigoureusement toute personne du sexe féminin que, durant les jeux pontificaux, le peuple ayant réclamé un couple de lutteurs, il remit sa présentation à la séance matinale du lendemain et fit proclamer qu’il ne voulait pas voir les femmes venir au théâtre avant la cinquième heure. »495
Et surtout un Auguste qui manie de main de maître une politique sportive de prestige personnel etdedistractiondupeuple,s’appuyantencelasurlabonnevieillecoutumedupotlatch,ladialectique dudon,dudéfietducontre-don.Ilrègneparlamagnificence.Lepeuple,liéauprinceparledondes jeux, lui doit, en contrepartie, soumission et respect. La réussite auprès de la population d'une telle politique sportive s’explique par la survivance de l'esprit du potlatch dans une société qui a cessé d'avoiruneorganisationtribale.Suétoneécrit:
« Par le nombre, par la variété et par la magnificence de ses spectacles, il surpassa tous ses prédécesseurs. Ildéclara qu’il célébra des jeuxpublics quatre fois en son propre nomet vingttrois foispour d'autres magistrats, quiétaient absents ou manquaient deressources... Ildonna aussi des luttes d’athlètes dans le champ de Mars, où furent disposés des bancs de bois, ainsi
491.Suétone. Vie des douze Césars.César.XXXIX.
492.Suétone. Vie des douze Césars.Auguste.XXXI.
493.Suétone. Vie des douze Césars. Auguste.XLV.
494.Suétone. Vie des douze Césars. Auguste.LXXXIII.
495.Suétone. Vie des douze Césars.Auguste.XLIV.
qu'un combat naval, pour lequel il fallut creuser le sol dans le voisinage du Tibre... Les jours de spectacle, il fit placer des gardes dans la ville, pour qu'elle ne devint pas la proie des voleurs, vu qu'il n’y restait presque personne. Dans le cirque il produisit des conducteurs de chars, des coureurs, des bestiaires, quelquefois même recrutés parmi les jeunes gens nobles. En outre, il fit très souvent donner des jeux troyens par des enfants de deux âges différents... Il fit quelquefois aussi participer même des chevaliers romains aux représentations théâtrales et aux combats de gladiateurs. »496
C'estTibèrequi,enrevanche,semblesoucieuxdelimiterlesfraisengagésdanscesentreprisesà fondsperdus:
« Comme l'anniversaire de sa naissance se rencontrait avec les jeux plébéiens, il permit seulement d’y ajouter en son honneur un char à deux chevaux.»497
Etdemanièregénérale:
« Il réduisit les dépenses des jeux et des spectacles en diminuant le salaire des acteurs et en limitant le nombre de couples de gladiateurs.»498
C'estCaligulaetlapratiqueségrégativedusport:
« Il n’admit à conduire des chars que des membres de l'ordre sénatorial.»499
UnCaligulafantasqueetsadique:
« Troublé dans son sommeil par la rumeur des gens qui dès le début de la nuit s’installaient aux places gratuites dans le cirque, il les fit tous chasser à coups de bâtons ; dans la bousculade furent écrasés plus de vingt chevaliers romains, et tout autant de matrones, sans compter une foule immense d'autres spectateurs... Quelquefois, pendant un combat de gladiateurs, il faisait replier le vélum, par un soleil des plus ardents, puis interdisait à tout le monde de sortir, et, vidant l'arène de ses occupants habituels, il leur substituait des bêtes galeuses, des gladiateurs de rebut, accablés de vieillesse, et, comme escrimeurs, des pères de famille connus, mais affligés d'une infirmité.»500
UnCaligulaopposantl'humournoiràl'hypocrisie:
« Un homme ayant fait vœu de se battre comme gladiateur si l’empereur se rétablissait, il le contraignit à s'exécuter, le regarda combattre avec le glaive et ne le relâcha qu’après bien des prières, lorsqu’il eut été vainqueur.»501
Tirantlalogiquecruelledumensongeflatteur:
« Un mirmillon d’une école de gladiateurs, qui s'exerçait à la baguette avec lui, s’étant laissé tomber volontairement, il le perça d’un poignard de fer et se mit à courir en tous sens avec la palme, à la façon des vainqueurs.»502
Maisaussijalouxetmesquin:
« Vivait alors un certain Aesius Proculus… que sa taille et sa beauté extraordinaire avaient fait surnommer l'Amour Colosse. Un jour de spectacle, il le fit tout-à-coup arracher de sa place, traîner dans l'arène et mettre aux prises d'abord avec un Thrace, puis avec un gladiateur armé de toutes pièces, mais comme il avait été deux fois vainqueur, il ordonna de legarrotteraussitôt,dele promeneràtraverslaville,toutcouvert de haillons,etdelemontrer aux femmes, puis de l'égorger.» 503
S'introduisantdanslesrivalitéscorporatives:
« Il mit des gladiateurs thraces à la tête de sa garde germaine ; il réduisit l'armure des mirmillons.»504
Portraitpeufavorabled'unhommedouémaisfou,avecunderniertrait:
496.Suétone. Vie des douze Césars.AugusteXLIII.
497.Suétone. Vie des douze Césars.Tibère.XXVI.
498.Suétone. Vie des douze Césars.TibèreXXXIV.
499.Suétone. Vie des douze Césars.CaligulaXVIII.
500.Suétone. Vie des douze Césars.CaligulaXXVI.
501.Suétone. Vie des douze Césars.CaligulaXXVII.
502.Suétone.ViedesdouzeCésars.CaligulaXXXII.
503.id.XXXV.
504.id;LV.
« Lui qui apprenait si facilement toutes choses ne sût pas nager.» 505
C'estNéron,biensûr,sonsouciduspectateuretduspectacle:
« Pour ceux du cirque, il réserva aux chevaliers des places à part et fit même courir des quadriges attelés de chameaux.» 506
UnNéronrelativementhumainensesdébuts:
« Durant les combats de gladiateurs qu’il donna dans un amphithéâtre de bois construit en moins d'une année dans la région du Champ de Mars, il ne laissa tuer personne, même parmi les condamnés ; au nombre des combattants figurent quatre cents sénateurs et six cents chevaliers romains, dont certains jouissaient d'une fortune et d'une réputation intactes ; à ces deux ordres appartenaient aussi les bestiaires et les divers employés de l’arène. »507
Quialesensdelafête:
« Il institua en outre, chose entièrement nouvelle à Rome, un concours quinquennal, triple, suivant l'usage grec - musical, gymnique et hippique -, auquel il donna le nom de joutes néroniennes. » 508
Etdépourvudepréjugésàl’égarddesfemmes:
« Aux luttes athlétiques il invita même les Vestales, parce qu’à Olympie même les prêtresses de Cérès sont admises à ce spectacle.» 509
MaisunNéroncherchantlagloirepersonnelleendehorsdelapolitique:
« Il avait surtout la passion de la popularité et prétendait rivaliser avec tous ceux qui à un titre quelconque possédaient la faveur de la foule. Après ses succès au théâtre, le bruit se répandit au prochain lustre qu’il descendrait dans l'arène parmi les athlètes, aux jeux olympiques; de fait, il s'exerçait régulièrement à la lutte et dans toute la Grèce il n’avait jamais assisté aux concours gymniques sans se tenir assis dans le stade, à la façon des arbitres, ramenant parfois de ses propres mains au milieu de l'arène les couples qui s’en écartaient trop. Voyant qu’on le mettait au niveau d'Apollon pour le chant et du soleil pour la conduite des chars, il avait même résolu d'imiter aussi les exploits d'Hercule ; il avait, diton, fait préparer un lion qu’il devait, paraissant tout nu dans l'arène de l'amphithéâtre, soit assommer à coup de massue, soit étouffer de ses bras, sous les regards du peuple.» 510
On sait que Néron fit retarder ces jeux de deux ans et s’adjugea le prix, bien qu’il fût tombé de sonchar.Celasesitueàla211èmeOlympiade.Onassisteauplusétrangemélangedelapolitiqueet dusportetplusriennesetrouveàsaplace.C'esttoujoursSuétonequirapporte:
« Il conduisit aussi des chars dans plusieurs concours, et même parut aux jeux olympiques avec un attelage de dix chevaux, quoique, dans l’un de ses poèmes, il eut blâmé le roi Mithridate précisément pour ce fait ; il fut d’ailleurs précipité de son char ; on l’y replaça mais ne pouvant tenir jusqu’au bout, il dut s’arrêter avant la fin de la course, ce qui ne l’empêcha point d’être couronné. Ensuite, en quittant la Grèce, il accorda la liberté à toute la province et à ses juges le droit de cité romaine, plus des sommes considérables. C'est luimême qui proclama ces récompenses, au milieu du stade, le jour des jeux isthmiques.»511
Les jeux romains, si liés à l'histoire, ont donc eux- mêmes une histoire. Tout se passe comme si une société incapable de concevoir un vrai système de valeurs ne trouvait d'autre image de soi que dans la dérisoire, désespérée et anachronique recherche de formes de socialisation dépourvues de significations actuelles, totalement périmées. L'imaginaire tient lieu de réalité. Mais c'est un imaginairesans imagination. C'est un imaginairevide. Il n'est pas alimenté parle réel. C'est du vide pourcacherlevide.Encesens,lesportestlerefletdelapolitique.
505.id.LIV.
506.Suétone.ViedesdouzeCésars.Néron.XI.
507.Suétone.ViedesdouzeCésars.Néron.XII.
508.Suétone.ViedesdouzeCésars.Néron.XII.
509.Suétone.ViedesdouzeCésars.Néron.XII.
510.Suétone.ViedesdouzeCésars.Néron.LIII.
511.Suétone.ViedesdouzeCésars.Néron.XXIV.
Cette organisation du vide obéit à une évolution. Sous Galien, au IIIe siècle, qui a exclu les sénateurs des commandements militaires, les questeurs et les prêteurs n’ont plus d'autre rôle, nous l'avonsdéjàdit,quedepréparerlesjeux.Aurélien,quivoudraitdonnerunebasereligieuseaurégime, invente un culte nouveau, celui du Sol Invictus, une divinité composite où l'on retrouve Apollon, Sérapis,Baal,Mithra,etilorganisedesjeuxtouslesquatreans.
De toutes façons, comme on l’a fait remarquer, les jeux sont devenus un besoin organique de la société.AuIVe siècle,175joursparanleursontconsacrésetonmesurela progressiondepuisMarcAurèleoùl'onencomptait135pourlemêmeusage.
Lapopulationestinoccupée,nerveuse,turbulente.Elleexigedesjeuxetonn’ariend’autreàlui proposer. C’est le souci du pouvoir, son système de gouvernement et sa ruine. Toutes les villes de provincesuiventlemouvement.Commeilfautpayerlesdépenses,c’estl’empereurquisupporteles charges, c’est-à-dire les contribuables, surtout ceux des provinces, et les riches citoyens qui ne peuvent se dérober à cette redistribution de la richesse et de la pauvreté. Et on retrouve le même processusàCarthage,àAntioche,maisaussiàTrèves,àMayence,àCologne.
L’idéologie officielle est un mélange de conservatisme, de résignation, d’arrivisme et de fausse culture,sibienqu’ilarriveauxbarbaresdedonnerdesleçonsd’honneur.Onlevoitbienen392quand le préfet Symmaque interprète comme un désastre et un acte "impie" le fait que les vingt-neuf prisonnierssaxonsqu’ildestinaitauspectacleontpréférés’étranglermutuellementquedeparaîtreau cirque. Évidemment le spectacle est perdu et aussi l’argent dépensé pour l’achat des victimes. Mais faut-ilserésignereninvoquantSocrateetlephilosophe?Dequelcôtéestlamorale?
D’ailleurslesbarbaresne donnentpasquedesleçonsd’honneur. Ilsdonnentaussidesleçons de politique.QuandTotilaen549entredansRomepourlasecondefoisàla têtedesesOstrogoths,ily est reçu comme un souverain rentrant dans sa capitale. C’est lui qui organisera des courses pour la dernièrefoisdanslegrandcirque.Lesbarbaresontfortbiencompriscequidevaitêtrefait.
Maispouvait-onréagir?LesempereursMarc-AurèleetJulienavaienteul’idéed'abolirlesjeux. Maisc’étaitagirsurlesconséquencesdeladécadence,nonsursacause.Etlevolontarismepolitique n’a pas prise sur le comportement populaire. Gratien se hâta de rétablir en Afrique les combats d’athlètes,disantqu’ilnefallaitpasrestreindrelesamusementspublics,mais,aucontraire,inciterle peuple à manifester sa joie là où il est heureux. Arcadius maintient les fêtes de mai, ne voulant pas, dit-il,enlesabolissant,jeterl’Empiredanslatristesse.
Les jeux vont mourir, sans doute, mais de leur belle mort, pas en vertu des interdits officiels ou des prescriptions morales. Tous ces rituels et ces symbolismes qui se survivaient, faute de mieux, sansêtrecompris,quêtedésespéréed’unscénariofantastiquemettantenscènelamortetlapuissance, nepouvaientrésisterdevantlapromessed’uneimmortalitéréelle,d’unsalutpersonnelréel,faitepar le christianisme et les religions à mystère qui fleurissent à l’époque. Les combats de gladiateurs semblent avoir disparu sous Théodose en Orient. L’écho de la cruauté gratuite, sous Honorius, en Occident.AuVIe siècle,ilsubsisteralescoursesdecharsetlaruinepubliqueymitfin.
Que reste-il des jeux romains? L’écho d’une cruauté gratuite, de l’ennui politique, un comportementdevoyeurenfacedelamort,uneeffrayantevisiond’unsportd’Etatoùl’empereuret lepeuple,solidairesetcomplices,jouentunehistoirequ’ilssontincapablesdevivre.
Il en reste quelques vers, charme désuet d’une époque qui décidément ne se comprend pas, ne cherchepasàsecomprendre,quinecroitpasàcequ’elledit,àcequ’ellefaitetquifaitdéjàsemblant depuislongtempsd’attacherauxmotsunsensqu’elleestdansl’impossibilitémanifestedediscerner ailleurs.
Rien de plus académiquement stupide et déplacé, en effet, que les vers d’Horace, pâle imitation desGrecs,ridiculeaffirmation,purlangagedepoèteenmald’effetfacile,constatd’uneculturemorte etd’unsportantiquemoribond,sous-produitd’unevagueréminiscencepindarique: « Il y a des hommes qui se plaisent à faire voler la poussière dans la carrière olympique : que, dans leur courserapide,ils aient évité la borne, lapalmequ’ils remportent les égale auxdieux maîtres du monde.»512
512.Horace, Odes,I,1,AMécène.
Peut-on lire ces vers sans réprimer un éclat de rire ? Et en même temps peut-on se garder d’un pincement au cœur quand on se souvient que les mêmes mots, dans un contexte culturel différent, relevaientd’uneinspirationpoétiqueréelle?
Entre la fin du sport antique que l’on peut dater pour des raisons de clarté et de commodité de 393, quand l’édit deThéodose abolissant lesfêtespaïennesvient mettre fin aux jeux olympiques, et l’apparitiondusportmodernepourlequelonpourraitproposertrèsarbitrairementl’année1719,celle où le premier titre de champion est décerné, il se passe à peu près autant de temps qu’entre la restaurationdesjeuxolympiquesanciensetleurdisparitiondéfinitive,largementplusquemillénaire. Bien entendu, ces dates ne sont que des repères. Les périodes de transition sont longues, fertiles en formes diverses. Mais surtout l’éclipsede l’institution n’est pastotale,absolue. Mieux, l’absence d’une réglementation officielle, ayant valeur universelle, la disparition de normes garanties par l’autoritéreligieuseoupolitique,permettentausportdereprendrecontactavecsessourcespopulaires, avec les émotions primitives. N’étant plus tenu par les exigences de la technique, la logique de la pédagogie et celle du rendement, des règles extérieures inamovibles, le sport à l’état sauvage va laisserlibrecours àl’imaginaire,amassantun capitalaffectifdans lecadredesjeuxtraditionnels,ce qui rendra possible l’explosion sportive le jour où la révolution industrielle reproduit les conditions quiavaientpermisl’institutionsportiveantique.
Ces conditions sont simples. Il faut, d’une part, l’unité de culture pour qu’une règle universelle soitpossible,pensable.Ilfaut,d’autrepart,ladiversitégéographiqued’adversaireslibresetégauxen droit.Sportettransportvontdepair.C’estlafacilitédudéplacementjointeàl’attachementlocalqui, entraînant l’obligation d’une même règle adoptée partout pour les adversaires éventuels, va faire la différenceentrelesjeuxtraditionnelscantonnésdansleuradaptationstrictementrégionaleaumilieu etlessportsquisontdesjeuxgéographiquementouverts.
Cettecinquièmepartieestcomposéedesquatrechapitressuivants:
Chapitre20. Sport et religion
Chapitre21. L’idée sportive au Moyen-Âge.
Chapitre22. Sport et philosophie.
Chapitre23. Sport et littérature
Sportetreligion. Apôtresetpèresdel’Église.
Ilconvientdesegarderdessimplificationsfacilesetdesidéesreçues.MichelClareacertainement raisondes’insurgercontrel’ignorancedel’histoire; « Unelégende quia laviedurea cru àun mépris à l’égard du corps. Un paganisme de pacotille a vu, dans l’attitude des chrétiens envers les jeux –envers surtout ce qu’ils étaient devenus – comme un refus des exercices qui favorisent l’épanouissement du corps humain. »513 L’auteur poursuit: « Ce qui est tout simplement confondre christianisme et hérésie chrétienne. La distinction paulinienne entre la chair et le corps est suffisamment précise sur ce point. Et Saint Paul a de superbes images empruntées à l’athlétisme. »514
Premièrechose,lesimagessportivesetleurlienévidentavecla représentationd’unevictoiresur la mort subsiste dans le cadre chrétien primitif. Raymond Bloch en fait la remarque: « La palme tenue à la main par un athlète, la couronne de laurier qui lui a été aussi décernée deviennent, en soi, la marque évidente dela victoire, du triomphe, etleur représentation figurée sur les tombeaux comme le monogramme rassemblant les initiales des mots Palma et Laurus apparaît dans des épitaphes païennes puis aussi chrétiennes. »515
Ala findumonde antique,lesportquiva disparaîtreaveclui lie toujoursétroitement sonimage de soi à l’immortalité héroïque: « La victoire agonistique et avant tout la victoire dans les courses de chars qui se déroulaient dans le cirque et surexcitaient la passion de tout un peuple était devenue le symbole de la victoire suprême, celle de l’âme sur la mort. »516
Le modèle sportif est un langage qui permet de se comprendre: « Les chrétiens eux-mêmes reprendront les mêmes images dont la valeur s’était si profondément enracinée et certaines peintures de catacombes représentent des quadriges victorieux pilotés par leurs cochers portant d’une main la palme, de l’autre la couronne de laurier. Le symbolisme a résisté aux siècles et nous parlons encore de la palme du martyre. »517
Commetoujours, le système de référence ancien est en mêmetemps nié, affirmé, dépassé par le nouveau.
Nié, il est visible quele christianisme propose une immortalité réelle à coté de laquelle la quasiimmortalitérevêtunealluredérisoire.Encesens,laruptureestradicale.
Affirmé, l’usage des métaphores n’est pas seulement un langage obligé. C’est une structuration préalabled’unsystèmedepenséedéjàorganiséquiconditionnelasuite.
Dépassé,lemondeantiquen’estplus,ilcèdelaplaceaumondechrétien. Iln’yadoncpaslieudes’étonneroutremesuredevoirlesformulessportivessurgirsouslaplume de Saint Paul. Il s’agit pour lui de se faire comprendre. Il s’agit de présenter l’au-delà invisible à l’aide des réalités visibles ici-bas. On notera cependant que l’au-delà chrétien n’est pas un nirvana. Lamentalitésportiveoccidentaleparled’uncielqu’ilfautgagnerdanslalutte.Lamentalitéorientale étrangère au sport n’offre que la perte de la conscience de soi et de l’affirmation de soi comme perspective de salut. Les grands systèmes religieux de l’Occident et de l’Orient divergent. Le bouddhismenefaitpasréférenceausport.
513.MichelClare. Introduction au sport.Ed.Ouvrières.1965.p.24. 514. id.p.24-25.
515.RaymondBloch. La religion romaine.«HistoiredesReligions»,l’encyc.delaPléiade.p.909. 516. Ibid 517. Ibid
SaintPaulestexemplaireàcetégard.Lavieestunecourse,c’estuncombat.Ilnefautsurtoutpas s’arrêter,sedécourager.Ils’agitdetenir.Ilestimportantdevaincre.
Illeditdansl’épîtreauxGalates: « Vous courriez si bien ! Qui donc a pu vous arrêter ? »518
Il le redit dans la première aux Corinthiens: « Dans les courses, sur la piste, ne savez-vous pas que tous ceux qui sont engagés courent mais le premier gagne seul le prix. Courez donc vous aussi, et si bien que vous remportiez la victoire. »519
Illereditencoredansl’épîtreauxPhilippiens: « Ce n’est point que j’ai gagné le prix, ni que j’aie acquis une forme parfaite, mais je continue ma course, avec le désir d’être vainqueur. »520
Encorefaut-ilrespecterlarègle dujeu: « Celui qui combat dans l’arène n’est point récompensé s’il ne donnede justes preuves desa valeur. L’athlète n’obtient la couronne que s’il observeles règles du combat. »521
C’est-à-direnepassetromperdecompétitionssil’onveutobtenir,carc’estlàl’important,leprix, le succès, la récompense: « J’ai combattu le bon combat. J’ai terminé ma course. J’ai servi la Foi. Il ne me reste plus qu’à recevoir la couronne de justice. »522
On le voit, il y a correspondance parfaite entre les deux langages, celui du sport, celui de la religion. Il n’y a pas lieu d’en être trop surpris, car nous savons déjà quels archétypes anciens véhiculentlesstructuressportives.Ilestnormalqu’ellesexprimentsibienl’idéedesalut.Allonsplus loin. Si le sportmimela sortie d’un enfer préchrétien, il est tout naturel quecelui qui se sauve entre danslecielchrétien.Toutcelarestecohérent.Enoutre,danscecontexte,oncomprendmieuxquele christianismeadmettedesdamnésmalgrésonaffirmationd’undieutout-puissant.Lesportdemeure fondamentalement un sacrifice de fondation. Pour constituer l’axe du monde, le ciel où entrent les élus,ilfautbien,encontrepartie, poursauvegarderl’équilibrecosmique,qu’ilyaitdesvictimes.Le christianismesesituedanslacontinuitédupaganisme,mêmes’ilétablitunecoupureradicale. Parlasuite,avecletemps,onneconstatepasnonpluscedivorcedontonparletant.Iln’yaguère d’hostilitédelareligionàl’égarddusport,saufpoursesexcès,saufpoursadénaturationinhumaine. Ilsuffit,pours’enconvaincre,deregarderl’attitudedeSaintAugustinvis-à-visdesréalitéssportives. Noustrouvonschezluiaumoinstroistextesdifférentsetsignificatifssurlaquestion. Le premier se situe dans les Confessions et relate un épisode d’enfance. La volonté de gagner y estparfaitementdécrite.Lacombativitél’emportenettementsurle fair-play.Maisc’estunesituation qui doit être dépassée.Elle n’est pas dramatisée. « J’avais un si sot désir de supériorité que, quand, dans le jeu, je me sentais battu, je captais souvent la victoire en trichant. Et pourtant s’il y avait une chose que je ne voulusse pas supporter et qui soulevât mes véhémences réclamations, quand je prenais les autres en flagrant délit, c’était justement ce que je leur faisais moi-même. Étais-je pris à mon tour sur le fait et incriminé, j’aimais mieux faire le coup de poing que de céder. »523
Lesecondtexteestcepassagedu De Ordine oùSaintAugustinindiqueclairementlelieuoùl’on se réunit pour discuter philosophie et religion en cas de mauvais temps: « Nous partions pour les bains (ce lieu, en effet, lorsque le ciel couvert ne nous permettait pas de nous tenir dans la prairie, était commode pour la discussion et nous était familier) »524
Le troisième texte lui fait suite immédiatement. C’est la reconnaissance de la beauté cruelle du spectacle sportif. Un combat de coqs le retient, le fascine. « Dans ces coqs mêmes, avec leur tête tendue en avant, leurs plumes hérissées, leurs coups violents, leurs habiles parades, et dans tous les mouvements de ces animaux sans raison, nous ne pouvions rien voir qui ne fût beau, parce qu’une autre raison gouvernait d’en-haut tout ce combat. » L’auteur continue: « Puis ce fut la loi du vainqueur : un chant d’orgueil et des membres pour ainsi dire ramassés en forme de roue, comme pour exprimer la fierté du triomphe. Quant au vaincu, il se reconnaissait aux plumes arrachées de sa
518.SaintPaul. Galates,V,-10.
519.SaintPaul. Ie Corinthiens,IX,24-27.
520.SaintPaul. Philippiens,III,12.
521.SaintPaul. IIe Timothée,II,2-7.
522.SaintPaul. IIe Timothée,IV,7-8.
523.SaintAugustin. Confessions.LivreI.XIX,30.
524.SaintAugustin. De Ordine.I,VIII,25.
tête, au complet désarroi de sa voix et de sa démarche et, par là même, à je ne sais quoi d’ajusté aux lois de la nature et du beau. »525
Il faudrait encore ajouter que la manière sportive ne déplaît pas à Saint Augustin quand il s’agit dediscuter.Acetégard,iladoptevolontierslestyledessophistesanciens.C’estparticulièrementnet danslesdiscussionspubliquesaveclesManichéens.Celuiquinepeutpasrépondreàl’autres’engage àsereconnaître"vaincu" 526
Enfait,l’attitudechrétienneàl’égarddesjeuxtraditionnelsetparconséquentdusportvas’établir clairementdanslessièclesultérieursetc’estpeut-êtreSaintFrançoisdeSalesquiendonnelabonne formule quand il définit les limites du convenable dans la récréation. Il ne condamne pas les jeux, tant que ceux-ci restent dans les limites acceptables: « Les jeux auxquels le gain sert de prix et récompense à l’habilité et industrie du corps ou de l’esprit, comme les jeux de la paume, ballon, paille maille, les courses à la bague, les échecs, les tables, ce sont des récréations, de soi-même bonnes et loisibles. »527 Mais, ajoute-t-il: « Il se faut seulement garder de l’excès, soit autant que l’on y emploie, soit au prix que l’on ymet ;car, si l’on emploietrop detemps, cen’est plus récréation, c’est occupation : on n’allège ni l’esprit, ni le corps, au contraire on l’étourdit, on l’accable. »528
Limiteraisonnabledutemps : « Ayant joué cinq, six heures aux échecs, au sortir on est tout recru et las d’esprit ; jouer longuement à la paume, ce n’est pas recréer le corps, mais l’accabler. »529
Limite raisonnable du prix: « Or, si le prix, c’est-à-dire ce qu’on joue est trop grand, les affections des joueurs se dérèglent ; et outre cela, c’est chose injuste de mettre de grands prix à des habiletés et industries de si peu d’importance et si inutiles, comme sont les habiletés des jeux. »530
Enunmot,nepaslaissertropdechampàl’émotionetàlapassion: « Mais surtout prenez garde, Philothée, de ne point attacher votre affection à tout cela ; car pour honnête que soit une récréation, c’est vice d’y mettre son cœur et son affection. Je ne dis pas qu’il ne faille prendre plaisir à jouer pendant que l’on joue, car autrement on ne se recréerait pas ; mais je dis qu’il faut ne pas y mettre son affection pour le désirer, pour s’y amuser et s’en empresser. »531
Ce texte est une doctrine du sport. Il préfigure l’attitude du sport éducatif et des fédérations affinitaires.Lesportestunmoyen,surtoutpasunevaleur,unedétente,pasuneémotion.
525. Ibid
526.SaintAugustin
527.SaintFrançoisdeSales. Introduction à a vie dévote.ChapitreXXXI.Despasse-tempsetrécréations,etpremièrementdesloisibles etlouables.
528. Ibid
529. Ibid
530. Ibid
531. Ibid
L’idéesportiveauMoyen-Âge. Uneparenthèse
institutionnelle.
Il faut avant tout relire Tristan et Yseult. C’est un bon centre de perspective. Des influences d’originediverses’yexpriment.Plusieursépoquessereflètentdans lalégende.Onysaisitmieuxce fait que des archétypes voyagent au travers des siècles se fixant au passage à d’autres structures et constituantdesmodèlesnouveauxquisefontetsedéfont,secontredisentouévoluentenformations pluscomplexes.
Le totémisme ancien y est encore présent. Le roi Marc a des oreilles de cheval. Il s’agit de l’ancêtre mythiqueconservédans le cadre d’une société féodale. C’est lenain Frocin qui révèle aux baronscetteparticularitédeleursouverain.
La signification hiérogamique du sport y est dans une certaine mesure conservée, encore que l’écho en soit fortement atténué. Mais les valeurs sportives sont toujours des valeurs sociales. Elles confèrent un prestige presque magique à celui qui les possède. Blanchefleur, la plus jeune sœur du roi Marc, ayant vu Rivalen jouer avec d’autres vassaux, tombe en un tel trouble qu’elle y reconnaît l’amour.C’estdecetteunionquenaîtralehérosTristan.
Ce Tristan est effectivement appelé àun grand destin. Il combat un premier géant, réminiscence de la Crète et du Minotaure. Il s’agit du Morholt, beau-frère du roi d’Irlande, un guerrier de taille gigantesque qui vient périodiquement en Cornouailles exiger un tribut; bref, c’est un peu l’histoire de Thésée. Il faut qu’un champion du roi Marc relève le défi du Morholt. Tristan se propose. On vérifie son lignage, n’importe qui n’est pas admis à l’ordalie. On détermine le lieu du combat, une île,uncerclemagiqued’oùunseulreviendra.
Plus tard, après bien des péripéties, Tristan ira quérir en Irlande la fiancée du roi Marc. Mais il doitlagagnerenaffrontantunredoutabledragon.Ilestaidéparlesmagiciennes,unpeucommeJason l’avait été par Médée, grâce à l’infusion d’herbes efficaces. C’est le second exploit de Tristan, une hiérogamieoùilestlechampioninterposé.
Plus tard encore, second géant dominé et troisième exploit, Tristan poursuit et réduit à sa merci Béliagogàlamassued’ébène,avecune sauvageriequi rappellel’attitudedeGilgameshetd’Enkidu face à Humbaba dans l’Épopée assyro-babylonienne. Vainqueur et vaincu aussitôt réconciliés construisent ensemble un palais secret et retiré du monde, une sorte d’au-delà, où tous les éléments du scénario figurent eneffigie: le Morholt, le dragon, Yseult, Frocin, Brangion la servante rusée, le chienHusdentetjusqu’àBéliagoglui-même.
A ces archaïsmes dont nous saisissons la provenance viennent se mêler évidemment des particularités médiévales dont certains points méritent d’être observés. L’éducation noble donnée à Tristan est une éducation sportive, ce qui n’a rien pour surprendre. L’écuyer Gorneval apprend au neveuduroiMarcàcourir,àsauter,ànager,àmonteràcheval,illuiapprendàcombattreàl’épée,à manier l’écu et la lance. Mais il lui apprend encore à tirer à l’arc et c’est là un détail qui doit être retenuquandonsaitleméprisultérieurdeschevalierspourunearmequitueàdistance,sanscontact d’hommeàhomme.
Ordalie (le Morholt), hiérogamie (le dragon), rite funéraire (Béliagog), les formes primitives du sportsontprésentesunpeupartout,ainsiquel’éducationphysiquedujeunenoble,etc’est encoreet toujoursdesportqu’ils’agitlorsquel’onveutsedivertir.LorsqueTristanépouseYseultauxblanches mains,poursedistraireets’amuseraprèslefestin,onvas’exerceretsedéfieràlaquintaine,aulancer dujavelotetàl’escrime.
Un certain nombre de choses sont passées dans les romans de Chrétien de Troyes. Parfois la réminiscence est curieuse. Dans Perceval, Guiromelan dit à Gauvin avec mépris: « Je vois que tu n’es qu’un jongleur alors que je te croyais un chevalier plein de prouesses. » On croirait entendre Euryale s’adressant à Ulysse dans l’Odyssée. C’est en tous cas affirmer une fois de plus que la pratique sportive est aristocratique et noble et même peut-être qu’elle constitue un rite de reconnaissanceentregensdehautniveausocial.
D’autres faits sont étonnants et troublants. Dans Yvain ou le chevalier au lion, le jeune roi a dû promettred’envoyerchaqueannéeuntributdetrentejeunesfillesetYvain,pourl’enlibérer,affronte les deux maufrésqui sebattent à coups de masse, àla manièrede Béliagog, commes’ils étaient des gardiens infernaux qui séquestrent les âmes malheureusement prisonnières du labyrinthe. C’est encoreunefoisl’histoiredeThésée.C’estl’éternellehistoiredutributdelamort,deladescente aux enfersetduriteinitiatiquequidébouchesurlemariage.
Souvenird’unrituelinitiatique?C’estévident.Il suffitdeserappelercepassagedu Perceval de ChrétiendeTroyes.Lareinefaitchaufferdesétuves,etcinqcentscuvesaumoins!Elleyfaitentrer les garçons. On leur a taillé des robes pour la sortie de bain. Ils veilleront ensuite jusqu’au matin, debout,sanss’agenouilleretàl’auroreGauvinlesferachevaliers.Réminiscencedoncd’uneinitiation detouteclassed’âgeparlafemmemagicienneousorcièreetpriseenmainsparleshommes.
Mais aussitôt les valeurs deviennent masculines, celles de l’épreuve physique, du défi et du combat.Onpeuts’enrendrecomptelorsdupremiergrandcombatsingulierdelaTablerondedécrit dans Erec et Enide. Il faut une occasion pour en découdre. Le prétexte est compliqué et raffiné. Un épervier de cinq mues est placé en haut d’une perche d’argent. Les concurrents doivent avoir amie belle et sage. Celui qui obtient l’oiseau trois fois de suite l’obtient pour toujours. Telles sont les conditions et le jour prévu, chacun des deux champions envoie son amie chercher l’oiseau. C’est le défi,lecombat.
Onvoitl’ambiguïtédelasituation.Onsebatpouruneamiequ’onditlaplusbelleetlaplussage. Mais on se lamente éventuellement de ne pas avoir amie belle et sage pour pouvoir se battre pour elle.Ilestvraiquelesdeuxélémentssontnécessairesauscénario.Encorefaudrait-ilsavoircequiest le plus important, l’épreuve ou la récompense et, on va le voir, cela ne va pas parfois sans contradictions.
ChezChrétiendeTroyes,laprésencedelafemmeredevientundesthèmesmajeursdel’épreuve. Rejouerait-on sans le savoir les hiérogamies primitives? Le modèle ancien, plus ou moins transmis et déformé par la tradition orale ou littéraire, se conserverait sous un nouvel habillage culturel dans unesociétéquirecueille cethéritageparcequ’elleestparticulièrementsensibleàuneréactualisation del’archétypeainsivéhiculé.
Enfait,la fonctiondelafemmechezChrétiendeTroyessembleàtout lemoinsplusidéaliséeet plusactivequedansleslégendesarchaïquesserapportantausportetdontnousavonsessayédefaire l’analyse.Peut-êtredoit-onyvoiruneinfluenceorientaleapparueenFrancedéjàversl’anmiletdont le moine Raoul Glaber déplore qu’elle passe les Pyrénées. En tous cas, la femme n’est pas fatale comme Atalante ou passive comme Hippodamie. Elle est l’inspiratrice. Elle entend être méritée par obéissanceetbravoure.Ellen’acceptepasd’êtregagnéeparforceetviolence.
Malgré tout, les images anciennes surgissent à l’intérieur du schéma nouveau. Dans Perceval, il yaunefille quiparaît aussifaroucheetcruellequ’Atalante.Ondit àplusieursreprises qu’elle afait trancherlatêtedemaintschevaliers,àtantd’honnêtesgens.QuandGauvinaccomplitl’exploitdelui amener son palefroi enchanté par-dessus la rivière, elle manifeste immédiatement son caractère sauvage, rebelle, hostile etle met en garde de sevanterde l’avoirtenueen ses bras: elle se sentirait déshonorée s’il avait touché, senti, palpé quoi que ce soit d’elle de sa main nue. La foule amassée souhaitemalheuràlafilleincapabled’aimeretlenautonierditqu’elleestpirequeSatan.
Onpourraitdirequedansunsensc’esticilecontrairedeshiérogamiesanciennes.Nousavonsvu que l’institutionnalisation des jeux, leur logique interne, correspondait à une régression du pouvoir féminin.Or,actuellement,danslecontextecourtois,lafemmetendraitàreprendrelapremièreplace.
Psychologiquement, c’est la femme qui motive et provoque l’exploit. Moralement, c’est elle qui rappellel’ordredesvaleursadmisesdanslasociétémédiévale.
Mais ce qui est certain, c’est que les deux thèmes dominants, d’une part, le combat, la gloire, d’autrepart,l’amour,lafemme,peuvententrerenconflit.Périlschevaleresquesetcalmesjouissances nevontpasdepair.Onestmêmeintroduitdansunesortedecerclevicieux.Quandl’hommeagagné, c’estlafemmeenréalitéquil’emporte.Elleseréjouitquandl’autreafinidejouer.Maiscelanedure pas et le doute s’introduit, car l’homme n’est désirable que pour autant qu’il continue de manifester sa noblesse, sa supériorité par des exploits, donc quand il quitte sa femme. C’est la sexualité impossible.C’estl’inaccessibleGraal.Yvainquittesajeuneépouseetpartàl’aventure.
Laprésentationdudilemmeestdramatiquedans Erec et Enide.Erecvitamoureusementavecson épouseetnepenseplusauxtournois.Ilnesongequ’àcourtisersafemme.Ilenestblâméparl’opinion publique.MaisquandEnideentenddireautourd’ellequesonmariestun"récréant", c’est àdire,en termesmodernes,quelqu’unquiresteauvestiaireàlami-tempsouquelqu’unquidéclareforfaitdans les compétitions, elle en est toute remuée, honteuse pour lui et pour elle-même. Alors il se rend compte qu’elle pleure, elle lui avoue ce que les gens pensent. A partir de là tout se précipite. Erec s’arme sur-le-champ. Aussitôt Enide se reproche d’avoir parlé. Mais Erec s’en va à l’aventure et interditàsafemmedeluiadresserlaparole.Lahiérarchiedessexesestd’unseulcouprenversée. On trouve un épisode semblable dans la Continuation de Perceval du manuscrit de Mons. Les amants vécurent les yeux dans les yeux ne sachant si c’était ciel ou terre. Mais l’amour de l’exploit l’emporte sur les exploits de l’amour. Au quatrièmematin, Percevalse ressaisit, réclame desarmes. Blanchefleur ne répond rien quand il lui parle pour l’apaiser. Il monte en selle. Elle reste là triste et accablée.
C’estunautreplaisirquis’affirme,celuidel’aventureetdelacompétition.Joiedesebattreetde faireassautd’élégance,dansle Chevalier au lion, voicilefair-play:YvainetGauvainluttenttoutle jour sans se reconnaître, puis, par admiration réciproque, chacun des deux veut se déclarer vaincu. De toutes façons, la manière importe plus que les avantages qu’on en retire. Dans Erec et Enide, le tournoi de la Pentecôte nous révèle des lances qui se brisent, qui percent des écus, des hauberts rompus. Les selles se vident, les chevaux écument. On nous dit qu’Erec ne cherchait pas à prendre deschevauxmaisseulementàjouteret fairedes prouesses,unebataillequireprit devantla porte du châteauetsepoursuivitjusqu’àvêpres.
On peut penser que Voltaire idéalise quelque peu quand il parle d’une sorte de pouvoir féminin dans les tournois: « Tout se faisait à l’honneur des dames, selon les lois du bon roi René. Elles visitaient toutes les armes, elles distribuaient les prix ; et si quelque chevalier ou écuyer du tournoi avait mal parlé de quelques-unes d’entre elles, les autres tournoyants le battaient de leurs épées, jusqu’à ce que les dames criassent grâce. »532
C’estprendretropausérieuxlestraditionsissuesdel’académismecourtoisdeChrétiendeTroyes. Cette poésie était une poésie de commande. Les clichés y étaient renforcés jusqu’à l’absurde. Peutêtrel’auteurs’amusait-illui-mêmeàfrôlerlepastichedugenrequ’ilutilisaitetdontilétaitprisonnier. CettelimiteestatteinteavecLancelot,lechevalieràlacharrette,qui,surl’ordredesadame,combat d’abord pour le pire et se fait passer pour un couard, ensuite pour le mieux, triomphe de ses adversaires… et regagne la prison dont on l’avait fait évader. On mesure l’ampleur du télescopage desvaleurscourtoisesimposéesparlesprincesses dutempsetdesarchétypesvenusd’autrecultures etplusoumoinsbienamalgamésquandonsesouvientquelemêmeLancelotaffronteraplustarden combat singulier le terrible Méléagant et lui tranchera la tête devant la cour du roi Arthur. Est-ce le mêmepersonnagevraiment?
Il vaut mieux constater avecJacquesHeersque les jeux de chevalerie ne prennent qu’à la fin du Moyen-Âge l’allure de fête et de réjouissance. C’est d’abord un entraînement intensif à la guerre et l’entréedansunesortedeconfrérie.AuXIIe siècle,plusieursjoursdurant,deséquipesdeconcurrents
532.Voltaire. Essai sur les mœurs.Ch.XCIX.
s’affrontententerraindécouvert.Puis,onvoitarriverlaquintaine,mannequindeboisplusoumoins grossier,onémousseleslances,ondiminuelesrisques,ondonnedéjàdanslespectacle.533
L’Églises’inquiètedel’importancepriseparcesjeuxguerriers.En1130,InnocentII,auConcile de Clermont, parle avec sévérité des tournois. Dans le même esprit d’opposition aux valeurs agressives,en1139,leConciledeLatranfaitinterdictiond’ailleursdel’usagedel’arcetdel’arbalète entrechrétiens.Onnoteracependantquelesdeuxinterventionsnevisentpaslemêmepublicetn’ont pas le même objectif. Un préjugé aristocratique veut désormais qu’on ne frappe pas l’ennemi à distance.AudébutduXIIIe siècle,l’empereurConradseralouéden’avoirjamaisvouluseservirdes arbalétriers.534
Unpeuplustard,lepouvoirpolitiqueaussis’inquiéteradesjeuxets’aperçoitquelepeuplepour sa part a aussi ses distractions qui ne sont pas celles de la noblesse. Aussi prend-il des mesures contrairesauxprécédentesmaisdestinéesàunautremilieu.C’estainsiquePhilippeleLongen1319 ordonneàsessujetsderenoncerauxjeuxdepalets,dequilles,desoules,pours’adonnerautiràl’arc etauxexercicesmilitaires.
Cela vaut qu’on s’y arrête un instant. Cela signifie, en effet, que tout d’abord l’arc est admis comme arme de guerre. Cela veut dire ensuite que c’est une arme confiée à l’infanterie, classe militaireinférieure.Celamontreenplusquelesportpopulairen’estaperçuparlesprincesquecomme préparation militaire. Cela révèle enfin l’incompréhension fondamentale des jeux traditionnels, domaine où le peuple conserve au niveau du rite, c’est-à-dire du comportement joué, des usages où sa liberté et sa créativité s’exercent, sur une base cérémonielle primitive, en dehors de toute soumissionauxautoritéssupérieuresroyalesetreligieuses,brefundomaineréservédesonimaginaire collectif.
Larésistancepassivedesjeuxtraditionnelsauvolontarismeutilitaristedesprincesestattestéepar l’escalade del’affirmation répressive du pouvoir. En Angleterre,Edouard IIIprescrit àses sujets en 1337 de renoncer à tous vains passe-temps et de se livrer au tir à l’arc « sous peine de mort. » L’ordonnance sera renouvelée en 1363 et on y a vu l’origine de notre désastre de Crécy. De même, enFrance,CharlesVdéfend,le3avril1369,souspeinedequarantesolsparisisd’amende,cequiest incontestablementmoinssévère,tousjeuxn’exerçantpasleshommesaumaniementdesarmes.535
En attendant, les tournois à grand spectacle prennent de l’envergure et passent en partie sous contrôle de la bourgeoisie. Ainsi avait lieu à Lille chaque année, lors du Carême, une fête très populaire avec bals, banquets et un grand tournoi, le béhourd, où s’affrontaient les bourgeois. Il s’agissaitdelacommémorationdupèlerinageduroietdelacouraucouventdesDominicainsetàla reliquedelasainteEpine.D’oùlenomdetournoidel’Epinette.Laprésidencedutournoiappartenait chaqueannéeàunrichebourgeoisquirecevaitunebranched’aubépineenfleursdesmainsduhéraut deLille:c’étaitle SiredejoieouRoidel’Epinette.OnsaitqueJean-Sans-Peurassistaen1410àce tournoihauten couleurs etqui nousrévèle,outre certaines évolutionssociologiques,unetendance à unretourpériodiquedescompétitions.
Maisvoiciqu’unpersonnagehistorique,plusvrai quenature,vientsoudainillustrer,incarnerun idéal chevaleresque qui commence déjà à être un anachronisme. C’est l’extraordinaire Bayard. Il traverse en sportif l’histoire et la légende. Il n’y a pas de fausse note. Il soutient jusqu’au bout un styledeviequinemanquepasd’allure.
Ce n’est pas du spectacle, il ne fait pas semblant. Le récit du Loyal Serviteur nous le montre d’abordtoutjeunets’endetterpouravoirledroitd’affronterMessireClaudedeVauldray,intouchable champion que le roi envoie en tournée de propagande. Un peu plus tard, à peine arrivé à Aire en Picardie, le bon chevalier fait crier un tournoi pour l’amour des dames où il y avait, dit-on, pour le mieux faisant un bracelet d’or et un beaudiamant pour donner à sadame. Ce goût de l’organisation nelequitterapas.AprèslaconquêteduduchédeMilan,ildresserauntournoienlavilledeCarignan, dontilemporterad’ailleursleprix.
533.JacquesHeers. Fêtes, jeux et joutes dans les sociétés d’Occident à la fin du Moyen-Âge.p.32-34. 534. Roman de Guillaume de Dôle 535.Jusserand.
Ilsemontretoutaussibrillantdanslaguerreet,s’illefaut,dansleduel.Courageuxetpointilleux surl’honneurtoutenétantforthumain,Bayardestunesortedemodèlederéférence,aupointdefaire rêverlesrois:Françoisveutêtrearméchevalierdesesmains.
Ce serait une erreur cependant de céder aux effets de perspective et de se laisser hypnotiser par cette imagerie d’Epinal, même si, en l’occurrence, elle est historique, commesi, denos jours, on ne retenaitdusportquel’extrêmepointedelapyramidesportive,l’imagequenousdonnentdusportles mass-médias.
Le sport médiéval comporte encore beaucoup d’autres choses dans le domaine des jeux traditionnels et il est bien dommage que l’ethnologie, le folklore et l’histoire se soient montrés si discretsjusqu’icidansleurapproche.
Il faudrait parler de la valeur exemplaire, à ce titre, de la lutte bretonne. C’est un jeu de princes, certes. Un seigneur tchèque, en 1466, défait le lutteur du prince à la cour bourguignonne. Et Henri VIII,aucampduDrapd’Or,semesureàFrançois Premier.C’estsurtoutunjeudupeuple.D’abord, il faut bien que les lutteurs à gages dont s’entourent les princes viennent de quelque part. Ensuite, toutvillageàsontournoietunmoutonenestlepremierprix.
On ne peut pas oublier non plus qu’en Irlande d’où nous vint la Renaissance Carolingienne, Alcuin et Scot Erigène, une tradition sportive était établie et conservée un peu sur le mode du roimagicien dont nous avons préalablement évoqué le statut dans la première partie de ce travail. Le grand roi Tara était une sorte de président des rois d’Erin dont il arbitrait les différends. Il lui appartenait aussi de présider les fêtes périodiques de Tara et surtout les Tailten Games. En 1007, la fête de Tailten est restaurée après une interruption de quatre-vingts ans. Mieux, lorsque le roi en personne revient, en 1166, célébrer les jeux de Tailten, le chroniqueur se fait l’écho d’un sentiment généralendisantquetoutl’ordreanciensemblerétabli.536
Etpuisonnepeutpasignorerlesjeuxdecrosseetdeballon.Enterrearrageoise,le Jeu de Robin et de Marion nousindiquelaferveuroùl’ontientlehockeyenmilieupopulaire.Ilnousrévèleaussi une hostilité franche et réciproque entre le chevalier qui ne peut se retenir de gifler Robin et les paysans qui ne se priveraient pas du plaisir d’enfourcher ledit chevalier si c’était possible. Il nous révèle encore que l’adhésion sportive s’effectue en fonction du milieu social: le chevalier revient d’un tournoi et Robin d’une partie de soule crossée dont le symbolisme pastoral n’est plus à démontrer.
Quant au ballon, Jacques Heers nous redit ce que confirment toutes les sources: « Les jeux de ballon, que l’on appelait la soule, offraient l’occasion de compétitions ardentes et brutales entre villages voisins ou clans rivaux, dans les campagnes françaises. »537
Ilresterait,avantdeclorecechapitre,àfairedeuxremarques.Lapremière,c’estquel’expression de sport médiéval prête à équivoque. On ne peut pas vraiment parler d’institution sportive, car il manque(1)leretouràintervallesréguliersdescompétitions,(2)unrèglementstableetuniverselpour chaque sport pratiqué, (3) une distinction nette entre mort réelle et mort symbolique, entre jeu et guerre.Mais,comptetenudetoutcequivientd’êtreexposé,onnepeutpasnonplusnierlaprésence d’uneactivitésportivepassionnéetantdanslepeuplequedanslanoblesse.
Laseconderemarque,c’estquelesjeuxdelanoblessesontbeaucoupmieuxconnusqueceuxdu peuple. Il faudrait que l’histoire s’interroge sur le choix de ses informations. Une préférence idéologiqueseprojettesurlepasséetsupposedefaçontout-à-faitarbitraireetcontestablequelesuns sont plus significatifs que les autres. Il n’est pas certain qu’une psychanalyse desjeux populairesne nousenapprennepasplusquel’inconscientcollectifetlemouvementdel’histoire.
536.EdmondCurtis. A History of Ireland.Methuen&CoLTD,191.p.8,21,25,29et46
537.JacquesHeers. Fêtes, jeux et joutes…p.113.
Descartes,Fénelon,Voltaire,LaMettrie,Rousseau,Hume.
Observation philosophique et sociale sur le sport, on serait évidemment loin du compte si l’on s’imaginaitqu’uneanalyseenrègleduphénomènesportifpouvaitavoirétéentrepriseenuneépoque où l’institution n’existait pas. C’est seulement par le biais d’études portant sur d’autres sujets et au hasarddesformulesqu’onpeutsepersuaderdelaprésenceréelledesjeuxetdessports.Entouscas, onestsûrdel’influencequ’ilsexercentsurl’imaginationdesgens,puisqu’ons’ensertpourillustrer defaçonimmédiatecequi,dansl’ordredeladémonstration,n’estpasimmédiatementévident.
Descartesparledusportaumoinsendeuxoccasions.
C’est d’abord au niveau de la philosophie morale. Il pose une question très moderne qui relève presquedecequ’onappelleaujourd’huidel’analyseinstitutionnelle.Pourquoileplaisirensefaisant mal? « La chasse, le jeu de paume et autres semblables… ne laissent pas d’être agréables, encore qu’ils soient fort pénibles ; et même on voit que souvent c’est la fatigue et la peine qui en augmentent le plaisir. »538
Laréponsequ’ilapportes’inscritdanslalignedeseshypothèsespsycho-physiologiques.C’estle plaisirdedevenirmaîtresetpossesseursdenotrenature: « Lacause ducontentementque l’âmereçoit en ses exercices consiste en ce qu’ils lui font remarquer la force, ou l’adresse, on quelque autre perfection du corps auquel elle est jointe. »539
C’estensuiteauniveaudesexplicationssavantessurladioptriqueetlanaturedelalumièrequ’il rencontre le sport et, plus particulièrement le jeu de paume, à titre de modèle analogique. « Il fut remarqué que la balle, outre son mouvement simple et ordinaire, qui la porte d’un lieu en l’autre, en peut encore avoir un deuxième, qui le fait tourner autour de son centre, et que la vitesse de celui-ci peut avoir plusieurs diverses proportions avec celle de l’autre. »540 Mouvement aléatoire et spin du photon,Descartespoursuitsacomparaisonsportive: « Ce que ceux qui jouent à la paume éprouvent assez, lorsque leur balle rencontre de faux carreaux, ou bien qu’ils le touchent en biaisant de leur raquette, ce qu’ils nomment, ce qui me semble, couper ou friser. » 541
Fénelon,demême,abordelesquestionssportivesaumoinspardeuxfois. La première fois, c’est en moraliste, et le duel, survivance mondaine des joutes médiévales, lui fournitunbonexemplepourmontrerqu’intentionn’estpasraisonetqu’uneaxiologien’estrecevable qu’appuyéesurunebonnethéoriedelaconnaissance: « Combien voyons-nous de maximes qui ont été établies contre l’impression des sens par la force de la coutume ? Par exemple, celle du duel, fondée sur une fausse règle de l’honneur. Ce n’était point en raisonnant, mais en supposant raisonner la maxime établie sur le point d’honneur, qu’on exposait sa vie et que tout homme d’épée vivait dans un péril continuel. Celui qui n’avait aucunequerelle pouvait enavoir à toute heure avecdes gens qui cherchaient des prétextespour sesignalerdans quelque combat. Quelque modéré qu’on fût, on ne pouvait, sans perdre le faux honneur, ni éviter une querelle par un éclaircissement, ni refuser d’être second du premier venu qui souhaitait se battre. Quelle autorité n’a-t-il pas fallu pour déraciner une coutume si barbare ! »542
538.Descartes. Lettre à Elisabeth.Egmond,le6octobre1645
539.Descartes. Lettre à Élisabeth.Egmond,le6octobre1645
540.Descartes. Dioptrique.DiscoursPremier.
541. Ibid
542.Fénelon. L’éducation des filles.ChapitreVII.
Lasecondefois,c’estenpédagogueprincier,dans unenarrationfabuleuseoùil imiteHomèreet Virgiledansleurprescriptiondesjeux.
C’estd’abordlalutte:
« Nous nous saisîmes l’un l’autre ; nous nous serrâmes à perdre la respiration. Nous étions épaule contre épaule, pied contre pied, tous les nerfs tendus, et les bras entrelacés comme des serpents, chacun s’efforçant d’enlever de terre son ennemi. Tantôt il essayait de me surprendre en me poussant du côté droit ; tantôt il s’efforçait de me pencher du côté gauche. Pendant qu’il me tâtait ainsi, je le poussai avec tant de violence que ses reins plièrent : il tomba sur l’arène, et m’entraîna sur lui. En vain il tâcha de me mettre dessous ; je le tins immobile sous moi.»543
C’estensuitelecombatdeceste:
« D’abord il me donna dans la tête, et puis dans l’estomac, des coups qui me firent vomir le sang et qui répandirent sur mes yeux un épais nuage. Je chancelai ; il me pressait, et je ne pouvais plus respirer… J’évitai plusieurs coups dont j’aurais été accablé. Aussitôt que le Samien m’avait porté un faux coup et que son bras s’allongeait en vain, je le surprenais dans cette posture penchée : déjà il reculait, quand je haussai mon ceste pour tomber sur lui avec plus de force : il voulut esquiver, et, perdant l’équilibre, il me donna le moyen de le renverser. »544
C’estenfinlacoursedechars:
« Il craignait que je ne passasse entre la borne et lui ; car mes chevaux, mieux ménagés que les siens, étaient en état de le devancer : il ne lui restait plus d’autre ressource que de me fermer le passage. Pour y réussir, il hasarda de se briser contre la borne ; il y brisa effectivement sa roue. Je ne songeai qu’à faire promptement le tour pour ne pas être engagé dans son désordre.»545
Maisilnefaudraitpasoublierque,danslecontexte,cesépreuvessontdestinéesàdésignerunroi et qu’elles sont suivies d’autres, intellectuelles cette fois, des énigmes qui, historiquement, sont effectivement dans les sociétés primitives, l’équivalent de nos problèmes analytiques actuels et qui doivent faire la preuve de la sagacité d’esprit du candidat. Autrement dit, on voit bien le message politiquequeFénelonentendfairepasseretlesqualitésqu’ilsembleexigerd’unroi.Onsaitd’ailleurs qu’ileutàsouffrirpolitiquementd’avoirécritle Télémaque.Maisilabeausedéfendre.Leprécepteur du duc deBourgogne avait quand même desidées précises surle gouvernement de laFrance et il le prouvera d’ailleurs, de même qu’il avait des amis qui le poussaient politiquement comme Mme de Beauvilliers,filledeColbert,àl’origineprobablementdel’Éducation des Filles
Si bien que nous voyons le sport, lié à la psychophysiologie et à la physique avec Descartes, apparaîtreliéàlamoraleetàlapolitiqueavecFénelon.
Mais Voltaire lui donne encore la dimension de l’histoire. « Il s’est fait des révolutions dans les plaisirs comme dans tout le reste. »546 Lestournoissontcomparésauxjeux,grecsetromains: « Les tournois, si longtemps célèbres dans l’Europe chrétienne, et si souvent anathématisés, étaient des jeux plus nobles que la lutte, le disque et la course des Grecs, et bien moins barbares que les combats des gladiateurs chez les romains. »547
Humesouligneaupassagelabasejuridiqueinhérenteàtoutemanifestationsportive: « Même ce genre sportif de guerre que pratiquent les lutteurs, les boxeurs, les escrimeurs au bâton et les gladiateurs, est réglé par des principes fixes. »548 Ilyadesrègles.
Rousseausefaitl’échod’unecomparaisonrapportéeparCicérondansles Tusculanes,tripartition de la fête sportive et analogie avec le monde et son spectacle : « Le spectacle du monde, disait Pythagore, ressemble à celui des jeux olympiques ; les uns y tiennent boutique et ne songent qu’à leur profit ; les autres y payent de leur personne et cherchent la gloire ; d’autres se contentent de voir les jeux, et ceux-ci ne sont pas les pires »549
543.Fénelon. Aventures de Télémaque.LivreV.
544. Ibid.
545. Ibid
546.Voltaire. Essai sur les mœurs.Ch.XCIX.Destournois.
547. Ibid
548.Hume. Enquête sur les principes de la morale
549.Rousseau. Emile.LivreIV.
Rousseau, c’est le sport féminin qui trouve occasion d’affirmer timidement ses droits à une époqueoùlesjeuxpopulairestraditionnelssontuneaffaireexclusivementmasculine;Sophieoblige Emileàs’employerpourlarattraperàlacourse: « Elle prend les devants avec une telle rapidité que, pour atteindre cette nouvelle Atalante, il n’a que le temps qu’il faut quand il l’aperçoit si loin devant lui. »550
Rousseau souhaite une éducation sportive la plus complète possible: « Emile sera dans l’eau comme sur la terre. Que ne peut-il vivre dans tous les éléments ? Si on pouvait apprendre à voler dans les airs, j’en ferais un aigle ; j’en ferais une salamandre, si l’on pouvait s’endurcir au feu. »551
L’engagement physique est valorisé: « On joue toujours lâchement aux jeux où l’on peut être maladroit sans risque : un volant qui tombe ne fait de mal à personne ; mais rien ne dégourdit le bras que d’avoir à protéger la tête. »552
Mais il faut prendre garde à proportionner le matériau utilisé au niveau technique acquis par le pratiquant: « Je n’entends pas qu’il aille peloter dans nos tripots, ni qu’on charge sa petite main d’une raquette de paumier ; mais qu’il joue dans une salle dont on aura garanti les fenêtres ; qu’il ne se serve d’abord que de balles molles ; que ses premières raquettes soient de bois, puis de parchemin, et enfin de corde à boyau bandée, à proportion de son progrès. »553
Préoccupation de pédagogue, sans doute, et fort louable assurément. Mais il en faut comprendre laportéehistoriquedansl’évolutiondesidéessportives.Lesjeuxpopulairestraditionnelsignoraient l’enfant comme ils ignoraient la femme. Cérémonies religieuses dégradées, elles étaient réservées aux hommes, aux initiés, aux adultes. Approchant le sport par une autre voie, celle de l’éducation, Rousseau renverse la perspective. Il est le premier àcentrerle sportsur l’enfant ets’étonnerde voir l’adultes’attardersuruneactivitéinfantile: « S’élancer d’un bout de la salle à l’autre, juger le bond d’une balle encore en l’air, la renvoyer d’une main forte et sûre ; de tels jeux conviennent moins à l’homme qu’ils ne servent à le former. »554
Onnesauraittropinsistersurcetteprisedeposition.Ellelielesportàl’éducation,doncàl’enfant. Toutunpanidéologiquedumondesportifvaadoptercepointdevue.Ildeviendrasifortqu’iltendra à exclure les autres aspects de la réalité sportive. La philosophie du sport se fait philosophie de l’éducation.Ellen’aurapasunseulinstantàl’espritqu’ellepourraitêtreaussibienetpeut-êtremieux philosophiedelaculture.Elleseveutmorale.Elle nesepensepashistoriquement.
D’une manière générale d’ailleurs, les Encyclopédistes ont tendance à penser utile et ne comprennentpaslesjeuxtraditionnels.C’estévidentavecla Mettrie quiparlede « cesfaiblesroseaux de la théologie, de la métaphysique et des écoles, armes puériles, semblables aux fleurets de nos salles, qui peuvent bien donner le plaisir, mais jamais entamer son adversaire »555
550.Rousseau. Emile.LivreV. 551.Rousseau. Emile.LivreII 552. Ibid.
553.Rousseau. Emile.LivreII 554.Rousseau. Emile.Livre 555.LaMettrie. L’homme-machine
Shakespeare,Ronsard,VictorHugo,Mérimée,Hemingwayetbien d’autres.
En revanche, c’est plutôt la spontanéité du jeu populaire qui est saisie par la littérature, moins volontariste en général dans son appréciation du phénomène sportif quand elle le décrit dans le contextedelaculture.
Shakespeare nous apporte nombre d’informations intéressantes sur les jeux traditionnels, leur prestigeauprèsdespopulations,leursuccèsauprèsdesprinces.
IInousparledujeudepaume,desatechnologie,lorsquenousprésentantunBénédictamoureux, ilfaitdiredeluiqu’ils’estfaitraserpourparaîtrejeuneque « l’antique ornement de sa joue est déjà allé rembourrer les balles du jeu de paume. »556
Ilnousparledelasoule, ennousdécrivanttantôt unesclaveballotté entre deuxmaîtresetquise plaint d’être traité en « foot-ball »557 , tantôt un intendant qui se fait traiter de « médiocre joueur de foot-ball. »558
Il nous parle encore de la lutte. Le pittoresque Monsieur Charles est un lutteur à gages dans les Ardennes.CelanousrenseignedéjàsurlaprofessionetsurlarenomméedeslutteursenFrance.Mais c’estpresqueuntueuràgages,carladémonstrationsportiveestfacilementmiseàprofitpourprocéder àunrèglementdecomptepolitique.Celanousrenseignesurlesmœurs.Entouscas,leprofessionnel accepte la basse besogne: « S’il vient demain, je lui donnerai son compte. Si jamais après cela il, peut marcher seul, je renonce à jamais lutter pour le prix. »559
Notre champion garde du corps a d’ailleurs tout du personnage dissuasif. En moins de quelques instants,ilaréduittroisadversairesàunétatpeuenviable: « L’aîné des trois a lutté avec Charles, le lutteur du duc, lequel Charles l’a renversé en un moment et lui a brisé trois côtes, si bien qu’il y a peu d’espoir de le sauver. Le second a été traité de même, et de même le troisième. Ils sont là-bas gisants. »560
Mais tout est bien qui finit bien, la présumée victime du complot va triompher du supposé bourreauets’acharnersurlui,cequidonnelieuàunbrefdialoguedanslestyledel’humournoir.Le duc Frédéric veut sauver son lutteur et crie: Assez! Assez! Orlande, au contraire, en redemande: Encore! J’adjure Votre Grâce. Je ne suis même pas en haleine. Penché sur son garde du corps estourbi,leducinterroge:Commentes-tu,Charles?Unvoisinfaitremarquer:Ilnepeutpasparler, monseigneur.561
Shakespeare nous parle enfin de l’escrime. La mode en est assez répandue en France pour qu’il nouscampeunmédecinfrançaisgrotesque,zézayant,toujoursprêtaudueletdontons’accordeàdire qu’ilyacertaintalent: « I have heard the Frenchman hath good skill in his rapier. »562
Mais l’escrime, c’est surtout cette étrange scène finale d’Hamlet. Le roi amène Laerte à jouter contreHamlet.Illeflatte : « Les escrimeurs de sa nation (française) n’avaient plus ni mouvement, ni
556.Shakespeare. Beaucoup de bruit pour rien.ActeIII.ScèneII.
557.Shakespeare. Comédie des Erreurs.ActeII.Scène1.
558.Shakespeare. Le Roi Lear.ActeI.Scène4.
559.Shakespeare. Comme il vous plaira.ActeI.Scène1.
560.Shakespeare. Comme il vous plaira.ActeI.Scène2
561.Shakespeare. Comme il vous plaira.ActeI.Scène2
562.Shakespeare. Les Joyeuses commères de Windsor.ActeII.Scène1.
garde, ni œil, dès que vous combattiez contre eux. »563 Illerassure: « Il n’examinera pas les fleurets, en sorte qu’il vous sera aisé, avec un peu d’adresse, de choisir une épée non émoussée. »564 Il l’excite: « … par une botte fine de lui rendre le coup qu’il a porté à votre père. »565 Etceseraensuite lemassacrequel’onsait.566
Onnoteraque,dansle casdel’escrimecommeprécédemmentdanslecasdelalutte,lesportest encorebienprèsdelaguerre,durèglementdecompteetdelapolitique.
Sport et littérature, il convient d’évoquer, biensûr, letémoignagede Ronsard, Ronsardqui a été un fervent de la pratique sportive. Il a voulu aussi lui rendre ses lettres de noblesse. C’est lui qui consacre tout un poème aux jeux olympiques et à la poésie de Pindare et, à défaut d’inspiration véritable,onpardonneracettelacuneeuégardàl’intention:
« Là s’amoncelait la jeunesse
Des plus belliqueux de la Grèce,
Studieuse à ravir l’honneur
De l’étrange feuille honorée
Que de la terre Hyperborée
Apporta le Thébain veneur ? »567
Comment ne pas penser à Molière aussi qui nousprésente une parodie de l’escrime académique et mercantile de professeurs sans génie? C’est la fameuse querelle du maître d’armes, du maître à danseretdumaîtreàchanter.568 C’estlabatailleàcoupdepoingscontrelemaîtredephilosophie 569 C’est Monsieur Jourdain touché par Nicole sa servante… parce qu’elle n’a pas eu la patience qu’il parte! 570
Maisilyauraittantd’auteursà citer!Keats parle deLamia,serpentqui s’éprendd’un athlèteet se métamorphose en femme. Elle ne surprend pas la vigilance du philosophe et meurt. A travers ce récitinspirédelavied’Appolonius,l’histoiresepassejustementàCorinthe,onretrouvecurieusement tous les symbolismes qui accompagnent la régression du pouvoir féminin, du moins des divinités féminines,danslesmythesdefondationdesgrandsjeuxdelaGrèce.571 VictorHugodécritunsauvage combatdeboxeoù,departetd’autre,onsedémolitdeboncœur.572 Mériméemènelejeudepaume et le fantastique573, Louis Hémon la boxe, le nationalisme exacerbé et l’anglophobie.574 Charles Deulin évoque le jeu de crosse dans un de ses contes populaires du Hainaut.575 René Bazin, entreprenant une analyse sociale des milieux populaires roubaisiens et de leur passion pour le tir à l’arc,réaliseundesbest-sellersdesonépoque.576 Ilyenademoinscélèbresquitententdeliersportetlittérature.577 Maisbeaucoupsontparmiles plusgrands.OnpenseàMontherlant.578 OnpenseàGiraudoux579.OnpenseàHemingway. 580 Aplus prèsdenousSillitoe581
563.Shakespeare. Hamlet.ActeIV.Scène2. 564. Ibid.
565. Ibid
566.Shakespeare. Hamlet.ActeV.Scène2. 567.Ronsard. Les Jeux olympiques et la poésie de Pindare. 568.Molière. Le Bourgeois Gentilhomme.ActeII.Scène3. 569.Molière. Le Bourgeois Gentilhomme.ActeII.Scène4. 570.Molière. Le Bourgeois Gentilhomme.ActeIII.Scène3. 571.Keats. Lamia.Poèmeécriten1819. 572.VictorHugo. L’homme qui rit 573.Mérimée. La Vénus d’Ille.
574.LouisHémon. Battling Malone 575.CharlesDeulin. Contes du roi Cambrinus 576.RenéBazin. Le roi des archers.
577.CharlesdeSaint-Cyr. Jean Piquet, homme de sport. 1920. 578.Montherlant. Les Olympiques
579.Giraudoux. Le sport
580. Cf. DanielBoulay. La philosophie du divertissement et de la violence rituelle chez Hemingway. Lille1972.p.165. 581.Sillitoe. La solitude du coureur de fond
DanslasecondemoitiéduXIX°siècle,onassisteàunbrusquedéveloppementdusportdanstous lespays.Desclubssecréentpartoutets’organisentàl’échellenationale,puisinternationale.Ilfallait desrèglescommunes.Celas’effectuedansuncontexteoùapparaissentlesmonopolesinternationaux. On reproduit, dans un autre système socio-économique, les conditions qui avaient permis au sport grec de s’institutionnaliser, circulation entre centres ayant les mêmes lois, parlant le même langage technique,c’est-à-direpossédantlamêmeculture.
Mais il faut bien se rendre compte que ce développement se produit au confluent de courants provenantdedeuxsourcesdistinctesdontlecontextesocio-économiquenefaitqu’amplifierledébit. Il y a la rencontre et l’interférence de deux lignes indépendantes jusque-là, celle qui trouve son inspiration dans les jeux populaires traditionnels eux-mêmes issus de cérémonies religieuses dégradées, celle ensuite qui se préoccupe d’éducation morale etpolitique, qui veut régénérer larace et qui réinvente l’olympisme. Cela va donner lieu à toute une série de malentendus que le sport modernen’apasencoreéclaircis,élucidés,àdescontradictionsqu’iln’apasencoresurmontées.
Les débats sur les rapports de l’école et du club en sont un bon exemple. L’école qui connaît l’enfantamis dutempspourdécouvrirl’éducation physique,puislesport comme moyen d’éduquer. Les jeux populaires, de leur côté, qui, pour les besoins de l’apprentissage technique du futur champion, admettent la présence de l’enfant parmi des adultes. Il en va de même pour la femme normalement exclue des sociétés masculines que sont les jeux traditionnels. Origines différentes, objectifs différents, le sport à l’école et le sport dit civil, intervenant l’un comme moyen et l’autre comme fin, ont longtemps tendu à s’ignorer. L’un arrive au sport par l’enfant, l’autre à l’enfant par lesport.Ilssontmaintenantencontactet,parconséquent,enconflit.
Unautreexempletiendraitàlanaturedel’autorité danslesportetaupartagedespouvoirs.Tout le vocabulaire actuellement en usage dans le sport civil ou associatif montre bien qu’à l’origine initiative et autorité viennent d’en bas. Les clubs sont des associations de joueursqui se gèrent euxmêmes.Ilsseregroupentenliguesquielles-mêmessefédèrent.L’autoritémontantenefaitquesuivre la logique de la compétition et chaque sport constitue une pyramide. Mais, avec le temps, la centralisationfédérale,renforcéeparleprocessusd’habilitation,atransforméleschémaprimitif.Les objectifs des fédérations, des ligues et des clubs tendent à se rejoindre, la décision se fait lointaine, l’informationcirculemal.Laloide1901est-ellecompatibleaveclaloide1975?Alalimite,onpeut prévoirunecassureentreunsportd’enhautrecevantsubsidesetconsignesdel’Etatetunsportd’en baslaisséàlui-même,performanced’uncôtéetrécréologiedel’autre.
Autre exemple encore, la ligne éducative se devait d’être omnisport puisque souhaitant le développement harmonieux et total de la personnalité. Elle se devait aussi d’être opposée au professionnalisme, d’abord pour la noble raison qu’il n’était pas éducatif de payer celui qui jouait, ensuitepourlaraisonmoinsnoblequelessportspayésétaientdeniveaupopulaire.Malheureusement lalogiqueconduitgénéralementlesgenslàoùprécisémentilsrefusentobstinémentd’aller.LesJeux olympiques issus du courant éducatif et moralisant ont rencontré la compétition acharnée, le nationalisme,l’argent,lespectacleet,prisentrelafidélitéauxprincipesetl’acceptationréalistedela modernité,ilsn’ontjamaispusurmonterlacontradiction.
Il reste à monter comment on en arrive à cette situation, aux ambiguïtés qu’elle comporte, aux blocagesqu’ellesuscite.Dialectiquedelafinsportiveetdumoyenéducatif,del’adulteetdel’enfant,
dialectiquedupeupleetdel’Etat,phénomèneaussidemicro-socialisationsurunevieillebaserituelle à structure mythique, tout n’a pas encore été dit ni sur la psychanalyse de l’institution, ni sur la philosophiepolitiquequ’elleappelle.
Sommes-noussûrsseulementdenosconcepts?Tantd’organismessedisentàlafoisolympiques et sportifs. Si cela désigne une même réalité, pourquoi deux mots? Et si la réalité exige une double dénomination,oùestaujusteladifférenceentrelesdeuxmots?
Mais l’histoire du sport n’est pas finie. Nous en faisons nous-mêmes partie. Et, en écrivant ces lignes, en contribuant àlancer un débat qui vise à éclaircir les enjeux et les donnéesd’un problème, nous y prenons position, une position qui n’est pas neutre et académique, mais, comme, nous le remarquions dans l’introduction, une position engagée. Nous sommes situés. Nous sommes partie prenante.
Cetteseptièmepartien’auraqu’unseulchapitre:
Chapitre24. L’idée sportive et l’idée olympique coïncident-elles ?
L’idéesportiveetl’idéeolympiquecoïncident-elles?
Lepartagedespouvoirsdanslesport.
Au début du XIX° siècle, on peut en juger par exemple à travers les statistiques de Dieudonné, les jeux populaires traditionnels jouissent d’une vitalité certaine, encore que regardés avec quelque condescendance par le pouvoir. L’éventail est large dans le Nord: « Les jeux les plus usités à la campagne parmi les jeunes gens et les hommes faits, sont ceux de balle, de quilles et de billon, le tir au blanc avec l’arc, l’arbalète et l’arme à feu, le tir à l’oiseau. »582 Ils donnent lieu à des compétitions,destournoisoùl’onsedéplaceàtourderôle,avecprixetrécompenses: « Desconcours et des luttes s’ouvrent de commune à commune durant la belle saison ; des effets d’argent, des mouchoirs, quelques hectolitres de bière sont proposés pour prix ; les jeunes gens des communes voisines viennent les disputer, et reçoivent à leur tour, leurs rivaux un autre dimanche. »583
Touteunevie populaire yestattachéeavecseslois,sestraditions,sesjoies.C’estvraipourletir àl’arc : « Le roi de l’oiseau, c’est ainsi qu’on désigne celui qui a jeté bas l’oiseau, est décoré par ses concurrents d’un oiseau d’argent suspendu à un ruban… Il est conduit au cabaret au son du tambour et du fifre… Souvent les champions reprennent l’arc pour aller tirer, non plus à la perche, mais au but, et décider qui d’entre eux sera le roi du plaisir, seconde dignité créée pour ajouter à la fête »584
Maisc’estvraiencorepourlejeudeballe,trèsvraisemblablementlacrosse. « Avantlarévolution, le prix du jeu de balle était, dans beaucoup de lieux, une balle d’argent 585 . Souventlevainqueurétait conduit en triomphe au temple où il suspendait le prix de son adresse comme un monument de sa piété.Ils’esttrouvébeaucoupdecesballesparmi lesargenteriesdeséglisesavantlarévolution.»586 Il n’en demeure pas moins que cesdivertissements populaires tournent à la passion etque le jeu s’impose parfois au détriment du travail. Dieudonné laisse entendre sa réprobation discrète: « Il est un jeu commun aux deux sexes, dans les villes, et vers lequel toutes les classes de citoyens paraissent portées avec passion, c’est le jeu de volant. Dès que premiers froids ont cessé et que les jours commencent à grandir, on reprend la raquette. Pendant deux ou trois jours de repos, ce divertissement est général ; pas une seule rue, dans les villes, qui ne soit remplie de joueurs qui y déploient une grande adresse. Ce jeu auquel le sexe excelle, donne occasion de remarquer combien les jeunes personnes, dans les villes, sont peu assidues au travail ; car il est peu d’heures dans la journée où l’on n’en voie, de la classe ouvrière surtout, se livrer à cet exercice, mais principalement après le dîner et le soir. »587
Parrapport àcetteviesportivelocalesousla forme dejeuxpopulaires traditionnels, l’apparition dusportmodernesecaractériseraàlafoisparlaruptureetlacontinuité.
Rupturecarl’universalismedesrègless’opposeauxcoutumeslocalesdiverses,cequicorrespond à une transformation de la société; les grandes fédérations sportives sont les contemporaines des monopolesinternationaux. « Le mouvement sportif ne se développe pas isolément de la vie sociale et culturelle de la société, il lui est étroitement lié et, dans une certaine mesure, il se définit et se détermine par les caractéristiques générales du développement de la société… Dans les années 60-
582.Dieudonné. Statistiques du Département du Nord.Tome1.Douai.AnVII,1804.p.82. 583. Ibid.
584.Dieudonné. op. cit.p.82-83; 585.Uneballed’environdeuxcentimètresdediamètre.
586.Dieudonné, op. cit.p.83.
587.Dieudonné, op. cit.p.84.
80 du XIXe siècle étaient apparues les causes objectives de la création d’unions sportives internationales. »588
Etpourtantcontinuitécarcesontlesjeuxtraditionnelsquifournissentlesbases,lesschémas,les modèles dont s’inspirent les sports nouveaux. Le tennis modernise la paume. Le football adapte la soule.Legolfcodifielacrosse.
Le passage est donc moins brutal qu’on pourrait l’imaginer rétrospectivement. C’est une longue évolution.En1719,lepremiertitredusportmoderneestattribué,dansledomainedelaboxe,àJames Figg.En1754,leclubdeSaintAndrewsréglementelejeudegolfetconserveradéfinitivementcette prérogative.Lecricketestcodifiéàsontouren1774.Descompétionsdenatationsontorganiséesau Japon en 1810 et à Londres en 1837. Le base-ball s’organise en 1840 et le problème difficile des règles du foot-ball est clairement posé en 1858, annonçant la rupture entre l’association et le rugby. La colombophile se donne immédiatement une structure compétitive en 1849. C’est un mouvement d’abord lent, mais irrésistible. Il s’exprime aussi bien en Europe qu’en Amérique et au Japon. Il se manifestedanstouteslesdimensionsdusport.
Parallèlement,il existecependantunautrecourantquisedéveloppeavecautantdedifficultésau départ et autant de vigueur et d’impétuosité par la suite. C’est celui qui combine projet éducatif et nationalismeetquiaboutitàl’olympismemoderne.Ilcontrastefortementavecleprécédent.Ils’agit moins de s’engager dans le sens de la modernité sportive populaire que de retrouver une ancienne pureté,desvaleursperduesououbliées,desauverouderégénérerlarace.
En Allemagne, c’est parfaitement net. Lorsque Ludwig Jahn fonde le Turnplatz, il insiste sur quatre dates: 9, l’arrêt de la civilisation romaine par Arminius; 919, la date du premier tournoi supposédansleSaintEmpire;1519,datedupremiertournoiorganisé;1811,créationduTurnplatz. Lemouvements’attribue undestinpolitique.Il fautdirequelaFrancenapoléoniennearéveillé tous les nationalismes. En tous cas, en 1819, Sand, un disciple de Jahn, assassine Kotzebue. LesTurners seront interdits. Mais on y reviendra en 1842, et, surtout, grâce à Bismarck, à partir de 1860. Évidemment, il y a quelque chose de militaire et d’étatique dans cette conception du sport et c’est sans doute à cela que pense Dubeel lorsqu’il écrit: « Le sport naquit au moment où l’être humain entier, tête,corps, âme, vie etpensée, fut recruté au servicede l’idéeforcenée denation moderne. »589
En Angleterre, si l’on en croit Giraudoux, le nationalisme avait déjà trouvé le sport comme un bon moyen d’éducation morale et civique. « A la fin du XVIIe siècle, la race anglaise était compromise. L’alcoolisme et ses sous-produits rongeaient la nation. La taille des Anglais rapetissait. Il était fréquent que les hommes d’Etat ne pussent achever leurs discours à la tribune, arrêtés par des crises. C’est à ce moment que l’île se donna aux sports et se régénéra. »590
Ilestcertainquede1828à1842,ThomasArnold,directeurduCollègedeRugby,façonnal’image de l’esprit sportif en Angleterre. Il est certain aussi qu’à la suite d’une crise de la jeunesse aux lendemains de Waterloo, Kingsley, chanoine anglican, fonda son association des Musclars Christians. Il est certain surtout que cette représentation édifiante d’une Angleterre sportive, éducative,morale,nationaleetdesurcroîtaristocratique,vaservirdemodèlederéférence,desupport idéologiqueàtouteuneconceptiondusport,delasociété,delavie.
D’abord, anglophilie et anglophobie vont s’y donner à cœur joie. Beaucoup sont favorables et projettenttoutl’idéaldel’autrecôtédelaManchepourfairemieuxressortirnotreindigniténationale française. Garcet de Vauresmont compare l’attitude du capitaine d’équipe de part et d’autre du Channel. En Angleterre? « En Angleterre, où le capitaine est aussi maître sur le terrain que charbonnier chez soi ou que l’amiral sur son vaisseau, aucun équipier, en eût-il la pensée, ne se risquerait à de semblables incartades. On le prierait, séance tenante, d’aller porter ailleurs ses appréciations, ses bavardages et sa science. »591 EnFrance? « En France, le capitaine, bon garçon et bon camarade, prend à part le récalcitrant ou la mauvaise tête, lui adresse de paternelles
588. Organisation de la culture physique en URSS.Moscou.1961.p.210-1.(enrusse)
589.Dubech. Où va le sport ? p.41.
590.Giraudoux. Le sport.1928.p.24.
591.GarcetdeVauresmont. Les sports athlétiques.1912.p.41.
observations, le calme, le flatte, ou bien ne dit rien du tout et laisse passer l’orage. »592 Conclusion? « Des deux capitaines, c’est évidemment l’Anglais qui a la vraie conception de son rôle. Bon garçon, soit, mais en dehors du service. Sur le terrain, tout le monde obéit. »593
Enrevanche,d’autressecomplaisentàrenverserl’imagedemarque,l’idéereçue.LouisHémon, l’auteur de Maria Chapdelaine, campe des personnages avec une partialité évidente. « L’Anglais, avec son torse puissamment musclé, son masque qui restait patient et dur sous les coups, et ce Français aux lignes trop harmonieuses, qui apportait au combat une figure radieuse d’enfant qui joue. »594 Dubech accuse les Anglo-Saxons d’avoir introduit l’argent dans le sport: « De quoi les Américains ne tireraient-ils pas un commerce ? L’Angleterre du XIXe siècle avait payé chichement quelques professionnels, l’Amérique paye grassement les amateurs. »595 EtVoivenel,faisantallusion au fameux match nul réussi le 22 février 1922 à Twickenham, épanche son amertume: « L’allure "gentleman" est une belle vitrine qui ne correspond pas forcément à la qualité de la marchandise en magasin. »596
Malgré tout, le modèle anglais avait exercé assez de séduction pour que la pensée éducative et nationaleytrouvesoninspirationetaboutisseàlacréationdesjeuxolympiquesmodernes.
On connaît le contexte de cette création. C’est en 1887 que sont publiés les résultats de l’expédition allemande effectuant des fouilles à Olympie, nouvelle impulsion donnée à l’éducation sportiveetàsavolontédeconsécrationinternationale:voilàleslettresdenoblessedel’histoireetde la culture, l’accès du sport à l’école. Un Congrès est organisé à Paris en 1894. Les Jeux ont lieu à Athènesen1896.
LenomdeCoubertinestliéàcetteréalisationqu’ilamarquéedesavolontéetdesonobstination. Si bienquesagloireestaujourd’huiàla mesuredel’incompréhensiondontseseffortsfurent l’objet à l’époque. Si bien que Coubertin, de nos jours, symbolise le sport comme Bayard la chevalerie et Socratelasagesse.Dubechécrit: « C’est grâce à son initiative, à sa persévérance et à sa valeur qu’il rénova les Jeux Olympiques à l’usage et à l’image du monde moderne. Les premiers eurent lieu à Athènes en 1896. Date significative : c’est en 1895 que l’athlétisme américain a détrôné l’athlétisme britannique.Au moment où un peuple neuf imposeson orgueil, saforceet son goût primitif durésultat immédiat, un Français vient proposer une idéologie généreuse … Sa grande idée était que les nations se méconnaissent parce qu’elles ne se rencontrent pas. »597
Loin de nous l’idée de contester courage, noblesse de sentiment, hauteur d’âme, ténacité, opportunitéchezcethommed’exception.Coubertinesttoutcelaàlafoisetc’estdéjàbeaucouppour unseulhomme.Maishistoriquement,c’estquandmêmefortsimplifierleschosesquedeleprésenter sous cette forme hagiographique. Il y aurait au moins deux réserves à faire. La première, c’est que Coubertin se situe aux origines del’olympismemoderne, cequi est loin designifieraux origines du sport moderne. Il représente la tendance éducative, donc omnisport. La seconde réserve, c’est que Coubertin exprime tout un climat et que son action individuelle s’inscrit dans un contexte favorable quiagitdanslemêmesens.
Insistons sur la première réserve. Coubertin a trouvé un sport qui existait déjà et qui, de toute façon,sedéveloppaitsanslui.Lefoot-ball,lerugby,biend’autresdisciplinessportivesneluidoivent strictement rien. Coubertin, en revanche, a contribué à orienter l’image du sport dans une opinion publique en centrant le sport sur l’athlétisme et l’athlétisme sur la course. La remarque a été faite: « Pierre de Coubertin, en rénovant les jeux olympiques… fit de la course à pied, plus encore que des sauts et des lancers, le grand sport universel. »598
Insistonsaussisurlaseconderéserve.Toutunclimat,desconditionsobjectivesdudéveloppement du sport, l’ouvrage soviétique précédemment cité y insiste: « Les historiens bourgeois considèrent
592. Ibid
593. Ibid.
594.LouisHémon. Battling Malone.Brest1880/Ontario1913.
595.Dubech. Où va le sport ? p.144.
596.Voivenel. Mon beau Rugby.p.259. 597.Dubech. Où va le sport ? p.69.
598.Gardien,Houvion,Prost,Thomas. L’athlétisme.Quesais-je?1972.p.7.
comme fondateur du comité olympiqueinternational le pédagogue Pierre de Coubertin, lui attribuant seul l’apparition des jeux olympiques à notre époque. Sans diminuer les mérites de Pierre de Coubertin, il convient de souligner que, pour expliquer l’apparition des jeux olympiques et la création du comité olympique international, il y avait des conditions objectives. Le mérite de Pierre de Coubertin consiste à avoir été le premier à comprendre la nécessité d’organiser des compétitions d’une aussi large envergure internationale et d’en avoir posé la question devant un gouvernement. »599
En fait, la Grèce n’avait attendu personne et, dès l’indépendance recouvrée, avait proposé, en 1829, une restauration des jeux olympiques que, faute de moyens, elle ne pourra réaliser que trente ansplustard.Mais,en1859,1870,1875,1889,desjeuxolympiquesgrecsmoderneseurentlieu.
Parailleurs,lasubstitutiondumodèlegrecaumodèleanglaisavaitledoubleavantagededégager lesFrançais dusoupçond’imitationserviled’unpeuplevoisin etplusencoredemettrelemodèlede référence à l’abri de toute surprise désagréable, le passé ayant sur le présent cette supériorité de ne pas pouvoir changer. Daryl écrit: « Que s’il nous faut absolument des modèles, nous pouvons les trouver dans l’Antiquité, plus nobles, plus sûrs, plus impeccables qu’au-delà de la Manche. »600 Et, plusloin,toutàlafindesonlivre: « Jeux olympiques : le mot est dit. Ilfaudrait avoir les nôtres ! »601
Maisya-t-iljamaiseudeparadisterrestredusport?Certainsfontsemblantdelecroireetparlent de l’idéal du développement de la personnalité. Ainsi le futur Cardinal Baudrillart. « Il est peu vraisemblable que tous les maîtres et tous les élèves eussent assez de bon sens et de modestie pour ne pas sacrifier plus qu’il ne convenait au désir de remporter la victoire, et partant, de favoriser les spécialités. L’ordonnancedes concours cependant encourageait plutôt le développement harmonieux de tous les organes et de toutes les facultés physiques, puisque le plus important, celui dont la palme était la plus enviée était le pentathle... »602
D’autressefontplusironiquesetJoycenesefaitpasfautederailleravechumourceuxqui,dans uncontexte irlandais,suiventlamêmedémarchederestaurationdesjeuxanciens: « Une discussion des plus intéressantes eut lieu … au sujet de la renaissance des anciens sports gaéliques et l’importance de la culture physique comme elle était comprise dans l’ancienne Grèce, l’ancienne Rome et l’ancienne Irlande, pour l’amélioration de la race. »603
L’olympisme moderne n’en continue pas moins sa route imperturbablement et irrésistiblement. Coubertinaétéérigéenancêtremythique.Etsouslecoubertinismeonrassembleuntissudebanalités etdelieuxcommuns.Onparletoujoursdepuretésportive.L’origineéducativeimposeauniveaudes principes l’horreur de l’argent et celle de la passion sportive. Mais, impuissance intellectuelle significative, on serait bien embarrassé de dire s’il existe une différence de nature et laquelle entre disciplines olympiques et disciplines non olympiques. Et, impuissance morale, on glisse vers l’hypocrisie,lespectacle,leprestigeetl’argent.
Entouscas,laproblématiquemoderneestposée.D’uncôté,uneligneunisportquis’inscritdans lacontinuitédesjeuxpopulairestraditionnels.Del’autre,uneligneomnisportsquisedéveloppedans lecadredelalogiqueéducative.L’origineestdifférente,l’objectifaussi,etencorelepublic,etmême lesdisciplinesprivilégiées.Unsportestcentrésurl’adulteetnedécouvrequetardivementlafemme etl’enfant.L’autreestcentrésurl’enfantetnedécouvrela compétitionquetardivement etcommeà regret parle biais del’éducation. Par lesgrands sports populaires deballe, on touche aux traditions, aux cérémonies, au sacré, au sacrifice de fondation. C’est un jeu sérieux et tragique qui rétablit, restaure l’axe cosmique vacillant, vieillissant de la sociabilité. C’est une affaire d’hommes. Par les grandssportsathlétiquesdebase,onsesitueaucontrairedanslaperspectiveéducativedel’effort,du développementharmonieuxdelapersonnalité,delaformationphysiqueetsociale.C’estuneactivité plusdestinéeàl’enfanceetàl’adolescence.
599. Organisation du sport et de la culture physique en URSS.Moscou.1961.p.212.
600.Daryl. La Renaissance Physique.1888.
601. Ibid
602.Baudrillart. L’éducation en Grèce.p.46.
603.Joyce. Ulysse.Folio.p.462.
La problématique est posée et reposée. Elle ne fait que reprendre l’opposition entre la ligne de Simonide-PindareetcelledePlaton-Xénophon.Entrelespoètesetlesphilosophes,ilyaladifférence de lapenséemythique etde la pensée analytique. Pour les premiers, vertu signifiait vertu cosmique. C’était la force même de la nature qu’on portait en soi. Le champion était encore l’héritier du roimagicien dépositaire de pouvoirs surnaturels. Pour les seconds, vertu voulait dire recherche personnelle, responsabilité morale. La liberté intérieure peut jouer à égalité avec les forces extérieures.LamortdeSocratecondamnén’estpasunedéfaite.
Héritage de périodes historiques différentes, ces lignes antagonistes demeurent présentes, tant il est vrai que l’histoire se construit, même celle du sport, à partir de modèles cumulatifs qui se superposent, s’affinent, se compliquent, mais aussi dont les tensions conduisent parfois au point de rupturel’institutiondontellesassumentpourtantlaréalité contradictoire.
Deuxsystèmesdecompétition(jeuxolympiquesomnisports,championnatsdumondeunisport), deux destinations (athlète citoyen, confrérie d’initiés), deux fonctions (méthode éducative, rite cosmogonique), deux héritages (poésie, philosophie), deux systèmes de pensée (mythique, analytique), deux critères (émotion quasi-religieuse, engagement physique médical préventif, ou prémilitaire, ou de formation physique et morale), tout sépare dans le principe l’idée olympique moderne, fruit de l’éducation, de la morale et de l’Etat, de l’idée sportive, conjonction de l’esprit associatif, du dynamisme de l’imaginaire collectif et de l’adhésion populaire spontanée. Nous assistons, à travers le temps et aujourd’hui encore, à une subtile dialectique du peuple et de l’Etat, précisons,del’émotionpopulaireetdelaraisond’Etat.
Du coup, on peut tirer quelques conclusions et quelques règles pour la bonne organisation du sport.Sansdouten’est-il pasquestiond’assignerdesloisàunehistoirequisembleprendreunmalin plaisir à se déroulerautrement quenous ne l’avions prévu. Mais on peut quand mêmemontrerqu’il existedefaituncertainpartagedespouvoirsetquetouterupturedansl’équilibredestensionsamène unfonctionnementaberrantdel’institutionsportive.
Équilibredestensionsetpartagedespouvoirs,onpourraitsereprésenterglobalementlasituation parleschémasuivant:
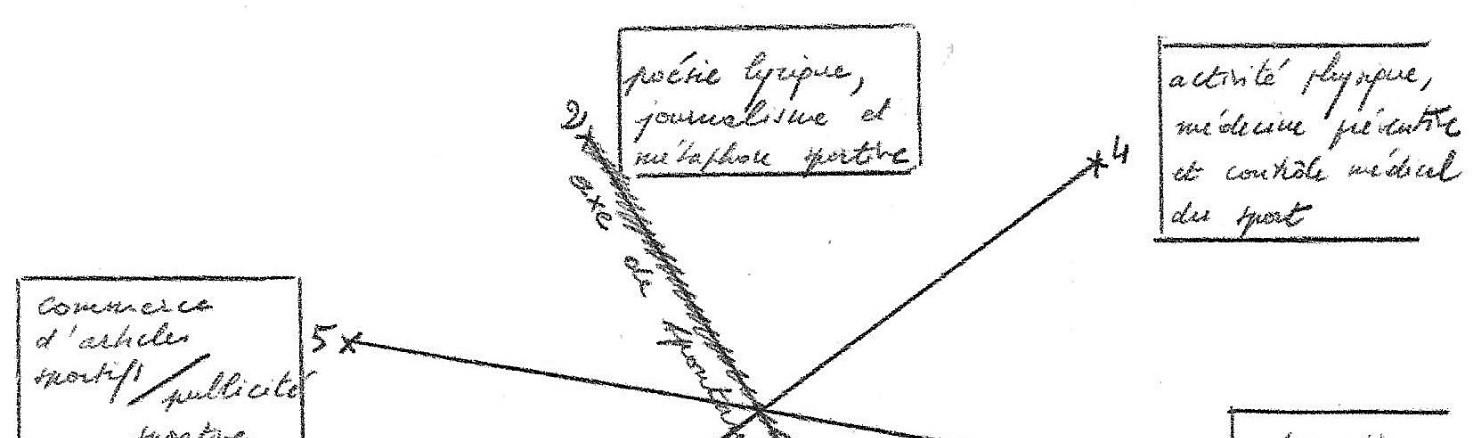

Onobserved’abordlaprésenced’unaxespontanédesociabilité.C’estledomainedesfédérations, du sport civil ou associatif. Nous avons déjà dit quelle était son origine, les jeux traditionnels euxmêmes, reprise de cérémonies religieuses dégradées. Mais cette reprise d’un scénario offert par
l’histoire est révélatrice d’un besoin explicable sociologiquement de micro-socialisation. C’est ici qu’il faudrait une analyse fine des populations sportives. Ce besoin émotionnel, effectif, trouve une chambred’échodanslapresse,prolongementnécessairedel’exploitaccomplietproclamationécrite, officielle, affirmée, d’une sociabilité instaurée dans et par l’épreuve. Cette rencontre ne doit évidemment rien au hasard. La métaphore sportive, si souvent remarquée et décriée au nom d’un moralisme ignorant, fait partie du langage mythique correspondant aux émotions ressenties dans le sport.Lafacilitédelamétaphore,sapuissanceévocatrice,sonsuccèsl’apparententaucontepoétique. Tout cela fait partie de la poésie populaire et constitue le complément mythique, raconté, du rituel, l’accomplissementgestueld’unscénarioimposéparlatradition,lesusages. La présence de cet axe de spontanéité permet déjà de comprendre l’importance d’une notion essentielle du sport moderne, le bénévolat. Le sport est nécessairement, dans ce contexte, une prise en charge par les sportifs eux-mêmes de leur activité cérémonielle. C’est la population sportive qui est dépositaire du rite et rien ne l’en feradémordre. L’institution nepeut pasêtre prise en chargede l’extérieur,souspeinedeperdresonintérêt.C’estdéjàvraichezHomèreoùAchilleorganiselesjeux funèbres de Patrocle comme un dirigeant de nos jours organise le tournoi de son club. Et on voit le vieux Nestor, ancien champion lui-même, conseillerson fils avant le départ, situation analogueà ce quisepasseactuellement oùlaplupart desdirigeants bénévoles,sinonlatotalité,sontdesparents et d’ancienschampions,danslesdeuxcasintéressésaffectivementaudéveloppementdel’institution. Autrement dit, quand on parle de bénévolat, il ne faut pas se méprendre et verser dans le contresens.Onnedoitpasconcevoirunbénévolatdelapénurieconsistantàfairedonnerdesleçons, des cours, par un personnel non qualifié, non compétent, pour compenser les manques de l’Etat en matière d’éducation. Il s’agit, au contraire, d’une volonté qui s’exprime dans les milieux sportifs, inventeurs et créateurs du sport et des sports, de revendiquer des droits d’auteur et de conserver le pouvoirdansleurspropresinstitutions.C’estlecontrôledusportparlespratiquants,uneexigencede direction, d’organisation, de décision, d’orientation. Cela n’exclut pas la présence de professionnels à titre d’enseignants, d’entraîneurs, d’administrateurs, de joueurs. Mais cela interdit la relation pédagogique,l’inégalitédedirigeantàdirigé.
Acetégard,lasubstitutionàlaloide1901d’uneloiditeMazeauden1975aintroduitenFrance beaucoup d’incertitude et de confusion, augmenté les malentendus. En officialisant la notion d’habilitation,lanouvelleloidonnelapossibilitéàl’Etatdedéposséderunefédérationrégulièrement élueparsesmandantsdesondroitàorganiserlescompétitionsdansladisciplinesportiveconsidérée. D’une part, il y a quelquechose degrotesque dans cetteattitudede l’Etatqui consisteà autoriser ce qui se fait déjà depuis cinquante ans, qu’il n’a pas inventé et qu’il ne fait pas fonctionner. D’autre part, tout se passe comme si le législateur avait voulu nationaliser le sport civil, offrir le sport associatifàl’Etat.
Tout cela crée d’ailleurs une situation absurde sur le triple plan juridique, financier et politique. Juridique, car la compatibilité de la loi Mazeaud et de la loi de 1901 est loin d’être assurée. Le président d’une fédération sportive est en même temps élu par en bas et habilité par en haut. A qui doit-il obéir encas deconflit ? Financier ensuite, carsi l’autorité est désormais descendante etvient de l’Etat, si désormais le sport, y compris le sport pour tous, est considéré comme un servicepublic aumêmetitrequele chemindefer oulestéléphones,ilestclair quelesbénévolesquinedétiennent plusl’autoritésurlesportqu’ilsontcréén’ontplusaucuneraisond’effectuergratuitementuntravail quidoitêtredorénavantceluidefonctionnaires.
L’Etat est-il prêt et capable de prendre la relève? Cela représente en emplois nouveaux une moyenne d’un milliard d’anciens francs annuels par discipline sportive dans chaque département. Politique enfin, car une époque où l’on désespère, et l’action socio-culturelle a pour objectif précisémentde réintroduirelaresponsabilité,d’inciterlesgensàseprendreencharge,oncomprend mal qu’on supprime cette dernière là où elle existe et où elle manifeste le plus de vitalité, dans le secteurassociatifdusport.
Aussiest-onamenéàs’interrogersurl’avenirdusportciviletassociatif,sespossibilitésdesurvie, les menaces de disparition qui pèsent sur lui. Le problème qui se pose alors est celui dela solidarité oudel’éclatementdelapyramidesportive.
Tout le vocabulaire en usage nous montre qu’à l’origine initiative et autorité viennent d’en bas. Les clubs sportifs sont des "associations" de joueurs. Ils se regroupent en "ligues" et ces "ligues" à leur tour se "fédèrent". L’autorité montante ne fait que suivre la logique de la compétition qui obéit au mécanismedu défi et chaque sportse constitue ainsi enune pyramide avecdifférents niveaux de pratiqueauxquelscorrespondentdifférentsniveauxdegestion.
Avec le temps néanmoins, l’étirement de la pyramide, l’intervention croissante du commerce et del’Etat,lacentralisationfédérale,renforcéeparleprocessusd’habilitation,ontmodifié,transformé leschéma, le modèleprimitif.Lesobjectifs desFédérations, desLigues, desAssociations,tendent à sedisjoindre,ladécisionsefaitlointaine,l’informationcirculemal.
Dèslorsonestconduitàregarderdeprèslacompositiond’unepyramidesportive,àl’étudiersous l’angle du niveau de la pratique. Les divers éléments sont-ils encore solidaires? Sont-ils amenés à faireéclaterlemodèle?
Sur la figure 2, on a proposé la carcasse du modèle,divisée en huit compartiments. A droite, les jeunes,àgauchelesadultes.
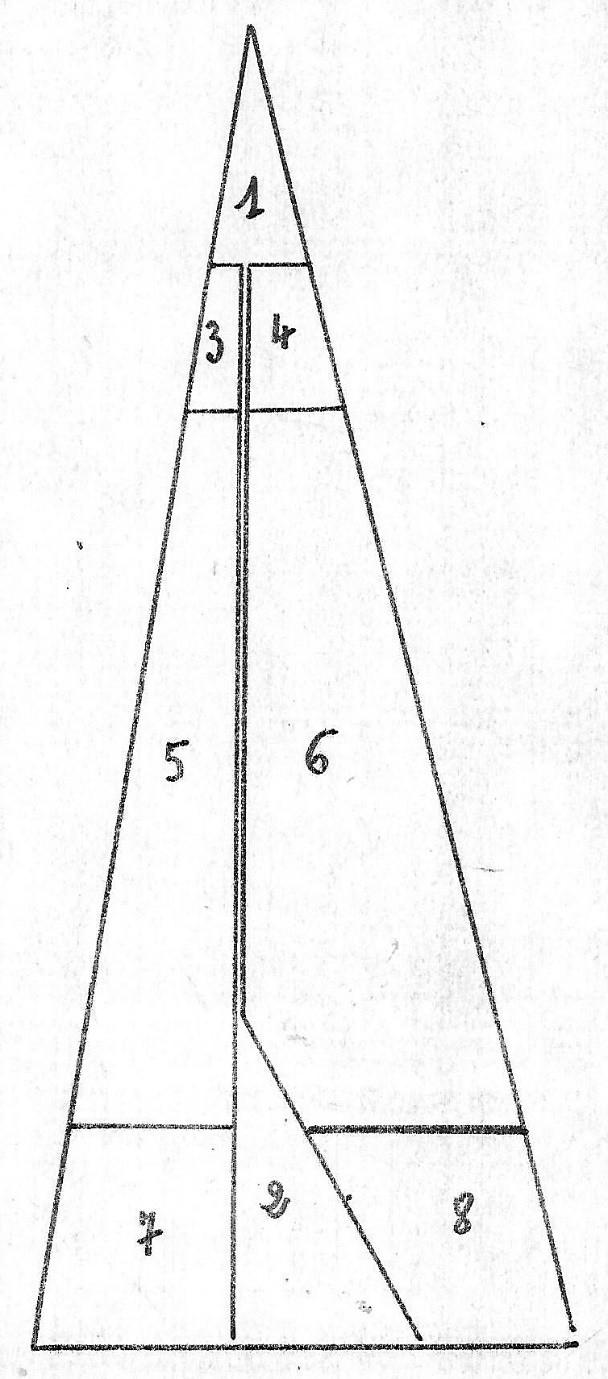


Enbaslesportdétente,enhautl’élite.Aumilieuhorizontalementlecœurdelaréalitésportive,sa passion,sonimplantation,sasolidité,sapermanence.Aumilieuverticalementl’aspirationaccélérée desjeunestalents,sélectionquiéchappeauxloisnaturellesdelapyramide.Lafigure3précisela naturedecesdifférentsmilieuxquihabitentlamêmefédération. Éclatement ou solidarité, la question peut se poser maintenant physiquement, juridiquement et socialement.Physiquement,certainsfontremarquerqu’ilyadifférentssecteursdepratiquesportive etqueleschématraditionnelfédéralestpérimé,anachronique,inefficace,dufaitqu’ilya,d’unepart, lesecteurscolaire,d’autrepart,lesportdeloisiractifet,d’autrepartencore,lesportdehautniveau. Bref,labiologieimposeunedifférencedenatureentreunsportdelaboratoire,lesportéducatif,etun sport qui relève de la récréologie. Juridiquement, il est vrai, c’est le schéma présenté plus haut qui demeure légal, aussi longtemps du moins qu’on s’entient à la loi 1901, et compte tenu des réserves portées sur la compatibilité de ces textes avec la législation ultérieure. Mais c’est peut-être sociologiquementquetoutsejoue.Quifaitquelsportàquelniveau?N’ya-t-ilpasinjusticesportive comme il y a injusticesociale en d’autresdomaines? Un étrangeballet se joueentrele juridique, le biologique,lesocialetlepartagedespouvoirs,suivantlesformesqu’ilrevêt,peutfortbienconsacrer etrenforcerdesinégalitéssoitbiologiquessoitsociales.
Il est certain que, si l’on s’en tient au modèle présenté dans les figures 2 et 3, on peut concevoir unecassurepsychologique,sinonjuridique,entreunsportd’enhautetunsportd’enbas.Laquestion n’estplusdesavoirsitechniquementonpeutorganiserpardesméthodesdifférentesunsportd’élite, un sport de base et un sport de masse. La réponse serait indiscutablement oui. La question est de déterminersilacassurequisedessinepourdesraisonsdegestionetdeniveauathlétiquedusportest socialementetculturellementsouhaitable,c’est-à-diresouhaitéedansunepolitiquedusport.
Cettequestionseposeau niveaudu pratiquant.C’estungraveproblèmede psychologiesociale. N’ya-t-ilpasunesolidaritémotivante,aussi bienpourlechampionquepourlenon-champion,dans le fait d’appartenir à une même famille sportive définie par la possession d’un même savoir technique? Le champion a-t-il un statut social s’il n’est pas le champion, ne fût-ce que très théoriquement, de toute cette base sportive qu’il a dû préalablement vaincre? Champion de quoi? L’élitisme risque de déconnecter etde démotiver. Onpeut penserque le champion sort de la base et abesoindelabase,sinontoutelajoiedusportdisparaît.
Cette question se pose aussi au niveau de la présélection des futures élites. On a dit qu’il fallait orienter très tôt les jeunes vers la discipline sportive où ils étaient à même d’obtenir leurs meilleurs résultatsetquecelajustifiaitlaprésenced’éducateurssportifscapablesdedécelerlesaptitudessurla base d’une pratique préalable omnisport. Mais il semble bien que ce soit là un sophisme inspiré par l’impérialisme médical en matière de sport. Rien ne prouve que l’adhésion à un sport s’effectue principalement sur des critères de performance. Sans doute la réussite sportive contribue-t-elle pour beaucoup ausentiment d’appartenance.Mais on vient avant tout faire du sport avecun copain et on reste pour des questions d’ambiance et de convenance. Si on sépare les copains diversement doués physiologiquement, on perd la motivation dans les deux orientations, ce qui veut dire, plus profondément,qu’onaoubliéquelesportestunphénomènedesocialisationplusqued’engagement physique. On ne peut pas brûler l’étape psychosociologique du club, apprentissage d’une certaine libertéetd’unecertainesociabilité.
Cettequestionseposeenfinauniveaududirigeant.Commentlesbénévoles,carnousyrevenons, qui assurent gratuitement l’animation sportive de la base dans nos quartiers, dans nos villages, pourront-ils rester solidaires à sens unique d’un sommet qui dirige tout, qui décide de tout et où les effortsaccomplissontsoutenusparlecommerceetl’Etat?
Ils auront l’impression qu’un gigantesque et monstrueux transfert de charge s’effectue à leur détriment. On sait en effetque les fédérations reçoivent pour leur élite une aide substantielle venant delapartdesgroupementscommerciauxditsdesoutienet,delapartdel’Etat,sousformededotation depostes(DTN,entraîneursnationaux,CTR,CTD)etquelesfédérations,encontrepartie,donnantà l’Etatletravailcorrespondantàl’animationsportivedebase,l’infrastructuredesclubs,lesbénévoles, etfournissent,produisentlemarchéoùsevendentlesarticlesdesport.
D’unpointdevuestrictementcomptable,ilseraitintéressantd’examinertroischoses:(1)sientre le sport etl’Etat, la balanceest égale,(2) si entrele sport et le commerce, le contratest honnête, (3) silefinancementdel’élitenesefaitpassurledosdelabase.
Sport et commerce, il faudrait comparer le bénéficedes venteset les coûts non comptabilisés du travailbénévole.SportetEtat,onauraitàmettreenparallèle,d’uncôté,latotalitédessubventionset desdotationsd’emploiset,del’autre,cemême travailnon comptabilisédesbénévoles.On s’étonne que des recherches aussi élémentaires n’aient pas été tentées ni par des économistes, ni par des sociologues,niparlesfédérations,nisurtoutparlesecrétariatdelajeunesseetdessports.
En l’absence de chiffres, on peut supposer avec vraisemblance, car on est en mesure d’estimer desordresdegrandeurà partirde quelques extrapolations surdesdonnées locales,que toutsepasse unpeucommesilesbénéficesaccordésàl’élite,pourdesraisonsdeprestigedanslecasdel’Etat,et d’intérêt,danslecasducommerce,étaientdesurcroîtéchangéscontreuntravailcolossald’animation sportivedontlessalairesfictifs,évidemmentnoncomptabilisés,sontdescentainesdefoissupérieurs auxaidesetsubventionsobtenues.
Partage des pouvoirs, dialectique de l’émotion populaire et de la raison d’Etat, on doit faire apparaître le difficile problème de l’école et du club. C’est un problème historiquement nouveau. Il résulte de la conjonction, de l’interférence plus exactement de la ligne des jeux populaires traditionnels qui, dans le prolongement sportif, découvrent l’enfant dont il convient de faire commencerl’apprentissageentempsutile,c’estàdiretrèstôt,etdelalignedel’éducationnationale qui, dans le monde moderne, découvre l’importance du sport et en a besoin en tant que moyen d’éducation. Les difficultés se manifestent dans le quotidien. Par exemple, le même enfant participe le samedi matin à une leçon d’éducation physique et l’après-midi à un match de football pour son club. Mais le débat est aussi de l’ordre des principes. On rejoint le conflit de l’idée olympique, éducative, et de l’idée sportive, adulte et populaire. C’est bien de partage des pouvoirs qu’il s’agit. L’ellipsesportivea deux foyers. Mais on aaussi tout essayédans le sens d’une réduction àl’un et à l’autre,sibienquelavoiequirelieleclubetl’écoleestjalonnéedetouteuneséried’institutionsqui plusoumoins,sil’onsecontented’uneprésentationschématique,onttendancesoitàinstallerleclub dansl’école,soitàinstallerl’écoledansle club.
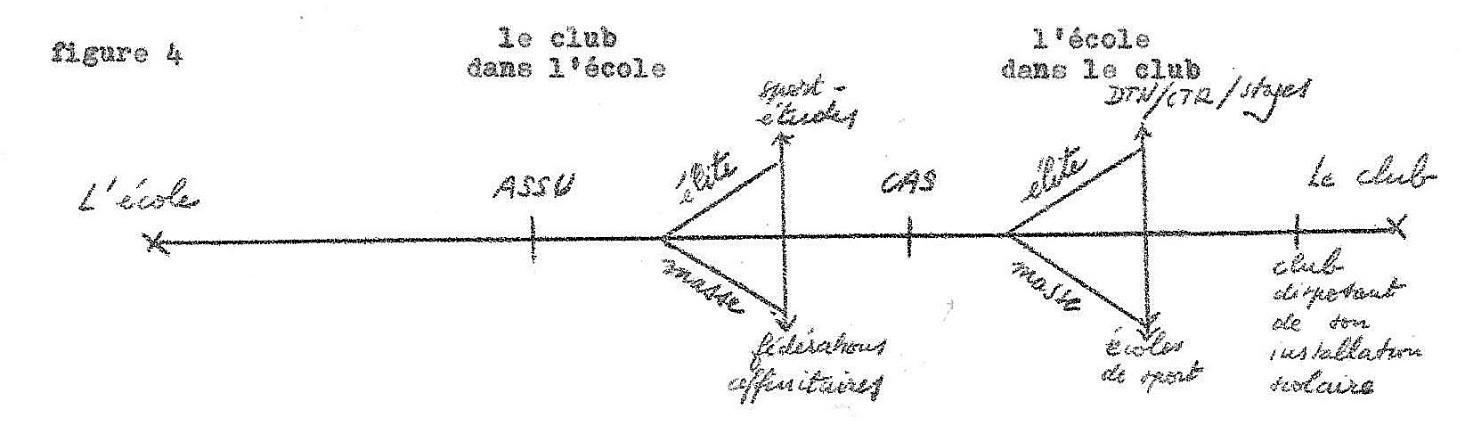
Ladernièreendatedecesinstitutionsestlacréationdesclassessport-études.Ilestpermisd’être sceptiquesurleurcompte.Onnoterad’abordqu’ellesreprésententunedoubleinjustice,àlafoisdans l’établissementscolaireparlaségrégationqu’ellesintroduisentdansledroitàl’enseignementsportif de haut niveau et dans la pyramide sportive par le renforcement des inégalités. On ne peut ensuite querevenirsurlefaitquelacheminéed’aspirationverslehautindiquéedanslesfigures2et3menace de faire éclater la solidarité sportive de la pyramide et que rappeler le risque de voir disparaître la solidaritéd’émotionentrechampionetnonchampion.
Mais il faudrait surtout souligner l’intervention volontariste de l'Etat qui décide, à la place des populations sportives, de la promotion technique de tel ou tel sport, faussant ainsi le jeu dialectique etprenantlerisquedetuerlapouleauxœufsd'ordel'émotionsportive.Volontarisme,caronnepeut que s'interroger si l'on se réfère au nombre des raisons qui font attribuer quatorze sections à l'athlétisme etonze seulement aufootball, dans l'ordreinverse du nombredes licenciés, et de même treizeàlanatationetuneseulementaubasket,ets'ils'agitd’enpromouvoirdouzeautennisetaucune
au jeu de paume.604 Sans doute dira-t-on qu'il en va de même pour l'octroi de subventions aux fédérations.Maisalorsquelscritères ?
Laréponseévidemmentestsimple.Certainssportssontolympiquesetd'autresnelesontpas,et, parmi les premiers, il y en a qui sont plus olympiques que d'autres, fondamentaux, sports de base. Bienentendu,onnefaitquerenvoyerlaquestion:qu'est-cequiestolympique,debase,fondamental, etpourquoi?Qu'est-cequiconfèrevaleuretdignitéàcechoixofficiel?
Toutsimplement,unefoisdeplus,nousvoyonss'établirleclivagesoulignéplushautentrel'idée sportiveetl'idéeolympique,entrelepeupleetl’Etat,entrel'éducationetlesjeuxtraditionnels,entre lefonctionneletlesacré,entrelalignedePlatonetlalignedePindare.
Oùvalesport?Nousserionsendroitderelancerl'interrogationdeDubech,puisquenoussommes auterme denotreenquêtesurlagenèsedel'idéesportiveetquenousobservonscertainesconstantes sedessineràtraversl'enrichissementcontinudumodèlesportifetdesescontradictions.
Il est hors de question, bien sûr, de prophétiser un style de développement qu'il appartient à l'histoired'instaurer.Maisnouspouvonsdumoinsindiquer,instruitsdel’expériencedupassé,leplan d'étude qu'il faudrait se donner pour aborder de façon constructive et prospective le sport dans sa modernitéetpourl'aborderdefaçonglobale,sanstomberdanslepragmatismeetl'aventure.
Onsedevrait,dansunepremièredémarche,dedéterminerclairementlesélémentsconstitutifsdu sport civil ou associatif.Celacomprendrait successivement la connaissance dessignifications et des problèmesdubénévolat,celledescasdefigureduclub,unitédebasedusport,maisunitécomplexe, variableetmouvante,celleenfindesfédérationsdirigeantesetaffinitairesetdesorganismessportifs unificateursdutypeCNOSF.
On se devrait, dans un second temps, d'examiner en détail le partage des pouvoirs, comprendre les origines profondes et populaires du pouvoir fédéral, établir les données exactes du rapport désormais inévitable entre le club et l'école, clarifier le malentendu entre passion sportive et raison d'Etat, préciser les relations exactes avec l'industrie et le commerce, reprendre la question de la pyramidesportiveetdesonunité,lessecteurs1et2delafigure2pouvantverserdansunorganisme sportif d'Etat, les secteurs 5 et 6 vers les fédérations affinitaires et l'animation socio-culturelle et les secteurs7et8verslesportdeconsommation,bowlings,patinoires,stationsdesportd'hiver.
On se devrait, dans un troisième temps, d'en venir à la dynamique de l'institution, analyser les populations sportives, leur nature. Qui fait quel sport? Qui dirige quel sport? On aurait à poser la question non pas aux sportifs, mais avecles sportifs. Cela suppose qu'on accepte deparler dece qui les intéresse, de parler leur langage. Et la discussion s'orienterait inévitablement sur les trois points de passage obligé de l'évolution du sport. Il y aurait la découverte de compétitions attrayantes, recherche faisant appel aux paramètres logiques et psychologiques. Ce problème détermine et conditionnetouslesautres.Donnez-nousdebonnesetbellescompétitionsetvousaurezdenombreux et bons sportifs. Mais il y aurait aussi la formation d'un encadrement capable de comprendre et de dominer l'animation qui le motive. Et il y aurait encore la détermination d'équipements adaptés aux objectifspoursuivisetrépondantauxnormeshumainesexigéesparla passionsportive,unterrain de micro-socialisation,autantqu'auxnormestechniquestraditionnelles.
L'histoire laisserait alors la parole à la sociologie. Celle-ci nous apprendrait à respecter les équilibres tensionnels que l'histoire nous aurait appris à distinguer clairement et à respecter. Mais c'est une entreprise délicate qui réclame habileté et sensibilité. Microsociétés, Etat, commerce, éducation,structuresd’émotions,toutdoitêtreàsaplace.Sinon,onrisqueraitd'abolirlephénomène sportif dans les secteurs qu'on aurait justement voulu promouvoir et l'imaginaire qui n'est jamais perdantnemanqueraitpasdeprocéderàuntransfertd'émotionsurdesdomainesmoinssollicités.
604. L’Equipe.02/03/1977.
Entre le 40e et le 12e millénaire, paléolithique supérieur, se forme le type de l’homme moderne. On possède l’usage du feu. Le troupeau humain primitif fait place à la communauté clanique. Une institution à base sans doute matriarcale s’instaure qui va durer quelques millénaires. On passe de l’armedepierreàl’arcetauxflèches.
Ilya7.000ansenvironapparaîtl’agriculture.L’agricultureetl’élevageprolongentlacueilletteetla chasse.Mais:
1)Onassisteàladifférenciationdutravailfémininquidevientd’ordreménager,ex.métierà tisser.
2) On fabrique des outils métalliques. On travaille le cuivre, le bronze et, à partir du-XIVe siècle,lefer.
3)Onobservelanaissancedel’esclavageprimitif,celledelapropriétéprivée(bétail,esclave).
4) On constate que les liens claniques commencent à faiblir pour faire place aux liens de voisinage.
Au début du IIIe Millénaire, on trouve des formes avancées de civilisation dans les Cyclades et sur les côtes d’Asie Mineure. Le commerce s’effectue par mer et entraîne un développement de la piraterie.EnTroadeseconstitueunecivilisationparticulièrementbrillante.C’estdelàqueseraitparti Pélops.
C’estl’époquedelaconstructiondelapremièregrandepyramideenÉgypte(-2.696).AlafinduIIIe Millénaire, dans la Grèce continentale restée au stade du néolithique, on découvre les traces d’une civilisation qui rappelle celle de la Troade. Troie I et Troie II ont été détruites respectivement en-2.300et-2.250.
AucommencementduIIe Millénaire,brusquedisparationdescivilisationsprécédentes.Lespremières populationsindo-européennesdelanguegrecquesontinstallées,Ioniens,Achéens,Eoliens,etc.
C’estl’époquedubronzeetdespremierspalaiscrétois.
La première moitié du IIe Millénaire verra se développer en Crète la civilisation minoenne. Vers -1400, c’est l’apogée deMycènes. Entre-temps, Hammourabi afondé l’empirebabylonien, les Hyksôssesontrendusmaîtresdel’Egypte.
LaguerredeTroieestàsituervers-1270.
Puis, nouvelle vague d’envahisseurs, les Doriens déferlent en Grèce à partir de -1300 environ. Ils apportentaveceuxlefer.LeurhérosseraHercule.
Acetteépoque,onmentionneunecourseauxmystèresd’Eleusis.
-884. Iphitos, roi d’Elide, consulte la Pythie à Delphes. Il lui est conseillé de rétablir les jeux olympiques.
-850.Époqueprésuméedelarédactiondespoèmeshomériques.
-776. Début des Olympiades. Une seule épreuve, la vitesse. Premier vainqueur: Coroebos. Il était cuisinier.C’estàpartirde-776qu’esttenueàjourlalistedesvainqueursconservéedanslesanctuaire. On institutionnalise en quelque sorte la vieille participation au geste archétypal. Mais c’est une stylisationetunesurvivance.Ils’agitderestaurerunrituelpérimédontonaperdulasignification.
Cerétablissementd’unusageancienmarqueenfaitunstyledecivilisationnouveau.Entoutcas,c’est une étape du sport qui va vers l’universalisation des règles et le retour périodique des compétitions. Mais l’impact culturel est considérable. La chronologie en olympiades sera adoptée par l’historien Polybequi,d’ailleurs,suitencelal’exempledeTimée.VoirEusèbe, Chroniques,194,10.
Lesjeuxétaientcélébrésfinjuillet–débutaoût.
II°Olympiade.
III°Olympiade
IV°Olympiade
V°Olympiade
VI° Olympiade. Les Eléens demandent à la Pythie quelle récompense accorder aux vainqueurs. Réponse:unesimplecouronne.
VII°Olympiade.
VIII°Olympiade.ContestationentrePisatesetEléens.
IX°Olympiade.
X°Olympiade.
XI°Olympiade.
XII°Olympiade.
XIII°Olympiade.Iln’yatoujoursqu’uneseuleépreuve.
XIV°Olympiade.Pausanias:«Ladoublecoursefutajoutée.»
XV°Olympiade.
XVI°Olympiade.
XVII°Olympiade.
XVIII° Olympiade. Introduction du penthale (premier vainqueur: Lampris) et de la lutte (premier vainqueur:Eurybatos).Cf.Pausanias.
XIX°Olympiade.
XX°Olympiade.
XXI°Olympiade.
XXII°Olympiade.
XXIII° Olympiade. Apparition du pugilat avec emploi de cestes (bandelettes de cuir renforcées par endroitsdeplaquesdecuivreetdeplomb).Premiervainqueur:OnomastedeSmyrne.
XXIV°Olympiade.
XXV°Olympiade.Onorganisedescoursesdequadriges,ainsi qued’autrescourseshippiques,dans unhippodromesituéàproximitédustade,maisquatrefoisplusgrand.
XXVI°Olympiade.
XXVII°Olympiade.
XXVIII°Olympiade.
XXIX°Olympiade.
XXX°Olympiade.
XXXI°Olympiade.
XXXII°Olympiade.LacoursedustadeestgagnéeparOrsipposquicourtnu,exemplequiserasuivi danslesolympiadessuivantes.Cf.Pausanias,I,xi,1.
XXXIII°Olympiade.
XXXIV° Olympiade. Les habitants de Pise, le roi Pantaléon à leur tête, constituent une armée et tiennentlesjeuxolympiquesàlaplacedesEléens. AussilesEléensnetiennent-ilspascesjeuxpour olympiques.Cf.Pausanias, Elis II,xxii,2.
XXXV°Olympiade.
XXXVI°Olympiade.
XXXVII°Olympiade.Pausanias:attributiondesprixpourlacourseetlaluttedesenfants
XXXVIII°Olympiade.
XXXIX°Olympiade.
XL°Olympiade.
XLI°Olympiade.
XLII°Olympiade.
XLIII°Olympiade.
XLIV°Olympiade.
XLV°Olympiade.
XLVI°Olympiade.
XLVII°Olympiade.
XLVIII°Olympiade.
XLIX°Olympiade.
L°Olympiade.
LI°Olympiade.
LII°Olympiade.Piseestvaincueetdétruite.C’estElisdésormaisquirégitOlympieetsontrésor.
LIII°Olympiade.
LIVOlympiade.
LV°Olympiade.
LVI°Olympiade.
LVII°Olympiade.
LVIII°Olympiade.
LIX° Olympiade. Praxidamas Eginète remporte le pugilat. Fait significatif, cela vaudra la première effigie d’athlète consacrée aux jeux olympiques. Autrement dit, la victoire personnelle est ressentie comme acte individuel plus que comme participation au geste archétypal. La statue était en bois et situéeprèsdelacolonned’Oïnomaos.
LX°Olympiade.
LXI°Olympiade.MêmeattitudechezRéxibiosd’Oponte,vainqueuraupancrace.
LXII°Olympiade.
LXIII°Olympiade.
LXIV°Olympiade.
LXV°Olympiade.Institutiondelacourseenarmes.VictoiredeDamarète.
LXVI°Olympiade.VictoiredeCléosthéned’Epidammeàlacoursedechars.
LXVII°Olympiade.
LXVIII°Olympiade.
LXIX°Olympiade.
LXX°Olympiade.
LXXI°Olympiade.
LXXII° Olympiade. C’est Tisicrate qui gagne la course à pied. Cf. Pausanias, Elis II, ix, 5. Mais Cléomède tue, au combat de ceste, son adversaire, Iccos d’Epidaure. Il est disqualifié. Il en devient fou.Cf.Pausanias,VI,ix,6à8;Plutarque, Romulus,28.
LXXIII° Olympiade. Gélon gagne la course de chars. Est-ce le tyran de Syracuse? Question controverséeselonPausanias, Elis II,ix,4.
LXXIV°Olympiade.
LXXV°Olympiade.
LXXVI°Olympiade.
LXXVII° Olympiade. Une organisation malheureuse et qui tire en longueur oblige à étaler les jeux sur plusieurs jours. Pausanias: l’économie des jeux d’aujourd’hui, avec les sacrifices du pentathlon et des courses de chars placés au second jour et ceux des autres compétitions au premier, fut fixée lors des 77° jeux. On avait prévu que les compétitions gymniques et les compétitions hippiques se tiendraient le même jour. Mais aux jeux que j’ai mentionnés, les pancratistes prolongèrent la compétitionjusqu’àla nuittombanteparcequ’ils n’avaientpasété introduitsdansl’arèneasseztôt. La cause dece retard était en partie dueà la course dechars mais plus encoreau pentathlon. Callias d’Athènes fut champion du pancrace, mais plus jamais par la suite le pancrace n’interféra avec le pentathlonoulacoursedechars.
LXXVIII°Olympiade.
LXXIX°Olympiade.
LXXX°Olympiade.
LXXXI°Olympiade.
LXXXII°Olympiade.
LXXXIII°Olympiade.
LXXXIV°Olympiade.Suppressiondelacoursedemulesquin’auraduréquecinquanteans.
LXXXV°Olympiade.
XCVIII° Olympiade. Six statues sont érigées avec les amendes infligées aux athlètes ayant enfreint les règles. Etaient pénalisés Eupolus deThessalie, Agénor l’Arcadien, Pritanis de Cyzice etPhormio d’Halicarnassequiavaientgagnéauxjeuxprécédents.Cf.Pausanias.
XCIX° Olympiade. Sodatès remporte la course de fond. C’était un Crétois. Il se proclame ensuite Ephésien.
C°Olympiade.
CI°Olympiade.
CII°Olympiade.
CIII°Olympiade.
CIV°Olympiade.LesjeuxsontorganisésparlesArcadiens.LesEléensnelesconsidèrentpascomme valables.Cf.Pausanias, Elis II,xxii,3.
CV°Olympiade.ProrusdeCyrènegagnela course.Cf.Pausanias, Phocis.II,3.
CXXV°Olympiade.Ladasd’Egéegagnelacourse.C’estl’époquedel’invasioncelte.Cf.Pausanias, Phocis,xxiii,14.
CL°Olympiade.
…
211° Olympiade. Xénodame d’Anticyre remporte le pancrace. Ce sont les seuls jeux mis dans le palmarès éléen.Cf.Pausanias, Phocis,xxxvi,9-10.
218°Olympiade.Unretardataire,Apollonios,estéliminé,et,vérificationfaite,sonretardétaitplutôt accablant. Pausanias: « Il n’était pas arrivé à temps, retenu par des vents contraires… Apollonios était en retard à cause d’un vol d’argent aux jeux ioniens. Les Eléens l’exclurent des jeux.»
…
235° Olympiade. Mésibule remporte divers prix (vitesse et diaule avec bouclier). Cf. Pausanias, Phocis,xxxiv,5.
…
En 393, les jeux olympiques sont abolis par Théodose, le premier empereur romain converti au christianismequiconsidéraitlesjeuxcommeunculteconcurrent.
Notesurlatrêveolympique.En-365,lesArcadienssesaisissentd’OlympieetrestaurentPise.Elis était soutenue par Sparte. Cf. Xénophon, Helléniques, VII,4,28. La trêve sacrée dont parle Thucydide (livre IV, ch. III, 74) est surtout l’écho d’un vœu pieux, d’une tradition sans fondement. Certes, on affirmait qu’on respecterait la sécurité de ceux qui se rendraient à Olympie. Mais il s’en fautdebeaucoupquel’Eliden’aitjamaisétéuneterreinviolable,pacifiqueetsacrée.
393/4.AbolitiondesjeuxolympiquesparThéodose.
870. Les enfants de Louis le Débonnaire marquent leur réconciliation en organisant une joute solennelle.
919.DatesupposéedupremiertournoidansleSaintEmpire,d’aprèsLudwigJahn.
920.L’empereurHenril’Oiseleurdonneunefête,rapporteVoltaire,pourcélébrersoncouronnement etonycombatàcheval.
XIe siècle. Guillaume, duc de Normandie, entreprend et réussit la conquête de l’Angleterre, et c’est parl’intermédiairedesessoldatsquelejeufavoridecesderniers,lasoule,passelaManche.
1130.ConciledeClermont:Innocent IIfulminecontrelestournois.
1139.ConciledeLatran:interdictiondel’usagedel’arcetdel’arbalèteentrechrétiens.
1279. Nicolas III excommunie ceux qui ont combattu et assisté au tournoi tenu en France sous PhilippeleHardi.
1309. Tournoi solennel de Boulogne-sur-Mer au mariage d’Isabelle de France avec Edouard II, roi d’Angleterre.
1314.EdouardIIinterditles« raigeries de grosse pelote »,carlesjeuxdeballon,sansdoutelasoule, sontcausededésordressérieux.
1319.PhilippeleLongprescritàsessujetsderenoncerauxjeuxdepalets,dequilles,desoules,etde s’appliqueraux exercices militaires, dont le tir àl’arc. L’ordonnanceviseparticulièrement les ludos solarum.
1337. Edouard III veut que ses sujets abandonnent tous vains passe-temps au profit du tir à l’arc… « sous peine de mort »!
1349. Edouard renouvelle l’interdiction de 1314 contre la soule, ce qui montre l’inefficacité des mesuresprisesantérieurement.
1363 Confirmation de l'ordonnance de 1337, ce qui sera un peu à l'origine du désastre français à Crécy.
1367 et 1369. Ordonnance de Charles V pour encourager les jeunes gens à « exciter, continuer et apprendre le fait de traire (=tirer)»etlesinciter« à eux exercer et habiliter en fait de trait d'arc ou d'arbalestre.»CharlesVinterditformellementtoutjeude« solles ».
1390. Tournoi de Londres organisé par Richard d'Angleterre et rapporté par Froissart en ses Chroniques (livreIV,ch.16).
1401.HenriIVprendunedécisionanalogueauxmesuresprisesenAngleterreen1314et1349contre lasoule.
1415.TournoiàParissousCharlesVI.
1446. Le Pas d'Armes de la Gueule du Dragon est organisé prés de Chinon par René d'Anjou, roi D'Anjou,roideSicile.
1457. Le parlement écossais interdit la pratique du golf et du football (de la crosse et de la soule). JacquesIIs'étaitinquiétédevoirdélaisserletiràl'arc.
1466. Unseigneurtchèquedéfaitlelutteurofficielduprinceàlacourbourguignonne.
1492.Le«bonchevalier»Bayard,âgédedix-huitans,fait« crier un tournoi »àAireenPicardie.Il l'organiseetlegagne.
1519.Dateduderniertournoi,selonLudwigJahn.
1546.Ronsardécritsapremièreodepindarique.
1549.DuBellays'engageàsontourdansl'imitationdePindare.
1559. Henri II est tué dans un tournoi aux Tournelles. C'est pratiquement la fin des tournois, estime Voltaire.
1610.Lesmaîtres-paumiers,raquettiers,faiseursd'éteufs,pelotesetballesontunstatutprofessionnel. 1639. Une ordonnance réserve aux gentilshommes la pratique du jeu de paume. Les registres du Parlementportenttémoignagedecontraventionsàcetteordonnance.
1657.UnambassadeurdesPays-Basadénombrécentquatorze(114)jeuxdepaumeàParis.
659.Lefootballs’organise:dimensionsduchampdejeu,nombrerestreintdejoueurs.
1698. Misson dit du football anglais, dans ses Mémoires et observations : « C'est un ballon de cuir gros comme la tête et rempli de vent ; cela se ballotte avec le pied dans les rues, par celui qui le peut attraper : il n'y a point d'autre science. »
1719.Lepremiertitredusportmoderne,celuidechampiondeboxe,estportéparJamesFigg. 1743.JackBroughtonrédigelesrèglespugilistiques.Ilseraimité,unsiècleplustard,parlemarquis deQeensbury.
1754. Fondation du Royal and Ancient Golf Club de Saint Andrews en Ecosse qui réglemente le jeu degolfdepuiscettedate.
1772.LivredeSudre: Le noble jeu de mail.
1774.Codificationducricket.
1780.Iln'yaplusquedix(10!)jeuxdepaumeàParis.
1781.ArrêtduParlementinterdisantdejeterlasoulelejourdeNoël...niaucunjour! 1786.PremièreascensionduMontBlancparBalmatetPaccard.
1806. Un Ecossais loue à Londres des terrains pour la pratique du cricket. C'est l'époque où se constituele Marylebone Cricket Club quiresteralégislateurincontestédecesport.
1810.AuJapon,uneréuniondetroisjoursestconsacréeàdescompétitionsdenatation.
1811.CréationduTurnplatz.
1823.ARugby,WilliamWebbEllisaurait,dit-on,« avecunsubtilmépris pourlesloisdujeuadmises à son époque, couru le ballon en mains.»
1829. Dèsl'indépendancerecouvrée,la Grècese proposela restauration des jeux olympiques. Faute demoyens,celaneseferaquetrenteansplustard.
1837.OnorganisedescoursesdenatationenAngleterre.Londrespossèdesix(6)piscines. 1839.Disparitiond'undesderniersjeuxdepaumedeParis,celuisituérueMazarine. 1840.Premièrecodificationdubase-ball.
1843.ATromsoe(Norvège),premièrecoursedefondàskis.
1845.FondationàNewYorkdu Knickerbocher Base-Ball Club. 1846.DesAméricainsorganisentàSidneylepremierchampionnatconnudenatation. 1849.FondationduCercledeRoubaix,premièresociétécolombophileduNord.
1851.Fondationduclubdefoot-balldeSheffield.
1852.1)LepréfetduNordinterditlescombatsdecoqsle11février.
2) Garcin, le célèbre paumier de Fontainebleau, se plaint de la décadence du jeu de paume. Plusdetraitementdepuis1830,nidelogementdepuis1848.
1853. Disparition du jeu de paume en plein air des Champs-Élysées. Il doit faire place au Palais de L’Industrie.
1854.Le17septembre,parutiondupremiernumérodujournal Le Sport.Sous-titre:Journaldesgens dumonde.
1857. Devant la diversité des règles adoptées, une Association pour la Réforme du foot-ball se constituequientendsupprimerl'usagedesmains.
1858.1)LesAustraliensorganisentunpremierchampionnatdenatation.
2)Codificationdéfinitivedubase-ball.
1859.1)PremiersjeuxolympiquesgrecsmodernesàAthènes.
2)FondationdupremierclubdepoloàCalcutta.
3) A Paris, disparition du jeu de paume de Mosselman, passage Sandrié (quartier de l'opéra), lors du percement du Boulevard Haussman. En compensation, on bâtit la salle du jardin des tuileriesetlejardinduLuxembourgestattribuéàlaLonguePaume.
1863. Sept clubs anglais créent la Foot-ball Association. La cohabitation avec les adeptes de la méthodedeRugbynedureraquequelquesmois.
1864.1)Premièrerencontred'avironOxford-Cambridge.
2) Lors d'un concours de pinsons à Roubaix, un concurrent, furieux d'avoir perdu, décapite publiquementsonpinsonpréféré.
1868.Premièrescoursescyclistes.
1869.LanatationsefédèreenAngleterre. 1870.SecondsjeuxolympiquesgrecsmodernesàAthènes. 1871.1)ConstitutiondelaRugbyFootballUnion:20clubs.
2) Fondation de la coupe d'Angleterre de Foot-ball Association. Ce sera le point de départ de l'extraordinairedéveloppementdecesportdontlesprogrèsavaientétéjusque-làassezlents.
3)Legardiendebutestautoriséàseservirdesesmains.
1872.NaissanceduHavreAthlétiqueClub.
1874.1)LemajorWingfieldinventelaSpairistique,courtransportable,nouvelleetperfectionnée, pourjouerl’ancienjeudepaume.
2)LivredeKingsley: Santé et éducation.
1875.TroisièmesjeuxolympiquesgrecsmodernesàAthènes. 1876.Codificationdesrèglesdulawn-tennis. 1877.1)PremierchampionnatdetennisàWimbledon.
2)EnRussie,surpropositiondeP.FLesgaft,descoursdegymnastiquesontouverts;ilsseront fermés en 1882 sur ordre d’Alexandre III. Le programme était étalé sur deux ans. Les cours étaientplacéssousdesauspicesmilitaires. 1878.1)LecyclismesefédèreenAngleterre.
2)Letenniss’introduitenFrance:Dinard. 1879.L’avironsefédèreenAngleterre. 1880.1)L’athlétismesefédèreenAngleterre.
2) On improvise des versions de tennis miniature, sur table, avec un équipement improvisé, livrestenantlieudefilet,raquettesdiverses.Laballeestencaoutchouc.
3)JulesFerryrendl’éducationphysiqueobligatoiredanslesécoles. 1881.1)IntroductiondurugbyenFrance.
2)LivredeFonssagrives: L’éducation physique des filles. 1882.1)Créationdel’InternationalBoardenfoot-ball.
2)ATokyo,dansl’enceinted’untemple,installationdelapremièresalledeKodokan.
3) Fondation à Paris du Racing Club de France, première association sportive régulièrement autorisée.Sonbut:lacourseàpied.LeStadefrançaisserafondéquelquessemainesplustard. 1883.SéjourdeCoubertinenAngleterre. 1884.ChezP.MAyres,àLondres,onvendlespremièresannalesdutennisminiature. 1885.Leprofessionnalisme,enfootball,estlégalisé. 1886.1)LetennissefédèreenAngleterre.
2)Créationdel’UniondesSociétésdeTir. 1887.1)Créationdel’UniondesSociétésFrançaisesdesSportsAthlétiquesparleRacingClubde FranceetleStadeFrançais.Coubertinenseralesecrétairegénéral.
2)PublicationdesrésultatsdesfouillesallemandesàOlympie.
3)PremièreapparitiondujudohorsduJapon.
1888.1)LivredeDaryl: La renaissance physique.« Jeux Olympiques, le mot est dit. Il faudrait avoir les nôtres. »
2)Sousl'impulsiondeCoubertin,uncomitépourlapropagandedesexercicesphysiques.
3)Sousl'impulsiondeGrousset,uneLigueNationaledel'Éducationphysique.
4)Premierchampionnatnationald'athlétisme. 1889.1)QuatrièmesjeuxolympiquesgrecsmodernesàAthènes.
2)Premierchampionnatnationaldecross-country. 1890.1)L’ingénieurGibbsuggèrel'utilisationdelapetiteballedecelluloïdpourletennis miniature.
2) Coubertin assiste à des "jeux olympiques" organisés depuis quarante ans par W.P Brookes auxconfinsduPaysdeGalles. 1891.1)ASpringfield(Massachussets),JamesNaismith"invente"lebasket.C'estlepremiersport créédefaçondélibérée.Ilpoursuitunbutd'éducationphysique.Alasurprisedesonauteur,il évolueverslacompétitionavecunsuccèsinattendu.
2)EnFrance,auHavre,lerugbyetlefoot-ballconstituentdessectionsdistinctes.
3)EnAngleterre,unbrevetestdéposé,souslen°19070,pourunjeuappeléping-pong. Lemotdevientappellationcommerciale.
4)PremierchampionnatdeFrancedetennis. 1892.1)PremierchampionnatdeFrancederugby.
2) On célèbre en Sorbonne le 5°anniversaire de l'Union des Sociétés Françaises des Sports Athlétiques. Bourdon parle du sport dans l’Antiquité, Jusserand au Moyen-Age, Coubertin danslestempsmodernes.Onévoquelacréationdejeuxolympiques. 1893.CoubertineffectueunséjourdequatremoisauxEtats-Unis. 1894.1)AParis,unCongrèsrassemblantlesdéléguésde34paysdécided'organiserlesjeux olympiques.
2)EnFrance,créationdelasociétédespéléologie.
3) Premier championnat de France de football. Il est organisé par l’Union des Sociétés FrançaisesdeSportsAthlétiquesetopposesixéquipes.
1895.1)C'estuntournantdansl'histoiredusport.LesAméricainssesubstituentauxAnglaisdansle domainedelasupérioritésportive.
2)WilliamMorganinventelevolleyball.
1896.1)Jeuxd'Athènes,lespremiersjeuxolympiquesmodernes.
2)APétersbourg,Lesgaftouvredescoursparticuliersd'unescolaritédetroisansà l'intentiondesmoniteursd'éducationphysique.
3)L'AllemandFischergagnelapremièreéditiondeParis-Roubaixcycliste,«l'enferduNord» 1897.1)EnHongrie,premierschampionnatsconnusdetennisdetable.
2)EnAngleterre,premierchampionnatdetennisfémininàWimbledon.
3)ALyon,premierchampionnatdumondedetir.
1899.AuvélodromeduParcBarbieuxàRoubaix,onopposeuncombat(?)restécélèbregrâceàune poésie satirique du Broutteux (le barde patoisant des voisins tourquennois !), un taureau à un vieuxlionlocalnomméGoliath.Cedernierfutsisuperbementindifférentdevantlestentatives d'agressiondesonadversairequelacorridas'achevadansl'amusementetletumultedupublic.
1900.Pourdonneruneidéedel'animationlocaleàl'époquedusportnaissant,Roubaixcompte755 «coulonneux» répartis en 50 sociétés, et 15.000 pigeons-voyageurs. Lors d'un concours de pinsons, le 17 mai, il y a 500 pinchonneux. La même année dans la même ville, il existe 28 sociétésinstrumentaleset37chorales!
1903.PremierTourdeFranceCycliste.C'estl'aboutissementdelagrandeépopéetechnologiquedu vélos'affirmantcommemoyendelocomotionàgrandrayond'action.Maisonmontredumême coupquel'homme,aveccetenginmagique,peutsanscesseallerau-delàdelui-mêmeetreculer seslimites.
1904.ouvertureàPétersbourgdel'EcoleSupérieureEscrimo-gymnique.Ellepréparaitdes
moniteursmilitaires(officiers).
1908.Pourdesraisonsdeprincipe(amateurisme),l’U.S.F.S.A.quittelaFédération InternationaledeFootballAssociation.
1910.LeComitéFrançaisInterfédéralquiregroupelaFédérationdesPatronagesetlaFédération CyclisteetAthlétiqueestadmisàlaF.I.F.A. etseconsacreuniquementaufootball.C'est pratiquementlapremièrefédérationspécialisée.
1911.Débutdusportautomobile.PremierRallyedeMonte-CarloetPremierGrandPrix d'Indianapolis.
1912.CréationdelaFédérationInternationaled’Athlétisme.
1913.AManille,premiersjeuxorientaux:lesPhilippinsgagnentletournoidevolley-ball.
1915.AShangaï,secondsjeuxorientaux:lesChinoisremportentletournoidevolley-ball.Cesport vaatteindreainsilaRussieetleJapon.
1918.FondationdelaCoupedeFrancedefootball.Ellevadonnersonessoraufootballfrançais.Ce phénomène, venant confirmer le précédent anglais, montrerait que le succès d'un sport est étroitement lié au fait qu'il ne sépare pas l'élite et la base dans l'établissement de son système compétitif.
1919. 1) Création de la FFF (Fédération Française de Foot-ball). C'est le début de la tendance à l'autonomiedesfédérationsetl'éclatementdel'USFA.
2) A Léningrad, s'inspirant du laboratoire d'éducation physique et de biologie de Lesgaft, on ouvreunInstitutdeCulturePhysique.
1923.1)EnFrance,créationdes24heuresduMans.
2)EnRussie:
a)Liquidationdesanciennessociétéssportivesbourgeoises(circulairedu23/06/23).
b) L'éducation physique ne doit pas être un mouvement particulier, mais doit entrer comme partieconstitutivedansunplangénéraldetravailculturel(circulairen°6du10/8/23).
c)Fondationde«Dynamo»,premièresociétésportive"volontaire".
1926. 1) Fondation de la Fédération Internationale de Tennis de Table. L'appellation «ping-pong» étaitimpossiblepourdesraisonscommerciales:marquedéposée.
2) En URSS, la XVe Conférence du parti relève des défauts dans l'organisation de la culture physique. Elle condamne l'attitudedédaigneuse àl'égarddes compétitions et desrecords et la réductiondelaculturephysiqueàunexercicehygiénique.
1928.1)Lesfemmessontadmisesàparticiperenathlétismeauxjeuxolympiques.
2)LivredeGiraudoux: Le sport.C'estunesuited'aphorismes.
1931.EnURSS,fondationduG.T.O.="PrêtpourleTravailetlaDéfense".C'estunesortedeBrevet SportifetMilitaire.
1932.1)CréationdelaFédérationInternationaledeBasket-ball.
2)DébutdufootballprofessionnelenFrance.
1936. En URSS, le Conseil des Commissaires de Peuple d'URSS décide d'organiser et de répartirlessociétéssportivesenfonctiondesseuls secteursdeproduction.
1947.CréationdelaFédérationInternationaledeVolley-ballàParis.
1956.ALeningrad,premièreConférencedePsychologieduSport.
1958.EnURSS,
a)3758participantsaux6e Spartakiadesd'été.
b)promulgationenjanvierdesstatuts-typesd'unesociétésportivevolontaire.
c)secondeconférence,àMoscou,depsychologie dusport.
Parmileslivressusceptiblesd'êtreconsultés,signalons:*
1) L'organisation de la culture physique en URSS.Ed.Culturephysiqueetsport.Moscou.1961.(en russe).L'ouvrage,publiésousladirectiondeI.I.NikiforovetdeV.S.Polchanski,comporte364pages etatiréà15.000exemplaires.Ilestdiviséenonzechapitres:
1.Fondementsorganisationnelsdumouvementsoviétiqued'éducationphysique.
2.L'uniondesSociétésetOrganisationssportivesd’URSS.
3.OrganisationetgestiondelaculturephysiqueetdusportdanslesystèmedesMinistères, Comitéd’ÉtatetDirection.
4.Lecaractèreauto-organisationneldumouvementsportifamateur.
5.LesystèmedepréparationdescadressportifsenURSS.
6.Planification,comptabilitéetinspectiondanslesorganisationssportivesd'URSS.
7.Propagandeetpublicitépourlesport.
8.Letravaildetrésorerie.
9.Organisationdelaculturephysiqueetdessportsdanslespaysducampsocialiste.
10.Lesorganisationssportivesinternationales.
2) Critique de la sociologie du sport bourgeois. Ed. Culture physique et sport. Moscou. 1965. (en russe).Rédigésousladirectiond'A.A.Frenkine,l'ouvragecomporte148pagesetaétépubliéà9.000 exemplaires. Outre l'introduction signée de A.V. Korobkov, il consiste en trois articles d'inégale longueur. Frenkine consacre 64 pages au sujet qui donne son titre au livre. Ponomarev conteste les théoriesbourgeoises sur l'apparition del'éducation physique.Chtchéoulov et Kaïtmazov parlent des rapportsdel’Égliseetdel'éducationphysique.
3)A.A.Frenkine. L'esthétique de la culture physique.(Enrusse)Ed.Culturephys.etsport.Moscou. 1963.C'estunlivrede150pageséditéà20.000exemplaires.Ilcomprendcinqchapitres.
1.Développementharmonieuxdelapersonnalitéetperfectionphysique.
2.Rapportdel'esthétiqueetdelaculturephysique.
3.Culturephysiqueetéducationesthétique.
4.Lesportetl’art.
5.Unitédel'éducationesthétiqueetmoraleetdel'éducationphysique.Unebiographietermine l’ouvrage.
4)JamesRiordan. Sport en Soviet Society.CambridgeUniversityPress.1977.Celivrede432pages étudie toute l'évolution du sport en URSS, ses rapports avec l'hygiène et la santé, la défense et le travail, aveclemouvementduProletkoult,lapérioded'industrialisationrapide,lapolitiqueétrangère, l'école,etc...
5) Sportifs.Recueil.Laviedeshommesremarquables.Sériedebiographies.Fascicule16.Ed.Jeune Garde.Moscou.1973.C'estunecollectionquis'enorgueillitd'avoirétéfondéeparGorki.Tournéeici vers les sportifs, elle s’intéresse au lutteur Ivan Poddoubni, au joueur d'échecs Alékhine ainsi qu'à
quelquesautresfiguresnotablesdusportsoviétique.L'ouvragecompte352pagesetestaccompagné d’illustrations.Ilaététiréà100.000exemplaires
Il convient également de se référer à la série d'articles publiés par Yvon Adam dans le Magazine France-URSSen1975,1976,1977.
Enfin on peut recommander le très intéressant passage sur les définitions du jeu et du sport qu'on trouvedanslelivredeM.S.Eagane: L'activité humaine.Moscou.1974.Pages204-208,(enrusse).
Quelquesdatespermettrontdemieuxsituerl'évolutiondusportsoviétique.
1917.- Dans les usines et les fabriques, dans les clubs ouvriers, création de cercles et de cellules de sport.
1918.-CréationàPetrograddupremierclubsportifmilitaire.IlyenauradesemblablesàMoscou, Toula,Kharkov,Kiev.
-Le7mai,fondationdu Vséoboutch (étudesmilitairespourtous).
1919.-ALéningrad,ouvertured'unInstitutdeCulturePhysique.Ils'inspireduLaboratoire d’EducationPhysiqueetdeBiologiedeLesgaft.
1920.-Le Vsévoboutch estréorganiséenEcoleMilitaireSupérieuredeFormationPhysique. Duréescolaire:deuxans.
1921.
1922.-Surunebasesyndicale,oncommenceàorganiserdescerclessportifsdanslesclubsouvriers.
1923.-Fondationde«Dynamo»,premièresociétésportive«volontaire».
-Le27/6/23,liquidationdesanciennessociétéssportivesbourgeoises.
-Le10/8/23,circulairen°6:L'éducationphysiquenedoitpasprendrel'aspectd'un mouvementparticulier,maisentrercommepartie constitutivedansleplangénéraldutravail culturel.
1924.-Ennovembre,VI°CongrèsdesSyndicatsdeRussie:Utiliserlaculturephysiquecomme méthoded'intégrationsyndicaledesouvriers,pourlasantéphysiqueduprolétariat,en organisantdescerclesdeculturephysiquesurleslieuxdelaproduction,afinderapprocher cesorganisationsdessolutionsauxproblèmespolitiquesetdeproduction.
1925.-Décretdu13juillet1925:Laculturephysiquedoitêtreenvisagéenonseulementdupointde vuedel'éducationphysique,delasantédesmasses,commemoyendepréparationàlavie économiqueetmilitaire,maisencorecommeméthoded'éducationetd'intégrationdes travailleursdanslaviedesorganisationssocio-politiques.
1926.-XV°ConférencedeParti:Onsouligneunesériededéfautsdanslaconduitedes organisationsdeculturephysique.Condamnationdel'attitudedédaigneuseàl'égarddes compétitions,desrecords,delaréductiondelaculturephysiqueàunexercicehygiénique.
1927.-
1928.-
1929.-IIIe ColloquedesSyndicatsdel'Unionsurlaculturephysique
-Le23septembre,leComitéCentralduParticondamneladispersiondeseffortset recommandeunemeilleureplanificationdutravail.
1930.-Création,le3avril,d'unConseildel'UnionpourlaCulturePhysiqueetleSport.
-Ennovembre:PremièreconférencedesSyndicatsdel'Unionsurlaculturephysique.
1931.-CréationduG.T.C.(prêtpourlaDéfenseetleTravail).
1932.
1933.
1934.-Fondationde"Spartak".
1935.-Fondationde"Lokomotiv"verslafindecetteannée.
1936.-Le14mai,leConseildesCommissairesduPeupledécidedeneplusorganiserlessociétés sportivesquedanslecadredessecteursdeproductions.
-21mai:Créationde64sociétéssportives"volontaires",surunebasesyndicale,dansl'esprit ducentralismedémocratique.
-23juin:Créationde15nouvellessociétésvolontaires,Médecine,Pétrole,Bouréviestnik, etc...
1937.
1938.
1939.
1940.-Ilexiste86sociétéssportives.
1941.
1942. 1943. 1944.
1945.-Le16juin:Fusiondessixsociétéssportivesdescheminsdeferenuneseule,«"Lokomotiv"». Plustard,"Troud"englobera"Motor"et"Start". 1946.
1947.
1948.-Lessociétéssportivesdesovkhosessontrassembléesdanslasociété"Ourojaïv". 1949. 1950. 1951.
1952.
1953.-"Torpédo"»regroupetouteuneséried'associationssportives.
- Le 15 mars: Abolition du Comité d'Etat pour la Culture Physique et le sport et transfert de sesattributionsauMinistèredelaSanté.
1954.-Rétablissementd'unComitépourlaCulturePhysiqueetleSportprèsleConseildes Ministresd’URSS.
1955.
1956.-ALéningrad,1e ConférencesurlaPsychologieduSport. 1957.
1958.-Le3janvier:Promulgationdesstatuts-typesdelasociétésportivevolontaire.
-Enaoût,VIe Spartakiadesd'été,avec3.758participants.
-AMoscou,IIe ConférencesurlapsychologieduSport.
1959.-Aladatedupremierjanvier,oncompte2.500.000pratiquantsdont14.000maîtresès-sports et92.000classéspremièresérie.
-Le9janvier,arrêtéduComitéCentraletduConseildesMinistres.
- Le 18 avril, élection du Conseil Central de l'Union des Sociétés et Organisations Sportives d'URSS.
1960.-Ondénombre19sociétéssportivesvolontairesappartenantauxsyndicatset56.000groupes de culture physique, 5859 maîtres ès-sports, 88.000 sportifs classés en première série, 2000 écolesdesport.
-ALeningrad,IIIe ConférencesurlaPsychologieduSport.
Résumé
Avertissement
Extraitdesarchives
Textenonachevé
Jean-Marc SILVAIN