FÉVRIER 2025 – NUMÉRO 2
LE MAGAZINE D’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET SOCIALE DU CENTRE PATRONAL


FÉVRIER 2025 – NUMÉRO 2
LE MAGAZINE D’ACTUALITÉ ÉCONOMIQUE, POLITIQUE ET SOCIALE DU CENTRE PATRONAL

Au moment de la parution du présent numéro de Plein Centre, la campagne devrait battre son plein en vue de la votation populaire sur l’initiative cantonale «Baisse d’impôts pour tous – Redonner du pouvoir d’achat à la classe moyenne». Cette dernière, déposée le 5 avril 2023 avec 28’486 signatures valables, devait en effet, selon la Constitution cantonale, être soumise au vote le 5 avril 2025 au plus tard.
Hélas, on est bien loin d’un tel scénario, tant l’officialité s’est ingéniée (et s’ingénie encore) à tout faire pour retarder le moment où la votation pourra avoir lieu. Parmi les différentes manœuvres dilatoires auxquelles il a été recouru jusqu’à présent, la plus vile est probablement celle consistant, pour le Grand Conseil, à faire dépendre d’un rejet de l’initiative l’entrée en vigueur d’une remise en état du régime vaudois de bouclier fiscal – pourtant indispensable d’un point de vue constitutionnel, pour éviter une imposition confiscatoire.
Cette manœuvre a réussi grâce aux voix des députés de gauche, combinées à l’abstention de bien des députés du centre-droite (seuls les représentants de l’UDC se sont invariablement montrés soucieux des institutions). Les deux objets n’ont pourtant absolument rien à voir l’un avec l’autre. Les avoir liés pose de graves problèmes d’unité de la matière et de liberté de vote. Pour éviter une campagne de votation viciée et tronquée, des membres du comité d’initiative n’ont pas eu d’autre choix que de déposer une requête en justice, en l’occurrence devant la Cour constitutionnelle, à qui il incombe désormais de résoudre ces délicates mais fondamentales questions. Ces citoyens ont agi avec responsabilité et célérité, mais la procédure judiciaire ouvre bien entendu de nouvelles possibilités, pour l’autorité intimée, à savoir le Grand Conseil, de retarder encore les choses. Finalement, c’est peut-être le Tribunal fédéral qui aura le dernier mot.
La population vaudoise n’est donc vraiment pas près de pouvoir se prononcer sur le poids extrême des impôts cantonaux sur le revenu et la fortune. Logiquement, une votation populaire s’impose pourtant. C’est aussi une question de respect pour les plus de 28’000 signataires de l’initiative. Quant aux effets de ces manœuvres et du marasme actuel sur l’image de notre canton et de ses autorités, eh bien, comment dire…

de francs
Importations
CHF 222’308 millions
UE 157'305
Allemagne 53'872
Slovénie 17’947
Italie 23'702
France 16'120
Royaume-Uni 3'718
Etats-Unis 14'134
Chine 17’217
Japon 4’631
Reste du Monde 25'303
En 2024, le total des importations a atteint CHF 222,3 milliards (-1,6% par rapport à 2023). Les exportations ont augmenté de 3,2%, atteignant CHF 282,9 milliards. En termes réels, les importations ont reculé de 1,6% et les exportations ont progressé de 2,5%.
L’Union européenne reste notre principal partenaire commercial,
Fin 2023, 80% des personnes actives occupées étaient des pendulaires, autrement dit des personnes ayant un lieu de travail fixe situé hors de leur bâtiment d’habitation. Pour se rendre sur leur lieu de travail, 35% des pendulaires avaient tout au plus un quart d’heure de trajet, 32% entre 16 et 30 minutes, 24% entre 31 et 60 minutes et 9% plus d’une heure à parcourir.
En 2023, la part des titulaires du passeport suisse ayant également une autre nationalité était de 21% dans l’ensemble, mais variait considérablement d’une région linguistique à l’autre: elle atteignait 17% en Suisse alémanique, alors qu’elle s’élevait à 31% en Suisse romande et à 30% en Suisse italienne.
UE 144'324
Allemagne 41'697
Slovénie 26’393
Italie 20'302
France 13'542
Royaume-Uni 8'329
Etats-Unis 52'655
Chine 16’261
Japon 8’082
Reste du Monde 53’290
Exportations
CHF 282’941 millions
avec 70,8% des importations et 51% des exportations.
En tenant compte de l’or en barres et autres métaux précieux, des monnaies, des pierres précieuses et gemmes, ainsi que des objets d’art et des antiquités, le total des importations était de CHF 325,3 milliards et celui des exportations de CHF 393,2 milliards.
Janvier 2025 (décembre 2020 = 100)
La variation de l’indice général de janvier 2025 est de +0,4% par rapport au mois de janvier 2024. L’indice des prix calculé selon les anciennes bases est disponible
sur internet www.bfs.admin.ch, rubrique Statistiques > Prix > Prix à la consommation > Indexation, tableaux d’indexation (fichier XLSX) .
Source: Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, données 2024 provisoires

«La
position d’UBS est loin d’être hégémonique et la concurrence est bien présente.»
En mars 2023, Credit Suisse disparaissait à la surprise générale, du moins pour la majorité de la population. En décembre 2024, une Commission d’enquête parlementaire (CEP) a rendu son rapport au sujet de cette affaire.
Texte Gauthier Dorthe // Photos Keystone ATS
Sommairement, des années de mauvaise gestion interne couplées à des lacunes dans les interventions de la FINMA et un zeste de coopération insuffisante entre les autorités fédérales impliquées dans la gestion de la crise ont fourni la recette du cocktail conduisant à l’effondrement de la banque too big to fail.
Credit Suisse étant un acteur systémique, une faillite aurait notamment provoqué de graves perturbations sur les marchés financiers, diminué la confiance des investisseurs et atteint d’autres institutions interconnectées, par ricochet. Cela aurait induit un effet domino amenant de probables soubresauts économiques plus ou moins graves freinant par exemple l’accès au crédit pour les entreprises et les ménages. Afin d’éviter ces phénomènes, UBS a racheté
Credit Suisse sous l’impulsion de la Confédération.
L’un absorbant l’autre, le paysage bancaire helvétique est passé de deux acteurs too big to fail à un seul. La Suisse compte désormais un mastodonte parmi une myriade d’acteurs financiers de taille plus réduite. Il est normal de se demander si cela change fondamentalement quelque chose au sein de notre secteur financier, et plus précisément bancaire.
Une vocation aussi internationale
A l’échelon international, la Suisse reste une place financière de premier plan, dont les acteurs bancaires réalisent, en plus de l’octroi de crédits, de la gestion de comptes et du trafic des paiements, des activités de gestion de fortune importantes.
Leurs activités se concentrent auprès d’une clientèle privée, internationale souvent, en termes de gestion de fortune, auprès d’une clientèle institutionnelle en termes
d’asset management (gestion d’actifs) et auprès d’une clientèle dite Entreprises en termes de services de transactions sur les devises, d’émissions d’actions et d’obligations, ainsi que de financements commerciaux.
Les banques jouent un rôle clé dans les activités transfrontalières. Nul besoin de rappeler que la Suisse est un pays exportateur: elle a exporté en 2024 pour CHF 393,2 milliards de marchandises, avec un excédent de la balance commerciale de CHF 67,9 milliards. Les secteurs exportateurs les plus importants étaient alors la chimie et la pharmacie, la construction mécanique et l’horlogerie. Cependant, les chiffres du secteur des services sont en croissance. D’après la BNS, en 2023, l’exportation de services a atteint CHF 148,8 milliards, dont 23,7 concernaient des services financiers au sens large, donc de gestion de fortune et de réassurance notamment, qui représentent 16% des exportations totales de services.
Une nouvelle répartition des activités bancaires
La disparition de Credit Suisse a laissé UBS en position dominante. Elle a dû réorganiser son portefeuille d’activités, conservant les secteurs stratégiques tout en cédant certaines branches jugées secondaires. La banque d’investissement de Credit Suisse a été partiellement démantelée, avec des segments cédés à des acteurs étrangers comme Apollo Global Management, tandis que certaines équipes ont été intégrées chez UBS. Par ailleurs, les activités de banque privée ont été rationalisées: plusieurs bureaux en Europe et en Asie ont été fermés ou fusionnés avec ceux d’UBS, et les clients institutionnels ont été redirigés vers de nouvelles équipes de gestion de fortune.
Les banques cantonales, telles que la BCV, la ZKB et la BCGE, ainsi que le groupe Raiffeisen, ont rapidement réagi à cette reconfiguration. La BCV, par exemple, a élargi son offre de services pour les
La débâcle de Credit Suisse en quelques chiffres
Le rapport de la commission d’enquête parlementaire (CEP) a livré quelques données édifiantes sur la période de 2010 à 2022:
CHF 15 milliards: le montant des amendes et dommages-intérêts payés en lien avec des scandales financiers, pratiques douteuses et violations de régulation.
CHF 39,8 milliards: la somme des primes de performance (bonus) que la banque a continué à verser.
CHF 33,7 milliards: le cumul des pertes dues principalement à des investissements dans des fonds spéculatifs et des erreurs de gestion.
Ces éléments mettent en lumière une gouvernance défaillante, qui a amené une crise de confiance des investisseurs et des clients et entraîné la chute spectaculaire de 2023. Le cours de l’action a perdu plus de 90% dans la période considérée, sa capitalisation boursière chutant de presque 70 milliards à 11 milliards, avant le rachat par UBS pour CHF 3 milliards.
Credit Suisse avait été créé en 1856 pour financer les infrastructures ferroviaires. On ne peut que regretter sa disparition. (LP)
entreprises, en ciblant les PME qui bénéficiaient auparavant du soutien de Credit Suisse. De son côté, la ZKB a renforcé son département de financement des infrastructures et des projets publics en Suisse alémanique. Elle a par ailleurs ouvert une antenne institutionnelle en dehors du canton de Zurich, à Lausanne. Julius Bär et Lombard Odier, spécialistes de la gestion de fortune, ont vu affluer de nouveaux clients souhaitant diversifier leurs actifs après la disparition de Credit Suisse. Enfin, les banques étrangères, notamment américaines et britanniques, ont augmenté leur présence à Genève et à Zurich, profitant de l’espace laissé vacant dans le segment des banques d’investissement.
Accent sur les activités de crédits bancaires et hypothécaires L’accès au crédit bancaire et hypothécaire reste une question centrale. UBS, bien qu’étant un acteur dominant, ne peut absorber l’ensemble des besoins des PME et des particuliers. Les banques cantonales et Raiffeisen ont ainsi renforcé leur présence sur le marché des crédits.
Les crédits hypothécaires constituent une part importante des financements en Suisse. En 2023, plus de CHF 1’100 milliards étaient engagés sous forme d’hypo-
thèques. Les banques cantonales, qui détiennent près d’un tiers de ce marché, offrent des conditions compétitives en raison de leur connaissance approfondie des marchés locaux et de leur proximité avec les clients. Du côté des crédits aux entreprises, la concentration accrue autour d’UBS a poussé certaines PME à rechercher des solutions auprès de banques régionales ou d’établissements spécialisés. La ZKB a ainsi mis en place un programme de financement destiné aux start-up innovantes, facilitant l’accès à des capitaux à des taux préférentiels. De même, Raiffeisen a développé des solutions de leasing et de financement commercial adaptées aux besoins des agriculteurs et des artisans locaux, secteurs historiquement négligés par les grandes banques. Cependant, la disparition de Credit Suisse a également entraîné une augmentation des exigences en matière de garanties et de fonds propres pour certains emprunteurs, notamment dans les secteurs jugés plus risqués comme l’hôtellerie et la restauration. Certaines entreprises signalent un durcissement des conditions d’octroi de crédits, particulièrement pour les nouveaux entrants sur le marché. Ce phénomène pourrait à terme

Emploi et fiscalité
Les banques établies en Suisse occupent pas moins de 158’500 employés (ETP). En tenant compte de la fourniture de prestations intermédiaires aux établissements bancaires ainsi que des dépenses de consommation de leur personnel, 169’500 personnes extérieures au secteur financier sont liées aux activités économiques des services bancaires. On constate un rapport de 107%: chaque emploi dans les services bancaires au sens strict entraîne un emploi supplémentaire. C’est un secteur qui génère du travail et qui assure un total de 328’000 ETP, soit 7,4% de l’emploi suisse global.
En ce qui concerne les impôts directs, le secteur bancaire se trouve être un contribuable considérable, notamment du fait de l’imposition des bénéfices des banques et de l’imposition des revenus des employés. En 2023, les impôts directs versés aux autorités fédérales, cantonales et communales atteignaient CHF 7 milliards. En considérant la création de valeur indirecte du secteur bancaire et les impôts qui lui sont liés, CHF 1,5 milliard supplémentaire peut être ajouté pour un total de CHF 8,5 milliards. A titre de comparaison, les dépenses de la Confédération pour l’éducation et la recherche se sont élevées à CHF 7,7 milliards.
Il est bon de noter que les transactions sur le marché financier et l’achat de services financiers donnent aussi lieu à des prélèvements fiscaux. En 2023, l’impôt anticipé, la taxe sur la valeur ajoutée et les droits de timbre ont généré à eux seuls quelque CHF 9,1 milliards de recettes pour nos autorités.
Source: Association suisse des banquiers –Etude d’importance 2024
«A l’échelon international, la Suisse reste une place financière de premier plan.»

ralentir certains investissements et peser sur la dynamique économique, bien que les autorités financières suisses surveillent de près ces évolutions.
Un débat sur la régulation
On le voit, la position d’UBS est loin d’être hégémonique et la concurrence est bien présente. Par ailleurs, le système bancaire suisse est déjà extrêmement réglementé. Pourtant, certains experts et régulateurs appellent à un renforcement des exigences en fonds propres pour les banques d’importance systémique, afin d’éviter une nouvelle crise. L’idée d’une séparation stricte entre les activités de banque de détail et celles d’investissement, comme le préconisait déjà le modèle Glass-Steagall aux Etats-Unis, refait surface.
Cependant, d’autres, plus pragmatiques, considèrent qu’un excès de réglementation risquerait de fra-
giliser la compétitivité de la place financière suisse. La FINMA pourrait exiger d’UBS une plus grande transparence sur ses stratégies de gestion des risques et ses engagements en matière de liquidités. Par ailleurs, la BNS surveille de près l’impact de cette consolidation bancaire sur la stabilité monétaire et le crédit aux entreprises. Le cas d’UBS n’est pas isolé: d’autres banques systémiques en Europe, telles que Deutsche Bank et BNP Paribas, font face aux mêmes défis de concentration et de surveillance accrue. La pression politique pour empêcher une nouvelle crise bancaire se fait de plus en plus forte, notamment sous l’impulsion du G20 et du Conseil de stabilité financière.
La Suisse, pays de la stabilité financière justement, se retrouve désormais avec un mastodonte bancaire dont la taille représente un défi en matière tant de sur-
veillance que de concurrence. Si une réglementation trop stricte risquerait d’entraver l’innovation et la croissance, une supervision insuffisante pourrait conduire à de nouvelles crises systémiques. Les prochaines décisions en matière de régulation devront donc trouver un équilibre délicat entre contrôle et flexibilité. Car si UBS semble aujourd’hui trop grande pour faire faillite, il reste à espérer qu’elle ne devienne pas trop lourde pour avancer.
Lancée pour la première fois en Suisse – à Renens – il y a cinq ans, 42 a la particularité d’être une école de programmation informatique gratuite et accessible sans diplôme. Des singularités qui sont évoquées avec son président et son directeur, en un entretien à deux voix.
Propos recueillis par Christophe Reymond
Avant tout, expliquez-nous ce qu’est une école 42?
La première école 42 a ouvert à Paris en 2013 à l’initiative de Xavier Niel, qui est, entre autres, le propriétaire de Salt. Actuellement, il existe 56 écoles du réseau 42, qui forment plus de 15’000 étudiantes et étudiants dans plus de 20 pays. Elles sont reconnues comme faisant partie des meilleures écoles de développement informatique du monde.
Il y a plus de 250 dossiers de candidature pour ouvrir d’autres écoles partout dans le monde. En Suisse, nous avons l’ambition d’ouvrir également une école 42 à Zurich.
Quelle est la structure juridique des écoles?
Chaque école est une entité à but non lucratif. Toutes sont financées par des fondations, des Etats ou des entreprises privées. A Lausanne, le financement est assuré par des entreprises privées, des organisations économiques et des fondations. Le Centre Patronal a d’ailleurs été l’un des mécènes dès la création.
Quelle est au fond sa vocation?
De former les personnes qui ont une forte motivation et le talent pour devenir développeur. Et aussi de fournir aux entreprises mécènes les professionnels dont elles ont un besoin criant.
Comment est née l’idée d’ouvrir un campus 42 à Lausanne?
Pour répondre à la pénurie de développeurs à laquelle font face toutes les entreprises en Suisse. Et pour mettre en valeur les talents qui existent et qui ne peuvent pas s’exprimer par l’absence de moyens financiers, de diplômes ou parce que le système d’éducation habituel ne leur est pas adapté.
Comment est financé 42 Lausanne?
Dès le début, nous avons considéré que c’est à l’économie privée de financer l’école parce qu’elle
en tire un bénéfice immédiat, à savoir trouver les talents qui lui font défaut. A notre avis, il ne serait pas pertinent de retirer des moyens à l’Etat, qui a une mission de formation généraliste.
Il faut savoir que le coût annuel de formation par tête chez 42 Lausanne est de CHF 3’500.–. Cela se situe en deçà des CHF 25’000.– à 30’000.– d’une HES, par exemple.
Le modèle est-il viable?
Oui, tant que 42 Lausanne apportera une valeur ajoutée aux entreprises. Au vu des premiers résultats et des perspectives de pénurie de professionnels dans la branche informatique, 42 Lausanne a encore une raison d’être pour de nombreuses années.
Comment qualifier la pédagogie utilisée?
On y apprend d’une manière différente, en développant de vrais projets en équipe, sur la base d’un cursus «gamifié». L’école n’a pas de professeurs, se déroule en présentiel, est gratuite et offre une formation complète pour faire face aux enjeux du numérique. Il n’y a aucun prérequis à l’entrée. Il faut juste avoir au minimum 18 ans et réussir le test d’admission en ligne, puis les quatre semaines intensives de tests que nous nommons «Piscine».
Quels sont les profils de vos étudiants?
L’âge moyen est de 28 ans. Il y a 80% d’hommes et 20% de femmes. Un tiers possède un titre universitaire, un tiers une formation de type CFC et un dernier tiers n’a pas de formation professionnalisante. En revanche, 80% ont déjà une expérience professionnelle. Le point commun de chacun consiste en une motivation très forte pour devenir développeur.
Combien en formez-vous chaque année?
Nous avons 2’500 candidats par année. Après deux étapes de sélection (test en ligne et Piscine), nous retenons entre 150 et 200 personnes. A ce jour, nous avons plus de 500 étudiantes et étudiants dans le cursus.
Le taux de réussite des formations gymnasiales dans le canton de Vaud est désormais public, établissement par établissement. L’Etat en a décidé la publication après avoir déjà réalisé celle des épreuves cantonales de référence (ECR) à la suite d’un recours de 24 heures auprès du préposé cantonal au droit à l’information, fondé sur la loi sur la transparence.
Texte Baptiste Müller // Photo Keystone ATS
Que nous révèlent ces chiffres? Tout d’abord que la moyenne cantonale de réussite de l’Ecole de maturité entre 2019 et 2023 s’élève à 93,5%.
Nyon est en tête avec 96,6% tandis qu’Yverdon-les-Bains ferme la marche à 89,9%. Du côté de l’Ecole de culture générale (ECG), la moyenne cantonale est de 89,6%, avec le Bugnon à 94,6% et Renens en queue de peloton à 85,5%.
Le Département de l’enseignement et de la formation professionnelle marche par ailleurs sur des œufs pour expliquer que les taux de réussite d’un gymnase à l’autre ne sont pas comparables et ne constituent pas un ranking, les examens n’étant pas identiques entre les établissements, sans compter les différences sociodémographiques entre les régions. Ces explications sont tout à fait rationnelles.
Une maturité déjà très accessible Il n’y a pas grand-chose d’autre à tirer de l’évolution entre les années des différents établissements. On en restera donc surtout au chiffre de 93,5% de réussite de la maturité, qui surprend. Ce taux, déjà plutôt élevé dans l’absolu, l’est encore plus dans le cas d’espèce. En effet, dans un canton où 46% des élèves quittant l’école entrent directement au gymnase, ce qui est presque un record sur le plan suisse, un tel taux de réussite paraît particulièrement haut. On pourrait s’attendre à ce que la maturité gymnasiale, cette formation tellement exigeante et astreignante qu’il faut en allonger la durée d’une année, présente un taux de réussite

«On pourrait s’attendre à ce que la maturité gymnasiale, cette formation tellement exigeante et astreignante qu’il faut en allonger la durée d’une année, présente un taux de réussite plus bas.»

plus bas. Mais non. Dans ces conditions, à quoi bon la passer à quatre ans? Les élèves n’en ont manifestement pas besoin, puisqu’ils achèvent déjà avec succès le programme dans un gymnase en trois ans. Ce chiffre ne mesure bien sûr que la réussite tout au bout du parcours. On nous rétorquera donc qu’une partie des élèves seulement le finissent en trois ans, puisque environ 40% des gymnasiens redoublent une année et effectuent donc déjà, dans les faits, un gymnase en quatre ans. Ce n’est toujours pas une bonne raison pour obliger les autres à réaliser une année de plus, mais passons. Il faut aussi prendre en compte le nombre d’élèves qui se détournent de la maturité à la fin de la première année. Ils seraient 30%, d’après une communication de l’Etat de Vaud datant de 2019, et même 40% en Ecole de culture générale! Il n’y a pas de raisons de penser que les chiffres aient beaucoup changé depuis.
Gymnase en quatre ans, quo vadis?
Evolution imposée par les autres cantons, la maturité gymnasiale en quatre ans sera une réalité en 2038 au plus tard. Un immense chantier sur le plan des ressources pour l’Etat de Vaud, mais aussi une grande occasion de modifier la fin de la scolarité obligatoire pour valoriser davantage la formation professionnelle. Les travaux sont en cours. Seuls les milieux scolaires y sont représentés, mais les milieux économiques sont régulièrement consultés. Le sujet ne manquera pas d’occuper ces pages dans les prochaines années.
Un écrémage relatif Il y a donc un certain écrémage entre la fin de la scolarité, où le gymnase est particulièrement attractif, et la réussite de la maturité. Mais celui-ci reste léger dans la mesure où le taux de maturité gymnasiale à 25 ans s’élève à 32,6% sur Vaud, alors que la moyenne suisse est de 22,9%. Ces données relativisent donc le taux de réussite, qui semblait bien impressionnant au premier regard. Elles mettent surtout en lumière l’importante inefficience du système vaudois de formation, qui fait de la voie gymnasiale la plus grande école de transition, à laquelle une grande partie des jeunes vont «par défaut» et dont un nombre important finit par réaliser, tardivement, un apprentissage, portant son âge moyen à l’entrée à 19 ans.
Ce qui serait véritablement intéressant, en revanche, serait de disposer des taux de réussite en première année d’Université, en fonction du canton de réalisation de la maturité gymnasiale. Un tabou pour les cantons, qui ne les ont jamais publiés. On peut raisonnablement douter que les Vaudois trustent la première place.
Au fond, ces chiffres nous en apprennent moins sur le système vaudois qu’ils ne renforcent la conviction que le gymnase en quatre ans n’apportera rien. Il s’agira donc de bien repenser la fin de la scolarité obligatoire pour éviter les conséquences néfastes de cette réforme. Heureusement, dans ce domaine-là, le canton garde encore un peu de compétence et n’est pas entièrement soumis au diktat intercantonal… pour l’instant.

Dans les pas perdus des tribunaux suisses, un léger vent de malaise s’est levé, soufflé tant par des recommandations internationales que par les résultats d’un sondage effectué auprès des juges.
En cause: les liens entre la justice et les partis politiques.
Texte Tatiana Rezso // Photo Shutterstock
Parce qu’il est censé être à l’image des justiciables et de leur diversité, le troisième pouvoir est structuré en fonction des forces politiques représentées au Parlement. Si la justice est empreinte de nombreux rituels, celui de l’élection d’un nouveau juge fédéral revêt donc une couleur particulière. Lorsqu’une place se libère, le candidat est présenté à l’Assemblée fédérale par un parti politique, dont il accepte a priori les valeurs défendues. Une fois qu’il est en place, l’éthique de sa fonction impose pourtant au juge l’impartialité et la neutralité. Il continue cependant à se soumettre à des réélections régulières durant sa carrière, sous les mêmes couleurs partisanes.
Si ce processus peut surprendre, il a pour but une représentation au sein de la justice des courants de la société. La fiabilité des institutions n’est pas remise en question par la seule appartenance partisane; les juges sont élus surtout pour leurs compétences et leur capacité à rendre des décisions neutres, impartiales et techniquement correctes. Cependant, la carte d’un parti politique ne suffit pas au bon déroulement d’une carrière de juge, puisque celui-ci doit aussi rétribuer le parti qui le présente régulièrement. Cette «contribution de mandat» due chaque année est fixée par les partis et les montants ne sont pas négligeables. Dans un sondage, 72% des juges indiquent payer cette contribution et, pour 60%
d’entre eux, le montant varie entre CHF 2’000.– et CHF 10’000.–. Ce sondage a aussi permis aux juges de signaler une désapprobation certaine, 83% des magistrats sondés estimant que la contribution porte atteinte à leur indépendance.
La séparation des pouvoirs est l’un des principes cardinaux d’un bon système politique et l’indépendance de la justice a donc une portée particulière, parce qu’elle garantit des décisions impartiales et justes. Bien que 72% des sondés indiquent ne pas être influencés par «l’impôt de parti» pour les décisions qu’ils doivent rendre, et bien qu’ils n’aient formellement pas de comptes à rendre aux partis, l’apparence d’indépendance en souffre toutefois. Le Groupe d’Etats contre la corruption (GRECO) a d’ailleurs émis une recommandation de réforme, estimant que ces contributions représentaient un risque.
Alors que le malaise des tribunaux ne fait pour l’heure que peu de bruit, il est vivement souhaitable que les partis, de tous bords, parviennent à réfléchir au-delà de leur simple intérêt financier, et envisagent de mettre en œuvre une nécessaire réforme.
Sondage 2024 auprès des juges suisses, par l‘Association Suisse des Magistrats, disponible sur:
A la fin du mois de décembre dernier, le Conseil fédéral a annoncé l’achèvement «matériel» des négociations avec l’Union européenne sur ce qu’on appelle les «Bilatérales III». Les textes n’étant pas publiés, il est trop tôt pour se prononcer. Mais les gesticulations des syndicats ne justifient en tout cas pas à elles seules un rejet.
Texte Sophie Paschoud // Photo Shutterstock
Après l’échec de l’accord-cadre institutionnel, la Suisse et l’Union européenne sont finalement parvenues à s’entendre sur les éléments propres à stabiliser la voie bilatérale. Ainsi, le 20 décembre 2024, le Conseil fédéral annonçait l’achèvement «matériel» des négociations. Le texte des accords n’est pas encore connu, mais l’on sait déjà que la Suisse a en particulier dû faire quelques concessions dans le domaine de la protection des salaires en lien avec les travailleurs détachés. Les syndicats poussent des cris d’orfraie et dénoncent une inacceptable détérioration des conditions salariales. Leurs récriminations portent en particulier sur trois aspects: le délai d’annonce, le remboursement des frais et les limitations au droit d’imposer des cautions aux entreprises. Ce dernier point ne sera pas abordé ici.
Le délai d’annonce
L’activité des travailleurs détachés par une entreprise ayant son siège dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) doit – à quelques exceptions près – faire l’objet d’une annonce au moins huit jours calendrier avant le début des travaux en Suisse. L’objectif de ce délai est d’accorder aux organes compétents le temps nécessaire à l’organisation de contrôles sur le respect des conditions de travail et de salaire.
Dans le cadre des négociations avec l’UE, la Suisse a accepté d’abaisser le délai d’annonce à quatre

jours ouvrables. Selon certains, ce délai serait bien trop court et rendrait impossible tout contrôle lors de travaux de très courte durée. Il semblerait toutefois que les difficultés, réelles, que poserait cette nouvelle règle tiennent avant tout au manque d’efficience de la procédure actuelle. En effet, une fois les annonces effectuées en ligne sur le portail de la Confédération, celles-ci sont transmises aux cantons, qui les adressent à leur tour aux organes de contrôle compétents, par voie postale semble-t-il, du moins dans certains cas.
Ce problème est toutefois identifié et des mesures d’optimisation et de développement de la procédure d’annonce en ligne sont en cours. On peut donc espérer que, d’ici l’entrée en vigueur des Bilatérales III – sur lesquelles on ne votera selon toute vraisemblance pas avant 2028 –, cette préoccupation n’en sera plus une, ou sera, au moins, en passe de ne plus l’être.
Le remboursement des frais En cas de détachement en Suisse, les travailleurs doivent percevoir une rémunération équivalente à celle applicable aux salariés indigènes. Cette règle vaut aussi au sein de l’Union européenne selon le principe «salaire égal pour un travail égal au même endroit».
En revanche, en vertu de la directive européenne 2018/957, les frais liés au détachement en tant que tel (en particulier les dépenses de voyage, de loge-

«Environ 80% des travailleurs détachés proviennent de pays qui connaissent une réglementation des frais comparable à celle de la Suisse.»
ment et de nourriture) devraient être remboursés sur la base des normes applicables dans l’Etat de provenance, alors que la législation suisse actuelle impose qu’ils le soient sur la base du droit helvétique.
C’est cet élément qui met le plus les syndicats en émoi, lesquels annoncent à grands bruits une inéluctable explosion du dumping salarial.
Si la reprise du droit européen à cet égard constituerait indéniablement une régression, il s’agit tout de même d’en relativiser l’importance. En effet, comme l’indique le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), relayé par 24 heures du 13 janvier, environ 80% des travailleurs détachés proviennent de pays voisins, qui connaissent une réglementation des frais comparable à celle de la Suisse. Les situations potentiellement problématiques ne concerneraient, sur la base des chiffres 2023, que 0,3% de l’ensemble des salariés en Suisse.
Par ailleurs, un tiers des missions effectuées en Suisse par des entreprises de détachement ne durent qu’un jour, et trois quarts d’entre elles durent moins de cinq jours. Cela signifie corollairement que les frais encours à ce titre sont fortement limités. Enfin, selon la directrice du SECO – citée par Le Temps du 7 février dernier –, seize pays de l’UE (sur vingt-sept!) n’appliquent pas la règle incriminée. Il y a lieu d’en déduire que la Suisse pourra – et devra –maintenir les exigences qu’elle connaît aujourd’hui. On ne voit en effet pas pour quel motif elle devrait faire du zèle.
Quoi qu’il en soit, il s’agira, lorsqu’ils seront disponibles, d’étudier minutieusement les textes des Bilatérales III et de juger, à ce moment-là, s’ils sont acceptables ou non au regard des intérêts helvétiques. Mais une chose est sûre: si les aspects négatifs se limitent aux points somme toute mineurs énumérés ci-dessus, il sera vite répondu à la question.
La RTS a décidemment un problème avec les statistiques. Après les écarts salariaux entre hommes et femmes (voir Plein Centre de janvier), ce sont les discriminations et violences «sexualisées» au sein de l’armée qui font l’objet d’un traitement erroné par le service public. Ainsi, au début du mois de janvier, la RTS a consacré un reportage à ce sujet et publié un article sur son site. Celui-ci indiquait notamment ce qui suit: «Il y a quelques semaines, une étude a révélé que plus de 80% des soldats ont subi des comportements ou des violences dites “sexualisées”.»
La réalité est la suivante. Une enquête a été menée par l’Armée auprès de 4’170 personnes, à laquelle 1’126 ont répondu, dont plus de 67% de femmes, lesquelles ne représentent que 1,6% des effectifs de l’armée. 81% des répondants ont indiqué avoir subi des remarques ou des blagues sexistes pendant le service. Il aura fallu qu’un lecteur s’offusque du traitement biaisé de l’information, puis s’adresse à la médiatrice, pour que la RTS daigne reconnaître n’avoir pas présenté «de manière fiable» ces «importants éléments de contexte ayant trait à la méthodologie» de l’étude, s’excuse de «cette erreur très regrettable, qui ne reflète nullement un positionnement» de la rédaction et publie, le 9 janvier, une version modifiée de l’article.
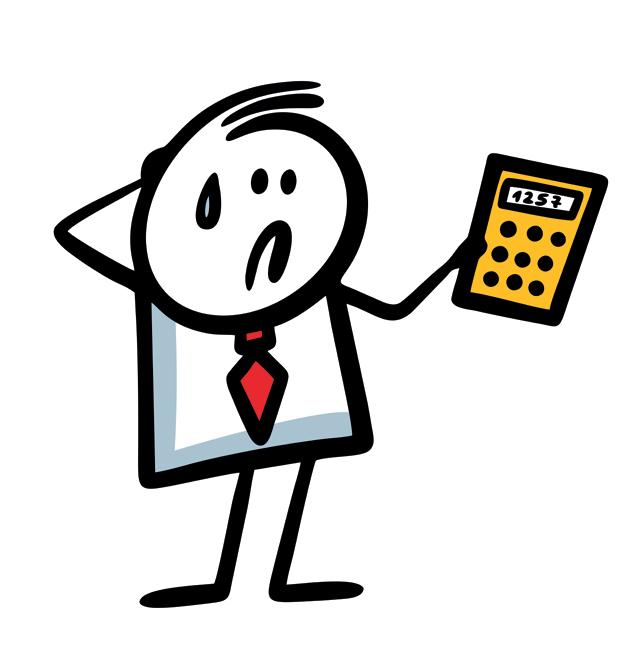
Nous n’avons pas de conseils à donner à la RTS, mais si elle tient réellement à sa – si chère – redevance, il va falloir qu’elle fasse un effort sous l’angle de la qualité et des compétences de ses journalistes. (PAS)

A l’occasion du Forum économique de Davos, la Suisse a signé deux nouveaux accords de libre-échange, l’un avec la Thaïlande, l’autre avec le Kosovo. Ces accords lient aussi les autres Etats de l’AELE.
La Thaïlande est la deuxième économie d’Asie du Sud et le deuxième partenaire commercial de la Suisse dans cette région, après Singapour. Elle représente désormais un site industriel important. En l’occurrence, la Thaïlande s’engage à réduire ou à supprimer ses droits de douane sur un grand nombre de produits industriels tels que les montres, les produits pharmaceutiques et les machines. En plus d’un chapitre désormais habituel sur la durabilité, l’accord avec la Thaïlande est un des premiers à contenir aussi un chapitre sur les PME. Quant au Kosovo, les échanges commerciaux bilatéraux avec ce pays représentent actuellement CHF 140 millions. Le nouvel accord devrait stimuler ces échanges. (PGB)
Imaginez la scène. Le décor est celui d’une conférence de presse. Face aux médias, les candidats au Conseil d’Etat et les présidents des partis de centre-droite présentent l’initiative populaire qu’ils sont en train de lancer pour diminuer progressivement de 10% l’imposition des personnes physiques. Il est question d’une «véritable offensive fiscale». De «redonner du pouvoir d’achat à la population. Une baisse d’impôts, c’est un cercle vertueux qui stimule la consommation, l’économie locale, et qui profitera à toutes et tous». On parle aussi de «conserver nos contribuables en évitant qu’ils fuient vers d’autres cantons où la fiscalité est plus intéressante», en ajoutant «qu’il faut des dépenses plus efficientes sans baisser les prestations et sans augmenter les taxes». Délire mythomane? Rêve éveillé d’un citoyen vaudois qui, malgré tout, veut y croire encore? Vous n’y êtes pas: la scène, bien réelle, s’est déroulée le 17 janvier dernier chez nos voisins neuchâtelois. Autres lieux… (OR)


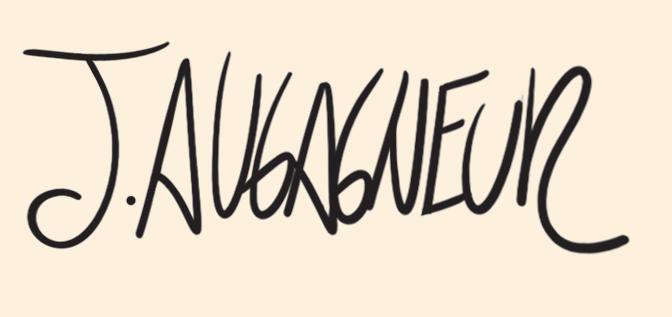

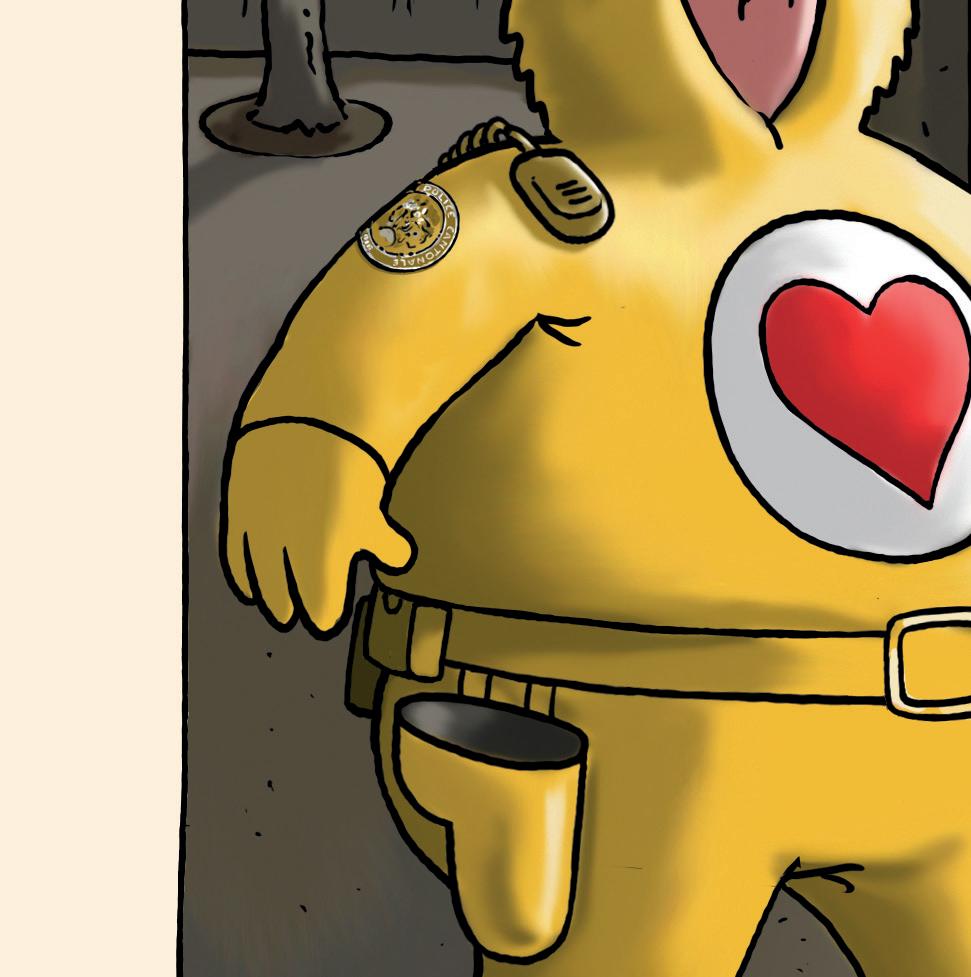


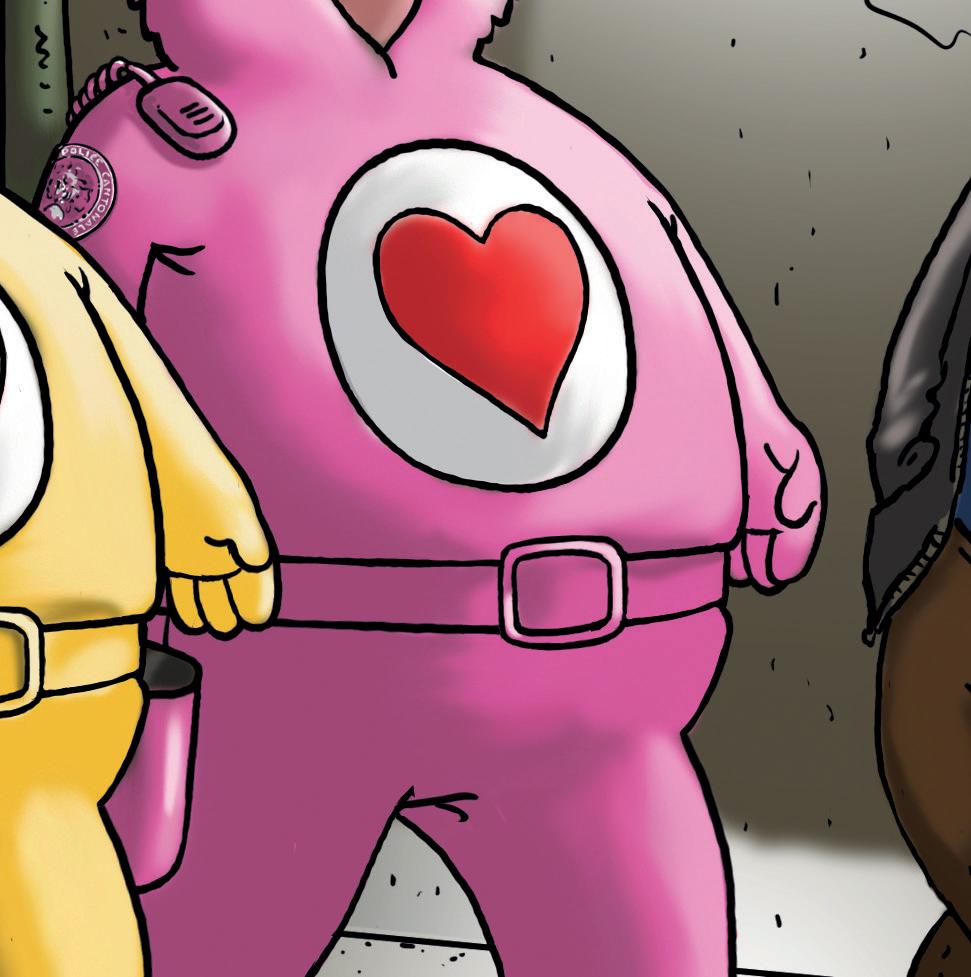













































































































































































Dans cette révision promise et attendue qui touche de près les entrepreneurs, l’Administration cantonale des impôts reste malheureusement au milieu du gué.
Texte Jean-Blaise Roggen // Photo Shutterstock
Selon la législation en vigueur, l’estimation fiscale des titres non cotés en bourse doit s’établir à leur valeur vénale. Or, quand on possède des titres de sa propre entreprise dans sa fortune privée, une telle estimation s’avère très complexe. A part le bilan de sa société (valeur comptable), le contribuable est bien souvent très emprunté pour mettre en avant une quelconque valeur vénale. Pour pallier cela, le Canton de Vaud a notamment émis, dès 2021, une réglementation (règlement sur l’estimation des titres non cotés et des titres non régulièrement cotés en bourse ou hors bourse pour l’impôt sur la fortune – RETIF) sur l’estimation fiscale de ces titres, qualifiés d’«outil de travail». Le cœur de ce dispositif, déjà modifié en 2022, est une méthode d’évaluation dont l’équation de base est la suivante:
Valeur de l’entreprise =
2 x valeur de rendement + 1 x valeur substantielle (comptable)
3
(Valeur de rendement = moyenne des résultats nets sur trois ans capi-
talisés à l’aide d’un taux de capitalisation donné; plus ce taux est élevé et plus cette valeur est donc basse. Valeur substantielle = actifs nets comptables augmentés de certaines réserves latentes nettes d’impôt.)
Des allégements à des conditions encore bien strictes
L’article 3 RETIF prévoit que le taux de capitalisation utilisé pour obtenir la valeur de rendement de l’entreprise dans la formule décrite plus haut s’élèvera à 16%, pour autant que l’actionnaire (personne physique) remplisse un certain nombre de conditions assez draconiennes. Ces conditions ont été précisées par d’autres exigences, que l’Administration cantonale des impôts vient de retoucher en décembre 2024. Ainsi, les principales modifications portent sur les points suivants:
L’exigence d’une détention minimale de 10% de participation pour les micro-entreprises (de 5 à 10 employés) remplace le précédent seuil de 25% de participation dans la société.
La condition de détention (par le biais d’un pacte d’actionnaires) d’une majorité qualifiée de 50% plus une voix de vote est (hélas) maintenue, mais certaines exigences concernant le pacte d’actionnaires ont été assouplies (notamment sur la gestion/administration de leurs droits de participation en commun).
S’agissant de l’exigence de la rémunération adéquate d’une fonction dirigeante, la directive se réfère maintenant à une conformité de la rémunération à l’ensemble des circonstances et n’exige plus, dans certains cas, qu’un rapport entre la rémuné-
ration brute (fixe et variable) du détenteur de participations et le bénéfice net de la société augmenté de la rémunération brute (fixe et variable) du détenteur de parts de 50% et plus au minimum (contre 70% par le passé).
Des interférences
Ces ajustements sont bien sûr bienvenus au regard de la directive initiale de 2022, mais les contraintes fondamentales qui pèsent sur les actionnaires sont maintenues. Ainsi, la fiscalité personnelle de l’actionnaire et ses charges AVS sont hélas toujours négativement touchées par cette réglementation. Dans le même temps, l’instabilité des
dispositions réglementaires a de quoi étonner (trois en quatre ans!). Pourtant, l’effet le plus négatif de cette réglementation est peutêtre à rechercher ailleurs. En effet, l’immixtion du fisc dans la politique salariale et dans la politique de distribution des bénéfices des sociétés (surtout de taille modeste) a un impact clairement négatif sur la liberté entrepreneuriale. En soi, une telle ingérence interfère d’un peu trop près avec certains éléments stratégiques clés de la pérennité et de la croissance des acteurs les plus essentiels à tout écosystème: les PME.
Déterminer si un travailleur doit être assuré contre les accidents non professionnels (AANP) est parfois compliqué. Voici un rappel des règles à appliquer.
Texte Laetitia Schriber
Selon l’article 13 alinéa 1 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents, les travailleurs à temps partiel occupés chez un employeur au moins 8 heures par semaine sont également assurés contre les accidents non professionnels. Savoir si cette moyenne est atteinte est parfois compliqué à déterminer lorsque le contrat ne prévoit pas de durée de travail fixe. Selon la recommandation de la Commission ad hoc Sinistres LAA n° 7/87, à laquelle s’est référé le Tribunal fédéral (Arrêt 8C_859/2012), la couverture
AANP doit être admise si l’une des conditions suivantes est remplie: la durée de travail moyenne hebdomadaire atteint au moins 8 heures ou les semaines comp-
tant au moins 8 heures de travail sont prépondérantes. La période déterminante pour le calcul est celle des trois ou douze derniers mois. Si, pendant la période déterminante, les semaines (entières) au cours desquelles le travailleur a été occupé (une heure de travail suffit) sont prépondérantes, seules les semaines travaillées sont prises en compte pour le calcul.
Exemple: T a cumulé 58 heures de travail durant les 12 dernières semaines. Il a travaillé entre 2 et 10 heures par semaine, à l’exception de 3 semaines pendant lesquelles il n’a pas travaillé. Dans ce cas, seules les semaines de travail sont prises en considération pour le calcul, puisqu’elles sont plus nombreuses (9 travaillées sur 12). En moyenne, T
a travaillé 6,4h par semaine (58/9).
La première condition de l’AANP n’est donc pas remplie. Cependant, sur les 9 semaines travaillées, 5 totalisent 8 heures ou plus. Comme les semaines comptant 8 heures sont prépondérantes (5 contre 4), T sera couvert en AANP, en application du deuxième critère. A noter que les heures manquées à cause d’une maladie ou d’un accident sont prises en compte si elles permettent d’atteindre la moyenne de 8 heures. Afin d’assurer une couverture correcte à ses travailleurs irréguliers, l’employeur serait donc bien avisé de calculer la durée moyenne travaillée dès le quatrième mois des rapports de travail, puis régulièrement. Le calcul le plus favorable au travailleur prévaut.

Le 13 mars 2025, de 8h à 16h, le Centre Patronal organise à Paudex un séminaire en marketing digital avec divers ateliers, notamment: diagnostic digital, travailler avec LinkedIn, l’IA pour votre stratégie digitale, stratégie B2B.
Inscription sur le site www.centrepatronal.ch, rubrique «actualité & événements»
Prix pour les membres de la Fédération patronale vaudoise: CHF 80.–; prix pour les non-membres: CHF 200.–
Suivez-nous sur les réseaux sociaux et développez votre réseau de contacts