






















































PAR ZYAD LIMAM
Fin ma i 2 022, voyage à Tunis, avec les sensations, les différences et les convergences entre ce que l’on lit et l’on entend à l’extérieur et ce que l’on ressent sur place. Cette magnifique baie de Tunis tout d’abord, la mer Méditerranée, lorsque l’on atterrit. Le premier contact avec l’aéroport, Tunis-Carthage, qui semble tel un vieux navire amiral, saturé et épuisé. Cette sensation d’activité, de fourmillement, avec les embouteillages, les immeubles flambant neufs, tous ces nouveaux quartiers, qui encerclent de plus en plus l’ancien centre-ville, ces autoroutes urbaines, ces embouteillages permanents, ces gens, nombreux, qui conduisent comme de véritables dingues, des dangers publics pour eux-mêmes et pour les autres. Il y a ces restaurants pleins, ces marchés animés, ces boutiques achalandées. Et cette impression pourtant que tout coûte cher, horriblement cher. Il y a ces grands bateaux que l’on voit dans la rade du port, au large, et dont un spécialiste me dit qu’il s’agit de cargaisons de blé qui attendent un paiement avant de débarquer… Il y a ces hôtels complets, un peu partout de Tunis à Djerba, avec les touristes qui reviennent en masse. Il y a eu le pèlerinage de la Ghriba, un véritable succès avec des centaines de fidèles venus se recueillir et festoyer dans l’une des plus anciennes synagogues du monde arabe. Avec les sempiternelles polémiques stériles sur les relations entre la Tunisie, sa diaspora juive et les passeports qu’elle détient…
Une dame évoque une urgence médicale, un séjour dans une clinique privée, avec des médecins et des équipements dignes de l’Europe, de la médecine du premier monde. Et puis, il y a ces hôpitaux publics qui faisaient autrefois la gloire de la Tunisie et qui luttent, se déglinguent, malgré le dévouement et la qualité des équipes. Un peu comme l’école et les universités.
Il y a cette Tunisie fonctionnelle, dans son siècle, celle des gens aisés, qui semble surfer sans
trop de problèmes sur la vague des incertitudes. Cette autre Tunisie, celle des classes moyennes et des gens modestes, fragilisés, qui voient l’inflation et la paralysie économique rogner les revenus et les salaires. Cette autre encore, celle du bled, ou des banlieues pauvres, ou des régions déshéritées, et qui semble comme prostrée. Cette Tunisie enfin qui vit de l’économie informelle, du cash et des dinars qui passent de main en main, une Tunisie pas franchement légale, mais qui sert probablement de matelas ou d’amortisseurs à toutes les autres.
Il y a ces discussions passionnantes avec une jeunesse toujours mobilisée, ces acteurs de la société civile, ces artistes qui cherchent toujours plus d’espaces de liberté. Il y a ces sportifs émérites comme la tenniswoman Ons Jabeur (qui est entrée dans le top 5 mondial) ou le nageur Ahmed Hafnaoui (médaille d’or sur 400 mètres nage libre aux JO de Tokyo 2021). On inaugure une rue de La Goulette du nom de Claudia Cardinale, et la star italienne, 84 ans, était présente, là, dans la ville où elle est née, témoignage émouvant sur les origines multiples de la tunisianité.
Il y a ces entrepreneurs qui cherchent à investir, malgré la crise, à ouvrir les marchés de l’avenir (santé, digital, services…). Et puis, il y a aussi ces chiffres désespérants, ceux de l’émigration, ces hommes, femmes et enfants, pauvres ou fortunés, qui s’échappent, pour aller vivre ailleurs. Il y a ces villes, ces campagnes, qui donnent une nette sensation de laisser-aller, cette impression que tout cela n’est pas très propre et que tout le monde s’en fiche, cet espace du bien commun qui paraît comme délaissé et abandonné. Comme si les Tunisiens se refermaient sur leur « sphère privée », sur leur vie, leur chez-soi, leur business, tout en délaissant une sphère « publique » jugée épuisante, dysfonctionnelle, sans espoir…
En ce fin mai-début juin, tous les écrans sont occupés par le président de la République, Kaïs
Saïed. Près d’un an après avoir dissous le Parlement et pris de lui-même les pleins pouvoirs (c’était le 25 juillet 2021), le président accélère, fonce même… Il n’a pas froid aux yeux, il a un plan qu’il veut imposer, il le dit depuis des mois, voire des années. Kaïs Saïed veut transformer, refonder la Tunisie, balayer les structures héritées de l’avantrévolution et de l’après-révolution. Il veut faire naître une nouvelle république, aux contours plus ou moins définis, qui serait réellement révolutionnaire. Où le peuple et le président se partageraient la légitimité et la souveraineté, balayant au passage tous les corps intermédiaires, partis, institutions, justice… Il veut lutter contre la corruption, perçue comme systémique. Pour le huitième président de la République (après Habib Bourguiba, Zine el-Abidine Ben Ali, l’intérim de Mohamed Ghannouchi, Fouad Mebazaa, Moncef Marzouki, Béji Caïd Essebsi, et l’intérim de Mohamed Ennaceur), le système est clairement pourri, à l’agonie. Il faut tout refaire. Et on verra plus tard pour le business, l’économie, les investissements, secteurs de toute façon hautement suspects qu’il faudra réorienter vers le développement « vrai » du pays…
Le président a exclu du dialogue national, annoncé début mai, les partis politiques. La puissante centrale syndicale, l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), a refusé, elle, d’y participer, comme d’autres aussi. Il a modifié de lui-même la composition de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), qui avait pourtant assuré le déroulement relativement satisfaisant des consultations depuis 2011. Kaïs Saïed « trace » malgré les objections des partenaires historiques, États-Unis, France, Union européenne, ou les messages surprenants en forme de leçons de démocratie du voisin algérien… Il invoque la souveraineté nationale, il tance les membres de la Commission de Venise, organe consultatif du Conseil de l’Europe sur les questions constitutionnelles, les somme de quitter la Tunisie… Le président veut faire voter sa nouvelle constitution le 25 juillet prochain. Mais à la date où ces lignes sont écrites, tout début juin, personne ou presque n’a encore vu le projet de nouvelle loi fondamentale. Même le mode de scrutin semble mystérieux. Par ailleurs, dans la nuit du 1er au 2 juin, le président a révoqué 57 juges pour incompétence, corruption, voire complicité avec les terroristes… 57 juges qui vont passer du prétoire au banc des accusés.
Kaïs Saïed aura été sous-estimé. Lors de sa campagne électorale de 2019, au début de sa présidence, sous-estimé aussi lors de sa prise du pouvoir du 25 juillet 2021. Sous-estimé depuis, dans sa marche méthodique,

envers et contre tous, vers une nouvelle architecture institutionnelle. L’ancien professeur de droit au discours emphatique est devenu un « politique » qui a conquis la Tunisie sans coup férir…
Une bonne partie de l’appareil d’État, des institutions sécuritaires, des forces de l’ordre appliquent ses ordres, font tourner comme ils le peuvent la machine. Il y a une cheffe du gouvernement, Najla Bouden, et des ministres. Le président bénéficie de l’onction du suffrage populaire. Il a été élu. Son discours sur « la corruption » et « la probité » a touché les plus fragiles et les plus jeunes. Il est soutenu également par tous ceux, et ils sont nombreux, dont le premier objectif était de se débarrasser des islamistes, d’Ennahdha, de Rached Ghannouchi, de cette fameuse théorie du « consensus » qui a prévalu depuis la chute de Ben Ali. Il est soutenu, même passivement, par une partie de l’opinion, épuisée par les errements, l’immobilisme et les divisions de la dernière décennie, les blocages politiques, la pandémie de Covid-19… Kaïs Saïed n’est peut-être pas aussi populaire qu’en 2019, mais il n’est pas globalement impopulaire en ce début d’été 2022.

Cela étant dit, la Tunisie, comme les autres pays, ne peut pas, ne peut plus être gouvernée par un seul homme. Le chef de l’État ne peut pas être également juge et législateur, définir les lois, les procédures et les juridictions. On ne peut pas effacer tous les acquis de la révolution, tout particulièrement en matière de démocratie. Le pays a besoin évidemment d’un pouvoir organisé, mais aussi d’institutions fédératrices pour fonctionner. Et de contre-pouvoirs pour éviter l’arbitraire. La Constitution est le reflet d’une volonté de vivre ensemble, le reflet d’un pacte national, d’une évolution longue. La Tunisie est en outre un pays fragile, modeste, endetté, qui a besoin d’alliances, de soutien, d’équilibres subtils dans sa relation au monde extérieur. Elle ne peut pas s’aliéner ses voisins, s’éloigner de l’Europe, des États-Unis, de ses marchés et de ses partenaires. Elle se doit d’être ouverte justement pour se financer, se restructurer, et donc protéger sa souveraineté.
La réalité, c’est que sans économie, sans développement, sans croissance, sans marge de manœuvre financière, les « institutions » et les constitutions ne peuvent rien. La Tunisie est un pays avant tout de com-
merçants, d’agriculteurs, d’entrepreneurs. Toutes les tentatives d’économie « administrée » ou « centralisée », ou « collectiviste », ont échoué. La corruption existe, mais ce n’est pas pire (ni mieux) qu’ailleurs. Il faut d’abord de la croissance, des emplois, des opportunités, réformer, moderniser.
Au fond, l’histoire de la révolution continue à s’écrire. Depuis 2011, la Tunisie est en transition, en mutation. Elle cherche à nouveau son équilibre dans un contexte particulièrement explosif, avec la guerre en Ukraine, ses conséquences, la crise qui menace [voir pp. 3 0-39], l’inflation, le coût des céréales et du pétrole, les risques d’éruptions sociales. Elle fait face, à nouveau, à un véritable choix de société, de modèle qui engage son avenir. Et ce choix ne peut être celui d’un seul homme. Ou d’un seul parti. De gauche, de droite, ou qui se réclame de Dieu. La Tunisie est un pays carrefour, complexe, aux identités et aux cultures multiples. C’est également un pays somme toute « gérable », idéalement placé au cœur de la Méditerranée, avec un acquis, des citoyens, créatifs, motivés.
Le crash est possible. Mais le rebond aussi. ■


3 ÉDITO
La Tunisie en transition permanente par Zyad Limam
10 ON EN PARLE
C’EST DE L’ART, DE LA CULTURE, DE LA MODE ET DU DESIGN
Africa Fashion prend ses quartiers à Londres
26 PARCOURS
Walid Hajar Rachedi par Astrid Krivian
29 C’EST COMMENT ?
Mauvaise note par Emmanuelle Pontié
40 CE QUE J’AI APPRIS
Imed Alibi par Astrid Krivian
106 VINGT QUESTIONS À…
Lucibela par Astrid Krivian






TEMPS FORTS
30 LA CRISE QUI VIENT par Cédric Gouverneur
34 Akram Belkaïd : « La faim est une menace à moyen terme »
36 Carlos Lopes : « S’organiser pour obtenir davantage »
38 Données et perspectives sur une rupture multifactorielle

42 Anthony Guyon : Des hommes considérés comme des soldats nés par Cédric Gouverneur
72 L’odyssée des rois de Napata par Alexine Jelkic
78 Dak’art est une fête par Luisa Nannipieri
84 Ndèye Fatou Kane : « Ce monde est fait pour les hommes » par Astrid Krivian

Afrique Magazine est interdit de diffusion en Algérie depuis mai 2018. Une décision sans aucune justification. Cette grande nation africaine est la seule du continent (et de toute notre zone de lecture) à exercer une mesure de censure d’un autre temps Le maintien de cette interdiction pénalise nos lecteurs algériens avant tout, au moment où le pays s’engage dans un grand mouvement de renouvellement. Nos amis algériens peuvent nous retrouver sur notre site Internet : www.afriquemagazine.com

DÉCOUVERTE
47 Djibouti : 45 ans ! par Thibaut Cabrera
48 Le chemin vers la liberté
53 La paix, seconde indépendance
56 D’hier à maintenant : Les 10 chiffres
60 Les enjeux de demain
90 Le gaz africain, nouvelle alternative
94 Rabia Ferroukhi : « La transition énergétique est une vaste opportunité »
96 Lacina Koné : « Nous devons davantage investir en nous-mêmes »
98 Gandoul et la connectivité Orange en Afrique
100 Le BTP turc à l’assaut du continent
101 Un étonnant modèle de coopération sud-sud par Cédric Gouverneur, Oscar Pemba et Emmanuelle Pontié
VIVRE MIEUX
102 L’andropause, la ménopause au masculin
103 Des crampes en marchant ?
104 Des plantes contre l’arthrose
105 Se blanchir les dents, mais pas n’importe comment par Annick Beaucousin et Julie Gilles
FONDÉ EN 1983 (38e ANNÉE)








31, RUE POUSSIN – 75016 PARIS – FRANCE
Tél. : (33) 1 53 84 41 81 – Fax : (33) 1 53 84 41 93 redaction@afriquemagazine.com
Zyad Limam
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DIRECTEUR DE LA RÉDACTION zlimam@afriquemagazine.com
Assisté de Laurence Limousin llimousin@afriquemagazine.com RÉDACTION
Emmanuelle Pontié DIRECTRICE ADJOINTE DE LA RÉDACTION epontie@afriquemagazine.com
Isabella Meomartini DIRECTRICE ARTISTIQUE imeomartini@afriquemagazine.com
Jessica Binois PREMIÈRE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION sr@afriquemagazine.com
Amanda Rougier PHOTO arougier@afriquemagazine.com ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO
Thibaut Cabrera, Jean-Marie Chazeau, Catherine Faye, Cédric Gouverneur, Alexine Jelkic, Dominique Jouenne, Astrid Krivian, Luisa Nannipieri, Oscar Pemba, Carine Renard, Sophie Rosemont.
VIVRE MIEUX
Danielle Ben Yahmed RÉDACTRICE EN CHEF avec Annick Beaucousin, Julie Gilles.
VENTES
EXPORT Laurent Boin
TÉL. : (33) 6 87 31 88 65
FRANCE Destination Media
66, rue des Cévennes - 75015 Paris
TÉL. : (33) 1 56 82 12 00
ABONNEMENTS
TBS GROUP/Afrique Magazine 235 avenue Le Jour Se Lève 92100 Boulogne-Billancourt
Tél. : (33) 1 40 94 22 22
Fax : (33) 1 40 94 22 32 afriquemagazine@cometcom.fr
COMMUNICATION ET PUBLICITÉ regie@afriquemagazine.com
AM International
31, rue Poussin - 75016 Paris
Tél. : (33) 1 53 84 41 81
Fax : (33) 1 53 84 41 93
AFRIQUE MAGAZINE EST UN MENSUEL ÉDITÉ PAR
31, rue Poussin - 75016 Paris. SAS au capital de 768 20 0 euros.
PRÉSIDENT : Zyad Limam.
Compogravure : Open Graphic Média, Bagnolet. Imprimeur : Léonce Deprez, ZI, Secteur du Moulin, 62620 Ruitz.
Commission paritaire : 0224 D 85602. Dépôt légal : juin 2022.
La rédaction n’est pas responsable des textes et des photos reçus. Les indications de marque et les adresses figurant dans les pages rédactionnelles sont données à titre d’information, sans aucun but publicitaire. La reproduction, même partielle, des articles et illustrations pris dans Afrique Magazine est strictement interdite, sauf accord de la rédaction. © Afrique Magazine 2022.
C’est maintenant, et c’est de l’art, de la culture, de la mode, du design et du voyage
Une exposition événement au Victoria and Albert Museum pour célébrer une SCÈNE ÉCLECTIQUE ET COSMOPOLITE, toujours en ébullition.
MÊME AU ROYAUME-UNI, c’est une première. L’exposition « Africa Fashion », organisée par le Victoria and Albert Museum, à Londres, qui ouvrira en juillet prochain, s’annonce comme la plus importante exhibition dédiée à la mode africaine jamais réalisée outre-Manche. Les conservateurs ont sélectionné 45 créateurs de plus de 20 pays à travers le continent et ont créé un parcours avec plus de 250 objets emblématiques pour célébrer l’histoire et l’impact mondial de la mode africaine contemporaine. Croquis, reportages, photographies, films et séquences de défilés alternent avec vêtements et accessoires sortis tout droit des archives personnelles des stylistes les plus iconiques de la seconde moitié du XXe siècle. Les créations de la première fashion designeuse du Nigeria Shade Thomas-Fahm, du maître du bogolan Chris Seydou, de l’« enfant terrible » de la mode ghanéenne Kofi Ansah et du « magicien du désert » Alphadi seront

présentées pour la première fois dans un musée londonien. Elles seront montrées au cœur de la section « L’avant-garde », avec les silhouettes de la pionnière marocaine Naïma Bennis. Mais l’exposition met aussi en avant les créateurs contemporains. Comme le Camerounais Imane Ayissi, dont un ensemble associant soie scintillante et couches exubérantes
de raphia accueille les visiteurs, soufflant l’idée que les modes africaines sont indéfinissables et que chaque artiste choisit son propre chemin. Parmi la nouvelle génération, on retrouve le label marocain MaisonArtC avec des pièces réalisées pour l’occasion, les Sud-Africains Thebe Magugu et Sindiso Khumalo, la marque nigériane Iamisigo et la rwandaise minimaliste Moshions. Avec des sections dédiées à la Renaissance culturelle africaine et au rôle politique des garde-robes dans le contexte des indépendances, l’exposition rappelle que la mode se développe avant tout dans la société et la rue. Un concept que l’on retrouve chez la Sénégalaise Selly Raby Kane ou dans les bijoux de la Kenyane Ami Doshi Shah, qui soulignent le rapport entre mode, matière et nature. ■ Luisa Nannipieri
« AFRICA FASHION », Victoria and Albert Museum, Londres (Royaume-Uni), du 2 juillet 2022 au 16 avril 2023. vam.ac.uk

Collection automne-hiver 2020 de la marque kenyane
Le fils d’Ali Farka Touré rend HOMMAGE À SES ORIGINES et à l’instrument transmis par son père : la guitare.Virtuose.
IL SUFFIT DE FERMER LES YEUX et de monter le son sur « Ngala Kaourene ». C’est alors que tout le potentiel hypnotique de la musique de Vieux Farka Touré prend son sens. Le guitariste malien sait tirer le meilleur de son instrument comme de sa voix, fort d’un héritage paternel qu’il célèbre aujourd’hui avec le bien nommé Les Racines, qui cultive les sonorités songhaï rendues célèbres par Ali Farka Touré – dont il a su s’émanciper durant de longues années. Qu’est-ce qu’être malien ? Comment faire face aux difficultés socio-économiques d’un pays à la culture pourtant ancestrale ? C’est pendant le confinement qu’il a tenté de répondre à ces questions. « Racines »,
À écouter maintenant !
❶
Emeli Sandé
Let’s Say For Instance, Chrysalis/Pias
Avec plus de 6 millions d’albums écoulés à ce jour, et forte de dix ans de carrière, Emeli Sandé pourrait se reposer sur ses lauriers. Que nenni, son nouvel album Let’s Say For Instance, signé chez un label indépendant, explore les thématiques de la résilience et de l’invention de soi-même avec un sens de la pop et du groove bien trempé. Avec, toujours, son timbre épatant… Parfait pour amorcer l’été.
❷ Sly Johnson 55.4, BBE Music




VIEUX
FARKA TOURÉ, Les Racines, World Circuit Records.
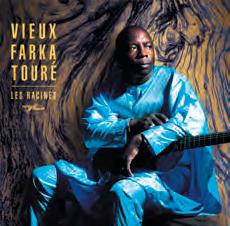
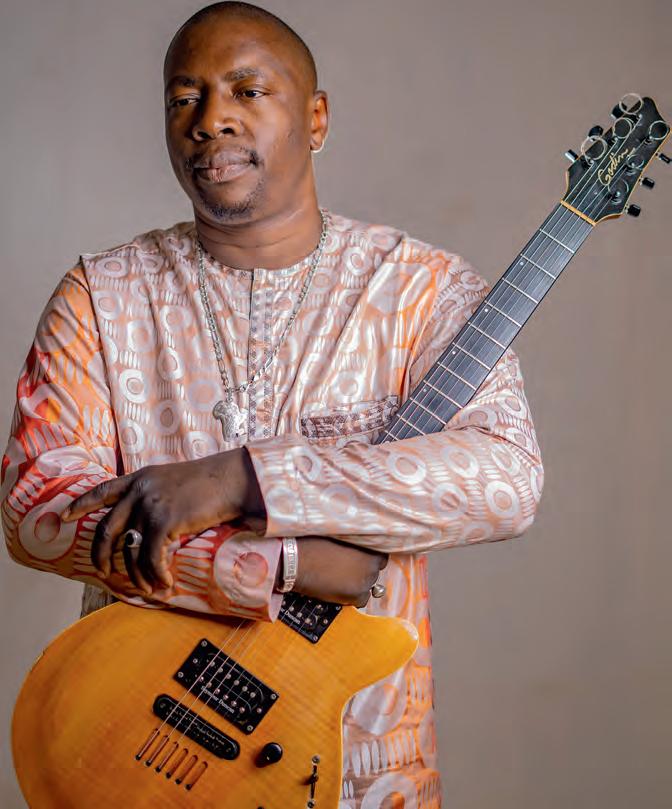
Devenu célèbre grâce au Saïan Supa Crew, le chanteur et beatboxer Silvère « Sly » Johnson s’est très vite émancipé avec son projet solo, dès le début des années 2010. Son signe distinctif ? Un mix réussi de soul, de rap et de funk, avec ce qu’il faut d’émotion et d’énergie, toutes deux contagieuses. Ce qui se retrouve dans ce quatrième album écrit, incarné et produit par Sly lui-même. Bien joué !
Thaïs Lona Cube, Mister Ibé
La dernière fois que l’on avait parlé ici de cette jeune chanteuse au joli potentiel, elle sortait seulement quelques titres et n’avait pas encore eu l’occasion de s’illustrer sur scène. C’est chose faite. Après des prestations remarquées en première partie de Kimberose, IAM ou encore Ibrahim Maalouf – qui l’a signée sur son label Mister Ibé –, Thaïs Lona s’affirme avec un premier album de R’n’B bien senti. ■ S.R.



Impulsé par le très populaire comédien, Tirailleurs s’attaque à un chapitre de la colonisation française peu traité au cinéma.



Entre deux tournages pour Netflix et un blockbuster à Hollywood, le héros star de Lupin REVIENT À SES SOURCES SÉNÉGALAISES dans un rôle historique en langue peule…
« ON N’A PAS LA MÊME MÉMOIRE, mais on a la même histoire. » C’est avec ces mots qu’Omar Sy a présenté au Festival de Cannes en avant-première un long-métrage sur les tirailleurs sénégalais. Trente-quatre ans après Ousmane Sembène (Camp de Thiaroye), c’est sous la bannière de la Gaumont que cette coproduction franco-sénégalaise impulsée par le très populaire comédien s’attaque à un chapitre de l’histoire coloniale française peu traité au cinéma [voir pp. 42-46]. L’essentiel de cette immersion dans la boucherie qu’a été la Première Guerre mondiale se passe à l’écran dans les tranchées de Verdun, mais plusieurs séquences ont été tournées au Sénégal en janvier dernier. L’acteur interprète avec sobriété un éleveur du FoutaToro qui, en 1917, essaye en vain d’empêcher son fils de 17 ans d’être enrôlé par les Français pour aller défendre « la maman patrie », comme le dit un recruteur. Il le suivra jusque là-bas. Amour filial, sens de l’histoire et complexités des rapports raciaux, soit autant de thèmes chers au comédien qui, pour ce rôle, s’exprime uniquement en peul. Réalisé et coécrit (avec
Olivier Demangel, coscénariste d’Atlantique, de Mati Diop) par Mathieu Vadepied, Tirailleurs sera en salles à l’automne en France… et les dernières images pourraient faire polémique à quelques jours de la célébration de l’armistice du 11 novembre. Omar Sy acteur et producteur, ce n’est pas qu’au cinéma : le contrat qu’il a signé avec Netflix court toujours, sur la lancée de Lupin. La troisième saison de la série française au succès planétaire vient d’être tournée, et c’est directement sur la plate-forme qu’est sortie en mai Loin du périph – la suite, dix ans après, d’un autre gros succès, De l’autre côté du périph, toujours en duo avec Laurent Lafitte. Il renoue aussi avec ses rêves d’enfants à Hollywood : après avoir joué un petit rôle dans X-Men: Days of Future Past, pour Marvel, en 2014, et dans le premier Jurassic World, le revoici en éleveur de vélociraptors dans le troisième épisode de la saga dinosauresque (Jurassic World : Le Monde d’après). Avant d’atteindre enfin le haut de l’affiche d’une production américaine dans Shadow Force, avec Kerry Washington, annoncé pour 2023… ■ Jean-Marie Chazeau

Le racisme et les travers du POLITIQUEMENT CORRECT dynamités… avec subtilité par une série US toujours aussi surprenante
IL AURA FALLU ATTENDRE QUATRE ANS, pour cause de pandémie, avant qu’une troisième saison de la remarquable série de Donald Glover arrive sur les écrans. Avec un ton unique pour souligner le racisme qui sous-tend les sociétés occidentales, le comédien et producteur américain poursuit les aventures du héros qu’il interprète, Earn, manager de son cousin rappeur à Atlanta. Dans ces 10 nouveaux chapitres, il part en tournée en Europe avec Alfred (dit Paper boi), le colocataire de ce dernier, Darius, et son ex, Vanessa, et c’est parfois le choc des cultures : prison trois étoiles et cérémonie pour une euthanasie à Amsterdam, soirée londonienne chez un riche mécène qui va se terminer à la tronçonneuse… Mais occasionnellement, un

FRANÇOIS BEAURAIN, Cinémas du Maroc : Lumière sur les salles obscures du Maroc, La Croisée des chemins, 392 pages, 80 €



ATLANTA, saison 3 (États-Unis), de Donald Glover. Avec Brian Tyree Henry, Lakeith Stan field, Zazie Beetz. Sur OCS.
épisode abandonne le trio et se recentre sur les États-Unis : un employé de bureau se voit réclamer des millions de dollars par une descendante d’esclaves africains au titre des réparations pour l’esclavage pratiqué par ses ancêtres, le petit garçon d’un couple de bourgeois new-yorkais blanc assiste aux obsèques de sa nounou antillaise qui était plus maternelle que sa propre mère… Des situations au bord du malaise, un regard acéré des Noirs sur les Blancs, dans des petits bijoux de 30 minutes qui n’hésitent pas à bousculer les travers du politiquement correct, mais aussi les comportements de la communauté noire. À noter : dans la version française, Donald Glover est doublé par le comédien malien Diouc Koma. ■ J.-M.C.


QUAND ELLES NE SONT PAS TRANSFORMÉES EN BERGERIES ou éventrées, les salles du Maroc sont conservées dans leur splendeur d’antan. Le royaume abrite en effet une étonnante variété de ces palais dédiés au septième art, construits depuis 1913, et qui n’ont pas tous été détruits ou transformés en multiplexes comme en Europe. Témoins architecturaux mais aussi d’une époque où les Marocains se retrouvaient en masse dans les salles obscures, ces lieux racontent l’histoire d’un pays, comme le révèlent les splendides photos de François Beaurain. Ce beau livre, désormais disponible hors du royaume, nous permet d’en rencontrer les exploitants et les projectionnistes, gardiens de temples somptueux menacés de disparition. À voir également, le compte @cinemagrhib sur Instagram, où le photographe français, installé à Rabat, distille quelques-uns de ces trésors. ■ J.-M.C.
Un nouveau roman sur la condition des femmes au Sahel, par la militante que la presse camerounaise surnomme « LA VOIX DES SANS-VOIX ».

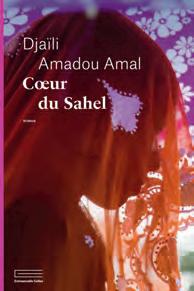
FINALISTE DU GONCOURT, puis lauréate du prix Goncourt des lycéens 2020 pour son roman Les Impatientes, l’écrivaine camerounaise se sert de l’écriture comme d’un instrument de combat contre les violences faites aux femmes. À 47 ans, cette militante féministe n’a en effet de cesse de dénoncer les problèmes sociaux et religieux causés par les traditions dans son pays, notamment les discriminations quotidiennes. Après avoir traité de la condition des femmes de la haute société musulmane et peule, c’est maintenant les vicissitudes de la vie de leurs domestiques chrétiennes qu’elle révèle. Son nouveau roman met en scène la jeune Faydé, partie dans la ville la plus proche, au nord, pour y devenir servante d’une riche famille, et ainsi aider sa famille à vivre. Un macrocosme où deux mondes se côtoient, mais ne se mélangent jamais. Deux mondes en proie aux répercussions du changement climatique et des attaques de Boko Haram. Un texte coup de poing, renforcé par un vrai travail d’enquête et le propre parcours de l’autrice, qui a elle-même subi les affres de la polygamie et de la violence masculine. Et une histoire d’acceptation de l’autre, de tolérance et d’interculturalité, où les jeunes filles luttent pour survivre et se construire un avenir, malgré les viols, les mauvais traitements, le mépris de classe… « Dans toutes les larmes s’attarde un espoir », écrit Simone de Beauvoir, que Djaïli Amadou Amal cite en exergue. Si son précédent roman a entraîné une prise de conscience au Cameroun – le gouvernement a décidé de l’inscrire au programme des classes de terminale –, Cœur du Sahel confirme son exhortation à résister et à restituer aux femmes le droit à disposer de leur corps. Un sujet primordial pour l’écrivaine, dans son œuvre comme dans les activités qu’elle mène en tant qu’ambassadrice de l’Unicef ou au sein de son association Femmes du Sahel, laquelle œuvre pour l’éducation des filles. Plus que jamais, les mots puisent leur force dans l’action. ■ Catherine Faye DJAÏLI AMADOU AMAL, Cœur du Sahel, Emmanuelle Collas, 364 pages, 19 €

À la fois authentique et longuement façonné, le premier album de cette NOUVELLE SENSATION fait mouche. À suivre de près.
LE « UNIVERSAL CREDIT » est une prestation sociale versée par le gouvernement du Royaume-Uni pour venir en aide aux foyers aux (très) faibles revenus. C’est aussi le nom du premier album d’un rappeur de 27 ans, Londonien d’origine jamaïcaine, qui fait beaucoup parler de lui sur la scène britannique, et pas seulement. Le son est old school, sans être nostalgique, le propos militant, et l’interprète charismatique. Ses armes, il les a faites dans l’appartement partagé avec sa mère et ses sœurs, à l’aide du micro USB d’un jeu de karaoké sur Nintendo ! Depuis, ayant collaboré avec des artistes comme le Nigérian Obongjayar (sur les super efficaces « Violence » et « Protein ») ou la chanteuse soul britannique Celeste, il a construit un langage engagé mais groovy, auquel il est bien difficile de résister. ■ S.R.







La guérisseuse Ma Atema, à Mana, en Guyane, Karl Joseph, 2019.

Femmes capitaines du peuple Saramaca, au Suriname, Nicola Lo Calzo, 2014.
Aujourd’hui comme hier, de l’autre côté de l’Atlantique, l’ART MARRON rend hommage à la liberté.
TELS DES ÎLOTS DE RÉSISTANCE, les créations artistiques des sociétés marronnes, qu’il s’agisse de sculptures, de gravures, de broderies ou de photographies, mettent en évidence la continuité historique et l’inventivité des témoins du temps de l’esclavage et de leurs descendants. Une culture originale, issue de la transmission et du prolongement de ces nouvelles sociétés, aux Amériques, aux Antilles ou dans les Mascareignes. Une fois libérés de leurs chaînes, les « marrons », nom donné aux esclaves ayant fui la propriété de leur maître, ont en effet su sauvegarder et transmettre leurs modes de vie africains, et même partiellement leurs langues d’origine. Plus encore, ils ont déployé une fibre créative d’une grande vitalité. Un art d’émancipation, mais aussi un art social qui célèbre les rencontres et l’altruisme. Des Guyanais Wani Amoedang et Franky Amete au peintre haïtien Hervé Télémaque, parrain de l’exposition, deux générations d’artistes peuvent enfin se présenter elles-mêmes et exprimer leur propre vision des arts marrons, notamment via le catalogue d’exposition (publié aux éditions Loco), préfacé par Christiane Taubira. ■ C.F.
« MARRONAGE : L’ART DE BRISER SES CHAÎNES », Maison de l’Amérique latine, Paris (France), jusqu’au 24 septembre. mal217.org


Le PREMIER RÔLE sur grand écran du rappeur fondateur
du collectif Bisso Na Bisso.
MONIKA, quadragénaire célibataire, dirige une galerie d’art contemporain à Francfort, où elle rencontre par hasard Joseph, venu de Kinshasa, qui trafique des diamants avec les diasporas congolaises et angolaises. Une histoire d’amour naît, se heurtant à plusieurs obstacles qui révèlent surtout les caractères de l’un et de l’autre : les pressions de leurs entourages respectifs sont sous-jacentes et poussent à la méfiance, quand il ne s’agit pas d’intolérance ou de racisme. On est en Allemagne, pas d’effusions sentimentales, pas de dramatisation à outrance. Ce n’est pas non plus la description clinique d’une histoire d’amour compliquée, les personnages sont incarnés avec justesse par les deux comédiens principaux, dont Passi : à bientôt 50 ans, pour son premier rôle au cinéma, le rappeur de Ministère A.M.E.R. incarne un personnage sexy, à la fois déterminé et fragile, sans jamais élever la voix mais en quête de respect : « Mon père a été colonisé. Pas moi. » Et on s’immerge avec lui dans les cafés congolais de la capitale financière de l’Europe ! ■ J.-M.C. LE PRINCE (Allemagne), de Lisa Bierwirth. Avec Ursula Strauss, Passi Balende, Nsumbo Tango Samuel. En salles.
Figure majeure de la littérature tunisienne, Habib Selmi aborde ici les questions de l’immigration, de l’acculturation, des dissemblances.
IL ÉCRIT TOUJOURS sur des sujets qui l’ont marqué. Des instantanés de la vie quotidienne, auxquels il parvient à donner une densité sensible, en explorant méticuleusement la singularité de l’humain. Des extraits de tous les jours, à la fois banals et uniques, comme en écho au va-et-vient du quotidien. S’il a longtemps enseigné la langue et la littérature arabes dans un lycée parisien, cet agrégé tunisien, auteur d’une dizaine de romans, ne peut écrire que dans sa langue maternelle, car son rapport à la langue arabe est viscéral. Une langue épurée, où la simplicité donne à voir différentes strates de la société tunisienne, en quête permanente. Dans ce roman plein d’humour, nommé pour le Prix international du roman arabe, il nous narre la rencontre inattendue à Paris entre Kamal, un sexagénaire bourgeois, et Zohra, que la plupart des habitants de l’immeuble appellent « la femme de ménage » ou « la Tunisienne ». Une histoire de hasard et de cœur. ■ C.F. HABIB SELMI, La Voisine du cinquième, Actes Sud, 208 pages, 21,50 €


Un récit à la frontière de l’Ouganda et de la République démocratique du Congo, qui interroge les motifs des hommes à se confronter aux aléas de la montagne.
« NYRAGONGO, Noël 1967. Tentez d’imaginer l’Origine de l’Eau. Imaginez une eau parfaite, une eau primitive qui mouillerait le monde pour la première fois. Cette eau originelle existe. Les volcanologues l’appellent “l’eau juvénile”. » Cet extrait des carnets d’expéditions d’un ancien compagnon de cordée de l’auteur préfigure le voyage d’un jeune couple d’alpinistes explorateurs, vingt ans plus tard. Un voyage initiatique, à l’assaut de l’ascension du mont Stanley, à plus de 5 000 mètres d’altitude, dans le massif du Ruwenzori, communément appelé « montagnes de la Lune ». C’est ici que naissent les sources du Nil Blanc. Entre les glaces tourmentées et les forêts de nuages, l’ascension se fait parfois éprouvante, malgré l’intensité de l’aventure. La quête et la détermination, plus que jamais moteurs. Le périple est relaté par le cinéaste, écrivain et alpiniste français Bernard Germain. Comme s’il en avait été. ■ C.F. BERNARD GERMAIN, La Montagne de la lune, Paulsen, 272 pages, 15 €


CORDES
Le JOUEUR DE GUEMBRI natif d’Essaouira revient avec 11 nouvelles chansons enregistrées entre ciel et désert.



FILS DU GRAND MAÂLEM
Boubker et petit-fils de Ba Massoud, icône de la musique gnaouie marocaine, le chanteur et joueur de guembri Moktar Gania revient avec un nouvel album enregistré aux côtés de ses musiciens, réunis à Essaouira sous le nom de Gnawa Soul. Et c’est vrai qu’il y a beaucoup d’âme dans ces ritournelles aux cordes entrelacées, comme en témoignent « Rabi Laafou » ou « Moussoyo ». Il y a aussi du groove audacieux sur « Lala Mulati » ou « Al Walidine ». Le son est de plus parfait, ayant bénéficié d’un mixage à Austin par Chris Shaw, lequel a travaillé avec Bob Dylan, Public Enemy ou encore Weezer, ainsi que d’un master aux studios londoniens Metropolis, signé Tony Cousins (Adele, Fatoumata Diawara, George Michael, Seal…). Oui, c’est chic, mais sans occulter la sincérité du chant de Moktar Gania. ■ S.R.
An Impenetrable Shield, Khadim Haydar, 1965.


La Glace au-dessus de la cheminée ?, Pablo Picasso, 1916-1917.

À travers quelque 70 œuvres, un dialogue quasi fraternel et une fascination mutuelle entre PICASSO
et les artistes
MODERNES ARABES.
C’EST UN VA-ET-VIENT idéologique et créatif fascinant entre le maître espagnol et les artistes arabes que cette exposition interroge, au-delà de l’influence reconnaissable du cubisme et de l’abstraction. Un voyage au cœur de thèmes tels que l’émancipation, l’anticolonialisme et le pacifisme. Picasso n’a pourtant jamais visité le Moyen-Orient, mais il a indéniablement été influencé par l’art du monde entier, notamment du continent africain. Apollinaire, dès 1905, le décrit d’ailleurs comme « arabe rythmiquement », offrant la promesse d’un art universel sans hiérarchie géographique (Orient/Occident), temporelle (passé/présent) ou stylistique (art naïf/art savant). Cette attraction est présente chez nombre de pères de la modernité irakienne, libanaise, syrienne, algérienne ou égyptienne, comme Jewad Selim, Aref El Rayess, Idham Ismaïl, Mohammed Khadda ou encore Samir Rafi. Parmi les 32 artistes exposés, certains d’entre eux ont même croisé la route de Pablo Picasso. L’un des principaux points focaux de ce dialogue artistique est incontestablement sa peinture épique, Guernica (1937) : une fresque universelle refusant toutes les formes de violence contre les civils, qu’aucune idéologie ni aucun régime ne peuvent justifier. ■ C.F.
« PICASSO ET LES AVANT-GARDES ARABES », Institut du monde arabe, Tourcoing (France), jusqu’au 10 juillet. ima-tourcoing.fr
La biennale internationale des métiers d’art et de la création met à l’honneur LES SAVOIR-FAIRE du continent.
POUR SON RETOUR au Grand Palais éphémère, du 9 au 12 juin, la biennale « Révélations » accueille artistes et artisans du continent. Ils dévoileront leurs créations sur des stands individuels et seront au centre du programme culturel Hors les murs, notamment avec l’exposition-vente « Exceptions d’Afrique », installée dans le concept store parisien Empreintes du 19 mai au 18 juin. Réalisée sous le commissariat de Nelly Wandji, la sélection comprend
pp j le commissariat de Wandji, la

L’œuvre textile
M.O.M.S.002 de la Marocaine Ghizlane Sahli.



Un masque de la communauté Mbunda, en Zambie.



des œuvres uniques d’ébénistes, de forgerons, bronziers, céramistes, vanniers et damasquineurs, issus d’une dizaine de pays comme Madagascar, le Burkina Faso ou l’Afrique du Sud. Dans les allées du salon, la dinanderie marocaine, le tissage traditionnel sénégalais revisité ou les métiers d’arts togolais offriront aux visiteurs un tour d’horizon du continent et de ses talents. Au Banquet, l’exposition internationale construite autour de 10 espaces scénographiés, on retrouvera les étonnants travaux textiles de la Marocaine Ghizlane Sahli, les sculptures en bronze et bois du Nigérian Alimi Adewale, ou encore la sélection de Claire Chan et Paula Sachar-Phiri de la Gallery 37d. Celles-ci présenteront les majestueux masques réalisés par la communauté Mbunda, à la lisière de la Zambie et de l’Angola. ■ L.N.


Une sculpture du Nigérian Alimi









Adewale













Ci-contre, « Sans titre », série La Salle de classe, Hicham Benohoud, 1994-2002.
SOUVENIRS D’ENFANCE, quête d’identité, vertige, extase… Avec plus de 80 œuvres de 64 artistes contemporains, la transgression et le divertissement deviennent dans cette exposition du Musée d’art contemporain africain Al Maaden (MACAAL), à Marrakech, les instruments de la représentation, notamment picturale. Et la création, une variation entre pratiques ludique et artistique. Psychanalytique aussi. La théorie du jeu, nous la devons à Donald W. Winnicott, pédiatre et psychanalyste britannique, qui définit le jeu comme une mise en scène des tensions psychiques et un moyen thérapeutique. Quelque chose qui, dans son observation, s’apparenterait à l’interprétation des rêves. C’est ce que font, à leur manière, loin des certitudes, Mariam Abouzid Souali, Joy Labinjo, GaHee Park ou encore Mohamed El Baz. Passeurs d’idées et de désirs, ces artistes interrogent eux aussi l’inconscient, individuel et collectif. En jouant avec les signes, les significations, les matières, les techniques et les technologies, ils proposent un autre regard, libre, parfois subversif. Un autre rapport à soi. Et au monde. Un monde décomplexé, onirique, souvent joyeux et frisant l’absurde. Peut-être plus authentique. ■ C.F.

Ci-dessous, « Berouita (Brouette) », série Rule Of Game, Mariam Abouzid Souali, 2017

« L’ART, UN JEU SÉRIEUX », Musée d’art contemporain africain Al Maaden, Marrakech (Maroc), jusqu’au 17 juillet. macaal.org
Son nouvel EP fait le PONT ENTRE DEUX CONTINENTS et de multiples genres musicaux. Frais et chic à la fois.
CHANSON, FOLK, afro-pop, et ce léger swing qui n’appartient qu’à elle : entourée de musiciens de Bangangté, Douala, Londres et Paris, la chanteuse camerounaise s’essaye au registre francophone. Et c’est réussi. Découverte au tout début des années 2000 avec le single « I Know », Irma est née de scientifiques mélomanes qui l’ont bercée au son d’Ella Fitzgerald ou de Fela Kuti. À l’adolescence, elle part faire de brillantes études à Paris, mais la musique l’appelle et, très vite, elle apprend à mixer et produire ses propres morceaux. Aujourd’hui, après trois albums dans la langue de Shakespeare, s’ouvre un nouveau chapitre : « Une étape qui me rapproche encore plus de moi-même, confie-t-elle, même


si cette quête ne sera jamais véritablement terminée ! » En effet, les huit chansons de cet EP sont nées pendant le premier confinement, et, comme son nom l’indique, entre Douala et Paris. « C’est un moment où tout s’est arrêté d’un coup, et il a été pour moi l’occasion d’une introspection à travers mes différentes identités, mes différentes cultures, se souvient la chanteuse. Comme chez beaucoup de gens, il a éveillé la nécessité d’un retour aux racines. Je suis une Africaine d’Occident ou une Occidentale d’Afrique. Cette dualité qui, lorsque j’étais plus jeune,

IRMA, Douala Paris, Irma Pany, sous licence exclusive Saraswati/ Sony Music.
était une source de conflit intérieur et de quête d’identité, est au fil des années devenue ma plus grande force. De là est née l’envie de parler de cette réconciliation culturelle et identitaire. » Ce qui s’entend au fil de Douala Paris, au travers de morceaux contrastés comme « Va-t’en », « Mes failles » ou encore « Danse ». Irma s’y dévoile plus que jamais auparavant, sur ses amours ou ses doutes existentiels, tout en renouant des liens forts avec sa ville natale : « Je suis fière de montrer que le Cameroun regorge de talents et d’un savoir-faire incroyables, qui résonnent dans le monde entier. Et puis, tout simplement, j’étais heureuse de tourner pour la première fois chez moi, là où j’ai grandi. Et de montrer la beauté, la richesse des paysages comme de la culture camerounaise. » ■ S.R.

Des fusions made in Lagos à l’héritage marocain mis à l’honneur à Marrakech, L’EXCELLENCE se décline de mille façons.
Le bar du Nok by Alara, à Lagos, a été décoré par le plasticien Victor Ehikhamenor.

● OUVERT PAR L’ENTREPRENEUSE Reni Folawiyo, déjà derrière le concept store Alara, le restaurant panafricain Nok by Alara est l’une des tables les plus connues de Lagos. On y vient pour dîner dans un cadre intimiste, un œil sur les œuvres d’art et de design venues de tout le continent. Ou pour se relaxer dans l’élégant jardin entouré de bambous et prendre un cocktail maison au bar décoré par l’artiste nigérian Victor Ehikhamenor. Mais surtout pour y déguster les classiques de la cuisine africaine revisités par les chefs : du misir wat de lentilles rouges éthiopien au dibi d’agneau sénégalais, en passant par le délicieux braai sud-africain ou le poulet suya, il y en a pour tous les goûts. On y trouve aussi l’un des meilleurs riz jollof de la ville, servi avec du bœuf dambu-nama, une spécialité du nord du pays.
● Si à Lagos on innove, à Marrakech on fait de la tradition une force. Chez La Maison arabe, un riad de luxe au cœur de la médina, on célèbre la finesse de la cuisine marocaine depuis 1946. Ouvert seulement le soir, Le Restaurant offre une expérience gastronomique raffinée en proposant en entrées des salades, des pastillas variées ou des briouates, mais aussi des plats, comme des couscous, des tajines et d’autres recettes classiques exécutées à la perfection, tels l’épaule d’agneau aux dattes ou le poulet au citron confit et au safran de Taliouine. Certains de ces plats sont à retrouver également dans l’autre restaurant de la maison, Les Trois Saveurs, ouvert, lui, à midi et doté d’une terrasse avec vue imprenable sur la piscine et les jardins. ■ L.N. nokbyalara.com / cenizaro.com

du CABINET COBLOC a transformé un vieux bâtiment délabré en un campus innovant et écoresponsable.
LE PREMIER CAMPUS de Sèmè City, espace dédié à l’innovation et au savoir, a pris ses quartiers fin 2020 dans un bâtiment multifonctionnel baptisé « Sèmè One ». Le projet a été magistralement réalisé par le cabinet franco-béninois Cobloc, dirigé par Ola Olayimika Faladé et Clarisse Krause, qui a rénové la structure délabrée préexistante avec une série d’interventions simples et efficaces. Le corps principal, un bloc de plus de 100 mètres de long, est plein et massif. Les murs ont été doublés pour réduire les écarts thermiques et garantir un climat stable, jour et nuit. Sur les trois côtés les plus exposés au soleil, ce système a permis de créer des fenêtres en retrait, naturellement ombragées. Avec une série de lamelles colorées, elles participent à un jeu de volumes qui anime la longue façade en terre rouge, cassant son horizontalité. Côté nord en revanche, de larges encadrements captent et diffusent le maximum de lumière à l’intérieur du campus. Ici, c’est par la couleur que se dessinent les différents espaces, et les murs cachent un système d’assistance smart building à l’avant-garde : le bâtiment est équipé pour transmettre et stocker des données sur son état et son utilisation. Une innovation qui permet au gestionnaire de la structure d’adapter l’éclairage, la climatisation, le réseau informatique ainsi que d’autres paramètres en fonction des besoins réels des usagers. ■ L.N. cobloc.archi
un premier roman sensible, en lice pour le prix Orange du livre. De Kaboul à Tanger, de Londres à Oran, il y fait le récit initiatique d’un jeune héros travaillé par des questions métaphysiques. par Astrid Krivian
e voyage, c’est aller de soi à soi en passant par les autres. » Ce proverbe touareg résume bien le cheminement du héros de Qu’est-ce que j’irais faire au paradis ? Français d’origine algérienne, Malek, la vingtaine au début des années 2000, souffre d’être assigné à une identité « arabe, musulmane » associée à l’obscurantisme, au déclassement. « Les attentats du 11 septembre ont bouleversé les représentations et débats dans la société française. Auparavant appelés “Arabes”, “immigrés”, les Français d’origine maghrébine sont devenus des “musulmans”. Et certains pratiquants étaient soupçonnés de radicalité », regrette Walid Hajar Rachedi. Après sa rencontre marquante avec un jeune exilé afghan, Malek se lance sur les routes du monde arabe, en vue de se libérer des carcans, de trouver du sens. Un voyage initiatique, une quête spirituelle, existentielle, pour découvrir les richesses culturelles de l’Andalousie au Caire, en passant par Tanger, Oran… Se confrontant aux autres, au réel, il crève l’écran de fantasmes posé entre lui et le monde. Avec pour boussole, sa foi en l’islam. « Mon roman est un thriller métaphysique. Souvent, les personnages issus de l’immigration sont sauvés par les lettres et la République. Le mien trouve sa force et sa transcendance autrement, incarnant une figure positive. » Malek tombe amoureux de Kathleen, jeune Londonienne dont le père, humanitaire en Afghanistan, a disparu. Dans ce portrait tout en nuances d’une génération Y mondialisée, l’auteur tisse avec finesse la toile de son intrigue haletante et entrelace les destins, entre Londres, Kaboul, Paris… Avec une puissance d’évocation, il trempe sa plume dans les drames contemporains comme dans les blessures intimes, les rêves et désillusions de ses héros. S’ils sont hantés par des questions semblables – amour, identité… –, les événements géopolitiques les affectent et les forgent différemment. Poursuivre les horizons, c’est aussi le moteur de cet écrivain. Né en 1981 à Créteil, enfant rêveur et solitaire, il s’évade à travers les livres. Il attrape le virus de l’écriture grâce à Sourires de loup, de Zadie Smith, et aux rappeurs des années 1990, maîtres du storytelling. Diplômé d’informatique puis d’une école de commerce, il est le cofondateur du média en ligne Frictions. Ses expériences professionnelles (consultant digital, journaliste, enseignant…) lui font poser ses valises au Mexique, aux États-Unis, au Brésil pendant six ans. Globe-trotteur infatigable, la soif de liberté et la curiosité en bandoulière, ce polyglotte, désormais établi à Lisbonne, a traversé l’Amérique latine du Brésil à Cuba, en se demandant : l’identité latino-américaine existe-t-elle ? Le voyage l’« autorise à être ébloui », défie ses valeurs, ses perceptions sur les sociétés. Et le libère de cette double conscience, avancée par le sociologue américain W.E.B. Du Bois, ce poids des représentations raciales, ce regard de l’autre qui enferme, et que le sujet intériorise. « Pour forcer un peu le trait, à l’étranger, je suis en mode béret-baguette !

Qu’est-ce que j’irais faire au paradis ?, Emmanuelle Collas, 304 pages, 18 €.
J’ai réalisé à quel point j’étais français – mes goûts culturels, la conscience sociale pour l’égalité, l’esprit critique, l’intérêt pour l’actualité, la curiosité… L’identité française existe, mais elle mérite un débat apaisé. » ■

«L’identité française existe, mais elle mérite un débat apaisé.»


● Directement sur le site afriquemagazine.com www.afriquemagazine.com/abonnement-papier ● Ou par le biais de notre prestataire avec le bulletin ci-dessous Contemporain, en prise avec cette Afrique qui change, ouvert sur le monde d’aujourd’hui, est votre rendez-vous mensuel indispensable.


: (33) 1 40 94 22 22 – FAX : (33) 1 40 94 22 32 – E-MAIL : afriquemagazine@cometcom.fr
Je choisis mon tarif :
❏ FRANCE (1 AN) : 39 €
❏ ÉTRANGER (1 AN) : 49 €

Je choisis mon règlement (en euros uniquement) à l’ordre de AMI par :

❏ Chèque bancaire ou postal
❏ Carte bancaire n°
Expirant le Date et signature obligatoire



PAR EMMANUELLE PONTIÉ
Le 16 juin sera célébrée la journée internationale de l’enfant africain, instaurée depuis 1991. Triste commémoration annuelle des jeunes tués lors du soulèvement estudiantin de 1976 à Soweto, en Afrique du Sud. À cette occasion, de nombreux bilans et études sont publiés, rappelant la situation précaire de l’enfance face notamment à l’éducation, première étape de la formation pour un accès à un travail et une intégration optimale dans le monde de demain. Les chiffres de l’Institut de statistique de l’UNESCO (ISU) brocardent sempiternellement l’Afrique subsaharienne. Parmi toutes les régions du monde, c’est en effet ici que l’on relève le plus fort taux d’exclusion de l’éducation : plus d’un cinquième des enfants âgés de 6 à 11 ans n’est pas scolarisé, suivi par un tiers des 12-14 ans et près de deux tiers des 15-17 ans.
Bien sûr, chez les filles, les indicateurs s’aggravent. Pour des raisons bien connues de pauvreté qui pousse les familles à « investir » sur l’éducation d’un seul garçon ou à rechigner à envoyer leur fille loin du foyer, ou pour des raisons culturelles ou d’attachement au mariage précoce, qui les entraînent à ne pas voir l’intérêt de l’envoyer à l’école.
D’autres soucis viennent compliquer encore l’accès à la scolarité, comme la pénurie de professeurs formés, la précarité des classes, sans eau courante ni électricité, parfois sans bancs, aux effectifs pléthoriques d’élèves… Et bien entendu, les zones de conflits génèrent année blanche sur année blanche. Alors certes, les politiques d’éducation s’améliorent, on construit des classes, on forme des profs, on lance des campagnes de sensibilisation à l’intention des parents retors, etc. Et les mentalités évoluent. Surtout en ville.
Pourtant, la démographie galopante de ces régions, qui affichent un taux de natalité très élevé, inquiète les spécialistes. Comment absorber demain et après- demain le nombre exponentiel d’enfants et de jeunes en demande d’éducation avec un système déjà totalement dépassé ? Et les projections du dernier Rapport mondial de suivi sur l’éducation de l’UNESCO ne sont pas très optimistes. Il en ressort, entre autres, que la proportion d’enseignants formés en Afrique subsaharienne est en baisse depuis 2000. On prévoit aussi qu’en 2030, 20 % des jeunes et 30 % des adultes ne sauront toujours pas lire… De quoi interroger les pouvoirs publics, qui doivent urgemment revoir leur copie. ■

Profitez de nos offres d'abonnements pour accéder à la totalité de nos magazines et bien plus encore