AFRIQUE MAGAZINE

Portrait
Henri Konan
Bédié à l’heure du choix
Monde arabe

Cameroun
LES EXIGENCES
D’UN SEPTENNAT
Un Découverte de 16 pages


Portrait
Henri Konan
Bédié à l’heure du choix
Monde arabe

Cameroun
LES EXIGENCES
D’UN SEPTENNAT
Un Découverte de 16 pages
Il est temps d’ouvrir le débat sur une pratique ancestrale, parfois illégale, souvent tolérée, voire encouragée. Et qui ne profite qu’aux hommes…
Changements VILLES ET DÉVELOPPEMENT
LOCAL : LES CLÉS DU FUTUR
Dossier spécial sur le sommet Africités
Maroc COUP DE STRESS SUR LES CLASSES MOYENNES

Collection Reine de Naples in every woman is a queen

Je le dis à tous les afro-sceptiques ou afropessimistes que je rencontre. Bien sûr que l’Afrique change, elle bouge, elle se transforme. C’est physique d’ailleurs, ça se voit sur le terrain. Entre les années 1980 et aujourd’hui, nous ne sommes plus sur le même continent. Des infrastructures émergent. L’urbanisation s’accélère et transforme les modes de vie. L’émancipation des femmes est une réalité progressive. Des entrepreneurs plus jeunes inventent un capitalisme africain, souvent basé sur les nouvelles technologies. Quelque chose se passe. Mais nous sommes loin de la renaissance (thème des années 2000) ou de l’émergence promise. Voici donc une tentative d’afroréalisme pour replacer dans leur contexte les discours sur l’avenir radieux.
Ainsi, fin 2018, on pourrait estimer le PIB du continent aux alentours de 3 000 milliards de dollars (sachant que les statistiques continentales sont loin d’être fiables).
Toute l’Afrique avec ses « géants », (Nigeria, Égypte, Afrique du Sud…), son immensité, son potentiel, ses richesses en matières premières, son potentiel agricole, bref cette Afrique avec toute cette magnitude « pèse » un peu plus qu’un pays comme la France (67 millions d’habitants) ou autant que l’Allemagne (82 millions d’habitants). Ça fait relativiser.
Plus grave, malgré les discours sur l’émergence, la pauvreté est endémique. La croissance est là, mais elle profite largement à ceux « qui ont déjà » (les grandes métropoles urbaines, costales, directement liées à l’économie mondiale). La poussée démographique fait le reste. Il suffit de sortir des capitales pour voir, à peine après quelques kilomètres, que le progrès s’arrête net. Que la lumière s’éteint, que l’eau ne coule plus et que commencent la précarité et la misère. Les différentes études estiment que plus de 500 millions d’Africains « vivent » sous le seuil de pauvreté (moins de 2 dollars par jour). 200 millions de personnes disposent, elles, de 2 à 4 dollars par jour. C’est la fameuse classe moyenne « flottante », si proche du gouffre. En clair, plus de 700 millions d’Africains sont pauvres ou très pauvres. Soit 60 % de la population du continent. Et les projections démographiques font réaliser l’ampleur du défi à venir. En 2050, la population de l’Afrique se situera entre 2 et 3 milliards d’habitants, et sera de 4,4 milliards en 2100. Aucune croissance aussi inclusive soit-elle ne pourra absorber un tel impact.
Il ne peut y avoir d’Afrique de demain avec une telle pauvreté de masse. Construire un modèle de développement uniquement basé sur la consommation de 300 millions d’Africains plus ou moins solvables, plus ou moins privilégiés, n’apportera qu’inégalités, accroissement de la pauvreté et, en fin de course, instabilités et catastrophes politiques. Le continent ne peut pas se développer en consommant de la téléphonie mobile, de la télévision par satellite ou des produits importés – souvent à bas coût et qui achèvent de détruire le faible tissu industriel existant. L’Afrique ne peut pas vivre que de ses élites, de ses privilégiés qui voyagent, qui s’« auto-reproduisent » au pouvoir et qui, plus ou moins consciemment, favorisent des politiques de classe. Pour exister demain, elle doit mettre la lutte contre la pauvreté au cœur de sa stratégie, au cœur de ses énergies. Opérer une révolution mentale, et sortir des clichés, des modèles occidentaux de consommation importés, des investissements de prestige, ou de l’incantation démographique (« nous avons de la place, nous avons nos traditions… »). Lutter contre les ravages de la mal gouvernance et de la corruption qui imposent un prix insupportable aux sociétés. Mobiliser les énergies sur ce qui compte. L’Afrique a fait d’immenses efforts en matière d’éducation de base, mais les compétences restent limitées. Le chantier éducatif reste entièrement ouvert. La mobilisation, la créativité, les capitaux devraient se focaliser sur cette mission historique : développer le potentiel humain du continent. On parle aussi d’investissements dans des secteurs directement productifs. On parle d’agriculture. On parle d’industries portées par des marchés régionaux relativement ouverts. Avançons plus vite ! Organisons l’attractivité. Créons les cadres juridiques et fiscaux. Ouvrons des chantiers sur lesquels nous avons un avantage compétitif, une chance. Je pense à la biodiversité, à la préservation des espèces et de la faune qui pourraient attirer vers nous énergie et capitaux. L’Afrique devra évidemment compter sur le monde extérieur (avec les risques que l’on connaît sur la dette et le nouveau néocolonialisme). Mais elle devra compter d’abord, et surtout, sur elle-même. Un chiffre pour finir et remettre « les choses dans leur contexte » : on estime le montant des capitaux africains « assis » hors du continent à près de 1 000 milliards de dollars. ■


Novembre n°386





3 ÉDITO Émergence ? par Zyad Limam
6 Livres : David Diop, l’espèce inhumaine par Catherine Faye
8 Écrans : Viola Davis, veuve impériale par Jean-Marie Chazeau
10 Musique : Aya Nakamura, à la conquête du monde par Sophie Rosemont
12 Agenda : Le meilleur de la culture par Catherine Faye
14 PARCOURS
Nacera Belaza par Catherine Faye
17 C’EST COMMENT ? Fake world par Emmanuelle Pontié
114 VINGT QUESTIONS À… Djazia Satour par Astrid Krivian
18 Polygamie : Vers la fin du privilège mâle ? par Emmanuelle Pontié, Venance Konan et Aurélie Dupin
26 La guerre des sultans par Zyad Limam et Fouzia Marouf
34 Henri Konan Bédié: À l’heure du choix par Ouakaltio Ouattara
40 Maroc : Coup de stress sur les classes moyennes par Julie Chaudier
DOSSIER:
46 LE SOMMET AFRICITÉS
S’inventer un autre avenir par Alexandra Fisch
52 Repenser la ville par Cédric Gouverneur
60 Interview : Dr Fatna EL-K’HIEL : « Contrebalancer le tropisme côtier et métropolitain » par Zyad Limam et Jean-Michel Meyer
80 Dhafer Youssef : « L’art est ma religion » par Astrid Krivian
84 Sounds of Africa par Sophie Rosemont
90 Cahier Afrique Méditerranée Business : L’automobile veut changer de vitesse par Jean-Michel Meyer, Julie Chaudier et Cédric Gouverneur

63 CAMEROUN : UN NOUVEAU SEPTENNAT par Emmanuelle Pontié et François Bambou
64 Désirs d’avenir
67 Renforcer la lutte contre la corruption
68 Consolider l’unité nationale
70 Une croissance mieux distribuée
72 Booster l’emploi
74 Les chantiers du social
76 CAN 2019 : gagner le pari de l’organisation
78 Se connecter à l’innovation
104 Escapades : Les Seychelles, tropicale attitude
107 Carrefours : Tout pour la couleur
108 Fashion : Amsterda m met le continent à l’honneur par Luisa Nannipieri
110 L’ostéopathie, tout en équilibre
111 L’avocat, incontournable pour une cuisine santé
112 Acné : les bons ré flexes
113 Bien respirer, c’est essentiel !



FONDÉ EN 1983 (34e ANNÉE)
31, RUE POUSSIN – 75016 PARIS – FRANCE
Tél. : (33) 1 53 84 41 81 – fax : (33) 1 53 84 41 93 redaction@afriquemagazine.com
Zyad Limam
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION DIRECTEUR DE LA RÉDACTION zlimam@afriquemagazine.com
Assisté de Nadia Malouli nmalouli@afriquemagazine.com
RÉDACTION
Emmanuelle Pontié
DIRECTRICE ADJOINTE DE LA RÉDACTION epontie@afriquemagazine.com
Isabella Meomartini DIRECTRICE ARTISTIQUE imeomartini@afriquemagazine.com
Jessica Binois PREMIÈRE SECRÉTAIRE DE RÉDACTION sr@afriquemagazine.com
Amanda Rougier PHOTO arougier@afriquemagazine.com
ONT COLLABORÉ À CE NUMÉRO
François Bambou, Julie Chaudier, Jean-Marie Chazeau, Frida Dahmani, Camille Deutschmann, Aurélie Dupin, Catherine Faye, Alexandra Fisch, Glez, Cédric Gouverneur, Aude Jouanne, Dominique Jouenne, Yasmina Khadra, Astrid Krivian, Venance Konan, Fouzia Marouf, Jean-Michel Meyer, Luisa Nannipieri, Ouakaltio Ouattara, Karima Peyronie, Sophie Rosemont, Alexandra Voeung, François Zabbal.
VIVRE MIEUX
Danielle Ben Yahmed RÉDACTRICE EN CHEF avec Annick Beaucousin, Julie Gilles.
VENTES
EXPORT Arnaud Desperbasque
TÉL.: (33) 5 59223575
France Destination Media 66, rue des Cévennes - 75015 Paris TÉL.: (33)156821200
ABONNEMENTS Com&Com/Afrique magazine 18-20, av Édouard-Herriot - 92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : (33) 1 40 94 22 22 - Fax : (33) 1 40 94 22 32 afriquemagazine@cometcom.fr
COMMUNICATION ET PUBLICITÉ
Ensuite / AMC
31, rue Poussin - 75016 Paris
Tél.: (33)153844181 – Fax: (33)153844193
GÉRANT Zyad Limam
DIRECTRICE GÉNÉRALE ADJOINTE Emmanuelle Pontié regie@afriquemagazine.com
CHARGÉE DE MISSION ET DÉVELOPPEMENT Élisabeth Remy
AFRIQUE MAGAZINE EST UN MENSUEL ÉDITÉ PAR
31, rue Poussin - 75016 Paris.
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL : Zyad Limam.
Compogravure : Open Graphic Média, Bagnolet. Imprimeur: Léonce Deprez, ZI, Secteur du Moulin, 62620 Ruitz
Commission paritaire : 0219 D 85602
Dépôt légal : novembre 2018.
La rédaction n’est pas responsable des textes et des photos reçus. Les indications de marque et les adresses figurant dans les pages rédactionnelles sont données à titre d’information, sans aucun but publicitaire. La reproduction, même partielle, des articles et illustrations pris dans Afrique magazine est strictement interdite, sauf accord de la rédaction. © Afrique magazine 2018.
En lice pour les plus prestigieux prix littéraires, FRÈRE D’ÂME est le livre phare de cet automne. Récit coup de poing d’un soldat sénégalais combattant pou r la France au cours de la Première Guerre mondiale.
AU-DELÀ D’UNE RÉFLEXION sur la violence et l’amitié absolue, Frère d’âme interroge les méandres de l’âme humaine et l’aliénation face à l’hostilité et au carnage. Ce texte poignant et hypnotique nous plonge dans la Grande Guerre et raconte le parcours de deux jeunes soldats sénégalais sur un champ de bataille français. On entre dans ce roman au ton singulier et incantatoire par une phrase sibylline, d’une force déchirante : « Je sais, j’ai compris, je n’aurais pas dû. » Dès lors, les mots s’enchaînent dans une confession brûlante. Obsédante. Presque un chant halluciné auquel on ne peut résister. « Si j’avais été alors tel que je suis devenu aujourd’hui, je l’aurais tué la première fois qu’il me l’a demandé, sa tête tournée vers moi, sa main gauche dans ma main droite. » David Diop ne nous laisse pas le choix. Il faut avancer avec Alfa, le narrateur. L’accompagner jusqu’aux confins de l’irréparable. S’enfoncer dans ses pensées, se fondre dans ses souvenirs, partir à la dérive,


dans ses souvenirs, partir à la dérive, sauver son ami, son frère, Mademba, du néant et le rendre à la vie. Endurer avec lui ce que plus de 120 000 tirailleurs sénégalais envoyés à la mort dans une guerre qui ne leur appartenait pas ont subi. Frère d’âme est un texte poignant, dans par la faute de ses semblables. La fiction s’incorpore à un questionnement philosophique sur la trahison et la loyauté. Sur la frontière entre l’humanité,


par Catherine Faye
l’inhumanité et la démence. « Je suis deux voix simultanées. L’une s’éloigne et l’autre croit. » Cette citation de Cheikh Hamidou Kane mise par l’auteur en exergue de son roman augure du sort que la guerre, cette « impitoyable et anonyme machine » selon les termes de Cendrars, réserve à Alfa. Avec ce roman d’une beauté écrasante, David Diop redonne la voix aux milliers de soldats africains.
il s

lequel un homme se déshumanise


Oui mon comm q
été rassemblés des lettres et s dans rythmé de certaines fo c universalité. « écouté mo corps, Dav Goncourt son chant dou
Homonyme d’un des plus grands poètes sénégalais du XXe siècle (1927-1960), cet écrivain, né en 1966, enseigne la littérature depuis vingt ans à l’université de Pau, en France. L’idée de cette fiction lui est venue à la lecture de Paroles de poilus, paru en 1998, chez Librio. Des lettres d’une grande intensité émotionnelle écrites par des jeunes gens qui ne savaient pas qu’ils allaient mourir quelques heures ou quelques jours après les avoir écrites. Se demandant ensuite s’il existait des textes de ce genre écrits par des tirailleurs sénégalais, il s’est plongé dans Amkoullel, l’enfant peul et Oui mon commandant !, d’Amadou Hampâté Bâ (Actes Sud), qui y indique que des effets de tirailleurs sénégalais ont été rassemblés quelque part. Il imagine alors qu’il s’y trouve des lettres et se lance dans un psycho-récit qu’inonde le flux des pensées de son protagoniste, raconté à la première personne dans une langue sobre. Une litanie semée d’images fortes, rythmée par la répétition de certains termes et de certaines formules, comme autant de refrains qui rappellent la cadence du wolof, tout en donnant au texte son universalité. « Par la vérité de Dieu, j’ai été inhumain. Je n’ai pas écouté mon ami, j’ai écouté mon ennemi », confesse le héros de cette descente aux enfers. Par la violence du verbe et des corps, David Diop frappe fort. En lice pour les prestigieux prix Goncourt, Renaudot, Femina, Interallié et Médicis, son chant douloureux nous jette à terre. Dans un cri d’amour. Où l’amitié, à l’aune de la formule de Montaigne, « parce que c’était lui ; parce que c’était moi », prend toute sa dimension. ■


Où l’amitié, à l c’était lui ; parc








« J’AI EU ENVIE DE RENCONTRER ces gens, de les connaître et de les faire connaître, pas tous, bien sûr, mais au moins une famille. » Avec la même sensibilité que dans Les Deux Vies de Baudoin, Fabien Toulmé raconte l’histoire véritable d’Hakim, un jeune Syrien qui a dû tout quitter, sa famille, ses amis, sa propre entreprise. À cause de la guerre. De la torture.
LE TITRE PROVIENT d’un proverbe yoruba, langue et peuple du Nigeria : « Chaque jour appartient au voleur, mais un seul au propriétaire. » Le ton est donné. Lorsque Teju Cole retourne à Lagos, après quinze années passées à New York, il tâche de renouer avec l’univers étourdissant de la mégapole africaine aux 12 millions d’habitants. En 27 chapitres illustrés de photographies, l’auteur entremêle souvenirs,

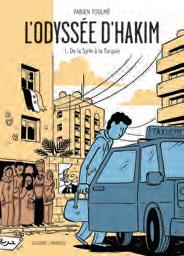

« L’ODYSSÉE D’HAKIM :
É
TOM E I, DE LA SYRIE À LA TURQUIE », Fabien Toulmé, Delcourt, 272 pages, 24,95 €.


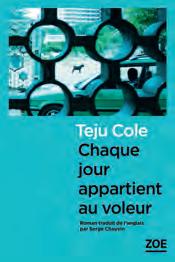

« CHAQUE JOUR
APPARTIENT AU VOLEUR », Teju Cole, Éditions Zoé, 192 pages, 19,50 €
Et parce que le pays voisin semblait pouvoir lui offrir avenir et sécurité. Cette bande dessinée se base sur des faits réels, et s’inspire des dizaines d’heures d’interviews recueillies par l’auteur, dont l’esprit de compréhension et de transmission est le fil conducteur. Ses planches, tout en simplicité, sont à la fois touchantes et puissantes. ■ C.F. reportage intime et fiction. Le récit percutant d’un retour au pays, dans lequel la ville devient un personnage à part entière. ■ C.F.
C’EST L’HISTOIRE d’un jeune Haïtien qui apprend la vie en marchant, tel Maître-Minuit, géant haïtien légendaire. Un homme debout qui avance toujours, quoi qu’il arrive. Poto est né sous les tristes tropiques d’une dictature sanguinaire. Avec pour seuls trésors ses dessins dans un sac à dos, il se met en chemin, mime le fou, vit de larcins et de jongleries. Funambule de la vie, il a un vrai don pour se percher au niveau des étoiles, rêver sa vie, se raconter le monde et le dessiner. Jusqu’au jour où il se place sous l’étrange protection d’un tueur à gages à la solde du régime. Baroque et explosif. ■ C.F. « MAÎTRE-MINUIT », Makenzy Orcel, Zulma, 320 pages, 20 €.

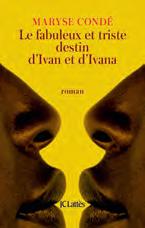

DESTIN
D’IVAN ET D’IVANA », Maryse Condé, JC Lattès, 250 pages, 19 €
L’écrivaine guadeloupéenne de 81 ans, auteure d’une trentaine de romans portant notamment sur l’esclavage et le colonialisme, a été désignée par un vote populaire. Une consécration pour cette grande dame des lettres francophones. Souvent pressentie pour le prix Nobel, cette voix singulière remporte le « nouveau prix de littérature » institué par une académie éphémère, créée pour compenser l’absence de remise du prix Nobel de littérature en 2018. Une situation due au fait que l’époux français d’une membre du jury a été accusé de multiples agressions sexuelles et qu’il aurait été couvert par l’Académie. Il a été condamné à deux ans de prison pour viol en octobre dernier, en Suède. ■ C.F.

Le cinéaste de TWELVE YEARS A SLAVE revient avec un film d’action saisissant, qui met en scène une actrice majestueuse.
par Jean-Marie Chazeau
PRESQUE CINQ ANS APRÈS son Oscar du meilleur film pour Twelve Years A Slave, sur l’esclavage dans les plantations américaines, le réalisateur britannique (et artiste contemporain) Steve McQueen propose un polar situé de nos jours à Chicago : une histoire de lourde dette à payer par les veuves de quatre braqueurs. Rien de commun entre elles, mais elles vont s’unir sous la houlette de Veronica, interprétée par Viola Davis, à la fois fragile et impériale, pour réunir la somme que leurs maris, tués par la police, devaient à un gang adverse…
Le casting est d’ailleurs l’un des atouts du film : du côté des gangsters qui veulent récupérer le butin, le Londonien Daniel Kaluuya (Get Out, Black Panther) joue avec cynisme et cruauté le rôle d’un dénommé Jatemme – « I love you too », lui lance l’un de ses ennemis, apparemment francophile ! Quelques mois après Ocean 8, dans lequel des femmes orchestraient un casse bling-bling à New York, ces quatre veuves sont plus tourmentées, mieux incarnées et bien
mieux ancrées dans le réel. Et c’est l’occasion de découvrir tous les quartiers de la ville de Chicago, selon les milieux sociaux et au gré d’une campagne électorale qui pimente le scénario…

« LES VEUVES » (États-Unis) de Steve McQueen. Avec Viola Davis, Colin Farrel, Daniel Kaluuya, Michelle Rodriguez.
Le point de vue est souvent décalé : une course-poursuite est entièrement filmée de l’intérieur d’une fourgonnette qui perd ses portes arrière, un dialogue a lieu dans une voiture dont on ne voit pas les protagonistes mais une partie de la carrosserie pour pouvoir mieux observer la ville, etc. Avec des scènes d’action efficaces et un rythme haletant, la mise en scène est pleine d’inventions, malgré quelques facilités de scénario du côté des rebondissements… Un film sombre, avec une actrice afro-américaine dans le rôle principal, qui pourrait bien devenir un classique. ■
DANS LA VEINE des films de retour au bled, voici Mohamed, lycéen de la région parisienne qui découvre au décès brutal de ses parents qu’il a été adopté… Il retrouve alors dans le sud du Maroc ses vrais père et mère, qu’il croyait jusque-là être son oncle et sa tante. Soulignant la barrière de la langue et la différence des milieux sociaux (« Y a même pas de wi-fi »), le film, tourné dans la superbe région d’Akfhenir, prend son temps, avec de belles images et une mise en scène fluide, mais les effets sont appuyés et souvent prévisibles. ■ J.-M.C. « LE FILS DU DÉSERT » (France-Maroc) de Laurent Merlin. Avec Ahd Saddik, Abdelmoula Oukhita.
EN COMPÉTITION au dernier festival de Cannes, Yomeddine raconte la vie d’un homme lépreux (guéri, mais physiquement marqué) qui, à la mort de son épouse, part à la recherche de ses racines. Dans les marges de l’Égypte d’aujourd’hui, un premier film sur des miséreux, sans voyeurisme.
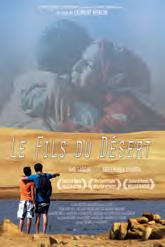
Mohamed, 17 ans, va découvrir ses véritables origines.

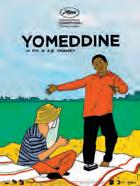

Yomeddine est son premier film.
AM : Un lépreux, un orphelin nubien, un cul-de-jatte… Tous vos personnages sont impressionnants de justesse. Comment les avez-vous trouvés ?
A. B. Shawky : J’ai eu beaucoup de chance. Le premier que j’ai rencontré, c’est Rady Gamal, pour le rôle principal : il avait de l’énergie, il était passionné, et on s’est tout de suite bien entendus. Pour le petit garçon, j’ai essayé de le trouver en Nubie, mais la seule chose qu’on a rapportée, c’est le prénom : Obama ! Et c’est le fils du portier d’un immeuble du Caire qui s’est imposé comme une évidence. Quant au personnage sans jambes, le rôle était destiné à un homme qui vendait des mouchoirs dans la rue, mais il a disparu le premier jour. On était dans une zone dangereuse, sous la protection de locaux qui ont cru que l’on se moquait d’eux quand on a voulu annuler le tournage. Je leur ai expliqué que l’on cherchait un cul-de-jatte, et l’un d’eux a dit : « C’est tout ? Mais moi, j’en connais un ! » Et il a été bien meilleur !
Comment ont-ils accepté d’être filmés sans craindre d’être exhibés ?
J’ai gagné leur confiance en leur parlant beaucoup pendant les quatre mois passés ensemble. Lentement mais sûrement, j’ai pu leur indiquer comment jouer. Je ne voulais surtout pas qu’ils aient l’impression que j’exploitais leur situation. J’ai pris soin de les protéger. À l’aéroport du Caire, ils n’ont pas pu embarquer pour le Festival de Cannes à cause de problèmes de visa, et les gens pensaient que je plaisantais quand je disais que je voyageais avec eux. Mais moi, je ne regarde pas leur maladie. Le film montre la misère en Égypte, mais il n’y a pas de message politique, alors que vous aviez réalisé un court-métrage sur la révolution en 2011, Martyr Friday. Je ne voulais pas faire un film dépressif ou, pire, du « poverty porn » (qui met en scène la misère), ni tomber dans le cliché du film proche-oriental qui parle politique et religion. Je voulais parler d’humanité, montrer des êtres humains. Et je souhaite que l’on regarde mon film comme un « feel good movie ». ■ Propos recueillis par J.-M.C.
LE RÉALISATEUR D’HEDI se penche à son tour sur le drame des « combattants » partis faire le djihad en Syrie, mais à sa manière, tout en subtilité, et en se concentrant sur des parents, à Tunis, qui n’avaient rien vu venir. En particulier le père, qui part à la recherche de son fils en remontant sa trace jusqu’à la frontière turco-syrienne. Pas d’explications, c’est la quête qui remue le spectateur, lequel voit ce père changer à l’heure d’une retraite qu’il espérait paisible… ■ J.-M.C. « MON CHER ENFANT » (Tunisie) de Mohamed Ben Attia. Avec Mohamed Dhrif, Mouna Mejri, Zakaria Ben Ayed.
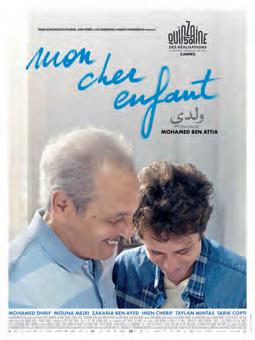
Cultivant un terrain urbain et girly à la fois, cette jeune Malienne qui a grandi en France a déjà un tube en stock, « DJADJA », et devrait battre tous les records avec son deuxième opus, Nakamura.



par Sophie Rosemont
PAS DE DOUTE LÀ-DESSUS, « Djadja » était l’un des tubes de l’été. Paroles culottées aussi accrocheuses que les rythmiques, il y avait de quoi chanter à tue-tête sur ce morceau, certifié single de platine. À l’origine de ce carton commercial, Aya Nakamura, née il y a vingt-trois ans à Bamako et élevée à Aulnay-sous-Bois par une famille de griots. Sa mère ayant toujours chanté, elle fait instinctivement de même. Après avoir lâché ses études de mode, Aya décide de se consacrer à la chanson. Son pseudonyme, elle l’emprunte à l’un des personnages de la série Heroes – capable de manier l’espace-temps à sa guise… Ce qui va plutôt bien à ses chansons, qui auraient déjà pu connaître le succès il y a trente ans – tout en étant résolument

contemporaines, usage généreux de l’auto-tune oblige.
En 2015, Aya partageait son premier titre sur YouTube, « J’ai mal », et a confirmé sa popularité immédiate avec un premier album, Journal intime, en 2017. Certifié disque d’or, l’opus comprend des featurings avec MHD, Dadju, le frère de Maître Gims, ainsi qu’Oumou Sangaré. Mais c’est avec Nakamura qu’explose aujourd’hui le charisme d’Aya. Maman d’une petite fille, elle y témoigne à la fois de son époque, de sa jeunesse et de la distance qu’elle prend face aux comédies humaines et autres jeux d’apparence. Elle évoque aussi les questions de la maternité et du mariage, rappelant qu’elle a évolué en trois ans tout
« NAKAMURA », Aya Nakamura, Warner Music
en gardant la tête froide. « Copines » évoque l’amitié et l’adultère, « Whine Up » s’attarde sur les plaisirs sensuels et « Ouya », plus sombre, narre les difficultés d’une relation amoureuse sous forme de ballade en piano-voix… Côté influences, tout s’articule autour d’une vision accessible de la trap, mêlée à des sons clubbing, du zouk et une afro-pop forte de caractère. Hors de question pour Aya d’oublier d’où elle vient. Mais elle devrait aller très loin : avec ses plus de 350 millions de vues cumulées sur YouTube, la chanteuse est entrée en force sur le terrain d’une musique à la fois francophone et populaire, qu’elle défend au sommet des classements européens comme africains. À quand le reste du monde ? ■
R’n’B
« EVERYONE’S JUST WINGING IT AND OTHER FLY TALES », Blinky Bill, Lusafrica/The Garden


NÉE AU SIERRA LEONE et élevée à Cologne, Mariama a pour idole Joséphine Baker, avec laquelle elle partage un grand sens de la générosité. Depuis son premier EP paru en 2015, Moments Like These, il est évident que cette chanteuse ensorcelante a beaucoup de choses à dire. Pour preuve, ce deuxième album, Love, Sweat and Tears, dont les 14 morceaux rivalisent d’élégance mélodique. Imaginé alors qu’elle s’illustrait dans la pièce La grenouille avait raison de James Thiérrée, cet album, réalisé sous la houlette de Manuel Schlindwein (Patrice, Akua Naru, Cody Chesnutt…), ne choisit pas entre toutes ses influences. On y entend des balafons du Burkina, des guitares guinéennes ou encore des synthés anglo-saxons. Le tout avec sa voix de velours, qui chante les relations humaines avec une pudeur très assumée… ■ S.R.


« OTODI », Vaudou Game, Hot Casa Record/Big Wax
funk
« LOVE, SWEAT AND TEARS », Mariama, Rising Bird


L’HYPNOTISANT VAUDOU GAME
DES CHANTS vaudous à l’afro-funk, ce qui se joue de plus fascinant habite la musique du surdoué Peter Solo, originaire d’un village situé près de Lomé, au Togo. C’est là qu’il a enregistré son troisième album, Otodi, du nom d’un lieu magique nommé l’Office togolais du disque… Construits durant les années 1970, les murs de ce studio de Lomé ont vibré au son des rythmiques togolaises et du funk sous influence américaine. On vous défie de ne pas lever les mains très haut sur « Pas content », titre partagé avec Roger Damawuzan, le James Brown national – et on n’exagère pas ! ■ S.R.


Au-delà des frontières africaines
DE L’INSTRUMENTAL « Lwanda Magere » à « Happy », difficile de résister au charme du premier album international du Kenyan Bill « Blinky » Sellanga. Pour servir 12 titres entraînants, il invite les musiciens les plus doués des quatre coins de la planète : Petite Noir, Nneka, Sage, Sarah Mitaru, Wambura Mitaru, Lisa Oduor Noah, Sampa the Great… Partagé entre un hip-hop old school qui nous rappelle les plus belles heures des années 1990, un funk expérimental et une pop qui ne connaît aucune limite de genre, Everyone’s Just Winging It and Other Fly Tales révèle une ambition artistique de haute voltige. Le coup de cœur de la saison ! ■ S.R.
soul J.P. BIMENI Un album libérateur
À 16 ANS, J.P. Bimeni quittait le Burundi pour fuir la guerre civile de 1993, qui a manqué de le tuer. Réfugié en Angleterre où il a découvert Otis Redding et Marvin Gaye, il a reconstruit sa vie en se consacrant, entre autres, à la musique. Pendant ses études d’économie à l’université du Lancashire, il commence à se produire sur scène. Depuis quelques mois, il est associé au groupe de Southern soul The Black Belts. Une belle brochette de musiciens qui sert la musique fédératrice de J.P. Bimeni dans ce premier album enregistré ensemble, baptisé Free Me. En écoutant ses paroles, racontant les traumas du passé tout en brillant par leur optimisme, on se dit que l’opus porte bien son nom. ■ S.R.
« FREE ME », J.P. Bimeni & The Black Belts, Tucxone Records
ur fuir uer. onsacrant, s mmence s,


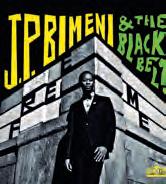

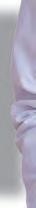


cinéma
Apatride, de la cinéaste
Narjis s Nejjar, ouvrira les JCC 2018.
Cette
année, le festival Africolor affirme sa féminité.
La 29e édition des Journées cinématographiques de Carthage s’inscrit sous le signe de la diversité.
CETTE ANNÉE, zoom sur les jeunes réalisateurs arabes et africains. Et place aux femmes ! Parmi les 206 films provenant de 47 pays retenus pour cette édition, le film d’ouverture des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) sera le long-métrage marocain Apatride, de la réalisatrice Narjiss Nejjar. Du côté de la section « Focus », elle aura comme invités l’Irak, le Sénégal, le Brésil et l’Inde. Chaque pays présentera une sélection de films (18 irakiens, 13 sénégalais, 12 brésiliens et 8 indiens). Un nouveau souffle qui redonne au festival sa dimension tricontinentale, voulue lors de sa fondation, confirmant ainsi sa vocation de festival du Sud. Enfin, les films seront projetés dans 19 salles de cinéma du Grand Tunis et dans quatre salles de cinéma dans les régions de Nabeul, Sfax, Kasserine et Siliana. ■ C.F. JOURNÉES CINÉMATOGRAPHIQUES DE CARTHAGE, Tunis, du 3 au 10 novembre 2018. jcctunisie.org



ELLES S’APPELLENT Rokia Traoré, Fatoumata Diawara, Nainy Diabaté, Hasna El Bacharia… Elles sont artistes, femmes et africaines, et ont décidé de mener leur révolution du désir en musique. Pour la 30e édition d’Africolor, elles prennent le pouvoir, instruments de musique au poing, et redessinent la carte sociologique du continent. Les mousso (« femmes » en bambara) sont l’avenir des musiques africaines et, pendant plus d’un mois, s’affichent dans plusieurs salles d’Île-de-France, au sein de prises de risques magnifiques et de transes assumées. Muthoni the Drummer Queen, la bombe du hip-hop kényan à la musique hybride et contagieuse, sera présente. Figure féministe d’Afrique du Sud, Dope Saint Jude repoussera quant à elle les frontières du hip-hop avec son lyrisme percutant et enflammé. Un programme tout en féminité, où les hommes ont aussi leur place : Les Tambours du Burundi, 3MA, Blick Bassy ou encore Aziz Sahmaoui répondront également présent. Sans oublier Le Bal de l’Afrique enchantée, à ne manquer sous aucun prétexte. ■ C.F.
AFRICOLOR, Île-de-France, du 16 novembre au 22 décembre 2018. africolor.com


AKAA, Carreau du Temple, Paris, du 9 au 11 novembre 2018. akaafair.com
POUR SA TROISIÈME ÉDITION, la foire d’art contemporain et de design centrée sur l’Afrique AKAA (Also Known as Africa) met à l’honneur les influences croisées entre le continent et d’autres régions du Sud global – Amériques, Asie, Moyen-Orient. Elle accueille 49 exposants, dont de nouveaux venus du Portugal, d’Italie, d’Afrique du Sud ou encore du Maroc. Plus d’une centaine d’artistes seront présents et, dans la continuité des éditions précédentes, tous les types d’expressions contemporaines seront représentés : sculpture, peinture, photographie, installation, performance et design. Flamboyant. ■ C.F.

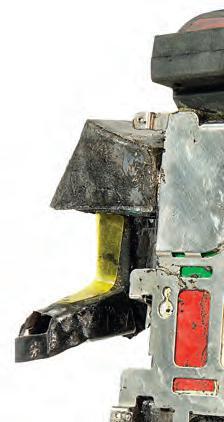

CAPITALE DE TOUS LES POSSIBLES
Le MIAM accueille 70 créateurs venus de Kinshasa pour proposer un portrait ultra-contemporain de la cité.




LE F A fri dése 1 ann styli met dése la cu l f mo UN IN Le exposition




SUR FOND DE DÉAMBULATION – une traversée de la ville qui mène les visiteurs de quartier en quartier –, l’exposition « Kinshasa Chroniques » s’articule autour de neuf sujets : performance, sport, paraître, musique, capital, esprit, débrouille, futur et mémoire. Si les thématiques sont diverses, elles n’ont pas pour autant l’objectif d’offrir une vision globale de Kinshasa : il s’agit plutôt de suggérer des pistes pour penser l’espace urbain kinois. Tout au long de l’exposition, photographes, vidéastes, peintres, performeurs, bédéistes, slameurs et musiciens disent la densité, la dynamique et les imaginaires de cette mégalopole telle qu’ils la vivent, la contestent ou l’espèrent. Une ville de quelque 13 millions d’habitants où se côtoient tours futuristes et vastes étendues autoplanifiées. Une capitale qui, vue par ses artistes aujourd’hui, devient espace de tous les possibles. Les œuvres présentées traitent de la grande complexité, mais aussi de la beauté et de la poésie de la vie à Kinshasa. Elles contribuent à l’écriture plurielle d’une histoire de l’art urbain congolais dans un espace fondé par les artistes Hervé Di Rosa et Bernard Belluc. Aménagé dans un ancien chai à vin, ce laboratoire est ouvert aux artistes de toutes générations et de tous horizons. ■ C.F. « KINSHASA CHRONIQUES », MIAM (Musée international des arts modestes), Sète, du 24 octobre 2018 au 10 mars 2019. miam.org

mode UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE Le FIMA fête ses 20 a ns.
LE FESTIVAL INTERNATIONAL de la mode en Afrique (FIMA) quitte pour la première fois le désert du Niger pour les dunes de Dakhla. Pour sa 11e édition, qui coïncide avec le vingtième anniversaire de sa création par le célèbre styliste Alphadi, ce rendez-vous immanquable met à l’honneur une ville entre océan et désert marocain. Placé sous le thème « L’art et la culture, vecteurs d’intégration africaine », le festival entend rassembler les cinq continents en terre africaine. Son but ? Favoriser la construction de passerelles pour permettre l’expression des talents créatifs de l’Afrique, agir pour son développement économique et en porter les valeurs de diversité, de cohésion et de paix à travers la culture. L’événement, qui s’ouvrira sur un concert du groupe ivoirien Magic System, promet de belles surprises, entre défilés de grands noms de la mode, concerts (notamment de la chanteuse marocaine Oum) et concours de jeunes créateurs… Un nouveau salon, le Haske (« lumière », en haoussa), présentera des marques de mode ainsi que des produits de beauté et de bien-être africains et internationaux. Enfin, cette édition rendra hommage au « Magicien du désert », Alphadi. Salué par les plus grands créateurs, le styliste a été nommé, en 2016, Artiste de l’UNESCO pour la paix. ■ C.F.
FIMA, Dakhla, du 21 au 24 novembre 2018. fima-africa.com
par Catherine Faye

Dla danseuse franco-algérienne occupe une place singulière sur la scène chorégraphique internationale. Ses spectacles minimalistes explorent la quintessence du geste, comme acte de résistance et quête de l’intime. Saisissant. Depuis 1989, la compagnie de la chorégraphe donne des représentations dans le monde entier. Ici, Le Temps scellé , à Paris, en 2012.
anser, une nécessité vitale. Comme respirer. Dans ses pièces, Nacera Belaza poursuit son exploration : sculpter le vide, lui donner un corps, le rendre palpable. « Ceci n’est pas de la danse, ceci est un trait, un seul mouvement, celui d’échapper à soi… », indique cette autodidacte née en 1969 dans un hameau proche de Médéa, en Algérie. C’est là qu’elle passe sa petite enfance, avant que sa famille ne s’installe à Reims, en 1973. C’est là aussi qu’elle revient chaque été, à la période des mariages, où s’entremêlent les chants des femmes, le son des darboukas et les youyous, lors de soirées que seules éclairent des bougies. Avec la liberté retrouvée auprès d’une famille élargie, chose perdue en France, où elle vit avec ses frères, ses sœurs et ses parents. « Certains s’intègrent, se diluent ; d’autres se replient, par peur de vivre dans un pays sans vraiment y vivre », raconte la Franco-Algérienne, qui n’a de cesse de creuser le sillon de l’aller-retour entre ses deux patries. Une passerelle indissociable de ses créations et de son engagement dans la transmission et le partage. « Parler du geste de Nacera Belaza, c’est revenir sur ce qui fonde en mémoire son appartenance à une terre, l’Algérie, et à un entre-deux, une mer, la Méditerranée, en ce qu’il est un mi-lieu, à moitié de tout, pris entre deux rives. Comme si son geste dansé se trouvait en ces bords où le là-bas interroge toujours l’ici où qu’il soit », écrit Frédérique Villemur dans l’ouvrage qu’elle lui consacre, Nacera Belaza, entre deux rives (Actes Sud). Répétition du geste, lenteur infinie, étirement du temps, ses chorégraphies explorent quelque chose de plus grand, de plus infime aussi : la naissance de la danse. Nacera Belaza pratique depuis ses 8 ans. Dès que ses parents sortent de l’appartement – car cela lui est strictement interdit –, elle pousse les meubles et se met à danser. « J’ai utilisé mon corps pour pouvoir m’exprimer. » Son rapport à la musique et au corps est spontané. Dès lors, il devient langage. Face à l’emprisonnement de sa double culture – qui deviendra ensuite sa meilleure alliée –, la jeune danseuse parle à travers son corps. En 1982, elle découvre Michael Jackson et le clip de « Billie Jean ». C’est une traînée de poudre. « J’ai vu quelqu’un qui incarnait la voix et l’intime, ça me parlait, ça m’était familier, c’était une langue que je comprenais. » Plus elle grandit, plus les interdits deviennent forts et se referment sur elle. Elle n’a ni le droit de sortir, ni celui de danser. Elle ne peut qu’aller à l’école. Nous sommes dans les années 1990, et le durcissement venu des imams d’Arabie saoudite se fait ressentir. L’étau se resserre, et son désir de liberté devient de plus en plus fort. Alors qu’elle suit des études de lettres modernes à l’université de Reims, la littérature devient un détonateur fabuleux. Le Meilleur des mondes, d’Aldous Huxley, lui montre la voie. Il y a deux façons d’explorer le monde : soit on part à sa découverte et on voyage, soit on plonge à l’intérieur de soi. Elle comprend alors qu’elle peut être libre là où elle est. Le voyage devient vertical, et la danse une introspection. Minimaliste. Sa quête spirituelle – elle est de confession musulmane – l’empêche de sombrer dans la violence. Jusqu’à la rupture. À 27 ans, elle décide de quitter sa famille, seule. C’est le vertige. Et l’envol. Elle crée sa compagnie en 1989. Son rayonnement est international. En 2015, Nacera Belaza est nommée Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres. Pour la première fois, ses amis et sa famille sont rassemblés dans une même pièce. « Mes parents ont pleuré. Puis, ma mère m’a dit que je les avais rendus fiers. Ici, et en Algérie. » Une consécration après tant d’années de combat. Et de résistance. ■

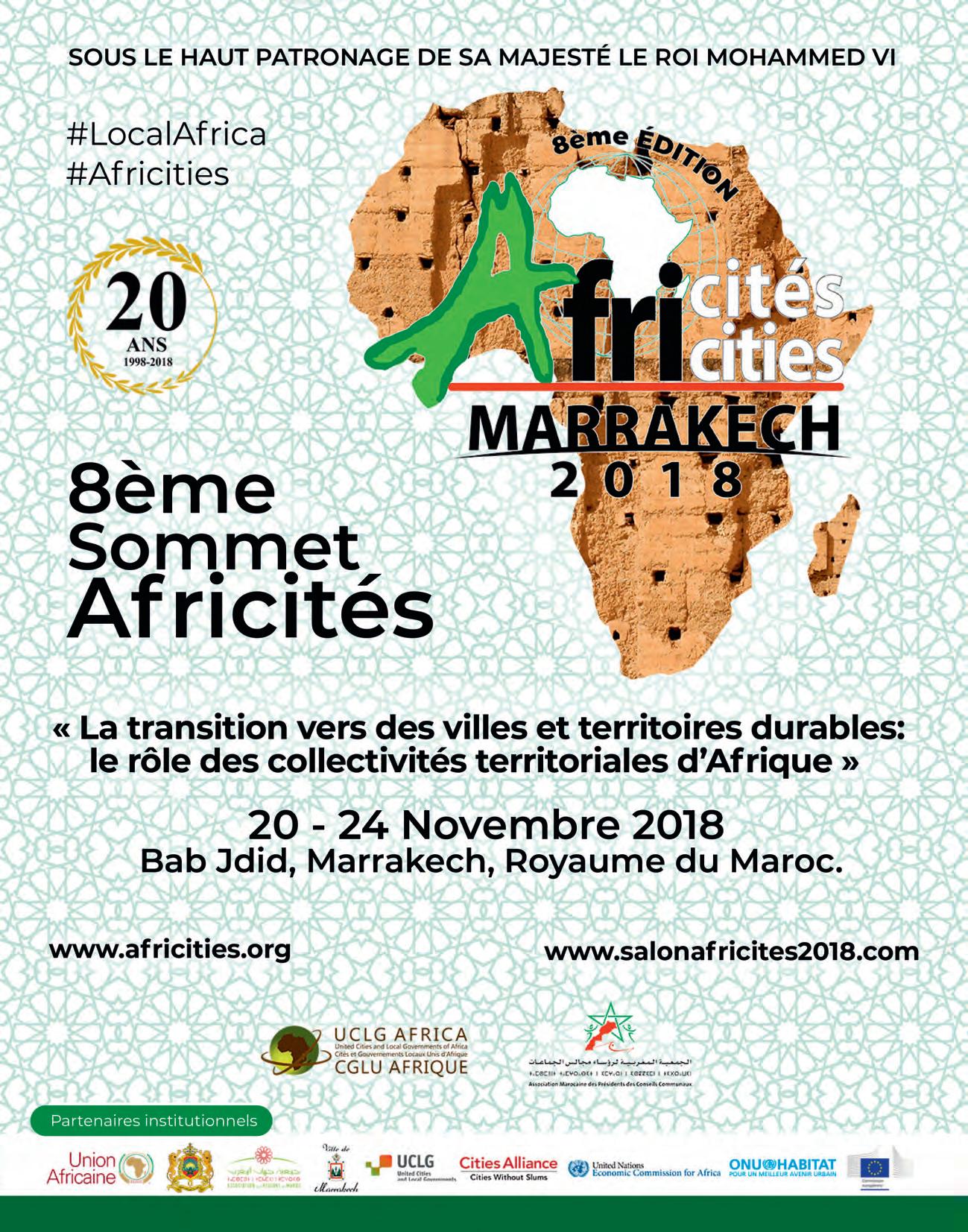

C’est le dernier mot à la mode. « C’est un fake ! » entend-on partout, tout le temps. La Toile est devenue en quelques années une machine à produire de fausses nouvelles, des infos volontairement erronées, fabriquées, nuisibles. Et en la matière, le continent africain est en passe de devenir champion toutes catégories de la manipulation, souvent grossière et bricolée à la va-vite. Les photomontages d’abord, où l’on juxtapose maladroitement des images pour faire croire que telle personnalité a fait ceci ou cela, ou se trouvait à tel endroit à une date bidon, manipulent l’opinion de plus en plus crédule, connectée, avide de scoops croustillants. Les intox ensuite tourneboulent les esprits, influencent dans tel ou tel sens, au profit bien sûr et toujours d’un lobby quelconque. Les opposants comme les pouvoirs en place s’y adonnent joyeusement. Les blogueurs en rajoutent, relayent, postent, et tout le monde partage, transformant un fake en une info virale en quelques minutes. Et les médias peu scrupuleux, pauvres, sans envie ou sans moyen de vérifier ladite info, la balancent à l’antenne ou sur leur site comme si elle était vraie. La rendant encore un peu plus crédible pendant un moment. Avant qu’un démenti formel n’intervienne finalement, avec la preuve que tout cela n’était qu’une grosse rumeur. Mais bien sûr, le mal est fait, la confusion s’est emparée des esprits. On se demande à chaque fois qui croire, qui ment, pourquoi, etc. Et à l’inverse, quand une info est vraie, celui que ça dérange peut crier au fake. Après tout, dans le doute, et dans un monde peuplé d’infos vérolées qui circulent, chacun en profite. Et ainsi de suite.

Alors aujourd’hui, tout le monde déplore le phénomène « fake », mais personne n’a les moyens de l’enrayer. Ou peut-être pas, en fait. Car seuls les médias dignes de ce nom, en faisant leur boulot avec professionnalisme, en vérifiant les sources et les informations avant de les divulguer, en refusant de se faire manipuler, peuvent redresser la barre. Et rappeler à tout le monde qu’il existe de véritables infos, données par des sources sérieuses. S’obliger à ne relayer que la vérité ou se taire est le seul moyen de décrédibiliser la kyrielle de petits malins qui pensent tirer leur épingle du jeu en installant une totale confusion dans le monde des médias, de la Toile, et surtout dans les esprits. ■
Le continent africain est en passe de devenir champion toutes catégories de la manipulation, souvent grossière et b ricolée à la va-vite.
de nos offres d'abonnements pour accéder à la totalité de nos magazines et bien plus encore