vitamine
lecture vitaminée pour les professionnels de l’automédication 10/2025

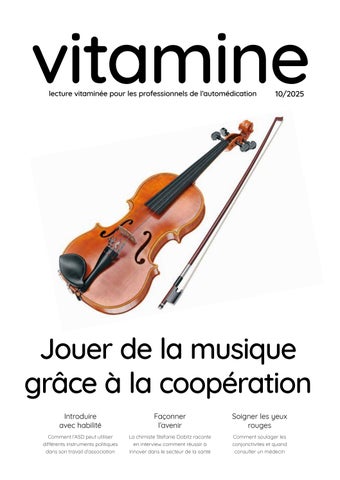
lecture vitaminée pour les professionnels de l’automédication 10/2025

Introduire avec habilité
Comment l’ASD peut utiliser différents instruments politiques dans son travail d’association
Façonner l’avenir
La chimiste Stefanie Dobitz raconte en interview comment réussir à innover dans le secteur de la santé
Soigner les yeux rouges
Comment soulager les conjonctivites et quand consulter un médecin
Thème central
Connaissances spécialisées

Réfléchir à des idées au quotidien
Comment réussir à innover dans le secteur de la santé malgré toutes les réglementations? Stefanie Dobitz, chimiste et responsable de recherche, nous en parle et explique le rôle que joueront les drogueries à l’avenir.

Il y a différentes coopérations dans la branche de la droguerie: au niveau politique, l’ASD défend ses intérêts avec des partenaires, tandis que dans le quotidien des drogueries, on travaille en collaboration avec des thérapeutes.

La goutte est une maladie courante liée au mode de vie moderne qui se caractérise par une inflammation aiguë des articulations. L’alimentation et le mode de vie jouent un rôle déterminant dans la prévention des crises de goutte.
4 Instruments politiques
Impressum vitamine
Editeur Association suisse des droguistes, Rue Thomas-Wyttenbach 2, 2502 Bienne, Téléphone 032 328 50 30, info@drogistenverband.ch
Distribution vitagate sa, Rue Thomas-Wyttenbach 2, 2502 Bienne
Directrice et responsable Ventes: Tamara Gygax-Freiburghaus, t.gygax@vitagate.ch
Annonces: Tamara Gygax-Freiburghaus, Marlies Föhn, Valérie Rufer, Janine Klaric, inserate@vitagate.ch
Abonnements et distribution: Sabine Andersen, vertrieb@vitagate.ch
Rédaction
Direction de l’édition: Heinrich Gasser, h.gasser@vitagate.ch
Rédactrice en chef: Céline Jenni, c.jenni@vitagate.ch
Ont collaboré à la rédaction de ce numéro: Astrid Tomczak, Barbara Halter, Christa Hofmann, Désirée Klarer, Jasmin Weiss
Conseils spécialisés: Dr oec. troph. (Univ.) Monika Wilhelm
Traduction: Daphné Grekos, Marie-Noëlle Hofmann
Couverture: stock.adobe.com/ARTYuSTUDIO
Production
Layout: Claudia Luginbühl
Impression: Courvoisier-Gassmann SA, Bienne 6 e année: paraît 10× par an
© 2025 – vitagate sa, Rue Thomas-Wyttenbach 2, 2502 Bienne

Magazine officiel de l’Association suisse des droguistes et média d’Employés Droguistes Suisse 17
Quels sont les instruments parlementaires et comme l’ASD peut-elle les utiliser?
Employés Droguistes Suisse
Ces règles s’appliquent aux employeurs qui souhaitent obtenir des références.
Connaissances spécialisées

Comment bien entretenir sa barbe
Les barbes courtes et classiques sont à la mode. Un barbier explique comment bien l’entretenir et donne des conseils et astuces pour un rasage humide réussi.
18
Aider à la prise de médicaments
Les droguistes peuvent aider à respecter la thérapie et à éviter la non-observance.
22
Lorsque les yeux sont rouges et démangent
Aperçu des différentes formes de conjonctivite et des limites de l’automédication.
Editorial

Créer des réseaux et les maintenir est aujourd’hui l’une des conditions préalables les plus importantes pour qu’une entreprise puisse non seulement survivre à long terme, mais aussi prospérer. De nombreuses drogueries entretiennent déjà des partenariats avec des thérapeutes. Qu’il s’agisse de naturopathes, de nutritionnistes, de physiothérapeutes, de coachs sportifs ou de sages-femmes, ceux qui considèrent les autres professions de santé non pas comme des concurrents, mais comme un enrichissement pour leur propre entreprise et leur clientèle créent une véritable valeur ajoutée. Les clients bénéficient de conseils holistiques, de traitements coordonnés et de nouvelles impulsions pour leur bien-être. Les coopérations sont également source de nouvelles idées, car des offres innovantes ou des services novateurs naissent souvent de la collaboration. Peut-être y a-t-il une possibilité d’organiser des ateliers sur la santé, des soirées d’information ou des services numériques communs? En développant des choses en collaboration avec d’autres, non seulement on élargit sa propre offre, mais on renforce également la position de la droguerie en tant qu’acteur pertinent dans le domaine de la santé. Ce qui commence à petite échelle dans votre propre droguerie est poursuivi à grande échelle par l’Association des droguistes au niveau politique. Grâce à des alliances et à des partenariats fiables, il est possible de faire valoir les intérêts de la branche, ce qui serait difficilement réalisable seul. La coopération n’est donc pas seulement une opportunité, mais aussi une stratégie – pour la branche, pour la clientèle et pour l’avenir de chaque droguerie.
Céline Jenni, rédactrice en chef Wirkstoff/vitamine, responsable médias spécialisés, c.jenni@vitagate.ch
L’Association
suisse des droguistes (ASD) suit les affaires politiques et dépose des interventions lorsque cela s’avère nécessaire. L’article suivant
donne un aperçu des instruments parlementaires existants et de la manière dont ils peuvent être utilisés.
7 Céline Jenni, Christa Hofmann | F D Marie-Noëlle Hofmann
Comme chacun le sait, les rouages de la politique tournent lentement. Il faut du temps avant qu’une demande aboutisse à une mesure du Conseil fédéral. L’Association suisse des droguistes suit toutes les affaires politiques pertinentes pour les membres de l’association et la branche et s’efforce de faire valoir les intérêts des drogueries le plus tôt possible et d’éviter les problèmes bureaucratiques inutiles. «Nous souhaitons avant tout résoudre les problèmes avec les autorités le plus possible bilatéralement», explique Andrea Ullius, directeur et responsable Politique et branche à l’ASD. «Nous y sommes déjà parvenus lors de discussions avec Swissmedic ou le Secrétariat d’État à l’économie (SECO), par exemple.» Ainsi, l’ASD a convenu avec le SECO, concernant l’obligation d’affichage des prix sur les rayons des produits pharmaceutiques, qu’une visualisation serait d’abord créée,
afin de pouvoir également examiner le problème d’un point de vue visuel. Cela a peut-être permis de trouver une solution au niveau des autorités. Si cela n’avait pas été possible, des demandes juridiques ou politiques auraient dû être formulées. «Mais cela exige beaucoup d’efforts», souligne Andrea Ullius. «Notre objectif est donc de lancer le moins d’initiatives possible.»
Les interventions sont des instruments parlementaires. Les membres des Chambres, les commissions et les groupes parlementaires peuvent utiliser les interventions pour demander des informations ou des rapports, exiger de nouvelles dispositions légales ou des mesures, généralement à l’adresse du Conseil fédéral. Il en existe différents types:
• questions
• interpellations
• postulats
• motions
Les différents instruments parlementaires
Donner l’impulsion pour des mesures ou de nouvelles dispositions légales:
Demander des informations au Conseil fédéral:
Une question invite le Conseil fédéral à fournir des informations sur des affaires fédérales. La réponse écrite, généralement fournie jusqu’à la session suivante, est adressée directement au parlementaire. Le conseil lui-même ne traite ni la question ni la réponse du Conseil fédéral. Une interpellation demande également au Conseil fédéral de fournir des informations sur les affaires touchant la Confédération. La différence avec une question est toutefois que l’auteur ou l’auteure peut déclarer s’il ou elle est entièrement, partiellement ou pas satisfait de la réponse du Conseil fédéral. Il peut également demander une discussion sur la réponse. Dans la pratique, cela ne se fait plus qu’au Conseil des États (le Conseil national ne discute plus que des interpellations déclarées urgentes).
Les réponses du Conseil fédéral aux interpellations donnent à l’ASD des indications sur le point de vue de l’administration ou du Conseil fédéral et fournissent des informations supplémentaires sur un sujet ou une problématique donnée. Cela peut servir d’argumentaire et, le cas échéant, pour d’autres interventions.
Examen d’une loi
Un postulat charge le Conseil fédéral d’examiner et de rendre compte de la nécessité de prendre une mesure ou de soumettre un projet de loi à l’Assemblée fédérale. Concrètement, il oblige le Conseil fédéral à examiner une loi et à proposer d’éventuelles modifications. Un postulat doit être accepté par le conseil auquel il a été soumis.
Un exemple actuel de postulat suivi par l’ASD est celui intitulé «Médicaments. Interdire ou mieux réglementer la vente par correspondance depuis l’étranger pour les particuliers», du conseiller national Philipp Matthias Bregy (Le Centre). Dans son postulat 25.3304, déposé lors de la session de printemps 2025, il a chargé le Conseil fédéral d’examiner si la disposition d’exécution actuelle relative à l’importation de médicaments en petites quantités par des particu-
liers doit être durcie. Le Conseil fédéral a proposé d’accepter le postulat. Le 20 juin, celui-ci a été adopté par le Conseil national et transmis au Conseil fédéral.
Une motion charge le Conseil fédéral de prendre une mesure ou de présenter un projet d’acte législatif à l’Assemblée fédérale. Elle oblige donc le Conseil fédéral à élaborer une loi dans un délai de deux ans ou à prendre une mesure spécifique. Toutefois, pour qu’une motion puisse être traitée, elle doit être approuvée par les deux Chambres.
Prenons l’exemple de la motion 25.3001 «Une couverture sanitaire solide et résiliente en toutes circonstances»: cette motion charge le Conseil fédéral d’élaborer, en collaboration avec les cantons, une stratégie définissant comment le système de santé peut garantir des soins solides et résilients en cas de crise, de catastrophe ou de guerre. Cette motion a été déposée par la Commission de la politique de sécurité du Conseil des États en janvier 2025. Le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion. Selon lui, des travaux sont déjà en cours sur cette question et il souhaite éviter les doublons. Lors de la session de printemps 2025, le Conseil des États a toutefois approuvé la motion. La Commission de la politique de sécurité du Conseil national a examiné cette motion le 23 juin. Elle a proposé à son conseil d’accepter la motion par 24 voix contre 0. Cette motion a été adoptée par le Conseil national lors de la session d’automne.
L’ASD suit cette motion dans le but de faire de la droguerie le premier point de contact en matière de soins de santé.
L’initiative parlementaire fait également partie des instruments parlementaires. Elle permet à un membre du conseil de soumettre ou de proposer un projet de loi fédérale. Les initiatives parlementaires ne sont toutefois pas des interventions au sens juridique du terme.
è Pour plus d’informations sur le fonctionnement des instruments parlementaires, consultez les sites parlament.ch
État des articles et des affaires parlementaires: mi-septembre 2025. è et juniorparl.ch

De l’académique à la pratique, en passant par le labo: la chimiste Stefanie Dobitz évolue à la croisée de la science, du milieu clinique et de l’entrepreneuriat. Elle explique comment réussir à innover même dans des domaines strictement réglementés et pourquoi les conseils prodigués en droguerie sont essentiels.
7
Astrid Tomczak | F D Daphné Grekos | Miriam
Kolmann
Stefanie Dobitz, vous êtes chimiste. Vous avez obtenu votre doctorat à l’EPFZ et travaillez aujourd’hui dans la recherche appliquée. Pourquoi vous être éloignée du milieu purement académique?
Stefanie Dobitz: Je reste fascinée par la science, mais encore plus par la manière dont les connaissances scientifiques débouchent sur du concret. Je voulais me rapprocher des interfaces décisionnelles, où une bonne idée devient ou non réalité du quotidien, qu’il s’agisse de médicaments, de technologies médicales, de prestations ou d’outils numériques. Il est passionnant d’accompagner des projets susceptibles d’améliorer la vie des patients.
Que faites-vous exactement au Centre du diabète de Berne?
Nous essayons de mieux comprendre comment l’insuline, qui est le principal médicament en cas de diabète de type 1, agit au quotidien. La stabilité de l’insuline peut être affectée par la température ambiante, la manipulation et les conditions de stockage. Son efficacité en pâtit, mais
les tests actuels ne détectent pas toujours ces changements avec précision. Le projet «Beyond Diagnostics» vise à mieux comprendre l’instabilité de l’insuline et son impact sur les résultats thérapeutiques. Notre objectif? Améliorer la prise en charge du diabète en garantissant l’efficacité de l’insuline.
Dans des domaines aussi réglementés que le secteur pharmaceutique et la technologie médicale, l’innovation peut-elle trouver sa place?
C’est vrai que les contraintes réglementaires sont considérables. Et c’est une bonne chose, car il est question de la sécurité et de l’efficacité de produits qui concernent directement les individus. La protection des patientes et patients reste primordiale, en particulier pour les médicaments et la technologie médicale. Mais cela n’exclut pas pour autant toute velléité d’innovation: c’est juste un processus qui prend plus de temps. Pour nous, ce n’est pas un obstacle, mais une partie du chemin. Le tout exige de la planification, des
Stefanie Dobitz
37 ans, est titulaire d’un doctorat en chimie et Senior Research & Development Manager au Diabetes Center Berne (DCB). Dans le cadre de son projet «Insulinaktivität», elle effectue des recherches sur des solutions innovantes visant à améliorer la vie quotidienne des patients sous insuline. Elle a par ailleurs travaillé dans le développement de médicaments, le diagnostic in vitro et la gestion de l’innovation. Elle s’investit également auprès de la plateforme «Women+ in MedTeCH» pour défendre la visibilité des innovations médicales à l’interface entre science, pratique clinique et entrepreneuriat.
connaissances techniques et beaucoup d’échanges.
Concrètement, avec qui échangez-vous? Avec des spécialistes du milieu hospitalier ou de l’industrie, mais aussi avec les autorités d’homologation et les start-ups. Ce sont
«L’innovation n’est pas un long fleuve tranquille: elle se nourrit de tentatives, de feedback et d’un apprentissage mutuel.»
notamment les projets émergents qui profitent énormément de ces partages. Nous avons fait de très bonnes expériences, y compris avec des organismes de réglementation comme Swissmedic ou l’Agence européenne des médicaments (AEM). Avec une bonne préparation et une communication transparente, le soutien et les conseils sont au rendez-vous.
Pourtant, bon nombre de start-ups n’arrivent pas à se faire une place sur le marché. Comment franchir ce cap?
En tenant compte du quotidien. Une bonne idée élaborée en laboratoire ne suffit pas. Il faut avoir conscience du quotidien des patients ou de l’environnement clinique et savoir comment fonctionnent les produits existants, quels sont les besoins et les obstacles. Autrement dit, il faut sortir du laboratoire, parler avec des patients, des médecins, des pharmaciens, des droguistes. Un échange direct apporte souvent plus que n’importe quelle théorie.
Dans la réalité du terrain, comment conciliez-vous la recherche, le milieu clinique et l’entrepreneuriat?
Ce sont encore souvent des sphères bien séparées, avec leurs logiques, langages
Le Centre du diabète de Berne
et priorités propres. Les chercheurs raisonnent sur la base des preuves, les cliniciens en fonction des patients et les entrepreneurs sont centrés sur le marché. À mon avis, il faut aménager des espaces de rencontre pour ces univers. Ici, au Diabetes Center Berne (CDB), cela fonctionne très bien: toutes les portes sont ouvertes, ce qui favorise la proximité et les rencontres fortuites pendant la pause café, là où naissent souvent les nouvelles idées.
Et côté tendances, quelles sont les évolutions qui redéfinissent aujourd’hui le marché de la santé?
De toute évidence, la personnalisation, c’est-à-dire l’adaptation des thérapies de manière plus ciblée aux patients, sachant que les médicaments induisent différentes réactions selon la personne. Par ailleurs, entre les applications de santé, les coachs thérapeutiques numériques et les outils d’auto-évaluation, la numérisation est un élément fondamental, qui modifie non seulement les soins, mais aussi les attentes des patients.
Et aussi le rôle des professionnels, comme les droguistes?
Tout à fait! Les droguistes deviennent de plus en plus des acteurs de référence, auxquels les gens s’adressent avec des questions, mais aussi avec des connaissances trouvées sur internet. Bon nombre de personnes se demandent si leurs informations sont correctes, si un produit leur convient ou si elles devraient consulter un médecin. Les droguistes peuvent jouer un rôle majeur en fournissant des conseils éclairés, en mettant les informations en perspective et en orientant les patients vers d’autres professionnels, si nécessaire. Cela implique un impact pour le savoir-faire qui est demandé aujourd’hui dans les drogueries.
Oui, les bases de connaissances doivent
Le Centre du diabète de Berne ou Diabetes Center Berne (DCB) est une fondation suisse privée et indépendante, fondée en 2017 dans le but de faciliter la vie des personnes atteintes de diabète. Le DCB soutient des idées et des projets dans le domaine de la technologie du diabète dans le monde entier en fournissant des connaissances spécialisées, un accès à des centres de recherche clinique et à ses propres laboratoires, ainsi que des fonds.
être très étendues. Les droguistes doivent maîtriser les principes actifs, les produits, mais aussi les bases médicales. Des connaissances pointues sont particulièrement précieuses en matière d’automédication, secteur qui englobe les médicaments en vente libre, les préparations vitaminées, les extraits phytothérapeutiques ou les thérapies d’appoint, mais aussi pour les produits cosmétiques, qui sont très demandés en droguerie.
Concrètement, qu’est-ce que cela signifie, par exemple concernant les cosmétiques? Réduction des rides, raffermissement de la peau, pureté, anti-âge: le marché des cosmétiques regorge de promesses, qui ne sont pas toutes scientifiquement étayées. Une occasion à saisir pour les droguistes, qui peuvent aider leur clientèle à démêler le vrai du faux: que peut réellement apporter un produit donné? Quels principes actifs sont utiles? Où s’arrête la cosmétique et où commence la médecine? Les droguistes peuvent faire office de filtre et agir contre la publicité abusive et la désinformation.
L’intelligence artificielle (IA) joue aussi un rôle de plus en plus important dans le secteur de la santé. Quelles opportunités et quelles limites décelez-vous dans ce phénomène?
L’IA est déjà largement utilisée aujourd’hui, par exemple pour le contrôle de la qualité dans la production de médicaments ou pour la planification d’études cliniques. Elle est capable d’analyser de grandes quantités de données, d’accélérer les processus et de révéler de nouvelles corrélations. Mais elle ne remplace pas un professionnel qualifié. Il faut toujours des personnes capables d’évaluer les résultats obtenus. En matière de conseil, c’est essentiel: l’IA donne des recommandations, mais c’est à un spécialiste de juger si elles sont utiles ou sûres.
Aujourd’hui, de nombreuses personnes recherchent des symptômes sur Google ou utilisent des applications pour s’autodiagnostiquer. Comment cela se traduit-il au quotidien pour une droguerie?
Les gens disposent de connaissances préalables très différentes, voire d’informations erronées. Les droguistes doivent donc à la fois les conseiller et les aider à se repérer au milieu de la jungle d’internet et de la réalité. Et ils peuvent aussi les aider à déterminer si tel produit suffit ou s’il faut consulter un médecin.
Comment les drogueries peuvent-elles s’affirmer dans un monde de plus en plus numérique?
En offrant ce que le commerce en ligne ne peut pas faire: conseil personnalisé, expérience produit et sécurité. Les personnes qui entrent dans une droguerie ne veulent pas juste faire des achats; elles veulent aussi être comprises et prises au sérieux. Les concepts qui combinent plusieurs dimensions ont un grand potentiel: par exemple, des zones dédiées au conseil, des coopérations avec des centres de fitness, des analyses dermatologiques ou des actions santé. L’expérience d’achat en présentiel doit offrir une valeur ajoutée.
Pour conclure, que conseillez-vous aux jeunes qui ont des projets dans le domaine de la santé?
Parlez avec votre public cible, sortez de votre zone de confort, écoutez, posez des questions. Et n’ayez pas peur de vous tromper. L’innovation n’est pas un long fleuve tranquille: elle se nourrit de tentatives, de feedback et d’un apprentissage mutuel.
Vous trouverez à cette place dans le numéro de novembre de vitamine une interview de la gagnante des SwissSkills.


En coopération avec différents partenaires, les droguistes unissent leurs forces pour défendre leurs intérêts, que ce soit au Palais fédéral ou sur le terrain. Comment ces collaborations au niveau politique et pratique renforcent-elles la branche de la droguerie?
Droguistes, pharmaciens, détaillants et membres du Parlement: des représentants de différents secteurs professionnels sont en réunion au Palais fédéral derrière une lourde porte en bois. Les gesticulations vont bon train et les dossiers se succèdent: sécurité de l’approvisionnement, régulation des prix, coûts de la santé. L’avenir du secteur de la santé et de l’automédication est âprement débattu tandis qu’au dehors, la Suisse vaque tranquillement à ses occupations. Chaque personne présente a pleinement conscience qu’elle ne pourra pas imposer toutes ses volontés, mais il est tout aussi clair que l’immobilisme n’est pas une option. Pour s’imposer face à la concurrence et aux réglementations politiques, l’union des forces et une action de concert font toute la différence. «Les revendications des seuls droguistes n’ont pas la priorité au Parlement», explique Andrea Ullius, directeur de l’Association suisse des droguistes (ASD) et responsable Politique et branche. «Mais si les pharmaciens et l’industrie pharmaceutique s’en mêlent, avec parfois l’appui des consommateurs, le Parlement leur accordera plus d’attention.»
Grâce à ce constat, l’ASD a mis en place un système de coopération et de partenariat à différents niveaux. La palette des partenaires va des poids lourds politiques comme l’Union suisse des arts et métiers à des organisations spécialisées comme la Fondation Refdata, en passant par l’Association des entreprises pharmaceutiques en Suisse (vips). Il était essentiel d’adhérer à la communauté d’intérêt CI OTX, une alliance en faveur de l’automédication et de la médecine complémentaire. «La CI OTX aborde des thématiques qui nous touchent toutes et tous de la même manière», souligne Andrea Ullius. Des personnes
partageant les mêmes idées collaborent au sein de cette alliance: l’ASD, pharmaSuisse, l’Association suisse des spécialités pharmaceutiques grand public (ASSGP) et l’Association suisse pour les médicaments de la médecine complémentaire (ASMC). «En unissant nos forces, nous pouvons faire bouger les choses sur le plan politique», ajoute le directeur de l’ASD.
La lutte dans le domaine des médecines complémentaires illustre bien l’efficacité de ces alliances: «Il y avait notamment une motion qui demandait que les médecines complémentaires soient exclues de l’assurance de base, pour ne plus être couvertes que par une assurance complémentaire. Nous avons réussi à convaincre le Conseil des États de rejeter cette proposition», se souvient Andrea Ullius. «Mais nous avons aussi connu d’autres cas où il a fallu nous rendre à l’évidence: nous ne pouvions pas continuer à opposer notre veto.» Par exemple, la problématique de la vente par correspondance, dont l’ASD se serait bien passé. «Rien ne sert de s’opposer à quelque chose par principe. En adoptant une telle attitude, on risque même de se retrouver perdant.» Mieux vaut s’engager dans le dialogue, voire prendre le lead, pour avoir voix au chapitre. «Nous pouvons ainsi au moins participer à définir les conditions d’introduction de la vente par correspondance», souligne Andrea Ullius. La coopération a toutefois aussi ses limites, comme dans le cas récent de l’ordonnance sur les cosmétiques. «Seuls les pharmaciens, les médecins et les chimistes sont autorisés à signer le dossier d’information sur le produit, qui inclut un examen des risques et une analyse toxicologique. Dans les faits, les droguistes ne sont ainsi plus autorisés à fabriquer de cosmétiques.» Malgré
Petit lexique: collaboration, coopération, partenariat
Souvent synonymes dans le langage courant, les notions de collaboration, coopération et partenariat peuvent être définies comme suit:
• La collaboration est le terme générique désignant toute forme d’action commune entre entreprises, qu’il s’agisse de conventions informelles ou d’accords écrits.
• On parle de coopération lors d’une collaboration structurée entre des entreprises juridiquement indépendantes, avec des accords bien définis afin d’augmenter la compétitivité commune ou d’atteindre des objectifs communs. Chaque partenaire conserve son indépendance, mais partage certaines ressources.
• Quant aux partenariats, ils constituent la forme la plus étroite de coopération, avec à la clé des alliances stratégiques et des projets de coopération, généralement à long terme, entre entreprises.
les interventions lors de la phase de consultation, cette issue n’a pas pu être évitée. Vous pourrez découvrir dès la page 4 les instruments politiques avec lesquels l’ASD peut s’engager concernant les affaires politiques.
La collaboration de l’ASD avec d’autres organisations ne se limite pas à la simple défense de ses intérêts sur la scène politique. «Début 2024, nous avons organisé des cours dans le domaine de la fabrication de médicaments, que nous avons aussi ouverts aux pharmaciens», rappelle Andrea Ullius. «Une meilleure coopération dans ce domaine serait souhaitable, d’autant plus que de nombreux points concernent les deux branches d’une manière ou d’une autre.» Dans certains domaines, l’ASD ne collabore qu’au cas par cas. Et pour d’autres sujets, il suffit de savoir à qui s’adresser si nécessaire, ou qui l’on pourrait rallier à sa cause.»
Pour réussir dans ces méandres complexes, tout dépend essentiellement des relations personnelles. «La popularité est importante, mais il ne faut pas trop en faire. Les personnes qui ont toujours quelque chose à dire sur tout ne vont pas forcément plus loin. Il faut juste être soi-même», souligne Andrea Ullius. D’un point de vue stratégique, il convient de bien déterminer où l’on investit son énergie, car on ne peut pas discuter de tout avec tout le monde. Une évaluation réaliste de la situation sur la scène politique est également indispensable pour assurer le succès à long terme de l’ASD. «Nous ne pouvons certes pas fixer les conditions-cadres, mais nous pouvons essayer de les influencer pour qu’elles servent notre cause.» Cela dit, le succès dépend en grande partie du soutien de la base: «Presque toutes les personnes qui gèrent une droguerie connaissent un conseiller communal, un député ou un conseiller aux États. Le travail politique commence déjà à ce niveau.»
De la carte de visite au carnet d’adresses
La sphère politique n’est toutefois qu’un des volets des partenariats. Une collaboration ciblée peut être précieuse dans d’autres domaines également. APODRO est un groupement qui mise fortement sur la coopération avec des thérapeutes externes. Tout a commencé il y a une dizaine d’années, et non à l’initiative de notre branche. «Plusieurs thérapeutes nous ont demandé s’ils pouvaient déposer
N’oubliez pas:
L’assemblée générale de cette année aura lieu le 14 novembre 2025 dès 13h30 au ARTE Seminar- und Konferenzhotel à Olten.


Association suisse des droguistes Rue Thomas-Wyttenbach 2 2502 Biel/Bienne 032 328 50 30 info@drogistenverband.ch droguerie.ch

leurs cartes de visite et des flyers dans notre magasin», se souvient Sabrina Winiger, codirectrice marketing d’APODRO. Aujourd’hui, une centaine de thérapeutes externes font partie du réseau des 19 filiales APODRO réparties dans toute la Suisse alémanique. Pour faire partie du réseau, il suffit de s’annoncer auprès d’APODRO, qui vérifie alors si le prestataire externe correspond à ses critères. «Nous travaillons exclusivement avec des thérapeutes certifiés et compétents, tout en veillant à ce que la qualité soit au rendez-vous», souligne Sabrina Winiger. Les offres commencent dès 40 francs. Selon le forfait choisi, le partenariat comprend différentes options: référencement sur le site web du groupement, présence pendant une journée dans une des filiales, affiches publicitaires sur place et, en contrepartie, publicité dans le dépliant des thérapeutes. Sans oublier les réunions de réseautage et les événements divers (soirées à thèmes, journées de la santé). «Nos partenaires externes bénéficient en outre de différentes activités ainsi que des recommandations de la part de notre personnel», ajoute Sabrina Winiger.
Dans la pratique, on constate toutefois que cela ne fonctionne pas aussi bien pour toutes les formes de thérapie. La naturopathie, par exemple, ainsi que la MTC, la kinésiologie ou encore les théra-
pies de résilience ont le vent en poupe, mais il est plus difficile de recommander des prestataires qui s’intègrent moins bien dans la consultation en droguerie. «C’est notamment le cas de la sonothérapie par les bols tibétains ou de l’art-thérapie», indique Sabrina Winiger. Le plus grand avantage pour APODRO, c’est que le groupement gagne en compétences: «Grâce aux nombreuses offres de thérapies externes répertoriées sur le site internet, APODRO bénéficie d’une meilleure visibilité. De plus, pour la clientèle, il est pratique de trouver autant de types de thérapie rassemblées à un seul endroit.»
Le service dédié aux ordonnances s’avère aussi utile: en effet, comme APODRO regroupe à la fois des drogueries et des pharmacies, les clientes et clients peuvent également remettre leurs ordonnances dans les drogueries et reçoivent ensuite le médicament souhaité par courrier postal. APODRO propose aussi ce service à d’autres drogueries. «Notre offre de partenariat en matière thérapeutique est de plus en plus appréciée. De nombreuses drogueries sont déjà de la partie», se réjouit la codirectrice du marketing.
Outre ces services suprarégionaux, comme ceux que propose APODRO, certaines approches misent davantage sur l’intégration locale, comme
Approfondissez vos connaissances sur les principes actifs et les indications relevant de l’automédication
Association suisse des droguistes, Rue Thomas-Wyttenbach 2, 2502 Biel/Bienne 032 328 50 30, bildung@drogistenverband.ch, droguerie.ch
le montre Serge Hagen, droguiste diplômé ES de la Dorf-Drogerie de Bassersdorf (ZH). Il y a neuf ans, au moment d’agrandir sa droguerie, il a directement prévu deux salles de thérapie supplémentaires dans le but de louer ces espaces à des thérapeutes externes. Aujourd’hui, il travaille ainsi avec une naturopathe, une aromathérapeute, une homéopathe et un podologue. Cette coopération est clairement structurée: les thérapeutes louent le local à l’heure ou à la journée et participent au chiffre d’affaires qu’ils génèrent auprès de la droguerie grâce à un système de commission. «Si une thérapeute nous adresse un patient ou une patiente pour une teinture maison, de la spagyrie ou des sels de Schüssler, nous lui remboursons une partie de nos gains», explique Serge Hagen. Pour lui, il est parfois complexe de définir des limites. «Je suis moi-même naturopathe et il arrive qu’une personne souhaite me demander un deuxième avis, mais ce n’est pas possible. Les gens doivent faire confiance à leur thérapeute.»
Le sérieux, une condition essentielle
Bien entendu, Serge Hagen ne fait pas aveuglément confiance au premier venu et sait se montrer sélectif au moment de choisir ses partenaires externes. «La condition essentielle, c’est le sérieux», souligne-t-il. «Par exemple, une thérapeute en fleurs de Bach qui prétendait pouvoir guérir le cancer a été écartée d’office. Les charlatans et les promesses hasardeuses de guérison n’ont pas leur place ici!» Cela dit, il espère que ces espaces supplémentaires dans sa droguerie permettront à la naturopathie d’être plus présente et mieux comprise. «Je serais en outre ravi que les sages-femmes ou les médecins, par exemple, travaillent davantage avec les drogueries», ajoute-t-il. «Mais ces derniers ont au contraire plutôt tendance à faire la sourde oreille.» Lors de l’inauguration des salles de thérapie, il a invité 33 médecins des environs, pensant leur montrer que ces formes de thérapie sont utiles et complémentaires, sans constituer une concurrence pour la médecine conventionnelle. Le résultat a été éloquent: pas un seul médecin n’a répondu présent. «Il y a bien sûr des médecins qui se montrent plus ouverts, mais apparemment pas dans la région de Bassersdorf, hélas.»

Une collaboration à inventer?
Le cas de Julius Jezerniczky, droguiste diplômé ES à Wädenswil (ZH), montre heureusement que certains médecins sont tout à fait ouverts aux approches issues de la médecine complémentaire. «Le Dr Aklin, par exemple, médecin et spécialiste des maladies tropicales, était très intéressé et venait régulièrement dans notre droguerie», se souvient-il. «Malheureusement, il est parti à la retraite.» Tout comme Serge Hagen, Julius Jezerniczky décèle un potentiel de taille dans le rapprochement avec les médecins conventionnels, mais il ignore si l’ouverture d’esprit serait au rendez-vous dans la région. «Je ne me suis jamais rendu moi-même dans les cabinets médicaux pour me présenter, car je suis trop pris par mes activités quotidiennes, mais c’est quelque chose que je recommanderais aujourd’hui aux jeunes qui débutent dans le métier.» D’autant plus que les drogueries maîtrisent à l’heure actuelle des compétences très différentes de celles d’il y a dix ou vingt ans. Il a toutefois pu observer que les médecins des environs envoient des gens dans sa droguerie. «Ce n’est certes pas une collaboration classique, mais nous profitons tout de même de ces synergies», se réjouit Julius Jezerniczky.
Même si la collaboration avec les médecins est plutôt informelle dans son cas, Julius Jezerniczky collabore plus étroitement avec d’autres organismes, par exemple avec les sages-femmes de
De la droguerie à un traitement dans l’espace de consultation: ces offres peuvent être rentables en fonction de la collaboration avec des spécialistes externes.
«Härzchlopfä». «Nous avons échangé et peaufiné nos idées, avant de finir par lancer de formidables produits sur le marché», se souvient-il. «C’était un pur plaisir de développer ce projet ensemble.» Il vend les produits en question aux sages-femmes à prix coûtant. «C’est certainement dû au fait que je suis lié avec elles aussi bien au niveau professionnel que sur le plan amical», précise-t-il.
Commercialement parlant, il juge que le domaine des compléments alimentaires recèle un potentiel certain. «Je trouve qu’il serait passionnant de collaborer avec des entreprises qui proposent des produits normalement disponibles uniquement en ligne», déclare le droguiste. «J’ai exposé une fois mon point de vue lors d’une réunion des membres de Dromenta, mais l’intérêt n’était malheureusement pas au rendez-vous. Je pense que c’est un marché de taille qui échappe ainsi aux drogueries.»
La plupart des naturopathes et des autres thérapeutes qui travaillent avec lui le connaissaient déjà avant. «Certains d’entre eux sont aussi venus me voir spontanément pour me demander d’envisager une collaboration.» Dans la plupart des cas, cette démarche aboutit à des projets intéressants, mais il y a aussi des exceptions. Une thérapeute pour animaux, par exemple, a directement exigé une réduction de 50 % sur ses achats. «Naturellement, c’est impossible», conclut Julius Jezerniczky. «Au bout du compte, les collaborations doivent aussi être rentables pour nous.» Les réductions oscillent ainsi entre 10 et 25 %, selon le volume de chiffre d’affaires généré.
À la droguerie Stutz, Maja Fabich-Stutz a elle aussi constaté que les partenariats n’apportent pas tous le succès escompté. «Nous avons tenté à maintes reprises de collaborer avec des thérapeutes externes, mais sans succès», soupire-t-elle, résignée. «Dans notre région, cela ne fonctionne tout simplement pas. Ces tentatives ont essentiellement généré une charge de travail supplémentaire.» Elle a ainsi commencé par élargir son assortiment pour satisfaire les besoins des thérapeutes, avant de constater que ces derniers commandaient leurs produits là où c’était le moins cher. «Ils se contentent de venir en droguerie pour les articles qu’ils
ne trouvent pas en ligne ou pour les mélanges de substances compliqués à réaliser», ajoutet-elle.
Maja Fabich-Stutz a donc décidé il y a quelque temps déjà de renoncer à une collaboration ciblée avec des thérapeutes externes. «Naturellement, si une personne vient aujourd’hui chez nous avec l’ordonnance d’un thérapeute, nous préparons les médicaments en fonction de ce qui est prescrit. C’est tout, et nous ne proposons pas non plus de réduction sur les prix.» Le jeu n’en vaut tout simplement pas la chandelle, d’autant plus que, souvent, les thérapeutes lui envoient un patient une seule fois pour acheter une teinture particulièrement complexe.
Les médecins envoient également des patientes et patients à Maja Fabich-Stutz. «Nous leur offrons un soutien, un accompagnement, et les médecins sont contents d’avoir quelqu’un qui prend part au suivi.» Comme pour Julius Jezerniczky, la collaboration avec les médecins s’est imposée naturellement: «Nous exploitons les synergies qui se présentent, mais je ne vais pas aller discuter des cas individuels avec les médecins.»
D’ailleurs, la plupart du temps, c’est tout bonnement inutile. «Si une personne a essayé tous les antibiotiques possibles et n’arrive pas à guérir de sa cystite, je n’ai pas besoin d’en débattre avec le médecin», souligne Maja Fabich-Stutz. Elle entretient en revanche des échanges informels avec un ostéopathe et un dentiste: «Avec eux, je peux être certaine qu’ils maîtrisent leur domaine. Et en plus, je peux parfois demander conseil si je me retrouve coincée face à un cas.»
Que ce soit en politique ou sur le terrain, les exemples sont clairs: la coopération, ce n’est pas la panacée. Parfois, elle ouvre des portes, parfois elle ne mène nulle part. Mais si les échanges, les réseaux et les alliances occasionnelles n’existaient pas, la branche de la droguerie aurait disparu depuis longtemps des arènes politiques et du quotidien de nombreux clients. Le plus important, ce n’est pas de transformer chaque contact informel en un partenariat réussi à long terme, mais d’avoir le courage de se lancer.
Ce qui est courant à l’étranger se généralise également ici: les entreprises ont de plus en plus souvent recours aux références dans le cadre du processus de recrutement. Ce qu’il faut savoir.
7
Regula Steinemann | F D Marie-Noëlle Hofmann
Bien que la tendance à demander des références soit en hausse, il n’existe aucune réglementation légale ou dans les conventions collectives de travail à ce sujet. La référence est considérée comme découlant du devoir de diligence de l’employeur et dérivée de l’obligation de fournir un certificat (voir à ce sujet les art. 328 et 330a du Code des obligations).

Regula Steinemann, avocate et directrice de «Employés Droguistes Suisse»
Cette page est ouverte à Employés Droguistes Suisse. L’avis de l’auteure ne doit pas coïncider avec celui de la rédaction et/ou de l’Association suisse des droguistes.
www.drogisten.org
Le contenu des certificats de travail est parfois controversé et la tendance à délivrer des certificats plus élogieux que ne le justifient les faits réels (le plus souvent pour éviter les litiges) n’est pas négligeable. Il n’est donc pas surprenant que les employeurs expriment de plus en plus souvent le souhait de pouvoir obtenir des références sur les candidates et candidats en complément des certificats, afin de se faire une idée plus précise de leurs performances, de leur comportement et de leur personnalité. En fin de compte, les références ont le même objectif que les certificats de travail, à savoir évaluer l’aptitude des candidats à occuper le poste vacant. On oublie souvent que les mêmes principes s’appliquent à la demande de références qu’aux certificats. Le certificat constitue le cadre de l’information, de sorte qu’aucune information contradictoire, dévalorisante ou de nature différente ne peut être fournie dans le cadre d’une référence.
Informations uniquement avec consentement
À la demande de l’employé, les anciens employeurs sont en principe tenus (en vertu du devoir de diligence post-contractuel) de fournir des informations. Sans le consentement de l’ancien employé, il convient de s’abstenir. C’est pourquoi, dans un cas concret, il faut toujours obtenir le consentement de la personne concernée avant de fournir des informations. Cela vaut également pour les futurs employeurs potentiels avec lesquels le candidat est en cours de recrutement: ils ne sont pas autorisés à contacter les anciens employeurs du candidat sans son accord. La personne peut révoquer son consentement à tout moment. L’expérience montre que, bien que cela soit interdit, il arrive parfois que les employeurs échangent des informations de manière informelle parce qu’ils se connaissent. Les commentaires positifs posent moins de problèmes, mais les commentaires négatifs peuvent empêcher une embauche. Cela est d’autant plus regrettable lorsque les informations sont incomplètes ou fondées sur un conflit personnel et ne sont donc pas objectives. En agissant ainsi, les employeurs s’exposent à un risque de responsabilité civile.

Bon nombre de maladies peuvent être traitées efficacement grâce aux médicaments, pour autant que la posologie soit respectée. Or, souvent, ce n’est pas le cas: une observance inadéquate ou sous-optimale du traitement est un phénomène courant, parfois lourd de conséquences. Les droguistes ont également un rôle à jouer, grâce à leurs conseils qui peuvent faire toute la différence.
7 Astrid Tomczak | F D Daphné Grekos
Qu’il s’agisse d’hypotenseurs, de sprays contre l’asthme ou de médicaments phytothérapeutiques, l’échec d’un traitement ne tient souvent pas à des raisons médicales, mais aux difficultés à mettre en œuvre les thérapies. En 2003 déjà, l’OMS mettait en garde: au niveau mondial, près de la moitié
des personnes atteintes de maladies chroniques ne prenaient pas leurs médicaments comme prescrit. Et cela n’a guère changé à ce jour, avec des conséquences radicales: hospitalisations, baisse de la qualité de vie et risques pour la santé, voire décès. Selon les estimations, la non-observance (appe-
lée aussi non-adhérence) entraîne jusqu’à 125 000 décès évitables par an aux ÉtatsUnis, avec des coûts annuels de plus de 500 milliards de dollars, et jusqu’à 200 000 décès évitables dans l’UE, pour des coûts annuels de 80 à 125 milliards d’euros. En Suisse, plus de deux millions de personnes vivent avec des maladies chroniques, et même en l’absence de chiffres précis, la non-observance entraîne une baisse de la qualité de vie et une charge pour le système de santé.
Participer plutôt qu’obéir aveuglément
Commençons par définir ce phénomène de la non-observance d’un traitement. Selina Barbati, pharmacienne et post-doctorante au sein du groupe de recherche Pharmaceutical Care de l’Université de Bâle, explique qu’autrefois, on parlait plutôt de compliance, de l’anglais «to comply», qui peut se traduire par «se conformer». Cela implique une relation hiérarchique entre le médecin et le patient, le second étant tenu d’obéir à ce que le premier lui dicte. «Aujourd’hui, le terme d’observance est privilégié, car il met l’accent sur le rôle actif des patients», poursuit Selina Barbati. Il ne s’agit donc pas seulement de suivre les instructions du médecin, mais de prendre des décisions ensemble et de transposer les schémas thérapeutiques dans la vie réelle. Elle distingue trois phases au niveau de ce processus: l’initiation, le début de la prise d’un médicament; vient ensuite l’implémentation, l’application correcte et régulière du traitement; et pour finir, la discontinuation, soit l’interruption des médicaments, parfois purement volontaire. Chacune de ces phases peut donner lieu à des écarts chez le patient, plus ou moins graves selon le médicament et la maladie.
L’emballage, un obstacle?
Pour lutter efficacement contre la non-observance, il est essentiel d’en rechercher les causes. «La non-observan-
ce peut être volontaire ou involontaire: la distinction est importante», souligne Kirstin Messner, doctorante et collègue de recherche de Selina Barbati. Ainsi, certaines personnes décident délibérément de ne pas suivre leur traitement, que ce soit par méfiance ou à cause des effets secondaires, par exemple. D’autres prennent leurs médicaments de manière incorrecte, mais inconsciemment: elles les oublient, ne comprennent pas les instructions ou font face à des problèmes très pratiques, comme des difficultés à avaler le comprimé ou à ouvrir l’emballage.
La non-observance est particulièrement fréquente en cas de maladie chronique asymptomatique telle que l’hypertension. En effet, ce genre de maladie ne se manifeste souvent pas immédiatement, mais entraîne des complications à long terme. «Si l’on n’a pas de symptômes, l’organisme ne

Le congrès de la droguerie aura lieu du 19 au 21 avril 2026 à l’ESD à Neuchâtel!
Plus d’informations suivront …
transmet pas de feed-back sur l’efficacité du médicament», explique Kirstin Messner. Contrairement aux maux de tête, où un comprimé peut apporter un soulagement immédiat. La polymédication, c’est-à-dire la prise simultanée de plusieurs médicaments, complique également l’observance du traitement.
Détecter la non-observance, c’est un exercice d’équilibrisme qui demande du tact. «Il ne s’agit pas d’accuser son interlocuteur de négligence ou de manquements délibérés», rappelle Selina Barbati. Des questions ciblées peuvent toutefois mettre la puce à l’oreille. Par exemple: «Sous quelle forme prenez-vous vos médicaments?» Les personnes qui ont du mal à avaler des comprimés pourront ainsi éventuellement opter pour des gouttes. Il existe en outre des questionnaires validés scientifiquement et destinés aux professionnels. Un entretien dit «motivationnel» peut s’avérer utile: il s’agit d’un style de conversation collaboratif qui vise à remettre en question les doutes et les croyances, tout en renforçant la motivation. Il ne faut pas non plus sous-estimer l’influence des proches, qu’il s’agisse de la famille ou des connaissances. «Si un membre de la famille du patient lui dit qu’il n’a pas besoin du médicament, la situation peut se compliquer», indique Kirstin Messner. À l’inverse, le patient peut se sentir soutenu s’il a des proches bien informés ou compréhensifs. Les professionnels devraient essayer d’inclure l’entourage dans le processus, si cela est possible et utile.
Que peuvent faire les drogueries?
La droguerie joue un rôle clé en matière de conseils de santé simples d’accès. Souvent, les obstacles du quotidien peuvent être décelés lors d’une conversation: l’heure du lever qui ne coïncide pas avec l’heure de la prise du médicament, les
effets secondaires désagréables ou, tout simplement, les oublis. «L’important, c’est de trouver des solutions individuelles», explique Selina Barbati. On peut associer la prise de médicaments à des routines quotidiennes, comme le brossage des dents, mais aussi recourir aux piluliers ou à des post-it. Les applications sur smartphone peuvent également aider les personnes à l’aise avec la technologie, en leur rappelant de prendre leur médicament grâce à une notification ou en fournissant des informations sur le traitement. L’important, c’est de trouver la solution adaptée à chaque cliente ou client.
L’observance n’est pas un état figé, mais un processus
L’une des plus grandes difficultés, c’est la constance. «Souvent, le comportement commence par s’améliorer, puis la personne retombe dans ses vieux travers», constate Selina Barbati. Il faut donc miser sur des stratégies à long terme: un suivi régulier, un dialogue sur un pied d’égalité et une écoute attentive des difficultés individuelles. Cela vaut également pour les médicaments phytothérapeutiques ou les compléments alimentaires disponibles en droguerie. «L’observance implique de trouver ensemble des solutions adaptées à la situation personnelle», conclut la chercheuse. Un bon conseil, c’est la clé de l’efficacité d’un traitement; et une personne qui se sent comprise sera plus motivée pour persévérer. Il suffit de lui poser les bonnes questions... Car au fond, une chose reste certaine: un médicament qu’on ne prend pas ne peut pas agir.
è Vous trouverez la bibliographie complète ici

Construis avec nous l’avenir de la branche de la droguerie – deviens membre de l’Association suisse des droguistes!
Tu es droguiste ES ou droguiste dipl. féd. et tu aimerais soutenir la branche de la droguerie et participer à son développement? En tant que personne membre de l’Association suisse des droguistes, tu reçois régulièrement des informations sur l’évolution et les tendances de la branche et tu peux en plus profiter d’autres prestations attrayantes.
Plus d’informations et inscription:

Association suisse des droguistes, Rue Thomas-Wyttenbach 2, 2502 Biel/Bienne

Les conjonctivites font partie des maladies oculaires les plus courantes. Quelles sont les différentes formes et quels sont les symptômes qui nécessitent une consultation médicale?
7 Céline Jenni | F D Marie-Noëlle Hofmann stock.adobe.com/New Africa
Les yeux rouges sont généralement les premiers signes d’une conjonctivite. Cette affection oculaire courante peut être causée par des virus ou des bactéries, ou avoir des origines non infectieuses. En fonction de la cause, la conjonctivite peut être contagieuse ou non. Selon l’hôpital universitaire de Zurich, plus de 100 000 personnes souffrent chaque année de conjonctivite en Suisse. Les enfants sont particulièrement exposés, car leur système immunitaire n’est pas encore complètement développé.¹
La conjonctive est une fine couche muqueuse transparente, normalement brillante. La conjonctive se compose de la conjonctive bulbaire (Conjunctiva bulbi), de la conjonctive des plis de transition (Conjunctiva fornicis) et de la conjonctive palpébrale (Conjunctiva tarsi) (voir illustration ci-contre). Elle forme le sac conjonctival avec la surface de la cornée.³ Le sac conjonctival a les fonctions principales suivantes:1,2

Les larmes artificielles soulagent souvent les symptômes de la conjonctivite.
• Il permet la libre mobilité du globe oculaire dans toutes les directions du regard.
• La surface conjonctivale permet un glissement sans frottement des couches muqueuses. Le film lacrymal sert de lubrifiant.
• La conjonctive joue un rôle important dans la défense contre les agents pathogènes.
En principe, en cas de conjonctivite, au moins un œil est rouge et les paupières sont collées le matin. Il est possible de déterminer le type de conjonctivite en fonction de la combinaison et de la gravité des symptômes (voir tableau à la page 28). Une augmentation de l’irrigation sanguine et l’apparition des vaisseaux sanguins de la conjonctive entraînent une coloration rouge de l’œil.¹
Dans le cas de la conjonctivite infectieuse, l’inflammation est causée par une nouvelle infection due à un contact direct avec des germes pathogènes, par exemple par les doigts, les linges ou à la piscine. Une conjonctivite infectieuse peut être provoquée par des bactéries ou des virus. Les champignons sont rarement à l’origine d’une conjonctivite (mycosique). Les parasites peuvent également provoquer une conjonctivite, mais cela est plus fréquent sous les tropiques et très rare sous nos latitudes. Une nouvelle infection est favorisée par un affaiblissement du système immunitaire.² Si les personnes concernées se frottent les yeux qui démangent et brûlent, elles peuvent répandre des agents pathogènes sur leurs mains, puis sur divers objets. D’autres personnes peuvent alors être infectées. La conjonctivite virale est particulièrement contagieuse.1,2
Outre les bactéries et les virus, la conjonctivite peut également avoir d’autres causes. Il s’agit notamment des irritations mécaniques ou physico-chimiques (fumée, poussière, froid, chaleur, vent, rayons UV, etc.), du manque de larmes, de verres de lunettes mal centrés, du surmenage ou du manque de sommeil, ou encore des interactions entre des médicaments. Cette conjonctivite banale est également appelée conjonc-
tivite simple. Dans le cas de la conjonctivite allergique, une réaction d’hypersensibilité à certains antigènes, tels que le pollen, les acariens ou les poils d’animaux, entraîne une conjonctivite.² La conjonctivite allergique se caractérise par le fait que les deux yeux sont presque toujours touchés et qu’ils démangent fortement en plus d’être rouges. De plus, les symptômes ne se limitent pas aux yeux, mais s’accompagnent d’éternuements et de sécrétions nasales.⁴
Les mesures suivantes peuvent aider à soulager les irritations: compresses rafraîchissantes pour les yeux, éviter le facteur irritant (s’il est connu), dormir suffisamment pour permettre aux yeux de se régénérer et éviter les courants d’air, la poussière, les rayons UV et les longues heures passées devant un écran. Les larmes artificielles sont toujours recommandées, de préférence sous forme de préparations sans conservateurs en doses uniques. Les produits à base de dexpanthénol aident également à lutter contre les inflammations et les démangeaisons. L’utilisation pour une courte période de collyres astringents (tétryzoline, naphazoline) pour décongestionner les yeux ou d’antihistaminiques (en cas de conjonctivite allergique) est recommandée. Les préparations à base d’euphraise (Euphrasia) peuvent être utilisées en complément. 2–4 Chez les personnes âgées, l’irritation de la conjonctive est souvent due à la sécheresse oculaire, car la production de larmes diminue avec l’âge. Mais les effets secondaires de certains médicaments peuvent également entraîner une diminution du flux lacrymal, ce qui peut favoriser la conjonctivite. Il s’agit notamment de diurétiques, de sympathomimétiques α2 , (clonidine, moxonidine), de statines, de certains antidépresseurs tricycliques ou d’anticholinergiques. En méde-
= conjonctive bulbaire
= conjonctive des plis de transition
= conjonctive palpébrale
= surface de la cornée (fait aussi fonctionnellement partie du sac conjonctival)

è Vous trouverez la bibliographie complète ici
cine, on parle de kératoconjonctivite sèche pour désigner une conjonctivite due à un manque de liquide lacrymal.1–3
Pour toute automédication, il convient d’informer la personne concernée qu’une amélioration doit être constatée dans un délai d’un jour et, au plus tard, dans un délai de trois jours. Dans le cas contraire, il faut consulter un ophtalmologue.³ Les maladies oculaires graves peuvent également débuter par une conjonctivite. Dans les situations suivantes, les personnes concernées doivent toujours être orientées vers un spécialiste: en cas de blessures et de douleurs oculaires, de vision réduite, de rougeur extrême de l’œil ou lorsque des nourrissons ou des enfants en bas âge souffrent d’une conjonctivite.1,3 En cas de suspicion de conjonctivite bactérienne, il est important de consulter un médecin afin de la traiter avec des antibiotiques. Au début, la conjonctivite bactérienne ne touche généralement qu’un seul œil, les sécrétions sont plutôt purulentes et les personnes concernées se plaignent souvent d’une sensation de corps étranger.1–3
La conjonctivite virale doit faire l’objet d’un examen médical. Il est impératif de consulter immédiatement un médecin en cas de suspicion de surinfection bactérienne ou si l’épithélium cornéen est également touché, généralement accompagné d’une fermeture spasmodique des paupières.1–3 Il n’existe toutefois pas de traitement spécifique contre la conjonctivite virale, sauf pour quelques types de virus tels que les virus d’herpès. Des traitements à base de collyres ou de pommades antivirales sont alors disponibles. La plupart du temps, les conjonctivites virales guérissent d’ellesmêmes au bout d’environ deux semaines. Les symptômes peuvent être soulagés à l’aide de larmes artificielles hydratantes et de compresses rafraîchissantes.¹
En cas de conjonctivite infectieuse, l’hygiène est primordiale. La personne concernée doit éviter autant que possible de se frotter les yeux, même si cela démange, et éviter tout contact direct avec d’autres personnes, par exemple en évitant de serrer la main. Il convient de se laver et de se désinfecter les mains fréquemment et de ne partager en aucun cas les linges/gants de toilette. Les porteurs de lentilles de contact doivent renoncer à les porter jusqu’à ce que l’irritation oculaire ait disparu.1–3
Symptômes des différentes formes de conjonctivite3 non infectieuse infectieuse conjonctivite allergique (rhinoconjonctivite) conjonctivite bactérienne conjonctivite virale
causes réaction d’hypersensibilité à certains antigènes tels que le pollen; souvent associée à une rhinite
infections à staphylocoques, streptocoques ou pneumocoques; chlamydias
infections par des adénovirus ou des virus d’herpès
sécrétions blanches, filantes, visqueuses purulentes, croûtes jaunâtres aqueuses symptômes démangeaisons prononcées rares parfois rougeur oculaire modérée prononcée modérée saignement rare modéré modéré gonflement de la conjonctive prononcé prononcé parfois yeux qui coulent modérés modérés prononcés gonflement des ganglions lymphatiques rare modéré prononcé fièvre pare parfois parfois

Lors d’une crise de goutte, les articulations sont gravement enflammées en raison de dépôts de cristaux d’acide urique. L’alimentation et le mode de vie jouent un rôle déterminant dans la prévention des crises de goutte.
7 Jasmin Weiss | F D Daphné Grekos
La goutte est l’une des plus anciennes maladies répertoriées. Autrefois, elle touchait surtout les plus riches qui pouvaient se permettre de consommer de la viande et de l’alcool en abondance.1,2 En raison de l’évolution de notre mode de vie, elle est devenue une maladie courante dont la prévalence ne cesse de croître.1 Par exemple, les barbecues estivaux riches en viande et en bière peuvent être un facteur déclencheur potentiel des crises de goutte.
La goutte est un trouble du métabolisme qui fait partie des maladies rhumatismales et qui se manifeste lorsque l’acide urique s’accumule en trop grande quantité dans le sang. Il ne faut pas confondre la goutte proprement dite avec l’hyperuricémie, qui se produit en cas de concentration trop élevée d’acide urique dans le sang, soit des valeurs supérieures à 400–420 μmol/l, sachant que les chiffres varient selon les sources. 2,3 L’acide urique est le produit de la dégradation des purines, qui sont des composants cellulaires essentiels de l’ADN et d’autres nucléotides (comme l’ATP).1,4 Leur apport passe par les aliments, mais elles se forment également lors de la dégradation des cellules de l’organisme.¹ Chaque jour, environ 800 mg d’acide urique sont éliminés principalement par les reins,1,4 dont 500 mg proviennent des purines apportées par l’alimentation et 300 mg résultent de la dégradation des cellules de l’organisme.⁴ L’hyperuricémie survient lorsque l’acide urique est produit en trop grande quantité ou qu’il n’est pas éliminé en quantité suffisante.1 Des taux d’acide urique trop élevés dans le sang sont fréquents et concernent environ 20 % de la population adulte.¹ La goutte ne se déclare toutefois pas dans tous les cas: sur ce pourcentage, seules 2 à 4 % des personnes vont effectivement développer la maladie.¹ Plus la concentration d’acide urique dans
le sang est élevée, plus le risque de goutte est important,¹ les facteurs de risque de la goutte étant liés au facteur génétique, à l’âge et au sexe.¹ Les femmes ont des taux d’acide urique plus bas jusqu’à la ménopause, en raison de l’influence des œstrogènes sur l’élimination de cet acide.¹ Selon leur principe actif, les médicaments peuvent aussi augmenter ou diminuer le taux d’acide urique à titre d’effet secondaire.¹ Comme pour de nombreuses maladies métaboliques, le mode de vie a également une influence. Le surpoids et l’obésité augmentent le risque de goutte dès que l’indice de masse corporelle (IMC) dépasse 25. L’alimentation peut également avoir un impact.¹
Cristaux d’acide urique au niveau des articulations
La goutte est une affection métabolique qui se développe à la suite d’une hyperuricémie.1,3 Lorsque la concentration d’acide urique est trop élevée, des cristaux d’acide urique se forment et s’accumulent principalement dans et autour des articulations, mais aussi dans d’autres tissus et organes.1,3 La formation de cristaux d’acide urique est favorisée par un pH faible dans les tissus ou par des surfaces cartilagineuses rugueuses dues à l’arthrose.³ Le système immunitaire réagit ensuite par une inflammation.¹ Une crise de goutte se manifeste par une inflammation articulaire aiguë; l’articulation touchée rougit, enfle et devient douloureuse.³ C’est l’articulation à la base du gros orteil qui est le plus fréquemment touchée, ainsi que, même si moins souvent, les articulations de la cheville et du genou.³
Une crise de goutte aiguë dure entre trois et quatorze jours sans traitement.³ Les crises de goutte répétées augmentent le risque de formation de dépôts de cristaux d’acide urique, appelés tophi.³ Les tophi peuvent notamment être observés aux genoux, aux coudes ou au pavillon de l’oreille. Ces dépôts nodulaires, jaunâtres à blancs, sont parfois visibles sous la peau.³ Sur la durée, ils endommagent les articulations et peuvent entraîner des pertes de fonction.³ Si la goutte n’est pas traitée de manière adéquate sur le long terme, des calculs rénaux à base d’acide
urique peuvent se former.¹ Il existe différents types de calculs rénaux, les plus fréquents étant les calculs de calcium, tandis que les calculs d’acide urique représentent environ 10 à 15 % des cas.5 Les risques potentiels de l’hyperuricémie et de la goutte comprennent des maladies ou des lésions rénales, un risque cardiovasculaire accru et une augmentation du risque de mortalité. 2,3 Les personnes atteintes de goutte souffrent plus souvent d’autres maladies qui touchent le cœur, les reins ou le métabolisme.2,3 La prévalence de l’hypertension, du diabète sucré et des dyslipidémies est également plus élevée chez ces personnes.1,3
En cas de crise de goutte aiguë, on utilise notamment, selon la situation médicale individuelle, des anti-inflammatoires non stéroïdiens (parfois sur ordonnance, selon le dosage), de la colchicine (liste A) et des glucocorticoïdes (sur ordonnance).³ Le traitement peut raccourcir la durée de la crise de goutte et réduire le risque de lésions tissulaires causées par l’inflammation.³ Pour prévenir durablement les crises de goutte, il est important de faire baisser le taux d’acide urique. Pour ce faire, il existe des médicaments sur ordonnance qui inhibent la production d’acide urique ou en augmentent l’élimination.³ Une modification du mode de vie est également nécessaire.³ La prise de médicaments susceptibles d’augmenter le taux d’acide urique, comme l’acide acétylsalicylique ou les diurétiques, devrait être évitée.³
En automédication, les compresses peuvent apporter un certain soulagement: les compresses froides, par exemple à base de séré ou d’argile médicinale, ont l’avantage d’atténuer les symptômes en cas de crise aiguë de goutte,6 mais elles peuvent aussi stimuler la formation de cristaux d’acide urique.6 En cas de goutte chronique, les compresses chaudes ou un bain de pieds chaud peuvent aider à dissoudre les cristaux d’acide urique, mais risquent malheureusement aussi de favoriser une réaction inflammatoire.6 Chaque personne doit tester et trouver elle-même ce qui atténue le mieux ses symptômes.6 La phytothérapie
permet aussi de compléter le traitement de la goutte, notamment via des tisanes à base de plantes médicinales aux propriétés anti-inflammatoires, dépuratives ou diurétiques, comme l’ortie, l’angélique, la prêle des champs, la camomille, la verge d’or, l’achillée millefeuille ou la réglisse.6
Éviter les aliments riches en purines
Comme le surpoids peut avoir des effets néfastes sur la santé et augmenter le risque de goutte, une perte de poids devrait être envisagée,² mais de manière progressive, car une perte rapide peut aussi déclencher des crises de goutte. 2,4 Les données sur l’alimentation en cas de goutte proviennent principalement d’études observant un lien entre l’alimentation et la goutte, mais il existe peu d’essais cliniques en la matière.¹ Au niveau de l’alimentation, il est important de limiter les aliments riches en purines, mais il faut aussi tenir compte des aliments susceptibles d’augmenter ou de diminuer le taux d’acide urique dans l’organisme, par exemple en influençant son élimination. Une adaptation alimentaire sur le long terme peut permettre de réduire les taux d’acide urique d’environ 10 à 15 %.² À noter que la consommation simultanée de nombreux aliments riches en purines, par exemple de grandes quantités de viande, d’abats et de bière, présente un risque de crise de goutte, même sous traitement médicamenteux.²
à d’autres boissons alcoolisées, c’est la bière, même sans alcool, qui augmente le plus le risque de goutte.¹ Aucun risque accru n’a pu être démontré en cas de consommation modérée de vin,¹ mais on estime que l’alcool réduit l’élimination de l’acide urique.¹ Ainsi, la viande, le poisson, les fruits de mer et l’alcool peuvent augmenter le risque de goutte.¹ Des études montrent que les personnes végétariennes présentent des taux d’acide urique plus bas.²
Les protéines végétales et les légumes riches en purines n’augmentent pas le risque de goutte.¹ Les sources de protéines végétales, comme le soja, peuvent même faire baisser les taux d’acide urique.² La consommation de lait et de produits laitiers est associée à un risque plus faible de goutte, car ils sont naturellement pauvres en purines et stimulent en outre l’élimination de l’acide urique par les reins.¹ D’après les observations, la consommation de café et de cerises a été associée à une diminution du taux d’acide urique.1,2
Le fructose, quant à lui, peut augmenter le taux d’acide urique et donc le risque de goutte.¹ Les jus de fruits, les sodas et les aliments sucrés au fructose doivent être évités, car la dégradation du fructose dans l’organisme produit de l’acide urique comme sous-produit.¹
Faible teneur en purines dans
Les purines sont présentes dans presque tous les aliments.² Certains en contiennent en grande quantité, notamment la viande rouge (surtout la peau et les abats), les poissons (surtout les anchois et les harengs), les fruits de mer ainsi que la bière. 2,4 Comparée
Les recommandations alimentaires en cas d’hyperuricémie et de goutte vont dans le sens du régime dit méditerranéen, sain et équilibré,¹ qui a une influence positive sur différents facteurs liés à la santé, contrairement au régime occidental.¹ Il ne s’agit pas d’interdire certains aliments, mais d’optimiser l’alimentation et d’adopter un mode de vie plus sain.¹ Il est en principe impossible de traiter la goutte uniquement par l’alimentation.¹
Qu’entend-on par maladies rhumatismales?
è Vous trouverez la bibliographie complète ici
Les maladies rhumatismales regroupent différentes maladies de l’appareil locomoteur, touchant par exemple les os, les articulations ou les muscles.7 Il existe plus de 200 maladies différentes connues, dont l’ostéoporose, l’arthrite et la fibromyalgie.7 Certaines d’entre elles sont dues à des réactions auto-immunes.7 La goutte est la maladie rhumatismale inflammatoire la plus répandue.1

Un
look au poil!
Entre le shampoing à barbe, le pré-rasage ou la pierre d’alun, le commerce propose une multitude de produits différents dédiés aux soins quotidiens de la barbe et au rasage. Quels conseils les droguistes peuvent-ils donner à leur clientèle masculine? Les explications d’un barbier.
7 Barbara Halter | F D Daphné Grekos
Le matin, à dix heures, l’effervescence règne au Rennweg, à Zurich, chez The Barber Paradox. C’est un va-et-vient incessant d’hommes bien habillés, dont beaucoup tout droit venus de la Bahnhofstrasse toute proche. La plupart des clients passent toutes les trois ou quatre semaines pour
redonner forme à leur barbe. «Actuellement, la mode est à la barbe complète propre, courte et classique; la tendance des barbes longues est un peu passée, on n’en voit plus que de manière ponctuelle. Quant à la moustache, elle est toujours aussi appréciée», résume Bilâl Oezcelebi, barbier

Les blaireaux permettent de créer une mousse crémeuse lors du rasage.
chez The Barber Paradox depuis neuf ans. Le magasin a ouvert il y a dix ans, parmi les premiers du genre à Zurich.
Bilâl Oezcelebi porte lui-même une épaisse barbe noire, dont il prend soin dans le cadre de sa toilette quotidienne. «Le plus simple, c’est de laver la barbe directement sous la douche avec un nettoyant pour visage. L’important, c’est que le pH du produit soit adapté au type de peau», explique-t-il. Les shampoings à barbe spéciaux pour hommes conviennent également. «Il est utile de bien nettoyer la barbe, car des restes de nourriture ou de boisson peuvent facilement s’y coincer; sans compter que les hommes touchent souvent leur barbe, ce qui en fait un nid à bactéries.» Pour les barbes plus courtes, les pellicules peuvent être éliminées à l’aide d’une brosse spéciale. Pour les barbes plus longues, il est recommandé de procéder à un gommage.
Après sa douche, Bilâl Oezcelebi utilise une huile ou un baume à barbe pour hydrater la peau et éviter les tiraillements dus à la sécheresse. Il privilégie les produits de qualité, comme l’huile de noyau de pêche ou l’huile d’argan. Il recommande à ses clients d’étaler l’huile sur leur barbe et leur visage encore humides pour faciliter la pénétration dans la peau. Deux à trois gouttes maximum suffisent. Outre les soins qu’elle apporte, une huile à barbe fait également briller les poils.
Prochain arrêt: études ES
Lance-toi dans des études ES à l’ESD à Neuchâtel. Participe à la journée
d’information du 12 novembre 2025 à 14h
Avant de raser un client, Bilâl Oezcelebi commence par appliquer un produit de pré-rasage, puis place des linges chauds et humides sur le visage. «Cela permet de dilater les pores, d’assouplir la peau et de ramollir les poils de la barbe.» Pour un rasage complet, il utilise un savon spécifique. «Mais la plupart du temps, je préfère recourir à un gel transparent pour bien distinguer les contours de la barbe et pouvoir travailler avec précision.» Il recommande également ce genre de produit transparent pour chez soi, où il est généralement encore plus difficile de bien visualiser les contours dans le miroir de la salle de bain.
La préparation de la peau est également de mise. «Si l’on se contente d’appliquer la mousse à raser sur son visage, il faut s’attendre à des irritations de la peau.» À la maison, au lieu d’appliquer des linges humides, il suffit de prendre une douche. Bilâl Oezcelebi recommande aux hommes à la peau sensible de ne procéder à un rasage sur peau mouillée que tous les deux ou trois jours et de privilégier le rasage à sec entre deux. Cela permet de minimiser le risque de «feu du rasoir», ces rougeurs dues à de légères blessures et irritations de la surface cutanée, qui se manifestent par des démangeaisons, des brûlures ou de petits boutons. Pour finaliser le processus, le professionnel pose des linges frais sur la peau et applique ensuite un baume ou un après-rasage. Ce

Association suisse des droguistes
Rue Thomas-Wyttenbach 2 2502 Biel/Bienne 032 328 50 30 bildung@drogistenverband.ch droguerie.ch
dernier contient de l’alcool et incarne la variante classique pour rafraîchir et désinfecter la peau après le rasage. Un baume pour la peau ne contient quant à lui que peu ou pas d’alcool et convient donc aux peaux sensibles.
Bilâl Oezcelebi a également une astuce pour les petites coupures qui surviennent de temps à autre lors du rasage, par exemple lorsqu’un bouton est touché sur une peau impure: la pierre d’alun est un moyen ancien mais toujours très efficace pour stopper rapidement les petites hémorragies. Composée d’alun, un sel d’aluminium, elle s’applique directement sur la coupure. «Elle aide aussi à apaiser le feu du rasoir: il suffit de passer le stick sur les zones concernées.»

Pour mettre en forme les poils de la barbe, les droguistes peuvent recommander aux barbus la cire à barbe. Elle est souvent composée d’ingrédients naturels, comme
Bilâl Oezcelebi
la cire d’abeille, et peut également être utilisée par les adeptes de la moustache; mais si la moustache doit être twistée ou si une forte tenue est nécessaire, il faut recourir à une cire spéciale pour moustache. Un mot encore sur les blaireaux de rasage, utilisés pour produire une mousse à partir du savon de rasage. Le blaireau permet d’appliquer la mousse sur la peau humidifiée en effectuant des mouvements circulaires. Chez The Barber Paradox, on utilise des articles en poils naturels de blaireaux. «On trouve aussi des poils synthétiques de bonne qualité; la sensation de douceur sur la peau est simplement moins marquée en général.» Pour que le blaireau dure le plus longtemps possible et reste propre, un nettoyage à l’eau suffit, mais il faut ensuite absolument le suspendre pour que l’air circule et que les poils puissent sécher jusqu’à la prochaine utilisation.
a suivi une formation commerciale, avant de fréquenter une école de barbiers à Londres. Il travaille depuis neuf ans chez The Barber Paradox, qu’il dirige aussi depuis quatre ans.
Poils incarnés: pourquoi? Comment agir?
Une fois rasés, les poils sont plus rêches, acérés et peuvent transpercer la peau dans le sens inverse dès que la barbe repousse. Trois facteurs sont déterminants: le type de poils, le type de peau et la manière dont le rasage est effectué. Les hommes dont la barbe est frisée sont particulièrement sujets aux poils incarnés, car leurs poils se recourbent facilement. Une peau impure favorise aussi les poils incarnés. Bilâl Oezcelebi conseille donc de prévenir en prenant bien soin de sa peau. Il faut surtout toujours préparer la peau du visage avant le rasage et aussi veiller à se raser dans le sens de la pousse des poils, avec une lame bien affûtée. Et une fois que le mal est fait, il faut réagir rapidement, c’est-à-dire dès que le poil apparaît sous la surface de la peau. Ensuite, à l’aide d’une pince à épiler désinfectée, il convient de percer très légèrement la peau pour que le poil puisse continuer à pousser normalement.

C'est aussi simple que rapide