Livre de l’enseignant(e)
6 A
Livre de l’enseignant(e)
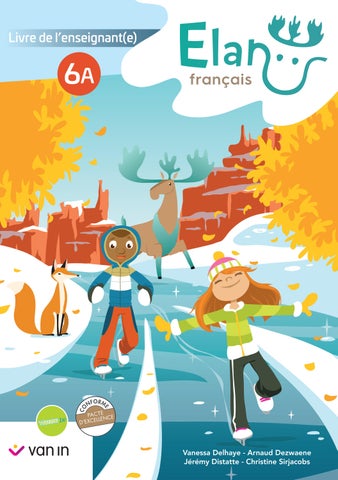
6 A
Livre de l’enseignant(e)
Vanessa Delhaye - Arnaud Dezwaene
Jérémy Distatte - Christine Sirjacobs
Pour l’élève : 2 livres-cahiers A et B
Pour l’enseignant : 2 livres de l’enseignant (comprenant le corrigé)
Des documents téléchargeables disponibles sur www.wazzou.be
Les manuels numériques (A et B) disponibles sur www.wazzou.be
Auteurs : Vanessa Delhaye
Arnaud Dezwaene
Jérémy Distatte
Christine Sirjacobs
Illustrations : K’ Naye – Karine Nayé-Roy
Conception, couverture et mise en page : Kiv’Là! – Softwin
Voici le code qui vous donnera accès aux documents reproductibles en ligne liés au présent ouvrage.
Pour activer ce matériel complémentaire, rendez-vous sur www.monactivation.be et suivez-y la procédure d’inscription.
•Une fois votre accès activé, vous pourrez consulter le matériel complémentaire aussi souvent que vous le désirez et aussi longtemps que la version imprimée du présent ouvrage ne sera pas remplacée par une nouvelle édition.
• L’accès au matériel complémentaire ne peut être utilisé que par une seule personne.
• L’accès au matériel complémentaire vous est fourni gratuitement à l’achat de l’ouvrage Élan 6A – Livre de l’enseignant(e). Aucune indemnité ne sera exigible en cas de non-fonctionnement ou d’indisponibilité du site hébergeant le matériel complémentaire ou du matériel complémentaire en lui-même, pour quelque raison que ce soit.
• En cas de non-fonctionnement et/ou de question, nous sommes à votre disposition par courriel à l’adresse support@vanin.be.
L’éditeur s’est efforcé d’identifier tous les détenteurs de droits. Si malgré cela quelqu’un estime entrer en ligne de compte en tant qu’ayant droit, il est invité à s’adresser à l’éditeur. L’orthographe telle que rectifiée le 6 décembre 1990 par le Conseil Supérieur de la langue française est d’application dans la collection. Toutefois, afin de respecter les écrits des auteurs, l’orthographe d’origine y est respectée.
Les photocopieuses sont d’un usage très répandu et beaucoup y recourent de façon constante et machinale. Mais la production de livres ne se réalise pas aussi facilement qu’une simple photocopie. Elle demande bien plus d’énergie, de temps et d’argent. La rémunération des auteurs, et de toutes les personnes impliquées dans le processus de création et de distribution des livres, provient exclusivement de la vente de ces ouvrages. En Belgique, la loi sur le droit d’auteur protège l’activité de ces différentes personnes. Lorsqu’il copie des livres, en entier ou en partie, en dehors des exceptions définies par la loi, l’usager prive ces différentes personnes d’une part de la rémunération qui leur est due. C’est pourquoi les auteurs et les éditeurs demandent qu’aucun texte protégé ne soit copié sans une autorisation écrite préalable, en dehors des exceptions définies par la loi.
Tous droits réservés. En dehors des exceptions définies par la loi, cet ouvrage ne peut être reproduit, enregistré dans un fichier informatisé ou rendu public, même partiellement, par quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation écrite de l’éditeur.
1re édition 2025
© Éditions VAN IN, Mont-Saint-Guibert – Wommelgem, 2025
ISBN 978-94-651-4020-9
D/2025/0078/69
Art. 609003/01
« Prenez votre Élan ! »
Le jeu de mot est « un peu facile », mais il prend ici tout son sens. En effet, grâce à cette nouvelle méthode, nous souhaitons insuffler une dynamique à l’élève : qu’il s’élance en confiance sur le chemin de l’apprentissage !
Mais l’élan, c’est aussi – et surtout – cet animal majestueux et fort, dont les bois ont pour nous une signification toute particulière…
Avez-vous remarqué que notre élan a trois bois ?
Chacun de ces bois représente dans notre méthode un des chemins que nous proposons à l’élève. En effet, notre ambition, pour que chaque élève puisse construire du sens en tant que récepteur d’un message écrit, est de proposer différents chemins adaptés pour y parvenir, dans une logique élémentaire de différenciation pédagogique. Découvrons ensemble de quoi il s’agit…
Lire, c’est construire du sens en tant que récepteur du message écrit.
Au départ d’évaluations diagnostiques (téléchargeables grâce au code présent dans le guide), l’enseignant(e) peut, à différents moments de l’année scolaire, répartir ses élèves en différents groupes de besoin. En fonction de son groupe, chaque élève reçoit un texte de même sens − porte d’entrée de chaque chapitre − mais aux difficultés adaptées à ses compétences propres.
Ainsi, parmi les trois ou quatre textes proposés, les paramètres suivants varient : la longueur des phrases, du texte ; la construction syntaxique des phrases ; le niveau de vocabulaire ; la présence ou non d’indices externes (illustrations, extraits sonores...) ; la police (type de police, taille, interligne…).
Écrire, c’est produire du sens en tant qu’émetteur d’un message.
Chaque chapitre se termine par une mission d’écriture, permettant à l’élève lecteur de devenir un élève producteur de textes. Cette étape essentielle est favorisée en amont par le travail, en contexte, des outils de langue nécessaires à la production d’écrit.
Et sur le chemin lui-même, que fait-on ?
Même si chaque élève a reçu un texte adapté à ses besoins en début de chapitre, les exercices et les apprentissages sont identiques pour tous les élèves.
La structure des chapitres est également commune et s’articule autour des points suivants :
Je découvre le texte
Je comprends le texte (notamment au moyen de stratégies de lecture)
Je découvre le genre du texte étudié et sa superstructure
Mes missions : La tâche finale que l’élève aura à produire au terme de la séquence y est détaillée.
Mes outils (de langue) : L’orthographe, la grammaire, la conjugaison et le vocabulaire y sont envisagés dans une progression chronologique cohérente mais aussi et surtout travaillés de façon signifiante et contextualisée. En effet, les outils au service de la langue abordés seront
ceux qui permettront à l’élève de produire l’écrit final.
Ma production
Mon évaluation : L’élève y a l’occasion de s’auto-évaluer avant l’évaluation de l’enseignant(e).
Le « savoir parler » et le « savoir écouter » ne sont pas en reste et sont travaillés régulièrement dans chaque chapitre à différents endroits de la structure proposée ci-dessus, complétant notre volonté d’aborder en profondeur l’ensemble des compétences de français. Ainsi par exemple, chaque chapitre débute par une proposition d’audio et de vidéo qui contextualise le thème abordé. Ces entrées sont disponibles via les QR codes de la page de garde.
Pourquoi des groupes de besoin ?
Lors de l’apprentissage de la lecture, le travail des compétences qui l’accompagnent s’arrête souvent après la 2e primaire.
Dès la 3e, le plus souvent, les élèves se retrouvent devant un texte avec la consigne de le lire et de répondre à une série de questions s’y rapportant. En faisant cela, on émet le postulat que chaque élève, à partir de la 3e primaire, possède toutes les habiletés de la lecture.
Pourtant, nous savons qu’aujourd’hui, nombreux sont ceux qui ne maitrisent pas encore la lecture. Lire un texte demande d’apprendre des stratégies, et celles-ci sont trop souvent négligées. Dans Élan, nous avons décidé d’intégrer l’apprentissage de ces stratégies dans le livre-cahier.
Bien sûr, plus un élève lit, meilleure sera sa lecture. Mais cela ne suffit pas. Pour comprendre un texte, l’élève doit apprendre à lire les syllabes, les mots, les groupes de mots par unité de sens, et même par groupes de mots non pertinents. Il faut également tenir compte de la fluidité de la lecture, du respect de la ponctuation, de la vitesse de lecture, de l’intonation, de la compréhension du vocabulaire… Tout ceci contribue à la compréhension du texte et est évalué, dans Élan, grâce aux évaluations diagnostiques.
Trois évaluations diagnostiques sont proposées. L’objectif est de mesurer la maitrise des différents points utiles et indispensables à l’apprentissage de la lecture et surtout à sa compréhension :
• la vitesse de lecture ;
• la fluidité de lecture ;
• la mémoire de travail ;
• la motivation de lecture.
Grâce à ces évaluations diagnostiques, l’enseignant(e) pourra créer des groupes de besoin au sein de sa classe en choisissant parmi les différentes versions de textes d’entrée celui qui est le plus adapté à chaque élève. Nous le rappelons : quel que soit le texte travaillé, la totalité du cahier pourra de toute façon être réalisée par chaque enfant.
Le groupe de besoin a pour but de mettre chaque enfant en situation de réussite par rapport au texte d’entrée de la séquence et par conséquent dans toutes les activités de la séquence. La production finale pourra, elle aussi, être modulée en fonction du groupe de besoin.
Nous insistons sur le fait qu’il s’agit d’une évaluation individuelle, qui doit idéalement se dérouler au côté de l’enseignant(e).
Par ailleurs, tout au long de l’année, des exercices de lecture en téléchargement vont permettre aux élèves d’exercer leur fluidité de lecture, leur vitesse, leur mémoire de travail. Ces exercices peuvent être proposés aux élèves au travers d’ateliers en classe ou de travail individuel à domicile.
Concrètement, comment créer les différents groupes de besoin en début d’année ?
Nous proposons que les groupes de besoin soient construits autour de l’apprentissage de la lecture. Ces groupes de besoin peuvent donc varier régulièrement tout au long de l’année et même à chaque nouvelle séquence. Pour aider l’enseignant(e) à construire ses premiers groupes de besoin, nous proposons de faire passer à chaque enfant l’évaluation diagnostique en lecture n° 1 en début d’année (septembre).
Pour autant, l’enseignant(e) peut aussi décider que sa classe est assez homogène pour ne créer qu’un seul groupe de besoin. Tous les élèves recevront alors le même texte de départ.
Par contre, pour une gestion optimale du groupe-classe, nous vous conseillons de faire maximum 3 groupes de besoin.
Il se pourrait tout à fait bien que vous n’ayez pas besoin d’évaluer vos élèves pour créer vos groupes de besoin, votre connaissance du groupe-classe étant toujours prédominante sur l’évaluation.
Et en cours d’année ? Comment faire évoluer les groupes de besoin ?
Les évaluations diagnostiques 2 et 3 permettent à l’enseignant(e) de mesurer la progression de chaque élève. Dès lors, elles se feront au cours de l’année à l’appréciation de l’enseignant(e) et ne doivent par ailleurs pas forcément avoir lieu au même moment pour tous les élèves, chaque élève progressant à des vitesses différentes.
Chaque évolution des groupes de besoin ne doit par ailleurs pas obligatoirement passer par une évaluation diagnostique. Le choix du texte peut être dicté par le thème de la séquence, par le type de texte présenté ou par l’intérêt général des élèves.
Comment attribuer les différents textes d’entrée ?
Dans le guide, à chaque entrée de séquence, une explication plus détaillée des différents textes d’entrée vous permettra d’appréhender au mieux les différences entre chaque texte et de les distribuer à vos groupes de besoin le mieux possible.
Ces dernières années, de nombreuses recherches scientifiques ont démontré qu’une « évaluation » très régulière est plus profitable que la répétition excessive du même type d’exercice.
Conscients de la difficulté de mettre cela en place dans vos classes et attentifs à ce que cela soit le plus ludique possible, nous avons créé un jeu de cartes : Graines de castor
Ce jeu de cartes reprend, par chapitre, la matière travaillée dans les outils de la langue. Des questions courtes, précises et fermées sont proposées aux élèves. Les réponses se trouvant sur les cartes, les élèves peuvent travailler en autonomie, sans l’enseignant(e). Les règles du jeu sont présentées à la page suivante de ce guide.
Pour que cette activité soit efficace et que les notions soient travaillées et retravaillées le plus souvent possible, la clé de la réussite, c’est la régularité. On pourrait par exemple imaginer organiser tous les matins par groupe de 2 ou 3 une séance de 8 minutes de ce jeu de cartes. Ce serait une manière ludique, enrichissante et intéressante de commencer la journée.
De plus, l’interaction entre élèves, le confrontation de leurs opinions ou de leurs réponses est un moyen très performant d’apprentissage et de progression individuelle. En effet, toute la matière vue dans les outils de la langue sera vue, expliquée et réexpliquée par les élèves et pour les élèves.
Attention, nous insistons sur le fait que même si nous appelons cela une « évaluation », il n’est en aucun cas utile d’intervenir dans le travail des élèves et de noter cette activité journalière.
Conclusion
Aussi vrai que les bois de l’élan sont larges, de grande envergure et ramifiés en de nombreux cors, les chemins que l’élève emprunte pour apprendre sont multiples et comportent de nombreux embranchements. Aussi il nous tient à cœur de vous proposer un manuel d’apprentissage du français qui tient compte de cette réalité pour que tous les élèves... prennent leur Élan !
Découvrez ici notre vidéo de présentation de la collection :


Nombre de joueurs : 2 ou 3 élèves
Matériel : Cartes correspondant aux différents chapitres du livre-cahier
Les élèves jouent uniquement avec les cartes correspondant au(x) chapitre(s) qu’ils ont déjà travaillé(s) en classe.
Avant de commencer la partie, chaque joueur choisit deux cartes au sort, faces retournées, sans les regarder.
Un des joueurs au choix est désigné maitre du jeu.
Le maitre du jeu pose les questions de ses deux cartes.
Si la réponse est bonne, il passe à la question suivante.
Si elle est fausse, il donne impérativement la bonne réponse avant de continuer.
Il est important que les élèves ne restent pas sur une mauvaise réponse, mais entendent la réponse correcte.
Le jeu ne se termine que lorsque chaque élève a été au moins une fois maitre du jeu.
Nous ne souhaitons pas qu’il y ait un système de score ou de points, mais chaque enseignant(e) peut faire évoluer la règle selon son organisation de classe.
Savoirs
Attendus
Orienter sa prise de parole, son écoute, sa lecture, son écrit
Intentions de communication lire écrire
Règles d’orthographe lexicale : construction des mots (morphologie)
Connaitre les intentions : – informer ; – d onner du plaisir/susciter des émotions ;
enjoindre ;
persuader/convaincre.
Construire un message significatif
parler écouter lire écrire
Termes du langage technique de la grammaire lire écrire
Conjugaison écrire lire
Stratégies/habiletés de compréhension lire
Connaitre les notions de famille de mots, racine et préfixe.
Connaitre les notions de classe, fonction, accord, genre, nombre et personne, substitut grammatical, anaphore, référent, mode, radical, terminaison, auxiliaire.
Connaitre les règles générales d’accord du participe passé (cas recouvrant les emplois du PP employé sans auxiliaire, avec « avoir », avec « être » à l’exception des cas de l’accord du participe passé des verbes pronominaux).
Connaitre la conjugaison au mode :
– indicatif : imparfait, plus que parfait, passé composé, présent.
Nommer et décrire les stratégies/habiletés de compréhension :
– se créer des images ((se) construire une représentation mentale du texte) ;
– f aire des hypothèses (anticipation et interprétation) et les vérifier ;
– résumer (percevoir le sens global) ;
– retrouver des informations (prélever des informations explicites) ;
– lire entre les lignes (élaborer des inférences).
Connaitre le rôle du contrôle de la compréhension.
Composantes de la production d’un message oral ou écrit
écrire
Maitriser les composantes de la production d’écrits :
– planification ;
– mise en texte ;
– révision ; – correction.
Structures textuelles dominantes lire écrire
Connaitre les caractéristiques générales des cinq structures textuelles : – narrative ; – argumentative ; – d escriptive ; – dialoguée ; – explicative.
Orienter sa prise de parole, son écoute, sa lecture, son écrit
Assigner un but à sa lecture ou son écoute lire
Planifier son message oral ou écrit en tenant compte de l’intention et du destinataire
écrire
Utiliser les caractéristiques de la phrase écrire
Émettre des hypothèses d’anticipation et d’interprétation puis les vérifier
Prélever des informations explicites
Utiliser les termes du support de lecture comme indices pour anticiper le contenu d’un document. Mobiliser ses connaissances préalables sur l’auteur, le sujet et le genre du texte.
Rassembler ses idées et les grouper par blocs de sens en tenant compte de la structure textuelle à produire.
Construire un message significatif/du sens
Utiliser le code
Utiliser toutes les marques de ponctuation dans une production personnelle.
Construire du sens à l’aide de stratégies
lire
Formuler des hypothèses d’anticipation et d’interprétation et les vérifier.
lire
Élaborer des inférences lire
Percevoir le sens global lire
Mettre en relation le sens du texte avec son vécu. Confronter les significations construites personnellement au texte et à celles élaborées par les pairs.
Repérer et reformuler des informations essentielles contenues dans un écrit (papier ou numérique fourni par l’enseignant(e)).
Déduire des informations implicites en reliant des informations explicites proches ou éloignées.
Déduire des informations implicites en reliant des informations du texte et son vécu ou ses connaissances du monde.
Inférer la pertinence du contenu d’un hyperlien par rapport à un but de lecture.
Exprimer le sens global du document.
Formuler les idées principales et les idées secondaires. Expliquer les liens existant entre les idées du texte (chronologiques, logiques).
Expliquer les liens entre les actions et les motivations des personnages.
Intégrer des informations disséminées dans un ou plusieurs documents (papier ou numérique).
Reformuler ou exécuter un enchainement de trois consignes (écrites).
Dégager et assurer la cohérence du message/texte
Identifier le genre du message entendu ou d’un texte
Organiser un message selon une structure textuelle dominante
lire
écrire
Utiliser des reprises d’informations d’une phrase à l’autre pour construire du sens
Observer le fonctionnement de la langue pour dégager des régularités
Utiliser les règles d’orthographe lexicale pour produire du sens
écrire
Dégager les caractéristiques de la structure textuelle dominante afin d’en définir le genre.
Organiser (graphiquement) les éléments donnés d’un texte selon les caractéristiques de la structure dominante donnée.
Utiliser les mots ou expressions qui assurent l’enchainement des phrases.
Utiliser des connecteurs d’opposition/concession/ restriction, de conséquence, de conclusion, de synthèse.
Utiliser les modes et les temps appropriés pour assurer la cohérence temporelle.
Assurer la reprise d’une information d’une phrase à l’autre en utilisant :
de s substituts lexicaux ;
de s substituts grammaticaux.
Traiter/utiliser les unités lexicales
lire écrire
lire
écrire
Observer la construction des mots formés par composition et par dérivation. Justifier une particularité orthographique en s’appuyant sur le préfixe.
Émettre des hypothèses sur le sens d’un mot inconnu à partir de sa forme et le vérifier.
Émettre des hypothèses sur l’orthographe d’un mot inconnu et laisser une trace du doute pour la vérifier. Utiliser les éléments qui composent le mot (préfixe, racine) pour identifier les différents sens d’un mot.
Traiter/utiliser les unités grammaticales
Utiliser la notion de phrase écrire
Prendre appui sur les indices grammaticaux pour construire le sens d’un message
lire
Respecter la structure des phrases simples dans une production écrite en utilisant la ponctuation adaptée.
Repérer et verbaliser les nuances apportées par les marques verbales dans le message entendu ou lu : – de temps.
Repérer le mode : indicatif.
Repérer et verbaliser les nuances apportées par les marques de la négation.
Repérer et verbaliser les nuances apportées par les marques de l’assertion, de l’interrogation, de l’injonction.
Repérer les structures passives.
Repérer les structures de mise en évidence.
Utiliser les règles d’orthographe grammaticale
écrire
Respecter le système temporel choisi parler écrire
Accorder le verbe avec le sujet.
Appliquer les règles générales d’accord du participe. Accorder les déterminants et les adjectifs en genre et en nombre.
Appliquer les règles particulières de la formation du pluriel des noms et des adjectifs (voir savoirs), y compris les exceptions.
Appliquer les règles particulières de la formation du féminin des noms et des adjectifs (voir savoirs).
Appliquer la règle générale et les règles particulières de formation des adverbes (voir savoirs).
Utiliser les formes verbales assurant la construction grammaticale correcte des phrases et la cohérence temporelle.
Assurer la présentation du message
Soigner la présentation de son écrit écrire
Assurer la lisibilité et adapter la présentation à son destinataire.
Utiliser l’outil numérique pour présenter sa production personnelle.
Apprécier, agir/réagir, réviser
Vérifier et ajuster sa production
Réviser sa production écrite écrire lire
écrire
Communiquer sa production écrite écrire lire
Relire sa production et vérifier :
– le contenu des idées ; – leur organisation dans des phrases respectant une structure dominante choisie (à l’aide d’une grille de révision) ;
– le respect de l’intention poursuivie. Définir des pistes de révision.
Ajuster sa production en fonction des pistes de révision.
Corriger une production de son choix à l’aide d’une grille de vérification et des référentiels (dictionnaire –en ligne –, correcteur orthographique, conjugueur…) de la classe en vue de la partager.
Manifester sa compréhension d’un document dont l’intention est :
– d ’informer.
Manifester sa compréhension
En répondant à des questions ou en produisant un dessin, quelques phrases ou une action qui donnent à voir certains des éléments suivants :
– le s liens établis entre l’implicite et l’explicite ;
– le s connaissances personnelles mobilisées/modifiées ;
– l’ intention de l’auteur ;
– le s caractéristiques de sa structure textuelle permettant d’identifier son genre.
Expliciter sa compréhension
Vérifier et justifier sa compréhension d’un document.
Écrire pour :
– informer ;
– donner du plaisir/susciter des émotions ;
– persuader/convaincre ;
– enjoindre.
En répondant à des questions posées oralement, expliciter les stratégies de compréhension mobilisées :
– prélever des informations explicites ;
– élaborer une inférence ;
– faire des hypothèses ;
– relier le texte et les illustrations ;
reformuler le sens global ;
– (se) construire une représentation mentale du texte.
En répondant à des questions posées oralement, justifier la pertinence du contenu d’un hyperlien par rapport à un but de lecture.
Détecter une perte de compréhension et réajuster celle-ci après une confrontation avec les pairs.
Produire un écrit
Rédiger un écrit qui combine plusieurs des éléments ci-dessous en mobilisant des ressources (référentiels) :
– en restant dans le sujet ;
– en tenant compte de l’intention et du destinataire ;
– en l’organisant selon une structure textuelle simple donnée ;
– en u tilisant les traits de ponctuation adéquats ;
– en orthographiant correctement les mots connus et inconnus et en appliquant les règles d’orthographes grammaticale et lexicale ; – en u tilisant les connecteurs ;
– en u tilisant les modes et les temps appropriés pour assurer la cohérence temporelle ;
– en u tilisant les substituts lexicaux et grammaticaux ; – en recourant aux lexiques courant et spécifique à une thématique ou un champ disciplinaire.
Expliciter les composantes de sa production
Verbaliser les composantes de la production d’écrits.
En répondant à des questions posées oralement, expliciter les composantes de la production d’écrits mises en œuvre :
– planification ; – mise en texte ;
– révision ;
– correction.
Les types et les formes de phrases :
– le s trois types de phrases : assertif, interrogatif, injonctif la forme affirmative et la forme négative la forme active et la forme passive la forme neutre et la forme emphatique
L’accord des participes passés
L’indicatif : présent passé composé im parfait plus que parfait
Préfixe, radical, suffixe
1Découverte du thème / Je découvre le texte 7-9
2Je comprends le texte 9-10
3Je découvre le fait divers 11-13
4Je découvre le fait divers / Découverte de la mission 14
5Les types et formes de phrases 15-22
7Les types et formes de phrases 15-22
8L’accord du participe passé 23-26
9L’accord du participe passé 23-26
6Les types et formes de phrases 15-22 2
10 L’accord du participe passé 23-26
11 Les temps du fait divers 27-28
14 Préfixes et suffixes 29-32
15 Préfixes et suffixes 29-32
12 Les temps du fait divers 27-28 3 13 Préfixes et suffixes 29-32
16 Première production écrite 33-34
17 (Auto)évaluation + correction de la première production 33-34
18 Production finale 33-34
Quiproquos
Entrée dans le thème – Propositions :
Avant d’ouvrir le livre-cahier, l’enseignant(e) recueille les représentations initiales sur ce qu’est un fait divers, à l’aide d’un brainstorming au tableau, par exemple, ou tout simplement oralement.
Il/Elle fait ensuite découvrir les différents indices proposés pour entrer dans le thème : quelques courtes vidéos un dessin humoristique quelques citations un rappel d’une activité vécue en troisième année
Cela permet d’affiner la représentation du fait divers, de confirmer ou d’infirmer les différentes hypothèses émises par les élèves lors du brainstorming.
Pour ce chapitre :
chemin A Version la plus longue ; syntaxe et vocabulaire très élaborés.
chemin C Version intermédiaire (entre les versions A et D).
chemin D
chemin B
Version légèrement plus courte que la A ; syntaxe et vocabulaire un peu plus simples.
Version courte et simple. Ce texte reprend les idées essentielles uniquement.
Nous attirons votre attention sur le fait que, pour éviter la comparaison entre élèves, une même lettre ne correspond jamais deux fois au même niveau de texte.
D’un chapitre à l’autre, le texte C peut par exemple être tantôt le plus complexe, tantôt le plus simple.
Ces différents textes sont téléchargeables sur Wazzou.
Par ailleurs, l’ensemble des textes d’entrée sont également disponibles en version audio sur Wazzou. Pour une question de temps, de facilité ou pour aider à la lecture, l’enseignant(e) peut donc décider de les faire écouter à certain(e)s de ses élèves.
Épicerie Épicerie







































Épicerie picerie
Colle ici le texte que tu as reçu de ton enseignant(e).
































































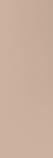









































Exercices 1 à 4
L’enseignant(e) distribue les textes en tenant compte des niveaux de difficulté respectifs.
Les résultats obtenus par chaque élève au test diagnostique proposé en début de parcours peuvent servir de base au choix du texte à attribuer à chacun.
L’enseignant(e) insiste sur le fait qu’il ne faut pas lire le texte mais uniquement le titre de celui-ci pour répondre aux quatre questions.
Il/Elle suggère d’utiliser le dictionnaire si nécessaire (questions 2 et 3).
Exercice 5
Les élèves partagent leurs réponses aux trois premières questions et corrigent si nécessaire.
Puis, en réponse à la question 4, chacun explique oralement son hypothèse au sujet de ce qu’il pourrait y avoir eu comme méprise dans un supermarché.
Exercices 1 à 5
Les élèves découvrent le texte.
Ils répondent ensuite aux questions qui s’y rapportent.
Il serait judicieux de former des groupes reprenant différents niveaux de textes.
Les élèves comparent leurs réponses.
En cas de désaccord, un retour au texte est indispensable afin d’y souligner les mots qui permettent de répondre à la question.
1x exercices complémentaires « stratégies » (Inférer)
↘ 1. Avant de lire le texte, arrête-toi sur le titre.
↘ 2. Quelle est la signification du mot méprise ? Coche ton choix.
une dispute
une erreur
un vol
un accident
↘ 3. Écris le verbe pronominal qui appartient à la même famille que le nom « méprise ».
↘ 4. Pendant quelques minutes, imagine de quel genre de méprise il pourrait s’agir.
↘ 5. En petits groupes, oralement, partagez vos hypothèses.
↘ 1. Quel est le rôle de ce texte ? Colorie ton choix.
enjoindre raconter et informer persuader émouvoir
↘ 2. Réponds aux questions suivantes.
→ a. De qui parle-t-on dans ce texte ?
D’une mère accompagnée de sa fille, d’un instituteur et de son frère jumeau
→ b. Que s’est-il passé ?
La mère s’est mise en colère contre un homme.
→ c. Où le fait s’est-il déroulé ?
→ d. Quand cela s’est-il passé ?
L’instituteur n’est pas poli.
À Verlaine, dans un supermarché
Vendredi dernier
→ e. Pourquoi cela s’est-il produit ? Coche les propositions correctes.
L’homme n’a pas salué la fillette et a répondu qu’il ne la connaissait pas.
L’instituteur faisait ses courses avec son frère jumeau.
L’homme du supermarché est le frère jumeau de l’instituteur. se méprendre
↘ 3. Entoure la réponse correcte, puis justifie ton choix en recopiant les mots du texte qui t’ont permis de répondre.
a. Le frère jumeau de monsieur Samuel est aussi instituteur. VRAI FAUX
Justification :
Un homme peu habitué aux enfants.
b. Monsieur Samuel enseigne en deuxième année primaire. VRAI FAUX
Justification :
Juliette, 10 ans, a cru reconnaitre son instituteur.
c. Le supermarché se trouve à Verlaine. VRAI FAUX
Justification :
Justification :
À Verlaine, dans le supermarché du village Il achetait des chocolats avant de se rendre souper chez des amis.
d. La rencontre dans le magasin a eu lieu : Tôt le matin Vers midi En fin d’après-midi
↘ 4. Par groupes, écrivez le nom de la personne qui a prononcé ou aurait pu prononcer ces paroles.
a. « Je suis vraiment désolée. »
b. « Je n’ai pas fait de courses vendredi. »
c. « Je ne vous connais pas. »
d. « Impoli ! Asocial ! »
La mère
L’instituteur, monsieur Samuel
Le frère de monsieur Samuel
La mère
↘ 5. Numérote chaque phrase afin de reconstituer l’ordre chronologique.
2 5 1 4 3
L’homme signale à Juliette qu’il ne la connait pas.
L’enseignant explique l’origine probable de la méprise.
Juliette croit reconnaitre son instituteur dans un magasin et lui dit : « Bonjour ! »
La mère de la fillette se rend à l’école pour présenter ses excuses à l’enseignant.
La mère de Juliette se met en colère contre l’homme.
Suggestion : Il serait intéressant de proposer aux élèves quelques journaux en version « papier », conçus pour les adultes, afin d’y voir apparaitre les différentes rubriques (qui n’apparaissent pas forcément de la même manière dans les journaux pour enfants).
Les élèves découvrent l’extrait du « Daily News » et citent les différentes rubriques qui y sont mentionnées.
Une comparaison peut être faite éventuellement avec de vrais journaux présents en classe.
L’enseignant(e) s’assure de la bonne compréhension des diverses rubriques proposées en posant quelques questions, par exemple :
Dans quelle rubrique va-t-on trouver : les résultats des matchs de foot du weekend ?
un article sur l’exposition De Vinci ? un compte-rendu de la dernière réunion des ministres belges ? un article relatif à un camion qui a pris feu sur l’autoroute et a causé de gros embarras de circulation ?
une grille de mots croisés ?
un article qui parle de la rencontre entre les présidents russe et américain ?
Exercices 1 à 3
Les élèves répondent aux trois questions.
Correction collective.
Dans un journal, les informations sont classées en différentes rubriques afin de permettre au lecteur de se repérer facilement. Voici quelques exemples :










INTERNATIONAL
POLITIQUE BELGE
ÉCONOMIE
FAITS DIVERS
SPORTS
CULTURE
LOISIRS






En↘ 1. Lis ces deux articles trouvés dans la même rubrique de deux journaux.














Islande, pendant le championnat d’Europe de football qui avait lieu en France, un fan de l’équipe islandaise a réservé un Boeing 737 pour emmener 180 supporters voir un match, à Nice. Une terrible surprise attendait les passagers à l’atterrissage ! En effet, ils se trouvaient à Niš, en Serbie !









L’organisateur avait tout simplement confondu les deux villes lors de la réservation ! Hélas, les supporters, dépités, ont dû rentrer au pays car il n’était pas possible de leur trouver un autre avion dans les délais.

































G. Trouvetout
















































































Mercredi dernier, dans le nord de la France, deux écoliers de 5 ans ont réussi à s’échapper de leur école en creusant un tunnel sous le mur d’enceinte de l’établissement, à l’aide de pelles à sable. Ils ont ensuite marché deux kilomètres afin de se rendre chez un concessionnaire de voitures de luxe. Ils voulaient y acheter une Jaguar ! Une dame, étonnée de la présence des deux bambins, seuls en ville, les a conduits au commissariat le plus proche. Entretemps, l’école avait prévenu la police de la disparition des deux petits fugueurs. Dépités, ceux-ci ont été reconduits dans leur école.













































































H. Lebontuyau


↘ 3. De quoi parlent les articles trouvés dans la rubrique « faits divers » ? Coche ton choix.
des actualités politiques
des résultats sportifs
des évènements récents et souvent proches tels que les vols, délits, accidents, actes héroïques, faits insolites... qui n’ont pas de grand impact sur la vie des lecteurs
des sorties cinématographiques












En↘ 4. Différentes couleurs ont été utilisées pour mettre en évidence les éléments importants de ce fait divers.



























Un fait divers :


Islande, pendant le championnat d’Europe de football qui avait lieu en France, un fan de l’équipe islandaise a réservé un Boeing 737 pour emmener 180 supporters voir un match, à Nice. Une terrible surprise attendait les passagers à l’atterrissage ! En effet, ils se trouvaient à Niš, en Serbie !

L’ organisateur avait tout simplement confondu les deux villes lors de la réservation ! Hélas, les supporters, dépités, ont dû rentrer au pays car il n’était pas possible de leur trouver un autre avion dans les délais.


Colorie les rectangles afin d’indiquer ce que chaque couleur représente.


- contient un titre accrocheur.

- répond aux questions suivantes :
- Qui ?
- Quoi ?
- Où ?




- Quand ?
- Comment ? / Pourquoi ?
- se termine par le résultat.
- est parfois accompagné d’une photo.


↘ 5. À l’aide du même code couleur, colorie les caractéristiques du deuxième fait divers de l’exercice 1.
Les élèves effectuent l’exercice. Il est conseillé de tracer une croix de couleur dans les cases afin de pouvoir corriger facilement. L’élève coloriera proprement une fois que les réponses auront été validées par l’enseignant(e).
L’enseignant(e) s’assure de la bonne compréhension de la consigne et effectue un exemple avec la classe.
Les élèves comparent leurs réponses et corrigent si nécessaire.
6
Pour effectuer cet exercice, les élèves doivent avoir accès aux différentes versions du texte de base.
Il est intéressant d’effectuer une mise en commun des réponses fournies car on pourra en dégager quelques caractéristiques du fait divers.
Les élèves complètent la synthèse en recopiant les éléments proposés.

↘ 6. Comparez, par groupes, les différentes versions reçues. Si un journaliste voulait raconter l’histoire que tu as découverte au début de ce chapitre dans la rubrique « faits divers », quelle version du texte choisirait-il ?
a. Colorie ton choix.
A C D B
b. Justifie ta réponse en quelques mots.
- Ce texte est plus court.
- Il ne donne que les informations essentielles pour comprendre l’évènement.
- Il n’y a pas trop de détails.
La structure d’un fait divers
Lis cet article et replace les différents éléments de la structure d’un fait divers.
de l’article
?








?
Pourquoi ?




Vendredi dernier, à Verlaine, une mère en colère a fait de l'esclandre dans le supermarché du village.





En effet, sa fille Juliette, âgée de 10 ans, avait adressé un sympathique « bonjour » à son instituteur, mais celui-ci lui a répondu qu’il ne la connaissait pas. Ceci a déclenché la colère de la mère qui a traité l’individu d’impoli et d’asocial.









Lundi, après réflexion, la maman de la fillette s’est rendue à l’école afin de présenter ses excuses à l’enseignant pour sa réaction un peu trop vive.








Celui-ci, étonné, a expliqué qu’il n’était pas dans le village ce week-end et qu’il s’agissait probablement de son frère jumeau, un homme timide et peu habitué aux enfants. Il achetait des chocolats avant de se rendre chez des amis pour souper. Terriblement embarrassée, la dame a demandé à l’enseignant de bien vouloir l’excuser très sincèrement auprès de son frère.










H. Lebontuyau
↘ À la fin de ce chapitre, tu devras rédiger un fait divers au départ de cette image.
Pour mener à bien cette mission, tu utiliseras différents outils que tu vas découvrir et/ ou approfondir dans ce chapitre. Les pages où se trouve chaque outil sont notées entre parenthèses.
Les éléments présents dans un fait divers (p. 11) - un titre accrocheur
- les réponses aux questions : Qui ? Quand ? Quoi ? Où ? Pourquoi/Comment ?
- les conséquences/le résultat
Les temps du fait divers : l’indicatif passé composé, l’indicatif imparfait et l’indicatif plus-que-parfait (p. 27)
L’accord du participe passé (p. 23)
Objectif : Amener l’élève à rédiger un fait divers sur base d’un dessin.
Les élèves découvrent la mission.
Celle-ci est basée sur un dessin à interpréter.
L’enseignant(e) invite les élèves à s’exprimer sur ce dessin :
Quels sont les personnages ?
Que s’est-il passé ?
Où se passe le fait divers ?
Quand a-t-il lieu ?
Comment ce fait divers s’est-il passé ? Pourquoi ?
De cette manière, les différents éléments qui doivent apparaitre dans le fait divers sont mis en évidence.
Attention ! Laissons un peu de place à l’imagination de chacun pour la fin du fait divers !
Les élèves sont donc invités à réfléchir à une fin tout en gardant leur idée secrète.
Lors de la réalisation de la mission, l’enseignant(e) pourra procéder à une mise en commun orale des différentes fins de récit imaginées. Les élèves les moins inspirés pourront donc y puiser quelques idées.
Objectif : Comprendre le sens d’un texte en tenant compte des unités grammaticales « types et formes de phrases ».
Note : Afin de se conformer aux nouveaux référentiels, les termes « assertives » et « injonctives » remplacent « déclaratives » et « impératives ». De même, le terme « emphatique » fait place à « mise en évidence ».
L’élève complète au crayon ordinaire. Différenciation : L’enseignant(e) note au tableau (en vrac) les noms des trois types et les signes de ponctuation qu’il convient d’utiliser pour la synthèse de rappel.
L’enseignant(e) organise une mise en commun des réponses. Au niveau de la ponctuation, il/elle met en évidence : Que toutes les phrases injonctives (impératives) ne se terminent pas forcément par un point d’exclamation (par exemple : Place le gâteau dans le four.). Que certaines phrases assertives (déclaratives) se terminent parfois par un point d’exclamation (par exemple : Comme tu as grandi !). Qu’il est donc dangereux de ne se fier qu’à la ponctuation pour identifier le type d’une phrase.
Les élèves effectuent l’exercice.
Les 3 types de phrases
Assertif (déclaratif) Interrogatif
Injonctif (impératif)
→ sert à raconter, déclarer
→ la phrase se termine par ou
→ sert à poser une question
→ la phrase se termine par
→ la phrase se termine par ou . ! ? . !
↘ 1. Coche la case qui correspond au type de la phrase.
Assertif (déclaratif) Interrogatif
Un cambrioleur n’a pas hésité à réveiller ses victimes pour leur demander leur code Wi-Fi !
Quand la piscine sera-t-elle inaugurée par le bourgmestre ?
Pourquoi n’ont-ils pas prévenu la police ?
N’utilisez plus de pesticides !
C’est une belle aventure qui commence.
→ sert à ordonner, conseiller, interdire, donner des consignes
Injonctif (impératif)
Au carrefour, tourne à droite et emprunte le sentier.
Prenez vos précautions : faites des réserves d’eau.
↘ 2. Lis ce fait divers.
Samedi dernier, les pompiers de Namur ont été appelés pour venir en aide à un chien tombé accidentellement dans la Meuse alors qu’il tentait de jouer avec un canard. L’animal avait échappé à la surveillance de son maitre qui faisait son jogging. Emporté par le courant, le toutou ne parvenait plus à rejoindre la berge. Un pompier a dû plonger pour récupérer l’animal avant de le rendre à son maitre, soulagé de retrouver son fidèle ami.
→ a. Réponds aux questions à l’aide de phrases assertives (déclaratives).
- Par qui l’animal a-t-il été sauvé ?
L’animal a été sauvé par les pompiers de Namur.
- Que faisait le maitre du chien en bord de Meuse ?
Le maitre du chien faisait son jogging.
- Pourquoi le chien est-il tombé dans la Meuse ?
Le chien est tombé dans la Meuse car il tentait de jouer avec un canard.
→ b. Rédige la question qui correspond à la réponse donnée.
Où le chien est-il tombé ?
Le chien est tombé dans la Meuse.
Quand ce fait divers a-t-il eu lieu ?
Ce fait divers a eu lieu samedi dernier.
Pourquoi l’animal ne parvenait-il pas à rejoindre la berge ?
L’animal ne parvenait pas à rejoindre la berge car il était emporté par le courant.

Pistes de différenciation :
Donner les mots interrogatifs pour le point b. Oraliser l’exercice avant de passer à l’écrit.
Exercice 3
Avec leur voisin(e), les élèves recherchent une phrase pour compléter chaque bulle. Le duo permettra le partage d’idées et donnera du rythme à l’activité.
Exercice 4
Il s’agit d’un exercice de rappel. Si nécessaire, la consultation de la carte mentale située en fin de séquence peut raviver la signification des termes « affirmative » et « négative ».
Exercice 5
Les élèves citent les mots employés pour exprimer une négation et les mettent en évidence dans l’exercice 4.
↘ 3. Invente deux phrases injonctives (impératives) en rapport avec ce fait divers.
Exemples de réponses attendues
À l’avenir, tenez votre chien en laisse !
Reste bien près de moi pendant ma course. (ou) Ne t’approche pas de l’eau !
↘ 4. Ces trois types de phrases peuvent être de forme affirmative ou négative. Coche la case qui correspond à la forme correcte de chaque phrase.
Un cambrioleur n’a pas hésité à réveiller ses victimes pour leur demander leur code Wi-Fi !
Quand la piscine sera-t-elle inaugurée par le bourgmestre ?
Pourquoi n’ont-ils pas prévenu la police ?
N’utilisez plus de pesticides !
C’est une belle aventure qui commence.
Au carrefour, tourne à droite et emprunte le sentier.
Prenez vos précautions : faites des réserves d’eau.
↘ 5. Dans l’exercice 4, entoure les mots qui t’ont permis de reconnaitre les phrases de forme négative.
↘ 6. Lili et Lola sont jumelles, physiquement semblables, mais pourtant bien différentes, avec des habitudes et des gouts vraiment opposés ! Complète chaque phrase prononcée par Lili afin de mettre la phrase de Lola à la forme négative. Utilise les mots proposés dans les cadres de droite.
J’aime le chocolat.
Je suis toujours de bonne humeur.
Je pratique la danse et la natation.
Tout le monde aime mon humour.
J’aime tout.
J’ai déjà un amoureux.
J’aime encore jouer à la poupée.
n(e)’... plus personne n(e)’... n(e)’... pas n(e)’... pas encore n(e)’... rien ne... ni …ni ne... jamais
Je aime le chocolat.
Je suis de bonne humeur.
n’ pas ne jamais ne ni ni
Je pratique la danse la natation. aime mon humour.
Personne n’
Je aime
n’ rien
Je ai d'amoureux.
n’ pas encore
n’ plus
Je aime jouer à la poupée.
La production de phrases négatives n’étant plus demandée, cet exercice vise à travailler les différentes manières d’exprimer une négation.
L’enseignant(e) s’assure de la compréhension de l’exercice en faisant réexprimer la consigne par les élèves.
La première phrase peut être réalisée en guise d’exemple.
Une fois l’exercice terminé, quelques élèves peuvent jouer les rôles des jumelles.
L’oralisation permettra de mieux discerner les erreurs éventuelles.
Les élèves corrigent leur production.
Exercice 7
Les élèves lisent les deux textes, comparent et soulignent les différences.
Exercices 8 à 10
Les élèves répondent aux questions.
Les élèves partagent leurs réponses et corrigent si nécessaire.
L’enseignant(e) organise une correction collective afin de s’assurer de la bonne compréhension de ces notions.
-f. : L’enseignant(e) introduit la notion de complément d’agent.
Les élèves sont invités à relire la consigne 7 pour utiliser les termes « active » et « passive ».
↘ 7. Les trois types de phrases peuvent aussi être à la forme active ou passive Lis ces deux articles qui racontent le même fait divers et souligne les phrases qui changent du texte A au texte B.
Drôle de visite (texte A)
Hier matin, un serpent de deux mètres qui se trouvait dans une douche a terrorisé une Anversoise. Le reptile s’était échappé d’un terrarium situé dans l’appartement voisin et avait emprunté les conduits d’aération de l’immeuble. Cette visite inattendue a surpris la pauvre dame. Pétrifiée, elle s’est mise à hurler. Son mari a immédiatement appelé les pompiers qui ont pu récupérer le fuyard en prenant les précautions nécessaires. Un médecin a examiné la dame, en état de choc.
Drôle de visite (texte B)
Hier matin, une Anversoise a été terrorisée par un serpent de deux mètres qui se trouvait dans sa douche. Le reptile s’était échappé d’un terrarium situé dans l’appartement voisin et avait emprunté les conduits d’aération de l’immeuble. La pauvre dame a été surprise par cette visite inattendue. Pétrifiée, elle s’est mise à hurler. Son mari a immédiatement appelé les pompiers qui ont pu récupérer le fuyard en prenant les précautions nécessaires. La dame, en état de choc, a été examinée par un médecin.
↘ 8. Quel texte veut attirer l’attention sur la dame ? Coche la bonne réponse.
Texte A Texte B
X
↘ 9. Quelle est la différence entre les phrases que tu as soulignées dans les deux textes ? Écris ta réponse sur ces quelques lignes.
Dans le texte B, on parle de la dame en début de phrase. C’est elle qui est le sujet de ces phrases. Dans le A, on parle d’abord du serpent ou de la visite ou du médecin.
Ce sont les sujets.
↘ 10. Observe ces phrases et réponds aux questions.
A. Hier matin, un serpent de deux mètres a terrorisé une Anversoise.
B. Hier matin, une Anversoise a été terrorisée par un serpent de deux mètres.
a. Dans les deux phrases, souligne le G.S. en bleu.
b. Dans les deux phrases, souligne le verbe en rouge.
c. Dans quelle phrase le G.S. fait-il l’action ?
d. Dans quelle phrase le G.S. subit-il l’action ?
e. Qui fait réellement l’action dans la phrase B ?
f. Comment appelle-t-on ce complément ?
g. Quelle est la forme de la phrase A ?
h. Quelle est la forme de la phrase B ?
dans la phrase A dans la phrase B « un serpent de deux mètres » complément d’agent
forme active
forme passive
↘ 11. Trace une croix pour indiquer la forme des phrases suivantes.
a. La dame a été examinée par un médecin.
b. Le pompier récupère le dangereux reptile.
c. Les sauveteurs récupèrent le nageur imprudent.
d. La nouvelle piscine sera inaugurée par le bourgmestre.
e. Le village a été touché par la tempête.
f. Les inondations ont causé de nombreux dégâts.
g. Le chat en détresse est secouru par un pompier.
h. Le champ de blé est détruit par les pluies violentes.
L’enseignant(e) peut inviter les élèves à souligner le verbe conjugué dans chaque phrase. Comment procède-t-on pour reconnaitre une phrase active d’une phrase passive ? On regarde si le sujet fait l’action ou la subit.
La mise en évidence a déjà été travaillée dans Élan 5B, chapitre 12.
Les élèves répondent aux différentes questions.
L’enseignant(e) organise une mise en commun collective.
Je retiens
Dans le nouveau référentiel, le terme « emphatique » fait place à la mise en évidence d’un élément de la phrase.
Mettre en évidence un mot ou un groupe de mots consiste à sortir un élément de sa position canonique dans la phrase afin de le valoriser, de l’insister, ou de le thématiser.
Cela transforme le point de vue de l’énonciateur et influence l’interprétation du récepteur.
Pourquoi dire que la phrase « n’est plus neutre » ?
Parce qu’elle porte désormais une intention discursive marquée : insister, convaincre, séduire, critiquer…
L’énonciateur manifeste un point de vue (intention) et oriente la lecture. Ce qui était une simple information devient une prise de position implicite.
Le but de cet exercice est de reconnaitre la structure utilisée pour mettre en évidence. Les élèves sont invités à se référer aux exemples donnés en haut de la page.
↘ 12. Avec ton voisin ou ta voisine, observez ces phrases et répondez aux questions.
A. Je n’ai pas compris cette leçon.
B. C’est cette leçon que je n’ai pas comprise.
C. Cette leçon, je ne l’ai pas comprise.
a. Ces phrases parlent-elles de la même chose ?
oui
b. Quelle est la différence entre la première phrase et les deux autres ?
Dans les phrases B et C, on insiste sur la leçon qui n’a pas été comprise.
c. Comment insiste-t-on sur cet élément dans la phrase B ?
On utilise les mots « c’est ... que ».
d. Comment insiste-t-on sur cet élément dans la phrase C ?
On commence par cet élément, on place une virgule puis on le répète dans la phrase en utilisant un pronom.
Dans ces phrases B et C, on met en évidence un mot ou un groupe de mots afin d’insister sur cet élément. Dans ce cas, la phrase n’est plus neutre.
↘ 13. Pour chaque groupe d’énoncés, colorie les cases selon le code suivant.
= Phrase neutre
= Mise en évidence d’un élément à l’aide des mots « C’est ... que (qui) », « ce sont ... que (qui) »
= Mise en évidence d’un élément en le plaçant en début de phrase
a. J’ai déjà rencontré ce chanteur.
C’est ce chanteur que j’ai déjà rencontré.
Ce chanteur, je l’ai déjà rencontré.
b. J’écoute cette chanson dix fois par jour !
Cette chanson, je l’écoute dix fois par jour !
C’est cette chanson que j’écoute dix fois par jour !
c. Ce sont ces exercices que Lola trouve trop difficiles.
Ces exercices, Lola les trouve trop difficiles.
Lola trouve ces exercices trop difficiles.
d. Ces souvenirs, je les ai achetés pour mes parents.
J’ai acheté ces souvenirs pour mes parents.
Ce sont les souvenirs que j’ai achetés pour mes parents.
↘ 14. Trace des croix dans le tableau afin d’indiquer le type et les formes de chaque phrase.
a. Pourquoi n’es-tu pas venu à mon anniversaire ?
b. Ne marchez pas sur les pelouses !
c. Mon père, lui, préfère rouler en décapotable.
d. Les touristes ont été guidés par un spécialiste de l’Égypte.
e. Avez-vous été surpris par la tempête ?
f. Préviens-moi dès ton retour de vacances.
Types
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Formes
Asser.Interr.Inj.Aff.Nég.Act.Pass.Neutre Avec mise évid.
Assertif (déclaratif)
Le médecin examine le blessé.
Interrogatif
Le médecin examine-t-il le blessé ?
Injonctif (impératif)
Examine le blessé !
Affirmative
Un médecin examine le blessé.
Négative
Un médecin n’examine pas le blessé.
Active
Un médecin examine le blessé.
Passive
Le blessé est examiné par un médecin.
Neutre
Un médecin examine le blessé.
Avec mise en évidence
C’est le médecin qui examine le blessé.
Cet exercice est un exercice de synthèse sur la reconnaissance des types et formes de phrases.
Les élèves peuvent s’aider de la synthèse.
1x exercices complémentaires ( - - )
1x évaluation
Note : Cette matière a déjà été abordée plusieurs fois dans la collection au cours des années précédentes.
Vu la complexité de celle-ci, l’étude de l’accord du participe passé d’un verbe conjugué avec l’auxiliaire « avoir » s’est volontairement limitée aux phrases dans lesquelles le C.D.V. se situait derrière ce participe passé, et restait donc invariable. Les termes « en général », « le plus souvent » et « pour le moment » ont été utilisés afin de bien signaler aux élèves que ce n’était pas toujours le cas et qu’ils étudieraient plus profondément cette matière en sixième année.
Exercice 1
Les élèves lisent les phrases proposées.
Pour identifier la forme verbale, le référent de conjugaison peut être consulté en cas d’oubli de la terminologie.
Exercice 2
L’enseignant(e) propose aux élèves de compléter les deux premières lignes du tableau au crayon ordinaire.
Un participe passé est donné volontairement dans le tableau afin de guider l’élève pour le classement (et ne pas intervertir « employé avec être » et « employé avec avoir »).
Les élèves comparent leurs hypothèses avec leur voisin(e), ajustent et corrigent.
L’enseignant(e) réalise une mise en commun collective.
Les élèves complètent la troisième ligne au stylo.
Ils peuvent tracer des flèches dans les phrases de l’exercice 1 pour relier le participe passé au groupe nominal qui commande son accord.
↘ 1. Quelle est la forme verbale des mots notés en caractères gras ? Écris ta réponse dans l'encadré.
a. Arrivée rapidement sur place, la police a sécurisé les lieux.
b. Des témoins ont vu l’agression et ont secouru les victimes.
c. Une automobiliste est entrée en collision avec un camion.
d. La S.P.A. a recueilli les chiots abandonnés par leur maitre.
e. Les secouristes sont partis à la recherche des deux promeneurs imprudents.
Ce sont
Participes passés employés seuls
Exemples :
Participes passés d’un verbe conjugué avec l’auxiliaire « être »
Exemples :
Le participe passé employé s’accorde avec (comme un adjectif).
des participes passés arrivée abandonnés seul le nom auquel il se rapporte « être » le sujet du verbe « avoir » entrée partis sécurisé vu secouru recueilli
Le participe passé d’un verbe conjugué avec l’auxiliaire
s’accorde avec .
Participes passés d’un verbe conjugué avec l’auxiliaire « avoir »
Exemples :
↘ 2. Complète le tableau ci-dessous et recopie chaque participe passé de l’exercice 1 dans la colonne adéquate.
Dans ces exemples, le participe passé d’un verbe conjugué avec l’auxiliaire ne s’accorde pas. Tu vas voir que ce n’est pas toujours le cas.
↘ 3. Avec ton voisin ou ta voisine, observez ces deux groupes de phrases et répondez aux questions.
GROUPE 1
A. Deux motards se sont lancés à la poursuite de la voiture et ils ont arrêté la voiture.
B. Deux motards se sont lancés à la poursuite de la voiture et ils l’ont arrêtée
GROUPE 2

A. Les enfants ont dérivé vers le large mais un sauveteur a ramené les enfants sur la plage.
B. Les enfants ont dérivé vers le large mais un sauveteur les a ramenés sur la plage.
a. Avec quel auxiliaire les participes passés notés en caractères gras sont-ils employés ?
Avec l’auxiliaire « avoir ».
b. Que pouvez-vous observer en ce qui concerne leur orthographe ?
Dans la deuxième phrase de chaque groupe, le participe passé a varié.
c. Quelle est la différence entre la phrase A et la phrase B de chaque groupe ?
Dans la deuxième phrase, on a utilisé un pronom pour éviter la répétition de « la voiture » ou de « les enfants ».
d. Quelle est la fonction des groupes « la voiture » et « les enfants » dans les phrases A ?
Ce sont des groupes compléments directs du verbe.
e. Où se trouvent ces groupes par rapport au verbe ?
Ils se trouvent derrière le verbe.
f. Quelle est la fonction des pronoms « l’ » et « les » dans les phrases B ?
Ce sont des compléments directs du verbe.
g. Où se trouvent-ils par rapport au verbe ?
Ils se trouvent devant le verbe.
h. Avec quel mot a-t-on accordé le participe passé « arrêtée » dans la phrase B ?
Avec « voiture » qui est remplacée par le pronom « l’ ».
i. Avec quel mot a-t-on accordé le participe passé « ramenés » dans la phrase B ?
Avec « enfants » qui est remplacé par le pronom « les ».
Les élèves lisent les deux groupes de phrases et répondent aux questions. Ces questions guident leur observation et ont pour but d’en dégager la règle d’accord du participe passé d’un verbe conjugué avec l’auxiliaire « avoir ».
L’enseignant(e) propose ces deux groupes de phrases au tableau afin de mieux visualiser les réponses données.
Les élèves partagent leurs hypothèses et corrigent après validation de celles-ci.
J’ai découvert
Les élèves notent leurs hypothèses dans leur cahier de recherches.
L’enseignant(e) organise une mise en commun collective des hypothèses et note les réponses au tableau.
Les élèves complètent la synthèse.
Exercice 4
Avant de débuter l’exercice, il serait probablement nécessaire de rappeler la manière de rechercher le C.D.V. :
Quelle question faut-il se poser?
À quel endroit faut-il se la poser ?
Exercice 5
Piste de différenciation : Les élèves oralisent la pronominalisation avant le passage à l’écrit.
Suggestion : Avant de passer à l’exercice suivant, l’enseignant(e) peut faire effectuer quelques variations, orales ou écrites, selon le temps disponible.
Exemples :
Remplacer « les moutons » par « les brebis »
Remplacer « leurs enfants » par « leurs filles »
Exercice 6
Piste de différenciation : Les élèves commencent par souligner les C.D.V. dans la première phrase de chaque exercice. L’enseignant(e) corrige avant de donner le feu vert pour la suite de l’exercice.
Le participe passé d’un verbe conjugué avec l’auxiliaire s’accorde seulement si le verbe a un placé lui.
Le participe passé reçoit alors le et le du qui est le centre du groupe nominal remplacé par ce avoir
Dans ce cas, le complément direct du verbe est un (le, la, les, que) car ces pronoms sont toujours placés le verbe.
↘ 4. Souligne le complément direct du verbe puis colorie le participe passé correctement orthographié.
a. Un individu a abandonné abandonnés des chiots sur un parking d’autoroute.
b. Un automobiliste les a recueilli recueillis et les a conduit conduits à la S.P.A.
c. Un jeune garçon a vu vus les chiots et les a immédiatement adopté adoptés
↘ 5. Évite la répétition en pronominalisant le complément direct noté en caractères gras. Recopie toute la phrase.
a. Les moutons se sont dispersés dans la montagne mais le chien du berger a rassemblé les moutons.
Les moutons se sont dispersés dans la montagne mais le chien du berger les a rassemblés.
b. Les parents ont organisé une surprise pour leurs enfants. Ils ont emmené leurs enfants dans un parc d’attractions.
↘ 6. Transforme en te basant sur la phrase de départ.
a. Ce brin de muguet, je l’ai cueilli pour maman.
Cette rose, je pour maman.
complément direct pronom devant avant genre l’ai cueillie
Ces fleurs, je pour maman.
b. Tom a retrouvé le chaton égaré et l’a ramené à son maitre.
Les parents ont organisé une surprise pour leurs enfants. Ils les ont emmenés dans un parc d’attractions.
égarés et les a ramenés à leur les ai cueillies
Tom a retrouvé les chatons maitre.
Tom a retrouvé la petite chienne maitre.
égarée et l’a ramenée à son nombre pronom nom
eu
↘ 7. Écris les participes passés des verbes notés entre parenthèses. Veille aux accords. Hier, un incendie a (avoir) lieu à Bruxelles. (Alerter) par les voisins, les secours sont (arriver) rapidement sur les lieux. Ils ont (déployer) la grande échelle pour atteindre les personnes du deuxième étage. Ils les ont (secourir) et les ont (emmener) à l’hôpital le plus proche. Les victimes y ont (recevoir) quelques soins. Elles sont (rentrer) dans leur famille en fin de journée.
employé seul
accord avec le nom auquel il se rapporte
Alertés arrivés
déployé
emmenées
reçu
rentrées
Orthographe du participe passé…
d’un verbe conjugué avec l’auxiliaire « avoir »
Y a-t-il un complément direct du verbe ?
Oui
Le C.D.V. est-il devant le participe passé ?
Non
secourues
Oui
Non
accord en genre et en nombre avec le C.D.V. invariable
accord avec le groupe sujet du verbe d’un verbe conjugué avec l’auxiliaire « être »
Il s’agit d’un exercice de synthèse.
Piste de différenciation : Afin d’aider l’élève à structurer son travail, l’enseignant(e) pourrait proposer d’utiliser trois couleurs différentes pour identifier les trois cas d’accord, avant de passer à la partie écrite de l’exercice.
La carte mentale de synthèse peut évidemment servir d’outil.
1x exercices complémentaires ( - - )
1x évaluation
Je retiens
L’accord du participe passé d’un verbe pronominal n’étant toujours pas présent dans le nouveau référentiel, il n’est pas abordé dans cette synthèse.
Objectifs : Assurer l’organisation d’un texte de type « fait divers ». Contribuer à la cohérence du texte en choisissant le temps et le mode appropriés.
Exercice 1a
Les élèves lisent le texte une première fois. Ensuite, ils soulignent les verbes conjugués.
Exercice 1b
Les temps à reconnaitre ont déjà été rencontrés précédemment. Si besoin est, les élèves peuvent consulter leur référent de conjugaison pour identifier les temps utilisés.
Avant de passer à la synthèse des découvertes, il serait intéressant de consulter d’autres faits divers (dans ce chapitre ou dans des journaux) afin de voir si les mêmes temps de conjugaison s’y retrouvent.
J’ai découvert
Les élèves complètent la synthèse des découvertes en recopiant les temps notés au tableau par l’enseignant(e).
↘ 1. a. Souligne les verbes conjugués à l'indicatif dans le fait divers suivant.
Une licorne à la dérive !
Hier matin, dans une zone non surveillée de la plage de Biarritz, une jeune fille a dérivé vers le large, allongée sur une bouée licorne. Ses parents, inquiets de ne plus voir leur fille, ont donné l’alerte. Emportée par le courant, la demoiselle endormie n’avait pas réalisé le danger qui la menaçait. Une équipe de sauveteurs a rapidement pris les choses en mains et a ramené l’imprudente sur la plage.
Les autorités locales envisagent d’agrandir la zone de baignade surveillée car de tels évènements sont trop fréquents en période estivale.
→ b. Regroupe les verbes qui sont conjugués au même temps Indique le titre de chaque colonne.
a dérivé ont donné
a ... pris a ramené imparfait menaçait plus-que-parfait avait ... réalisé présent envisagent sont
Complète à l’aide des temps adéquats.
L’indicatif passé composé
est le temps le plus utilisé dans le fait divers. Il sert à raconter les évènements qui ont eu lieu. et
l’indicatif plus-que-parfait passé composé
L’indicatif imparfait
sont utilisés pour parler des évènements qui ont eu lieu avant ceux écrits au passé composé et pour décrire les circonstances des choses.
L’indicatif présent
est utilisé pour raconter un évènement qui se déroule encore actuellement
↘ 2. Colorie les formes verbales correctes pour compléter ce fait divers.
Batman arrêté dans la capitale espagnole
Hier soir, la police de Madrid a flashé flashait un automobiliste à plus de 150 km/h. Immédiatement, deux motards s’étaient lancés se sont lancés à la poursuite du bolide noir et l'ont arrêté l’arrêtaient après une course poursuite.
Surpris, les agents ont découvert découvraient au volant un individu vêtu du costume de Batman. Celui-ci leur avait expliqué a expliqué qu’il était a été fan de ce héros et qu’il voulait a voulu rattraper un voleur de bijoux.
Toutes ces explications n’ont pas suffi n’avaient pas suffi pour convaincre les agents qui lui donnaient ont donné une sévère contravention en lui rappelant qu’il vaut vaudra mieux faire appel à la police plutôt que de risquer la vie des gens.







↘ 3. Conjugue les verbes donnés entre parenthèses en choisissant les temps adéquats
La magie des ballons
Dimanche après-midi, un jeune homme (perdre) son petit frère de six ans à la foire de Liège. Il (décider) de s’arrêter au stand de tir mais une fois la partie terminée, il (constater) avec stupeur que l’enfant (disparaitre) !
Affolé, il (se mettre) à courir dans tous les sens en criant le nom du petit garçon. Quelques personnes l’(aider) , mais sans résultat. Paniqué , l’homme (appeler) les secours qui (organiser) de nouvelles recherches.
C’(être) auprès du clown aux ballons que le petit fugueur, effrayé par le bruit des carabines, (trouver) refuge !
a perdu a appelé ont organisé est avait trouvé avait décidé a constaté avait disparu s’est mis ont aidé
Les élèves choisissent les formes verbales adéquates.
Les élèves comparent leurs choix. L’oralisation permet aussi de mieux se rendre compte de la cohérence du texte.
Une correction collective permettra à l’enseignant(e) de mettre en évidence la manière d’effectuer le choix des temps :
Quelles sont les actions qui ont eu lieu uniquement hier ?
Quel temps va-t-on utiliser pour les exprimer ?
Quels verbes désignent des actions qui existaient déjà avant le fait divers qui a eu lieu hier ?
Quel temps va-t-on utiliser pour les exprimer ?
Quel verbe du texte désigne une « vérité » ? (vaut)
Quel temps va-t-on utiliser pour l’exprimer ?
Piste de différenciation :
Donner le temps à utiliser pour chaque verbe :
Perdre (ind. P.C.)
Décider (ind. P.Q.P.)
Constater (ind. P.C.)
Disparaitre (ind. P.Q.P.)
Se mettre (ind. P.C.)
Aider (ind. P.C.)
Appeler (ind. P.C.)
Organiser (ind. P.C.)
Être (ind. Prés.)
Trouver (ind. P.Q.P.)
Donner deux propositions de verbes conjugués, comme dans l’exercice 2.
Dimanche après-midi, un jeune homme (perdre) a perdu / avait perdu son petit frère de six ans à la foire de Liège. Il (décider) a décidé / avait décidé de s’arrêter au stand de tir mais une fois la partie terminée, il (constater) constate / a constaté avec stupeur que l’enfant (disparaitre) avait disparu / disparaissait !
Affolé, il (se mettre) s’était mis / s’est mis à courir dans tous les sens en criant le nom du petit garçon. Quelques personnes l’(aider) avaient aidé / ont aidé, mais sans résultat.
Paniqué, l’homme (appeler) a appelé / avait appelé les secours qui (organiser) ont organisé / avaient organisé de nouvelles recherches.
C’(être) était / est auprès du clown aux ballons que le petit fugueur, effrayé par le bruit des carabines, (trouver) trouve / avait trouvé refuge !
L’enseignant(e) organise une mise en commun des réponses. L’oralisation permet aussi de mieux se rendre compte de la cohérence du texte obtenu.
1x exercices complémentaires ( -
1x évaluation
Objectif : Comprendre le sens d’un texte en distinguant les éléments qui composent un mot (préfixe, radical, suffixe).
Exercice 1a
Jeu de dominos
Matériel : Par duo : prévoir un jeu de dominos (voir annexe à télécharger) et au moins un dictionnaire.
Conseil : Veiller à équilibrer les duos afin que la recherche dans le dictionnaire ne constitue pas un frein au déroulement du jeu.
Le principe de ce jeu est probablement connu des élèves. Un bref rappel du déroulement sera effectué afin de s’en assurer.
Déroulement :
Mélanger les dominos et les distribuer entre les deux joueurs. Chaque joueur dispose ses dominos devant lui afin de pouvoir les lire aisément.
Le plus jeune débute la partie et pose un domino, au choix.
À son tour, l’autre joueur dépose un domino, à gauche ou à droite du premier, afin de former un mot.
Chacun joue à tour de rôle. Quand un joueur ne sait pas placer de domino, il passe son tour.
Le gagnant est le premier qui a tout déposé.
Remarque : À chaque mot formé, le joueur le lit et essaie d’en donner la signification. Le dictionnaire sera probablement un outil précieux pour vérifier l’existence du mot et son sens.
Suggestions :
Pour corser le jeu, l’enseignant(e) peut imposer de passer le tour si une proposition de mot se révèle erronée après vérification dans le dictionnaire.
Les groupes plus rapides peuvent refaire une partie ; ce sera l’autre joueur qui commencera.
Les duos peuvent aussi changer.
Exercice 1b
Les élèves écrivent les mots formés en faisant attention à l’orthographe.
Une fois le travail terminé, ils peuvent éventuellement mettre les préfixes en évidence en les coloriant.
Exercices 1c à 1f
Les élèves répondent aux questions.
Correction collective.
Exercice 2
L’enseignant(e) peut effectuer un exemple collectivement afin de s’assurer de la bonne compréhension de l’exercice.
Il/Elle fait remarquer qu’un même préfixe peut être utilisé plusieurs fois.
↘ 1. Avec ton voisin ou ta voisine, jouez une partie de dominos avec le jeu que vous avez reçu de votre enseignant(e).
→ a. Oralement, donnez la signification de chaque mot formé.
→ b. Recopie les mots que vous avez formés pendant cette partie.
→ c. Comment ces mots ont-ils été constitués ?
→ d. Quel est le rôle de la première partie ?
En assemblant deux éléments ; L’élément ajouté au début du mot de base
lui donne un autre sens. On forme donc un nouveau mot.
→ e. Quel est le terme qui désigne cet élément ?
Il s’agit du portrait qu’une personne a fait d’elle-même. X
un suffixe un préfixe un adverbe
→ f. Sachant que le préfixe « auto » signifie « soi-même », écris ce que signifie le mot « autoportrait ».
↘ 2. Écris le contraire des mots en utilisant un préfixe au choix parmi les propositions. dés- dé- in- im- ir- il- mal-
Mot de baseContraire de ce motMot de baseContraire de ce mot adresse mobile respect tolérance armer plaisant mortel justice légal avantage
aéroport bicyclette retrouver inhabituel antigel centimètre extraterrestre international maladresse irrespect désarmer immortel illégal immobile intolérance déplaisant injustice désavantage impoli déboucher préfabriqué malheureux anormal télécommande triangle multicolore autocollant désordonné irréel quadrupède en mettant un élément devant un mot qui existe...
↘ 3. Dans chaque série, entoure le mot qui n’est pas formé d’un radical et d’un préfixe
a. injuste inutile individu introuvable
b. milliardaire millimètre millilitre milligramme
c. prédire précuire préférer prévoir
d. trilingue tribunal tricolore tricycle
e. imprécis imprévu impossible important
↘ 4. Écris la solution de chaque devinette en utilisant un mot qui contient un préfixe.
Réponse
Chacune des deux moitiés du globe terrestre.
Se dit d’un mot dont la forme et l’orthographe ne changent jamais.
Se dit d’un animal sans colonne vertébrale.
Mesure de longueur de dix mètres.
Unité de masse équivalant à mille grammes.
↘ 5. Avec ton voisin ou ta voisine, jouez une partie avec le jeu de duos que vous avez reçu de votre enseignant(e).
→ a. Oralement, donnez la signification des mots formés.
→ b. Écris les mots que vous avez formés pendant cette partie.
camionnette africain irlandais acceptable distributeur franchise arrosoir autrichien élevage renardeau musical tremblement suédoise prudence muret mystérieux
→ c. Comment ces mots ont-ils été formés ?
En assemblant deux éléments ; en plaçant un élément derrière un mot qui existe. hémisphère invariable invertébré décamètre kilogramme
Cet exercice peut poser problème. Il ne faut donc pas hésiter à effectuer un exemple avec les élèves avant de se mettre au travail.
Les élèves observent les mots de la première ligne et mettent en place une méthode pour trouver la réponse. Ils verbalisent leur réflexion.
Exemples : « injuste » : « in » est un préfixe pour marquer le contraire de « juste ».
« individu » : « in » n’est pas un préfixe car cela ne veut pas dire le contraire de « dividu » ; d’ailleurs, ce mot n’existe pas.
Les élèves effectuent l’exercice.
Piste de différenciation : Donner le préfixe à utiliser pour les trois premiers mots. (Les deux derniers font référence au cours de grandeurs et doivent être connus des élèves.
Éventuellement, les référents mathématiques peuvent être utilisés.)
a. Chacune des deux moitiés du globe terrestre. hémi
b. Se dit d’un mot dont la forme et l’orthographe ne changent jamais. in
c. Se dit d’un animal sans colonne vertébrale. in
d. Mesure de longueur de dix mètres. (voir grandeurs)
e. Unité de masse équivalant à mille grammes. (voir grandeurs)
Exercice 5a
Le jeu des paires
Matériel : Par duo : prévoir un jeu et au moins un dictionnaire.
La règle de ce jeu est probablement connue des élèves.
L’enseignant(e) en effectue un bref rappel.
Retourner les cartes, faces cachées, en plaçant les rectangles à gauche et les carrés à droite.
Le joueur le plus âgé commence.
Tour à tour, chaque joueur retourne deux cartes (une rectangulaire et une carrée).
S’il est possible de former un mot, le joueur prend les deux cartes et obtient un point.
Si ce n’est pas possible, le joueur les redépose, face cachée, au même endroit.
Le gagnant est celui qui aura réalisé le plus de « paires » en fin de partie.
Remarque : À chaque mot formé, le joueur le lit et essaie d’en donner la signification. Le dictionnaire sera probablement un outil précieux pour vérifier l’existence du mot et son sens.
Attention : Mettre en évidence l’importance de la mémoire visuelle. Il faut essayer de retenir l’emplacement des cartes qui peuvent être utiles.
1x annexe « Jeu de dominos »
Exercice 5b
Les élèves notent les mots formés en portant une attention particulière à l’orthographe. Ils peuvent mettre les suffixes en évidence en les coloriant.
Exercices 5c à 5f
Les élèves répondent aux questions.
Correction collective.
Exercice 6
L’enseignant(e) encourage l’utilisation du dictionnaire, si nécessaire. Piste de différenciation : Proposer aux élèves de rechercher d’abord le nom masculin. Donner les différents suffixes qui seront utiles : AIN – IEN – AIS – OIS
Remarque : Attirer l’attention sur la nécessité d’écrire des majuscules car ces noms désignent des personnes.
Suggestion : Pourquoi ne pas profiter de cet exercice pour rappeler la différence entre « Je suis allé dans un restaurant japonais. » (adjectif, donc pas de majuscule) et « Les Japonais ont organisé les Jeux Olympiques. » (nom, donc majuscule) ?
Exercice 8
Cet exercice ressemble à l’exercice 3. Les élèves peuvent donc y retourner afin d’établir des analogies dans les consignes.
→ d. Quel est le rôle de l’élément placé à la fin ?
Il donne un autre sens au mot.
→ e. Quel terme désigne cet élément ? Coche ton choix.
un préfixe un adverbe un suffixe
→ f. Sachant que le suffixe « able » signifie « qui peut être », écris la signification du mot « recyclable ».
Cela signifie « Qui peut être recyclé ».
↘ 6. Choisis le suffixe adéquat et écris les noms qui désignent un habitant et une habitante de :
Bruxelles
Bruxellois, Bruxelloise
Italie
Italien, Italienne
Paris Chine
Marseille
↘
Parisien, Parisienne
Marseillais, Marseillaise
Mexique
Chinois, Chinoise
Mexicain, Mexicaine
Liégeois, Liégeoise
Liège Pakistan
Pakistanais, Pakistanaise
7. Écris le nom dérivé des verbes suivants en utilisant un suffixe. blesser → évoluer → changer → comprendre → balayer → coudre →
la blessure
l’évolution le changement la couture le balayage la compréhension
↘ 8. Entoure le mot de chaque série qui ne possède pas de suffixe
a. promenade noyade salade embrassade
b. regrettable étable jetable vendable
c. allumette fillette camionnette clochette
d. pommier cerisier poirier panier
Il est utile de reconnaitre un mot dérivé :
- pour découvrir son sens
Exemple : Ce que vous dites est invérifiable.
Même si tu ne connais pas le mot invérifiable, tu peux trouver son sens en l'analysant:
Préfixe signifiant Base venant du suffixe signifiant « le contraire » verbe vérifier « qui peut être » In + vérifi + able
- pour pouvoir l’orthographier
Exemple : Tu veux écrire un nouveau mot : japonais.
Tu sais que le suffixe « ais » désigne un habitant de...
Il te suffit donc de combiner Japon + ais → Japonais
... avec un préfixe :
préfixe + mot de base → mot dérivé
anti + vol → antivol dé + faire → défaire
... avec un suffixe :
mot de base + suffixe → mot dérivé jardin + age → jardinage gourmand + ise → gourmandise
Mots dérivés formés..
... avec un préfixe et un suffixe :
préfixe + mot de base + suffixe → mot dérivé im + précis + ion → imprécision ré + chauff(er) + ment → réchauffement
Synthèse : Les élèves lisent la carte mentale proposée, puis referment le livre-cahier.
Les élèves réexpriment ce qui a été lu et compris.
1x exercices complémentaires ( - -
1x évaluation
Avant d’ouvrir le livre-cahier, l’enseignant(e) demande aux élèves de rappeler la mission qui leur est demandée dans ce chapitre.
Les élèves réexpriment la mission qui avait été découverte.
Ils rappellent également les éléments du dessin qui leur serviront à rédiger les différents points du fait divers.
L’enseignant(e) insiste sur le fait que la fin (la conséquence) du fait divers n’apparait pas sur le dessin et doit donc être imaginée par chacun pour terminer le texte.
L’enseignant(e) invite les élèves à citer les outils de la langue qui ont été travaillés afin d’enrichir leur production.
Les élèves ouvrent leur livre-cahier et relisent la mission.
À toi ! Rédige un fait divers au départ de cette image.
↘ Ma première production
Rédige le brouillon de ton article sur une feuille à part. Vérifie que tu as bien fait attention à tous les éléments repris dans la grille de la page suivante.
↘ Ma production finale
Lis attentivement les remarques notées sur la fiche d’évaluation. Corrige, améliore ton travail, puis recopie-le soigneusement.






↘ Colorie les cases selon ton niveau de maitrise :
Je maitrise. Je ne maitrise pas encore suffisamment. J’ai besoin d’aide. Je dois m’exercer
Moi Mon enseignant(e)
Mon texte contient les éléments qui caractérisent un fait divers :
-Un titre accrocheur
-Les réponses aux questions : Quoi ? Quand ? Où ?
Qui ? Pourquoi ?
-Le résultat, les conséquences
J’ai ponctué mon texte.
J’ai utilisé les temps adéquats.
Mes participes passés sont correctement orthographiés.
J’ai été attentif(-ve) à l’orthographe.
Les critères proposés reprennent l’ensemble des notions abordées dans ce chapitre. L’enseignant(e) est libre de faire ajouter au groupe classe en entier ou à des élèves individuellement des notions auxquelles l’élève ou les élèves doit ou doivent également être attentif(s).
En début d’activité, il peut être intéressant de faire construire la grille d’évaluation par les élèves (livre fermé). Ceux-ci doivent faire appel aux notions étudiées ainsi qu’au contenu de la mission présentée en début de chapitre.
La manière d’évaluer la production finale est laissée à l’appréciation de chacun (couleurs, lettres, points et répartition de ceux-ci, émoticônes…).