BatiMag
CONSTRUIRE, RÉNOVER, EMBELLIR
Numéro5
Bois : ressource naturelle renouvelable
Écomatériaux : Quels sont-ils ?

Sargasses, comment valoriser ?
Le François, commune en pleine transition


















































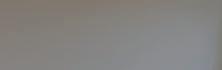





CONSTRUIRE, RÉNOVER, EMBELLIR
Numéro5
Bois : ressource naturelle renouvelable
Écomatériaux : Quels sont-ils ?

Sargasses, comment valoriser ?
Le François, commune en pleine transition


















































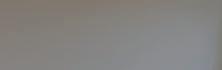




Ce numéro du BatiMag97 a pris l’air de son temps.
Les enjeux énergétiques, la diminution des ressources, la valorisation de déchets sont autant de sujets qui concernent directement le secteur du bâtiment. Heureusement, des stratégies ne cessent de se dessiner en vue d’améliorer l’empreinte environnementale de la construction.
BatiMag97 s’est penché sur quelques-unes d’entre elles, encouragées par des initiatives locales. C’est ce que contiennent les dossiers sur les écomatériaux, la valorisation des sargasses, les études de la qualité de l’air…
BatiMag97 a aussi donné la parole à ceux qui y participent activement, les prescripteurs, les architectes… Ainsi que ceux qui tracent l’avenir de leur ville, comme le maire du François qui a détaillé les nombreux projets de sa commune.
Conscient de toujours vivre une période de charnière, le BatiMag97 tente aussi d’analyser les marchés, les importations de matières premières en interrogeant les experts.

Depuis cinq ans, l’intention du BatiMag97 est de relayer un maximum d’informations et de devenir porte-parole de ceux qui négocient les virages pour bâtir la Martinique de demain.
N’hésitez donc pas, chers lecteurs, à nous faire part de vos projets, objectifs ou actualités. Le magazine se fera un plaisir d’en faire écho dans ses prochains numéros.
La rédaction
BatiMag97 est une publication de la société Media55
Directeurs de la publication
Pascal Frémont : contact@batimag97.com
Salim Mirous : media55.commercial@gmail.com
Régie publicitaire
Martinique :
Pascal Frémont - 0696 81 31 33 - contact@batimag97.com
Guadeloupe et Guyane :
Salim Mirous 0690 06 96 65 - salimmirous@batimag97.com
Rédaction : Marlène François - Adeline Louault Pron (Guyane) -
Valérie Esnault (Guadeloupe)
Conception et réalisation : BatiMag97
Conception des publicités : Frédéric Lemaire
Photographes : Hugues Moray (Martinique)Bruno Michaux Vignes (Guadeloupe) - Jody Amiet (Guyane)
Couverture : Hugues Moray
Impression : Graficas Monterreina Cabo de Gata, 1-3 - 28320 - Pinto - Madrid, Espagne
Suivez-nous sur batimag97.com
ISSN 2779-2587 - La reproduction d’articles et illustrations édités par BatiMag97, même partielle, est interdite.


MESURER
124 Projet Corsair : Étude de corrosion des métaux par les sargasses
PRÉVOIR
132 Agenda des salons
DÉCOUVRIR
140 Les nouveautés
144 Le PVC
147 Les toitures tropicales
AVANCER
154 Écomatériaux : matériaux géosourcés
162 Ayembao : nouveau matériau
170 Great Place to work
176 Écomatériaux : matériaux biosourcés
186 L’amiante, roche naturelle fibreuse

ENCOURAGER
192 La fibre de bananier
TESTER
204 La qualité de l’air dans les bâtiments
INNOVER
224 Travaux d’extension de l’aéroport

L’Agence Française de Développement (AFD) de Fort-de-France et la société́ Renko, filiale de Systeko, ont signé́ une convention pour le financement, à hauteur de 5 millions d’euros, d’un projet de construction et d’exploitation d’environ cent centrales photovoltaïques sur toitures, en Guadeloupe, en Guyane et en Martinique. Ces installations permettront de produire 5.7MWc par an et répondront ainsi aux besoins de consommation électrique de 1900 foyers ultramarins. L’AFD confirme ainsi son engagement pour la transition énergétique dans la région en finançant ce nouveau projet vertueux porté par un acteur local.
Datant de 1870, le centre hospitalier actuel en état de vétusté avancé n’est plus à même de fournir des soins de qualité optimale. C’est donc un tout nouvel hôpital qui devrait remplacer le centre hospitalier du SaintEsprit. En effet, la mairie a mis à disposition un terrain de 3 hectares pour édifier le bâtiment. 17,3 millions d’euros ont été débloqués par l’Agence Régionale de Santé, fonds basés sur les financements des plans de relance de l’Etat et les fonds d’intervention régionaux. Ces fonds sont valables jusqu’en juin 2022, une incitation à agir rapidement pour lancer les travaux, qui devraient durer 4 ans.

Au François, Orange va déployer la fibre optique jusqu’aux logements d’ici 2023. A ce jour plus de 100 prises sont déjà commercialisables, et les prévisions pour fin août sont de 900 prises. Ce déploiement est en parfaite complémentarité avec celui du Réseau d’Initiative Publique de la Collectivité de Martinique, Martinique THD. En effet, la commune sera desservie par 2 réseaux, dont le déploiement du FttH. La Ville du François a obtenu l’engagement de la Direction Filière Numériques de la CTM pour l’accompagner dans le pilotage de cette convention. Ce nouveau réseau est fiable, sans coupure et sans baisse de débit via une technologie FttH.

En recherche de main d’œuvre, la fédération française du bâtiment a signé une convention de partenariat avec Pôle emploi en juillet dernier au Fort Saint-Louis afin de donner plus de visibilité aux métiers du BTP et enclencher de plus amples recrutements dans ce secteur.
Avec cette convention, les deux partenaires espèrent apporter de la visibilité aux métiers du bâtiment qui peinent à recruter. Hervé Etilé, président de la fédération française du bâtiment, souhaite ainsi recruter une nouvelle main d’œuvre, qui fait défaut au secteur.
Le programme de rénovation urbaine de Fort-deFrance se poursuit avec le projet de construction d’un habitat collectif social de 56 logements situés sur l’ilôt « Béro » de Terres-Sainville, venant compléter l’ensemble immobilier existant. Il s’agit de la 2è phase du projet mené par la SIMAR et la ville. Les travaux s’étendront sur 2000 m2, ils nécessitent la reprise en propriété par la ville de plusieurs logements. Début des travaux 2025 jusqu’en 2027. Des travaux au long cours car il faut maîtriser des bâtis anciens pour mieux les reconstruire après démolition. Le budget s’élève à 8 millions portés par la Simar et la caisse des dépôts et consignations.

Voilà plus de 7 ans qu’Arnaud Calixte a mis ses connaissances de l’architecture lumineuse et de l’éclairage au cœur des trois enseignes Flashing LED. Assurée d’une équipe experte et confortée par une sélection de produits originaux, l’entreprise répond aux professionnels et aux particuliers avec des solutions d’ambiance lumineuse intérieures et extérieures personnalisées et très stylées.

Sainte-Marie, le troisième magasin Comme à Fort-de-France et à Ducos, le magasin de Sainte-Marie rassemble ce que l’éclairage comprend de plus novateur (lampes, suspensions, appliques, lustres, plafonniers, spots, rubans, LED). Des produits de qualité associés à de grandes marques qui autorisent la conception d’éclairages originaux.
Des concepts jusqu’aux réalisations Flashing LED s’est taillé une réputation d’expert. Les compétences et l’expérience de ses collaborateurs permettent de conseiller, d’accompagner tous les projets d’études d’éclairage et de suivre les chantiers les plus audacieux. Ainsi, de l’édition de plans à l’implantation et à la distribution de l’éclairage (en y incluant une simulation 3D de la mise en lumière et du rendu lumineux), Flashing Led fournit des concepts sur mesure en réponse à des demandes très spécifiques. Des exemples ? L’éclairage des installations de la Ligue de tennis, la nouvelle architecture lumineuse des studios ATV... Et régulièrement, l’entreprise travaille sur les mises en lumière de boutiques de mode ou de showrooms automobiles.
L’éclairage, un élément de décoration

Se servir de l’éclairage comme élément de décoration représente un pari relevé chaque jour par Flashing Led qui reste au service de particuliers souhaitant mettre en valeur une architecture ou un intérieur. Et ce, en modulant des volumes, en créant des effets d’ombre et de lumière ou tout simplement, en mettant un objet en évidence. Une jolie et vaste sélection de luminaires originaux en magasin assure la création de décorations harmonieuses de jour, sublimées la nuit. De plus, la boutique propose un rayon solaire où les lanternes, cordons, guirlandes, spots sont autant d’idées qui magnifient une architecture et créent une ambiance extérieure harmonieuse.


accompagner tous
d’études
ment sur des offres d’activités sportives, nautiques, patrimoniales et culturelles. Aussi, la commune souhaite-t-elle mettre en place une signalétique touristique pour dynamiser la découverte du territoire.
L’ancien Lagoon Resort se transforme en résidence hôtelière. Les services de l’urbanisme au François ont confirmé être en possession d’une dizaine de déclarations d’intention d’aliéner (DIA). Formalité imposée à tout propriétaire qui souhaite vendre un bien immobilier situé sur une zone de préemption. Le propriétaire a gardé quelques logements, mais il s’est entouré d’autres partenaires qui ont fait l’acquisition de suites ou de bungalows.

Ce concept renforce l’attractivité de la commune. Et les Villas du Lagon ne seront pas les seules à étoffer l’offre d’hébergement au François. L’ancien hôtel/restaurant la Riviera prépare sa renaissance.
Des demandes d’autorisations de travaux ont été récemment déposées pour le site. Les acquéreurs ont présenté leur ambitieux projet au maire du François, Samuel Tavernier. Ce nouveau projet comporte l’ambition de monter un 4 étoiles en lieu et place de l’ancienne Riviera. Des travaux d’envergure démarreront l’an prochain.
L’ouverture de ce nouvel établissement hôtelier est prévue pour 2023.
L’Agence Française de Développement (AFD) signe une convention de prêt de financement pour la commune des Trois-Ilets en faveur du développement du tourisme, grâce notamment au fonds de financement européen FEDER.
Les Trois-Ilets, commune parmi les plus touristiques de la Martinique, a axé sa stratégie de développe-
Le prêt de préfinancement octroyé par l’AFD, évalué à 674.000€, permettra d’instaurer un repérage sur l’ensemble du territoire avec pour objectif de guider les visiteurs grâce à des informations et des marquages de départs des sentiers. De quoi aider les acteurs économiques à gagner en visibilité.
En novembre dernier, CERQUAL Qualitel Certification, organisme certificateur de l’Association QUALITEL, a annoncé le déploiement de la marque NF Habitat – NF Habitat HQE en Guadeloupe, sous le haut patronage de la mairie de Pointe-à-Pitre. Cette certification est accessible aux professionnels du logement collectif en construction de l’archipel. Elle répond à un objectif central : offrir aux habitants un logement associant qualité de vie, respect de l’environnement et performance économique.
Le référentiel a été adapté aux contraintes de la construction, spécificités techniques et économiques locales, en collaboration avec les acteurs du territoire : bailleurs publics et privés, architectes, fédérations professionnelles, bureaux d’études, contrôleurs techniques et institutionnels. Objectif : valoriser les meilleures pratiques guadeloupéennes, tant sur le choix des matériaux que sur la conception bioclimatique, tout en apportant des réponses concrètes aux contraintes spécifiques du territoire. C’est la seule certification couvrant l’ensemble des critères constitutifs de la qualité globale d’un logement : confort hygrothermique et acoustique, luminosité, qualité de l’air, sécurité, maîtrise des charges et des consommations, etc.


Ainsi par exemple, le référentiel en vigueur en Guadeloupe intègre :

- l’amélioration des facteurs solaires, présence de brasseurs d’air ou d’attentes, logements traversants, qualité des capteurs solaires thermiques ou photovoltaïques, etc.
- un ensemble d’exigences liées à la performance des menuiseries, des occultations, des éléments de façades et de l’étanchéité des toitures.
- le respect de l’environnement en prenant en compte la topographie du terrain, le maintien des plantations existantes ou la présence d’une végétalisation adaptée.
- l’optimisation de la qualité des parties communes et des logements en termes d’intimité des logements, d’éclairage naturel, d’adaptabilité au vieillissement de la population.
Pour un montant de 50 000 €, un bâtiment du Camp Dugommier géré par le Ministère des Armées à la Jaille (Baie-Mahault), a par exemple bénéficié de la réfection complète de sa toiture en 2021. Cette réalisation a permis un remplacement des tôles et de l’isolation de sorte à amenuiser les pertes thermiques. A Saint-Martin, où le passage de l’ouragan Irma a laissé des traces, les travaux de construction d’un site interministériel innovant ont débuté en mars 2021. Le site regroupera de multiples services de l’État - Ministère de la Justice, Préfecture, services issus de la réforme territoriale, Rectorat, Douanes, Police -ainsi que l’ARS, l’OFII, l’INRAP et Le Conservatoire du Littoral. Les nouvelles constructions aux normes para-cycloniques et parasismiques répondront aux objectifs de transition énergétique et environnementaux (réduction de la consommation énergétique de 60% d’ici 2050) et seront entièrement financées par le plan France Relance.
En 2021, le Gouvernement s’est engagé dans un programme de rénovation thermique des bâtiments de l’État et de ses établissements publics. Ces opérations doivent bénéficier aux acteurs de la construction du territoire et participer à la relance de l’économie locale. Les 28 opérations d’investissement réparties dans 8 communes de l’archipel et dans la collectivité de Saint-Martin pour un montant total de plus de 44 millions d’euros ont débuté en 2021 et devront être achevées fin 2023.
Les dossiers concernent à la fois des bureaux, des logements et des espaces dédiés à l’enseignement supérieur, notamment la rénovation thermique des bâtiments de l’UAG, du CIRAD, de l’INRAE, du CROUS, de l’Aviation Civile, de la Cour d’Appel…
France Relance : 28 projets retenus en Guadeloupe et à Saint-Martin pour la rénovation énergétique des bâtiments publics de l’État pour soutenir l’économie localeCROUS et UAG
Réélue en novembre par ses pairs, Carine Sinaï-Bossou est aux commandes de la CCI jusqu’en 2026. Parmi la foule de dossiers à porter, trois chantiers ont été identifiés comme prioritaires par la nouvelle équipe : la ZAC de Dégrad-des-Cannes, «un axe de développement stratégique pour l’économie guyanaise» qui, avec ses 72 hectares, offrira de nouvelles perspectives de développement aux entreprises du territoire ; le renouvellement de la concession de l’aéroport Félix Eboué avec la présentation d’une offre de gestion associant des entrepreneurs locaux, la CCI et la CTG ; le renforcement de la formation professionnelle.
Lancée en août 2020 cette cité scolaire se compose d’un collège et d’un lycée qui sortiront de terre d’ici décembre 2022. Abritant une filière générale et une filière technologique, le lycée pourra accueillir 765 élèves tandis que le collège en recevra 680. Une section SEGPA de 80 élèves et un internat de 140 places sont également prévus.

Ce projet de 67 millions d’euros accueillera également, dès la rentrée 2023 : Un réfectoire pouvant servir 1200 repas par jour, Un complexe sportif des infrastructures sportives multidisciplinaires ainsi que des logements de fonction. Cet établissement permettra la scolarisation des jeunes de l’Est guyanais à proximité de leur lieu de résidence. Jusqu’à présent, les élèves de Régina, Saint-Georges ou encore Camopi devaient se déplacer à Cayenne pour poursuivre leurs études au lycée.
C’est l’un des lycées le plus attendus, le lycée de Maripasoula d’une capacité d’accueil de 825 élèves, avec son hall sportif, des logements de fonction et son internat de 80 places. Son chantier a démarré en août 2020, alors que la pose de la première pierre, en présence de l’ancienne Ministre des Outre-mer Annick Girardin, avait eu lieu en novembre 2019. Autre lycée dans l’Ouest, celui de Saint-Laurent de Maroni, c’est le quatrième qui sera construit sur la commune. C’est d’ailleurs le plus grand de toute la liste, pouvant accueillir plus de 1000 élèves, son chantier a débuté en avril 2020. Tout comme celui du lycée de Macouria. Un établissement qui accueillera plus de 885 élèves, avec 100 places en internat. Et enfin, il reste le chantier du lycée de Matoury qui sera finalement implanté quartier Copaya. Les ouvertures de ces nouveaux établissements sont pour la plupart prévues pour les rentrées 2023 et 2024.
SOCAUMAR SAS distribue, entre autres, des véhicules utilitaires légers et industriels MERCEDES-BENZ ET FUSO. FUSO est une marque appartenant à Daimler dont la gamme de véhicules industriels s’étend sur les segments de 3.5 à 8.5 tonnes.

La réponse aux exigences de toutes les professions Avec sa large gamme de solutions carrossées (bennes, grues, appareils à bras, bennes à ordures ménagères, caisses frigorifiques, caisses sèches, hydrocureuses…), Socaumar répond sur mesure à toutes les attentes. Des spécialistes en véhicules utilitaires configurent des modèles selon les exigences propres à divers secteurs : livraison (frigorifique ou sec), BTP, espaces verts, voiries). En réalisant des utilitaires efficaces reconnus pour leur robustesse, leur polyvalence et leur technologie, Mercedes-Benz et Fuso deviennent vos partenaires.
Des commerciaux à l’écoute Formés et certifiés par Daimler, les commerciaux Mercedes-Benz et Fuso détiennent toute l’expertise afin de traiter des requêtes spécifiques aux véhicules utilitaires légers et industriels et apporter des solutions appropriées.
Le VITO Mixto, le remplaçant fiscal du pick-up double cabine
Avec ses 5 ou 6 places et son espace de chargement, le VITO Mixto est la solution qui combine transport de personnes, transmission 4x4 et véhicule « défiscalisable » sans TVS.
Citan, utilitaire léger aux multiples possibilités
Dimensions extérieures compactes, espace intérieur généreux, ergonomie, le nouveau Citan est taillé pour transporter dans un confort exceptionnel. Doté d’aides à la conduite, et à la sécurité, d’un système multimédia MBUX et de solutions de connectivité intelligentes, il se décline en 3 motorisations thermiques et électriques. Configurable pour le transport de personnes.
Service après-vente
Les contrats services de Socaumar Sas permettent de budgétiser le coût de détention d’un véhicule (utilitaire, industriel et Fuso) sur 36, 48 et 60 mois. Trois types de contrats existent : extension de garantie, contrat de maintenance et contrat complet. Les clients utilitaires et camions bénéficient d’une réception et d’un atelier dédié.
Large gamme de véhicules disponibles en Martinique.
Socaumar, distributeur et réparateur agréé de Fuso, Mercedes Benz et Mercedes Benz Trucks




La signalétique d’entrée de ville de Rémire-Montjoly située au carrefour de Suzini a été intégralement repensée par la Municipalité pour laisser place à un nouvel ouvrage. L’objectif est de marquer le cinquantenaire de la commune et de mettre en valeur son identité. Une fabrication de 18 m de long réalisée par l’artiste Abel Adonaï et son équipe avec le concours des services techniques municipaux a été inaugurée en octobre.

Installées sur un socle en béton, les armoiries et 14 lettres blanches au format XXL affichant le nom de la ville se dressent fièrement à l’entrée historique de Rémire-Montjoly, première voie d’accès pour se rendre dans la commune.
A travers cet outil de communication, la municipalité souhaite valoriser l’identité et l’image de sa ville, ses atouts touristiques et son patrimoine culturel. «L’am-

De Macouria au nord à Roura au sud, en passant par Matoury, Cayenne et Rémire-Montjoly, le trait de côte s’étire sur 70 km de long. La CACL avec l’appui du Conservatoire du Littoral lance un projet de sentier d’écotourisme sur ces rivages parfois difficiles d’accès
bition que nous avons de faire de Rémire-Montjoly une ville d’art et de culture passe par cette signalétique», a déclaré le maire. Ces travaux de valorisation des signalétiques vont se poursuivre dans d’autres secteurs de ville, normalement au rond-point Adélaide Tablon et sur la plage de Gosselin. et vierges. Son aménagement devrait permettre aux habitants comme aux touristes de découvrir la richesse faunistique et biologique qu’il recèle. Cette initiative, inscrite dans le cadre du plan de relance et conduite par le Cerema, opérateur public de l’opération, a été récompensée par une subvention de 240 000 € pour une étude estimée à 300 000 €. La phase opérationnelle d’aménagement pourrait démarrer début 2023.
Avec cette campagne d’études et de travaux financés par «France Relance», l’État veut permettre de finaliser l’ouverture de tronçons manquants et de restaurer ceux qui doivent l’être pour des raisons de sécurité d’usage et de banalisation d’espaces dégradés. Les buts de cette opération sont l’accès libre et gratuit à des paysages «vue sur mer» époustouflants et la découverte du patrimoine culturel et naturel de nos littoraux.
Il s’agit de la plus grande installation photovoltaïque urbaine d’Europe.
La plus grande installation photovoltaïque en milieu urbain de d’Europe a été inaugurée le 12 octobre dernier aux Abattoirs d’Anderlecht en Belgique sous le projet SolarMarket. Désormais dotée de plus de 5.800 panneaux solaires, la toiture de l’édifice devrait produire annuellement 1.653 MWh.
La toiture du bâtiment des halles des Abattoirs d’Anderlecht a ainsi bénéficié d’un projet de réno-
Des dirigeables pour résoudre les problèmes de logistique et d’enclavement
La CTG et Flying Whales, société française à l’origine du grand programme industriel LCA60T (pour aéronef à grande capacité/large capacity airship) destiné au transport de charges lourdes, entament une collaboration afin d’étudier le déploiement et l’utilisation du transport cargo par ballons dirigeables sur le territoire guyanais. Cette étude, menée sur 3 ans, prendra en compte tous les aspects de l’implantation de ce moyen de transport à haut potentiel en Guyane.
L’équivalent d’un très gros camion-remorque Avec sa capacité d’emport de 60 tonnes, son gabarit de 200 m de long sur 50 m de diamètre et sa soute longue de 96 m, le LCA60T représenterait l’équi-
vation ambitieux et accueille désormais un parc solaire de 12.000 m2. Près de 30 % de l’énergie ainsi produite sera utilisée par les Abattoirs, tandis que le reste devrait être injecté dans le réseau au profit des entreprises bruxelloises. Ce projet ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le déploiement du photovoltaïque en Région bruxelloise afin d’atteindre les objectifs climatiques que nous nous sommes fixés, une région neutre en carbone d’ici 2050.
valent d’un très gros camion remorque. Innovant et propre, il n’utilisera pas d’hydrocarbure mais de l’hélium et de l’électricité. Ce dirigeable à propulsion hybride – et bientôt entièrement électrique grâce à une pile à combustible – aura une faible empreinte environnementale (jusqu’à 30 fois moins d’énergie consommée qu’un hélicoptère par rapport au poids transporté), couplée à un faible coût d’exploitation en comparaison des solutions existantes et du fait de la suppression des infrastructures de transport. Capable de vol stationnaire, il atteindra une vitesse de croisière de 120 km/h, avec un maximum à 150 km/h et pourra donc charger et décharger sans se poser marchandises, matériel ou matériaux.
Une opportunité économique et environnementale
Pour la Guyane, le transport de marchandises par dirigeable représente une opportunité économique et environnementale. La filière bois par exemple, y voit une solution pour éviter la création et l’entretien, tous deux extrêmement coûteux, de pistes forestières primaires et secondaires, ce qui aura un effet positif sur la compétitivité du secteur comme sur l’impact environnemental de ses activités.
Le projet Flying Whales est d’ailleurs né, en Métropole, après des discussions avec les dirigeants de l’ONF qui cherchaient à extraire davantage de bois des forêts sans avoir la capacité de le faire.
Des investisseurs poids lourds
Ces dirigeables rigides de transport de charges lourdes seront fabriqués à Laruscade dans le nord de la Gironde où est implantée la société innovante. La Région Nouvelle-Aquitaine détient d’ailleurs 30 % du capital de Flying Whales et le Québec, où va être construite une seconde unité de fabrication pour les Amériques, 25 %. On note aussi la présence au capital (25 %) d’Avic (Aviation Industry Corporation of China), concepteur et fournisseur d’avions de combat pour l’armée chinoise. En 2020, l’ONF, ADP, Bouygues et Air Liquide ont rejoint les bancs des actionnaires.
Un moyen de transport puissant, écologique et facile à mettre en œuvre. Le 1er vol est prévu en 2024 pour une commercialisation d’ici 2025.


sur l’autonomie, permet au lecteur d’assimiler les connaissances nécessaires au fil des leçons et de s’entraîner grâce aux tests d’auto-évaluation corrigés. D’excellents outils pédagogiques indispensables aux formations des métiers du bois.
Le tome 1 traite des fondamentaux : le bois et ses dérivés, les assemblages, les ouvrages de menuiserie. Il aborde également l’outillage et les différents produits à utiliser.
Le tome 2 traite des techniques : la fabrication (y compris placage et stratifié), la pose, la sécurité, les machines et leurs outils. Les techniques de fabrication et l’implantation des machines-outils.
3 tomes
Hors collection Dunod - parution août 2020
« Technologie des métiers du bois » s’adressent à ceux qui suivent une formation dans les métiers du bois (ébénisterie, menuiserie d’agencement et du bâtiment). La démarche claire, structurée et axée
Le tome 3 traite de conception, de fabrication et d’agencement : les documents de fabrication, les montages d’usinage, la conception de pièces cintrées et de panneaux moulés, la gestion de production. Il aborde également le confort de l’habitat (conforts thermique, acoustique, ventilation, éclairage…), la sécurité incendie et les techniques de pose des ouvrages. Ainsi que la gestion de production et CFAO. Gestion de l’ordonnancement. Coûts de fabrication. Qualité. Gestion des stocks. Maintenance. CFAO et commande numérique.

Collection Technique et ingénierie, Dunod – parution septembre 2021
Les énergies renouvelables ne se produisent pas de la même manière que les énergies classiques. Leur production est conditionnée par des éléments variables tels que le vent, l’eau ou le soleil. Aussi, l’intégration au réseau de l’électricité fournie par ces nouvelles énergies exige une réflexion approfondie. C’est ce que propose cet ouvrage qui aborde de manière détaillée :
• Les caractéristiques des générateurs classiques et des générateurs intermittents utilisant les énergies renouvelables.
• L’équilibre du réseau entre l’offre et la demande (incidence de l’introduction des énergies renouvelables sur le réseau et leur utilisation éventuelle pour faire face aux pics de consommation).
• Les méthodes de conversion des énergies renouvelables en électricité.
• Les systèmes de puissance.
• La privatisation de l’électricité et la création de nouveaux marchés, notamment l’électricité « verte ».
• Le développement des énergies renouvelables grâce aux progrès techniques.
• Les réseaux électriques de l’avenir, comme les réseaux de distribution actifs.
Edition mise à jour des derniers développements technologiques et économiques. Les ingénieurs, les techniciens en bureaux d’études dans le domaine de l’électricité mais aussi les personnes intéressées par l’environnement y trouveront un panorama complet des énergies renouvelables actuellement disponibles, de leur production à leur intégration, ainsi que des exemples concrets avec calculs théoriques et applications numériques.

Jean-Louis Gazzaniga, Xavier Larrouy-Castera, Jean-Paul Ourliac
Edition Lexis Nexis – parution avril 2021
« L’eau est l’élément le plus naturel de la vie, et sans elle il n’y a pas de vie. »
La ressource en eau a été longtemps considérée comme suffisante ou même inépuisable. Il s’agissait alors d’en organiser la disposition et de la relier à la propriété.
Depuis quelques décennies, l’homme a pris conscience que la ressource était rare et précieuse : l’eau est désormais un patrimoine commun dont la valeur est reconnue par tous. Ce que l’on appelle le droit de l’eau est, dans les faits, un ensemble de textes, reflets des préoccupations successives du législateur et des solutions qu’il a pu leur apporter. Cet ouvrage se propose de faciliter l’accès à une matière complexe. Il fait le point de la législation et de la réglementation, de la jurisprudence et de la pratique.
À ce titre, il intéresse les élus locaux et les administrations, les professionnels et les particuliers, les associations, et plus généralement l’ensemble des professionnels du droit (avocats, notaires, étudiants).

Sont abordés successivement :
– l’histoire et la politique de l’eau, en la replaçant dans le contexte européen ;
– le statut et le régime juridique de l’eau et des milieux aquatiques ;
– l’administration et la planification ;
– la police de l’eau ;
– les usages ;
– la gestion des risques et les inondations.
La quatrième édition de cet ouvrage intègre les réformes législatives et réglementaires récentes. Elle est à jour des textes publiés au 1er mars 2021.



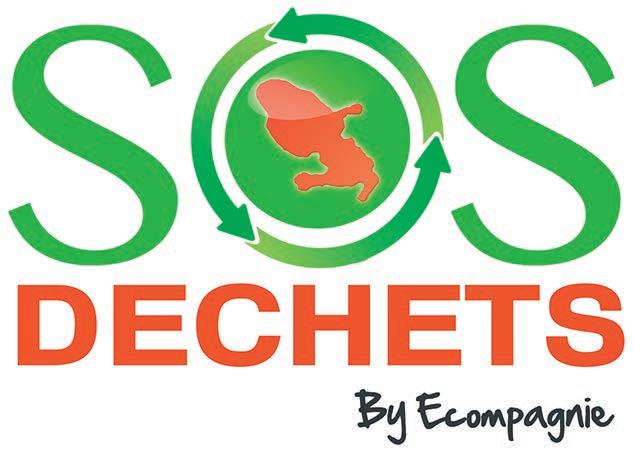

















BOULONNERIE INOX




















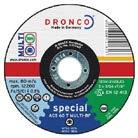




























BOULONNERIE ACIER


FIXATION
COLLIER










ABRASIF
CONSOMMABLE
PRODUITS INDUSTRIELS























ECLAIRAGE

























































































Une convention pluriannuelle a été signée pour trois ans - de 2020 à 2022 - entre la Chambre de Commerce et d’Industrie de Martinique (CCI) et l’Office De l’Eau (ODE). Elle vise à pallier les préoccupations de rareté et de qualité des eaux, et apporter aux professionnels un accompagnement technique et financier pour l’amélioration de la gestion de l’eau au sein de leurs activités économiques.

Quels sont les axes prioritaires ?
L’amélioration de la connaissance et des impacts des activités économiques sur l’eau et les milieux aquatiques et l’appui technique aux professionnels afin d’améliorer leurs pratiques.
Cela comprend la mise en place de moyens de communication et de sensibilisation sur les pratiques intelligentes et l’aide aux professionnels dans l’obtention de financements pour des projets visant à diminuer les impacts de leurs activités sur la ressource en eau.
Un certain nombre d’actions ont lieu :
- Sensibilisation des opérateurs touristiques sur la biodiversité avec la mise en place d’une opération « Qualité Tourisme » qui se traduit notamment - pour les opérateurs, restaurateurs, hôteliers… - par des ateliers de formation sous forme de visites terrain permettant aux professionnels de connaître les milieux aquatiques. Remise de livrets pédagogiques, organisation de webinaires…
- L’appel à projet « Economies d’eau pour les entreprises » qui constitue une aide pour les chefs d’entreprise dans leurs projets de récupération et d’utilisation des eaux pluviales, de mise en place d’équipements hydroéconomes, de réutilisation et recyclage des eaux de process et de sensibilisation des employés à cette problématique.
- En 2022, d’autres actions sont prévues, notamment une autre aide destinée aux entreprises du secteur de la restauration pour le prétraitement d’assainissement : la récupération des graisses. Il s’agit de les accompagner dans l’acquisition de bacs à graisse servant à séparer les graisses et huiles de l’eau avant leur passage dans les eaux d’assainissement. Une subvention de 75 % est accordée par l’ODE pour l’acquisition de bacs à graisse. La CCI Martinique réalise la mise en place et la promotion du dispositif, l’accompagnement des entreprises candidates pour le montage de leurs dossiers. Une action conjointe est menée pour le développement de la filière de récupération et valorisation des graisses et des huiles des restaurateurs.
À cet effet, une chargée de mission « eau et assainissement » a rejoint le pôle Environnement, Transition Énergétique et Développement Durable de la CCI qui, dans le cadre de la mise en œuvre de la convention, organise les actions de sensibilisation.
CCI Martinique

50 rue Ernest Deproge
Fort-de-France
martinique.cci.fr
De gauche à droite :
Mme Sarah JEAN-BAPTISTE
SIMONNE - Chargée de mission Déchets et Economie circulaire
Mme Maureen LUGIERY - Chargée de mission Eau et Assainissement
Mme Isabelle LISE - Responsable du Pôle Environnement, Transition Energétique et Développement
Durable - M. Philippe JEAN-ALEXISDirecteur de l’Aménagement du Territoire et des Agences
La Mission patrimoine (aussi appelée Mission Bern) a été confiée par le Président de la République à Stéphane Bern en septembre 2017 afin d’évaluer le patrimoine en péril et de trouver des moyens de financer la restauration des sites. Parmi eux, le Loto du Patrimoine. Pour 2021, un comité de sélection a désigné dix-huit sites emblématiques qui seront représentés sur les tickets de grattage Mission Patrimoine de la FDJ. Une centaine d’autres sites (dits de maillage) recevront aussi une aide financière de la mission.
Voici les sites sélectionnés pour les Antilles/Guyane :
- Villa Didier à Fort-de-France (Martinique)

- Moulin à vent de la sucrerie Roussel-Trianon à Marie-Galante (Guadeloupe)
- Cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)
- Musée Alexandre-Franconie à Cayenne (Guyane).
Villa Didier à Fort-de-France
Inscrite depuis 2015 à la liste des Monuments Historiques de Martinique, la villa Didier en est l’un des bâtiments les plus intéressants du courant moderniste sur l’île (1927-1968). Période d’invention d’un usage noble du béton armé, ce courant a marqué une rupture dans le paysage architectural existant. La Villa Didier est une grande bâtisse à composition symétrique autour d’une entrée et dotée d’un escalier monumental, d’un porche à auvent, surmonté d’une rotonde à l’étage. Les fenêtres sont ornées de clés en forme de consoles art-déco et la porte est décorée de ferronnerie aux motifs géométriques typiques.


L’état actuel
Fortement dégradée par les assauts du temps et du climat (absence d’étanchéité), cette bâtisse souffre d’une disparition totale de peinture, d’une corrosion des aciers, de l’éclatement des bétons, de l’attaque des termites, de menuiseries abîmées… Les réseaux électriques, d’eau et d’assainissement sont défectueux, vétustes et hors normes. Les sols intérieurs en carreaux de ciment ou granito sont descellés ou cassés par endroits.
Le projet
La villa, acquise en 2017 par un couple de jeunes Martiniquais, est composée de cinq unités de vie indépendantes, la partie centrale est devenue leur résidence principale, tandis que les quatre autres appartements seront destinés à une maison d’hôtes ou un gîte, mais aussi à l’accueil d’artistes en résidence sur l’île. Ils mettront à disposition de leurs hôtes une documentation sur l’architecture moderniste en Martinique grâce au recensement de l’ensemble du patrimoine bâti existant ou disparu de ce courant architectural.
Les travaux prévus
- Reprise des bétons et aciers endommagés (extérieur/intérieur)
- Étanchéité des toits et toits-terrasses
- Restauration des menuiseries et d’une partie des serrureries
- Reprise des dalles, sols et escaliers extérieurs et sols intérieurs
- Reprise du système d’évacuation des eaux pluviales
- Mise aux normes des réseaux (électricité, eau, assainissement)
- Destruction des rajouts postérieurs à la construction initiale
- Aménagement des espaces extérieurs et restauration des jardinières, murets en pierre et four à pain
- Renforcement du mur de soutènement en pierre L’ensemble des travaux de rénovation et de remise en état est estimé à 682 000 euros, 252 000 euros restent à financer.
Cette année, la Guadeloupe voit deux monuments sélectionnés par la Mission Bern.
Moulin à vent de la sucrerie
Roussel-Trianon à Marie-Galante
Construite sur l’emplacement de l’habitation sucrière Trianon (1669), la sucrerie Roussel-Trianon est fondée à la fin du XVIIIe siècle par son dernier propriétaire, Paul Botreau Roussel. Vers 1800, le moulin à bêtes est remplacé par un moulin à vent (un des plus beaux de l’île) pour le broyage de la canne à sucre. La modernisation du domaine est amorcée avec la construction d’une usine à vapeur dès 1845. Achevé vers 1860, le complexe sucrier sera même le premier aux Antilles à être équipé d’appareils à triple effet Derosne et Cail pour les opérations de cuite.
Le moulin à vent ne résistera pas au déclin de l’industrie sucrière et sera fermé en 1874, laissant des ruines riches de leur histoire.
Le projet
La finalité du projet est de faire de ce site un espace de culture, de loisirs, de récréation et de bien-être, structuré dans une approche d’écomusée vivant.
Le site tout entier est fortement dégradé par le climat et la végétation.
La globalité du site demande une réhabilitation. Cela suppose la restauration de ces vestiges patrimoniaux : Moulin à vent.
Les travaux de rénovation d’autres édifices sont hors Mission Bern.
Cathédrale St Pierre et St Paul à Pointe-à-Pitre
Le plus grand édifice religieux de Pointe-à-Pitre.

La cathédrale, construite en 1807, a été victime du tremblement de terre de 1843 mais a été reconstruite en 1867. Au fil des années, sa structure en bois a été remplacée par une ossature métallique plus résistante. C’est grâce à cela que l’édifice a pu résister aux nombreux cyclones et tremblements de terre qui ont ravagé la ville à plusieurs reprises. A l’intérieur, elle est remarquable par la hauteur de la nef et des colonnes aux chapiteaux néo-gothiques. Son maître autel en marbre de Carrare a été réalisé au XIXe siècle par les ateliers de maître Vincent Bonomi. L’édifice est classé au titre des monuments historiques depuis 1978.

La cathédrale est affectée au culte principalement mais d’autres pistes de valorisation future sont envisagées (certaines sont déjà mises en œuvre occasionnellement) telles que les concerts lyriques et l’ouverture à la visite, notamment lors de la saison des croisières. La restauration permettra d’organiser une exposition présentant l’édifice et les travaux envisagés, des conférences avec l’architecte et des ateliers pédagogiques en partenariat avec les établissements scolaires sur différentes thématiques : histoire de l’art et techniques de construction. Restaurée, la cathédrale sera intégrée à un circuit du patrimoine pointois.
> Suite page 40

Depuis plus de 25 ans, l’entreprise IDEA est spécialisée dans la fabrication d’armatures pour béton adaptées à notre territoire sensible aux aléas sismiques.

Sur plan ou sur-mesure, les produits sont confectionnés sur place, au Gros Morne.
IDEA est née de l’entreprise individuelle créée par Monsieur PIEJOS Léon en 1993, fort de son expérience et ses connaissances du métier. Entreprise 100% locale de plus d’une cinquantaine de salariés, IDEA réalise des armatures pour toute sorte d’ouvrages spécialement dédiés aux constructions parasismiques afin de limiter les dégâts causés par les séismes.

Les armatures béton
L’entreprise réalise le montage d’armatures béton sur plan ou sur mesure suivant les préconisations des BET (Bureau d’études) visant à respecter les normes de construction. De la fondation à la toiture, semelles, amorces, longrines, poteaux, chainages sont confectionnés dans nos ateliers au Gros-Morne. IDEA, c’est aussi la réalisation et la commercialisation de produits standards : Barres, chaînages verticaux, épingles, poteaux, poutres, étriers, treillis soudés, semelles filantes, toutes les armatures béton parasismiques pour les maisons individuelles, bâtiments, murs de soutènement, ouvrages d’art, confortements parasismiques.
Un service efficace de l’étude à la mise en œuvre À partir des plans du bureau d’études, le service technique d’IDEA composé de techniciens expérimentés, réalise le décorticage des plans pour la mise en fabrication aux ateliers, où des façonneurs-machinistes et des soudeurs qualifiés garantissent une production de qualité sous la supervision de chefs.
À la demande, IDEA assure les livraisons des commandes sur chantier, et ce sur toute la Martinique. Pour ce faire, des camions- grues et plateaux sont mis à disposition de la clientèle.
Au-delà de son expérience en fabrication, IDEA est également une référence dans la mise en œuvre des armatures réalisées dans ses ateliers. Une équipe spécialisée en pose intervient sur les chantiers. L’entreprise garantit des réalisations respectueuses des normes et conformes aux besoins. Les livraisons sont réalisées dans les délais prévus.
Les perspectives de développement Dans un souci de maintenir un haut niveau de qualité et d’améliorer ses performances en termes de productivité et de compétitivité, l’évolution d’IDEA se poursuit.
Un atelier additionnel a vu le jour tout récemment et des investissements en matériel de production et de servitude ont été réalisés en acquérant de nouvelles machines et engins ; notamment pour servir le secteur très exigeant de la confection de cages pour fondations profondes. Ce sont d’ailleurs des acquisitions qui permettent de répondre à la demande tant locale que régionale dans des délais record tout en en améliorant la qualité.
67 82 50

IDEA réalise des armatures pour toute sorte d’ouvrages spécialement dédiés aux constructions parasismiques afin de limiter les dégâts causés par les séismes



IDEA est également une référence dans la pose des armatures réalisées dans ses ateliers




L’état
On note de graves problèmes structurels sur la toiture, les murs gouttereaux, la structure métallique et les murs hauts, sans oublier les fenêtres hautes et basses. Les couvertures sont vétustes et leurs revêtements peints sont usés ou ont disparu. Des pannes de charpente sont corrodées. En façade, des chutes d’enduits, desquamations et fissures sont visibles. Les parements et fenêtres hautes sont infiltrés et les armatures laissent pénétrer les eaux pluviales. Des zones de corrosion sont visibles sur plusieurs ouvrages en fer - structurels (telles les bases des piles supports de la charpente métallique) ou décoratifs. Par ailleurs, l’absence d’isolant entraîne une température d’environ 50°C sur les tribunes et les accès sont dangereux, les marches présentant des fractures ponctuelles.
Les travaux
- Restauration et renforcement des charpentes
- Reprise de la toiture et des réseaux d’eaux pluviales
- Étaiements et mise en sécurité sismique
- Tranche 1 : travaux d’urgence
- Tranche 2 (hors Mission Bern) : travaux prioritaires
S’engagera ensuite une tranche de travaux (T3) de restauration générale de l’édifice, extérieure et intérieure.
Musée Alexandre-Franconie à Cayenne Immeuble bâti entre 1824 et 1842 par la famille Franconie.
En 1888, après la destruction du musée local de la Colonie lors de l’incendie de Cayenne, le gouverneur E. Mewart fit don du rez-de-chaussée de l’immeubleacheté par l’administration coloniale - à Paul Gustave Franconie, fils d’Alexandre Franconie. En octobre 1901 fut inauguré le nouveau musée qui reconstitue un microcosme, un concentré de la Guyane : des collections d’histoire naturelle au bagne, en passant par les monstres, l’artisanat amérindien, un tronc de palmier bifide, un pied bot boni créole, des maquettes, minéraux, tableaux historiques, etc.
En 1885 la bibliothèque prit le nom d’Alexandre Franconie en hommage à ce célèbre habitant. L’étage restait toutefois attribué à des services d’Etat. En 1946, le musée local devint le musée départemental.

Le musée est actuellement ouvert au public et les travaux ne devraient pas empêcher son ouverture. Ils permettront d’améliorer l’accueil des visiteurs.

La dernière phase de travaux d’envergure sur deux des trois ailes date de 1988. Les pathologies les plus préoccupantes sont localisées sur les ailes anciennes. L’absence d’entretien du réseau d’évacuation des eaux pluviales en toiture et des caniveaux au pied des édifices sont les principaux facteurs de désordres.


Les travaux
Une restauration générale de l’édifice est envisagée. Les travaux sont répartis en cinq phases. Certaines restitutions sont suggérées, comme la remise en place des ornementations des couvertures en tôles, ou encore les modénatures de façades telles que les bandeaux moulurés.
Compte tenu de l’état très préoccupant du petit édifice, une des ailes présente une réelle urgence. Les travaux peuvent être menés sans impacter l’activité de la bibliothèque et du musée, et comprendront également la reprise complète à neuf des réseaux fluides.
La Mission Patrimoine, soutenue par la Fondation pour le patrimoine, a aussi une liste de 100 projets de maillage pour 2021. Parmi eux, trois se situent aux Antilles/Guyane :



Guadeloupe
Maison Dubreuil, dite « des aînés » à Sainte-Claude Habitation ayant appartenu successivement à de grandes familles de notables jusqu’en 2017. L’objectif est d’y créer un lieu d’exposition, de rencontres et de transmission du patrimoine entre les différentes générations.
Martinique
Habitation Leyritz (Basse-Pointe)
Habitation d’environ 500 ha, l’une des plus importantes de l’île. Après la production de sucre, puis de rhum, elle fut transformée en hôtel-restaurant jusqu’à son abandon en 2007 à la suite de l’ouragan Dean. Objectif : en faire un lieu touristique avec parcours pédestre et sportif ou encore un musée.
Guyane
Ancienne maternité (Mana)
Bâtiment des années 1820-1830 qui requiert des travaux urgents. Envahi de végétation et fragilisé par les intempéries, il menace de s’effondrer sur la voie publique. L’objectif est d’y installer le futur Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de la ville.
• CUISINE
• DRESSING
• CHAMBRE




• BUREAU
• MEUBLE D’EXTERIEUR
•
0696 305 311

info@moltoohome.fr






Zone disponible : Martinique • Guadeloupe
• St-Martin
• St-Barth.
Le BTP martiniquais contraint de naviguer à vue en pleine tempête
Alors que 2022 s’annonçait comme l’année de la relance économique post-Covid par les activités du Bâtiment et des Travaux Publics, plusieurs nouvelles sont venues doucher l’optimisme naissant des entrepreneurs du secteur.
L’arrivée d’une nouvelle gouvernance aux affaires de la Collectivité territoriale de Martinique n’a pas encore produit les effets attendus. D’autres acheteurs publics tardent également à sortir leurs projets. Malgré des annonces récentes, les entreprises attendent toujours les appels d’offres dont elles ont à présent urgemment besoin. Tout cela n’est pas bon pour nos entreprises dont les carnets de commandes se vident.
Le conflit russo-ukrainien a provoqué une nouvelle flambée des prix des matériaux de construction. Les chantiers en cours pâtissent fortement de cette situation, totalement imprévue. Plus inquiétant encore, il faut désormais craindre que les affaires qui sortiront ne pourront supporter les conséquences de ces augmentations, rendant systématiquement les consultations infructueuses.
Enfin, même si ce n’est pas encore l’actualité brûlante, les entreprises appréhendent avec prudence et parfois avec méfiance, la future mise en place des réglementations RE2020
et économie circulaire pour les déchets du BTP. Les surcoûts engendrés par ces réglementations pourraient en effet encore ralentir les projets.
Il n’y aura pas d’issue apaisée et indolore à l’ensemble de ces problèmes sans le maintien à minima d’un dialogue permanent entre donneurs d’ordres, maitres d’œuvre et entrepreneurs.
Au-delà des entreprises elles-mêmes, dont nous avons besoin pour continuer à équiper notre pays Martinique, il faut surtout penser aux jeunes Martiniquais, qui étudiants ou apprentis dans des spécialités du BTP, qui collégiens ou lycéens en plein questionnement. Préserver les fondamentaux et le dynamisme du secteur doit avant tout permettre d’attirer vers nos métiers ces jeunes filles et ces jeunes hommes appelés à prendre un jour la relève.
C’est aussi ce défi spécifique qu’il nous faut relever ensemble.
Foss é kouraj pou manmay le BTP.
Par Steve PATOLE Président du Syndicat des Entrepreneurs en Bâtiment Travaux Publics et Annexes de Martinique (SEBTPAM)
Chaque métier est différent et votre entreprise évolue constamment : faites de votre Crafter Châssis un véhicule unique et spécialement conçu pour répondre à vos besoins. Découvrez toutes les combinaisons possibles pour personnaliser votre utilitaire notamment avec le Crafter benne et Caisse grand volume.
Pratique, innovant, se charge facilement. Charge utile allant jusqu’à 1 310 kg.
Avec son design remarquable, ses systèmes d’aide à la conduite dernier cri, son système d’infotainment innovant et son poste de conduite ergonomique, le Caddy Cargo incarne la fiabilité et la flexibilité de demain.
16 m3
Le groupe AJ2K, présent en Martinique depuis plus de quatre ans, comprend trois entités locales et une entreprise située dans l’Hexagone, EFPMI. Des entreprises indépendantes actives dans des domaines variés et qui travaillent exclusivement sous maîtrise d’œuvre ou avec des bureaux d’architecture.
BatiMag97 a rencontré le gérant, Julien Schrantz, qui détaille les domaines d’activités de ses entreprises.
Une entreprise intervient pour des travaux d’électricité industrielle, des installations électriques neuves (raccordements, branchements…), de la rénovation (mise aux normes, remplacements d’appareils, réaménagement…) et répond à des demandes en domotique (mise en place d’automatismes, équipements nouveaux, surveillance…).

Forte d’une expérience d’une dizaine d’années et dotée d’une équipe de douze électriciens qualifiés, l’entreprise maîtrise parfaitement les règles d’installation et les normes en vigueur aux Antilles. Elle garantit des installations électriques et domotiques fiables et sécurisées.
Une deuxième entité accomplit des travaux de plomberie et sanitaires, tant pour de nouvelles installations qu’en rénovation et installe des chauffe-eaux électriques. Ses quatre plombiers/installateurs aménagent également des salles de bains (robinetterie, carrelages, étanchéité, faïence, meubles…) et réalisent les raccordements au réseau (tuyauteries, canalisations…).
Enfin, une troisième entreprise spécialisée en menuiserie intérieure fournit et pose des placards, dressings, cloisons, portes et réalise de la menuiserie alu dans le cadre d’agencement de magasins, de restaurants (notamment pour la chaîne O’Tacos) et de villas. L’entreprise existe depuis une dizaine d’années et occupe quatre poseurs.

Certainement. Les trois entités proposent l’expertise de professionnels expérimentés qui veillent à fournir des prestations irréprochables. Toujours à l’écoute, ils accompagnent le client au fil des projets afin de répondre à toute attente, à toute demande, même complexe.
En un mot, le groupe AJ2K accorde beaucoup d’importance à la réussite de chaque projet et aime terminer un chantier avec la satisfaction du client.



AJ2K
ZI Petite Cocotte

Ducos

07 85 03 41 53 gestioncpc972@gmail.com




Pétrole, gaz, plastique, papier, bois, acier... Toutes ces matières premières subissent une poussée inflationniste qui affecte le monde entier. Et forcément les Antilles. Dans un premier temps, ce phénomène consécutif à la crise sanitaire a été accentué chez nous par le manque crucial de containers et donc, par une hausse des tarifs des coûts d’importation. En effet, la baisse d’activité due au premier confinement a entraîné une diminution spectaculaire des stocks, alors que la demande est revenue. Bref, l’offre ne suit plus les demandes, une situation qui se répercute sur les prix. Aujourd’hui, c’est la situation de guerre en Ukraine qui affole les marchés et les prix de certains matériaux de construction et c’est une bien mauvaise nouvelle pour le plan de relance économique qui s’appuie fortement sur le secteur de la construction.

Jean-Yves Bonnaire livre ses réflexions expertes sur ce sujet :
Encore une répercussion économique due dans un premier temps à la pandémie Covid 19 mondiale. L’une des conséquences les plus remarquées a été le fort ralentissement de certains secteurs économiques. Mais les perturbations liées à la chaîne d’approvisionnement en sont une autre qui montre combien la dépendance influence les échanges de marchandises entre les pays.
Ces perturbations touchent des marchandises diverses et parmi elles, les matériaux de construction. Elles sont souvent liées à l’arrêt brutal de la demande durant les premières périodes de confinement et parfois suivies par un retour tout aussi brutal de la demande.
La raréfaction des moyens de transport ou des restrictions d’accès aux infrastructures a également été un des facteurs aggravants d’une crise qui dure depuis plusieurs mois.
Pour la Martinique, cette problématique du prix des marchandises relève d’une triple peine.
1) Une flambée des prix (Free On Board - FOB) au départ des zones d’approvisionnement majoritairement européennes ou chinoises. Cette flambée est plus importante pour les « petits » clients dont font partie les importateurs martiniquais.
2) Des prix des frets maritimes en forte augmentation liés en grande partie à l’indisponibilité des containers, leur production ayant été arrêtée au plus fort de la crise sanitaire en Chine, mais aussi à la spéculation. Les tarifs de fret Chine-Europe de l’Ouest ont été multipliés par 4 ou 5. Les prix des frets maritimes transatlantiques ont doublé.

3) Une taxation à l’entrée sur le territoire martiniquais au titre de l’octroi de mer dont l’assiette est le prix Coût Insurance and Freight – CIF – dont les deux composantes majeures ont subi de fortes hausses.
Dans le domaine des matériaux de construction, la dépendance de la Martinique est très importante puisque la quasi-totalité des productions locales dépend de matières premières importées, par exemple : clinker, acier, bois…
Deux autres conséquences de la crise sanitaire ont été notées pour les matériaux de construction : - Des ruptures d’approvisionnement - Une volatilité des prix dont les périodes de validité se comptent parfois en périodes inférieures à un mois
Les approvisionnements sont réalisés dans le cadre d’accords commerciaux annuels ou pluriannuels. Les importateurs martiniquais du secteur matériaux de construction restent donc contraints. L’insularité a aussi pour conséquence la constitution de stocks excessifs, un élément favorable pour le consommateur martiniquais tant que la tendance haussière se maintient, mais qui devient défavorable dès que les prix recommencent à baisser. Or, dans un marché très perturbé et cyclique, ces moments de bascule sont impossibles à anticiper.
L’insularité amplifie une problématique déjà complexe









































Difficile de mesurer l’impact précis de la situation sur les coûts de construction. Tous les corps de métier ne sont pas affectés de manière égale.
La structure du prix d’un ouvrage est très diverse. Les matériaux représentent une part très variable du déboursé sec. Entre la pose d’un transformateur électrique et la pose d’une pose de carrelage, on comprend bien que la part « matériau » aura un poids très différent.
La durée entre l’établissement d’un prix dans le cadre d’un appel d’offres et la réalisation de l’ouvrage est de plusieurs mois. C’est notamment le cas pour certains corps d’état de second œuvre particulièrement concernés par les augmentations de prix. Face à la volatilité des prix, l’entrepreneur prend un risque extrêmement important. Soit il anticipe d’éventuelles augmentations et risque de faire une offre élevée qui ne sera pas retenue, soit il prend le risque de devoir gérer contractuellement des augmentations de prix. Mais les marchés publics comme privés sont rarement contractualisés sur des bases permettant la juste prise en compte d’augmentations de prix de matériaux qui sont pourtant bien réelles.
Dans la crise actuelle qui est réactivée par la situation en Ukraine, beaucoup d’entreprises pourraient faire jouer les clauses d’imprévisibilité pour dénoncer des marchés mettant en difficulté des projets et des maitres d’ouvrage. Il faut également craindre des défaillances d’entreprises en cours de réalisation de chantiers, des situations toujours très pénalisantes pour des projets dont la consommation de financements est généralement contrainte dans le temps.
Le plan de relance territorial a sans doute été conçu sur des bases budgétaires qui sont à présent obsolètes. Son déploiement risque d’être compliqué par une situation imprévue.
Les indices de révision de prix nationaux ne tiennent compte que partiellement des hausses de prix constatées en Martinique. La composante fret transatlantique et mécaniquement l’incidence de l’octroi de mer ne sont pas prises en compte dans le calcul des indices de révision de prix nationaux. Pourtant, ce sont ces indices qui sont mentionnés dans les CCAG et CCAP lorsque les marchés autorisent les révisions de prix.
Le logement social neuf et l’amélioration de l’habitat sont particulièrement vulnérables aux hausses de prix, mais c’est l’ensemble de la filière construction qui est à risque.



Le front de mer de Sainte-Luce doit être protégé afin de préserver les écosystèmes et donc les ressources et les activités qui en découlent. Le maire a souhaité reprendre un projet arrêté en 2005 et l’agence d’architecture et d’urbanisme
EGA Erik Giudice Architecture a répondu à l’appel d’offres en 2019.
> Suite page 62
ABAISSE LA TEMPÉRATURE EN ESPACE EXTÉRIEUR ET/OU SEMI EXTÉRIEUR pour des postes de travail a n de réduire la pénibilité au travail liée aux fortes chaleurs



SOLUTION EFFICACE POUR ABATTRE LE TAUX DE POUSSIÈRES REJETÉ et néfaste pour le personnel et pour l’environnement sur les sites types Carrières, déchèteries, centrales à béton etc.



AMÉLIORE LES PERFORMANCES ET RENDEMENT THERMIQUE des échangeurs des aérocondenseurs et tours aéroréfrigérées




Depuis 2014, Systeko développe, construit et installe des centrales dédiées aux professionnels. A son actif, la plus grande installation en autoconsommation des DOM/TOM et plus de 800 projets d’injection d’électricité propre dans les réseaux antillo-guyanais.

Bâtiments professionnels : 3 modèles d’accompagnement dans le solaire
• L’autoconsommation : le propriétaire du bâtiment investit dans une centrale avec l’objectif de produire l’électricité qu’il consommera.
• L’injection réseau par vente directe : le propriétaire investit dans une installation afin de revendre à EDF la production d’électricité propre (selon les tarifs d’achat de ZNI).
• La valorisation de toiture : en partenariat avec le propriétaire, Systeko porte l’investissement et revend lui-même l’électricité à EDF moyennant un loyer annuel fixe pour la toiture du bâtiment.
Aujourd’hui, la valorisation de toiture devient accessible aux particuliers Outre le volet financier et l’impact énergétique vertueux au niveau du territoire, la proposition Systeko de location solaire de toiture offre cet avantage : faire profiter les bailleurs de la rénovation de leur toiture et de leur structure que Systeko finance par avance des annuités de location correspondantes futures. Avantage proposé aussi aux particuliers souhaitant valoriser leur toiture en la louant à Systeko qui revend l’électricité à EDF.
les bailleurs de la rénovation de leur toiture et de leur structure
La prise en charge technique et financière de travaux de rénovation des biens par le solaire : mode d’emploi ! Systeko évalue la rentabilité du projet sur 20 ans. Après engagement du bailleur, l’entreprise réalise un audit détaillé de viabilisation des toitures et structures.

Sur base des datas relevées par un drone et l’audit d’un bureau de contrôle indépendant, une analyse-rénovation établit une préconisation des travaux pour une viabilisation saine et durable. Un plan et un devis très précis des travaux sont présentés au bailleur. Financés par Systeko et récupérés sur les annuités correspondantes futures, les travaux sont réalisés par des artisans locaux - couverts par une garantie décennale - sous la supervision d’un coordinateur Systeko dédié. Ce combo artisan/ Systeko reste solidaire des travaux engagés sur toute la durée de la location. Systeko se charge aussi des démarches administratives, de la construction, de l’installation, de l’exploitation et de la gestion des flux vers le réseau.
Systeko, un engagement fort
L’entreprise, investie dans la transition énergétique, revendique aussi la connaissance des contraintes et spécificités locales. Pas étonnant dès lors qu’elle tienne à assurer la maintenance des installations deux fois par an, durant 20 ans. D’autre part, sa croissance a généré 40 postes en cinq ans et compte plus de 100 prestataires partenaires locaux.



Systeko
Martinique

16 rue des Amarreuses - Zac la Marie Ducos
0696 76 00 20
Guadeloupe Imp Sisyphe - Voie Verte - Jarry


Baie-Mahault
0690 238 900

Guyane 9 rue des plaisanciers - Port de Degrad des Cannes

Rémire - Montjoly
0694 91 49 00
www.systeko.fr
Dans une démarche de résilience, le projet d’aménagement, dont la livraison est prévue en 2025, s’appuie sur les ressources locales afin de renforcer durablement le littoral et préserver l’écosystème et les activités existantes. Sur 6 680 m² (dont 509 m² SDP), l’espace multifonctionnel comprend : un nouveau marché de poissons sur ponton, marché de fruits et légumes de forme triangulaire, l’Espace Gommier dédié aux pêcheurs, avec des aménagements pour le développement d’activités ludiques et halieutiques, et deux pontons et cales de halage.
Dans les maquettes, la complémentarité et interopérabilité des données SIG* n’a pas été oubliée, d’autant que l’objectif est de pouvoir exploiter dans le modèle les données issues des documents-cadres de planification territoriale (SIG) et remonter éventuellement les informations projetées (du BIM vers le SIG).
Un autre enjeu a consisté à simuler des événements climatiques pour atténuer les aléas (inondation et houle) du périmètre du projet. Les simulations thermiques, climatiques et de luminosité, ont guidé des choix décisifs dans les essences végétales et la préservation de la faune, et enrichi les phases préliminaires de conception
des aménagements des frontages actifs. Outil de coordination et de médiation entre les parties prenantes du projet, la maquette numérique pourra, tout au long de la vie des ouvrages, être consultable dans le cadre de la maintenance des réseaux enterrés.
Ce projet a reçu un BIM d’argent aux BIM d’Or Le projet d’aménagement du front de mer de SainteLuce a reçu le BIM d’Argent de la Catégorie « Projet de CIM, LIM, RIM » lors de la 8e cérémonie des BIM d’Or, en septembre 2021.


Équipe :
• EGA Erik Giudice Architecture : Architecte-Urbaniste Mandataire
• LBD PAYSAGES : Paysagiste
• EGIS BATIMENTS ANTILLES GUYANE : BET TCE, Infrastructures maritimes, VRD, Gestion de l’eau et du littoral, HQE, économie.
*SIG : système d’information géographique












PREVENTIS Antilles Guyane se positionnait déjà comme un des organismes référents en matière de coordination, de contrôles règlementaires, de formations liées à la sécurité et de Préparations opérationnelles à l’emploi. Aujourd’hui, elle ajoute une compétence en devenant Centre de Formation d’Apprentis.


Depuis 2013, l’entreprise multiplie les qualifications et les pôles d’activités :
- Coordination en BTP (SPS et OPC)
- Contrôles réglementaires : électricité et Vérification Générale Périodique des appareils, engins de levages et machines, puisque PREVENTIS AG détient les mêmes accréditations et agréments - les autorisant à contrôler les installations électriques et les équipements mécaniques - que les bureaux de contrôle représentés sur le plan national
- Formations liées à la sécurité des travailleurs de façon générale et du BTP répondant aux besoins du marché, en partenariat avec les entreprises du bâtiment et leurs OPCO, en utilisant différents dispositifs tels que les POE, Préparations Opérationnelles à l’Emploi.
L’entreprise multiplie les qualifications et les pôles d’activités
PREVENTIS AG poursuit sa lancée et devient Centre de Formation d’Apprentis

Très logiquement, P AG, déjà spécialisé en formations définies par le code du travail, a évolué pour exercer en tant que Centre de Formation d’Apprentis depuis juillet 2020. Pour rappel, les programmes du CFA garantissent une qualification professionnelle reconnue dans un secteur d’activité précis, avec délivrance de titre professionnel à l’issue d’une année de formation. Toujours dans le souci d’enseigner et de guider au mieux les candidats, la société fait appel à des prestataires extérieurs - professionnels reconnus dans leurs différentes activités - en renfort des équipes déjà en place. Afin de bénéficier des programmes de CFA, plusieurs leviers existent : la demande peut provenir des apprentis eux-mêmes, de Pôle Emploi, des collectivités, des missions locales d’entreprises demanderesses…
Cette appellation CFA n’interfère absolument pas avec les programmes de formation professionnelle.
Preventis
Immeuble Synergie, Californie 2
Le Lamentin
0596 39 76 20
preventis-ag.com
Suivez-nous sur Instagram et Facebook
Rencontre avec Samuel Tavernier, maire du François depuis juin 2020. Si son programme s’articulait autour de la transition écologique et énergétique, le maire reste à l’écoute de ses habitants afin d’améliorer leur cadre de vie, veiller à leur bienêtre et leur préparer un avenir confortable. Pour BatiMag97, Samuel Tavernier dresse un état des lieux des projets, des travaux prévus et des objectifs.


Avec l’excellence allemande votre business avance.
Découvrez un large choix de modèles de 3,3 à 30 m3 et des transformations sur-mesure pour trouver le bon utilitaire adapté à votre activité professionnelle.
FOURGONNETTES I FOURGONS MOYENS I GRANDS FOURGONS I PETITS CAMIONS
Ces Utilitaires permettent aux sociétés de ne pas payer de TVS (Taxe sur les véhicules de société)
1,5L 100CH L1 Diesel
Existe en automatique
Volume de chargement : 3,3 m3
1,5L 100CH Diesel L2
Volume de chargement : 3,9 m3
1,5L 100CH Diesel L1
Volume de chargement : 4,6 m3
1,5L 120CH Diesel L2
Volume de chargement : 5,3 m3
2,3L 150CH Diesel L1H1
Volume de chargement : 8 m3
Samuel Tavernier : Dans le cadre du développement des énergies renouvelables, le François va installer une centrale photovoltaïque au sol. C’est sur l’ancienne décharge municipale située à la Pointe Courchet, derrière l’hôpital du François, que devrait voir le jour ce nouvel équipement d’une capacité de production de 1,68 mégawatt-crête, soit l’équivalent de la consommation de 600 foyers*. Une fois terminée, elle sera l’une des centrales au sol les plus puissantes de la Martinique. La ville du François a reçu l’accord de principe de l’AFD pour le financement, le montant global étant évalué à 2,5 millions d’euros. Sur ce projet, la mairie est accompagnée par la SPL Martinique Énergies Nouvelles (partenaire énergétique des collectivités locales) dont la ville du François est actionnaire et qui, à ce titre, bénéficie de l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Les études d’impact et les autorisations étant favorables, les travaux devraient débuter prochainement pour se terminer dès la fin 2022.

* La centrale sera constituée de 3 888 panneaux photovoltaïques de type silicone monocristallin représentant une surface de 20 000 m2 environ, la puissance maximale de la centrale s’élève à 1,68 MWc. Aucun stockage d’énergie n’est prévu.

ST : Notre plan se dissocie complètement du projet territorial du SMEM entamé voilà deux ans.
Au François, il est prévu de remplacer toutes les armoires électriques et plus des 300 mâts, d’installer près de 2800 points lumineux. Une fois mis en place, ce programme permettra une gestion intelligente de l’éclairage (notamment avec un meilleur éclairement, un niveau d’intensité de lumière en fonction des heures) et une maintenance efficace.





Nous construisons avec vous des solutions sur-mesure pour vos chantiers.





À terme, cet investissement comprimera substantiellement le coût total de la facture énergétique publique. Les appels d’offres et les auditions ont permis de retenir un partenaire pour ce vaste programme dont le budget s’élève à 4 millions d’euros. Les travaux devraient débuter au second semestre de cette année, il concernera tous les quartiers, soit 43 au total.
* Processus de modernisation du système d’éclairage (NDLR).
ST : Parce qu’il est capital de projeter notre territoire dans l’avenir et de l’envisager via les prismes des aléas climatiques (zones inondables, réchauffement climatique, érosion de la frange côtière, sargasses… ) et des besoins de la population, le nouveau plan d’aménagement du territoire tient compte des politiques d’habitat, de déplacement et d’urbanisme. Dans ce contexte, et par le biais d’un aménagement cohérent du territoire, nous apporterons une réponse à cette question : où et comment construire au François ? Par la même occasion, nos services pourront réagir à des demandes de déclassement de la part de Franciscains, toujours en attente de décision.

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est déjà en cours de révision avec une évaluation de son budget. Un comité de pilotage effectif devrait être mis en place pour lancer les appels d’offres. Ce plan, qui concerne l’ensemble du territoire franciscain, générera des travaux s’étalant sur quatre ans environ.
La question du logement se voit directement liée à ce nouveau PLU. Sur ce point, il n’est pas superflu de déplorer une certaine inertie de la part de la gouvernance précédente qui a créé très peu, trop peu, de logements.

Cette situation nous met aujourd’hui en net décalage au regard de la loi SRU* qui impose aux communes un minimum de 20 à 25 % de logements locatifs sociaux de 20 ou 25 % du total des résidences principales du territoire. La commune du François ne peut se prévaloir que de 12 %, ce qui a pour conséquence des pénalités s’élevant, en moyenne, à 140 000 euros par an. C’est démesuré et inacceptable.
Aussi est-il urgent de densifier le territoire, non pas le bourg - arrivé à saturation -, mais l’ensemble de la commune en privilégiant des logements en périphérie et à l’intérieur des terres.
Afin de concrétiser rapidement ces programmes, deux opérations sont à l’étude. L’une verrait le jour au quartier de la Dumaine (30 logements construits par la SIMAR) et l’autre dans les Hauts de Trianon (300 logements SMHLM). D’ici 2026, le plan global prévoit de faire sortir de terre 400 logements environ.
Dans une perspective de mixité, l’opportunité sera aussi donnée aux Franciscains d’accéder à la propriété, avec la construction de villas, de maisons et de logements sociaux. Dans cette optique, deux opérations sont sur le point de démarrer : une dizaine de villas dans le quartier de la Manzo et treize logements au quartier Frégate Est 1.

En 2019, le François comptait 15 980 habitants en diminution de 12,32 % par rapport à 2013. Ce dépeuplement, à imputer au manque de logements entre autres, devrait cesser dès lors que la commune sera en mesure d’accueillir de nouveaux habitants sur son territoire. Depuis que la nouvelle gouvernance municipale (soit bientôt deux ans) a pris ses fonctions, 508 demandes de logements ont été comptabilisées.
ST : Actuellement géré par un délégataire (contrat signé avec la ville du François en 2011 se terminant en 2040), le port n’a fait l’objet d’aucun investissement depuis onze ans, contrevenant ainsi à ce qui avait été conclu. En effet, un programme d’investissements prévoyait, entre autres, l’édification d’une capitainerie, la création d’infrastructures portuaires, l’aménagement d’équipements d’accueil… Situation d’autant plus intolérable que chaque année, le délégataire perçoit les redevances des plaisanciers pour une moyenne de trois cent mille euros environ.
Certes, des autorisations d’urbanisme ont été délivrées avec du retard, mais la situation n’a pas évolué pour autant… Devant cet immobilisme dommageable, la ville a entrepris de résilier le contrat afin de reprendre en régie la gestion du port de plaisance, le temps de trouver un repreneur soucieux de faire prospérer la marina. Une structure à haut potentiel économique pour la ville du François.
* La loi SRU vise à densifier de manière raisonnée les espaces déjà urbanisés afin d’éviter l’étalement urbain : elle limite la possibilité de fixer une taille minimale aux terrains constructibles et supprime le contrôle des divisions de terrain ne formant pas de lotissements. (NDLR)
** 25 % multipliés par la différence entre 25% ou 20% des résidences principales et le nombre de logements sociaux existant dans la commune l’année précédente. (NDLR)
ENSEIGNE | SIGNALÉTIQUE






BUREAU D’ÉTUDE | CONCEPTION | IMPRESSION | DÉCOUPE

SOUDURE | PEINTURE | ÉCLAIRAGE | INSTALLATION

www.artisign.fr


ST : Par manque de place dans les bâtiments de l’hôtel de ville, plusieurs services municipaux ont été délocalisés, au grand dam des administrés qui ne s’y retrouvent plus. Autre conséquence, des loyers qui grèvent les finances de la mairie.
Afin de remédier à cette situation coûteuse et complexe, la mairie envisage une extension de l’hôtel de ville sur une parcelle jouxtant directement les bâtiments municipaux actuels. C’est donc un véritable centre administratif qui rassemblera bientôt tous les services. La maîtrise d’œuvre, déjà désignée, travaille sur le projet avec une date de fin de travaux fixée à fin 2023.
L’ancienne mairie, aujourd’hui en décrépitude, constitue un autre projet de taille. Elle vient d’être classée aux monuments historiques par le ministère de la Culture et fera bientôt l’objet d’une réhabilitation à l’identique. Un architecte des bâtiments de France accompagnera la ville sur les démarches et procédures requises pour la rénovation de cet édifice patrimonial. À termes, l’ancienne mairie abritera des services culturels, une salle de mariage, un musée, une galerie d’exposition…
Un plan d’investissements devrait être établi rapidement (participation de l’État à concurrence de 40 %, le Feder à 55 % et la ville du François à 5 %) avec nomination d’une maîtrise d’œuvre.
Les travaux débuteraient début 2023.

ST : Outre les villas du Cap Est et la réhabilitation de la résidence hôtelière La Riviera (projet privé), quelques autres programmes d’hébergements touristiques sont prévus, notamment au Cap Est et à la Presqu’île où le projet d’un immeuble privé de 19 appartements devrait voir le jour.

ST : Pour lutter contre ce fléau, la ville du François a dressé - et communiqué à la CTM et au FEDER - un plan de financement de deux millions d’euros. Ce projet de grande envergure comprend la pose de filets en mer, l’acquisition de bateaux de ramassage en mer, de matériels et d’équipements d’évacuation (camions, pelleteuses…) et le stockage dans un endroit agréé au niveau environnemental et sanitaire. Un Plan Sargasses, soutenu par le sous-préfet, a aussi été proposé à l’État.
En tant que conseiller territorial à la CTM, j’ai requis un pilotage « État-CTM » qui traiterait et mènerait les opérations à un niveau territorial.
La société Holdex – située au François - récupère les sargasses propres, c’est-à-dire avant échouage, ce qui nécessite un enlèvement en mer. Une condition difficile à remplir actuellement puisque la loi stipule que tout enlèvement à plus de 300 m de la côte relève de la compétence de l’État. Et que jusqu’à présent, celui-ci se désengage de cette obligation, avec pour corollaire l’échouage des sargasses sur nos côtes, relevant ainsi de la responsabilité de la ville. Cette irrégularité nous coûte énormément d’argent, plus de 400.000€ en 3 ans. Heureusement, la situation devrait évoluer grâce à l’intervention du sous-préfet, très sensible à cette problématique, et qui a déjà mis en place un plan d’urgence – de trois cent mille euros – concernant l’enlèvement systématique des sargasses échouées.
Comment ? Avec les moyens du bord déterminés selon l’accessibilité aux zones d’échouages : au moyen d’engins terrestres mécaniques, de barges (dans les quartiers difficiles comme à Dostaly et Thalémont) ou encore, dans les zones plus facilement accessibles, avec des interventions manuelles.
ST : La commune est desservie par 2 réseaux. En effet, le déploiement en zones blanches, dont le centre du bourg, est géré par le Réseau d’Initiative Publique de la Collectivité de Martinique, Martinique THD et en zones grises, par Orange et SFR.
La convention signée entre ces deux opérateurs et la Ville du François facilite le partage des informations, les modalités et le calendrier de déploiement du réseau FttH (Fiber to the home », littéralement « la fibre jusqu’au domicile) avec la Direction Filière Numériques de la CTM.
Ce déploiement du réseau s’effectue en plusieurs étapes, pour couvrir à son terme 70 % des logements (particuliers, professionnels…) de la commune du François, soit au total 7294 prises.
La municipalité se réjouit de la collaboration menée avec tous les opérateurs puisque les travaux avancent très vite et permettront d’alimenter tous les logements en fibre optique d’ici 2023.

Priorité avait été donnée aux écoles, bâtiments municipaux, foyers ruraux, associations, zones commerciales situés dans le centre du bourg, déjà largement fibré.
Le très haut débit représente en effet un fort levier de développement et d’attractivité pour le territoire.
Samuel Tavernier est aussi 1er vice-président de la Communauté d’Agglomération du Sud de la Martinique (CAESM) et Conseiller territorial de la Martinique.
Acti Protection habille tous les métiers. En effet, l’entreprise fournit des vêtements de travail professionnels, des équipements de protection individuelle (EPI), des accessoires indispensables à la sécurité au travail pour les secteurs du bâtiment et construction, travaux publics, services techniques, industries, sites Seveso, collectivités, cantines et crèches scolaires, collèges et lycées, hôtellerie et restauration, médical et paramédical, grande distribution, artisanat… À cette panoplie, s’est ajoutée une gamme d’éclairages divers.

Son gérant, Bruno Arcelin, à la tête de la société depuis 1998, répond à nos questions.
Oui, sur place et en permanence, Acti Protection dispose d’une vaste gamme de vêtements professionnels et de chaussures de sécurité adaptées à nos climats et à l’usage. D’ailleurs, notre site vitrine s’avère très représentatif des produits en stock. Il informe aussi les visiteurs de toutes les normes de sécurité et de protection en vigueur.
D’Acti Protection, peut-on dire qu’on reparte avec ce que l’on était venu acheter ?
Le spécialiste des vêtements et accessoires de protection et de sécurité
Des demandes très pointues faisant l’objet de commandes spécifiques peuvent être livrées ou récupérées en magasins. Il en va de même pour toute commande passée par mail, fax ou téléphone et qui, à la demande, est préparée pour être récupérée dans un de nos deux magasins ou livrées.
Effectivement, depuis trois ans, notre savoir-faire a migré au Marin, à la zone Artimer. Ce qui permet à la chalandise du sud de se fournir dans une boutique experte, orientée aussi vers les métiers liés à la marine et au nautisme.
Oui, la livraison et la récupération de marchandises ont pris de l’essor. Situation qui nous a amenés à étoffer l’équipe du magasin de Ducos. Ainsi, nous comptons trois personnes supplémentaires : un responsable de dépôt et deux préparateurs de commande/livreurs qui ont à leur disposition quatre nouveaux véhicules de livraison. De plus, l’enseigne a également fait évoluer son système informatique, avec un nouveau logiciel, plus rapide, qui centralise les deux structures.


Des produits de marques expertes en protection, des prix très concurrentiels, la qualité de l’accueil, des conseils et des services que sont la livraison, la recherche et la commande de produits spécifiques, et enfin, les paquetages individuels. À cela, on peut ajouter une certaine proximité grâce à nos deux boutiques et notre site vitrine.
Z.I Champigny à Ducos 0596 56 25 20 - 0696 45 46 61
Zone Artimer
Le Marin 0596 67 62 96
actiprotection.fr
Rencontre avec Jean-François Caclin, président du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Martinique
L’impact du secteur de la construction sur l’environnement pèse lourd. Les architectes, urbanistes, concepteurs de la construction ont certainement un rôle à jouer dans la transition énergétique en prescrivant des pratiques et des écomatériaux plus respectueux de nos ressources et de notre environnement.
Leurs connaissances affutées des phénomènes thermiques, énergétiques et bioclimatiques servent à développer des bâtiments confortables, économes en énergie et abordables en maintenance.

Dans cette réflexion, BatiMag97 a rencontré JeanFrançois Caclin, Président du Conseil Régional de l’Ordre des Architectes de Martinique

La réponse est simple, la brique en terre cuite est le seul matériau géosourcé disponible sur l’île. Et ce matériau - parmi les plus anciens à s’inscrire dans le développement durable - se prescrit malheureusement de moins en moins, puisqu’il est restreint à l’infime part du marché de la construction des maisons individuelles.
Aucune filière de terre crue n’existe à ce jour, alors que son utilisation serait avantageuse, dans la mesure où la terre ne manque pas à la Martinique. De plus, comme il existe une problématique réelle des terres de déblai considérées comme des rebuts de chantier, la valorisation de cette ressource deviendrait vertueuse. Divers tests ont été menés par Kebati - grâce à l’association Permadomia - sur le comportement des terres
locales après séchage. Un autre projet mené par la thermicienne Jennifer Baratiny, Ayembao, a été conçu pour «isoler» au moyen de la terre, matériau comportant un déphasage intéressant.
Je pense que ce projet stagne, faute de moyens de fonds (publics), indispensables pour, entre autres, émettre des avis techniques réglementaires sans lesquels les matériaux ne peuvent être utilisés en construction.
Il serait souhaitable de voir plus de constructions utilisant des matériaux issus de nos territoires. Surtout au vu de l’actuelle flambée du cours des matières premières et des prix des approvisionnements. Aucune alternative ne nous est accessible. Et à terme, afin de réussir les démarches de transition écologique, d’économie circulaire, de circuit court, la Martinique doit se saisir de ces problématiques et trouver de nouveaux modèles susceptibles de se sortir de cette dépendance et trouver la voie de l’autonomie.
Tout porte à le croire, la volonté existe, mais les moyens manquent.
Un investissement dans le présent promouvrait l’avenir économique de la Martinique en créant de nouvelles filières aux conséquences très positives : nouveau bassin d’emplois, nouvelles compétences, etc.
Lors des journées de l’architecture, nous souhaitions utiliser le bambou dans le pavillon provisoire que l’Ordre des architectes a construit pour l’occasion. Avec ce bâtiment, notre démarche avait pour objectif de promouvoir les matériaux locaux dans la construction.
Cette lenteur est-elle imputable à un manque de moyens ?
Pour revenir aux écomatériaux, le bambou peut-il représenter une alternative sérieuse ?Jean-François Caclin
Nous avions d’ailleurs contacté un artisan qui travaille le bambou en mobilier et parements. Mais une contrainte de délai nous a empêchés de finaliser cette construction et de la justifier réglementairement avec des savoir-faire et une technicité encore insuffisamment répandue et éprouvée localement. Par sécurité donc, notre pavillon a été réalisé en bois.
Cela dit, le bambou représente un écomatériau intéressant, pour preuve, l’un des quatre projets retenus au Prêcheur, dans le cadre des Opérations d’Habitats Renouvelés, est constitué en partie de bambou. Au niveau de la filière, il semblerait que l’espèce invasive qui pousse à la Martinique n’offre pas une résistance mécanique suffisante pour répondre aux normes parasismiques. Une étude de l’ADEME est en cours, elle porte sur l’utilisation du bambou en construction ou rénovation.
Il existe plusieurs vecteurs dans l’écologie. Si l’on revient à l’architecture vernaculaire, on sait qu’il n’y avait d’autre

choix à l’époque que de construire avec des matériaux issus localement. Le mode de construction s’adaptait aux conditions climatiques et aux modes de vie.
Peut-être faut-il se réapproprier certaines pratiques : orientation des bâtiments, ouvertures au vent traversant, cloisons de distribution, ventelles en partie haute…
À l’époque, n’existaient que des toits en pente avec charpente traditionnelle, permettant d’installer des chiens assis, des ouvertures en toiture créant des appels d’air capables d’évacuer l’air chaud en hauteur. Ces conceptions simples ont, à ce jour, encore toute leur utilité. Et en attendant de se doter de systèmes constructifs alternatifs, on pourrait déjà se pencher sur tous ces moyens « naturels ».
Oui et les architectes militent dans ce sens-là. Certains interlocuteurs avertis souhaitent des constructions plus respectueuses de l’équilibre de l’environnement, plus enclines à limiter la consommation de ressources naturelles et d’énergie, à optimiser la récupération et le recyclage…
parler de bâtiments écologiques sans parler d’écomatériaux ?

Des leviers sur lesquels nous tentons d’agir au mieux. Il arrive parfois que des particuliers souhaitent répliquer ce qu’ils voient dans des émissions de télévision « made in métropole ». Mais réduire l’impact environnemental ne s’exerce pas de la même manière dans l’Hexagone et ici (dont les aléas climatiques doivent être pris en compte). Bref, avec un peu de pédagogie, nous tentons de sortir de ces modèles non adaptés et de trouver une solution locale.



Le bambou représente un écomatériau intéressant
Les entreprises investies dans un mouvement militant pour l’écologie et le climat existent, mais leur nombre reste encore insuffisant. Pour être franc, la majorité des entreprises continuent à faire ce qu’elles ont l’habitude de faire : opter pour des solutions non chronophages, rentables, efficaces économiquement. La brique de terre cuite est un exemple très significatif. De moins en moins d’entreprises sont disposées à réaliser des ouvrages en maçonnerie. Ce mode de construction exige du temps, des finitions, du métier, bref, il semble moins rentable que la pose d’un voile en béton armé. Et pourtant ! Le béton doit être complété d’un doublage thermique, d’une climatisation, pour, in fine, ne jamais atteindre le confort thermique naturel que peut offrir la terre cuite…
Rapporté aux coûts d’exploitation d’un bâtiment sur toute la durée de son existence, on constate aussi un déficit de conscience de l’impact d’un mauvais choix sur l’investissement de départ. Trop souvent, la démarche se limite à faire un investissement réduit à sa plus simple expression, pour en dégager un maximum de bénéfices. Sans penser aux coûts d’exploitation, à la maintenance …
acteurs de la chaîne de construction sont formés, équipés et investis dans son utilisation.
Ici, seules quelques grosses opérations sont réalisées en maquette numérique, alors que beaucoup d’agences d’architecture travaillent déjà dans les logiciels autorisant la méthodologie du BIM.
Peut-être … En principe, tous les marchés publics devraient être présentés en BIM. Mais tant que les entreprises et les acheteurs ne sont pas prêts, rien ne sert de présenter les projets en BIM. La maquette numérique ne prend tout son sens que si tous les
Il faudrait une prise de conscience collective de tous les défis que la transition constitue ! Le biomimétisme se nourrit du pragmatisme, de l’efficacité et de la résilience de la nature en vue de les déployer dans notre développement. Mais si les cycles naturels opèrent un renouvellement, une récupération, une transformation jusqu’à ce qu’à la fin, il ne reste rien, il n’en va pas de même avec la société que l’homme a engendrée. C’est lui qui a créé le déchet… Et la Martinique est confrontée quotidiennement à cette énorme problématique de production de déchets dont l’impact affecte nos ressources naturelles, notre façon de nous nourrir et de vivre.
Ici, les notions de traitement et de valorisation sont des sujets sensibles dans la mesure où tout ne peut être traité et que les déchets ultimes demandent à être évacués. Et malgré les obligations et les encadrements réglementaires dans la construction, il existe des failles qui entretiennent la pollution. Prenons l’exemple des pots de peinture, refusés en déchèterie quand il reste de la peinture à l’intérieur. Qu’advient-il de cette peinture ? Comme les terres de déblais qui, par manque de structuration de la filière de traitement des déchets du BTP, peuvent mener à des décharges sauvages.
Voilà des sujets sans réponse, oubliés et volontairement occultés lorsqu’il est question de brandir la charte de Haute Qualité Environnementale des chantiers dits propres.
Pensez-vous que le biomimétisme soit un modèle inspirant pour la transition écologique dans notre région ?
Justement, le BIM peut-il jouer un rôle sur la prévision de ces coûts sur la durée de vie d’un bâtiment ?
Et donc, permettra-t-il à un architecte d’argumenter en faveur de choix plus écologiques, plus réfléchis dès le départ ?
Voilà plus de vingt-cinq ans que VIVRE EN BOIS Martinique apporte des solutions bois traitées localement, adaptées au climat antillais et s’engage pour garantir les usages vertueux du bois, matériau écologique et performant.
VIVRE EN BOIS Martinique en quelques mots…
L’enseigne dispose de deux plateformes de distribution et rassemble trente et un salariés dont le métier consiste à apporter aux clients des solutions de construction et d’aménagement extérieur en exploitant au mieux le matériau bois issu des massifs forestiers français.
VIVRE EN BOIS est labellisé Produit PIL, «nous sommes la seule entreprise qui traite le bois localement pour qu’il soit adapté au climat tropical, la valeur ajoutée se fait ici, le bois est garanti 15 ans au sol et 20 ans hors sol», rappelle Yann Chabin, responsable de l’enseigne en Martinique.
La superficie de la forêt représente 31 % du territoire hexagonal. Contrairement à la plupart des pays d’Amérique du Sud, la forêt française grandit. De 8,5 millions d’hectares en 1850, puis 14,1 millions en 1985, la métropole compte aujourd’hui 16,9 millions d’hectares de forêt, soit un massif forestier qui augmente de 0,7% chaque année depuis 1985.

Cette ressource s’accroît après avoir transformé environ 56 % de ce que la forêt produit, permettant de répondre aux exigences de la construction actuelle et d’anticiper les enjeux à venir.
Une ressource précieuse gérée intelligemment
Son engagement environnemental explique pourquoi VIVRE EN BOIS propose des produits intégralement issus de forêts gérées durablement. Leur fournisseur PIVETEAUBOIS investit dans toutes les initiatives liées à la régénération des forêts et à leur bonne gestion pour garantir demain une ressource abondante et continuer à «décarboner» l’atmosphère. Pour rappel, les forêts naturelles absorbent du CO² durant les 100 premières années de vie des arbres. Ensuite, elle commence seulement à rejeter du carbone. En revanche, une forêt gérée conserve le CO², puisqu’après chaque coupe redémarre un nouveau cycle de vie.

Les arbres absorbent le CO2 de l’atmosphère et continuent à le stocker une fois récoltés.
1 m3 de bois utilisé = 1 tonne de CO2 stocké

Aujourd’hui, nous devons tous prendre conscience que la forêt, l’arbre et le bois sont des ressources essentielles au développement durable.
Chez Vivre en Bois, le pin, le douglas, le mélèze et l’épicéa sont proposés pour les projets de construction et d’aménagement : structure, menuiserie intérieure et extérieure, revêtement et aménagement extérieurs.










En construction, le bois prend toutes les formes et tous les coloris, il se prête à des fantaisies architecturales, isole thermiquement, offre une intégration harmonieuse dans le paysage, répond aux normes réglementaires paracycloniques et parasismiques de nos régions. Et surtout, il minimise considérablement l’empreinte écologique d’une construction.
Il lutte contre l’effet de serre Le bois nécessite peu d’énergie à planter, à faire pousser, à récolter, à transformer et représente un réel « puits à carbone ». En effet, grâce à la photosynthèse, le carbone de l’atmosphère est absorbé et fixé dans l’élément constituant le végétal, à savoir dans l’herbe et l’arbre (1 tonne de bois absorbe 1,6 tonne de CO2 lors de sa croissance et stocke 0,5 tonne de carbone).

Ce phénomène participe à l’assainissement de l’environnement, notamment en purifiant l’air que l’on respire.
Ainsi, plus les arbres poussent, plus la forêt joue son rôle de capteur de carbone dans l’atmosphère. Pour respecter l’équilibre écologique et maintenir un échange carbone «zéro», la forêt doit être exploitée de façon raisonnée via un reboisement efficace et durable.
Taillé et inutilisé, un arbre rejette petit à petit son carbone dans l’atmosphère. Alors que s’il est transformé, le carbone stocké reste présent dans le bois.
Par exemple, l’utilisation de 1m3 de bois équivaut à éviter qu’une tonne de carbone soit relâchée dans l’atmosphère.

Un isolant thermique performant
La conductivité thermique du bois étant très faible comparativement à d’autres matériaux - 0,12 W/mK pour le sapin, 2,1 W/mK pour le béton - il s’avère un isolant thermique intéressant, particulièrement aux Antilles.
Bref, il préserve une température intérieure beaucoup plus agréable que le béton.
Des
Très résistant au feu
Le bois a une excellente tenue au feu, contrairement à ce que l’on pourrait croire. En cas d’incendie, le bois transmet 10 fois moins vite la chaleur que le béton. Et en se consumant, une couche carbonisée se forme à la surface du bois, couche qui progresse à la vitesse de 0,65 mm/minute vers l’intérieur du bois (8 fois plus isolante encore que le bois lui-même). Phénomène qui permet de ralentir la combustion.
Flexible en cas de séisme
Ce qui permet à un bâtiment de résister à un séisme, c’est sa capacité à se déformer pour absorber et en dissiper l’énergie.
Lorsque la terre tremble, le sol commence à bouger à une vitesse croissante, entraînant dans son mouvement les bâtiments qui subissent une force proportionnelle à leur poids. Comme le bois est plus léger que l’acier ou le béton pour une résistance égale, la force subie par un bâtiment en bois est moindre que celle d’un bâtiment en acier ou en béton. Cette force doit alors se dissiper dans la structure pour que le bâtiment ne s’effondre pas. Dans un bâtiment en bois, ce sont les assemblages (clous et vis) qui donnent à la structure sa souplesse pour se déformer et amortir la force du séisme.
Structure souple, l’ossature bois est capable d’absorber l’énergie générée par le séisme. Structure légère, elle suit les mouvements provoqués par les secousses et les absorbe sans s’effondrer.
Propre, écologique et confortable
Les chantiers de maisons en bois sont propres et secs : ils génèrent peu de déchets et consomment peu d’eau. Au-delà de ses bénéfices environnementaux, le bois possède également de nombreux bienfaits qui agissent tant sur notre moral que sur notre corps. On parle d’un matériau « biophilique ».
Le bois labellisé
Idéalement, le bois de construction doit provenir de forêts gérées dans le cadre d’un développement durable. Plusieurs labels garantissent qu’il n’est pas issu de coupes illégales ou de forêts non gérées durablement. Parmi ces certifications de traçage, PEFC et FSC s’appuient sur des principes de gestion rigoureux.
Sous nos climats, le bois est soumis à des agressions naturelles extérieures telles que les champignons, les insectes et termites et l’humidité. Pour le protéger durablement contre ces attaques et renforcer sa durabilité durant de longues décennies, il est traité en autoclave. Un procédé qui l’imprègne d’agents de conservation. La profondeur d’imprégnation est déterminée en fonction des classes de risque définies selon l’utilisation du bois.

En Martinique, pour garantir le bois durant des décennies, un traitement en autoclave s’impose
La construction aux Antilles préconise des bois de classe 4 (bois en contact direct avec le sol et/ou l’eau douce et une humidification constante). Les menuiseries et structures intérieures ainsi que les pièces de finitions sont aussi réalisées en bois de classes 3.1 et 3.2.

Les essences les plus courantes en construction sont des résineux provenant d’Europe, d’Amérique du Nord et des bois exotiques (bois rouges) issus de forêts sud-américaines dont la traçabilité s’avère peu fiable. Cependant, étant naturellement répertoriées en classe 4, ces essences résistantes ne requièrent aucun traitement.
Parmi les résineux, le pin (classe 4), le douglas (classe 3,2) et le sapin/épicéa (classe 3,1) subissent, après séchage, le traitement en autoclave nécessaire pour tous les bois d’œuvre : charpente, ossature, bardage, menuiserie…
C’est aussi lors de cette opération que l’on peut teinter le bois au moyen de pigments.
Implantée en Martinique depuis plus de trente ans, MATBOIS est spécialisée dans l’importation de bois bruts issus de la première transformation. Dans ses ateliers, MATBOIS transforme des avivés en produits finis.
Nous sommes spécialisés dans l’importation de bois :

- en provenance d’Amérique du Sud, d’Afrique, d’Europe, d’Asie. Ce qui nous permet de sélectionner des essences de bois exotiques du monde entier dont voici les plus prisées : l’Ipé, le Cumaru, le Muiracatiara, le Balata, le Tatajuba, l’Okan, l’Azobé, l’Angélim, le Tali, l’Angélique, le Courbaril, le Grignon, le Bois Serpent, l’Okumé, le Mahogany, le Poirier local...
- en provenance de Métropole avec du Sapin, de l’Epicéa et du Douglas.
Engagés dans une démarche respectueuse de l’environnement, nous nous assurons du contrôle des origines afin d’assurer une traçabilité de nos approvisionnements. Nous trions nos déchets et broyons les chutes de bois pour les transformer en énergie verte, le tout en circuit court.
Notre expertise - tant dans une relation de confiance avec les pays producteurs que dans notre maîtrise de la logistique – nous permet d’importer directement depuis ces pays et ainsi de pouvoir proposer le tarif le plus juste à nos clients partenaires.
Afin de répondre rapidement à toute demande, il est essentiel de maintenir en permanence un stock important. Raison pour laquelle nous nous devons de réussir à nous approvisionner constamment et ce malgré la crise mondiale qui impacte grandement la filière bois. Sur place, nos équipes commerciales utilisent leurs compétences pour répondre à toute demande et conseiller au mieux les clients, professionnels comme particuliers.
Voilà plus de trente ans que nous accompagnons des professionnels et des particuliers dans la réalisation de leurs constructions bois comme les charpentes, solivages, decks de piscine et bien d’autres.
Nous proposons des solutions pour l’aménagement intérieur et extérieur de la maison. D’ailleurs, outre des bois bruts, nous proposons aussi une grande variété de produits finis usinés sur place tels que des plinthes, des quarts-de-rond, des appuis de fenêtre, des brise-vues ainsi que des produits finis importés : lambris, lames de volet, bardage, plancher, contreplaqué marine ou traité…, des bois de coffrages, des lamellés collés, des contrecollés… Un atelier de seconde transformation : dédoublage et rabotage permet de répondre à une demande de services de rabotage et délignage sur place pour nos clients.









Les forêts couvrent une superficie d’environ 48 500 ha, soit 43 % du territoire. (Un tiers des forêts est public, deux tiers privés)

Cette estimation inclut les mangroves dont la superficie n’est pas comptabilisée dans le territoire terrestre (chiffres de 2017).
Le secteur de la forêt et du bois contribue au PIB de Martinique à hauteur de 1 à 2%*. Les données sur les entreprises et l’emploi indiquent qu’entre 100 et 360 entreprises sont recensées dans le secteur (en fonction des modes de comptabilisation) et qu’environ 640 à 680 personnes sont employées. Il convient d’ajouter que les activités principales mobilisent principalement le bois importé. La filière bois est plutôt déconnectée des forêts martiniquaises.
*(1% pour DAAF, non daté ; 1,5% pour Ernst & Young, 2007 ; 2% pour ONF, 2013).
La répartition par essence des volumes de bois des forêts martiniquaises n’est évaluée que de manière qualitative, sur la base d’informations datant de l’inventaire forestier de 1974. Les variations de volume ne sont pas connues faute d’un suivi régulier. La réalisation d’un inventaire forestier est prévue dans le cadre du PRFB (Programme régional de la forêt et du bois).
Cependant, on peut affirmer que les peuplements artificiels de mahogany grandes feuilles, plantés au milieu du XXe siècle pour pallier la déforestation de l’île, et le pin caraïbe forment aujourd’hui l’essentiel des zones de production en forêt publique et occupent une superficie réduite de moins de 30 ha. Le reste (90 % environ) est consacré à la protection des milieux et de la biodiversité́.
Quelques chiffres :
Sur les 15500 ha de forêts publiques gérées par l’ONF en Martinique, seuls 1200 ha ont été aménagés pour la production de bois. Ces forêts de production représentent 10 % des forêts publiques et 1,5 % de la surface de l’île.

Ces plantations sont susceptibles de fournir annuellement environ 5500 m3 de bois, dont 50% de bois moyens et gros bois et 50% de petit bois (éclaircies).
Une étude menée par l’ADEME a analysé les possibilités de créer des écomatériaux dans le cadre de la filière bois existante en Martinique. Voici le constat :
• Déchets de bois en scieries : seulement 60 % du bois coupé est exploité en scierie et 30 % restent valorisables
• Tuiles de bois / parquet / bardeaux : basé sur le même gisement de bois d’éclaircie
• Isolant fibres en vrac (copeaux) : la valorisation de la plaquette forestière représente 30 % de déchets de scierie, soit 1 000 m3.
Selon les principaux exploitants forestiers, le gisement en bois de mahogany acheté sur pied est d’environ 7 000 m3 (6 000 m3 issus de la forêt publique et environ 1 000 m3 supplémentaires issus de la forêt privée).
• 30 % de ces 7 000 m3 environ restent en forêt, soit 2 000 m3 environ, dont 50 % représentent le gisement en bois d’éclaircie
• 60 % du bois représente les coproduits de bois en scierie (3 000 m3)
• Importations de bois en Martinique : 15 % (en tonnes) des importations globales en Martinique concernent le bois et ses dérivés Selon la DAAF, la Martinique importe environ 60 000 m3 par an (panneaux, meubles).
Beaucoup de données à prendre avec précaution
Bois pour la construction : le gisement est estimé à 30 % du bois acheté́ sur pied soit environ 2 000 m3.
La production locale des différents produits bois, en volume ou en valeur, n’est pas connue. Si on dispose des chiffres d’importation et d’exportation des douanes, les données téléchargeables ont un intérêt limité, car elles ne permettent pas de connaître les échanges inter-régions, notamment entre la Martinique et la métropole.

Les importations depuis la métropole représenteraient plus des 2/3 des importations de bois de la Martinique, soit 40 000 t/an, sans que la répartition des essences ne soit connue (DAAF, 2012).
Le secteur de la construction fonctionne grâce à des importations massives de résineux (23% du volume, 47% de la valeur) en provenance d’Europe dont 2/3 de métropole. Les importations de Chine et d’Europe de l’Est sont en hausse et le bois local subit également la concurrence de l’importation de maisons en kit du Brésil (Coudert et al. 2014).
- 7 000 m3 de bois sur pieds provenant des forêts publiques et privées sont exploités aujourd’hui
- 5000 m3 arrivent en scieries, et 2000 m3 sont réellement produits
- 70 % de taux de perte à valoriser sur les volumes achetés sur pied
La qualité des bois de coupe hétérogène pourrait augmenter la disponibilité pour la filière écomatériau.
- Une ressource difficile d’accès : le bois d’éclaircie est laissé sur place, car trop difficile à récupérer
- Une filière peu structurée qui a vu la disparition du SBAM (Syndicat du bois de la Martinique)
- Certaines scieries ne sont plus suffisamment équipées
- Fonctionnement en flux tendu : la production s’effectue en fonction de la demande
- Le marché local est limité.
- Développer de la valeur ajoutée pour le bois d’éclaircies et les déchets de bois
- Rentabiliser le débardage par câble (très onéreux) en augmentant les volumes
- Mutualiser les investissements avec d’autres filières écomatériau pour obtenir un gisement important de fibres en vrac
- Développer la connaissance et l’exploitation de la forêt privée : l’ONF travaille à la mise en place de plans de gestion avec des propriétaires volontaires
- Valoriser la biomasse forestière : les résidus de coupe sont importants (laissés sur place), le bois d’industrie ne possède pas de débouchés commerciaux sur l’île.
Et les pertes en scierie sont vendues à des charbonniers
- Faire certifier les écomatériaux par un label en lien avec l’ONF
- Obtenir des certifications pour développer l’exportation de Mahogany (on estime à 4 ou 5 000 m3 de bois exportable).
> Suite page 104

Entreprises créées en 2000, Distribois et CBC (Compagnie des Bois Caraïbes) possèdent une connaissance du bois et une expérience professionnelle leur permettant de sélectionner les meilleures essences de bois de construction et de décoration pour les particuliers et les professionnels. Les enseignes se répartissent sur trois sites.


Le vaste showroom du Lamentin s’est orienté vers la distribution de pin traité classe 4. Nos pins proviennent principalement d’Europe du Nord et de l’Est. Leur spécificité et leur avantage tiennent dans la présentation de cernes d’accroissement plus serrés qui confèrent au bois une plus forte résistance à la flexion. D’autre part, comme ils sont secs, leur pose s’en voit facilitée et garantit une mise en place sans variation dimensionnelle avec des assemblages stables. Ils répondent à de multiples réalisations : charpentes, abris, bardages, bardeaux, garde-corps, brise-vue, margelles de piscine, terrasses, balustres, decks…
Le showroom du Lamentin consacre aussi un espace «quincaillerie» généreusement fourni en articles et produits destinés aux bois vendus par nos deux entreprises : visserie, connexions bois, fixations et bien sûr, en produits professionnels de protection, entretien et nettoyage du bois. Un autre département met en avant une large gamme d’outillages (y compris des appareils électroportatifs) et de matériels professionnels de grandes marques.

Vous accueillez vos clients sur trois sites, que propose Distribois au Lamentin ?
Le vaste entrepôt CBC dispose d’un stock permanent de bois exotiques sélectionnés avec beaucoup de rigueur pour la réalisation de travaux tels que les parquets, plinthes, volets, plans de travail, pièces de mobilier, portes, châssis… Il s’agit d’un négoce en gros, doublé d’une menuiserie à façon, où les techniciens fabriquent et mettent en vente des tables, bancs, modules, plateaux...

Les trois sites rassemblent des spécialistes formés aux bois et produits distribués. Forts de leurs connaissances et d’un savoir-faire expert, ils fournissent des conseils
avisés sur les sections, les variétés de bois à sélectionner selon les usages (intérieur ou extérieur), les contraintes techniques et les critères esthétiques, soit un conseil juste sans générer de surcoût à l’achat.
Pas du tout, aucune de nos deux sociétés n’est liée à une marque en particulier. Cette indépendance nous permet de sélectionner les meilleures essences chez les producteurs mondiaux tout en répondant à un cahier des charges tenant compte du climat et des intempéries martiniquaises.



Distribois
Zone Bois Carré

Le Lamentin 0596 39 88 44

Z.I Cocotte Plazza
Ducos 0596 77 07 01
info@distribois.com

CBC La Semair Le Robert 0596 65 45 26
cbc@cbc972.com

distribois.com

Il représente 95% de la production martiniquaise de bois et n’a pas les certifications nécessaires pour garantir la qualité mécanique des produits et répondre aux normes européennes de construction. Et pourtant, environ 1 400 ha de plantations de Mahogany en forêt territorialo-domaniale sont affectés exclusivement à la production, auxquels il faut rajouter 200 ha de forêts à usage mixte d’accueil du public et de production. Le potentiel de production de bois par l’ONF en forêt publique s’élève environ à 5 700 m3/an, mais en moyenne 2 000 m3/an de bois d’œuvre et d’industrie ont été exploités sur ces forêts publiques au cours des 5 dernières années, quasi exclusivement en Mahogany.
Les volumes de bois d’œuvre et d’industrie prélevés en forêt privée sont évalués entre 500 m3/an et 823 m3/an, sans compter les prélèvements informels, qui pourraient s’élever à 20% des volumes totaux de bois d’œuvre exploités.

Objectif à 10 ans : réussir à exploiter 6000 m3 de bois/an et 1500 m3 en forêts privées
Constat :
La faible exploitation des forêts a plusieurs causes : les contraintes d’exploitation, la baisse du prix de vente du Mahogany du fait de la concurrence du marché́ informel, des importations et de la lassitude des consommateurs vis-à-vis de ce bois et des produits qui en sont issus, la faible diversité́ des bois proposés, la baisse du nombre d’exploitants forestiers formels, la faible performance de l’exploitation, la sous-valorisation des bois d’éclaircie et coproduits de coupe.
En ce qui concerne l’exploitation, seuls 12% des surfaces de forêts apparaissent exploitables (en particulier, 86% des plantations de Mahogany sont inexploitables). Le relief est la principale contrainte : au-delà̀ de 50 %, l’exploitation est impossible tandis qu’au-delà̀ de 30 %, le réseau routier n’a pu être qu’insuffisamment développé́ à cause des contraintes de pente.
Comment améliorer l’activité dans le secteur ? L’activité́ est dominée par le commerce de détail de meubles, la fabrication de charpentes et autres menuiseries, le commerce de gros et dans une moindre mesure la fabrication de meubles de cuisine. La 1re transformation génèrerait un chiffre d’affaires de l’ordre de 2 M€/an, la 2e transformation un chiffre d’affaires de près de 45 M€/an, en baisse, tandis que le négoce génèrerait un chiffre d’affaires de plus de 50M€/an, en hausse. Cependant, toutes les activités importantes montrent une diminution du nombre d’entreprises et de salariés sur 10 ans.
Le PRFB vise à augmenter la valeur produite grâce au bois produit localement. La valorisation des volumes de bois déjà̀ produits est une priorité́. L’augmentation durable des volumes produits est visée en second lieu. Il s’agira d’augmenter les volumes exploités en forêt (publique et privée), le nombre et les volumes des produits issus de la première et de la seconde transformation des bois produits localement, tout en augmentant aussi le nombre d’essences valorisées.
Les produits CABEX sont adaptés aux plafonds d’habitations, de bureaux, d’espaces publics et commerciaux. Grâce à des procédés de fabrication modernes et souples, CABEX vous équipe en lambris PVC, pour une mise en place rapide.





ZI Pelletier • 97232 - Le Lamentin • Tél. : 0596 57 10 23 pour plus d’informations : www.cabex-industries.fr
Eau de ville
Eau de pluie
UNE LARGE GAMME DE CITERNE


ENTERRÉES ou HORS SOLS
VERTICALES ou HORIZONTALES
Actuellement, les bois produits localement sont peu valorisés et le potentiel de production de l’ONF, très faible par rapport aux importations, n’est pas atteint, la filière manque d’efficacité́ du fait de sa très faible organisation.
D’autre part, la communication sur l’aspect local et durable des productions bois est inexistante.
Augmenter la part des productions à base de bois local sur les différents marchés, existants ou à créer. Comment ? En organisant des filières de valorisation (et des nouveaux produits) de bois produits localement.
Certaines activités économiques mobilisant du bois d’œuvre, d’industrie ou du bois d’énergie sont à la recherche de matière première sans trouver satisfaction dans la production actuelle.
Il s’agit pour les forêts publiques d’intervenir uniquement sur les parcelles actuellement en production. L’objectif de récolte de bois fixé par le PRFB est uniquement basé sur la réalisation de l’exploitation de toutes les coupes prévues dans les documents d’aménagement en excluant la création de nouvelles parcelles. Tout en évitant des incidences négatives sur l’environnement, bien sûr.
Le potentiel exploitable par l’ONF (6 000 m3/an) devrait être atteint au terme de la mise en œuvre du PRFB.
Parmi les moyens déployés : l’amélioration de la desserte et des capacités des exploitants, la réduction des impacts de l’exploitation forestière, notamment sur les sols et l’exploitation des bois non valorisés actuellement.
Les forêts privées aussi seront mises à contribution avec une augmentation de leur production dans le cadre d’une gestion durable des forêts validée par des documents de gestion. Cette mobilisation pourrait atteindre 1500 m3/an (tous types de bois confondus) au cours de la mise en œuvre du PRFB.
Un potentiel reconnu par les professionnels du secteur
Parmi les institutions publiques impliquées, l’ADEME, la CTM et l’ONF s’accordent sur la nécessité de favoriser la filière bois. Quant à la DIECCTE, elle identifie le secteur forestier comme une opportunité intéressante pour l’emploi et l’insertion.
L’identification des modalités d’organisation de la filière serait une véritable avancée du programme régional de la forêt et du bois et donc une opportunité de développer la filière bois.
Presque toutes les entreprises de la filière bois martiniquaise sont actrices de filière de «seconde transformation» c’est-à-dire de façonnage du bois. Il s’agit d’artisans ou de petites structures de transformation qui opèrent dans des domaines variés : ébénisterie, menuiserie, fabrication de meubles et, plus récemment, construction de charpentes et de maisons en bois.
Reverdir la Martinique, un projet porté par Péyi Vert
« Péyi Vert », inauguré en juin 2020, est porté par l’association Entreprises & Environnement. Ce programme a pour ambition de planter un million d’arbres en Martinique en cinq ans.
L’objectif ? Protéger, voire restaurer les écosystèmes dégradés et préserver notre patrimoine végétal (au profit des espèces exotiques souvent envahissantes) afin de contribuer à la résilience du territoire.
Environ 70 espèces indigènes – rares ou menacées d’extinction - font partie de la liste établie avec les experts scientifiques (ONF, DEAL, Conservatoire Botanique de Martinique, DAAF...).

Un nouveau partenariat pour offrir des solutions plus performantes
JV Finances, cabinet de courtage expert en assurance construction, scelle un nouveau partenariat avec une grande compagnie française et étoffe ainsi son offre de solutions pour les professionnels du bâtiment. Explications avec Joël Varsovie, le directeur.
En une quinzaine d’années, vous avez développé une grande expérience dans le secteur de l’assurance et de la banque.
Quel est votre parcours ?
J’ai commencé à apprendre le métier de courtier en Guyane auprès de mon père, Jocelyn Varsovie, en 2005. Après avoir obtenu mon DAEU en suivant des cours du soir, j’ai intégré l’Ecole Nationale d’Assurance (l’ENASS), à Paris. Mon BTS en assurance en poche, j’ai multiplié les expériences, travaillant chez Solly Azar, un grand nom du courtage, puis dans la banque. En 2011, j’ai rejoint la Groupama en Guyane, puis SFS, un courtier spécialisé en assurances construction. Chargé de la clientèle professionnelle, j’ai sillonné le territoire pendant 5 ans afin d’étoffer le portefeuille de la société. Fort de cette expérience, j’ai décidé de créer mon propre cabinet en 2017. Le succès a été immédiatement au rendez-vous.

Entre 2016 et 2018, des faillites en cascade de compagnies d’assurance étrangères ont impacté le marché de l’assurance construction, limitant drastiquement le nombre d’offres. C’est la raison pour laquelle je me suis rapproché d’une compagnie d’assurance française réputée. Ce nouveau partenariat permet à JV FINANCES de proposer davantage de solutions.
Mon panel de services s’enrichit notamment de la garantie décennale avec reprise du passif. Un point très important pour les nombreuses entreprises ayant eu un défaut d’assurance au cours de ces 3 dernières années.
Nous sommes un groupe familial avec plusieurs domaines de compétences. Outre l’assurance, nous avons également des activités complémentaires : la promotion immobilière et le courtage bancaire. Elles nous apportent une compétitivité telle que nous avons choisi de nous développer en externe en ouvrant l’agence JV FINANCES à Rivière Salée en Martinique en 2019.

JV Finances
9, rue des Entreprises - Dégrad des Cannes - Rémire-Montjoly
0694 45 80 97
contact @jvfinances.com
jvfinancesassurance.com
Facebook : JV Finances
Depuis 2011, les afflux massifs récurrents de sargasses ont incité les pays touchés à rechercher des moyens de valoriser ces algues. Divers projets ont vu le jour, dans des domaines très variés, qui vont de la nutrition animale à la phytothérapie en passant par la production de biomatériaux.

La présence de métaux lourds dans leur composition et la saisonnalité du phénomène peuvent freiner les entreprises à investir dans la valorisation de cette ressource. Pourtant, une valorisation à forte valeur ajoutée permettrait de rentabiliser, même partiellement, les opérations de collecte et transport.
Aujourd’hui, les sargasses continuent à faire l’objet d’études avec de réels potentiels de transformation. L’ADEME (Agence de la Transition Ecologique) suit et accompagne depuis plusieurs années un certain nombre de projets de valorisation (recherche, projet pilote, etc.).
En dehors de nos territoires, des filières de valorisation existent. Selon le guide d’utilisation des sargasses édité en 2020 par le CERMES (University of West Indies) et la FAO (Sargassum Uses Guide, A. DESROCHERS), on dénombre près d’une trentaine de projets de recherche ou industriels liés à la valorisation des algues sargasses dans la Caraïbe. On peut citer Algas Organics à Sainte-Lucie qui produit un biostimulant support de germination. À Porto Rico, on transforme les algues en torchis de production tandis qu’à la Barbade, on en fait du savon. D’autres pays s’orientent vers une valorisation en biocarburants (Trinidad, etc.). Une entreprise mexicaine a introduit les sargasses dans de la pâte cellulosique pour en faire des cartons, des carnets, des produits de papeterie, etc.

Dans le secteur de la construction, on note également le projet porté par l’entrepreneur mexicain Omar Sánchez Vázquez, fondateur de la société BlueGreen, qui transforme ces algues brunes invasives en
briques de construction. Une première maison a été construite en quinze jours, avec 2 000 br iques, valorisant ainsi 20 tonnes de sargasses. Selon l’entreprise, les maisons « totalement écologiques » présentent un bilan carbone négatif car les gaz à effet de serre emprisonnés par les algues et le bois excèdent largement la quantité d’énergie totale nécessaire à leur construction.
Un certain nombre de projets portés sur l’identification et la mise en œuvre de filières de valorisation des sargasses ont vu le jour ces dernières années. La plupart de ces projets ont fait l’objet d’un accompagnement financier public (agences publiques de financement, collectivité territoriale, Etat, FEDER, etc.).
Au bout de deux ans de recherche, le projet ECO3SAR (2018) a pu livrer ses résultats sur la composition des algues et des résidus issus de leur dégradation, notamment au regard de l’arsenic et du chlordécone. Mené avec la participation de la société Holdex Environnement au François (Martinique) qui produit des amendements organiques tels que le compost, ce projet a également permis d’amender les études existantes sur la valorisation des algues par co-compostage. D’après les premières études menées sur le sujet (ADEME, Appel à Projet Sargasses, 2016), l’algue enrichit le compost en oligoéléments et contient des bactéries intéressantes pour l’activation du processus. Après de multiples années de recherche, l’entreprise a pu identifier et mettre en œuvre des procédés de compostage à base de sargasses (10% sur la masse) avec un suivi par analyses physico-chimiques afin de s’assurer notamment du respect des normes relatives aux concentrations en métaux lourds, sable et sodium, auxquelles le compost est soumis (NFU 44051 et NFU 44551). Les résultats de ces analyses s’avèrent à ce jour inférieurs aux normes. À terme, la société devrait pouvoir traiter 30 000 tonnes d’algues.
En 2018, à travers sa filiale SITA Verde, SUEZ s’est intéressé à la valorisation des sargasses en Guadeloupe et a répondu à des appels à projets issus de cette réflexion. Soutenue par l’ADEME, l’entreprise a exploré la valorisation par co-compostage sur un site de traitement existant où 100% des algues réceptionnées ont été traitées. L’entreprise a aussi expérimenté la valorisation énergétique des algues (production de biogaz) dans son installation de traitement de déchets non-dangereux à Sainte-Rose. Ces expérimentations n’ont toutefois pas été poursuivies dans le temps.
Dans le cadre de l’Appel à Projet (AAP) international Sargassum porté par l’ANR (Agence Nationale de la Recherche), plusieurs projets de recherche sur les sargasses sont en cours en Guadeloupe et Martinique. Les 12 projets retenus touchent diverses thématiques liées aux sargasses, de l’origine du phénomène à la valorisation des algues en passant par la télédétection
ou encore la collecte. En ce qui concerne la valorisation, différentes voies de valorisation sont explorées dont principalement : la production de charbons actifs/biochars/bio-oils, la production de biostimulants, la production de cartons et la méthanisation. En Guadeloupe, dans le cadre du projet PYROSAR, l’Université des Antilles (UA) cherche à isoler les molécules contenues dans les sargasses pour tester des applications en pharmacologie et agroalimentaire mais également à transformer les sargasses en charbon actif qui permettrait de fixer les molécules de chlordécone. En Martinique, The Marine Box (projet SAVE-C), start-up créée voilà 3 ans a eu l’idée de valoriser les algues en les intégrant dans des cercueils destinés à la crémation. Composés de sargasses (60%), de fibres de banane (30%) et de fibre de coco (10%), ce produit affichait un indice écologique relativement élevé. La start-up souhaitait aussi se pencher sur la production d’emballages en carton.
Sargasse Project a pour objectif de produire de la cellulose papier et moulée à partir d’algues sargasses. Le projet, financé en partie par l’ADEME et porté par Pierre-Antoine Guibout installé à Saint-Barthélemy, a permis dès ses débuts de produire une pâte qui, séchée, ressemble à une feuille de papier. Le laboratoire CEVA - Centre d’Étude et de Valorisation des Algues - a collaboré à la certification de la pâte à sargasse (100 % sargasses) qui lui reconnaît des propriétés cellulosiques similaires à celles du papier et du carton.

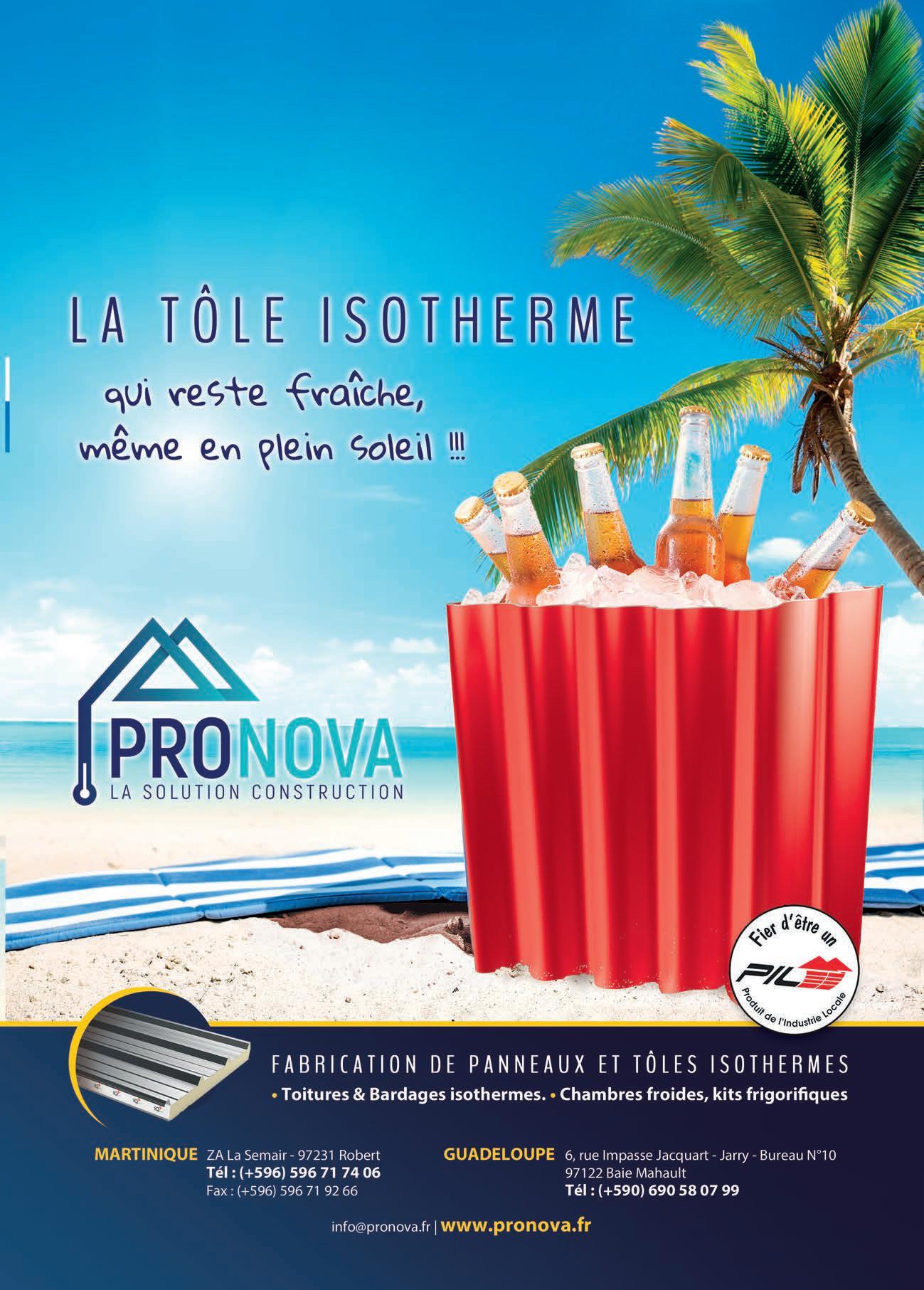
Sargasse Project précise que les analyses de métaux lourds réalisées sur les produits de valorisation affichent des teneurs comparables à celles mesurées habituellement sur des papiers et cartons d’emballage.
L’ensemble de ces découvertes a permis à Sargasse
Project d’être retenu comme lauréat de la catégorie Start du Concours Innovation Outremer et plus récemment du Grand Prix Tech4Islands, organisé par la French Tech Polynésie.

Toujours en phase d’étude auprès de laboratoires industriels de Recherche et Développement, Sargasse
Project entend poursuivre les dernières études techniques nécessaires à la concrétisation de leur projet
et ainsi entamer la phase de mise en place d’un pilote industriel pour une production à grande échelle.
Terre d’algues est un projet collaboratif piloté par l’agence In Situ Architecture et cofinancé par l’ADEME dont l’objectif est de produire des biomatériaux pour le secteur du BTP. L’idée de ce projet est venue avec le constat d’un manque de valorisation de matériaux (argile, tuf, bois, etc.) dans le secteur de la construction en Martinique.
Dans le cadre de ce projet, le partenariat établi entre IN SITU, le Cerema (Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement) et les sociétés Nobatek INEF4 et Tox Sea In doit aboutir à l’élaboration d’un matériau de construction à base de terre (en excès sur les chantiers de construction), d’algues sargasses (jusqu’à 85%) et de liants naturels.
Ces composants pourraient servir à fabriquer des briques et des panneaux par exemple. Il pourrait en résulter un bilan carbone positif, d’autant que la sargasse capture et stocke du CO2. On note également que pour transformer l’algue en matériau de construction, le besoin énergétique s’avère très faible.
Des études sont en cours pour vérifier la faisabilité d’utilisation des éco-matériaux produits au regard des normes actuelles et en vue de monter un pilote d’expérimentation, avant commercialisation.


(voir l’interview de Nicolas Vernoux-Thélot, architecte DPLG et porteur du projet de « Terre d’algues »)
La gestion des échouages de sargasses constitue une charge difficile à assumer par les collectivités locales. En effet, elles déplorent fréquemment le manque de moyens techniques et financiers auquel elles font face pour la collecte, le transport et le stockage des algues, et ce, malgré les soutiens financiers des services de l’État et des collectivités territoriales.
Aujourd’hui, il est urgent de trouver un équilibre logistique, financier et technique pour pérenniser durablement les opérations de collecte et ainsi offrir les conditions optimales et favorables à l’implantation de filières de valorisation sur nos territoires.
Au vu des mises en place rapides de filières de valorisation des sargasses dans d’autres états impactés, on peut penser que la France prenne du retard… Mais pas du tout. Les réglementations française et européenne, plus rigoureuses, nécessitent des études techniques parfois très poussées pour l’obtention de certifications. Dans le secteur de la construction, les matériaux doivent êtres normés (plus encore aux Antilles que dans l’Hexagone) avant d’être utilisés. Des étapes coûteuses qui réclament du temps.
• 7 communes impactées par les afflux massifs d’algues sargasses chaque année en Martinique contre 13 communes en Guadeloupe,
• 40% des échouages de l’archipel de la Guadeloupe se produisent à Marie-Galante,
• En 2018, année record à ce jour en matière de volume d’algues échouées, ce sont plus de 100 000 m3 de sargasses qui ont été collectés en Guadeloupe et Martinique.





Quatre partenaires sont réunis dans ce consortium « Terre d’algues » qui travaille sur le projet de matériaux géocyclés, valorisant les déchets sargasses échoués sur les littoraux. Il s’agit de Nobatek Inef4, institut de transition énergétique, Cerema, centre d’expertise technologique de l’État, Tox Sea In, société spécialisée en toxicité environnementale et marine et In Situ Inc., bureau d’architecture domicilié à Saint-Barthélemy, filiale de la société In Situ Architecture, dont je suis le gérant. D’autre part, je porte et coordonne le projet « Terre d’algues ».
Actuellement, les sargasses sont à l’origine de tellement de dégâts aux conséquences économiques graves impactant de nombreux secteurs que la valeur ajoutée d’un produit de valorisation sera toujours intéressante.
Avant de démarrer le programme avec l’ADEME le 25 juin 21, nous avions déjà réalisé des essais sur échantillons avec un produit composé de sargasses et de terres des chantiers amalgamées par des liants écologiques.
Produit qui a d’ailleurs fait l’objet d’un dépôt de brevet, raison pour laquelle je ne peux pas entrer plus en détail dans le procédé.
L’exploration de la gamme de matériaux potentiels débute à peine, mais je peux cependant dévoiler que la proportion de sargasses peut monter à 75 % (masse volumique) pour certains produits. Une information encourageante.
Selon les types de matériaux, et donc leurs caractéristiques mécaniques et thermiques, le calcul de déphasage…, cette proportion de sargasses est susceptible de varier.
Un autre intérêt économique du procédé repose sur une transformation minime générant une empreinte carbone négative sur l’ensemble de la production de ce matériau. Il est bon de rappeler que la sargasse étant un végétal, elle séquestre et stocke le carbone pour en restituer de la cellulose, matériau vertueux. Enfin, compte tenu des défis économiques des communes sur le ramassage, la collecte, le stockage (encore mal maîtrisé) et le souhait de travailler avec des filières écologiques - alternatives à celles que nous connaissons aujourd’hui -, on peut espérer que la brique d’algues trouve sa place sur les marchés à venir. Par ailleurs, le matériau « terre » représente une filière en pleine expansion aujourd’hui, et même s’il est mélangé aux sargasses, notre produit reste dans la lignée de ces marchés porteurs.
On n’en est pas encore là ! Après le stade des échantillonnages, nous arriverons à celui des épreuves techniques (résistance mécanique, tenue à l’eau, stabilisation, sécurité incendie, innocuité environnementale…) afin d’obtenir un agrément technique labellisé.
En ce qui concerne les normes, la brique d’algues (plutôt des adobes) devra répondre aux Eurocode en vigueur. Elle sera peu impactée par des normes paracycloniques, puisque ce matériau n’est pas structurel. Aucune contrainte particulière ne la concerne.
Quel est votre rôle dans «Terre d’algues»
Où en êtes-vous dans les études ?
Ont-elles déjà rendu tous les résultats attendus ou pas ?
Est-ce à dire que 75 % de sargasses représentent une grosse valeur ajoutée qui rend rentable le produit final ?

Ce produit, fabriqué aux Antilles, sera-t-il utilisé exclusivement aux Antilles ?
L’objectif est de proposer un produit écologique, à empreinte carbone maîtrisée. Cela dit, cette ressource n’est pas présente exclusivement dans les Antilles, elle s’échoue aussi sur les côtes normandes, bretonnes, dans la Manche… Il s’agit donc d’un matériau susceptible de se développer dans les zones impactées par des problématiques similaires.
Difficile de se prononcer sur ces briques mexicaines… Les publications scientifiques (procédé, brevet, production industrielle) n’en ont pas fait état. Seuls des articles de communication ont mis en avant des solutions avec des produits hypothétiques. Aucune comparaison ne peut donc être établie avec notre projet qui, a contrario, fait l’objet de programmes scientifiques, de procédés longs à mettre en œuvre, de tests…

Comment expliquez-vous qu’un produit presque identique à votre projet
ait été développé au Mexique en très peu de temps et qu’ici, on en est encore aux balbutiements d’une filière de valorisation ?
Cette entreprise requiert de l’énergie, du temps, des moyens. D’ailleurs, le fait d’être soutien de l’ADEME suscite une réelle accélération. De plus, une fois le projet abouti, l’ADEME nous permettra sûrement d’approcher des industriels susceptibles de développer la brique d’algues.
Échantillon © Terre d’algues
relais et s’intéresser un peu plus à ce projet pour le développer via des filières locales. Aujourd’hui, les élus régionaux savent que le projet existe et où il en est. Nous attendons un peu plus d’attention …
Avec mille tonnes de sargasses, on peut produire 10 millions d’adobes. C’est dire si avec plusieurs centaines de milliers de tonnes de sargasses qui s’échouent par an, il y a un réel potentiel de fabrication.
À travers l’ADEME, l’État a déjà fourni un gros effort. Il serait souhaitable de voir les régions prendre le

L’État pourrait-il être partie prenante à certains stades (collecte, ramassage, transport…) ?
Les impacts liés à l’échouage des algues sargasses sur les littoraux antillais sont nombreux. Ils concernent les secteurs de l’économie, de la santé (pneumologie ...), de la biodiversité ...

Une initiative nommée Sargassum est menée conjointement par les communautés scientifique et économique et vise la création d’un corpus de savoirs et d’expertises de référence sur la thématique des sargasses.
Dans le cadre de Sargassum, diverses études ont été initiées, dont le projet Corsair qui a pour ambition d’étudier l’impact de ces algues sur les corrosions atmosphérique et marine des matériaux métalliques en intégrant également une approche juridique sur ces aspects.
En cause, la dégradation prématurée d’appareils constitués d’une enveloppe métallique (réfrigérateur ...) ou plastique (ordinateur, TV...) contenant des cartes électroniques.
Le projet Corsair mené par l’Université des Antilles –en collaboration avec Madininair – est prévu sur trois ans et se divise en trois axes de recherche, l’étude de la corrosion atmosphérique, l’étude de la corrosion marine et l’approche juridique.
Il s’agit d’identifier l’influence des rejets gazeux des sargasses et des nappes échouées, et de comprendre comment ils accélèrent la dégradation des matériaux métalliques, zinc, cuivre, aciers… et donc des appareils ménagers des résidents littoraux.
Depuis janvier 2021, des mesures spécifiques sont relevées dans l’air ambiant sur trois sites distincts :

• Frégate Est : site fortement impacté par les émanations de gaz liées à la dégradation des algues sargasses
• Diamant : site moins impacté par les gaz émis par la dégradation des algues sargasses mais soumis à l’influence des embruns marins de manière plus importante
• Vert Pré au Robert : plus loin des zones majoritairement impactées, à l’intérieur des terres. Toutefois dans cette zone, il a déjà été ressenti des odeurs d’H2S lors d’échouages massifs d’algues sargasses, site sur lequel une dégradation accélérée des matériaux est observée.
Pour cette étude, trois composés sont recherchés via des capteurs installés par Madininair :
• L’hydrogène sulfuré H2S
• L’ammoniac NH3
Tous deux sont suivis dans l’air par la mesure en continu et en temps réel des concentrations atmosphériques de ces composés
• NaCl : les ions sodium et chlorure correspondant aux embruns marins.
Ce composé, recherché dans les retombées atmosphériques, permettrait de quantifier l’influence des sels marins sur la corrosion des métaux lorsqu’il n’y a pas d’algues et l’influence combinée avec les gaz fortement corrosifs H2S et NH3 (un acide et une base), dégagés par les algues. La question est de savoir si la présence de ces trois éléments combinés renforce l’agressivité de la corrosion.
> Suite page 128

Les algues sargasses dégagent du sulfure d’hydrogène (H2S), gaz toxique qui, par un processus d’oxydation accélérée, impacte les métaux (et surtout le cuivre) contenus dans les équipements électriques, dont les climatiseurs. Aujourd’hui, il existe une solution : Aqua Aero, le traitement appliqué par FROID EXPRESS.
Afin d’apporter une solution à ce fléau, FROID EXPRESS a mis en place un traitement protecteur appliqué en cabine sur des climatiseurs neufs, sans altération des échanges thermiques.
La partie intérieure du climatiseur s’altère plus vite, car l’humidité présente sur la batterie de condensation accélère la corrosion. Le mélange de l’hydrogène sulfuré avec la condensation génère une eau acide qui corrode l’ensemble des tuyauteries en cuivre, jusqu’à les rendre poreuses. Créant ainsi des fuites de gaz irréparables. Le processus d’oxydation est identique sur l’unité extérieure. Mais celui-ci est plus lent, car il n’y a pas de condensation sur cette partie du climatiseur.
Le climatiseur neuf est intégralement démonté et les parties électriques sont isolées. Chaque unité (intérieure et extérieure) passe dans un sas de nettoyage.
Un détergent biodégradable élimine toute graisse afin d’optimiser l’adhérence du traitement.
Une fois secs, les échangeurs entrent en cabine pour recevoir trois produits :
- une couche d’apprêt
- un traitement plastifiant imperméable sur l’ensemble des pièces en cuivre.
- un vernis protecteur - véritable bouclier – est appliqué en finition sur l’ensemble de l’appareil.
Le climatiseur est ensuite remonté à l’identique et remis en boîte.
Les peintures anticorrosion ne résistent pas toutes aux gaz H2S. Le choix du produit est donc primordial pour une efficacité dans le temps. Aqua Aero est conçu pour résister à n’importe quel taux de concentration d’H2S dans l’air.



Ce traitement protège les échangeurs contre l’usure et la corrosion, quelle que soit son origine (air salin, sulfure d’hydrogène, humidité…).
Non seulement la durée de vie de l’appareil est allongée, mais il conservera plus longtemps sa puissance frigorifique et son rendement énergétique initial. Ce qui lui permet de consommer moins d’énergie tout au long de sa vie.
FROID EXPRESS offre une garantie anticorrosion par les sargasses de 3 ans sur tous les climatiseurs traités.
Froid Express
469 ZI de la Lézarde
Immeuble Talic
Le Lamentin
0596 50 67 77
froidexpress.com
Des partenaires, notamment le laboratoire des matériaux et molécules en milieu agressif (L3MA) de l’UFR STE (Sciences Technologies Environnement), recherchent actuellement des substances inhibitrices de ce phénomène de corrosion, et tout particulièrement des solutions naturelles issues de la biodiversité tropicale.
L’étude de dégradation des matériaux est toujours en cours.
Cette étude concerne la corrosion marine, microbienne qui se produit sous la surface de l’eau et s’observe, par exemple, sur les pylônes de pontons immergés, sur les coques de bateau… En effet, la communauté microbienne qui se développe à l’intérieur des bancs de sargasses serait potentiellement agressive pour les métaux.
Ici, il est question d’une corrosion liée à l’encrassement des surfaces par des communautés vivantes qui accompagnent les bancs de sargasses. Ce volet s’avère plus exploratoire puisqu’il vise à identifier les générateurs de corrosion. Il inclut aussi la recherche de solutions pour pallier cet encrassement des surfaces, soit un antifouling naturel qui protègerait la surface des métaux.
Ce volet est mené en partenariat avec l’Institut d’étude en droit public qui travaille avec des spécialistes du droit de l’environnement, mais aussi avec Ecomobil (qui récupère des électroménagers endommagés par ce type d’avarie) ainsi qu’avec des assureurs couvrant ce type d’appareils.
L’objectif est de dresser un inventaire en termes de lois ou de décrets susceptibles de protéger les victimes.




Un bilan sera établi et sera assorti d’une comparaison avec d’autres régions qui subissent les mêmes dommages. À l’issue de cette étude, l’Institut proposera des solutions, un projet d’indemnisation, de protection des usagers qui pourront se faire dédommager sur base du constat des dégâts.


La fin du projet global est prévue pour décembre 2023.

Le projet Corsair a pour ambition d’étudier l’impact de ces algues sur les corrosions atmosphérique et marine

Batimat, Idéobain, Interclima
Salon mondial de la construction
3 au 6 octobre 2022 - Paris Expo Portes de Versailles - Paris
Bâtir
Salon de la construction, de la rénovation, de la décoration de l’habitat
05 au 14 mars 2022 - Acropolis - Nice
Energie Habitat
Salon du bâtiment, de l’énergie et de l’habitat
18 au 22 mars 2022 - Parc des Expositions - Colmar
Piscine Global Europe
15 novembre 2022 - Eurexpo - Lyon
Carrefour international du bois
1 au 3/06/2022 à Nantes
NordBAT
Le rendez-vous incontournable pour l’ensemble des professionnels de l’acte de construire des régions nord de la France
31/03 au 01/04/2022 à Euralille - Lille
Sèvres & Bat
4/3/2022 à Niort
Eurobois
Salon des équipements et techniques de la transformation du bois et du bois matériau
1 au 4/2/2022 - Eurexpo - Lyon
Salons Bio & Co
Salon de la bio et de la construction saine
01 au 03 avril 2022 - Parc des expositions
Micropolis - Besançon
AquiBAT
2 au 4/3/2022 au Parc des Expositions de Bordeaux à Bordeaux
Architect @ work
Salon de l’architecture et de l’architecture
d’intérieur
11 et 12/05/2021 - Parc Chanot à Marseille
Bautec
Foire allemande internationale de la construction
22 au 25/02/2022 - Messegelände - Berlin
Dach + Holz International
15 au 18/02/2022 à Cologne
Light & Building
Le salon leader mondial des technologies
d’éclairage et de construction
13 au 18/03/2022 - Exhibition CentreFrancfort
Holz-Handwerk
29/03 au 1/4/2022 à Nuremberg
International Hardware Fair
Salon des matériaux de construction et de bricolage
06 au 09 mars 2022 - Exhibition CentreCologne
Farbe - Ausbau & Fassade
Salon professionnel international de la peinture et de la décoration
9 au 12 mars 2022 - Exhibition CentreCologne
Holz & Bau
Salon professionnel pour la construction en bois

31/08 au 3/09/2022 à Klagenfurt
Batibow
Salon international du bâtiment, de la rénovation et de la décoration.
19 au 27/02/2022 à Brussels Exhibition Center - Bruxelles
Bois & Habitat
Salon de la construction en bois, de l’aménagement et des énergies nouvelles
Juin 2022 - Namur Expo - Namur
Construtec
Salon international des matériaux de construction et des solutions pour le bâtiment
15/11/2022 - Ifema - Parque Ferial Juan
Carlos I - Madrid
Archistone
Salon international de la construction en pierre naturelle
15 au 18 nov. 2022 - Ifema - Parque Ferial
Juan Carlos I - Madrid
Issa Interclean Europe
Salon industriel du nettoyage industriel, de la maintenance et des services au bâtiment
10 au 13 mai 2022 - RAI International Exhibition and Congress Centre - Amsterdam
Homebuilding & renovating show
Salon de la construction de la maison et de sa rénovation
21et 22/05/2022 - Scottish Exhibition and Conference Center - Glasgow
IFSEC International
Salon international de l’industrie de la sécurité
17 au 19 mai 2022 - Excel - Londres
Bauma CTT Russia
Salon international du bâtiment et de la construction
24 au 27/05/2022 - Crocus-Expo IEC –Moscou
MIR STEKLA
Salon international de l’industrie du verre. Fabrication, process, matériaux et applications
06 au 09 juin 2022 - Expocentr’ Krasnaya
Presnya Fairgrounds - Moscou


Défiscaliser vos investissements pour résister à la crise sanitaire et être présent lors de la reprise économique
Son professionnalisme de plus de 20 ans positionne ECOFIP comme un des leaders de la place sur le métier de la défiscalisation. Rencontre avec le directeur de Martinique, M. de Franciosi.
Les secteurs les plus touchés par la pandémie sont globalement non éligibles à la défiscalisation, tels que la restauration ou l’événementiel. Ainsi, ECOFIP a pu « résister » ces deux dernières années grâce à une base de clientèle fidèle issue de secteurs qui ont pu continuer à investir comme le BTP, l’agriculture et l’artisanat, même si l’arrêt du secteur touristique nous a beaucoup impacté. En terme de bilan, l’année 2021 est restée dynamique avec l’arrivée de nouveaux clients dans l’agriculture, l’artisanat et le BTP en plus d’une légère reprise de l’activité des loueurs de voitures sur le dernier quadrimestre 2021.
La stratégie est de poursuivre notre développement sur notre cœur de métier qui nous réussit depuis plus de 20 ans, mais aussi de mieux s’organiser pour développer plus encore la défiscalisation sur les dossiers de montants importants qui nécessitent l’obtention d’agrément fiscal que ce soit en Girardin classique ou en crédit d’impôt
pour l’investissement productif outre-mer. Banquier durant 25 ans et ayant pratiqué la défiscalisation avec agrément pendant 10 ans, je sais de quoi je parle. Chaque région outre-mer est différente et la Martinique a un tissu économique spécifique composé de grands groupes qui n’ont plus accès à la défiscalisation GIRARDIN. Depuis 2015, ces groupes ont l’obligation d’utiliser le mécanisme du crédit d’impôt outre-mer et c’est donc une option que nous devons proposer à ce type de clients. Bien entendu, notre tissu économique est aussi composé de nombreuses PME et TPE qui peuvent bénéficier de la défiscalisation Girardin et nous resterons hyper présents dans ce domaine.
ECOFIP est un facilitateur de financement des investissements pour nos entreprises martiniquaises. Nous intervenons tout d’abord en injectant du cash dans les opérations d’investissements de nos clients. Cette aide au financement va de 25 à 30 % du montant de l’investissement ce qui réduit considérablement le coût final pour nos clients. De plus, ce cash ne leur coûte rien (ni taux d’intérêt, ni remboursement). Enfin, nous accompagnons aussi nos clients dans la recherche du financement bancaire complémentaire. Nous travaillons avec les banques de la place et les sociétés de financement avec l’objectif de ‘’boucler leur plan de financement dans les meilleurs délais’’.
Notre équipe a ‘’le client en tête’’ et reste à son service pour l’orienter et le conseiller au mieux, car le respect de la règlementation fiscale est une chose sérieuse et parfois compliquée.

Facilitateur de financement des investissements pour nos entreprises martiniquaises
Quelle aide au financement des investissements du tissu économique martiniquais ?
Trä & Teknik - Wood
30/08 au 02/09/2022 à Göteborg
Nordbygg
Le grand salon nordique de la construction
26 au 29 avril 2022 - StockholmsmässanStockholm
Swissbau
Salon de la construction
18 au 22/01/2022, Basel Fairground - Bâle
HOLZ
Salon suisse de la menuiserie
11 au 15/10/2022 - Basel Fairground - Bâle
Architect@work
Salon de l’architecture et de l’architecture d’intérieur.
6 et 7/04/2022- Enercare Center - Toronto
Expo Grands Travaux

Salon des grands travaux et des équipements lourds
29 au 30 avril 2022 - Centre BMO Espace
Saint-Hyacinthe - Québec
Atlantic Heavy Equipment show
Salon des professionnels de la construction, le camionnage, les travaux publics, la construction de routes, la maintenance
13 au 14 octobre 2022 - Moncton Coliseum
Complex - Moncton
International Builder’s show
Exposition internationale du bâtiment
08 au 10 fév. 2022 - Orlando
Chicago Build
31/03/2022, Chicago
New York Build Expo
Le grand salon du bâtiment et du design
1 au 3/3/2022 à Jacob Javits Convention Center à New York
Injection molding & design Expo
Salon du marché de l’injection et du moulage de plastiques
16 au 17 mars 2022 - COBO Convention
Center - Detroit
BatiMat ExpoVivienda
Le grand salon argentin de la construction et du bâtiment
29/6 au 2/7 2022 - La Rural Predio FerialBuenos Aires
Intersec Buenos Aires
Salon international de la sécurité, de la protection contre le feu, de la sécurité, industrielle et personnelle
24 au 26/08/2022 - La Rural Predio FerialBuenos Aires
Feicon Batimat
Salon professionnel international de l’industrie de la construction
29/03 au 1/04/2022 - Sao Paulo Expo Exhibition Center - Sao Paulo
Fenahabit
Salon de la construction, de l’architecture, de l’ingénierie. Produits et services pour l’habitat et l’immobilier
19 au 23/5/2022 - Parque Vila GermanicaBlumenau
Fesqua
Salon des fenêtres, façades, portes et leurs composants
14 au 17/9/2022 - Sao Paulo
Expo Exhibition CenterSao Paulo
Interieurs Australia
10/02/2022, South Wharf
ARBS
Salon professionnel de l’air conditionné, de la réfrigération et des services au bâtiment 27au 29/4/2022 - Melbourne Exhibition & Convention Centre - Melbourne
AFRIQUE
Smart Skyscrapers Summit
Forum des gratte-ciel intelligents et durables 23 et 24/11/2022 - Sofitel de Dubai - Dubaï
Lightexpo Africa / Buildexpo
04/05/2022 - Kigali - Rwanda
Decorex
Salon du design et de la décoration intérieure
16 au 19/06/2022 - International Convention Center - Le Cap
Frigair
Salon de l’air conditionné, de la ventilation
2 au 4/6/2022 - Gallagher Convention Center - Johannesburg

Direction de l’environnement, de l’aménagement et du logement
Avec des sols instables, des reliefs escarpés et des pluies souvent intenses, la Martinique est fortement exposée aux risques de glissements de terrain susceptibles de causer de nombreux dégâts. De plus, les constructions se concentrent souvent sur de petits espaces, imperméabilisant les sols et rendant certaines zones encore plus vulnérables.

Comment se prémunir du risque de glissement de terrain ?
Le territoire est couvert par des plans de prévention des risques naturels (PPRN) qui réglementent les constructions en fonction des niveaux d’aléas naturels. Ces outils s’imposent aux documents d’urbanisme des communes ; ils identifient les zones dangereuses où la construction est interdite ou autorisée sous conditions techniques particulières telles que la réalisation d’études de sol et le respect des préconisations constructives formulées par ces études (www.pprn972.fr).
Le respect des PPRN permet de se prémunir des risques de glissement de terrain.
Comment protéger sa maison ?
Une grande partie des dommages peut être évitée par des actions simples visant à prévenir les glissements de terrain, à mettre en sécurité sa maison et à protéger sa responsabilité en cas de sinistre.
La structure de la maison doit être conçue dans les règles de l’art en faisant appel, de préférence, à des professionnels pour la conception et la construction
Il s’agira, par exemple :
• de renforcer les chaînages (poteaux, poutres en béton armé ceinturant un bâtiment pour le renforcer) horizontaux et verticaux des murs en maçonnerie ;
• d’améliorer la résistance des fondations en les élargissant ou en les approfondissant par reprise en sous-oeuvre ;
• de lier les fondations isolées par un réseau de longrines (poutres en béton armé)
• de renforcer la résistance des murs de soubassement.
De bonnes pratiques permettent de se protéger des coulées de boues en faisant obstacle au matériaux en provenance du versant pour les empêcher d’atteindre les personnes dans l’habitation :
• renforcer la façade exposée à la coulée ;
• réaliser des ouvrages de déviation dans le versant en amont de la maison ;
• réaménager l’espace intérieur pour mettre en sécurité les pièces de sommeil
• densifier le couvert végétal dans le versant.
Les pentes doivent être sécurisées :
• décaisser un terrain doit être compensé par la conception d’un mur de soutènement réalisé par un professionnel, car un creusement provoque une décompression du sol en amont et son instabilité ;
• entretenir les murs de soutènement régulièrement,
2 fois par an ou après de fortes pluies, notamment
en curant les barbacanes pour que l’eau qui pousse derrière le mur puisse s’évacuer librement.
Dans les zones les plus sensibles, la gestion des eaux de surface doit être réalisée avec le plus grand soin :
• limiter l’infiltration des eaux dans les sols en canalisant les écoulements jusqu’à une ravine naturelle ou un collecteur prévu à cet effet ;
• entretenir régulièrement les dispositifs de drainage et d’assainissement ;
• vérifier l’absence de fuite des canalisations. L’eau dans les sols est, en effet, l’une des principales causes de glissement de terrain.
Téléchargez le guide
« Glissements de terrain en Martinique » : http://www.martinique.developpement-durable.gouv.fr/ IMG/pdf/glissement-martinique_hd.pdf

martinique.developpement-durable.gouv.fr

Dans les années 1960, l’amiante était largement utilisé dans les constructions. S’il est interdit depuis 1997, de nombreux bâtiments en contiennent encore. Lorsque le désamiantage ou l’encapsulage n’est pas possible ou trop coûteux, et que l’amiante est présent au sol, la technique du recouvrement permet de ne pas être en contact direct avec cette substance. Pour répondre à cette problématique, Beauflor propose une gamme spécifique nommée « Résitex ». Il s’agit d’un revêtement de sol en vinyle, une structure en sept couches, qui isole parfaitement de l’amiante. Il se pose facilement, et propose des finitions esthétiques. De plus, il peut être posé en milieu occupé. La pose ne nécessitant pas d’intervention directe sur l’amiante, l’entreprise en charge des travaux n’a pas besoin d’être certifiée.
Concernant sa composition, le fabricant souligne qu’il ne contient pas de métaux lourds, solvants, formaldéhydes, phtalates ou plastifiants nocifs pour la santé. En PVC, il est également 100 % recyclable, et conçu pour minimiser son impact sur l’environnement.
Côté esthétique, la gamme propose de nombreux styles et finitions qui répondent aux tendances de décoration intérieure actuelles, avec des effets parquets aux teintes naturelles, bétons cirés ou carrelages. Ce revêtement de sol peut à la fois être utilisé pour un usage résidentiel élevé ou pour un usage commercial modéré (bureaux, boutiques, chambres d’hôtels etc).

Créé par Alphi et K-Ryole, Kross Builder (chariot de manutention électrique français) a été développé pour transporter jusqu’à 500 kg de matériel sans effort. Un module spécifique, co-conçu par les deux sociétés partenaires, permet de déplacer facilement les étais, cadres et poutrelles de coffrage, ainsi que les éléments de tours d’étaiement. Grâce à son bac bennable, les étais peuvent être chargés pratiquement à la verticale.
Le module favorise ainsi la réduction des TMS et de la pénibilité pour les compagnons sur les chantiers. Sa technologie calcule 100 fois par seconde l’effort de l’utilisateur. Ce chariot est assisté par une technologie d’annulation d’effort et se manipule simplement à l’aide d’une poignée. En poussant ou tirant la poignée, les moteurs (2 x 1500 Watts) réagissent instantanément pour annuler le poids du chariot et de son chargement. La prise en main est intuitive et simple. (bouton unique). Une télécommande de contrôle permet de gérer l’inclinaison du module. Ainsi, sans formation ni Caces, les opérateurs peuvent déplacer des centaines de kilos de matériel, comme si c’était un caddie vide ! Une innovation qui contribue en outre à augmenter la productivité sur les chantiers. En utilisation intensive, il affiche une autonomie de deux jours, et trois à quatre jours en utilisation normale.
Le Kross Builder 500, un chariot sans Caces pour mécaniser la manutention horizontale et supprimer ainsi la pénibilité



SAP RO c’est lepa rten aire de vosproje ts de con stru ct ionetde r én ovat ion , deséquipesàl’écoute,tantdesparticuliersquedesprofessionnelsdubâtiment.





Ch ez SA PRO vous t rou verez forcem e nt l e c arrel age, la faï en ce, les s a nitai res et la p e int ure qui rép on dron t àvo s envi es.




Grande résistance
Pour répondre aux réglementations actuelles, la résistance des menuiseries Aluminium et PVC est désignée par une classification AEV (éléments Air Eau Vent). Elle est définie à la suite d’essais réalisés en centrale d’essai où de puissants ventilateurs mêlés avec de l’eau (simulation de la pluie) recréent des conditions météo extrêmes sur de longues périodes. La menuiserie PVC obtient d’excellents résultats et est même supérieure en matière d’étanchéité à l’eau et à l’air. Toutes les menuiseries PVC fabriquées par l’Atelier Sagip passent les exigences de classement à l’air, à l’eau et au vent demandées aux Antilles : A3, E7, V4.
Excellente résistance à l’écrasement et aux chocs
Les fenêtres PVC de l’Atelier Sagip utilisent des profilés PVC renforcés plus rigides et plus élégants qui permettent d’offrir une plus grande surface vitrée et une plus grande résistance mécanique.
Dans le retardement à l’effraction, la quincaillerie est déterminante
La matière d’une menuiserie n’a pas ou peu d’influence sur la résistance de la menuiserie face à une tentative de cambriolage. En effet, il y va surtout du choix de la quincaillerie et du nombre de points de
fermetures : nombre de points de verrouillage de la menuiserie (3 points ou 5 points), qualité des crémones et des gâches, etc.
Les fenêtres PVC offrent les mêmes performances que celles en bois au niveau de l’isolation thermique, elles ne conduisent pas la chaleur et permettent ainsi de garder son habitat frais. Elles sont en moyenne 25% plus isolantes que des fenêtres en aluminium de même dimension. Plus les baies sont petites, plus cet avantage est important (pour maintenir une pièce fraîche ou pour empêcher la chaleur de faire monter la température).

Les assemblages soudés d’une fenêtre PVC sont garants d’une parfaite étanchéité à l’eau dans les angles. Côté entretien, le PVC sera votre ami : de l’eau savonneuse suffit sur les profilés.
Le PVC, isolant naturel, requiert peu d’énergie à extruder (2,5 fois moins d’énergie que l’aluminium) et se recycle à 100 %. L’atelier Sagip utilise une matière de première extrusion, homologuée DOM TOM par le CSTB pour sa haute résistance aux UV (BV 14684-1). Elle garantit la meilleure densité́ des profilés et une excellente finition de surface. Cette haute qualité́ permet aussi au blanc de rester blanc et de ne pas jaunir, c’est garanti.
Enfin, le PVC utilisé par l’Atelier Sagip résiste à l’air salin, aux rayons du soleil et est doté de propriétés anti-moisissures.
Palmex International est un produit unique conçu au Canada en 2003. Au fil des ans, l’entreprise a acquis une solide réputation, fondée sur la qualité et la durabilité de ses revêtements et toitures tropicales synthétiques.

En effet, ces solutions sont permanentes, résistantes et recyclables, parfaitement conçues pour nos climats. Et surtout ces revêtements, similaires aux toitures traditionnelles naturelles, confèrent un cachet exceptionnel aux bâtiments qu’ils recouvrent.


Ces matériaux de toiture, couverture, de surface et de décor en «chaume artificiel» reproduisent des matériaux naturels utilisés sous les tropiques : roseau asiatique, paille africaine, feuille de latanier, bambou… et sont classés selon deux gammes différentes selon l’aspect désiré. Quelle que soit la gamme sélectionnée, chaque produit signe des performances intéressantes.
Ces matériaux écoresponsables correspondent aux impératifs de construction et de développement durable :
• Garantie : 20 ans
• Durée de vie : 50 ans
• « Recyclabilité » des matériaux
• Production sans déchets
L’entreprise possède une certification liée à ISO 9001:2015 (Systèmes de management de la qualité).
• Imperméabilité assurée
• Résistance certifiée aux vents jusqu’à 260 km/h (160 mph)
• Résistance certifiée aux rayons UV et à la décoloration
• Version ignifuge à la demande
• Excellent isolant thermique
• Protecteur de charpente
• Aucune formation de pourriture ou de moisissure
• Aucun attrait pour les insectes, oiseaux ou nuisibles
• Certification du CSTB.
• Installation rapide et facile
• Aucun remplacement ni réparation de feuilles nécessaires
• Aucun entretien général ni nettoyage régulier.
Grâce à des alvéoles contenant de l’air entre chaque feuille, les toitures offrent une haute protection contre la chaleur. De plus, leur matière est conçue pour laisser ruisseler l’eau de pluie rapidement afin d’en assurer une évacuation rapide.
A la demande, un produit ignifuge peut être injecté lors de fabrication des feuilles de palme.










En activité depuis 2016, l’entreprise, dirigée par Julie Bérénice, fait partie d’un groupe industriel local, fabricant de matériaux de construction.
TOP Martinique est membre du réseau TOP qui réunit des experts, apporteurs de solutions sur-mesure dans la fabrication d’éléments de couverture en métal (enveloppe métallique du bâtiment, pannes…) auprès de professionnels et particuliers depuis près de 20 ans.

Composée d’une dizaine de collaborateurs, Top Martinique se concentre sur la qualité des produits et des services, quel que soit le projet de construction, de rénovation ou d’extension. L’entreprise a ainsi bâti une relation unique avec la clientèle, largement basée sur son savoir-faire reconnu : profilage de tôles par formage à froid (profils ondulés et nervurés), production d’accessoires de couverture, pliage (standards et sur-mesure) et création de lames de façade. Une maîtrise qui autorise la fabrication locale des produits en 48 h selon les normes DTU avec une garantie de dix ans.
La réactivité et le professionnalisme caractérisent l’enseigne, au même titre que la qualité de ses tôles en acier et en aluminium travaillées avec beaucoup de dextérité. Mieux, sa connaissance approfondie de l’aluminium permet aujourd’hui à Julie Bérénice de le recommander spécifiquement pour les couvertures. Elle s’en explique : « Ce matériau affiche un rapport résistance/poids parmi les plus élevés des métaux. Trois fois plus léger que l’acier et doté d’une malléabilité exemplaire, l’aluminium s’avère un matériau facile à poser. Sa résistance à la corrosion, bien supérieure à l’acier, le destine aux couvertures et bardages tant en bord de mer qu’à l’intérieur des terres. Effectivement, même à faible épaisseur, une feuille d’aluminium
est totalement imperméable. Générant naturellement une autoprotection, il présente la propriété de passivation, signant par la même occasion une meilleure adhérence pour les colles et les peintures. Avec une palette déclinée selon 12 coloris, un pouvoir réfléchissant supérieur à celui de l’acier, un caractère écologique et une «recyclabilité» à 100%, l’aluminium s’avère un matériau idéal sous nos latitudes. »


Dans une approche visionnaire, Top Martinique a constitué un stock important d’aluminium qui concurrence sérieusement l’acier, dont le prix et la disponibilité sont devenus incontrôlables. Une opportunité de passer à l’aluminium et de bénéficier de tous ses atouts.
Pour obtenir des renseignements, un devis ou passer commande, TOP Martinique est joignable par téléphone au 0596 73 10 02 ou par WhatsApp au 0696 25 40 75 ou encore par mail : contact@top-martinique.com
TOP Martinique
Z.I de Champigny
Ducos
(à l’entrée de la Z.I, 1er rond-point à gauche)

Les limites de nos modèles de construction basés, entre autres, sur le béton sont atteintes (responsable d’émission de gaz à effet de serre, production énergivore, épuisement de certains constituants de base, dont le sable constructible…). Son impact est carrément négatif à de nombreux égards.
À la faveur de ce constat, il est urgent de réduire notre dépendance aux importations et contribuer aux développements de matériaux locaux adaptés aux climats de nos territoires, une démarche entamée par de nombreux acteurs antillais.

Parmi eux, des matériaux biosourcés ou géosourcés sont susceptibles de répondre aux enjeux d’un développement plus soutenable. Pour rappel, un matériau biosourcé contient une teneur variable en biomasse végétale ou animale (bois, bagasse, laine de mouton…) et un matériau géosourcé est issu des ressources d’origine minérale. Le plus souvent locaux et peu transformés, ces écomatériaux ont une empreinte carbone plus faible. Ils représentent également une opportunité de sortir d’une logique unique pour aller vers une logique plus globale qui tient compte des ressources d’un territoire, de leurs diversités, de leurs caractéristiques techniques, etc. afin de placer «le bon matériau au bon endroit». Demandant souvent moins de transformations (terre crue, pierre sèche…), les écomatériaux présentent une empreinte environnementale plus faible.
C’est le terme générique le plus souvent utilisé pour parler des matériaux disposant de critères sociaux et environnementaux. Bruts ou transformés, le plus souvent locaux, ils se composent d’une diversité de produits d’origine naturelle ou issus du réemploi. La ouate de cellulose par exemple est issue de journaux et papiers recyclés ; en Martinique, les granulats de verre recyclés sont utilisés en terrassement, etc.

Pouvant être utilisés tant dans les produits de construction, de décoration ou encore de mobilier urbain, les écomatériaux sont présents sur une large gamme de produits : isolants (panneaux ou rouleaux), éléments de structures (bétons végétaux, briques…), peintures, papiers peints, etc. En effet, en construction tout comme en rénovation, leurs applications ne manquent pas.
Ces matériaux possèdent les performances techniques et fonctionnelles habituellement exigées dans le secteur du bâtiment. Comme tout autre matériau de construction, ils répondent à des normes, disposent d’avis techniques et doivent être mis dans les conditions d’utilisations conformes à leur destination (DTU).
La loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte a confirmé l’intérêt d’utiliser des matériaux biosourcés dans le secteur du bâtiment, car ils participent au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources. Une qualité qui les propulse au cœur de la performance environnementale des bâtiments.
Les matériaux importés sont pour la plupart pétrosourcés (origine pétrochimique - matériaux à fort impact carbone). Les produits locaux peuvent l’être également, mais ils signent un bilan carbone plus faible puisqu’ils sont produits localement (sans transport).

La terre
Comme on peut le voir dans l’hexagone ainsi que dans d’autres territoires d’outre-mer (Guyane, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, etc), la terre représente de plus en plus une alternative au béton. Plus encore que le bois, c’est l’écomatériau par excellence. La ressource en terre est en effet quasi illimitée et recyclable à l’infini en l’état. Elle pourra être prélevée sur site et ne nécessitera alors aucun transport (ou quasi) et ne génèrera pas de déchets. Utilisée « crue », elle n’émettra pas de gaz à effet de serre, nécessitera peu d’énergie (contrairement à la terre cuite) et… elle ne coûtera rien ! Pas étonnant dès lors que l’habitat en terre crue abrite pas moins de 2 milliards de personnes, dans 150 pays différents.
Crue ou cuite et façonnée en briques, elle constitue un des éléments de base d’une construction. La terre, excellent régulateur hygrométrique, est dotée de très bonnes performances thermiques et phoniques. Néanmoins, la terre demeure sensible à l’infiltration d’eau et il conviendra de mettre en œuvre les dispositions constructives permettant de la protéger (débord de toit, soubassement en pierre ou béton)
avec une attention portée à la jonction des éléments de toitures, réalisation d’enduits, etc.
Construire en terre, c’est construire avec un matériau qui se trouve sous nos pieds. Aussi, la nature de cette terre, ses priorités (différentes d’un endroit à l’autre dans sa teneur en sable, limon et argile) va influer sur le mode constructif choisi. Cependant, il est également possible de modifier la formulation d’une terre (ajout de liant, etc.) afin de la rendre plus apte à l’usage qu’on souhaite lui conférer.
Ainsi, plusieurs techniques existent pour la stabiliser : ajout de composés organiques d’origines végétales (fibres, copeaux …), animales (blancs d’œufs…), ou minérales (chaux, etc.). À noter que les stabilisants vont souvent avoir comme objectif d’améliorer les caractéristiques techniques de la terre et pas uniquement sa sensibilité à l’eau. Certains d’entre eux ne visent qu’à limiter le craquellement en cas d’argile gonflante, par exemple, ou encore, améliorer sa capacité isolante.


Ci-dessous sont présentées les techniques les plus couramment utilisées :
Murs composés d’éléments :
- L’adobe : brique de terre crue, moulée et séchée au soleil.

- La brique de terre compressée : version moderne de l’adobe, la BTC requiert l’utilisation de presse manuelle, mécanique ou hydraulique.
- La brique de terre compressée stabilisée au ciment ou chaux pour améliorer la résistance mécanique de la terre.
Murs coffrés :
- Le pisé, pour lequel la terre est coffrée entre 2 banches.
- La bauge, un mélange terre-paille façonné
Murs à ossature bois :
- Le torchis, mélange de terre et fibres végétales disposé entre les éléments porteurs en bois d’une construction.
L’ADEME Martinique a entamé une étude portant sur l’utilisation du bambou et de la terre crue en construction. Les réflexions se fondent sur l’architecture vernaculaire utilisatrice de terre crue, l’identification des connaissances de constructions en milieu tropical humide, étude des propriétés hygrothermiques, identification des acteurs en Martinique, etc.
Du centre au sud on y trouve une terre argileuse alors qu’au nord il s’agit d’une terre plutôt limoneuse à sablonneuse.
Si la construction en terre n’est pas récente et fait partie de notre patrimoine vernaculaire, son utilisation dans la construction «moderne» reste récente et toutes les techniques terre ne disposent pas encore de règles professionnelles. S’il manque encore des travaux dans ce domaine, on peut cependant remarquer les avancées de la Réunion qui a rédigé des règles professionnelles pour la BTC qui ont été traduites également pour la Guyane. Ces démarches sont inspirantes et contribuent à faire avancer la création de filières.

En Martinique, la Poterie des Trois-Ilets représente le seul site d’extraction d’argile actuellement exploité. En fait, l’extraction s’effectue sur deux sites : « La Pointe », à proximité de la poterie, il s’agit d’une marre d’où on extrait les argiles dites « maigres ». L’argile nécessaire à la production annuelle de la poterie y est extraite en une fois par an.

Un second site pour les argiles dites « grasses » : un grand pré autour de la poterie.

L’argile y est extraite sur une profondeur de deux mètres, après fauchage. Et la quantité d’argile extraite actuellement s’élève à 20 à 25 000 tonnes par an. Pour un marché en terre crue, il faudrait ajouter un volume d’extraction de 30 000 tonnes/an/carrière, ce qui ne créerait aucun problème d’approvisionnement pour ce nouveau marché.
L’utilisation de la terre dans le bâti en Martinique interroge. De quel type de terre disposons-nous ? Pour quelle utilisation ? Que ce soit au travers d’innovations dans les procédés constructifs (comme Ayembao), de réappropriation ou d’adaptation de techniques ancestrales ou de réalisations en test grandeur nature (Opération Habitat Renouvelé du Prêcheur), plusieurs initiatives émergent en Martinique et tentent de répondre, à leur échelle à ces interrogations. Associé à divers projets d’expérimentation sur la terre avec un GT dédié, Kebati a réalisé des visites de sites (dont une au Vauclin grâce à l’association Permadomia) et a pour objectifs d’étudier les terres de Martinique et d’explorer les pistes d’emploi.
FABRICATION SUR MESURE DE MENUISERIES EXTÉRIEURES EN ALUMINIUM ET PVC

Grand choix de menuiseries : porte-fenêtres, baies coulissantes, jalousies sécurity, gardes-corps, moustiquaires, protections sliding, volets roulants ...
LARGE GAMME DE VITRAGE
Isolation acoustique - contrôle solaire - verres feuilletés de sécurité.





FABRIQUANT DE LA MARQUE TECHNAL
Menuiseries conformes aux normes AEV et anticycloniques

Large choix de finitions laquées - Labellisées Qualicoat et Qualimarine

Innovation brevetée, l’AYEMBAO® est l’alliance de la structure en ossature bois et de la terre cuite.
DJE Constructions fabrique, en construction modulaire et sur mesure, des pans de murs en AYEMBAO® qui respectent la RTAADOM et assurent un rafraîchissement naturel qui génère des économies d’énergie.

Comment ? Les températures maximales en Martinique atteignent régulièrement 32°C et tendent à augmenter en raison du réchauffement climatique. La journée la plus longue sous nos latitudes étant de 12 heures, les pans de mur en AYEMBAO® permettent aux bâtiments de bénéficier d’un déphasage de 15 heures.

En d’autres termes, ces pans de murs ne restituent la chaleur emmagasinée en journée qu’après 15 heures d’exposition continue, garantissant ainsi un confort thermique stable.
Il faut savoir qu’une construction classique en béton emmagasine la chaleur extérieure en moins de quatre
heures et la restitue tout au long de la journée avec un pic de restitution en début de soirée. En découle une augmentation de l’utilisation de la climatisation, donc une surconsommation électrique.
Jennifer Baratiny ajoute « nous souhaitons également développer un processus de recyclage de la terre (après récupération de terres de terrassement considérées comme déchets ultimes) afin de l’analyser et de la reconditionner sous forme de matière première, la terre cuite, élément indispensable à la fabrication des pans de murs en AYEMBAO®. L’objectif étant de contribuer à la baisse des consommations électriques, notamment en réduisant l’utilisation de la climatisation dans les immeubles construits en AYEMBAO®. »











Première société à avoir développé le concept du bâtiment hors site aux Antilles, Bimini continue à répondre rapidement et de façon de plus en plus sophistiquée aux demandes de constructions sur mesure en Martinique et en Guadeloupe.
Le hors site, un concept à l’avenir toujours plus prometteur Rien d’étonnant à ce que la construction hors site (80 % du travail effectué en atelier) s’impose toujours plus. D’une part, la crise sanitaire a pointé certaines failles du système traditionnel de construction. En effet, l’écosystème actuel d’un chantier repose sur un ensemble de petites entreprises susceptibles de s’arrêter – pour raisons sanitaires, financières, aléas climatiques… - du jour au lendemain, retardant ainsi l’ensemble d’un chantier. Le mode de fabrication du bâtiment hors site n’est absolument pas concerné par ce type d’aléa. La production continue, quoiqu’il arrive.
D’autre part, le concept du bâtiment hors site repose sur des valeurs très écologiques. Avec des ressources recyclables, la suppression de nuisances liées au chantier, la réduction de déchets, la maîtrise de l’empreinte écologique et les performances énergétiques, ce mode de construction répond aux grands défis contemporains.
Enfin, cette technologique réunit d’autres atouts déterminants, comme la rapidité de conception et de montage, la configuration et l’aménagement sur mesure (y compris la mise en conformité aux normes exigées).
Bimini sur le marché du reconditionné
Ce type de fabrication ne fige aucun ouvrage dans le temps, aussi, séduit-il par le caractère réversible et évolutif de ses bâtiments tout en limitant la production de déchets liés à une démolition.
Parfaitement inscrit dans l’économie circulaire, Bimini propose des bâtiments qui, recyclés, se transforment pour connaître plusieurs vies (bureaux, crèches, vestiaires, club house, base de vie…). Démonté, vérifié (ossatures et panneaux), réaménagé selon les besoins du client, un bâtiment modulaire se reconditionne en atelier avant d’être installé chez le client. Tout en offrant un avantage tarifaire non négligeable, ce modèle de réemploi garantit une disponibilité immédiate.
Le service de logistique de Bimini se charge des opérations de désinstallation, de transport et de réinstallation des bâtiments.
Bimini, une solution aux questions urgentes
Avec sa gamme de hangars à structure métallique, de réservoirs sur mesure, parasismiques et para-cycloniques, son parc locatif de bâtiments modulaires et de containers, Bimini apporte des solutions de construction temporaire à des fins événementielles, en cas d’imprévus ou d’urgences.

Bimini Guadeloupe
22 ZAC de Nolivier
Sainte Rose
0590 28 27 50
Bimini Martinique
12, ZAC Les Coteaux Sud
Sainte Luce
0596 68 70 30
bimini.fr
Bimini apporte des solutions de construction temporaire à des fins événementielles, en cas d’imprévus ou d’urgences











Un label qui distingue les entreprises où il fait bon travailler. Et il y en a en Martinique !
Great Place to Work® , de quoi s’agit-il ?
Créé en 1992 aux États-Unis, présent dans 60 pays et en France depuis 20 ans, Great Place To Work® démontre que les organisations les plus performantes sont celles qui placent l’expérience collaborateur au cœur de leur raison d’être et de leur stratégie.
C’est l’acteur de référence en matière de qualité de vie au travail. Il se distingue avec :
- Sa mission : créer une société meilleure en aidant les organisations à devenir des Great places to work pour tous.
- Sa méthodologie de diagnostic structurante, éprouvée par des années de recherche, s’appuie sur 2 outils pour une vision complète de toute organisation : Trust index (un questionnaire adressé aux collaborateurs) et Culture audit (un questionnaire sur les pratiques managériales)
- Son programme de reconnaissance qui constitue le plus haut niveau de reconnaissance de la qualité de l’environnement de travail d’une organisation
Quel est l’objectif ?
Mettre en mouvement des organisations afin de les transformer à travers plusieurs leviers :
• Développer l’engagement des collaborateurs
• Renforcer l’expérience collaborateur
• Réduire l’absentéisme et la rotation des effectifs
• Développer la capacité d’adaptation et d’innovation
• Valoriser la marque employeur via les labels Great Place To Work®
Les bénéfices : Impacter la performance économique avec plus d’engagement des collaborateurs, moins d’absentéisme, moins de turnover.
L’état des lieux aux Antilles ?
De nombreuses organisations antillaises se distinguent déjà par leur performance, la richesse de leurs talents et la qualité des conditions créées pour développer l’épanouissement humain au service de leurs défis économiques.
Depuis 2018, en tant Great Partners Antilles, Jeannine Monlouis Bonnaire leur propose de s’engager dans la démarche Great Place To Work® afin d’évaluer ou faire reconnaître la qualité de vie au sein de leurs structures.
Un véritable projet collectif avec l’ensemble de leurs collaborateurs, au service de leur performance, répondant aux problématiques locales et besoins majeurs de nos organisations antillaises :
- Intégrer la dimension stratégique de l’humain au sein de l’entreprise
Les
ont une performance financière supérieure à la normale
- Poursuivre la restauration du dialogue social
- Donner du sens au travail et agir sur le développement de la motivation, de l’engagement au sein de l’entreprise.

En septembre 2021, avec un résultat remarquable de 87 % de perception positive de l’entreprise par ses collaborateurs, CAA MARTINIQUE a confirmé cette vision en offrant l’immense fierté aux Antilles de compter leur première entreprise certifiée.
Dans des conditions de crise et de profonde remise en question, les organisations gagneraient à faire valoir leur marque employeur et à se distinguer à travers une reconnaissance nationale - et bien entendu locale - de leur capacité à fonder leur succès sur les hommes qui les composent.
C’est dans ce sens que Jeanine Monlouis Bonnaire s’engage et propose ce défi de faire reconnaître nos talents en démontrant qu’aux Antilles, il ne fait pas seulement bon vivre, mais aussi bon travailler…
Great Place To Work®
Jeannine MONLOUIS BONNAIRE
0596 696 45 95 56
monlouisbonnairejeannine12@gmail.com

CAA travaille l’agencement « design » dans les règles de l’art depuis sa création, en Martinique, en 1993. Depuis, l’entreprise a essaimé dans les départements d’outre-mer, en métropole et dans le monde entier, totalisant aujourd’hui 300 compagnons et 11 agences. En s’inscrivant comme la référence en matière de création et d’agencement d’espaces professionnels, l’entreprise collabore avec les architectes et décorateurs les plus exigeants.
Des projets ambitieux…
Donner une cohérence à l’aménagement d’un espace de travail en restituant la dimension souhaitée d’un projet, telle est la mission des 40 collaborateurs de CAA Martinique. Avec une valeur ajoutée : être source de proposition. Saisir l’esprit des lieux pour des hôtels-restaurants/bars, intégrer l’ergonomie et la fonctionnalité dans les bâtiments tertiaires, attirer l’œil du chaland pour sublimer l’accueil d’une boutique, prioriser la sécurité, l’hygiène et le confort dans les établissements de santé,etc. voilà les impératifs dont CAA se saisit avant de restituer des solutions créatives, harmonieuses et sur mesure.

requièrent des experts minutieux
Concrétiser les idées les plus audacieuses nécessite des talents et des compétences. CAA n’en manque pas. Travail des bois massifs et précieux, des métaux, de la résine, du verre, du cuir, de la pierre, des textiles, des peintures, intégration de dispositifs divers et de e-technologies, aucune corde ne manque à l’arc de CAA Martinique pour signer des agencements créatifs, fonctionnels, innovants, hautement technologiques ou artisanaux. Cette large palette de solutions est rendue possible grâce à une veille constante sur les nouveautés technologiques, les matériaux d’avenir et les qualifications associées à l’univers du design.
Une organisation bien huilée
CAA s’organise autour de plusieurs services : structure commerciale, étude avant-projet, coordination, bureau d’études, logistique, atelier, livraison, pose, menuiserie traditionnelle, mobilier sur mesure, résine acrylique, cloisons, faux plafonds, échantillonnage, prototypage … De quoi répondre à toutes demandes créatives et toutes sensibilités architecturales. Et faire de l’agencement un trait d’union entre l’esprit et la main.
CAA Martinique, première entreprise des Antilles/Guyane certifiée Great Place to work. Avec cette certification, CAA Martinique aspire à faire reconnaître tant son excellence technique qu’humaine, caractéristique de son succès, et à créer des conditions favorables à l’engagement collectif.


Architectes : Stanisla Lafosse-MarinEdouardo Chiatelo - Pauline Delbende


- Amélie Aubery

Architecte : Hélène Quillet

CAA Martinique
580 Chemin des Digues

Ducos
0596 51 68 91 caa.martinique@caa-agencement.fr caa-martinique.fr

Architecte : Jeff Van Dyck

Architecte : Dubosq & Génovese



Définition : matériaux issus de la matière organique renouvelable (biomasse), d’origine végétale ou animale, pouvant être utilisés comme matières premières dans des produits de construction et de décoration, de mobilier fixe et comme matériau de construction dans un bâtiment (cf. arrêté du 19 décembre 2012 relatif au contenu et aux conditions d’attribution du label bâtiment biosourcé).


Le bois
En matière de sylviculture, une petite production de bois issus des mahoganys a été mise en place sur l’île par l’Office National des Forêts, à raison de 1200 ha de forêt utilisée pour un rendement d’environ 5.500 m3 de bois par an.

Toutefois, malgré les atouts de ce bois pour l’ébénisterie ou la charpente, les débouchés locaux demeurent limités du fait de la concurrence des bois d’importation (voir article en page 96).
Le bambou
Il existe plus de mille trois cents espèces et quatrevingt-dix genres de bambous répartis dans le monde entier, Amérique, Afrique, Océanie et surtout en Asie, il résiste sous tous les climats même à -20 °C. Ressource quasi inépuisable, le bambou se révèle porteur de nombreuses promesses pour la construction locale.
Matière première naturelle rapidement renouvelable, ses nombreux avantages techniques en font un produit écologique. Le bambou est 27% plus dur que le chêne, sa contraction et sa dilatation par la chaleur sont 50% inférieures à celles du chêne et sa structure particulière en fait une espèce peu sensible aux changements d’humidité relative à l’air.
Un des porteurs de projet de la filière bambou en Martinique au sein de l’association Kebati explique que le bambou s’avère plus solide que l’acier et que, correctement assemblées, les structures en bambou sont résistantes aux séismes et ouragans.
Effectivement, ses qualités physico-chimiques sont impressionnantes. Soumis à des tests de compression, de cisaillement, de tension et de flexion, les bambous de construction (Stenotachya et Guadua en particulier) sont beaucoup plus performants que le Douglas. Soit un excellent matériau de construction.
Afin de développer la filière, un travail doit s’engager au niveau de la R&D (procédés de traitement et de transformation, assurer la stabilité d’approvisionnement), élaboration de normes (fiabilité et qualité de constructions), de certifications, mise en place de formations (porteuses de création d’emplois).
Bambousa vulgaris : espèce invasive
La forte teneur en amidon de cette espèce de bambou la rend plus sensible aux attaques d’insectes xylophages.
Ce type de bambou ne se prête à priori pas à la réalisation de la structure d’un ouvrage, mais il peut convenir parfaitement aux aménagements extérieurs (carbets, volets, revêtements de sols, bardages, etc.).
En Martinique, plusieurs acteurs de type associatif ou même des entreprises travaillent avec ce bambou dans l’objectif de le valoriser.
Bambousa Guadua Angustifolia
Bambou utilisé le plus fréquemment dans la construction.
Il a été introduit en Martinique voilà plusieurs années afin d’être utilisé dans la construction. Faute de marchés et de règles professionnelles, son marché n’a pu se développer. Depuis, il est présent en Martinique, notamment aux jardins de la Bambouseraie Sainte-Marie. Son utilisation est notamment envisagée dans le cadre d’un programme innovant de la commune du Prêcheur au Nord de la Martinique. En effet, dans le cadre du programme « Opérations d’Habitats Renouvelés en Outre-Mer » et du concours d’idées visant à faire émerger des pistes de solutions nouvelles, un jury - sous la coprésidence du directeur de la DEAL de Martinique - a choisi de désigner quatre lauréats.


L’un des projets tire parti des principes d’économie circulaire et présente une conception structurelle intéressante en bambou, avec une grande souplesse d’aménagements intérieurs.
L’ADEME - avec le soutien de l’association KEBATI - a d’ailleurs lancé une étude** sur le bambou dont les objectifs sont d’identifier les pratiques, acteurs, besoins - notamment en matière de qualifications de ce matériau et les limites de son utilisation pour les deux variétés présentes sur l’île.
D’ores et déjà, on peut citer ses multiples avantages en matière environnementale :
- Il fixe 30 % de plus de CO2 que les arbres, jusqu’à douze tonnes de CO2/ha/an (trois tonnes pour une forêt de feuillus) et libère de ce fait plus d’oxygène.
- Il améliore l’infiltration de l’eau dans le sol (2 fois plus qu’une forêt de feuillus).
- Il limite l’érosion des sols (réseau racinaire très dense sur 60 centimètres de profondeur)

- Il limite le lessivage des sols (infiltration en profondeur de nutriments... ou polluants)
- Il restaure des sols appauvris
- Il participe à l’élimination de certaines toxines du sol (phytoremédiation)
- Il pompe l’eau du sol quand elle est disponible en surface, sans assécher les nappes phréatiques
- C’est une culture nécessitant peu ou pas d’engrais et pas de produits phytosanitaires
Au niveau énergétique, le bambou a une bien meilleure balance* que d’autres matériaux de construction. Par rapport au ciment, le bambou requiert 8 fois moins d’énergie pour créer un bâtiment d’une même capacité (échelle de valeurs Roach 1996) :
- Acier : 1500
- Ciment : 240
- Bois : 80
- Bambou : 30
* La balance énergétique est l’énergie nécessaire pour produire une unité de matériau de construction avec un même niveau de capacité à supporter une charge, exprimée en MJ/m3 par N/mm².
Le bambou atteint sa maturité après 3 à 6 ans à partir du moment où il commence à sortir de terre. À ce stade, les fibres sont plus fortes et il y a moins d’humidité dans le chaume. Il y a quelques signes révélateurs pour déterminer si une tige est prête à être récoltée. Dans les climats tropicaux, les plus vieux chaumes sont ceux qui sont recouverts de plus de lichen et de mousses. Propres et lisses, les tiges sont sans doute de nouvelles pousses qui n’ont pas les qualités solides structurelles nécessaires pour la construction. Sous les tropiques, la récolte se fait à la fin de la saison des pluies, lorsque les insectes sont moins actifs. Les chaumes sont coupés au plus près de la base, au premier nœud situé au-dessus de la terre au-dessus du nœud.

Il est préférable de récolter le bambou lorsque la teneur en amidon de la plante est plus faible et donc moins sensible aux attaques des insectes (surtout les scolytes, minutus Dinoderus).
que les fibres de verre et 28 fois moins que les fibres de carbone.
L’inconvénient des fibres végétales est leur teneur en cellulose (principal composant d’une fibre végétale dont la quantité́ influe sur les propriétés de la fibre) et qui fluctue en fonction de l’âge de la plante.
• Produits issus du recyclage : papier, verre, carton, fibres textiles...
• Produits issus de l’aquaculture (ex. : les algues utilisées dans les peintures) : très peu utilisés aujourd’hui dans la construction.
Ces matériaux sont valorisés pour des applications en isolation, en décoration et en composites. Ils sont issus de l’agriculture, notamment des cultures de la canne à sucre, de la noix de coco, de l’ananas et de la banane, quatre productions potentiellement intéressantes pour fabriquer localement des écomatériaux.
En effet, en Martinique, une entreprise est sur le point de transformer les résidus de bagasse de canne à sucre en isolant sous toiture.
Les fibres de bananiers sont valorisées par une entreprise de placage (voir article p. 192).
La fibre de coco est utilisée dans le traitement des eaux usées (Procap utilise le biofiltre à coco). Une solution d’assainissement durable, économique, écologique, et particulièrement adaptée aux spécificités climatiques de nos régions.

Issues des parties renouvelables, elles constituent une ressource biodégradable et locale avec un faible impact environnemental : 6 fois moins énergivores
Dans le cadre des opérations d’habitats renouvelés en Outre-mer, les prototypes présentés servent aujourd’hui d’expérimentations à des constructions relançant les filières biosourcées. En effet, des recherches sur les gisements disponibles ont mené à la conception de plusieurs architectures contemporaines perpétuant la tradition constructive. Ces prototypes constitués majoritairement de bambou, briques de terre crue, bois caraïbe, blocs de chanvre, mais aussi pouzzolane des lahars, briques de terre… permettront de réduire les émissions de CO2, de limiter les excavations, de signer une forte efficacité énergétique … Ces expérimentations et recherches sur le développement de nouvelles filières de matériaux sont en cours au Prêcheur.
** Étude portant sur l’utilisation de la terre crue et du bambou afin de répondre aux besoins des secteurs de la construction (gros œuvre et second œuvre) et de l’aménagement paysager.
Au regard de la situation géographique et des ressources, cette étude vise à aider, à déterminer un plan d’action, une stratégie permettant de qualifier voire d’encourager et de développer le recours à ces matériaux dans les projets de construction ou de rénovation.
Les produits issus de l’agriculture (banane, canne à sucre, ananas, coco...)



Depuis sa création en 1992 en Martinique, la société STS s’est imposée grâce à sa rigueur, son professionnalisme et l’innovation qu’elle a su mettre en place pour répondre aux problématiques locales, tout en accordant une attention particulière à l’environnement.

En étanchéité, STS a privilégié la membrane PVC aux caractéristiques environnementales supérieures à l’étanchéité bitumineuse classique (pas de goudron, meilleure efficacité thermique).
En 2009, STS a introduit les réseaux sans tranchées en Martinique avec le forage dirigé (possibilité de poser de nouvelles canalisations sans détériorer les revêtements existants) et l’éclatement (les canalisations existantes sont remplacées tout en maintenant ou en augmentant leur diamètre).
STS est également spécialisée dans le confortement de talus qui permet de protéger les constructions des glissements de terrain et de réduire l’emprise au sol des talus.
Avec la pression actuelle sur le foncier et le besoin de préservation de notre environnement, la réhabilitation du bâti existant est primordiale. Dès 2005, STS s’est donc intéressée à ces problématiques en s’orientant vers le renforcement parasismique et les micropieux afin de rendre les bâtiments existants plus résilients en cas de séisme (écoles, logements sociaux…). Poursuivant cette démarche, la société a élargi en 2018 son champ de compétence à l’amiante avec la qualification SS4.
STS a introduit les réseaux sans tranchées en Martinique
Désamiantage
En 2022, STS obtient la certification amiante SS3 qui lui permet d’intervenir sur tous les chantiers de désamiantage. La rigueur de la certification est garante du sérieux de l’entreprise : procédures écrites, démarche qualité, gestion des déchets, rapports de fin de travaux… Un processus long et exigeant pour lequel l’entreprise a mobilisé toutes ses forces : investissements matériels conséquents et formation d’un personnel qualifié. Aujourd’hui, STS est habilitée à intervenir sur tous travaux classés en sous-section 3 (SS3) et sous-section 4 (SS4). Cette qualification vient compléter l’étendue de ses interventions et répondre aux besoins rencontrés en Martinique, en Guadeloupe et en Guyane.



Références
La clientèle de STS est essentiellement constituée de collectivités, de Sociétés d’Economie Mixtes (SEM) et d’entreprises privées. L’entreprise est un partenaire privilégié et régulier des bailleurs de logements sociaux.
Une entreprise 100% locale qui forme sa jeunesse Peu d’entreprises locales du BTP affichent une telle longévité. STS emploie aujourd’hui une vingtaine de salariés originaires du pays, tous investis du même esprit d’entreprise. Les anciens transmettent au quotidien leur savoir-faire aux plus jeunes. STS investit beaucoup dans la formation. Ces formations théoriques s’enrichissent ensuite sur le terrain des compétences de professionnels aguerris.
Connu et utilisé depuis l’Antiquité, l’amiante a connu un essor à partir des années 1860. Les dangers de l’inhalation de poussières d’amiante pour la santé sont connus depuis le début du siècle dernier. Le Centre international de Recherche sur le cancer a classé l’amiante dans la liste des produits cancérogènes pour l’homme. En France, l’amiante a été interdit à partir de 1997.

L’amiante est présent dans plus de 3000 matériaux et produits utilisés dans l’industrie et la construction : colles de carrelage, revêtements de sol, enduits, peintures, mastics de vitrages, enrobés s’agissant des voiries… (Voir photothèque sur prevention-amiante.fr), etc.
Différents diagnostics sont obligatoires pour les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 :
• Diagnostic amiante en cas de vente.
• Dossier Amiante pour les Parties Privatives (DAPP) et constitution du DTA* (parties communes) dans les immeubles collectifs à usage d’habitation.
• Constitution et mise à jour d’un DTA* pour les immeubles à usage autre que l’habitation (bureau, commerce, établissement recevant du public,..).
• Diagnostic amiante avant démolition.
*DTA = Dossier Technique Amiante.
Les repérages doivent être réalisés par un professionnel du bâtiment certifié. Cet état des lieux informe les occupants ou les entreprises amenées à effectuer des travaux de l’éventuelle présence de matériaux/ produits contenant de l’amiante.
Depuis l’interdiction de l’amiante - entrée en vigueur du décret n° 96-1133 du 24/12/1996 -, l’obligation de réaliser des diagnostics amiante a évolué. Le décret du 9/5/2017 et les arrêtés qui viennent en fixer les modalités d’application ont restructuré le Code du travail dont l’objectif principal est de protéger les salariés des entreprises amenés à intervenir pour réaliser des travaux.
La recherche d’amiante est assurée par un opérateur certifié amiante avec Mention. Celui-ci est en mesure de réaliser des prélèvements qui feront l’objet d’analyses par un laboratoire certifié COFRAC. Il doit s’assurer de la pertinence des résultats avant de remettre le rapport au maître d’ouvrage conformément à la norme NF X 46-020* et conformément aux arrêtés en vigueur.
*La norme NF X 46-020 définit la méthodologie à adopter pour repérer l’amiante.
Le donneur d’ordre a pour obligation de faire appel à un opérateur de repérage certifié avec mention et doit lui communiquer le programme de travaux. En cas de conclusion de présence d’amiante, il devra choisir l’entreprise en charge de réaliser les travaux portant sur les MPCA. Le chantier sera donc catégorisé amiante sous-section 3 ou sous-section 4*.
Le chantier sera donc catégorisé amiante sous-section 3 ou sous-section 4*.
*La sous-section 3 vise le retrait des matériaux ou produits contenant de l’amiante tandis que la sous-section 4 concerne les interventions de maintenance, de réparation ou encore d’entretien.
Liens utiles : https://prevention-amiante.fr/reperage-diagnosticamiante/ https://demoldiag.fr/

Dans le cadre de projets de réhabilitation, démolition ou travaux sur bâtiments privés et publics, ACTE est spécialisée dans les repérages des polluants du bâtiment : amiante, plomb, termites, déchets. Le repérage amiante sur les navires et bateaux étend notre offre aux armateurs. Rencontre avec Monsieur Jacquier, gérant de la société
Aux Antilles/Guyane, nous proposons différents types de diagnostics : amiante, plomb, nuisibles, déchets. Dans le cas d’un DAAT (diagnostic amiante avant travaux) ou d’un DAAD (avant démolition), nous informons le MOA sur la présence ou pas d’amiante avant d’entamer des travaux ou une démolition. Opération obligatoire afin d’éviter les dommages liés à l’exposition de fibres d’amiante et les risques de pollution de la population environnante et de l’environnement. Un laboratoire accrédité nous transmet les résultats d’analyse à intégrer dans nos rapports. Ils sont alors analysés. Le repérage vise aussi la bonne gestion des déchets. Ainsi, à l’issue de cet examen, nous proposons d’estimer la qualité de déchets générés par la déconstruction et de prescrire une filière d’exploitation des matériaux récupérables. Après le retrait des Matériaux et Produits Contenant de l’Amiante, nous procédons à un examen visuel des surfaces traitées et vérifions l’atmosphère de travail avec des mesures d’empoussièrement avant, pendant et après les travaux. Nous sommes accrédités par le COFRAC pour réaliser l’ensemble de ces mesures (AIR-LAB).
Antilles Conseils Techniques et Expertises est certifiée sur les repérages Amiante avant Travaux et Démolition ainsi que sur la gestion de DTA (qualification 02-01
L’équipe ACT-Expertises
et 02-02 par I-Cert). Les techniciens, très expérimentés, sont qualifiés Amiante avec Mention. L’entreprise bénéficie d’une formation continue afin de maintenir et d’élever son niveau de compétences. Membres du Réseau DEMOLDIAG - Réseau National des spécialistes du repérage de l’amiante - nous respectons la charte qualité en vigueur et disposons de l’équipement requis pour ces types d’intervention. Le respect de la réglementation nous vaut d’ailleurs une réputation solide et sert l’exigence de notre clientèle (CTM, les Communes, les bailleurs privés, les sociétés d’HLM, …) en Martinique, Guadeloupe et Guyane.

Oui nécessairement, avec à l’esprit la protection des populations face aux risques, nous avons complété et développé notre activité de repérage Termites et Plomb. Ce dernier est obligatoire (pour les biens immobiliers construits avant 1994) avant tous les travaux ou avant démolition. Lors de travaux ou de démolition, la recherche d’insecte xylophage supprime le risque de transporter des termites vers des zones non impactées.
Nos connaissances des systèmes constructifs et des bâtiments antillais nous permettent de réaliser des maquettes 3D « Building Information Modeling ». Elles constituent le dossier technique numérique du bâti compilant l’ensemble des éléments graphiques, techniques, temporels et des éléments facilitant la maintenance et la gestion financière. La numérisation par modélisation se fait via un scanner performant (résolution d’1 mm pour 10 m) et nos dessinateurs-projeteurs transforment le nuage de points en une maquette numérique 3D exploitable par tous les logiciels d’architecture.



Spécialisée dans les repérages des polluants du bâtiment : amiante, plomb, termites, déchets


ACT-Expertises
0696 26 74 01
contact@act-expertises.fr
AIR LAB 0696 26 74 01


commerce-972@air-lab.fr

Avec le bananier, pas question de déforestation puisque les hectares de bananiers sont disponibles après la récolte des régimes et que la plante se renouvelle tous les 9 mois.
La fibre de bananier se définit donc comme un matériau recyclé, 100% naturel et biodégradable. Une alternative sérieuse au placage bois.



















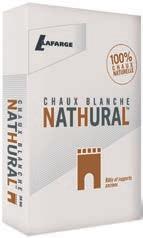















Contrairement à ce qu’on pourrait penser, il n’y a pas de bois dans le bananier, ce n’est donc pas un arbre, mais une plante géante, pouvant atteindre plusieurs mètres (sa taille fait aussi partie de ses atouts). Au lieu de tronc, on parle plutôt de stipe, soit une tige composée de feuilles (un déchet au regard de la production alimentaire).
La véritable création est d’avoir recours au bananier pour concevoir un revêtement 100 % naturel. Après plusieurs années de recherche et développement, FIBandCo, une entreprise martiniquaise qui existe depuis 2010, a déposé une demande de brevet pour la maîtrise d’une chaîne de valeur innovante et intrinsèquement responsable. Elle en a d’ailleurs fait sa spécialité avec Green Blade : un placage fabriqué à partir des tiges de bananiers et qui ne nécessite ni eau ni colle dans sa fabrication. L’entreprise a consolidé son engagement écologique en installant l’usine au cœur même des bananeraies afin de limiter les transports. De plus, elle produit son électricité à l’aide de panneaux photovoltaïques afin d’offrir un bilan carbone exemplaire.
Le cœur du stipe est tranché en lames, celles-ci sont ensuite posées à plat sur une feuille et, après quelques passages sous les presses à différentes températures, elles ressortent sous forme de feuilles fines brutes qu’il s’agit de doubler d’un intissé afin de les rendre moins fragiles.
Les nombreuses finitions possibles, la finesse, l’esthétique de ce “placage” en ont fait un matériau haut de gamme, novateur, naturel que prescrivent de nombreux professionnels, architectes et décorateurs. Et de Saint-Barthélemy à Paris, de Hong Kong à Amsterdam, les produits Green Blade (panneaux décoratifs et autres revêtements) se retrouvent dans des hôtels et des bâtiments dont la conception intérieure se double d’une conscience écologique.
Ce matériau organique inspire aussi des designers (notamment Philippe Starck) pour la décoration et la réalisation de panneaux acoustiques.

Le revêtement en fibre de bananier, plaqué sur des panneaux acoustiques, offre de très bonnes performances qui sont mesurées par un laboratoire acoustique européen. L’indice NRC (indicateur d’absorption acoustique) variant de 60 à 90%.
Un produit qui a intéressé des marques avant-gardistes comme Tesla qui s’en est servie pour fabriquer le tableau de bord de sa concept-car. En aviation aussi, le revêtement en fibre de bananier a été sélectionné pour la finition des cockpits. En Martinique, l’Espace Sud et le Lycée Schoelcher ont également opté pour ce matériau.




























Aujourd’hui, l’entreprise souhaite se tourner vers un marché destiné aux particuliers. Et ce, avec une gamme de produits neufs et toujours 100 % naturels. Des solutions de revêtement.
Rencontre avec Ludovic Rolland, directeur de Green Blade, qui a travaillé à l’élaboration de cette nouvelle collection.
Oui, l’idée est de proposer à la vente un produit fini et « protégé ». La feuille de fibre de bananier, délicate à travailler lorsqu’elle est brute, nécessite un support pour pouvoir être utilisée par des particuliers.
Afin de ne pas altérer la fibre et faciliter son nettoyage, nous avons appliqué un film de protection mat. Nous l’avons ensuite doublée de divers supports selon l’usage prévu. Il en ressort trois nouveaux produits.

Wall, du papier peint (qui existe en deux dimensions), le Skin, de l’adhésif pouvant être appliqué sur des surfaces planes telles que les portes. Un produit facile à couper, simple à poser grâce à sa pellicule adhésive.
Enfin, l’Original, destiné au revêtement mural, vertical ou horizontal. Une plaque fine composée d’une feuille de fibre, d’un fin support mousse et d’une lame autocollante. Un produit parfait pour gommer les imperfections d’un mur ou d’une surface non lisse.
Pour le lancement en grande distribution, notre gamme se compose de trois coloris de base : clair, moyen, foncé. Mais à la demande, nous pouvons fournir tous les revêtements dans nos 10 coloris.
Tout à fait, ils sont référencés en grande distribution, dans certains magasins de bricolage.















Avec la crise sanitaire, la commercialisation a pris un peu de retard. Le secteur des papiers, impacté par le succès de la vente à distance, a vu la demande d’emballages grimper en flèche. Bref, la livraison de nos boîtes d’emballages s’est faite avec 9 mois de retard. Enfin, tout est prêt, tout est livré !
Et lorsque ce marché-test aura fourni des retours, les produits pourront aussi s’exporter vers l’Hexagone et l’Europe.
Bien sûr ! D’ailleurs, ces produits destinés aux particuliers sont tout à fait adaptables à des solutions professionnelles. Aussi, les panneaux, les adhésifs et le papier peint peuvent être produits sur mesure.


Oui, nous comptons établir des franchises dans d’autres pays, notamment en Inde et à Madère. Mais la Martinique conservera le pôle de Recherche et Développement.
En ce qui concerne la fibre de bananier, nous proposons nos revêtements, mais d’autres études sont en cours, afin de valoriser cette matière.
Âge moyen nécessaire des essences pour la production de placages décoratifs naturels :

Chêne : 80 ans
Teck : 70 ans
Ébène : 75 ans
Noyer : 60 ans
Hêtre : 40 ans
Eucalyptus : 15 ans
Bambou : 5 ans
Bananier : 9 mois.


L’agence PZA réunit une équipe pluridisciplinaire apportant toutes les compétences nécessaires à la conception, la réalisation, la direction et l’accompagnement de projets. Quelques réalisations récentes ou en cours :
Immeuble de 20 logements collectifs à Fort-de-France
Opération en R+2 sur sous-sol (caves privatives). 3 bâtiments conçus afin de respecter l’échelle urbaine du site. Le choix des matériaux en façade permet une lecture très qualitative des bâtiments (verre, appareillage de pierres naturelles, bois exotique, et aluminium gris-anthracite). Appartement en penthouse doté d’une terrasse à 2 niveaux permettant l’implantation d’une piscine privative, d’un sauna et d’un jacuzzi.
Immeuble de 20 logements collectifs aux Anses d’Arlet
Bâtiment en R+4, le dernier niveau offre un volume en double hauteur dans les zones de séjour, traité par une couverture 2 pentes en zinc, et permettant des éclairages zénithaux doux. Garde-corps traités en verre sablé avec motifs dégradés. Des habillages bois à claire-voie dynamisent et ponctuent les façades.
Immeuble de 30 logements collectifs à Fort-de-France
Afin de respecter le tissu urbain existant, ce bâtiment reprend les modénatures et volumes de l’architecture typique créole : bardage, bois, appuis de fenêtre, toitures deux pentes, lambrequins, garde-corps, volets… Les volumes décalés des façades permettent une lecture de l’immeuble à taille humaine.
Immeuble de 45 logements collectifs à Fort-de-France
3 entrées indépendantes sont conçues pour respecter l’échelle urbaine du site.
Le choix des matériaux en façade permet une lecture très qualitative des bâtiments, mêlant verre, habillage bois exotique, et aluminium gris-anthracite. Tous les appartements en RdC sont dotés de jardins privatifs, de jacuzzis ou de piscines.
60 logements collectifs à Fort-de-France
Opération composée de 2 corps de bâtiments formant une unité visuelle. La physionomie du bâtiment conçue pour se caler parfaitement sur la topographie très accidentée du site. Ce qui a permis de créer des accès à 2 niveaux distincts pour les poches de parking. Les façades mixent des habillages en vêtage en pierres, des systèmes de pergola apportant des ombres portées, des murs rideaux vitrés.
Bureaux à Fort-de-France, en R+3
Dans un secteur urbanisé, bâtiment possédant des plateaux nus modulables pour un aménagement ultérieur et fonctionnel afin de répondre aux besoins des futurs utilisateurs. Construction « vitrine » qui permettra aux occupants de profiter d’une identité forte et visible. Casquettes, murs rideaux vitrés, lignes dynamiques : autant d’atouts contribuant au vocabulaire architectural de cette opération.

Centre commercial à Balata - Fort-de-France
4 lots sur la Route de Balata. Structure aux lignes extrêmement fluides, à l’image d’un ruban métallique se déroulant sur toute la façade, jusqu’à la création d’un cylindre en partie supérieure, autorisant la création d’une double hauteur pour l’un des commerces.
Les accès sont desservis par une galerie couverte et ouverte, donnant un maximum de visibilité aux enseignes.
Résidence de tourisme au Diamant
Résidence de 12 appartements prévue pour l’accueil des touristes. Face au Rocher du Diamant, à l’échelle du quartier, elle sera dotée d’une piscine commune et d’espaces arborés et paysagés.
Villa de prestige à Saint-Martin, à Terres Basses
Villa composée de 4 chambres spacieuses, dotées de salles de bains et de dressing, leur conférant intimité et indépendance, d’un large séjour ouvert sur une cuisine et d’un bar immergé dans une piscine type « miroir ». Des espaces extérieurs en relation directe avec la villa seront créés : pergolas, brasero, pas-de-loup immergés…
Philippe Zaffran Architecte - PZA
Immeuble Objectif 3000 - Acajou Sud
Le Lamentin 0596 30 12 26 - 0696 74 14 74 philippe-zaffran-architecte.fr
De gauche à droite : 45 logements à Fort-de-France - 20 logements aux Anses d’Arlet - 20 logements à Fort-de-France30 logements à Fort-de-France - 60 logements à Fort-de-France










Pour rappel, dès 2023, tous les établissements recevant du public auront obligation de surveiller la qualité de l’air. Cette obligation comporte 2 volets : une évaluation des moyens d’aération et de ventilation et la réalisation au choix d’un diagnostic de la qualité de l’air, lors duquel le propriétaire peut se faire accompagner d’un expert en air intérieur, ou d’une campagne de mesure par un organisme accrédité. Cette démarche a pour objectif l’obligation de mettre en place un plan d’action pour améliorer la qualité de l’air intérieur.













Madininair, association agréée par le ministère chargé de l’Environnement pour la surveillance de la qualité de l’air en Martinique, intervient depuis plus de 10 ans sur des problématiques de la qualité de l’air intérieur. Forte de son expérience et de son expertise, elle accompagne d’ores et déjà certaines communes et collectivités dans la mise en œuvre de cette obligation.


Pour les autres établissements ou lieux de travail, la seule obligation, liée à la qualité de l’air intérieur, est définie par le Code du travail et concerne uniquement le maintien d’un renouvellement d’air minimum en garantissant un débit d’air constant dans les pièces (soit par ventilation mécanique ou par ventilation naturelle). Aucune obligation en ce qui concerne la mesure de la qualité de l’air intérieur n’est en vigueur à ce jour.
Cependant, Madininair intervient régulièrement pour mesurer la qualité de l’air dans des bureaux et des lieux de travail spécifiques (laboratoires, ateliers ...), à la suite d’une problématique sanitaire ou dans une démarche volontaire et proactive de l’entreprise.
Un air dont les particularités méritent d’être étudiées puisqu’il impacte la santé et plus largement, le bien-être
des occupants. En effet, cette démarche a pour objectif principal d’évaluer la qualité de l’air et d’apporter des actions correctives et préventives afin de limiter l’exposition des occupants aux polluants de l’air.

Beaucoup de sources dégradent la qualité de l’air dans un bâtiment, notamment lorsqu’il est neuf ou rénové :
- Qualité de l’air extérieur
- Matériaux de construction, de finition et d’équipement :
° Formaldéhyde, composés organiques volatils ou COV (formaldéhyde, solvants organiques, éthers de glycol, hydrocarbures...) dégagés par de nombreux matériaux : colles, peintures, bois traité, produits de pose... et qui peuvent être jusqu’à 15 fois plus présents dans l’air intérieur que dans l’air extérieur.
° Particules et fibres
- Activités des occupants
° Manque d’aération
° Tabagisme
° Produits d’entretien
° Utilisation de produits de bricolage
° Utilisation de désodorisants.

Forte de plus de quarante années d’existence en Martinique, la société BIOMETAL est leader de la fabrication locale de couvertures résistantes, bardages et accessoires fiables en acier pré-laqué. L’entreprise vient de rafraîchir sa gamme en s’inscrivant plus que jamais dans l’innovation de solutions technologiquement très avancées. Et parmi elles, une nouveauté, la gamme EXTENSIO.
Une gamme de produits plus performants
Aux côtés de produits classiques tels que METALCOVER® (revêtement de haute qualité garanti 10 ans en intérieur terre) et METALISO® (tôle dotée d’un isolant réflecteur mince haute technologie), METALPROTECT® s’impose comme la solution la plus performante et la plus durable pour les ouvrages très exposés. Spécialement développé pour le bord de mer, ce produit est issu de la technologie Colorcoat Prisma® (substrat Gavalloy® + 3 couches protectrices) garante de sa résistance inégalable à la corrosion. Cette optimisation de la protection permet de garantir METALPROTECT® 10 ans, de 1 m à 3 km du bord de mer.
EXTENSIO®, garantie 20 ans !
Qui peut le plus peut le moins. Aussi, les propriétés de METAPROTECT® ont-elles été appliquées à EXTENSIO®, pour l’intérieur des terres. Un nouveau produit indiqué pour être posé au-delà de 3 km du bord de mer et qui, dans ces conditions, est garanti 20 ans. Une exclusivité à la Martinique. Comme toutes les tôles, EXTENSIO® se décline en plusieurs coloris au choix (sélectionnés pour leur tenue dans le temps et leur esthétique). Elle peut aussi bénéficier du traitement Isol +, qui lui confère toutes les qualités d’un isolant réflecteur mince haute technologie pour apporter le confort thermique et acoustique en plus de la durabilité.
BIOMETAL se positionne comme la référence de son secteur d’activité et est reconnue comme telle par les professionnels et particuliers.
Biométal Parc d’activité du Robert 0596 65 14 44
biometal-martinique.com
Bénéficiant du traitement Colorcoat Prisma® avec le substrat Galvalloy® et de 3 couches protectrices spécifiques pour les conditions de bord de mer, la tôle EXTENSIO® dure deux fois plus longtemps lorsqu’elle est installée dans les terres. Sa longue durabilité lui vaut d’être la tôle la plus économique. BIOMÉTAL est fière de proposer la plus longue garantie pour une tôle aux Antilles !
Substrat Galvalloy®
Ce substrat métallique unique est composé d’un mélange spécial de 95% de zinc et de 5 % d’aluminium. Il offre une protection sans pareil aux tôles EXTENSIO®

RÉNOVER SA TOITURE
SANS SE RUINER !
Éligible au dispositif EDF AGIR PLUS et au dispositif maprimerenov.gouv.fr, la gamme EXTENSIO® de BIOMÉTAL est RGE. Elle vous fait donc bénéficier de la prime économie d’énergie 14€/m2 en résidentiel —

Couche protectrice
Revêtement
Primaire
Traitement de surface
Zinc
Acier
Trois grandes familles de polluants intérieurs (voir encadré) :
- Polluants physiques : fibres et particules
- Polluants biologiques : moisissures et champignons
- Polluants chimiques : COV.
Généralement, lorsque Madininair est sollicité pour des problématiques en air intérieur, des ingénieurs réalisent une première visite de l’établissement afin d’identifier les sources potentielles de pollution (peintures murales et plafond, nouveau mobilier, revêtement de sol …). Cette investigation préliminaire cerne les composés qui pourront être mesurés. Les ingénieurs complètent cette investigation par :
- Une évaluation de l’environnement extérieur à prendre en compte dans les possibles transferts extérieur/intérieur.
En effet, dans une zone où l’air extérieur est chargé en particules fines et en dioxyde d’azote en raison de la proximité d’un axe de trafic routier, par exemple, ces polluants peuvent être intégrés aux mesures réalisées afin d’évaluer l’impact des sources de pollution extérieure sur la qualité de l’air intérieur.
- Un examen de l’aération et de la ventilation des pièces.
Le personnel de Madininair formé à ce diagnostic procède à une inspection poussée de l’état et du fonctionnement des éléments d’extraction et de renouvellement d’air et de climatisation (dont les filtres).
- Une évaluation des paramètres de confort (température des pièces, humidité dans l’air, mesure du CO2 pour évaluer le confinement* …)
* La mesure du dioxyde de carbone (CO2) met en évidence le confinement, un facteur aggravant de la qualité de l’air. Le confinement de l’air caractérise le taux de renouvellement de l’air d’une pièce, en fonction de son
occupation. Lorsque le confinement s’avère très élevé́, des actions doivent être menées pour améliorer le renouvellement d’air de cette pièce.
Un autre type d’intervention – obligatoire dans certains cas - concerne des lieux où sont exercées des activités spécifiques. Y sont réalisées des mesures à des fins de comparaison avec des normes, des valeurs d’exposition professionnelles.
Par exemple, les centres de tir ont une obligation de mesure des métaux, des ateliers de ponçage vérifient la quantité de particules inhalables dans l’air, les stations d’épuration mesurent l’hydrogène sulfuré, les laboratoires vérifient les quantités dans l’air des composés manipulés sur place…
Ces mesures peuvent comprendre un panel étendu de composés divers dès qu’ils sont identifiés et ciblés dans une zone déterminée.
Carole Boullanger de Madininair admet qu’il est dommageable que les mesures ne soient pas rendues obligatoires à l’issue d’un chantier de construction ou à la réception d’un bâtiment neuf ou réhabilité. Heureusement, dans ce secteur, les demandes de mesures de qualité d’air intérieur se multiplient, elles concernent surtout les particules fines, le formaldéhyde et les COV.
Responsables directs de la qualité de l’air, les systèmes de ventilation et d’aération sont systématiquement vérifiés.
Lorsqu’il s’agit de bâtiments réhabilités, les mesures sont réalisées en deux temps : avant et après que le personnel intègre les locaux. La pollution intérieure fluctuant selon le nombre de personnes dans la pièce, le rythme d’aération, les produits de nettoyage, l’utilisation (nocive) d’encens, de bougies, de désodorisants…











Le cas des moisissures
Il est plutôt fréquent de constater des moisissures ou des champignons, même sur des bâtiments neufs. Pour prévenir ce phénomène, il est indispensable de privilégier des types de matériaux adaptés à l’humidité des Antilles et de les stocker dans des endroits secs et ventilés.
Attention : certains faux plafonds et contreplaqués sont de vrais substrats fongiques qui se gorgent d’humidité.
Quelques préconisations :
- Vérifier la qualité des produits et des matériaux : Privilégier des produits classés A+ sur l’étiquette “Émissions dans l’air intérieur” et/ou avec des écolabels.
Pour les peintures et produits de pose : opter pour des peintures en phase aqueuse, peu émissive en COV (essentiellement les 28 premiers jours), des peintures mates plutôt que satinées (moins émissives). Pour les plafonds, choisir des produits adaptés aux conditions climatiques. Pour les produits bois, privilégier les panneaux sans colle - à base de formaldéhyde - et les résines polyuréthane.
- Placer un isolant entre le béton et le revêtement de sol
- Veiller à une ventilation équilibrée*
- Éviter le couplage ventilation/climatisation. Ce système engendre une perte de ventilation lorsque la climatisation est coupée.
- Vérifier régulièrement les filtres des systèmes d’extraction et de climatisation.
* Dans un bâtiment, le débit total d’air rentrant mécaniquement (débit d’air neuf rentrant grâce à des ventilateurs) doit être égal à celui évacué par les ventilateurs d’extraction ou de rejet, sauf cas particulier. Si pas, le système est mal réglé ou déficient.

UN BON UTILITAIRE, C’EST COMME UN BON ARTISAN : IL SAIT TOUT FAIRE
Moduwork®
15 aides à la conduite
Hauteur maximale : 1m90
Jusqu’à 6,60m3 de chargement
Charge rapide : jusqu’à 80% en 30 minutes
TVA récupérable à 100% sur l’électricité

Bonus écologique jusqu’à 5 000€
Amortissement déductible : 30 000€
Créée en 2016, ECO ENERGIE est spécialisée dans le conseil et la vente de matériel électrique et d’éclairage. En plus d’être distributeur agréé, ECO ENERGIE accompagne aussi bien les professionnels que les particuliers dans tous leurs projets de création et de rénovation, grâce à son expertise et son engagement auprès de sa clientèle.
Rencontre avec Florian Prudent, directeur d’ECO ENERGIE.
Actuellement ECO ENERGIE référence cinq grandes familles de matériel :

• Éclairage LED (intérieur - extérieur)
• Câblerie/filerie

• Distribution électrique (tableau électrique, disjoncteur...)
• Appareillage électrique (interrupteurs, prises)
• Système Sécurité Incendie
Les marques que nous avons sélectionnées ont fait leurs preuves à l’échelle nationale et nous proposons bien sûr les marques leader du marché mondial.
À tout moment ! En amont du projet, au cours du projet, pendant le gros-œuvre, le second-œuvre, ECO ENERGIE met l’accent sur l’accompagnement du client du début à la fin de son chantier.
Nous proposons également toute une gamme de produits d’optimisation électrique et d’éclairage LED qui répondront à toutes les étapes de votre projet.

Au-delà d’un référencement fournisseur gage de qualité, nous privilégions toujours la proximité avec nos clients.
La qualité du service est vraiment ce qui nous distingue : nos conseillers techniques sont impliqués dans les projets de notre clientèle. Conseils, disponibilité, choix du matériel, chiffrage, déplacement sur site, vous pouvez leur faire confiance pour réussir votre installation électrique !
Le fait que nous soyons une entreprise familiale à taille humaine est aussi un de nos points forts, nous partageons tous la même philosophie et le même souci de l’innovation et du service. Une prise de contact facile, une réactivité minute, une livraison sur site sont autant de prestations que nous avons mises en place au sein d’ ECO ENERGIE, à la grande satisfaction de nos clients !
Espace Laouchez
Bât A - Local N° 12
Les Hauts de Californie
Le Lamentin 0596 80 75 80
contact@eco-energie97.com
Facebook et Instagram : ECO ENERGIE
ecoenergie97.com





La réponse au besoin de rafraîchissement est cadrée pour le logement par la Réglementation Thermique, Acoustique et Aération des logements neufs outre-mer 2016 (arrêté du 17/04/2009 modifié le 11/01/2016 sur la RTAA) : porosité minimale des façades, balayage des pièces par les flux d’air, brasseurs d’air dans les pièces principales. Pour les bâtiments neufs, tous usages confondus, la conception doit permettre de respecter la Réglementation Thermique de la Martinique (RTM), du 28 juin 2013 et ses indicateurs Bbio (besoin bioclimatique) et ICT (indice de confort thermique) sans exigence de moyen.
Évaluation de la qualité de l’air dans les bureaux :
- Évaluation des polluants réglementés (pollution non spécifique)
- Évaluation des polluants non réglementés tels que les COV ou les moisissures en partenariat avec le CHUM.
- Diagnostic des moyens d’aération et ventilation (observations)
- Recherche de sources potentiellement émettrices
- Comparaison aux normes en air intérieur

- Recommandations et conseils permettant d’améliorer la qualité́ de l’air intérieur
- Si symptômes, mise en relation avec l’ARS et la médecine du travail
Évaluation de la qualité de l’air des locaux à pollution spécifique :
- Répondre à la réglementation d’évaluation de la qualité́ de l’air ambiant
- Évaluer la qualité́ de l’air dans les pièces potentiellement soumises à une source de pollution (nécessité́ d’identifier la source pour la mesure)
- Évaluation d’un large panel de polluants réglementés et non réglementés
- Comparaison aux normes et valeurs d’exposition professionnelle.
Merci à Carole Boullanger et Gaëlle Grataloup de Madininair.


Les principaux polluants
Le formaldéhyde : il est essentiellement émis par des sources de pollution intérieure comme les panneaux de bois agglomérés, les produits d’entretien (détergents, désodorisants…), les matériaux de construction et d’ameublement. Il est nécessaire de permettre sa dilution et son évacuation (aération naturelle, extraction mécanique). Le benzène (COV réglementé en air intérieur) : il est principalement émis par des sources extérieures au bâtiment. Il est issu de la combustion : on le retrouve dans les émissions du trafic automobile, de l’industrie... En air intérieur, on le retrouve dans les détergents, la fumée de tabac, les parfums, la peinture ou les revêtements plastifiés.
Particules fines PM10 : particules dont le diamètre est inférieur à 10 μm et qui restent en suspension dans l’air. Les particules fines sont un polluant dont les principales sources d’émission sont le trafic routier, l’industrie et, de façon saisonnière, les brumes de sable.
Dioxyde d’azote NO2 : polluant issu de sources extérieures (émissions de trafic automobile, installations de combustion). Il est donc nécessaire de minimiser sa pénétration dans le bâtiment et de permettre son évacuation.

Moisissures
Les moisissures sont des champignons microscopiques qui, avec une humidité favorable et suffisamment d’éléments nutritifs, sont capables de coloniser des supports de nature variée (bois, papier, tissus, etc.). Elles peuvent libérer dans l’air des spores en grande quantité et/ou des substances odorantes (odeur de moisi) voire toxiques (mycotoxines, composés organiques volatils). Ces spores sont introduites dans les locaux par les ouvertures, les allées et venues des occupants, leurs vêtements et leurs chaussures, la poussière et des matériaux/matières contaminé(e)s. L’humidité du climat en Martinique favorise leur croissance. Les pièces humides mal ventilées, le bas des murs mal isolés ou avec des défauts d’étanchéité sont des zones propices au développement des moisissures. Leur croissance sur les supports contaminés se traduit par des taches de tailles et de couleurs variées (vertes, grises, noires...).





Si la crise sanitaire liée au Covid a affecté le trafic, celui-ci a pu se maintenir à 50% de celui de 2019 et de 2021. Bien sûr, le déroulement du chantier d’extension de l’aéroport Martinique Aimé Césaire s’est vu impacté par cette crise. Ça fait plusieurs mois que les travaux d’agrandissement ont repris. Ils permettront d’atteindre les objectifs de trafic fixés par la SAMAC, soit l’accueil de 3 millions de voyageurs en 2025.






L’aéroport représente un levier de croissance indéniable pour la Martinique. Avec une démarche partenariale associant les acteurs de l’industrie aéronautique et du tourisme, la stratégie contribue au renforcement de l’attractivité de l’île, œuvrant aussi à la construction de son avantage concurrentiel dans le bassin caribéen. La SAMAC, gestionnaire responsable, s’inscrit dans ce projet de développement en recherchant de nouveaux marchés et en multipliant les propositions de destinations.


L’aérogare « passagers », qui accueille l’essentiel du trafic, s’étend actuellement sur une superficie de 24 000 m2. L’aérogare fret couvre 9 400 m2 de surface et possède une capacité de 20 à 30 000 tonnes de chargement chaque année. 20 000 m2 de surface additionnelle vont agrandir le bâtiment actuel de l’aérogare « passagers ». L’aérogare passera ainsi de 24 000 à 44 000 m2. Cette nouvelle structure offrira aux voyageurs une expérience agréable et sûre et permettra aux clients de la plateforme d’évoluer dans un espace optimisé et fonctionnel.

Nous sommes Rockfon, leader mondial en solutions de plafonds acoustiques. Aujourd’hui, nous passons jusqu’à 90% de notre temps à l’intérieur d’un bâtiment. Un environnement intérieur sain est donc essentiel à notre bien-être.
Nos solutions de plafonds acoustiques sont fabriquées en laine de roche, un matériau durable permettant de créer une réelle valeur ajoutée aux bâtiments de demain.
Nos systèmes d’installations plafonds et ossatures s’adaptent à tous types d’infrastructures.
Nous offrons également des solutions esthétiques et design avec nos gammes de panneaux muraux et îlots acoustiques. Rockfon a la solution à chaque concept d’intérieur !

Un projet, une rénovation, ou un chantier en cours de conception pour l’agencement d’intérieur ?

N’hésitez plus et rendez-vous sur www.rockfon.fr pour en savoir plus et bénéficier de conseils personnalisés.
Vous pouvez également vous rendre dans les points de distribution habituels présents en Guadeloupe, Martinique et Guyane.
Après plus de 300 réalisations, PIEUX ML est un partenaire de choix en fondations spéciales et propose une gamme de pieux métalliques vissés avec refoulement du sol (norme NF EN 12699 : 2015-07) : des fondations profondes performantes et économiques.
L’entreprise dispose d’équipes, ateliers et engins en Martinique, comme en Guadeloupe et en Guyane. Elle intervient sur des ouvrages neufs, en rénovation et dans le cadre de confortement parasismique.
L’équipe s’étoffe très régulièrement. Parmi les collaborateurs, Nathalie Gomez (conductrice de travaux) et Cédric Serbin (chef d’équipe installateur-soudeur) nous livrent leur vision du métier.
Nathalie nous dit :
« Le BTP contribue à l’urbanisation et au développement de la population. Pouvoir travailler dans un domaine technique voué à une forme d’amélioration de la condition de l’homme dans son habitation me semblait idéale en termes de vocation professionnelle.
Le secteur du BTP regroupe différents types d’activités : économie, conception, exécution dans les domaines publics mais également privés. J’apprécie la polyvalence et le choix qu’offre ce secteur.
Un de mes objectifs après mes études était de pouvoir travailler dans mon île, et ressentir ma contribution à son développement. En tant qu’ingénieure Génie Civil et Géotechnique, le poste de Conductrice de Travaux proposé par Pieux ML me permet de rassembler beaucoup de mes attentes, professionnelles et personnelles. »
« J’occupe un poste dont les tâches sont diversifiées, et les challenges différents chaque jour : visites de site en amont d’un démarrage de chantier, contrôles de bonne exécution sur sites, réalisation de bancs de charge, réunions de chantiers avec les
différents corps d’états d’une opération… Mais aussi des tâches administratives au bureau. Une polyvalence qui nécessite une forme de flexibilité au travail. Cette particularité est la raison pour laquelle je me plais à mon poste chez Pieux ML.»
Cédric Serbin a lui commencé chez PIEUX ML en tant qu’intérimaire soudeur en 2016. En 2018, il passe en CDI en tant que soudeur/ installateur. Et depuis octobre 2020, il est chef d’équipe.
« La journée commence très tôt chez Pieux ML : préparation du matériel, des machines, constitution des équipes… Une fois sur chantier, avec mon équipe, nous réalisons les ouvrages (soudures MIG en atelier, à l’arc sur le terrain…). Afin de veiller à la continuité des chantiers, j’assure aussi l’entretien et les réparations du matériel. La technique des pieux vissés m’était inconnue, mais j’ai vite appris, tant ces produits innovants m’ont motivé. De plus, l’équipe est jeune, dynamique, ce qui participe à une excellente ambiance sur les chantiers. »





PIEUX ML
0596 79 94 68
martinique@pieuxml.com

guadeloupe@pieuxml.com
guyane@pieuxml.com

pieuxml.com

L’entreprise intervient sur des ouvrages neufs, en rénovation et dans le cadre de confortement parasismiqueÉquipe Pieux ML
Le programme de modernisation des équipements et de l’infrastructure aéroportuaire concerne aussi :

• L’adjonction de nouveaux comptoirs d’enregistrement. 10 comptoirs d’enregistrement supplémentaires compléteront les 34 actuellement en place. Des bornes libre-service et des dispositifs de dépose-bagages automatiques seront installés sur l’ensemble de la plateforme.
• L’agrandissement de 1500 m2 de la salle d’embarquement, incluant une nouvelle organisation de la galerie commerciale et la présence de nouveaux commerces et services.
• Un nouvel espace dédié au tri bagages des vols long courrier incluant les équipements réglementaires de contrôle des bagages de soute.
• Une nouvelle organisation de la galerie commerciale et la présence de nouveaux commerces et services.
L’avancée des travaux se déroule selon les délais prévus et la nouvelle plateforme devrait être inaugurée l’année prochaine, en 2023.


Construction métallique - Serrurerie

PRÉSENT AUX ANTILLES DEPUIS 2016
Notre entreprise est devenue une référence en construction métallique et serrurerie grâce à notre savoir faire.

C/o Buro Club - 11 Rue des Arts et Métiers - 97200 FORT-DE-FRANCE

Le Service Prévention du Département des Risques Professionnels de la CGSS Martinique a pour objectif de prévenir les risques d’accidents du travail (AT) et de maladies professionnelles (MP) dont sont victimes les salariés afin d’en diminuer le nombre et la gravité.
En 2019, le secteur du BTP représentait plus de 16 % des accidents du travail, 48 % étant liés aux manutentions manuelles, 16 % aux chutes en hauteur et 14 % aux chutes de plain-pied.
Comme le rappelle, David Herthé, contrôleur de sécurité au Département des Risques Professionnels de la CGSS Martinique, il existe des priorités permettant de réduire cette sinistralité dans le BTP.
En effet, il est capital pour les maîtres d’ouvrage (MOA) d’intégrer - dès le début de la conception d’une opération – un plan de coordination intégrant la mise en place de diverses mesures :
- Mutualisation et gestion des protections collectives réduisant l’exposition des intervenants aux risques de chutes (plateformes de travail, accès en toiture…)
- Gestion des manutentions et approvisionnements : organisation de stockage et utilisation de dispositifs mécanisés (transport vertical et horizontal de personnes et de charges afin d’optimiser la circulation)
- Hygiène et conditions de travail (mise à disposition de sanitaires, vestiaires…)
- Mission Coordination Sécurité Protection de la Santé (CSPS) associée dès la phase conception dans les choix techniques et organisationnels du projet en relation avec la santé et la sécurité lors de la réalisation de l’ouvrage
- Anticipation des interventions ultérieures sur l’ouvrage. Cette prise en compte dès la conception permet de répondre aux objectifs de santé et de sécurité imposés aux MOA pour la construction et la maintenance de l’ouvrage (garde-corps, accès aux façades, aux zones techniques, aux surfaces fragiles…)
David Herthé insiste sur ce point « pour prévenir les chutes dans le BTP, le seul moyen efficace est d’agir en amont avec des priorités ». Comment ? En intégrant, dès l’appel d’offres et dans les pièces écrites de marché (PGCSPS, CCTP, DQE/ DPGF), le recours à des dispositifs mutualisables et utilisables par tous les corps de métier (manutentions hors grue par exemple), l’aménagement et l’entretien de voies d’accès, les accès au bâtiment, aux niveaux supérieurs ou en toiture.
Anticiper les risques diminue la sinistralité, l’absentéisme, les arrêts de chantier et améliore la productivité/performance globale du chantier. Résultats : respect des délais, gain économique, image du chantier et performance.
Les MOA peuvent bénéficier d’un accompagnement (formations, aides financières, conseils…) de la part des caisses régionales de l’Assurance Maladie – Risques professionnels (Carsat, Cramif, CGSS).

Anticiper les risques diminue la sinistralité, l’absentéisme, les arrêts de chantier et améliore la productivité/ performance globale du chantier


0596 66 53 35
prevention972@cgss-martinique.fr
Informations : david.herthe@cgss-martinique.fr
drp.cgss-martinique.fr








Dans vos magasins COTTRELL, il vous sera toujours proposé la solution la plus adaptée à vos projets tout en répondant à vos exigences.




Les entrepreneurs, les artisans du bâtiment et les particuliers, à tous nous garantissons qualité, performance et innovation.
magasins

Les accompagner pas à pas de la construction à l’aménagement.



