KARMIN
Dessin : BLEQUIN Scénario :AYOUB

La BD
SADIK À suivre…
Entretien informel avec le papa de Louison Cresson
Léo Beker continue à rééditer Les tribulations de Louison Cresson : à l’occasion de la ressortie du troisième tome, nous lui avons posé quelques questions sur le pouce.

Dans Le secret du « mister », vous mettiez en scène un ordinateur qui devient autonome : à une heure où on parle beaucoup de l’intelligence artificielle, pensez-vous avoir été visionnaire ?
Non, parce que le thème de l’ordinateur intelligent, ce n’est pas moi qui l’ai inventé : il y en avait déjà bien avant dans la littérature de science-fiction, dans 2001 : L’Odyssée de l’espace, par exemple. J’ai lu beaucoup de S.F. et ça m’a suggéré ce thème qui m’intéressait : comme je n’avais jamais vu quelqu’un essayer de continuer l’œuvre d’un artiste mort, j’ai combiné les deux idées…
Dans Le gros rhûbe, Louison et ses amis découvrent une poubelle venue de l’espace…
Là, ça m’avait été inspiré par un événement qui avait fait du bruit dans les années 1990 : une grande ville, dont je ne citerai pas le nom, avait payé quelqu’un pour la débarrasser de certains de ces déchets. Ce quelqu’un les a mis dans un cargo et les a envoyés dans un pays du tiers-monde. La presse ayant eu écho de la transaction, le pays d’accueil a finalement refusé de laisser décharger le bateau, qui a entrepris un pèlerinage océanique à la recherche de
Interview
nouveaux pays d’accueil. Mais tous refusant de l’accepter, il a dû revenir à la ville expéditrice avec sa puante cargaison…
Dans cet album, après les USA, c’est l’URSS qui en prend pour son grade…
Oui, comme ça, pas de jaloux ! Mais ça reste humoristique, ce n’est pas très virulent !
Le fait que les parents de Louison soient communistes devient important, du coup.
Dans mon esprit, ça l’a toujours été : on ne se rend plus compte de ce que ça représentait dans les années 1950 ! Il fallait impérativement être inscrit au parti communiste pour avoir accès à un logement dans les quartiers HLM de certaines banlieues de Paris, d’après ce que j’ai lu !
On apprend que Louison porte ce prénom parce que son père admire Louison Bobet : vous aussi ?
Pas du tout : au temps de sa gloire, je ne savais même pas que ce coureur cycliste existait ! En revanche, je connaissais Poulidor, celui qui finissait toujours deuxième…

Vous faites subir un triste sort à monsieur Douille en l’envoyant au goulag…
Il est ce qu’il est, mais il ne mérite pas ça tout de même !
Oui bon… Tu verras qu’après, il s’en sort ! Mais c’est vrai que ce n’est pas très romantique…
Propos recueillis en juillet 2023
À l’heure où nous mettons sous presse, Léo Beker est occupé à la refonte du quatrième tome de Louison Cresson : nous y reviendrons en temps voulu
http://louisoncresson.com/
Philosophie
Traduire Platon : quand la traduction dessert la pensée
1ère partie : apories
Tout traducteur le sait : aucune langue n’est le décalque exact d’une autre, chaque langue peut être considérée comme une monade au sens leibnizien du terme dans la mesure où elle constitue une fenêtre ouverte sur le monde qui n’est en aucun cas assimilable à une autre : elle est porteuse d’une vision du monde à part entière qui ne peut en aucun cas être superposée scolairement à une autre, encore moins quand il s’agit de langues issues d’aires culturelles aussi distantes géographiquement et historiquement que la Grèce classique et la France d’aujourd’hui.

Platon
De ce fait, pour restituer dans une autre langue la pensée d’un auteur tout en satisfaisant les exigences d’élégance litté-
raire qui rendent un texte lisible pour tous, la parfaite connaissance de la grammaire et du vocabulaire de la langue ne suffit pas toujours : c’est pourquoi les traductions de Platon éditées dans la collection
Guillaume Budé, parfois considérées comme dignes de faire autorité, ont souvent été menées avec un souci d’élégance littéraire qui prenait le pas sur l’exactitude philologique. Non que les traducteurs aient trahi le texte originel mais, de même que les petits ruisseaux font les grandes rivières, les petites erreurs font les grands malentendus et certaines approximations, a priori minimes, véhiculées par leurs traductions, ont favorisé au sein du public une compréhension galvaudée et inexacte de la pensée platonicienne. De ce fait, non seulement il est vital de se reporter au texte originel et de le retraduire par ses propres
moyens pour vraiment pénétrer dans la pensée de l’auteur mais il faut aussi se libérer, ne serait-ce que momentanément, du complexe de la traduction inélégante : la traduction littérale n’est certes pas une panacée mais elle permet de rendre saillants bien des aspects de Platon que le souci d’élégance littéraire risque de voiler, tant il est vrai que la vérité n’est pas faite que de beauté

Socrate et Xanthippe
Soyons justes : bon nombre de ces approximations s’expliquent par l’impossibilité effective de trouver une expression équivalente en français. Ainsi, dans le Phédon, dialogue demeuré célèbre en tant que récit des derniers instants de Socrate, Platon fait intervenir, pour la seule et unique fois dans toute son œuvre con-
servée, Xanthippe, l’épouse du maître, que Xénophon avait dépeinte comme une insupportable mégère dont la seule fonction auprès de Socrate serait de lui procurer un entraînement à la vie civique (parler de « vie sociale » serait anachronique), donnant ainsi le coup d’envoi d’une longue tradition historico-littéraire :
καὶ ὁ Ἀντισθένης, πῶς οὖν, ἔφη, ὦ Σώκρατες, οὕτω γιγνώσκων οὐ καὶ σὺ παιδεύεις Ξανθίππην, ἀλλὰ χρῇ γυναικὶ τῶν οὐσῶν, οἶμαι δὲ καὶ τῶν γεγενημένων καὶ τῶν ἐσομένων χαλεπωτάτῃ; ὅτι, ἔφη, ὁρῶ καὶ τοὺς ἱππικοὺς βουλομένους γενέσθαι οὐ τοὺς εὐπειθεστάτους ἀλλὰ τοὺς θυμοειδεῖς ἵππους κτωμένους νομίζουσι γάρ, ἂν τοὺς τοιούτους δύνωνται κατέχειν, ῥᾳδίως τοῖς γε ἄλλοις ἵπποις χρήσεσθαι. κἀγὼ δὴ βουλόμενος ἀνθρώποις χρῆσθαι καὶ ὁμιλεῖν ταύτην κέκτημαι, εὖ εἰδὼς ὅτι εἰ ταύτην ὑποίσω, ῥᾳδίως τοῖς γε ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρώποις συνέσομαι καὶ οὗτος μὲν δὴ ὁ λόγος οὐκ ἄπο τοῦ σκοποῦ ἔδοξεν εἰρῆσθαι 1
Platon ne reprend pas à son compte cette représentation très dévalorisante et, osons le dire, quelque peu misogyne : la première impression que nous laisse Xanthippe est celle d’une épouse dévouée qui se laisser aller à une détresse parfaitement compré-
1 Xen. Banquet 2.10 « Antisthène demanda : « Comment donc, Socrate, avec un tel savoir, n’entreprends-tu pas d’éduquer Xanthippe et fréquentes-tu une femme que je crois être la plus insupportable des femmes présentes, passées et à venir ? – Parce que, répondit Socrate, je vois que ceux qui veulent devenir cavaliers ne se procurent pas les chevaux les plus dociles mais des chevaux irascibles. Ils pensent en effet que s’ils sont capables de maîtriser de tels chevaux, il leur sera facile de faire usage des autres. Et bien moi aussi, étant désireux de fréquenter les humains et d’avoir commerce avec eux, j’ai pris cette femme, bien conscient que si je la supportais, il me sera facile de fréquenter tous les autres hommes. » Cette parole ne parut pas hors de propos. » Sauf mention contraire en cas de citation de la traduction des Collection des Universités de France, tous les textes grecs ont été traduits par l’auteur.
hensible en de telles circonstances : ὡς οὖν εἶδεν ἡμᾶς ἡ Ξανθίππη, ἀνηυφήμησέ τε καὶ τοιαῦτ᾽ ἄττα εἶπεν, οἷα δὴ εἰώθασιν αἱ γυναῖκες, ὅτι ‘ὦ Σώκρατες, ὕστατον δή σε προσεροῦσι νῦν οἱ ἐπιτήδειοι καὶ σὺ τούτους.’2 Tout au plus pourrait-on lui reprocher de ne pas se montrer digne de la sérénité affichée par son mari, mais les disciples de Socrate eux-mêmes ne feront guère mieux quand le moment sera venu pour le maître de boire le poison. Cependant, il est intéressant de se concentrer sur le premier mot qu’elle lui lance, tout de suite après avoir prononcé son nom : il s’agit de ὕστατον, forme neutre et donc adverbiale de l’adjectif ὕστατος qui signifie « dernier ». Une traduction littérale donnerait donc « dernièrement », ce qui n’est absolument pas satisfaisant ; dans ce contexte, on aura donc recours à l’expression « pour la dernière fois », mais comment restituer pleinement l’importance rhétorique dont est investi le mot ὕστατον du fait de sa situation en début de citation ? Léon Robin a utilisé cette tournure : « Voici, Socrate, la dernière fois que s’entretiendront avec toi ceux qui te sont attachés, et toi avec eux ! »3 L’usage de « voici » avait de quoi séduire mais, en
2 Plat. Phédon [60a] « Lorsque Xanthippe nous vit, elle poussa des cris de douleur et prononça des paroles habituelles pour les femmes : « Socrate, c’est maintenant la dernière fois que ceux qui te sont proches s’entretiendront avec toi et toi avec eux ! »
3 Traduction de Léon Robin (CUF 1960)
mettant le nom « Socrate » en incise, Robin a fait passer le mot « dernier » de la seconde à la troisième position, ce qui lui fait perdre de son importance. Il est sans doute plus pertinent d’employer une tournure plus directe, en l’occurrence le gallicisme « c’est », ce qui donne « c’est la dernière fois », mais force est d’admettre que le mot « dernier » n'en perd pas moins un peu de sa force, alors que dans la bouche de Xanthippe, le mot ὕστατον venant immédiatement après Σώκρατες rend la citation plus polysémique qu’elle n’y parait : est-ce que Xanthippe ne cherche pas, tout en exprimant son chagrin, à exhorter Socrate à profiter de cette ultime occasion de de disserter en compagnie ses proches voire même à l’inclure, elle, à la conversation, ce qui reviendrait à lui reprocher implicitement de ne pas s’être davantage occupé d’elle durant sa vie ? On se gardera bien de trancher abruptement ces questions, mais le simple fait que de telles hypothèses puissent être émises montre que la phrase attribuée à Xanthippe est loin d’être unidimensionnelle et qu’il est envisageable de reconnaître à l’épouse de Socrate une subtilité d’esprit dont elle a été privée par la tradition
Toujours dans le Phédon, on retrouve cette formule empruntée aux mystères qui pose problème : ὡς ἔν τινι φρουρᾷ
ἐσμεν οἱ ἄνθρωποι καὶ οὐ δεῖ δὴ ἑαυτὸν ἐκ ταύτης λύειν οὐδ᾽
ἀποδιδράσκειν.4 De son propre aveu, c’est faute de mieux que Léon Robin a traduit ϕρουρά par « garderie »5. Même l’expression « poste de garde » est trop faible pour restituer tout le sens du terme grec qui désigne également une prison ; cette polysémie est difficile à restituer et se fait d’ailleurs sentir surtout par la juxtaposition des deux verbes λύειν et ἀποδιδράσκειν, entre lesquels la différence est du même ordre que celle qui existe entre le soldat déserteur et le prisonnier évadé. En affirmant que le corps est une ϕρουρά, Platon affirme qu’il s’agit d’une place que les dieux assignent à l’âme humaine, qu’habiter un corps et l’animer est le rôle assigné à l’âme humaine, rôle qu’elle ne choisit pas et à laquelle elle doit cependant se tenir : difficile de résumer tout ça en un seul mot français…

4 Plat. Phédon. [62b] « C’est dans quelque poste de garde que nous, les hommes, vivons, et il ne faut ni le déserter ni s’en évader. »
5 Traduction de Léon Robin (CUF 1960)
Socrate s’adresse par la suite au personnage éponyme du dialogue en lui expliquant que le but premier de la conversation à laquelle il assiste est moins de sauver l’individu Socrate, qui n’en mérite pas tant, que d’éviter aux interlocuteurs un danger autrement plus menaçant que la mort : ὡς οὐκ ἔστιν, ἔφη, ὅτι ἄν τις μεῖζον τούτου κακὸν πάθοι ἢ λόγους μισήσας. γίγνεται δὲ ἐκ τοῦ αὐτοῦ τρόπου μισολογία τε καὶ μισανθρωπία.6 L’idée est qu’il serait moins grave pour Socrate de disparaître que d’être infidèle à l’enseignement qu’il a dispensé et au parti pris suivant lequel il a mené sa vie. Même à l’heure dernière, le philosophe doit rester ami de la sagesse et son agonie est en quelque sorte l’examen final de son cursus philosophique, celui au cours duquel il doit remporter une ultime victoire sur une menace autre que la mort, la μισολογία, c’est-à-dire, en termes modernes, la haine de la raison. Mais dans cet extrait, c’est le mot λόγος qui pose problème. À l’instar de Léon Robin, nous le traduisons, faute de mieux, par « raisonnement » qui est un terme français plutôt galvaudé pouvant désigner les réflexions d’une personne aménageant son emploi du temps voire les manigances d’un individu préparant un mauvais coup ; il va de soi que dans ce contexte, et dans la bouche de
6 Plat. Phédon [89d] « Il n’est pas de plus grand malheur, dit-il que puisse subir quelqu’un que d’en arriver à haïr les raisonnements. Or misologie et misanthropie naissent de la même façon. »
Socrate

Socrate, λόγος a un sens à la fois plus précis et plus large : plus précis parce qu’il désigne bien évidemment l’investigation philosophique mais aussi plus large parce qu’il recouvre l’ensemble des règles de conduite qui sont attachées à la praxis philosophique et qui en constituent les conditions de possibilité, la première d’entre elles étant la nécessité de mettre à l’écart, dans l& mesure du possible, tout ce qui peut entraver l’exercice dépassionné de l’investigation philosophique. En effet, la philosophie telle que l’envisage Platon ne se limite pas à un savoir théorique et constitue d’abord une technique de recherche de la vérité reposant sur un savoir pratique, une τέχνη à part entière qui s’acquiert par l’apprentissage. Le λόγος n’est donc pas simplement le raisonnement au sens ordinaire du mot, qui est pour ainsi dire accessible à tout être humain mais bien l’attitude
philosophique prise dans son ensemble, à laquelle Socrate s’efforce de rester fidèle et dont il serait tentant de se départir dans le contexte tragique de ce dialogue : d’ailleurs ses disciples, par leurs larmes, ne sont pas loin de se laisser aller à la misologie Il est donc extrêmement difficile de trouver un terme adéquat pour restituer de façon satisfaisante tout ce qu’implique l’usage du terme λόγος, la seule certaine étant que « raisonnement » ne suffit pas.
Plus révélateur encore est cet extrait du Banquet où Agathon traite Socrate d’ὑβριστὴς : ὑβριστὴς εἶ, ἔφη, ὦ Σώκρατες, ὁ Ἀγάθων.7 Léon Robin a traduit cet adjectif par « insolent »8 , ce qui peut se justifier dans ce contexte où le jeune poète tragique victorieux semble se contenter de reprocher à Socrate son refus supposé de faire part de ses découvertes,
7 Plat. Banquet. [175e] « Socrate, tu dépasses la mesure, dit Agathon. »
8 Traduction de Léon Robin (CUF 1970)
Le Banquet, Anselm Feuerbach
mais cette traduction est très en-deçà de la très grave signification que recouvre le terme grec. Dans ὑβριστὴς, on reconnaît bien sûr le mot ὕϐρις qui désigne la pire des fautes dont on puisse accuser un Grec, en l’occurrence ce péché d’orgueil par lequel l’homme tente de franchir les limites de l’humanité pour empiéter sur le domaine réservé des dieux. Même si l’on peut supposer qu’Agathon emploie ici des mots qui dépassent sa pensée (d’autant qu’une tendance à la grandiloquence ne serait pas incompatible avec son statut de poète tragique), il n’empêche que le terme qu’il emploie trahit la méfiance que les Athéniens, peuple politique s’il en est, nourrissent envers la pensée pure sans visée pratique immédiate, étant donné, comme l’explique Francis Wolff, que « la sagesse de l’Athènes du Ve siècle se réalise essentiellement dans l’ordre politique ; la politique, art subtil et empirique, dépen-
dant des circonstances »9. Aussi, en montrant un poète tragique utiliser ce terme à l’intention de Socrate, Platon sous-entend qu’il n’y a pas que les poètes comiques qui ont joué un rôle dans la perte de son maître. Mais à la décharge de Léon Robin, il est vrai qu’il n’y a pas de substantif français vraiment adéquat pour restituer toute la gravité dont le mot ὕϐρις est investi en grec, il manquera toujours une nuance à chaque proposition envisageable – excès, démesure, mégalomanie, etc. Il n’est pas interdit de contourner l’obstacle avec une périphrase telle que « tu dépasses la mesure », mais ça n’a pas la même efficacité. Le dernier exemple d’aporie est d’ordre non plus lexical mais syntaxique : il n’est pas tenu suffisamment compte du fait que le mythe d’Er dans le livre X de la République est relaté par le biais d’une proposition infinitive rapportant au discours indirect les propos de Socrate :
 9 WOLFF Francis, Socrate, p.20-21.
L’Acropole d’Athènes
9 WOLFF Francis, Socrate, p.20-21.
L’Acropole d’Athènes
ἔφη δέ, ἐπειδὴ οὗ ἐκβῆναι, τὴν ψυχὴν πορεύεσθαι μετὰ πολλῶν, καὶ ἀφικνεῖσθαι σφᾶς εἰς τόπον τινὰ δαιμόνιον, ἐν ᾧ τῆς τε γῆς δύ᾽ εἶναι χάσματα ἐχομένω ἀλλήλοιν καὶ τοῦ οὐρανοῦ αὖ ἐν τῷ ἄνω ἄλλα καταντικρύ. δικαστὰς δὲ μεταξὺ τούτων καθῆσθαι, οὕς, ἐπειδὴ διαδικάσειαν, τοὺς μὲν δικαίους κελεύειν πορεύεσθαι τὴν εἰς δεξιάν τε καὶ ἄνω διὰ τοῦ οὐρανοῦ, σημεῖα περιάψαντας τῶν δεδικασμένων ἐν τῷ πρόσθεν, τοὺς δὲ ἀδίκους τὴν εἰς ἀριστεράν τε καὶ κάτω, ἔχοντας καὶ τούτους ἐν τῷ ὄπισθεν σημεῖα πάντων ὧν ἔπραξαν. (…) ὅσα πώποτέ τινα ἠδίκησαν καὶ ὅσους ἕκαστοι, ὑπὲρ ἁπάντων δίκην δεδωκέναι ἐν μέρει, ὑπὲρ ἑκάστου δεκάκις, τοῦτο δ᾽ εἶναι κατὰ ἑκατονταετηρίδα
ἑκάστην, ὡς βίου ὄντος τοσούτου τοῦ ἀνθρωπίνου, ἵνα δεκαπλάσιον τὸ ἔκτεισμα τοῦ ἀδικήματος ἐκτίνοιεν10
Certes, il est impossible de restituer cela au travers d’une traduction française à moins de sacrifier la lisibilité du texte, mais avoir conscience de ce fait d’ordre grammatical nous met en garde contre la tentation de comprendre ce récit au pied de la lettre – l’utilité relative d’une traduction littérale n’excuse pas une compréhension littérale. En effet, lorsque Socrate évoque la durée des châtiments, une lecture littérale ne manquerait pas de disqualifier comme fantaisiste l’idée suivant laquelle
10 Plat. République X. [614b-615b] « Après, dit-il, être sortie, l’âme fut conduite avec beaucoup d’autres et elles arrivèrent ensemble en un lieu divin où il y avait, dans la terre, deux ouvertures contigües l’une à l’autre et, en haut dans le ciel, deux autres se faisant face. Dans leur intervalle siégeaient des juges qui, après avoir prononcé leur sentence, ordonnaient aux justes de se diriger vers la droite en haut dans le ciel, après leur avoir attaché sur le devant un signe du jugement, et aux injustes de se diriger vers la gauche en bas, portant eux aussi à l’arrière un signe de tout ce qu’ils avaient commis. (…) Quel que fût le nombre de fautes qu’elles avaient commises et le nombre de personnes qu’elles avaient lésées, elles expiaient tous leurs forfaits l’un après l’autres, dix fois chacun, et chaque châtiment durait cent ans, comme la vie de l’homme, afin de faire payer chacun des forfaits au décuple. »
cette durée devrait être égale à cent ans et équivaudrait ainsi à celle de la vie humaine ; or l’important n’est pas la donnée quantitative mais la durée qualitative, c’est-à-dire le fait que les actions commises par l’homme déterminent toute sa vie. Un signe qui ne trompe pas est l’absence totale d’arbitraire dans les décisions rendues par les juges infernaux, leurs délibérations sont à peine évoquées, à croire qu’elles n’ont même pas lieu : à rebours des représentations mythiques traditionnelles où les humains condamnés aux supplices éternels, tels Sisyphe et Tantale, sont en fait les victimes (pas tout à fait innocentes, il est vrai) des dieux qui règlent leurs comptes avec les mortels qui les ont défiés, aucun ressentiment personnel, cette fois, n’intervient dans le jugement dont les âmes font l’objet, le jugement est tacitement reconnu comme parfaitement fiable, prononcé suivant une logique implacable, la possibilité d’émettre une réserve à son sujet n’est même pas envisagée ; les juges n’assument à aucun moment la responsabilité du jugement prononcé qui constitue moins le fruit de leur décision que la conséquence logique et nécessaire de la vie menée par les âmes condamnées. En faisant de l’âme la seule et unique responsable de son sort, Platon exclut toute magie de ses mythes eschatologiques qui s’avèrent être les récits de faits non pas à venir mais qui ne cessent de se répéter au
cours d’une vie d’homme et que l’on peut résumer par la formule « on ne récolte que ce qu’on a semé ». Malheureusement, le passage du grec au français contraint à changer la situation d’énonciation et donc
à atténuer la dimension mythique du récit qui se trouve mis sur le même plan qu’une démonstration logique.
À suivre…

Dessins d’actualité

 La mort de Socrate, Jacques-Louis David
La mort de Socrate, Jacques-Louis David
Au lit avec Emma
Je suis au lit avec Emma. Ces sept petits mots n’ont l’air de rien. D’ailleurs, ça n’est rien. Je l’ai mal baisée, j’en ai bien conscience. Je n’avais pas tiré un coup depuis des années, l’inexpérience a joué contre moi. Emma a simulé un semblant d’orgasme pour ne pas me vexer, elle aurait pu s’en passer, je n’avais pas besoin de ça pour être aux anges. Je suis au lit avec Emma qui dort encore, et ça suffit à mon bonheur. Mon bonheur de t’avoir fait payer pour elle et pour moi, pauvre connard.
Tout avait commencé au lycée. Un lycée miteux, dans une banlieue qui n’était même pas assez « difficile » pour que la télé en parle. Il n’y avait pas de voyous, même pas de dealers, rien que l’habituel troupeau de puceaux boutonneux à cheveux gras qui n’en avaient rien à foutre des cours dispensés par des profs dont le salaire de misère n’aurait pas justifié un excès de zèle. Je ne dépareillais pas outre mesure dans le tas, même si j’étais plutôt bon élève. En fait, j’étais même le premier de la classe, mais il y avait si peu de concurrence que je n’avais pour ainsi dire aucun mérite. Et si j’étais studieux à ce point, c’était seulement pour pouvoir quitter le bahut au plus vite. D’ailleurs, on ne me jalousait pas. Pour tout dire, on ne me remarquait même pas : personne n’aurait pu s’intéresser à un gros garçon taciturne et binoclard, coiffé et habillé par Papa-
maman. Surtout pas les filles. Et je le vivais assez bien, en fin de compte.
Ce n’est pas que les filles ne m’intéressaient pas : comme tous les garçons de mon âge, j’avais déjà les hormones qui me travaillaient et je n’aurais pas craché sur le regard d’une petite minette. Surtout Emma, justement. Il faut dire que cette belle blonde sculpturale aux yeux azur se distinguait de la masse des gamines qui gloussaient par paquet de cinq. Mais bon, je ne lui plaisais pas, je ne plaisais pas non plus aux autres demoiselles, je n’en faisais pas une affaire et je vivais avec. Et puis tu es arrivé.
Tu t’étais déjà fait virer de cinq lycées privés. En désespoir de cause, ton PDG de père t’avait inscrit dans notre bahut pourri, pensant que la fréquentation des enfants de peuple te mettrait un peu de plomb dans la cervelle. Alors tu es arrivé, avec ta mobylette rutilante, ton beau cos-
Nouvelle
tard tout blanc hors de prix, tes ray-bans dans tes longs cheveux blonds flottant au vent… Inutile de dire que toutes les pisseuses se sont pâmées à ta vue. Surtout Emma, encore une fois. Tu as voulu d’elle dès le premier regard : tu l’as eue tout de suite. Le plus beau mec avec la plus belle nana : personne n’a contesté, surtout pas moi. Les autres filles n’ont pas cessé de t’idolâtrer pour autant, même si elles avaient bien conscience que c’était grillé pour elles. Mais les garçons n’ont pas été longs à te regarder d’un sale œil, et tu as eu peur que ces fils de pauvres ne s’en prennent à ton cheval mécanique. Alors tu as essayé de te faire aimer aussi des mecs. Mais tu étais un connard. Et que fait un connard quand il veut se faire aimer ? Il se choisit une tête de turc. Et sur qui est-ce tombé ? Ben tiens !
Comme dirait la pub, qui d’autre ? Pas beau, pas fort, premier de la classe, j’étais le bouc émissaire rêvé ! Pendant des mois, j’ai eu droit tous les jours aux savonnettes, aux moqueries, aux affaires volées, aux passages à tabac infligés par une demi-douzaine de tes admirateurs… Bref, à tout l’arsenal des brimades et humiliations que les mâles dominants de cours de récré imposent à leurs victimes officielles. J’ai bien essayé de me plaindre, mais après avoir entendu deux ou trois fois les profs, le surgé et le protal me répliquer que je n’avais qu’à « faire des efforts pour
m’intégrer au groupe », j’ai renoncé. Ces messieurs-dames n’avaient qu’une hâte, celle d’être mutés dans des établissements moins glauques, alors il ne fallait pas trop leur en demander… Au moins, j’avais une raison supplémentaire pour décrocher mon bac du premier coup. Et j’y suis arrivé. Je passe les détails : après quelques années d’études sans grand intérêt, j’ai décroché, sans trop comprendre comment, une place de petit cadre dans une entreprise de province qui vend des trucs dont j’oublie régulièrement la nature. Pour justifier mes émoluments, je fais comme mes collègues, je brasse de l’air dans un open space pendant que le vrai boulot, celui qui rapporte des sous à la boîte, est exécuté par des pauvres types sous-payés qui errent de stages en CDD. Un jour, la patronne a décidé de m’envoyer présenter je ne sais plus quoi au conseil d’administration d’une maison de Paname aussi inutile que la sienne : comme ça tombait un vendredi en fin d’après-midi et que je n’aime pas rouler de nuit, j’ai pris une chambre d’hôtel histoire de m’offrir une virée à la capitale. J’ai fait mon numéro devant les grands pontes de la boîte parisienne, ils semblaient contents, la papesse pourra se vanter d’avoir décroché un nouveau marché de mes propres mains, mais en sortant, j’étais déjà à deux doigts de m’écrouler, lénifié par mon propre discours. Je suis donc entré dans le premier bistrot venu, j’ai comman-
dé un demi à un patron aussi aimable qu’un ours dérangé en pleine hibernation et, tout à coup, j’ai entendu une voix féminine m’appeler par mon prénom. Je me suis retourné : c’était elle.
Emma. Avec quelques années et autant de kilos de plus. Mais qu’est-ce que ça lui va bien ! Si j’étais un poète à deux balles, je dirais bien qu’entre l’Emma lycéenne et l’Emma adulte, il y avait la même différence qu’entre une rose en bouton et une rose épanouie. Mais j’ai beau être un mec à deux balles, je ne suis pas poète pour autant. Ce qui n’a pas eu l’air de rebuter Emma qui avait enfin quelqu’un à qui raconter son malheur. Car elle était malheureuse. Et elle m’a raconté. Entre deux larmes, elle m’a raconté. Sa vie avec toi. De moins en moins avec toi.
Tu avais eu ton bachot d’extrême justesse, après un passage obligé aux oraux de repêchage. Tu ne savais rien faire de tes dix doigts et ton daron avait décidé depuis longtemps que ce serait ta sœur aînée qui hériterait de la boîte. Mais il t’a quand même offert une planque bien payée dans son entreprise, histoire de se débarrasser de toi. Moyennant un salaire à cinq chiffres, tu n’avais qu’à aboyer des ordres au petit personnel et déléguer le plus possible. Une fois ton contrat signé, tu as demandé à Emma de l’épouser : elle a accepté. Le lien de cause à effet coulait de source : version moderne du prince charmant qui emmène
Cendrillon, le tralala habituel qui fait rêver les connasses à bigoudis, mariage luxueux, Rolls blanche, propriété paradisiaque avec une armée de domestiques… On accepte d’abord, on réfléchit après ! Et alors, ça fait mal…
Oui, « l’après » lui a fait mal : tu t’es vite lassée d’elle, tu passais tes nuits dans des boîtes à la mode à embrocher des starlettes anorexiques par paquets de douze dans des piscines de Champagne. Délaissée après moins d’un an de mariage, elle trouvait le réconfort dans les pâtisseries que lui préparait ton cuisinier : sa silhouette s’arrondissait, tu lui reprochais de se laisser aller, tu l’emmenais plus à la piscine et à la plage comme elle l’aimait, tu disais que tu aurais eu honte que les gens voient ta sirène se transformer en lamantin. La vraie raison, c’est que tu n’osais plus montrer ton propre corps : autant Emma n’avait que de petites rondeurs qui lui allaient (et lui vont toujours) à ravir, autant tes tablettes de chocolat avaient fondu en un temps record pour laisser la place à une bedaine pâlichonne aussi appétissante qu’un blanc de dinde industriel… Tu ne roulais plus en mobylette depuis longtemps, tu ne rentrais plus dans ton costume blanc, tes ray-bans ne cachaient même plus tes valoches sous tes yeux de lendemain de fête permanent et, surtout, tu t’es mis à perdre tes cheveux si rapidement qu’Emma s’est demandée un
instant si tu ne portais pas une perruque !
Moi, je n’ai jamais été beau, mais au moins, je n’ai pas changé… Mais Emma ne disait rien. Tu n’avais pas sa décence : tu l’insultais pour un oui ou pour un non, tu lui foutais des marrons quand tu rentrais bourré de tes soirées en compagnie d’autres connards pleins aux as, tu la forçais à se maquiller pour cacher ses ecchymoses quand tu daignais la sortir avec toi dans quelque mondanité idiote où elle jouait son rôle d’épouse modèle… Ado, tu étais un connard : adulte, tu étais devenu un connard cosmique !
J’ai demandé à Emma pourquoi elle ne demandait pas le divorce. Elle ne pouvait pas : tu avais toujours sous la main un bataillon d’avocats prêts à t’éviter cette honte qui aurait inévitablement nui à ta carrière. Et oui, même ton papa-patron, qui s’était fait tout seul, en avait marre de tes caprices et de tes retards au boulot : alors il attendait le premier prétexte pour te donner une leçon, et s’il était porté sur la place publique que son rejeton était un mari infidèle et violent, il ne te l’aurait pas pardonné. Une fois son récit terminé, Emma m’a demandé pardon de ne pas m’avoir défendu quand tu m’emmerdais. Elle n’était pas la première, chaque fois que le hasard me faisait rencontrer un de tes anciens exécuteurs, j’ai eu droit à la même piteuse défense : « je n’avais rien contre toi, j’ai suivi
le mouvement » ! Mais avec Emma, ce n’était pas pareil : elle était si triste (et si belle) que j’ai accepté ses excuses et je lui ai même proposé de l’aider…
Nous avons passé la nuit à échafauder une stratégie : elle connaissait ton emploi de temps, elle savait que tu allais descendre dans un hôtel de luxe marseillais à l’occasion d’un « séminaire » totalement inutile pour la boîte de ton père mais qui te donnait l’occasion de te faire bronzer sur la Côte d’Azur aux frais de la princesse. Mais surtout, Emma en savait assez sur toi pour deviner comment tu allais te conduire tôt ou tard : il suffisait d’être un peu patient. Ma chef a été un peu surprise que je lui demande l’autorisation de prendre mes congés payés en avril, mais au vu de mes bons états de service, elle n’a pas posé de questions. Je ne roulais pas sur l’or, mais j’avais quand même de quoi me payer une chambre à Marseille. Pas dans le même hôtel que toi, bien sûr : même si j’en avais eu les moyens, il ne fallait pas éveiller les soupçons, et puis l’argent qu’Emma m’a confié devait servir exclusivement à graisser la patte au vigile de ton quatre-étoiles phocéen. Ce jeune homme, qui consacrait ses loisirs à l’informatique, ne t’aimait pas. Personne ne t’aimait, ce n’était pas original. Mais ça m’a bien aidé à le convaincre : moyennant un gros billet chaque jour, il cachait une caméra dans ta chambre et promettait de diffuser sur le web la pre-
mière vidéo compromettante. Je n’ai pas ruiné Emma car il n’a pas eu à attendre longtemps ! Tu l’as bien aidé : au bout de cinq jours, la vidéo de tes ébats avec une femme de chambre non consentante était déjà virale…
La suite, tu la connais : tes avocats t’ont évité la prison mais pas le divorce, même le pouvoir de l’argent a ses limites, tu as été condamné à verser une pension alimentaire exorbitante à Emma, quasiment la moitié de ton salaire sérieusement rogné par ton papa-patron, tu as été obligé de te calmer vu qu’on ne t’invite plus nulle part… Emma et moi-même n’avons été soupçonnés de rien, le vigile pas davantage : le scandale médiatique a tout étouffé, tu n’as trouvé aucun défenseur, tes anciens
« amis » étaient trop heureux d’avoir une occasion de te mettre hors-jeu. Il parait que ton autorité sur tes subalternes en a pris un coup, que tu es obligé de mettre la main à la pâte et que plus aucune femme ne veut de toi. Dieu ou ce qui en tient lieu m’en est témoin, je n’ai pas voulu tout ça : t’imposer l’humiliation d’un passage au tribunal et libérer Emma me suffisait. Emma est en train de se réveiller. Je lis déjà dans son œil que je ne la reverrai pas : je l’ai mal baisée, et avec la pension que tu lui verses, elle n’a pas besoin de mon petit salaire. Raison de plus pour savourer ma chance. Ma chance d’avoir pu précipiter ta chute. Ma chance d’avoir vengé tous les losers de la planète. Ma chance d’être au lit avec Emma.
 Dessin d’actualité
Sophie Davant préparant son émission sur les animaux, d’après La femme au perroquet de Courbet
Dessin d’actualité
Sophie Davant préparant son émission sur les animaux, d’après La femme au perroquet de Courbet
« Cavanna avait la générosité de faire éclater au grand jour les qualités d’autrui. »

Virginie Vernay
Virginie Vernay fut la collaboratrice de François Cavanna avec qui elle compila notamment les images de Hara-Kiri parues dans les recueils édités chez Hoëbeke. Cavanna en a fait un personnage littéraire, en l’occurrence la « petite Virginie » de Lune de miel et Crève, Ducon ! : c’est sur la place Maubert, chère au cœur de l’écrivain, non loin des anciens locaux des éditions du Square, qu’elle a accepté d’échanger sur la relation privilégiée qu’elle entretint avec cet auteur à propos duquel elle se révèle intarissable.
Commençons par une question très originale : comment avez-vous connu Cavanna ?
En fait, il a déjà tout raconté dans Lune de miel : j’avais treize ans, j’habitais à Saint-
Étienne quand j’ai découvert ses livres et j’ai eu le sentiment de trouver enfin quelqu’un qui me comprenait. Quelques années plus tard, il était présent à la fête du livre de Saint-Étienne et je suis venue avec
Interview
contemplant Paris au sommet de l’Institut du MondeArabe.
Les Russkoffs pour pouvoir le rencontrer et lui parler. Mais la signature du livre était un prétexte, j’avais tellement de choses à lui dire ! Quand je suis revenue le lendemain, je n’en revenais pas qu’il me reconnaisse ! Puis nous avons entretenu une correspondance, tout en continuant à nous voir chaque année à la fête du livre de Saint-Étienne, et quand je me suis installée à Paris, nous sommes devenus les meilleurs amis du monde. J’ai découvert après que beaucoup de lecteurs ont ressenti la même chose que moi : on a l’impression que c’est un ami quand on le lit ! J’ai eu la chance de faire ce que beaucoup de lecteurs auraient eu envie de faire, lui dire combien il comptait pour eux, combien ils l’aimaient… J’ai eu l’audace de le faire !


Vous parlez d’audace : vous pensez qu’il impressionnait les gens ?
Il impressionnait physiquement : Reiser et Cabu l’ont toujours vouvoyé ! Ses coups de gueule restent légendaires mais c’était un amour d’homme, j’ai rarement connu quelqu’un d’aussi humain que lui. Jamais il ne m’a déçu ! Bien sûr, il avait parfois ses colères, mais il argumentait toujours, ce n’était pas un imprécateur. Il avait une vraie sagesse, mais il ne se posait jamais en maître à penser. Il incarnait ce qu’il disait, ce n’était pas un donneur de leçons. J’aurais presque pu publier son « précis de sagesse », faire un recueil de toutes ces phrases qui sont des modèles de bon sens… Il n’y avait jamais de résignation ou de ressentiment chez lui : il a vécu des choses terribles mais il est toujours allé de l’avant. Même quand il avait conscience des malhonnêtetés dont il était la victime, il trouvait toujours un moyen pour regarder vers l’avant. Il aimait trop la vie pour la
Virginie devant des photos de Reiser et de Cavanna
gaspiller à se plaindre : rien ne valait plus pour lui que d’être vivant, de respirer à plein poumon, d’avoir ses jambes pour marcher… En société, il était le seul à ne pas prendre la parole d’autorité : il ne pérorait jamais et beaucoup de gens sont passés à côté de lui parce qu’ils n’ont pas pris la peine de lui accorder un temps de parole.
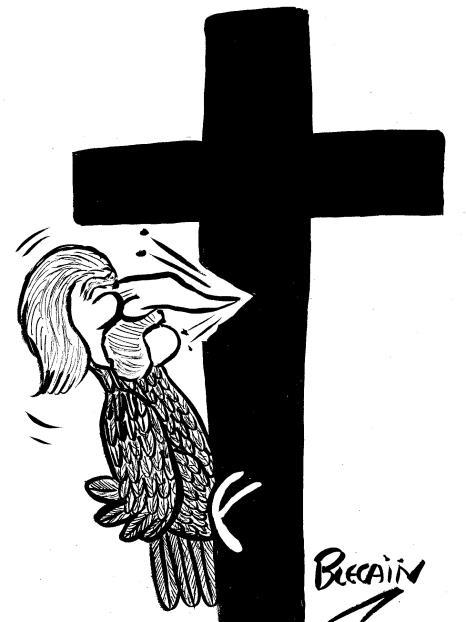
Justement, vous avez réédité Stop-crève : est-ce qu’il a toujours cru à la possibilité d’abolir la mort ?
Alors, pour commencer, ce dont il est question dans Stop-crève, ce n’est pas tant de supprimer la mort : l’idée était de s’attaquer au vieillissement pour que le corps garde sa vitalité. L’édition originale, chez Jean-Jacques Pauvert, recueillait les chroniques sur ce thème récurrent parues entre 1969 et 1973 mais, avec l’éditeur de Wombat, on en a trouvé d’autres sur le même sujet, ce qui nous a permis de faire une deuxième partie avec ses chroniques
plus « tardives », jusqu’en 2013. J’ai aussi retrouvé un biologiste, Lionel Simonneau, qui, à l’époque jeune étudiant, s’était enthousiasmé pour ces théories et l’avait rencontré pour en discuter. Il a accepté de postfacer cette réédition. En fait, Cavanna détestait la vieillesse, c’était pour lui une souffrance permanente : il aimait la marche, le vélo, il nageait, il avait boxé… Il avait donc toutes les raisons de mal vivre le vieillissement du corps ! C’était un sanguin, il prenait la vie par les deux bouts : quand nous nous promenions au Jardin de plantes, devant la beauté d’une fleur, je me bornais à dire qu’elle était belle J’étais dans la « théorie », la contemplation… du blabla. Lui, il y plongeait le visage, la respirait à plein poumon ! Même l’écriture était chez lui une activité très physique, ça se sent jusque dans sa façon d’interpeler ses lecteurs : il n’y a pas de fioritures, il ramenait tout à l’essentiel.

À Brest lors de la journée d’étude « Cavanna sous (presque) toutes les coutures »

Comment en êtes-vous arrivée à travailler avec lui ?
Tout est parti de notre amitié : je travaillais alors dans une petite maison d’édition, je connaissais peu Hara-Kiri, et quand j’ai découvert le « journal bête et méchant » grâce à la collection de Cavanna, j’ai été subjuguée par tant d’inventivité ! J’ai donc proposé à Hoëbeke d’en faire un best of et j’ai commencé à compiler les images. C’est là que ça a commencé et c’était formidable de travailler avec lui : il m’apportait sa rigueur, moi je lui apportais mon œil neuf… On a donc sorti Hara-Kiri, les belles images et on en a vendu 100.000 exemplaires ! On a fait une deuxième compilation, consacrée aux fausses pubs,
puis une troisième et même une quatrième. Travailler avec lui fut un plaisir immense, même s’il ne rigolait pas avec ça : pour lui, quand on travaillait, on travaillait, point. Un moment, alors que nous étions en désaccord, il a haussé le ton. Pas habituée, ça m’a terrorisé, j’étais au bord des larmes. « Mais quoi, on travaille », a-t-il dit, désarçonné par ma réaction ! Ce fut un bonheur de travailler à ses côtés, ça m’a aidé à prendre confiance en moi.

Vous parliez d’inventivité à propos de Hara-Kiri : Cavanna était un découvreur de talents hors pair… Oui, il savait repérer chez un auteur, un dessinateur le « truc » que celui-ci ne voyait pas lui-même : ça demande un œil et une vraie générosité, il ne faut pas être dans l’envie, la jalousie, il faut avoir la
générosité de faire éclater au grand jour les qualités d’autrui.
Pour ceux qui ont lu Lune de miel, vous êtes « la petite Virginie » : qu’est-ce que ça vous a fait ?
Ça m’a touchée immensément. Ça me touche encore aujourd’hui quand je revois Willem et Delfeil de Ton qui m’appellent ainsi. Dix ans après sa mort, c’est tellement émouvant de relire ces pages : la lectrice aime ce personnage ! Même s’il y a quelque chose de schizophrénique pour moi : je pense à ce passage où il écrit un chapitre et où elle attend les pages qu’il lui donne pour qu’elle vive sa vie ! Vertigineux pour moi…
Cavanna nous a quittés il y a bientôt dix ans : comment vivez-vous son absence ?
À sa mort, il a bien fallu que je me reconstruise… Mais j’ai l’impression que la conversation n’a jamais cessé. Il continue de m’accompagner. Il est toujours présent, la solitude que j’ai ressentie à sa mort s’est apaisée. Sur le plan éditorial, il est un peu oublié, ce que je regrette énormément, d’autant qu’il reste d’une actualité brûlante : il était en avance sur bien des sujets, comme la souffrance animale. J’aimerais tellement l’entendre sur tous les débats actuels. J’imagine volontiers les discussions que j’aurais avec lui
Propos recueillis en septembre 2023

Le mot de la fin Non au diktat du sourire !
On me reproche souvent de ne pas être souriant. C’est vrai que ça ne me vient pas spontanément et, quand je suis de mauvaise humeur, je suis incapable de le dissimuler. J’ai envie de vous dire : « Et alors ? » Qu’est-ce que ça peut faire, tant que je ne fais de mal à personne ? Ce n’est pas parce qu’on ne vous sourit pas qu’on vous veut forcément du mal, figurez-vous ! J’ajouterais même « Bien au contraire ! » Avez-vous le sourire radieux qu’affichent les alligators de Floride ? Ils ont l’air sympa, hein ? Sauf que si vous avez le malheur de vous approcher de l’un d’eux, vous pouvez être sûr de vous retrouver avec ses dents plantées dans la jambe dans la seconde qui suit ! Et le fameux sourire des mignons gentils dauphins ? Saviez-vous que c’est, dans la plupart des cas, un signe d’attaque, et que même les professionnels, à ce moment-là, ne s’aventurent pas à faire joujou avec ces sales bêtes qui ont tout ce qu’il faut pour mordre et n’ont pas peur d’agresser l’homme ?
Au sein du genre humain, ce n’est pas beaucoup mieux : que cache le sourire béat du vendeur propre sur lui et bien coiffé qui vous saute dessus au magasin si ce n’est la ferme intention de vous embobiner pour vous faire acheter un bidule qui va vous endetter pour des années ? Que dissimule le sourire niais de l’animateur de télévision bien habillé et tout maquillé qui sait si bien vous distraire après les horreurs du journal télévisé, si ce n’est la volonté affirmée de vendre à Coca-Cola votre « temps de cerveau disponible » ? Que cache le sourire enjôleur du politicien pas fier et pas bêcheur qui écoute vos problèmes et paie sa tournée si ce n’est l’espoir que vous lui offriez un siège de parlementaire qui lui rapportera un max mais sur lequel il ne s’assiéra presque jamais ?
A contrario, l’instituteur qui se bat comme un lion pour faire de vos gosses des citoyens éclai-
rés et les sortir de la triple fange footballsmartphone-consommation dans laquelle le Grand Capital voudrait les laisser croupir, l’infirmière qui lutte au quotidien pour sauver des vies, que ce soit dans nos hôpitaux publics privés de moyens ou sous d’autres latitudes ravagées par la guerre, le bénévole qui se met la rate au court-bouillon pour atténuer les misères humaines, que ce soit sous nos fenêtres ou à l’autre bout du monde, est-ce que vous allez leur reprocher de tirer la tronche de temps en temps, au vu de l’ampleur du combat qu’ils mènent et des moyens dérisoires dont ils disposent ? Pour résumer, vous préférez un malfaiteur souriant ou un bienfaiteur qui fait la gueule ?
«Ah oui, mais quand même, le service rendu avec le sourire, c’est quand même bien agréable », rétorquera la rombière débile qui préfère le sourire de Marine Le Pen à la mine inquiète de Greta Thunberg ! Je n’ai jamais compris en quoi un sourire améliorait un service rendu : quand je vais acheter des timbres à la poste, tout ce que je demande à la guichetière, c’est de faire son boulot et de me vendre les timbres en question, point barre ! Si elle fait la gueule parce que son mec l’a larguée, parce qu’elle a reçu une lettre des huissiers ou parce que son boulot la fait chier, je ne lui en voudrai pas, du moment que j’ai mes timbres ! Et à tout prendre, je préfère qu’elle concentre son énergie sur son boulot au lieu de la gaspiller à composer une mine réjouie qui ne reflète pas la réalité ! Parce que sourire quand on n’en a aucune envie, ça demande un effort, et je préfère qu’elle le fournisse à faire son travail correctement plutôt qu’à afficher un sourire qui risquerait de m’agacer si j’avais moi-même une contrariété quelconque ! Honnêtement, si on vous accueillait à Auschwitz avec le sourire, est-ce que ça vous rendrait le séjour plus agréable ?
 LA GRANDE GUEULE
N°5 : Emmanuel Macron
LA GRANDE GUEULE
N°5 : Emmanuel Macron










 9 WOLFF Francis, Socrate, p.20-21.
L’Acropole d’Athènes
9 WOLFF Francis, Socrate, p.20-21.
L’Acropole d’Athènes


 La mort de Socrate, Jacques-Louis David
La mort de Socrate, Jacques-Louis David
 Dessin d’actualité
Sophie Davant préparant son émission sur les animaux, d’après La femme au perroquet de Courbet
Dessin d’actualité
Sophie Davant préparant son émission sur les animaux, d’après La femme au perroquet de Courbet



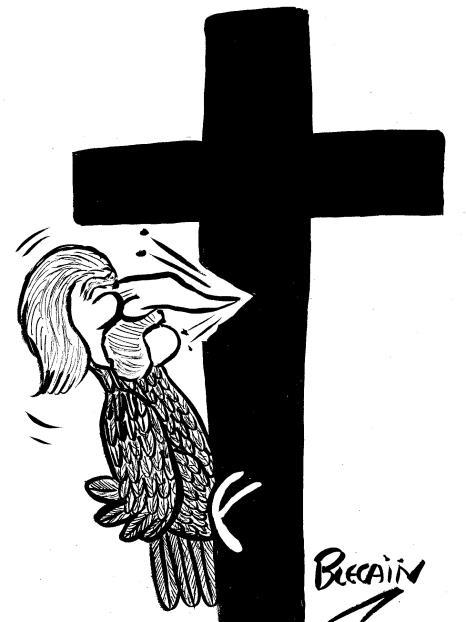




 LA GRANDE GUEULE
N°5 : Emmanuel Macron
LA GRANDE GUEULE
N°5 : Emmanuel Macron